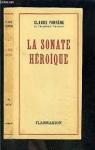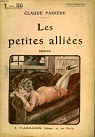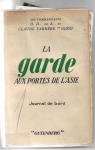Critiques de Claude Farrère (88)
Publié en 1953 aux éditions "André Martel", ce livre est un des derniers romans de Claude Farrère.
Cinquante ans se sont écoulés depuis ses premières nouvelles pleine de fumée d'opium, et depuis le prix goncourt obtenu avec les civilisés.
"Les petites cousines" est un livre dont on ne sait rien en l'abordant.
Par son titre, le fidèle lecteur peut raisonnablement penser ouvrir un de ses livres féministes inspirés de sa relation et de son admiration pour Colette, comme l'a pu être par exemple "Mademoiselle Dax, jeune fille".
Et, puisque comme tout bon vieux broché, l'édition ne possède pas de quatrième de couverture.
Et, qu'au fil de la liste de ses nombreux livres écrits, Claude Farrère semble avoir aimé surprendre ses lecteurs ... le suspens reste entier.
De suspens, il sera en effet question: "Les petites cousines" est un roman policier.
Mais le suspens ne sera pas insoutenable.
Il s'avérera vite n'être que simple curiosité de lecture.
L'on pénètre, ici, dans une famille bourgeoise dont l'auteur dissèque les amours, les haines, les bonheurs, les jalousies, les hypocrisies et les grands élans de générosité.
Les deux cousines sont Marcelle Puesch qui vient d'obtenir le prix Nobel de chimie, et Elisabeth, sa soeur, l'heureuse épouse de Jean Evariste Marmont qui a fait sa fortune dans les ciments et l'acier.
Les deux cousines s'invitent pour l'été aux "Hirondelles" où vivent encore la grand-mère Puesch, et deux de ses autres petites filles agnès et Louise.
Le bonheur de se retrouver n'est qu'un écran de fumée qui cache les vieilles rancoeurs, les jalousies, et d'anciennes rancunes tenaces.
La haine est tapie dans cette maison pleine de souvenirs.
Et le drame, aussi violent qu'un orage d'été, vient fracasser le récit ...
Ce roman s'ouvre sur des accents un peu naïfs, s'annonce comme un peu répétitif.
Les personnages féminins que Farrère à son habitude sait si bien décrire ne sont ici que les silhouettes utiles à l'intrigue.
Claude Farrère peut-être a-t-il trop usé sa plume dans ses autres livres, sur d'autres horizons et dans d'autres rêveries.
L'auteur de ce livre semble plus n'être qu'un vieil écrivain fatigué.
Pourtant la lecture est agréable et, en son milieu, le récit rebondit de manière inattendue.
Et, comme Farrère, même devenu un vieil académicien tranquille, est toujours Farrère, il se permet, dès les premières lignes de dénoncer de vieilles théories surannées encore en cours dans les années 50 :
"les filles n'ont pas besoin d'en apprendre si long. Qu'elles soient capables d'être de bonnes épouses et d'élever proprement leurs enfants, c'est tout ce qu'il faut, avec un peu de catéchisme" ...
"Les petites cousines", au final, est un bon petit roman policier, délicieusement désuet, que l'on peut s'offrir à redécouvrir juste pour le plaisir de sa lecture ...
Cinquante ans se sont écoulés depuis ses premières nouvelles pleine de fumée d'opium, et depuis le prix goncourt obtenu avec les civilisés.
"Les petites cousines" est un livre dont on ne sait rien en l'abordant.
Par son titre, le fidèle lecteur peut raisonnablement penser ouvrir un de ses livres féministes inspirés de sa relation et de son admiration pour Colette, comme l'a pu être par exemple "Mademoiselle Dax, jeune fille".
Et, puisque comme tout bon vieux broché, l'édition ne possède pas de quatrième de couverture.
Et, qu'au fil de la liste de ses nombreux livres écrits, Claude Farrère semble avoir aimé surprendre ses lecteurs ... le suspens reste entier.
De suspens, il sera en effet question: "Les petites cousines" est un roman policier.
Mais le suspens ne sera pas insoutenable.
Il s'avérera vite n'être que simple curiosité de lecture.
L'on pénètre, ici, dans une famille bourgeoise dont l'auteur dissèque les amours, les haines, les bonheurs, les jalousies, les hypocrisies et les grands élans de générosité.
Les deux cousines sont Marcelle Puesch qui vient d'obtenir le prix Nobel de chimie, et Elisabeth, sa soeur, l'heureuse épouse de Jean Evariste Marmont qui a fait sa fortune dans les ciments et l'acier.
Les deux cousines s'invitent pour l'été aux "Hirondelles" où vivent encore la grand-mère Puesch, et deux de ses autres petites filles agnès et Louise.
Le bonheur de se retrouver n'est qu'un écran de fumée qui cache les vieilles rancoeurs, les jalousies, et d'anciennes rancunes tenaces.
La haine est tapie dans cette maison pleine de souvenirs.
Et le drame, aussi violent qu'un orage d'été, vient fracasser le récit ...
Ce roman s'ouvre sur des accents un peu naïfs, s'annonce comme un peu répétitif.
Les personnages féminins que Farrère à son habitude sait si bien décrire ne sont ici que les silhouettes utiles à l'intrigue.
Claude Farrère peut-être a-t-il trop usé sa plume dans ses autres livres, sur d'autres horizons et dans d'autres rêveries.
L'auteur de ce livre semble plus n'être qu'un vieil écrivain fatigué.
Pourtant la lecture est agréable et, en son milieu, le récit rebondit de manière inattendue.
Et, comme Farrère, même devenu un vieil académicien tranquille, est toujours Farrère, il se permet, dès les premières lignes de dénoncer de vieilles théories surannées encore en cours dans les années 50 :
"les filles n'ont pas besoin d'en apprendre si long. Qu'elles soient capables d'être de bonnes épouses et d'élever proprement leurs enfants, c'est tout ce qu'il faut, avec un peu de catéchisme" ...
"Les petites cousines", au final, est un bon petit roman policier, délicieusement désuet, que l'on peut s'offrir à redécouvrir juste pour le plaisir de sa lecture ...
Dès ses premiers mots, ses premières phrases, dès ses premiers temps et contretemps, il semblait que cette sonate héroïque ne dusse pas résonner plus remarquablement que celle que son auteur, en 1950, avait qualifiée de tragique.
Mais la littérature, comme la musique, réserve parfois bien des surprises.
"La sonate héroïque" est un recueil de trois longues nouvelles.
La première, "Amour" est dédié au comte De La Varende, un frère.
La seconde, "le soldat d'Attila" à André Humbert, en admiration.
C'est la troisième, "Amitié", dédiée à l'ami G.J. Jonckbloedt de Juge, qui fait tout le piquant du recueil.
Des deux premiers textes, il y a peu à dire : ils sont écrits honorablement mais sans grand talent déployé.
Il se pourrait même que la plume de Claude Farrère s'y soit ennuyée.
Puis s'annonce le "Rondo con fuoco", une troisième nouvelle, longue d'un peu plus d'une cinquantaine de pages.
L'un a le talent, l'autre le génie.
Présentés, en 1901 ou 1902, dans un de ces salons littéraires qui foisonnaient à Paris en ce temps là, ils se rencontrèrent, pour la première fois, à vingt-cinq ans.
Ils se retrouvèrent, sept ans plus tard, dans une réception très secrète, de grand goût et vaguement ahurissante.
De l'amitié offerte, un baiser donné en publique, un grand amour gâché, Claude Farrère fait le compte de sa relation avec Colette.
Ils ne seront, ici, nommés ni l'un, ni l'autre.
Mais derrière l'art du portrait que possède la plume de Farrère, la silhouette de Colette ne peut se dissimuler.
L'hommage est splendide, c'est celui d'un homme amoureux.
Cette nouvelle, "Amitié", est un petit bijou glissé discrètement dans l'oeuvre dense et riche de Farrère.
Pareil au sentiment qui semble avoir uni ces deux "monstres" de la littérature, elle peine à dire son nom : son titre est un cri de pudeur.
"Tu m'as aimée, je t'ai aimé", écrit Colette dans sa dernière lettre à Farrère, "je te pardonne tout, parce que tu m'as écrit une très belle lettre, une très folle lettre, sans du tout réfléchir que tu es vieux, que je suis vieille, qu'en écrivant une magnifique déclaration tu te couvrais de ridicule, ce qui est très brave, très digne de toi, et même de nous".
Toute leur existence, l'un a eu peur, l'autre a fui.
A l'hiver de leur vie, ils se sont trouvés tout de même.
Et j'ai retenu mon souffle, tout au long des mots qui restent de cet amour perdu ...
Mais la littérature, comme la musique, réserve parfois bien des surprises.
"La sonate héroïque" est un recueil de trois longues nouvelles.
La première, "Amour" est dédié au comte De La Varende, un frère.
La seconde, "le soldat d'Attila" à André Humbert, en admiration.
C'est la troisième, "Amitié", dédiée à l'ami G.J. Jonckbloedt de Juge, qui fait tout le piquant du recueil.
Des deux premiers textes, il y a peu à dire : ils sont écrits honorablement mais sans grand talent déployé.
Il se pourrait même que la plume de Claude Farrère s'y soit ennuyée.
Puis s'annonce le "Rondo con fuoco", une troisième nouvelle, longue d'un peu plus d'une cinquantaine de pages.
L'un a le talent, l'autre le génie.
Présentés, en 1901 ou 1902, dans un de ces salons littéraires qui foisonnaient à Paris en ce temps là, ils se rencontrèrent, pour la première fois, à vingt-cinq ans.
Ils se retrouvèrent, sept ans plus tard, dans une réception très secrète, de grand goût et vaguement ahurissante.
De l'amitié offerte, un baiser donné en publique, un grand amour gâché, Claude Farrère fait le compte de sa relation avec Colette.
Ils ne seront, ici, nommés ni l'un, ni l'autre.
Mais derrière l'art du portrait que possède la plume de Farrère, la silhouette de Colette ne peut se dissimuler.
L'hommage est splendide, c'est celui d'un homme amoureux.
Cette nouvelle, "Amitié", est un petit bijou glissé discrètement dans l'oeuvre dense et riche de Farrère.
Pareil au sentiment qui semble avoir uni ces deux "monstres" de la littérature, elle peine à dire son nom : son titre est un cri de pudeur.
"Tu m'as aimée, je t'ai aimé", écrit Colette dans sa dernière lettre à Farrère, "je te pardonne tout, parce que tu m'as écrit une très belle lettre, une très folle lettre, sans du tout réfléchir que tu es vieux, que je suis vieille, qu'en écrivant une magnifique déclaration tu te couvrais de ridicule, ce qui est très brave, très digne de toi, et même de nous".
Toute leur existence, l'un a eu peur, l'autre a fui.
A l'hiver de leur vie, ils se sont trouvés tout de même.
Et j'ai retenu mon souffle, tout au long des mots qui restent de cet amour perdu ...
Ce roman est un roman toulonnais de Toulon.
C'est une fenêtre ouverte à travers le temps sur la vieille ville maritime et coloniale.
Chaque phrase est accrochée à une de ses ruelles, à un de ses vieux quartiers.
"Les petites alliées" est un roman où, d'après son auteur, la morale n'a pas trouvé sa place.
Claude Farrère dit n'y avoir point gardé ni mesure, ni prudence.
Et il juge son ouvrage malencontreux et malhabile.
Dans une courte préface, il prévient : d'aucune attaque il ne le défendra.
Mais, en 1910, espérant qu'elle daigne l'accepter, il l'a déposé aux pieds de Stratonice !
Célia est une jeune et jolie fille de 24 ans.
Elle est installée depuis six semaines à Toulon où elle a suivi un lieutenant de vaisseau qu'elle avait connu jeune enseigne à Paris.
Le marin, embarqué sur le Bayard, est parti pour deux ans de campagne vers la Chine.
Et la belle, de la galanterie a fait son métier.
Mais un jeune aspirant, Bertrand Peyras, va se frayer un chemin vers son coeur ...
Ce roman est un roman d'atmosphère.
Il est tissé à l'ancienne, sa littérature est soignée mais lente.
Sa lecture aspire parfois à reprendre sa respiration.
Claude Farrère use ici de la langue des "mocos".
"Il exagère des trois-quarts par courtoisie et par juvénile enthousiasme".
Mais l'homme et l'écrivain ont du panache.
Il tient à ne pas imiter le "pudique" Brieux et appeler un chat un chat.
Ce livre est un de ceux qui, ancrés dans leur époque, craignent la foudre des esprits étriqués et bien-pensants.
Il fait l'apologie de l'opium et de l'union libre.
Le coeur du livre, niché dans une seule phrase, bat page 134 :
"Et pourquoi traiteraient-ils une courtisane moins honorablement qu'une femme mariée !"
Ce livre, que l'on a taxé d'immoralité, peut être défendu en étant qualifié de sensible et délicat.
Dès les premières pages, l'on a reconnu, en Célia, la jeune Alice Dax.
Et Comme "Alice Dax jeune fille", "Les petites alliées" est un ouvrage féministe.
C'est un excellent livre.
Et s'il fallait lui trouver un défaut, ormis qu'il soit un peu long, un peu lent, l'on pourrait dire qu'il tord un peu la vérité à sa convenance, qu'il a oublié que la Marine n'a jamais été composée que d'officiers.
Et surtout que son auteur, Claude Farrère, se montre parfois caricatural dans son obsession à n'attribuer le courage, l'intelligence et l'honneur qu'aux "maîtres" du bord !
En 1936, Jean Dréville a fait un film du magnifique roman de Claude Farrère.
Madeleine Renaud y est Célia.
Après avoir refermé la dernière page du livre, une petite séance de cinéma se fait bien tentante ...
C'est une fenêtre ouverte à travers le temps sur la vieille ville maritime et coloniale.
Chaque phrase est accrochée à une de ses ruelles, à un de ses vieux quartiers.
"Les petites alliées" est un roman où, d'après son auteur, la morale n'a pas trouvé sa place.
Claude Farrère dit n'y avoir point gardé ni mesure, ni prudence.
Et il juge son ouvrage malencontreux et malhabile.
Dans une courte préface, il prévient : d'aucune attaque il ne le défendra.
Mais, en 1910, espérant qu'elle daigne l'accepter, il l'a déposé aux pieds de Stratonice !
Célia est une jeune et jolie fille de 24 ans.
Elle est installée depuis six semaines à Toulon où elle a suivi un lieutenant de vaisseau qu'elle avait connu jeune enseigne à Paris.
Le marin, embarqué sur le Bayard, est parti pour deux ans de campagne vers la Chine.
Et la belle, de la galanterie a fait son métier.
Mais un jeune aspirant, Bertrand Peyras, va se frayer un chemin vers son coeur ...
Ce roman est un roman d'atmosphère.
Il est tissé à l'ancienne, sa littérature est soignée mais lente.
Sa lecture aspire parfois à reprendre sa respiration.
Claude Farrère use ici de la langue des "mocos".
"Il exagère des trois-quarts par courtoisie et par juvénile enthousiasme".
Mais l'homme et l'écrivain ont du panache.
Il tient à ne pas imiter le "pudique" Brieux et appeler un chat un chat.
Ce livre est un de ceux qui, ancrés dans leur époque, craignent la foudre des esprits étriqués et bien-pensants.
Il fait l'apologie de l'opium et de l'union libre.
Le coeur du livre, niché dans une seule phrase, bat page 134 :
"Et pourquoi traiteraient-ils une courtisane moins honorablement qu'une femme mariée !"
Ce livre, que l'on a taxé d'immoralité, peut être défendu en étant qualifié de sensible et délicat.
Dès les premières pages, l'on a reconnu, en Célia, la jeune Alice Dax.
Et Comme "Alice Dax jeune fille", "Les petites alliées" est un ouvrage féministe.
C'est un excellent livre.
Et s'il fallait lui trouver un défaut, ormis qu'il soit un peu long, un peu lent, l'on pourrait dire qu'il tord un peu la vérité à sa convenance, qu'il a oublié que la Marine n'a jamais été composée que d'officiers.
Et surtout que son auteur, Claude Farrère, se montre parfois caricatural dans son obsession à n'attribuer le courage, l'intelligence et l'honneur qu'aux "maîtres" du bord !
En 1936, Jean Dréville a fait un film du magnifique roman de Claude Farrère.
Madeleine Renaud y est Célia.
Après avoir refermé la dernière page du livre, une petite séance de cinéma se fait bien tentante ...
Voici donc le dernier roman de Claude Farrère qui, conservé par son ami et secrétaire Alfred Sexer, ne fut publié à la demande de son auteur qu'en 1960, trois ans après sa mort.
Il est préfacé par Pierre Chanlaine, alors président de "l'Association des Ecrivains Combattants" que Farrère avait désigné comme sa légataire universelle.
En 1901, sir Edward et lady Trelawney, venus des terres afghanes des Pathans, parviennent au poste français de Cao-Bang, au Tonkin, tout près de la frontière chinoise.
Juste à temps pour que Lady trelawney y donne le jour à une petite fille à qui, parce qu'elle est née le 5 juin, l'on va donner le prénom de Florence.
Le couple est en fuite et traîne derrière lui un secret dangereux.
La petite fille, pour sa sécurité, est confiée au docteur Colomer avec une lettre cachetée d'un sceau marqué d'armoiries et 20.000 livres sterling ...
Quelques douze ans et cinquante pages plus tard, un drame se prépare sur le quai de Tillsitt, à Lyon ...
Ce dernier livre n'ajoutera rien à l'oeuvre de Claude Farrère.
La plume s'est définitement émoussée.
Claude Farrère se perd ici dans des secrets mondains, médicaux et diplomatiques dont il semble faire grand cas, et mystère, mais qui ont peu de chance d'intéresser le lecteur d'aujourd'hui.
Rien n'est ici imaginé, a prévenu l'auteur, et peut-être, continue-t-il, si j'ai su les aimer assez, les personnages, dont j'ai changé les noms, vont-ils revivre ...
Mais le temps a déposé un voile d'ombre sur une tragédie dont aujourd'hui on ne sait plus rien.
Et le livre de Claude Farrère n'a pas su trouver les mots pour la rendre impérissable.
Ce roman, en substance, ne contient rien de ce qui a fait de Farrère un grand écrivain, de ce qui a mené le jeune officier de marine à L Académie Française.
Les rivages exotiques, les personnages hauts en couleur, les océans, les beaux portraits ont disparu.
Les mots de Farrère qui ont su si souvent passionner, étonner et parfois même irriter ou scandaliser ses lecteurs ne sont plus ici que de petites phrases mondaines dépourvues de style et de force.
Ce roman, moyen s'il eût été d'un autre, parce qu'il est de Farrère est à placer sous la pile de ses nombreux autres ouvrages à redécouvrir ...
Il est préfacé par Pierre Chanlaine, alors président de "l'Association des Ecrivains Combattants" que Farrère avait désigné comme sa légataire universelle.
En 1901, sir Edward et lady Trelawney, venus des terres afghanes des Pathans, parviennent au poste français de Cao-Bang, au Tonkin, tout près de la frontière chinoise.
Juste à temps pour que Lady trelawney y donne le jour à une petite fille à qui, parce qu'elle est née le 5 juin, l'on va donner le prénom de Florence.
Le couple est en fuite et traîne derrière lui un secret dangereux.
La petite fille, pour sa sécurité, est confiée au docteur Colomer avec une lettre cachetée d'un sceau marqué d'armoiries et 20.000 livres sterling ...
Quelques douze ans et cinquante pages plus tard, un drame se prépare sur le quai de Tillsitt, à Lyon ...
Ce dernier livre n'ajoutera rien à l'oeuvre de Claude Farrère.
La plume s'est définitement émoussée.
Claude Farrère se perd ici dans des secrets mondains, médicaux et diplomatiques dont il semble faire grand cas, et mystère, mais qui ont peu de chance d'intéresser le lecteur d'aujourd'hui.
Rien n'est ici imaginé, a prévenu l'auteur, et peut-être, continue-t-il, si j'ai su les aimer assez, les personnages, dont j'ai changé les noms, vont-ils revivre ...
Mais le temps a déposé un voile d'ombre sur une tragédie dont aujourd'hui on ne sait plus rien.
Et le livre de Claude Farrère n'a pas su trouver les mots pour la rendre impérissable.
Ce roman, en substance, ne contient rien de ce qui a fait de Farrère un grand écrivain, de ce qui a mené le jeune officier de marine à L Académie Française.
Les rivages exotiques, les personnages hauts en couleur, les océans, les beaux portraits ont disparu.
Les mots de Farrère qui ont su si souvent passionner, étonner et parfois même irriter ou scandaliser ses lecteurs ne sont plus ici que de petites phrases mondaines dépourvues de style et de force.
Ce roman, moyen s'il eût été d'un autre, parce qu'il est de Farrère est à placer sous la pile de ses nombreux autres ouvrages à redécouvrir ...
En somme, j'aurai passé l'été avec Claude Farrère.
Il m'aura, en l'espace d'une saison, porté sur bien des rivages, raconté de nombreuses histoires fascinantes, présenté quelques-uns des personnages qui comptent dans une vie de lecteur, et introduit dans "le dernier refuge des époques périmées et révolues".
Car ce roman aurait du être le passage où le 19ème siècle finissant vint mourir, et où le 20ème, à peine naissant, s'annonçait déjà.
"Le dernier dieu" se veut un livre romanesque
Aussi j'espérais qu'il me réconcilie avec l'amour.
Malheureusement, j'ai dû inscrire sur la page de garde de mon exemplaire un avertissement afin que plus personne, jamais, ne vienne s'y engluer :
"Il peut passer son chemin, le collectionneur de vieilles tournures, l'amateur de belles phrases qui en serait venu par un hasard fortuit à retrouver ce livre.
L'ayant lu pour lui, je n'y ai ressenti qu'un mortel ennui" ...
Après 800 jours d'une longue attente, Charles Edouard Stuart retrouve la baronne de Spanheim, la femme qu'il aime.
Elle fut son infirmière lorsque les tranchées le recrachèrent, au Chemin des Dames, comme une loque sanglante et pitoyable.
En 1920, elle est une femme mariée dont il devient vite l'amant.
Mais si l'amour n'est pas une fiction, il ne dure pourtant pas toujours ...
Même s'il contient quelques belles descriptions de Paris, ce roman est décevant.
Les personnages sont fades et ne parviennent pas à accrocher l'intérêt.
Le récit, vaguement érotique et licencieux, est lent, linéaire et sans véritable rebondissement.
Il a, je crois, très mal vieilli.
Ce livre n'apporte rien à l'oeuvre de Farrère.
Et, on peut en être sûr, le lecteur d'aujourd'hui n'en tirera aucun plaisir ...
Il m'aura, en l'espace d'une saison, porté sur bien des rivages, raconté de nombreuses histoires fascinantes, présenté quelques-uns des personnages qui comptent dans une vie de lecteur, et introduit dans "le dernier refuge des époques périmées et révolues".
Car ce roman aurait du être le passage où le 19ème siècle finissant vint mourir, et où le 20ème, à peine naissant, s'annonçait déjà.
"Le dernier dieu" se veut un livre romanesque
Aussi j'espérais qu'il me réconcilie avec l'amour.
Malheureusement, j'ai dû inscrire sur la page de garde de mon exemplaire un avertissement afin que plus personne, jamais, ne vienne s'y engluer :
"Il peut passer son chemin, le collectionneur de vieilles tournures, l'amateur de belles phrases qui en serait venu par un hasard fortuit à retrouver ce livre.
L'ayant lu pour lui, je n'y ai ressenti qu'un mortel ennui" ...
Après 800 jours d'une longue attente, Charles Edouard Stuart retrouve la baronne de Spanheim, la femme qu'il aime.
Elle fut son infirmière lorsque les tranchées le recrachèrent, au Chemin des Dames, comme une loque sanglante et pitoyable.
En 1920, elle est une femme mariée dont il devient vite l'amant.
Mais si l'amour n'est pas une fiction, il ne dure pourtant pas toujours ...
Même s'il contient quelques belles descriptions de Paris, ce roman est décevant.
Les personnages sont fades et ne parviennent pas à accrocher l'intérêt.
Le récit, vaguement érotique et licencieux, est lent, linéaire et sans véritable rebondissement.
Il a, je crois, très mal vieilli.
Ce livre n'apporte rien à l'oeuvre de Farrère.
Et, on peut en être sûr, le lecteur d'aujourd'hui n'en tirera aucun plaisir ...
Voilà donc un des deux livres, avec "L'Europe en Asie", qui me valut, un sombre jour de novembre, les foudres d'une muse "babeliote" qui enrageait de me voir défendre, au sortir de leur lecture, quelques-unes des plus belles pages de Claude Farrère.
Elle soupçonnait l'homme, mais aussi l'écrivain qu'il était, de fascisme et de racisme.
Sans être une groupie béate, il m'est arrivé pourtant d'éprouver pour cette plume marine quelque admiration.
Voilà donc un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention et que je "critiquerai" un peu plus longuement qu'à mon accoutumée.
Car si, comme les plaisanteries, les critiques les plus courtes semblent toujours être les meilleures, il faut pourtant savoir parfois aussi prendre le temps de la longueur.
Le décor du "grand drame de l'Asie" est le Japon, un Japon condamné par la Société des Nations pour sa politique impérialiste et ses exactions, un Japon que Claude Farrère retrouve presque 30 ans après avoir écrit, en 1909, son roman "La bataille" dont il fit aussi, en 1921, une superbe pièce de théâtre .
Le contexte du "grand drame de l'Asie" est le climat délétère de 1938 : une guerre déclarée entre la Chine et le Japon, un conflit larvé entre la Russie soviétique et le Japon impérialiste, la montée en puissance du fascisme européen avec au bout du tunnel la tragédie de la seconde guerre mondiale.
Le livre, tout d'abord, est écrit de façon magistral, avec une force qui pourtant n'exclut dans la tournure aucune des finesses dont la plume de Farrère est capable.
Le livre est un bel hommage au Japon, un Japon neuf en surface mais éternel en profondeur.
Débarrassé de ses épines de parti-pris, débroussaillé du fatras dans lequel il s'est enchâssé, élagué de ses branches mortes de vieux principes, le livre finalement s'avère être édifiant et diablement intéressant.
Car ce que dit d'abord ce livre sur son auteur c'est que Farrère, grand admirateur du maréchal Lyautey, est un homme qui a forgé sa personnalité à la fin du XIXème siècle.
C'est un homme d'autrefois, colonialiste et impérialiste, mais qui, affirmant n'avoir aucune estime pour le "teuton" qu'il devine prêt à fondre sur l'Europe, ne peut cependant pas être soupçonné d'être fasciste.
Quand au soupçon de racisme porté à l'encontre de Farrère, il ne tient pas la longueur de quelques lignes, de quelques "Fumées d'opium".
La Chine est ici décrite comme une grande civilisation dont le seule manque est de ne parvenir à fédérer ses différentes nationalités que sous la tyrannie.
La réflexion de l'ouvrage est complexe.
Sa clé se trouve à sa 87ème page.
Le propos est parfois dictée par un anticommunisme violent.
Et c'est bien la Russie du soviet qui est ici la cible du pamphlet.
Car L'homme est de droite.
L'écrivain se paie de toutes les audaces, jusqu'à même se permettre d'égratigner l'immense, l'intouchable Victor Hugo.
"Le grand drame de l'Asie" est un livre intéressant parce qu'il réaffirme une vieille amitié franco-japonaise.
Il est intéressant car il éclaire le contre-jour de l'Histoire, la schizophrénie des grandes démocraties européennes dénonçant le Japon mais pourtant aussi présentes en Chine et ailleurs en Asie.
Mais ce livre ne doit pas faire oublier que derrière le plaidoyer souvent se cache le crime.
Il est à lire sans naïveté.
Il est à réserver au lecteur averti.
Mais il est à lire pour mieux comprendre l'époque dont il provient ...
Elle soupçonnait l'homme, mais aussi l'écrivain qu'il était, de fascisme et de racisme.
Sans être une groupie béate, il m'est arrivé pourtant d'éprouver pour cette plume marine quelque admiration.
Voilà donc un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention et que je "critiquerai" un peu plus longuement qu'à mon accoutumée.
Car si, comme les plaisanteries, les critiques les plus courtes semblent toujours être les meilleures, il faut pourtant savoir parfois aussi prendre le temps de la longueur.
Le décor du "grand drame de l'Asie" est le Japon, un Japon condamné par la Société des Nations pour sa politique impérialiste et ses exactions, un Japon que Claude Farrère retrouve presque 30 ans après avoir écrit, en 1909, son roman "La bataille" dont il fit aussi, en 1921, une superbe pièce de théâtre .
Le contexte du "grand drame de l'Asie" est le climat délétère de 1938 : une guerre déclarée entre la Chine et le Japon, un conflit larvé entre la Russie soviétique et le Japon impérialiste, la montée en puissance du fascisme européen avec au bout du tunnel la tragédie de la seconde guerre mondiale.
Le livre, tout d'abord, est écrit de façon magistral, avec une force qui pourtant n'exclut dans la tournure aucune des finesses dont la plume de Farrère est capable.
Le livre est un bel hommage au Japon, un Japon neuf en surface mais éternel en profondeur.
Débarrassé de ses épines de parti-pris, débroussaillé du fatras dans lequel il s'est enchâssé, élagué de ses branches mortes de vieux principes, le livre finalement s'avère être édifiant et diablement intéressant.
Car ce que dit d'abord ce livre sur son auteur c'est que Farrère, grand admirateur du maréchal Lyautey, est un homme qui a forgé sa personnalité à la fin du XIXème siècle.
C'est un homme d'autrefois, colonialiste et impérialiste, mais qui, affirmant n'avoir aucune estime pour le "teuton" qu'il devine prêt à fondre sur l'Europe, ne peut cependant pas être soupçonné d'être fasciste.
Quand au soupçon de racisme porté à l'encontre de Farrère, il ne tient pas la longueur de quelques lignes, de quelques "Fumées d'opium".
La Chine est ici décrite comme une grande civilisation dont le seule manque est de ne parvenir à fédérer ses différentes nationalités que sous la tyrannie.
La réflexion de l'ouvrage est complexe.
Sa clé se trouve à sa 87ème page.
Le propos est parfois dictée par un anticommunisme violent.
Et c'est bien la Russie du soviet qui est ici la cible du pamphlet.
Car L'homme est de droite.
L'écrivain se paie de toutes les audaces, jusqu'à même se permettre d'égratigner l'immense, l'intouchable Victor Hugo.
"Le grand drame de l'Asie" est un livre intéressant parce qu'il réaffirme une vieille amitié franco-japonaise.
Il est intéressant car il éclaire le contre-jour de l'Histoire, la schizophrénie des grandes démocraties européennes dénonçant le Japon mais pourtant aussi présentes en Chine et ailleurs en Asie.
Mais ce livre ne doit pas faire oublier que derrière le plaidoyer souvent se cache le crime.
Il est à lire sans naïveté.
Il est à réserver au lecteur averti.
Mais il est à lire pour mieux comprendre l'époque dont il provient ...
Il aurait été dommage d'attendre, jusqu'en 2050, le rendez-vous fixé dans sa préface par Bernard Gavoty pour redécouvrir ce petit ouvrage.
Car comme Jules Verne et Pierre Loti, Claude Farrère peut se flatter d'avoir entraîné vers le large bien des lecteurs.
Mon exemplaire, brûlé à demi, sauvé de l'incendie par une main inconnue, est dédicacé avec toute l'affection de l'auteur au docteur Marcel Chaumier.
Je l'ai acheté presque pour rien à un généreux brocanteur ...
"Je suis marin" n'est pas une biographie.
C'est un album souvenir où Claude Farrère évoque son métier.
Frédéric-Charles Bargone, avant de prendre comme nom de plume celui de Claude Farrère, a été marin durant vingt cinq ans.
De 1894 à 1916, il a mis son sac sur un peu plus d'une vingtaine de bâtiments.
Claude Farrère devint marin par vocation mais aussi par hérédité.
Il était l'arrière-petit-fils d'un corsaire célèbre au temps du Consulat.
Il était le fils d'un colonel d'infanterie de marine en retraite ...
"Ce qui importe c'est l'oeuvre, non l'ouvrier" nous dit-il.
Pourtant, si l'on peut admirer l'officier, l'homme de mer.
C'est l'écrivain qui, ici, prend toute son épaisseur.
Les souvenirs, les anecdotes affluent.
La plume est élégante, légère et brillante.
Le ton est badin.
La lecture est agréable.
Mais le récit, lorsque la mer se durcit, sait se faire tragique.
Claude Farrère raconte le naufrage du paquebot "Lamoricière".
Il rend hommage à son commandant, le capitaine Milliasseau, qui ne voulut quitter son bord que le dernier ... qu'il ne voulut pas quitter ... qu'il ne quitta pas.
L'écrivain rend aussi hommage aux fidèles compagnons de mer à qui il dédie ce livre.
Le bonheur de sa carrière, écrit-il, est de n'être tombé, pour ses débuts, que sur des marins de qualité qui étaient en même temps des hommes de sang-froid et des gentilshommes.
Claude Farrère a été marin vingt cinq ans.
Sa vieillesse s'en est trouvée illuminée.
Son livre, "Je suis marin", en est une magnifique et passionnante évocation ...
Paru en 1951
Car comme Jules Verne et Pierre Loti, Claude Farrère peut se flatter d'avoir entraîné vers le large bien des lecteurs.
Mon exemplaire, brûlé à demi, sauvé de l'incendie par une main inconnue, est dédicacé avec toute l'affection de l'auteur au docteur Marcel Chaumier.
Je l'ai acheté presque pour rien à un généreux brocanteur ...
"Je suis marin" n'est pas une biographie.
C'est un album souvenir où Claude Farrère évoque son métier.
Frédéric-Charles Bargone, avant de prendre comme nom de plume celui de Claude Farrère, a été marin durant vingt cinq ans.
De 1894 à 1916, il a mis son sac sur un peu plus d'une vingtaine de bâtiments.
Claude Farrère devint marin par vocation mais aussi par hérédité.
Il était l'arrière-petit-fils d'un corsaire célèbre au temps du Consulat.
Il était le fils d'un colonel d'infanterie de marine en retraite ...
"Ce qui importe c'est l'oeuvre, non l'ouvrier" nous dit-il.
Pourtant, si l'on peut admirer l'officier, l'homme de mer.
C'est l'écrivain qui, ici, prend toute son épaisseur.
Les souvenirs, les anecdotes affluent.
La plume est élégante, légère et brillante.
Le ton est badin.
La lecture est agréable.
Mais le récit, lorsque la mer se durcit, sait se faire tragique.
Claude Farrère raconte le naufrage du paquebot "Lamoricière".
Il rend hommage à son commandant, le capitaine Milliasseau, qui ne voulut quitter son bord que le dernier ... qu'il ne voulut pas quitter ... qu'il ne quitta pas.
L'écrivain rend aussi hommage aux fidèles compagnons de mer à qui il dédie ce livre.
Le bonheur de sa carrière, écrit-il, est de n'être tombé, pour ses débuts, que sur des marins de qualité qui étaient en même temps des hommes de sang-froid et des gentilshommes.
Claude Farrère a été marin vingt cinq ans.
Sa vieillesse s'en est trouvée illuminée.
Son livre, "Je suis marin", en est une magnifique et passionnante évocation ...
Paru en 1951
Voilà un livre qui ressemble à son auteur, dont le fond de la pensée est insaisissable aujourd'hui.
Claude Farrère nous l'assure dans une court prologue en forme de lettre, ce livre est un roman pur, né en 1940, d'une imagination totale afin de ne pas en rétrécir le sujet,.
Pas une de ses intrigues n'est copiée d'après nature.
Il est inventé de la première à la dernière ligne.
Il n'empêche !
Il n'empêche que ce récit m'a fait, à moi, l'impression d'être une petite lucarne ouverte sur l'Histoire.
Sun Chôweï, à quarante ans, est le dictateur d'une Chine mal intelligible aux cerveaux européens, d'une Chine que Farrère a approché en se mêlant de son mieux à l'Asie durant quelques quarante années de sa vie.
Sun Chôweï est un bon général, et un grand homme d'état acharné à la tâche de ressusciter la Chine millénaire.
Ayant acquis le pouvoir, il n'en abuse pas, refusant même d'en user, sauf pour le bien public.
Il projette de se rendre à Pékin rencontrer le maréchal Koung Wenn-Tchoung afin de solliciter son appui et éviter ainsi dans sa politique ambitieuse toute alliance étrangère.
Mais c'est sans compter sur Daria Serguieff, l'espionne russe, et sans deux plénipotentiaires japonais : le colonel Nagaoka Akiza et le secrétaire d'état Atsuda Kyômori ...
Ce roman ne bouscule pas son intrigue.
La phrase y prend le temps d'en préciser le décor.
L'efficacité y cède le pas à l'atmosphère.
On y sent la gêne, le regret de Farrère à voir s'affronter deux pays qu'il aime profondément.
On y perçoit sa haine du communisme soviet, sa haine du nazisme aryen.
Les personnages, même s'ils sont imaginaires, ont la consistance de l'enjeu du drame.
Les femmes y ont un rôle primordial.
Et comme ce livre ressemble à Farrère, on y croise furtivement la silhouette de Loti.
Ce récit est un roman pur, un bon roman de style et de péripétie.
Il n'empêche que durant sa lecture s'impose l'impression d'une arrière-pensée de son auteur.
Mais à travers cette petite lucarne ouverte, le regard porté doit assurément être historien, ou spécialiste, pour en comprendre le sens profond.
Peut-être était-ce nécessaire pour ne pas rétrécir le sujet ...
Claude Farrère nous l'assure dans une court prologue en forme de lettre, ce livre est un roman pur, né en 1940, d'une imagination totale afin de ne pas en rétrécir le sujet,.
Pas une de ses intrigues n'est copiée d'après nature.
Il est inventé de la première à la dernière ligne.
Il n'empêche !
Il n'empêche que ce récit m'a fait, à moi, l'impression d'être une petite lucarne ouverte sur l'Histoire.
Sun Chôweï, à quarante ans, est le dictateur d'une Chine mal intelligible aux cerveaux européens, d'une Chine que Farrère a approché en se mêlant de son mieux à l'Asie durant quelques quarante années de sa vie.
Sun Chôweï est un bon général, et un grand homme d'état acharné à la tâche de ressusciter la Chine millénaire.
Ayant acquis le pouvoir, il n'en abuse pas, refusant même d'en user, sauf pour le bien public.
Il projette de se rendre à Pékin rencontrer le maréchal Koung Wenn-Tchoung afin de solliciter son appui et éviter ainsi dans sa politique ambitieuse toute alliance étrangère.
Mais c'est sans compter sur Daria Serguieff, l'espionne russe, et sans deux plénipotentiaires japonais : le colonel Nagaoka Akiza et le secrétaire d'état Atsuda Kyômori ...
Ce roman ne bouscule pas son intrigue.
La phrase y prend le temps d'en préciser le décor.
L'efficacité y cède le pas à l'atmosphère.
On y sent la gêne, le regret de Farrère à voir s'affronter deux pays qu'il aime profondément.
On y perçoit sa haine du communisme soviet, sa haine du nazisme aryen.
Les personnages, même s'ils sont imaginaires, ont la consistance de l'enjeu du drame.
Les femmes y ont un rôle primordial.
Et comme ce livre ressemble à Farrère, on y croise furtivement la silhouette de Loti.
Ce récit est un roman pur, un bon roman de style et de péripétie.
Il n'empêche que durant sa lecture s'impose l'impression d'une arrière-pensée de son auteur.
Mais à travers cette petite lucarne ouverte, le regard porté doit assurément être historien, ou spécialiste, pour en comprendre le sens profond.
Peut-être était-ce nécessaire pour ne pas rétrécir le sujet ...
"Le choix" est une pièce inédite en trois actes, écrite, en 1921, par Claude Farrère spécialement pour "Les Oeuvres Libres".
Ele n'a été, je crois, jamais représentée.
Quel dommage !
Quel drame poignant en eurent tiré de bons comédiens !
En mai 1915, André est au front.
Il y subit la boue, la pluie, le froid ... et puis, le danger.
Mais il aime, d'un amour fou et partagé, Rosine que ses parents auraient souhaité marier à Fantin-Lagarde, avocat, député, et pour l'heure sous-secrétaire d'état à la guerre.
André n'a ni fortune, ni relations, ni carrière.
Il écrit. Il était journaliste.
Rosine est la fille unique du procureur-général, deuxième magistrat de France.
Elle est belle, intelligente et riche ...
Cette pièce est un drame, un drame de la guerre, de l'amour, un drame des préjugés et de la convenance.
C'est une très belle pièce, restée coincée dans un vieux numéro, le quatrième, des Oeuvres libres.
Elle n'a, je crois, jamais été rééditée.
Quel dommage !
Quel plaisir en eurent tiré de nouveaux lecteurs !
L'action se déroule à Paris.
Le rideau s'ouvre, en mai 1915, sur le décor très modeste d'un bureau d'homme de lettres.
Le deuxième et troisième acte se jouent quelques huit ans plus tard, dans le cabinet du ministre de la Justice, place Vendôme..
André est une sorte de "Colonel Chabert" dont la plume de Farrère se serait emparé, que son imagination aurait recréé et que son style aurait remodelé, que des temps nouveaux aurait modernisé.
La stature des personnages fait éclater la couture étroite de la caricature où un écrivain, s'il eût été moins doué, les aurait enfermés.
La pièce est grave, humaine.
Elle brille, au détour de quelques dialogues, d'un petit reflet de drame antique.
Après "Veille d'armes", écrite en 1917, et "Roxelane", en 1920, "le choix" est la troisième pièce de Claude Farrère.
Et le moindre des compliments que l'on puisse lui faire est de dire que sa plume est, aussi, bien taillée pour le Théâtre ...
Ele n'a été, je crois, jamais représentée.
Quel dommage !
Quel drame poignant en eurent tiré de bons comédiens !
En mai 1915, André est au front.
Il y subit la boue, la pluie, le froid ... et puis, le danger.
Mais il aime, d'un amour fou et partagé, Rosine que ses parents auraient souhaité marier à Fantin-Lagarde, avocat, député, et pour l'heure sous-secrétaire d'état à la guerre.
André n'a ni fortune, ni relations, ni carrière.
Il écrit. Il était journaliste.
Rosine est la fille unique du procureur-général, deuxième magistrat de France.
Elle est belle, intelligente et riche ...
Cette pièce est un drame, un drame de la guerre, de l'amour, un drame des préjugés et de la convenance.
C'est une très belle pièce, restée coincée dans un vieux numéro, le quatrième, des Oeuvres libres.
Elle n'a, je crois, jamais été rééditée.
Quel dommage !
Quel plaisir en eurent tiré de nouveaux lecteurs !
L'action se déroule à Paris.
Le rideau s'ouvre, en mai 1915, sur le décor très modeste d'un bureau d'homme de lettres.
Le deuxième et troisième acte se jouent quelques huit ans plus tard, dans le cabinet du ministre de la Justice, place Vendôme..
André est une sorte de "Colonel Chabert" dont la plume de Farrère se serait emparé, que son imagination aurait recréé et que son style aurait remodelé, que des temps nouveaux aurait modernisé.
La stature des personnages fait éclater la couture étroite de la caricature où un écrivain, s'il eût été moins doué, les aurait enfermés.
La pièce est grave, humaine.
Elle brille, au détour de quelques dialogues, d'un petit reflet de drame antique.
Après "Veille d'armes", écrite en 1917, et "Roxelane", en 1920, "le choix" est la troisième pièce de Claude Farrère.
Et le moindre des compliments que l'on puisse lui faire est de dire que sa plume est, aussi, bien taillée pour le Théâtre ...
En avril 2013, dans son superbe ouvrage "un roman turc de Claude Farrère", Gisèle Durero-Köseoglu dit de "l'homme qui assassina" qu'il est le roman de l'ombre et de l'errance.
Claude Farrère, dans son livre, dit de Constantinople qu'elle est la capitale délicieuse de l'oubli.
Le colonel Renaud de Sévigné a quarante-six ans.
Il est attaché militaire français à Constantinople.
Il y a retrouvé Mehmed Djaleddin qu'il avait autrefois soustrait à un destin funeste en le faisant embarquer* à bord de"la feuille de rose", le bâtiment sur lequel il était alors officier en second.
Le fuyard d'hier est aujourd'hui devenu un homme puissant.
Renaud de Sévigné est une sorte d'espion mondain.
Ses soirées sont accaparées par les dîners et les corvées frivoles.
Mais jusqu'au "five o'clock, il peut longuement, par grandes flâneries fantasques, de la Porte du Sérail aux Murs, et de la Corne d'Or à Marmara, découvrir les beautés secrètes de "Stamboul".
Bientôt le voilà tout féru des turcs et de la Turquie.
Il est guidé dans ses vagabondages par lady Falkland avec laquelle il court, bras dessus bras dessous, les ruelles de la vieille ville.
Il y a ses coins préférés : l'esplanade de Suleïmanié-Djami, la cour cloitrée de la mosquée de Sélim, une arche d’aqueduc, toute habillée de lierre, qui enjambe une minuscule rue, à deux pas du fameux quartier d'Aboul Vefa, une vieille place dallée où se dresse une mosquée décrépite qu'on appelle la mosquée des Tulipes, et le plus adorable des petits cafés turcs, celui de la Mahmoud Pacha Djami, tout enseveli sous d'immenses platanes....
Mais sa compagne d'errance vit un drame, une triste histoire très banale.
Elle est mal mariée.
Elle ne daigne rien reprocher à son mari sinon qu'il la hait et qu'elle le hait.
Elle se moque de son propre sort mais elle est seule à aimer son enfant.
Son mari, par égoïsme et vanité de race, veut, avec l'aide d'une étrangère, lui enlever le dernier objet de son amour par un divorce ignominieux.
Ce drame va glisser inexorablement vers une tragédie...un meurtre sera commis...
Ce roman est un morceau important de notre littérature.
C'est un véritable tableau, une peinture saisissante de la Turquie du début de ce vingtième siècle.
Il est est à la fois très moderne - il montre une Turquie étranglée par l'Europe du fait d'une dette étouffante - et très classique - par son propos et dans sa forme.
Il exalte une Turquie ancienne.
Il fait une description flatteuse mais non complaisante du peuple turc.
Ce grand roman, au style élégant et vivant, a donné naissance à de nombreuses adaptations de tous genres : une pièce de théâtre écrite, en 1913, par Pierre Frondaie, un film, en 1930, avec dans les deux rôles principaux Marie Bell et Jean Angelo, une bande-dessinée, réalisée par rémy Bourlès et publiée de manière posthume en 2003...
Ce roman prouve une fois de plus, s'il en était besoin, que Claude Farrère, malgré qu'il soit un peu oublié, reste une des grandes plumes de notre littérature.
* voir "la sonate à la mer" - dans la première nouvelle "nuit turque, l'an 1322..." - Or, en fin de printemps, il advint, cette année là, à notre aviso "le Vautour" de mouiller, sans qu'on sût pourquoi sur rade de Corfou... -
Claude Farrère, dans son livre, dit de Constantinople qu'elle est la capitale délicieuse de l'oubli.
Le colonel Renaud de Sévigné a quarante-six ans.
Il est attaché militaire français à Constantinople.
Il y a retrouvé Mehmed Djaleddin qu'il avait autrefois soustrait à un destin funeste en le faisant embarquer* à bord de"la feuille de rose", le bâtiment sur lequel il était alors officier en second.
Le fuyard d'hier est aujourd'hui devenu un homme puissant.
Renaud de Sévigné est une sorte d'espion mondain.
Ses soirées sont accaparées par les dîners et les corvées frivoles.
Mais jusqu'au "five o'clock, il peut longuement, par grandes flâneries fantasques, de la Porte du Sérail aux Murs, et de la Corne d'Or à Marmara, découvrir les beautés secrètes de "Stamboul".
Bientôt le voilà tout féru des turcs et de la Turquie.
Il est guidé dans ses vagabondages par lady Falkland avec laquelle il court, bras dessus bras dessous, les ruelles de la vieille ville.
Il y a ses coins préférés : l'esplanade de Suleïmanié-Djami, la cour cloitrée de la mosquée de Sélim, une arche d’aqueduc, toute habillée de lierre, qui enjambe une minuscule rue, à deux pas du fameux quartier d'Aboul Vefa, une vieille place dallée où se dresse une mosquée décrépite qu'on appelle la mosquée des Tulipes, et le plus adorable des petits cafés turcs, celui de la Mahmoud Pacha Djami, tout enseveli sous d'immenses platanes....
Mais sa compagne d'errance vit un drame, une triste histoire très banale.
Elle est mal mariée.
Elle ne daigne rien reprocher à son mari sinon qu'il la hait et qu'elle le hait.
Elle se moque de son propre sort mais elle est seule à aimer son enfant.
Son mari, par égoïsme et vanité de race, veut, avec l'aide d'une étrangère, lui enlever le dernier objet de son amour par un divorce ignominieux.
Ce drame va glisser inexorablement vers une tragédie...un meurtre sera commis...
Ce roman est un morceau important de notre littérature.
C'est un véritable tableau, une peinture saisissante de la Turquie du début de ce vingtième siècle.
Il est est à la fois très moderne - il montre une Turquie étranglée par l'Europe du fait d'une dette étouffante - et très classique - par son propos et dans sa forme.
Il exalte une Turquie ancienne.
Il fait une description flatteuse mais non complaisante du peuple turc.
Ce grand roman, au style élégant et vivant, a donné naissance à de nombreuses adaptations de tous genres : une pièce de théâtre écrite, en 1913, par Pierre Frondaie, un film, en 1930, avec dans les deux rôles principaux Marie Bell et Jean Angelo, une bande-dessinée, réalisée par rémy Bourlès et publiée de manière posthume en 2003...
Ce roman prouve une fois de plus, s'il en était besoin, que Claude Farrère, malgré qu'il soit un peu oublié, reste une des grandes plumes de notre littérature.
* voir "la sonate à la mer" - dans la première nouvelle "nuit turque, l'an 1322..." - Or, en fin de printemps, il advint, cette année là, à notre aviso "le Vautour" de mouiller, sans qu'on sût pourquoi sur rade de Corfou... -
Un première préface d'importance, datée de 1945, suivie d'une seconde antérieurement écrite en 1922 ...
Et voici que s'ouvre le livre de deux marins, le journal de bord d'une grande affaire, d'une bataille navale manquée qui aurait dû tuer la guerre !
La bataille navale de mars 1915 des Dardanelles ...
O. de S., capitaine de corvette X. et Claude Farrère de l'Académie Française, sont tous deux lieutenants de vaisseaux en 1915.
A tous deux également brevetés de canonnage, rien n'est étranger de tout ce qui concerne la mer, les vaisseaux, les canons, les batteries de côte et les explosifs de leur époque.
Le premier a fait la campagne du premier au dernier jour.
Le second, entre Mer Noire et Mer Egée, a servi sur le Vautour commandé par Pierre Loti et a été très mêlé à l'Histoire turque.
Pour les deux, la guerre est un fléau.
En 1915, le premier, O. de S., a rédigé un journal de bord au jour le jour.
En 1922, le second, Claude Farrère, l'a abrégé et annoté.
En 1946, "La garde aux portes de l'Asie" paraît aux éditions "Gutenberg" de Lyon.
C'est un petit traité, un essai d'un peu plus d'une centaine de page.
Sa lecture ne nécessite pas de connaissances historiques spéciales.
Elle est édifiante et éclairante.
Pour Farrère, la bataille navale des Dardanelles ayant été perdue par la flotte franco-anglaise prolongea la guerre d'au moins deux pleines années.
Pour Farrère, d'avance on avait décidé de n'être pas vainqueur !
Plus important que la victoire, selon lui, étaient la volonté anglaise de ne pas livrer le détroit aux russes, et la volonté française de ménager le peuple turc prisonnier d'un régime inféodé à l'Allemagne nazie ...
Très convainquante est cette démonstration écrite à quatre mains.
Assez convaincante, du moins, pour que je me lance sur la toile à la recherche du vrai nom complet du deuxième auteur de ce livre.
Je cherche, je cherche ...
Par ailleurs, on a souvent accusé Claude Farrère de sympathie avec le régime turc allié aux forces de l'Axe, allant jusqu'à le taxer parfois même de fascisme.
Ce livre, et ses deux préfaces en sont autant de dénégations éclatantes.
Est dit, ce qui est à dire.
Est à lire, ce qui doit être lu ...
Et voici que s'ouvre le livre de deux marins, le journal de bord d'une grande affaire, d'une bataille navale manquée qui aurait dû tuer la guerre !
La bataille navale de mars 1915 des Dardanelles ...
O. de S., capitaine de corvette X. et Claude Farrère de l'Académie Française, sont tous deux lieutenants de vaisseaux en 1915.
A tous deux également brevetés de canonnage, rien n'est étranger de tout ce qui concerne la mer, les vaisseaux, les canons, les batteries de côte et les explosifs de leur époque.
Le premier a fait la campagne du premier au dernier jour.
Le second, entre Mer Noire et Mer Egée, a servi sur le Vautour commandé par Pierre Loti et a été très mêlé à l'Histoire turque.
Pour les deux, la guerre est un fléau.
En 1915, le premier, O. de S., a rédigé un journal de bord au jour le jour.
En 1922, le second, Claude Farrère, l'a abrégé et annoté.
En 1946, "La garde aux portes de l'Asie" paraît aux éditions "Gutenberg" de Lyon.
C'est un petit traité, un essai d'un peu plus d'une centaine de page.
Sa lecture ne nécessite pas de connaissances historiques spéciales.
Elle est édifiante et éclairante.
Pour Farrère, la bataille navale des Dardanelles ayant été perdue par la flotte franco-anglaise prolongea la guerre d'au moins deux pleines années.
Pour Farrère, d'avance on avait décidé de n'être pas vainqueur !
Plus important que la victoire, selon lui, étaient la volonté anglaise de ne pas livrer le détroit aux russes, et la volonté française de ménager le peuple turc prisonnier d'un régime inféodé à l'Allemagne nazie ...
Très convainquante est cette démonstration écrite à quatre mains.
Assez convaincante, du moins, pour que je me lance sur la toile à la recherche du vrai nom complet du deuxième auteur de ce livre.
Je cherche, je cherche ...
Par ailleurs, on a souvent accusé Claude Farrère de sympathie avec le régime turc allié aux forces de l'Axe, allant jusqu'à le taxer parfois même de fascisme.
Ce livre, et ses deux préfaces en sont autant de dénégations éclatantes.
Est dit, ce qui est à dire.
Est à lire, ce qui doit être lu ...
Claude Farrère aimait la Turquie.
Dans nombre de ses romans et de ses essais, il a, avec plus ou moins de bonheur, exposé et expliqué ce sentiment.
Ce qui, parfois mal compris dans une époque troublée, ne lui a pas valu, en son temps, que des compliments.
Il a longuement décrit dans son oeuvre la Chine, le Japon et la Turquie.
Une grande partie de son inspiration lui venait de la mer, et de l'Orient.
Claude Farrère, officier de marine, écrivain de l'Académie Française, était un admirateur de Pierre Loti auprès duquel il avait servi sur le contre-torpilleur "Vautour".
"Les quatre dames de l'Angora" est un roman dont un des personnages est la Turquie, la Turquie d'hier, d'avant-hier même.
Luc Saint-Gemme, le romancier dont la qualité de pensée le confond lui-même parfois, est à bord de l'express d'Anatolie qui relie Stamboul à Angora.
Il va y rencontrer le prestigieux docteur François Villandry, appelé à Angora pour y opérer une ancienne infirmière à lui ... Lalé Hanoum, madame Moukhtar Pacha, si vous préférez ...
J'ai eu du mal à m'enfoncer dans ce récit.
Ce livre est un bon livre, mais qui a vieilli, trop vieilli.
Le temps y pèse sur les mots, trop.
Et, le romantisme qu'il contient semble aujourd'hui bien ampoulé, bien désuet.
Aborder l'oeuvre du "grand" Farrère par "Les quatre dames d'Angora" serait, aujourd'hui, lui faire injustice.
Car il n'y souffle pas le tourbillon de finesse et de force contenu dans bien de ces livres ...
Dans nombre de ses romans et de ses essais, il a, avec plus ou moins de bonheur, exposé et expliqué ce sentiment.
Ce qui, parfois mal compris dans une époque troublée, ne lui a pas valu, en son temps, que des compliments.
Il a longuement décrit dans son oeuvre la Chine, le Japon et la Turquie.
Une grande partie de son inspiration lui venait de la mer, et de l'Orient.
Claude Farrère, officier de marine, écrivain de l'Académie Française, était un admirateur de Pierre Loti auprès duquel il avait servi sur le contre-torpilleur "Vautour".
"Les quatre dames de l'Angora" est un roman dont un des personnages est la Turquie, la Turquie d'hier, d'avant-hier même.
Luc Saint-Gemme, le romancier dont la qualité de pensée le confond lui-même parfois, est à bord de l'express d'Anatolie qui relie Stamboul à Angora.
Il va y rencontrer le prestigieux docteur François Villandry, appelé à Angora pour y opérer une ancienne infirmière à lui ... Lalé Hanoum, madame Moukhtar Pacha, si vous préférez ...
J'ai eu du mal à m'enfoncer dans ce récit.
Ce livre est un bon livre, mais qui a vieilli, trop vieilli.
Le temps y pèse sur les mots, trop.
Et, le romantisme qu'il contient semble aujourd'hui bien ampoulé, bien désuet.
Aborder l'oeuvre du "grand" Farrère par "Les quatre dames d'Angora" serait, aujourd'hui, lui faire injustice.
Car il n'y souffle pas le tourbillon de finesse et de force contenu dans bien de ces livres ...
Une fois de plus, ici, Claude Farrère projette sa plume là où on ne l'attend pas et réserve une belle surprise à son lecteur.
"Le traître" est une dense et riche uchronie.
La France de 1940 avait, malgré l'appel lancé de Londres par le général de Gaulle, suivi le maréchal Pétain lorsqu'il abandonna la lutte et renia la parole donnée à l'Angleterre.
Un demi-siècle plus tard, le Royaume-Unis, en 20.., a suivi sir Austin Gatterwood, lorsqu'il signa l'armistice de Birmingham, conclu et subi avec le dictateur de l'Union Soviétique ...
Le récit plonge, tout d'abord, dans une Angleterre ruinée par la guerre et l'occupation de 500.000 soldats rouges.
Cependant l'anticipation, pour le lecteur, laisse la place à l'imagination.
Elle ne contient ni descriptions, ni paysages, et très peu de contexte.
Le récit n'est solidement basé que sur des arcanes politiques.
Les personnages, seuls, semblent retenir l'attention de Claude Farrère :
Tout d'abord, Sir James Garnwall, amiral de la flotte, et vice protecteur de l'Angleterre, qui est l'homme dont la postérité se souviendra peut-être comme "le traître"...
Sa jeune épouse, lady Lucy Garnwall ...
Walter Raleigh, son secrétaire privé ...
Son jeune fils de vingt ans, Réginald, réfugié au Japon, puis en Chine et ignoré des russes ...
Mais le splendide personnage central du récit est celui d'une femme, une chinoise, la Fou Ta Jenn A-Lann, comme elle aime à se nommer elle-même.
Ce roman, paru en 1952, est issu de la guerre froide.
Il est teinté de philosophie et d'espionnage.
Et il a comme une vague résonnance de tragédie antique.
C'est le roman d'un voyageur qui connaît les peuples.
Claude Farrère affiche ici une grande estime pour la Chine qui, dit-il, est la première nation du monde, et laisse filtrer dans ses propos un mépris amusé pour les Etats-Unis.
Le roman est divisé en trois parties de longueurs inégales :
"Edimbourg", "Pékin" et "Libération".
On y retrouve le style qui a fait de Farrère un grand écrivain.
Ce livre, certainement, possède plusieurs niveaux de lecture.
Il peut être perçu comme un plaidoyer pour le vieux maréchal français que l'Histoire a marqué comme traître à sa nation.
Mais aussi, dans le même temps, comme une condamnation du même maréchal pour ne pas avoir repris le combat lorsque l'heure en était venue.
L'honneur, dont il peint sir James Garnwall, devait en passer par là.
Ce roman est politique, et très humain.
Claude Farrère condamne le communisme soviet, qui selon lui aggrave, plus encore que le capitalisme, les inégalités entre les hommes.
Cependant le mercantilisme de la nation américaine ne trouve pas non plus grâce à ses yeux.
Son regard est tourné vers la Nation Centrale, cette Chine qui pour lui est un pays qui compte ...
"Le traître" est une dense et riche uchronie.
La France de 1940 avait, malgré l'appel lancé de Londres par le général de Gaulle, suivi le maréchal Pétain lorsqu'il abandonna la lutte et renia la parole donnée à l'Angleterre.
Un demi-siècle plus tard, le Royaume-Unis, en 20.., a suivi sir Austin Gatterwood, lorsqu'il signa l'armistice de Birmingham, conclu et subi avec le dictateur de l'Union Soviétique ...
Le récit plonge, tout d'abord, dans une Angleterre ruinée par la guerre et l'occupation de 500.000 soldats rouges.
Cependant l'anticipation, pour le lecteur, laisse la place à l'imagination.
Elle ne contient ni descriptions, ni paysages, et très peu de contexte.
Le récit n'est solidement basé que sur des arcanes politiques.
Les personnages, seuls, semblent retenir l'attention de Claude Farrère :
Tout d'abord, Sir James Garnwall, amiral de la flotte, et vice protecteur de l'Angleterre, qui est l'homme dont la postérité se souviendra peut-être comme "le traître"...
Sa jeune épouse, lady Lucy Garnwall ...
Walter Raleigh, son secrétaire privé ...
Son jeune fils de vingt ans, Réginald, réfugié au Japon, puis en Chine et ignoré des russes ...
Mais le splendide personnage central du récit est celui d'une femme, une chinoise, la Fou Ta Jenn A-Lann, comme elle aime à se nommer elle-même.
Ce roman, paru en 1952, est issu de la guerre froide.
Il est teinté de philosophie et d'espionnage.
Et il a comme une vague résonnance de tragédie antique.
C'est le roman d'un voyageur qui connaît les peuples.
Claude Farrère affiche ici une grande estime pour la Chine qui, dit-il, est la première nation du monde, et laisse filtrer dans ses propos un mépris amusé pour les Etats-Unis.
Le roman est divisé en trois parties de longueurs inégales :
"Edimbourg", "Pékin" et "Libération".
On y retrouve le style qui a fait de Farrère un grand écrivain.
Ce livre, certainement, possède plusieurs niveaux de lecture.
Il peut être perçu comme un plaidoyer pour le vieux maréchal français que l'Histoire a marqué comme traître à sa nation.
Mais aussi, dans le même temps, comme une condamnation du même maréchal pour ne pas avoir repris le combat lorsque l'heure en était venue.
L'honneur, dont il peint sir James Garnwall, devait en passer par là.
Ce roman est politique, et très humain.
Claude Farrère condamne le communisme soviet, qui selon lui aggrave, plus encore que le capitalisme, les inégalités entre les hommes.
Cependant le mercantilisme de la nation américaine ne trouve pas non plus grâce à ses yeux.
Son regard est tourné vers la Nation Centrale, cette Chine qui pour lui est un pays qui compte ...
Jean-Jérôme Haricotelle devint-il très jeune mathématicien, ou plutôt l'était-il de naissance ?
Quoi qu'il en soit, seul de sa race, il voyait les quantités imaginaires !
Les quantités imaginaires, beaucoup de gens l'ignorent, sont un des plus ardus mystères de la mathématique dite spéciale.
Jean-Jérôme Haricotelle, donc, voyait dans l'inconnu mathématique !
Marcel Aymé nous l'eût-il présenté qu'on l'eût pris aussitôt pour une fantaisie de plus du célèbre franc-comtois.
Mais ce livre, paru en 1938, est signé de Claude Farrère, Claude Farrère, qui fut, entre autres petites choses, un illustre officier de marine, un homme de droite convaincu, le lauréat du prix Goncourt en 1905 et un membre prestigieux de l'Académie Française.
Parce qu'il affirme qu'Haricotelle a bien existé, un tel homme peut-il être soupçonné d'excentricité ?
Aucun romancier, jamais, n'eût pu inventer une histoire pareille !
Il aurait fallu des volumes entiers pour raconter tant et tant d'aventures qui se sont déposées aux pieds d'Haricotelle durant toutes ces années où il parcourut le globe, d'abord comme officier de Marine, puis comme ingénieur des Ponts et Chaussées.
"Les imaginaires" sont donc un résumé.
Mais elles sont d'abord et surtout un bon livre où la fiction dépasse la fiction.
Le livre est drôle.
Mais il n'est pas fait de ces humours gras ou joviaux qui amènent un gros rire.
Il est tissé d'humour, de finesse et d'intelligence.
Claude Farrère parfois y égratigne pourtant un peu la politique, l'état-major de la Marine et quelques autres de ses bons amis.
Mais il le fait sans qu'il n'y ait rien à y redire, sans qu'il ne s'abîme en aucune manière, ni lui, ni son livre.
Sa plume virevolte avec style et s'embarque vers des destinations exotiques dont il n'est dit que le nécessaire.
Claude Farrère a pris le parti de ne vider son encrier que pour révéler son personnage, de ne faire de ce livre que le portrait d'un surdoué égocentrique perdu dans notre monde.
Le livre a peu vieilli, seul le papier a un peu jauni.
Et sa lecture, rapide et agréable, est toujours, aujourd'hui, un véritable plaisir ...
Quoi qu'il en soit, seul de sa race, il voyait les quantités imaginaires !
Les quantités imaginaires, beaucoup de gens l'ignorent, sont un des plus ardus mystères de la mathématique dite spéciale.
Jean-Jérôme Haricotelle, donc, voyait dans l'inconnu mathématique !
Marcel Aymé nous l'eût-il présenté qu'on l'eût pris aussitôt pour une fantaisie de plus du célèbre franc-comtois.
Mais ce livre, paru en 1938, est signé de Claude Farrère, Claude Farrère, qui fut, entre autres petites choses, un illustre officier de marine, un homme de droite convaincu, le lauréat du prix Goncourt en 1905 et un membre prestigieux de l'Académie Française.
Parce qu'il affirme qu'Haricotelle a bien existé, un tel homme peut-il être soupçonné d'excentricité ?
Aucun romancier, jamais, n'eût pu inventer une histoire pareille !
Il aurait fallu des volumes entiers pour raconter tant et tant d'aventures qui se sont déposées aux pieds d'Haricotelle durant toutes ces années où il parcourut le globe, d'abord comme officier de Marine, puis comme ingénieur des Ponts et Chaussées.
"Les imaginaires" sont donc un résumé.
Mais elles sont d'abord et surtout un bon livre où la fiction dépasse la fiction.
Le livre est drôle.
Mais il n'est pas fait de ces humours gras ou joviaux qui amènent un gros rire.
Il est tissé d'humour, de finesse et d'intelligence.
Claude Farrère parfois y égratigne pourtant un peu la politique, l'état-major de la Marine et quelques autres de ses bons amis.
Mais il le fait sans qu'il n'y ait rien à y redire, sans qu'il ne s'abîme en aucune manière, ni lui, ni son livre.
Sa plume virevolte avec style et s'embarque vers des destinations exotiques dont il n'est dit que le nécessaire.
Claude Farrère a pris le parti de ne vider son encrier que pour révéler son personnage, de ne faire de ce livre que le portrait d'un surdoué égocentrique perdu dans notre monde.
Le livre a peu vieilli, seul le papier a un peu jauni.
Et sa lecture, rapide et agréable, est toujours, aujourd'hui, un véritable plaisir ...
Quand il est temps de reprendre la mer, d'embarquer à nouveau, le mieux n'est-il pas de choisir son équipage, le nom de son bâtiment, ses officiers et l'ouvrage que l'on va glisser dans son sac ?
Ce livre ne s'ouvre pas sur une préface ennuyeuse, mais sur une introduction protocolaire afin de mieux présenter les "dix-sept histoires de marins" qui s'y trouvent.
Elles sont, au dire même de leur auteur, hétéroclites, mal assorties pour être ensemble contenues dans un volume dont le fil est tendu par un point commun, celui de parler des hommes qui vivent sur la mer et des femmes qui les aiment ...
L'ouvrage s'ouvre, en 1894, un jour de pluie, sur la fin d'une escale à Brest et se referme sur la mort tragique, pathétique et courageuse d'un jeune enseigne de vaisseau, piégé avec ses hommes dans sa tourelle par une charge qui s'était enflammée toute seule.
Entre les deux, Claude Farrère égrène, durant quelques 300 pages, un ensemble de souvenirs personnels, d'histoires entendues et de récits imaginés ...
Entre les deux, Fargue, le lieutenant de vaisseau canonnier, qui se repose des bombardements en traduisant Confucius, monte au quart et s'invite au rendez-vous galant qu'il a avec la vie ...
Au risque d'une fois encore me faire savonner, je vais écrire que la littérature de Claude Farrère est, ici, fine élégante et généreuse.
Mais que sa sensibilité ne lui enlève rien de la force dont elle empreinte.
Le recueil est articulé en quatre parties :
"leurs amies, grandes et petites", "ceux du gaillard d'avant", "ceux de la grand'chambre" et "service commandé".
Il se referme sur "comment ils meurent", le récit d'un tragique exercice de tir ...
"la double méprise de Loreley Loredana" :
Une jeune, belle et chaste chanteuse d'opéra comique est persuadée que l'enseigne de vaisseau Marcy, qu'elle aime, a fait naufrage sur "l'Ardèche" en sortant de Brest ...
"Idylle en masque" :
Un jeune enseigne de vaisseau a posé dans la rubrique "mariage" du journal une annonce afin de trouver l'ame soeur ...
"la capitane" :
Quel ne fut pas la surprise du capitaine Soria, embarqué sur "la Cérès" à la poursuite du brigantin pirate "le Corbeau" de découvrir, cachée dans la chambre de son capitaine, une belle et jeune dame, richement ajustée ...
"Perdu corps et biens" :
Une histoire de contrebande d'armes et de diplomatie ...
"L'invraisemblable ratière" :
Une bonne histoire, de celles qui se racontent la nuit à la passerelle et qui aurait pu s'intituler "la double, le rat et le commis" ...
"108 Le Duc, ambassadeur" :
Un matelot de 2ème classe du croiseur "la Pensée" est chargé, par son lieutenant de vaisseau, de porter, rue Parallèle à Smyrne, une lettre à Mme Erizan, la femme du riche armateur ...
"La crapule" :
464, le matelot Tiphaigne est incontestablement la plus sale bête du bord pourtant le lieutenant de vaisseau Fargue va, presque jusqu'à outrance, faire preuve d'indulgence ...
"La baleinière deux" :
304, Kerrec, matelot de 1ère classe, gabier breveté, est le patron de la baleinière deux sur le "Ça -Ira", au large de la côte marocaine ...
"La royale charité" :
Là où l'auteur en vint à pleurer d'un chagrin d'amour en montant au quart à la passerelle ...
"L'amoureuse transie" :
En 1904, à Fort de France en Martinique, l'horreur s'invite au rendez-vous galant ...
"Histoire de mannequin" :
Après l'horreur, place à la délicatesse. Le lieutenant de vaisseau Fargue, sur le contre-torpilleur "Ça-Ira", en rade de Mogador, s'offre 15 sous de galanterie ...
"Naissance de vaisseau" :
Aux Forges et Chantiers de la Méditerranée, à la Seyne, faubourg de Toulon, une cale attend de livrer un cuirassé de bataille, le le croiseur "le Paris" ...
"L'ex-voto de l'Acropole" :
C'est par un bijou, glissé, en guise d'offrande, dans la main d'une statue rendue jadis immortelle par un dieu reconnaissant, qu'Hartus obtint l'amour de tous les êtres que son désir effleurera ...
"La tourelle"
Le lieutenant de vaisseau Fargue fait le tour du propriétaire de sa tourelle double de 305 mm, l'arme la plus effroyable du cuirassé, sa meilleure chance de sortir vainqueur des batailles à venir ...
"Dix secondes" :
Dans le port de Safi, au Maroc, il n'y a, pour l'enseigne de vaisseau Olivier de Serres, que dix secondes pour choisir entre la guerre ou la paix ...
"Fontenoy" :
Le 25 septembre 1911, le cuirassé "Nation", ayant à son bord des poudres B brevetées avec garantie du gouvernement, explosa ...
"Comment ils meurent" :
Jean Scherrer, jeune enseigne de vaisseau, est pris au piège, avec ses hommes, dans sa tourelle, par l'explosion de ses munitions ...
Ce livre ne s'ouvre pas sur une préface ennuyeuse, mais sur une introduction protocolaire afin de mieux présenter les "dix-sept histoires de marins" qui s'y trouvent.
Elles sont, au dire même de leur auteur, hétéroclites, mal assorties pour être ensemble contenues dans un volume dont le fil est tendu par un point commun, celui de parler des hommes qui vivent sur la mer et des femmes qui les aiment ...
L'ouvrage s'ouvre, en 1894, un jour de pluie, sur la fin d'une escale à Brest et se referme sur la mort tragique, pathétique et courageuse d'un jeune enseigne de vaisseau, piégé avec ses hommes dans sa tourelle par une charge qui s'était enflammée toute seule.
Entre les deux, Claude Farrère égrène, durant quelques 300 pages, un ensemble de souvenirs personnels, d'histoires entendues et de récits imaginés ...
Entre les deux, Fargue, le lieutenant de vaisseau canonnier, qui se repose des bombardements en traduisant Confucius, monte au quart et s'invite au rendez-vous galant qu'il a avec la vie ...
Au risque d'une fois encore me faire savonner, je vais écrire que la littérature de Claude Farrère est, ici, fine élégante et généreuse.
Mais que sa sensibilité ne lui enlève rien de la force dont elle empreinte.
Le recueil est articulé en quatre parties :
"leurs amies, grandes et petites", "ceux du gaillard d'avant", "ceux de la grand'chambre" et "service commandé".
Il se referme sur "comment ils meurent", le récit d'un tragique exercice de tir ...
"la double méprise de Loreley Loredana" :
Une jeune, belle et chaste chanteuse d'opéra comique est persuadée que l'enseigne de vaisseau Marcy, qu'elle aime, a fait naufrage sur "l'Ardèche" en sortant de Brest ...
"Idylle en masque" :
Un jeune enseigne de vaisseau a posé dans la rubrique "mariage" du journal une annonce afin de trouver l'ame soeur ...
"la capitane" :
Quel ne fut pas la surprise du capitaine Soria, embarqué sur "la Cérès" à la poursuite du brigantin pirate "le Corbeau" de découvrir, cachée dans la chambre de son capitaine, une belle et jeune dame, richement ajustée ...
"Perdu corps et biens" :
Une histoire de contrebande d'armes et de diplomatie ...
"L'invraisemblable ratière" :
Une bonne histoire, de celles qui se racontent la nuit à la passerelle et qui aurait pu s'intituler "la double, le rat et le commis" ...
"108 Le Duc, ambassadeur" :
Un matelot de 2ème classe du croiseur "la Pensée" est chargé, par son lieutenant de vaisseau, de porter, rue Parallèle à Smyrne, une lettre à Mme Erizan, la femme du riche armateur ...
"La crapule" :
464, le matelot Tiphaigne est incontestablement la plus sale bête du bord pourtant le lieutenant de vaisseau Fargue va, presque jusqu'à outrance, faire preuve d'indulgence ...
"La baleinière deux" :
304, Kerrec, matelot de 1ère classe, gabier breveté, est le patron de la baleinière deux sur le "Ça -Ira", au large de la côte marocaine ...
"La royale charité" :
Là où l'auteur en vint à pleurer d'un chagrin d'amour en montant au quart à la passerelle ...
"L'amoureuse transie" :
En 1904, à Fort de France en Martinique, l'horreur s'invite au rendez-vous galant ...
"Histoire de mannequin" :
Après l'horreur, place à la délicatesse. Le lieutenant de vaisseau Fargue, sur le contre-torpilleur "Ça-Ira", en rade de Mogador, s'offre 15 sous de galanterie ...
"Naissance de vaisseau" :
Aux Forges et Chantiers de la Méditerranée, à la Seyne, faubourg de Toulon, une cale attend de livrer un cuirassé de bataille, le le croiseur "le Paris" ...
"L'ex-voto de l'Acropole" :
C'est par un bijou, glissé, en guise d'offrande, dans la main d'une statue rendue jadis immortelle par un dieu reconnaissant, qu'Hartus obtint l'amour de tous les êtres que son désir effleurera ...
"La tourelle"
Le lieutenant de vaisseau Fargue fait le tour du propriétaire de sa tourelle double de 305 mm, l'arme la plus effroyable du cuirassé, sa meilleure chance de sortir vainqueur des batailles à venir ...
"Dix secondes" :
Dans le port de Safi, au Maroc, il n'y a, pour l'enseigne de vaisseau Olivier de Serres, que dix secondes pour choisir entre la guerre ou la paix ...
"Fontenoy" :
Le 25 septembre 1911, le cuirassé "Nation", ayant à son bord des poudres B brevetées avec garantie du gouvernement, explosa ...
"Comment ils meurent" :
Jean Scherrer, jeune enseigne de vaisseau, est pris au piège, avec ses hommes, dans sa tourelle, par l'explosion de ses munitions ...
L'on dit que l'Histoire a souvent propension à se répéter.
Le siècle qui vient, pour ce grand pays qu'est la Turquie, ne semble pas s'annoncer sous les meilleurs augures.
Et déjà, le début du XXème siècle avait vu sonner le glas de l'Empire Ottoman.
Pourtant "turcophobe" en diable, lorsqu'en 1902, il sortit du collège, c'est "turcophile" de la tête aux pieds que Claude Farrère revint, pour la première fois, de Constantinople, deux ans plus tard.
Publié en 1921, mais écrite avant 1914, "L'extraordinaire aventure d'Achmet Pacha Djemaleddine pirate, amiral, grand d'Espagne et marquis" est accompagnée dans ce recueil de six autres singulières histoires.
L'ouvrage est tendu vers un but, faire comprendre à ses contemporains pourquoi Claude Farrère aimait tant la Turquie.
Le propos de l'auteur est d'en évoquer le jadis, le naguère.
Et de lui rendre un hommage venu de tous les temps !
Le premier texte, éponyme, est le chant d'Abdullah, fils d'Abdullah, chanteur par droit héréditaire de toutes sortes de contes et de dictons.
C'est le récit, aux moulures orientales, des aventures d'Achmet Pacha qui reçut, du Sultan Magnifique, la mission de délivrer seul le grand roi franc François des geôles de Don Carlos de Castille, cinquième du nom, roi des Espagnes et soi-disant empereur de toutes les Allemagnes ...
C'est un récit de jadis qui rapporte aux premiers temps de l'amitié franco-Turque.
Le second texte, venu de naguère, est un ensemble de sept lettres envoyées à Paris, pour Mme Simone de la Cherté, par la princesse Seniha Hâkassi-Zadeh ...
Il y est beaucoup question de politique, mais le propos principal en reste pourtant la condition féminine.
La troisième partie, qui se veut de tous temps, est un ensemble de cinq textes :
- "Conscience Turque" est une anecdote vécue par le yachtman Claude Farrère qui en dit long sur l'honnêteté et le sens de l'honneur Turcs ...
Puis viennent "une histoire de chat" et "une histoire de chiens" parce que sur les vaisseaux de la République, on est, comme dans les villes de Turquie, bon pour les bêtes ...
- "Tripolitaine", dédié au capitaine de vaisseau Pierre Loti, voit trois générations de soldats turcs jeter dans la panier ottoman leur courage, leur fierté et leur amour de la liberté ...
- "Celui qui est mort", Arif Bey, était un ami de Claude Farrère.
Le premier était capitaine d'état-major, aide de camp de sa majesté impériale, le sultan Abd-Ul-Hamid II, le second officier de quart à bord d'un vaisseau français.
Le second avait surnommé le premier "Portici", l'homme qui a fait parler la muette, car d'une adorable athénienne, dédaigneuse et silencieuse, il avait su délier la langue ...
Le livre se referme sur une magnifique et tragique histoire d'amour.
Il est écrit magistralement.
Si il est éminemment politique, engagé et partial, il est avant tout un cri d'amour vers le grand peuple de Turquie.
Et son propos est moderne, fin et sensible.
Il vient se replacer de lui-même dans une chaude actualité, car déjà, hier, comme aujourd'hui, la parole de l'Europe avait failli à cette Turquie qui se veut de notre continent ...
Le siècle qui vient, pour ce grand pays qu'est la Turquie, ne semble pas s'annoncer sous les meilleurs augures.
Et déjà, le début du XXème siècle avait vu sonner le glas de l'Empire Ottoman.
Pourtant "turcophobe" en diable, lorsqu'en 1902, il sortit du collège, c'est "turcophile" de la tête aux pieds que Claude Farrère revint, pour la première fois, de Constantinople, deux ans plus tard.
Publié en 1921, mais écrite avant 1914, "L'extraordinaire aventure d'Achmet Pacha Djemaleddine pirate, amiral, grand d'Espagne et marquis" est accompagnée dans ce recueil de six autres singulières histoires.
L'ouvrage est tendu vers un but, faire comprendre à ses contemporains pourquoi Claude Farrère aimait tant la Turquie.
Le propos de l'auteur est d'en évoquer le jadis, le naguère.
Et de lui rendre un hommage venu de tous les temps !
Le premier texte, éponyme, est le chant d'Abdullah, fils d'Abdullah, chanteur par droit héréditaire de toutes sortes de contes et de dictons.
C'est le récit, aux moulures orientales, des aventures d'Achmet Pacha qui reçut, du Sultan Magnifique, la mission de délivrer seul le grand roi franc François des geôles de Don Carlos de Castille, cinquième du nom, roi des Espagnes et soi-disant empereur de toutes les Allemagnes ...
C'est un récit de jadis qui rapporte aux premiers temps de l'amitié franco-Turque.
Le second texte, venu de naguère, est un ensemble de sept lettres envoyées à Paris, pour Mme Simone de la Cherté, par la princesse Seniha Hâkassi-Zadeh ...
Il y est beaucoup question de politique, mais le propos principal en reste pourtant la condition féminine.
La troisième partie, qui se veut de tous temps, est un ensemble de cinq textes :
- "Conscience Turque" est une anecdote vécue par le yachtman Claude Farrère qui en dit long sur l'honnêteté et le sens de l'honneur Turcs ...
Puis viennent "une histoire de chat" et "une histoire de chiens" parce que sur les vaisseaux de la République, on est, comme dans les villes de Turquie, bon pour les bêtes ...
- "Tripolitaine", dédié au capitaine de vaisseau Pierre Loti, voit trois générations de soldats turcs jeter dans la panier ottoman leur courage, leur fierté et leur amour de la liberté ...
- "Celui qui est mort", Arif Bey, était un ami de Claude Farrère.
Le premier était capitaine d'état-major, aide de camp de sa majesté impériale, le sultan Abd-Ul-Hamid II, le second officier de quart à bord d'un vaisseau français.
Le second avait surnommé le premier "Portici", l'homme qui a fait parler la muette, car d'une adorable athénienne, dédaigneuse et silencieuse, il avait su délier la langue ...
Le livre se referme sur une magnifique et tragique histoire d'amour.
Il est écrit magistralement.
Si il est éminemment politique, engagé et partial, il est avant tout un cri d'amour vers le grand peuple de Turquie.
Et son propos est moderne, fin et sensible.
Il vient se replacer de lui-même dans une chaude actualité, car déjà, hier, comme aujourd'hui, la parole de l'Europe avait failli à cette Turquie qui se veut de notre continent ...
Dix fois, j'ai interrompu ma lecture, et posé ce livre.
Dix fois, je l'ai reprise.
"L'Atlantique en rond" est un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains.
Son propos, qui heurte parfois, souvent même, vient entacher l'image d'un écrivain englué dans de graves contradictions.
Et, au final, je ne suis pas sûr d'avoir voulu y découvrir le vrai visage de l'officier de marine, de l'homme qui se cache derrière son élégante et riche plume.
"L'Atlantique en rond" embarque son lecteur, à bord d'une frégate à grandes voiles carrées, dans un superbe voyage au cours duquel le guide, même s'il sait se rendre indispensable par son érudition, se révèle pourtant au final être importun.
Quelques heures après le départ de Brest, de cette rude ville de granit gris, l'île de Sein, la baie d'Audierne et le phare géant d'Eckmühl déjà ont disparu.
C'est le grand large ... l'Atlantique ...
L'écrivain, dans ce voyage à travers le temps et l'espace d'un océan, mélange Histoire et Géographie.
Heureux qui, comme Ulysse, ou Claude Farrère, semble partir pour un beau voyage :
Porto-Santo, Madère, les Canaries, l'île de Ténériffe, les îles du Cap Vert, la Nouvelle-Orléans, le pays Basque, l'Andalousie ...
Il semble au lecteur qu'il n'a qu'à se laisser agréablement porter par les alizés ou conduire, dans le sens inverse, par le Gulf-stream, ce courant si cher à nos climats tempérés.
Le propos de l'auteur est riche, varié et passionnant.
Il n'oublie pas que le seul point de vue qui intéresse son lecteur est l'imaginatif.
Il évoque le vieux continent de l'Atlantide dont il pense apercevoir les derniers vestiges dans les îles volcaniques qui émergent de l'océan.
Il condamne la vieille civilisation européenne qui, après y avoir massacré les populations indigènes, porte une tache indélébile de sang.
Pourtant le propos est parfois poisseux.
Claude Farrère s'y déconsidère, s'y montre indigne.
Derrière l'élégant écrivain, le savant marin, se dessine la silhouette du sombre colonialiste, voire même de "l'esclavagiste".
L'affaire est grave.
Pour lui "le crime ne réside pas dans la traite mais dans les massacres qui l'ont précédé".
A de nombreuses reprises, le propos est martelé et répété.
Il salit gravement son auteur.
Il est parfois des bons livres que l'on aimerait mieux ne pas avoir lu ...
Dix fois, je l'ai reprise.
"L'Atlantique en rond" est un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains.
Son propos, qui heurte parfois, souvent même, vient entacher l'image d'un écrivain englué dans de graves contradictions.
Et, au final, je ne suis pas sûr d'avoir voulu y découvrir le vrai visage de l'officier de marine, de l'homme qui se cache derrière son élégante et riche plume.
"L'Atlantique en rond" embarque son lecteur, à bord d'une frégate à grandes voiles carrées, dans un superbe voyage au cours duquel le guide, même s'il sait se rendre indispensable par son érudition, se révèle pourtant au final être importun.
Quelques heures après le départ de Brest, de cette rude ville de granit gris, l'île de Sein, la baie d'Audierne et le phare géant d'Eckmühl déjà ont disparu.
C'est le grand large ... l'Atlantique ...
L'écrivain, dans ce voyage à travers le temps et l'espace d'un océan, mélange Histoire et Géographie.
Heureux qui, comme Ulysse, ou Claude Farrère, semble partir pour un beau voyage :
Porto-Santo, Madère, les Canaries, l'île de Ténériffe, les îles du Cap Vert, la Nouvelle-Orléans, le pays Basque, l'Andalousie ...
Il semble au lecteur qu'il n'a qu'à se laisser agréablement porter par les alizés ou conduire, dans le sens inverse, par le Gulf-stream, ce courant si cher à nos climats tempérés.
Le propos de l'auteur est riche, varié et passionnant.
Il n'oublie pas que le seul point de vue qui intéresse son lecteur est l'imaginatif.
Il évoque le vieux continent de l'Atlantide dont il pense apercevoir les derniers vestiges dans les îles volcaniques qui émergent de l'océan.
Il condamne la vieille civilisation européenne qui, après y avoir massacré les populations indigènes, porte une tache indélébile de sang.
Pourtant le propos est parfois poisseux.
Claude Farrère s'y déconsidère, s'y montre indigne.
Derrière l'élégant écrivain, le savant marin, se dessine la silhouette du sombre colonialiste, voire même de "l'esclavagiste".
L'affaire est grave.
Pour lui "le crime ne réside pas dans la traite mais dans les massacres qui l'ont précédé".
A de nombreuses reprises, le propos est martelé et répété.
Il salit gravement son auteur.
Il est parfois des bons livres que l'on aimerait mieux ne pas avoir lu ...
Et si Claude Farrère avait fait du Maroc le personnage principal de son livre ?
Et si l'essentiel des "Hommes nouveaux" était son décor ?
Claude Farrère, toujours, a le coup d'oeil du peintre, et la main sûre pour nous restituer, de quelques traits de son élégante plume, toutes les beautés d'un paysage.
Il déambule, il flâne, il admire, il observe et annote ...
Mais le roman est poussif.
Pourtant, il est sauvé de l'ennui par son bel et tragique épilogue.
Après avoir ronronné pendant presque deux cent pages, le dernier tiers du récit, aussi inattendu qu'émouvant, réussit l'improbable gageure de redonner souffle à une lecture que l'on pensait déjà avoir presque quittée.
Jean de la Fontaine avait raison, la persévérance est parfois récompensée.
"Les hommes nouveaux" sont ici les nouveaux riches, ceux dont la fortune s'est construite en même temps que s'est édifié le Maroc colonial du maréchal Lyautey.
Claude Farrère engage sa plume.
Et fait de son roman un plaidoyer en faveur de l'action française au Maroc.
Autant dire qu'aucun vent de liberté ne le traverse !
Claude Farrère, on le sait, n'a rien d'un homme de gauche.
Ses propos, parfois, sont d'un autre temps, d'un autre monde.
Quelques uns sont d'ailleurs ici un peu choquants.
Mais aucun qui ne condamne vraiment l'ouvrage, qui ne vienne définitivement le murer ...
Sur le pont du paquebot le "Mezzar" qui a appareillé de Marseille pour se rendre à Casablanca, Amédée-Jules Bourron a rencontré Christiane Séveral.
Le second jour de la traversée, avant qu'il ne soit midi, il l'a demandée en mariage.
Bourron avait adoré la jeune femme depuis la veille, dès sept heures, sept heures cinq !
Et le même jour, tout le monde le sût dès huit heures moins le quart, huit heures moins dix !
"Les hommes nouveaux" est d'abord un roman d'amour, celui d'un idylle aussi mal partagée que comprise.
Et malgré qu'il soit encombré de beaucoup de longueurs et de quelques vieux principes moisis, ce roman est un bon roman.
Si, élagué et nettoyé de ses parasites, il avait été traité comme un de ces fiers oliviers méditerranéens, il serait certainement devenu une oeuvre forte et inoubliable ...
Et si l'essentiel des "Hommes nouveaux" était son décor ?
Claude Farrère, toujours, a le coup d'oeil du peintre, et la main sûre pour nous restituer, de quelques traits de son élégante plume, toutes les beautés d'un paysage.
Il déambule, il flâne, il admire, il observe et annote ...
Mais le roman est poussif.
Pourtant, il est sauvé de l'ennui par son bel et tragique épilogue.
Après avoir ronronné pendant presque deux cent pages, le dernier tiers du récit, aussi inattendu qu'émouvant, réussit l'improbable gageure de redonner souffle à une lecture que l'on pensait déjà avoir presque quittée.
Jean de la Fontaine avait raison, la persévérance est parfois récompensée.
"Les hommes nouveaux" sont ici les nouveaux riches, ceux dont la fortune s'est construite en même temps que s'est édifié le Maroc colonial du maréchal Lyautey.
Claude Farrère engage sa plume.
Et fait de son roman un plaidoyer en faveur de l'action française au Maroc.
Autant dire qu'aucun vent de liberté ne le traverse !
Claude Farrère, on le sait, n'a rien d'un homme de gauche.
Ses propos, parfois, sont d'un autre temps, d'un autre monde.
Quelques uns sont d'ailleurs ici un peu choquants.
Mais aucun qui ne condamne vraiment l'ouvrage, qui ne vienne définitivement le murer ...
Sur le pont du paquebot le "Mezzar" qui a appareillé de Marseille pour se rendre à Casablanca, Amédée-Jules Bourron a rencontré Christiane Séveral.
Le second jour de la traversée, avant qu'il ne soit midi, il l'a demandée en mariage.
Bourron avait adoré la jeune femme depuis la veille, dès sept heures, sept heures cinq !
Et le même jour, tout le monde le sût dès huit heures moins le quart, huit heures moins dix !
"Les hommes nouveaux" est d'abord un roman d'amour, celui d'un idylle aussi mal partagée que comprise.
Et malgré qu'il soit encombré de beaucoup de longueurs et de quelques vieux principes moisis, ce roman est un bon roman.
Si, élagué et nettoyé de ses parasites, il avait été traité comme un de ces fiers oliviers méditerranéens, il serait certainement devenu une oeuvre forte et inoubliable ...
Quel beau morceau de scène aurait fait une adaptation théâtrale réussie de ce puissant roman !
Quel précieux numéro de "la Petite Illustration", ne serait-il pas venu illustrer !
Décidément, à se replonger dans l'oeuvre de Claude Farrère, il s'avère que chacun de ses livres, ou presque, résonne, par son intelligence, sa modernité et sa finesse, comme un trait d'union entre le monde d'hier et celui d'aujourd'hui.
"Le chef" est un beau roman, un livre politique lucide et une délicate histoire d'amour.
Il est dédié à tous les vrais chefs qui tentent de sauver le monde ...
Le Portugal en est le décor.
Claude Farrère, allant le qualifier de l'un des pays les "plus humainement civilisés", lui rend un hommage appuyé.
Le tableau, qui en est peint, l'est fait de manière à isoler le noble caractère du peuple portugais trop souvent confondu avec celui de son voisin espagnol.
Le décor est en place.
Une révolution s'y avance .
L'Amérique, voulant récupérer une dette de quinze cent millions d'escudos, menace de s'emparer des colonies portugaises du Timor et de Faial.
Une révolution est imminente, qui risque de balayer le pouvoir en place représenté par le vieux marquis Da Veiga, premier ministre du président de Setubal.
Cette révolution est personnifiée par le jeune député colllectiviste Vasco Ortigão.
Maria-Pia Da Veiga, la jeune femme du ministre, est, elle, l'amour, celui qui, parfois, vient redistribuer les cartes du destin ...
Dans ce roman se niche un propos profondément intellectuel.
Mais bien présomptueux celui des lecteurs qui, après avoir lu ce livre, prétendrait situer politiquement la pensée de Farrère.
A la manière d'Hitchcock qui fugitivement traverse chacun de ses films, Pedro Carlos Alcantara-Mar, un marin philosophe vivant entre ciel et eau, vient se faire le porte-parole de la réflexion de l'auteur.
Elle est fine, sensible et complexe, pleine de raison.
"Le chef" est un roman puissant.
Il est écrit, à l'ancienne, avec des moulures élégantes et raffinées.
Mais que l'on ne vienne pas croire que pour autant il manque ni de force, ni de beauté.
Ce roman est sûrement l'une des clés idéale pour mieux entrer dans l'oeuvre de Farrère
Il est certainement l'un de ceux qui comptent le plus dans cette dernière car l'homme, derrière sa plume d'écrivain, s'y mettant discrètement à nu, se découvre quelque peu ...
Quel précieux numéro de "la Petite Illustration", ne serait-il pas venu illustrer !
Décidément, à se replonger dans l'oeuvre de Claude Farrère, il s'avère que chacun de ses livres, ou presque, résonne, par son intelligence, sa modernité et sa finesse, comme un trait d'union entre le monde d'hier et celui d'aujourd'hui.
"Le chef" est un beau roman, un livre politique lucide et une délicate histoire d'amour.
Il est dédié à tous les vrais chefs qui tentent de sauver le monde ...
Le Portugal en est le décor.
Claude Farrère, allant le qualifier de l'un des pays les "plus humainement civilisés", lui rend un hommage appuyé.
Le tableau, qui en est peint, l'est fait de manière à isoler le noble caractère du peuple portugais trop souvent confondu avec celui de son voisin espagnol.
Le décor est en place.
Une révolution s'y avance .
L'Amérique, voulant récupérer une dette de quinze cent millions d'escudos, menace de s'emparer des colonies portugaises du Timor et de Faial.
Une révolution est imminente, qui risque de balayer le pouvoir en place représenté par le vieux marquis Da Veiga, premier ministre du président de Setubal.
Cette révolution est personnifiée par le jeune député colllectiviste Vasco Ortigão.
Maria-Pia Da Veiga, la jeune femme du ministre, est, elle, l'amour, celui qui, parfois, vient redistribuer les cartes du destin ...
Dans ce roman se niche un propos profondément intellectuel.
Mais bien présomptueux celui des lecteurs qui, après avoir lu ce livre, prétendrait situer politiquement la pensée de Farrère.
A la manière d'Hitchcock qui fugitivement traverse chacun de ses films, Pedro Carlos Alcantara-Mar, un marin philosophe vivant entre ciel et eau, vient se faire le porte-parole de la réflexion de l'auteur.
Elle est fine, sensible et complexe, pleine de raison.
"Le chef" est un roman puissant.
Il est écrit, à l'ancienne, avec des moulures élégantes et raffinées.
Mais que l'on ne vienne pas croire que pour autant il manque ni de force, ni de beauté.
Ce roman est sûrement l'une des clés idéale pour mieux entrer dans l'oeuvre de Farrère
Il est certainement l'un de ceux qui comptent le plus dans cette dernière car l'homme, derrière sa plume d'écrivain, s'y mettant discrètement à nu, se découvre quelque peu ...
"Des mémoires ? Oh non ! Pour écrire des mémoires, il faut avoir, au préalable, fait des choses..." C'est par ces mots, par un excès de modestie, peut-être par un exercice de style, que Claude Farrère ouvre le grand livre de ses "Souvenirs".
Ce livre est foisonnant, terriblement intéressant et passionnant.
C'est un témoignage exceptionnel.
Pourtant, à mon plus grand regret, il faut le préciser avant toute discussion, il s'en dégage, parfois, des relents nauséabonds.
Le meilleur voisine avec le pire. Certains propos sont insupportables.
Je n'en parlerai pas. Non pas que je les excuse mais, vous ayant prévenu, j'ai préféré ne considérer que ce qui fait de ce livre un ouvrage précieux et indispensable.
Claude Farrère a soixante-dix sept ans.
Il est membre de l'Académie Française, écrivain, homme de théâtre - auteur et critique.
C'est un marin, il a combattu durant la première guerre mondiale.
En attendant de sortir de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et faisant son paquet, il déroule, ici, ce qu'il appelle l'interminable voyage de son existence.
Non sans avoir, auparavant, défini, rapidement mais précisément, l'art d'écrire.
"Il consiste à choisir le mot propre et à n'y ajouter aucun épithète.
Selon lui, les adjectifs sont des mots dont la seule utilité est de rendre moins mauvais un substantif déjà médiocre.
Toute l'écriture se résume en cela : le verbe et le nom, rien de plus.
N'écrire jamais que pour mettre en noir sur blanc l'indispensable et couper tout le superflu.
Or, quiconque écrit doit pouvoir être lu, et compris - avis aux fanatiques de l'obscur.
César est un écrivain. Cicéron est un bavard..."
Claude Farrère écrit son premier livre, "les civilisés", le relit, le trouve exécrable et l'enferme dans un tiroir avant de se trouver d'autres occupations.
Il est, alors, officier canonnier dans la Marine Nationale Française.
Jusqu'en 1904, son "pacha", sur le croiseur-torpilleur "Vautour" fut Pierre Loti.
En 1919, il démissionne de la marine afin de se consacrer totalement à l'écriture.
L'analyse, souvent fine et intelligente, de ses souvenirs littéraires et maritimes entremêlés, donne à cet ouvrage un poids et une valeur exceptionnels.
Ce livre est foisonnant.
On y rencontre, lors d'anecdotes piquantes ou de voyages lointains, de nombreux personnages prestigieux tels que Colette, Clémenceau, Poincaré, le tsar Nicolas II, Pierre Louÿs, Mussolini, Rudyard Kipling, Mussolini, Pierre Frondaie, Lyautey, le commandant Charcot, Paul Doumer qu'il ne réussit pas à sauver en s'interposant durant un tragique attentat politique perpétré par un médecin russe réfugié en France, et bien d'autres encore...
Claude Farrère rend hommage à Jean de la Varende, à Margaret Mitchell, à Charles Morgan.
Il parle de la participation de Corneille dans l'oeuvre de Molière.
Il raconte son espérance d'être élu à l'Académie Française, sa déception de ne pas l'être à deux reprises et son désir de rencontrer, à l'occasion des visites de sollicitation aux immortels, les plus grands noms de la coupole.
Cet ouvrage, formidablement bien écrit et intelligent, pourtant parfois gâché par un esprit par trop réactionnaire, émet des avis très tranchés sur la politique, l'opium et l'alcool, sur certains auteurs du temps, sur le colonialisme et, enfin, sur la littérature et le théâtre.
Ce livre, puissant et cultivé, ne peut laisser indifférent.
Ce livre est foisonnant, terriblement intéressant et passionnant.
C'est un témoignage exceptionnel.
Pourtant, à mon plus grand regret, il faut le préciser avant toute discussion, il s'en dégage, parfois, des relents nauséabonds.
Le meilleur voisine avec le pire. Certains propos sont insupportables.
Je n'en parlerai pas. Non pas que je les excuse mais, vous ayant prévenu, j'ai préféré ne considérer que ce qui fait de ce livre un ouvrage précieux et indispensable.
Claude Farrère a soixante-dix sept ans.
Il est membre de l'Académie Française, écrivain, homme de théâtre - auteur et critique.
C'est un marin, il a combattu durant la première guerre mondiale.
En attendant de sortir de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et faisant son paquet, il déroule, ici, ce qu'il appelle l'interminable voyage de son existence.
Non sans avoir, auparavant, défini, rapidement mais précisément, l'art d'écrire.
"Il consiste à choisir le mot propre et à n'y ajouter aucun épithète.
Selon lui, les adjectifs sont des mots dont la seule utilité est de rendre moins mauvais un substantif déjà médiocre.
Toute l'écriture se résume en cela : le verbe et le nom, rien de plus.
N'écrire jamais que pour mettre en noir sur blanc l'indispensable et couper tout le superflu.
Or, quiconque écrit doit pouvoir être lu, et compris - avis aux fanatiques de l'obscur.
César est un écrivain. Cicéron est un bavard..."
Claude Farrère écrit son premier livre, "les civilisés", le relit, le trouve exécrable et l'enferme dans un tiroir avant de se trouver d'autres occupations.
Il est, alors, officier canonnier dans la Marine Nationale Française.
Jusqu'en 1904, son "pacha", sur le croiseur-torpilleur "Vautour" fut Pierre Loti.
En 1919, il démissionne de la marine afin de se consacrer totalement à l'écriture.
L'analyse, souvent fine et intelligente, de ses souvenirs littéraires et maritimes entremêlés, donne à cet ouvrage un poids et une valeur exceptionnels.
Ce livre est foisonnant.
On y rencontre, lors d'anecdotes piquantes ou de voyages lointains, de nombreux personnages prestigieux tels que Colette, Clémenceau, Poincaré, le tsar Nicolas II, Pierre Louÿs, Mussolini, Rudyard Kipling, Mussolini, Pierre Frondaie, Lyautey, le commandant Charcot, Paul Doumer qu'il ne réussit pas à sauver en s'interposant durant un tragique attentat politique perpétré par un médecin russe réfugié en France, et bien d'autres encore...
Claude Farrère rend hommage à Jean de la Varende, à Margaret Mitchell, à Charles Morgan.
Il parle de la participation de Corneille dans l'oeuvre de Molière.
Il raconte son espérance d'être élu à l'Académie Française, sa déception de ne pas l'être à deux reprises et son désir de rencontrer, à l'occasion des visites de sollicitation aux immortels, les plus grands noms de la coupole.
Cet ouvrage, formidablement bien écrit et intelligent, pourtant parfois gâché par un esprit par trop réactionnaire, émet des avis très tranchés sur la politique, l'opium et l'alcool, sur certains auteurs du temps, sur le colonialisme et, enfin, sur la littérature et le théâtre.
Ce livre, puissant et cultivé, ne peut laisser indifférent.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Claude Farrère
Quiz
Voir plus
Yvain, le chevalier au lion d'Anne-Marie Cadot-Colin
Yvain, le chevalier au lion a été écrit:
au XXème siècle
au XIème siècle
au XIIème siècle
au XIIIème siècle
30 questions
1800 lecteurs ont répondu
Thème : Yvain, le Chevalier au Lion de
Anne-Marie Cadot-ColinCréer un quiz sur cet auteur1800 lecteurs ont répondu