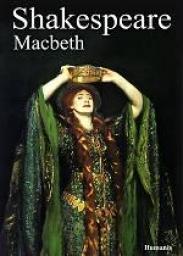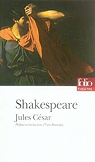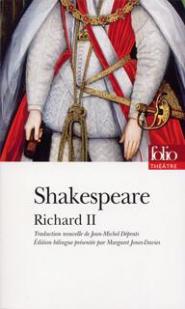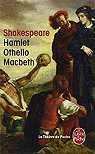Critiques de William Shakespeare (1629)
La Tragédie De Macbeth synthétise beaucoup des thèmes chers à William Shakespeare : la trahison comme dans Othello, l'usurpation et la vengeance comme dans Hamlet, la prophétie et la destinée comme dans La Tempête, la folie et le changement dynastique comme dans Richard II, pour ne citer que celles-là car l'on pourrait encore allonger de la sorte démesurément la liste sans que cela n'apporte beaucoup au propos.
On aura compris qu'il y a différents thèmes dans cette pièce en cinq actes. Celui qui m'apparaît ressortir plus que tout autre est celui de la morale et de l'acte vertueux. Restons dans le droit chemin, semble nous dire en substance Shakespeare, car chaque pas en dehors du tracé du bien en appelle un suivant de sorte que, de vilenie en vilenie, le retour à la vertu est impossible et l'on s'embourbe toujours plus profondément dans les fétides marécages du mal jusqu'à n'en plus trouver d'issue, sauf l'ultime.
Au départ, Macbeth a des valeurs, des scrupules, des freins, des remords puis, peu à peu, à chaque nouvelle action pendable, ses verrous intérieurs sautent les uns après les autres jusqu'à lui accorder toute licence dans l'atrocité ou dans la barbarie.
Il convient de signaler également dans cette fonction facilitatrice, le rôle prépondérant de Lady Macbeth, totalement dénuée de scrupules alors que son mari tergiversait. Comment interpréter cette nouvelle mouture de la consommation du fruit défendu par Adam sous la houlette d'Ève et de l'exclusion à jamais qui s'ensuit du Jardin d'Éden ?
Macbeth, de courageux et noble au départ, à mesure qu'il sombre dans les travers du mal mu par sa soif de pouvoir, devient pleutre et vil. Lady Macbeth, de forte et inflexible qu'elle nous apparaît au commencement, se métamorphose progressivement jusqu'à devenir fragile, malingre et instable.
On perçoit, je pense, le sens qu'a voulu donner l'auteur à l'aliénation du couple principal : en déviant de l'axe vertueux, on érode, on corrode, on débrode le joli fil de soie de la morale humaine, livrant au regard la trame brute et laide du textile sans fard, l'animalité crue de l'Homme, dépouillée des règles sociales et morales.
Ce qui fait l'humain, c'est qu'il ne s'abandonne pas à ses instincts primaires, c'est le respect des lois et de la morale. À mesure donc que Macbeth enfreint les règles élémentaires (hospitalité, allégeance, amitié, fidélité, loyauté, etc.), il se déshumanise graduellement jusqu'à devenir un rat acculé au coin d'une pièce, prêt à sauter au visage de n'importe qui simplement pour rester en vie.
Je ne peux m'empêcher de voir dans Macbeth un double inversé de Hamlet. Ou, plus précisément, la même pièce mais focalisée sur un point de vue différent. Dans Hamlet, le roi légitime, le vieil Hamlet, avait été trahi et assassiné par son frère Claudius avec la connivence de la reine, propre mère de Hamlet. Le point de vue était donc centralisé sur le fils du roi déchu.
Ici, au lieu d'avoir le point focal sur Hamlet, on l'a sur Claudius, et Claudius se nomme alors Macbeth. Mais c'est la même formule de base ; convertissez Hamlet en Malcolm et le vieil Hamlet en Duncan ; acceptez qu'il puisse y avoir un dédoublement du vieil Hamlet qui en plus d'être Duncan serait aussi Banquo et vous retrouvez le spectre dont le rôle est si prégnant dans Hamlet.
Pour que l'analogie soit totale, il nous faut encore un messager symbolique : c'était le jeu de la pièce de théâtre dans Hamlet, ce sont les trois sorcières dans Macbeth et, comme par magie, l'on retombe sur nos pieds. Le thème phare de Hamlet — la mort et l'inutilité de la vie ( le fameux « to be or not to be ») — s'avère être une part cruciale de Macbeth, prétexte à l'une des plus belles tirades de tout le théâtre shakespearien à la scène 5 de l'acte V où Macbeth s'écrie :
« La vie n'est qu'une ombre en marche, un pauvre acteur,
Qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène,
Et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit
Conté par un idiot, plein de bruit et de fureur,
Et qui ne signifie rien. »
Formule magistrale à laquelle un autre William (Faulkner), donnera une descendance au XXème siècle.
On pourrait poursuivre encore longtemps le parallèle entre Hamlet et Macbeth. Par exemple, Hamlet se faisait passer pour fou afin de sonder l'entourage du roi Claudius, et ici, Malcolm se fait passer pour vil afin de tester Macduff. Les deux veulent venger la mort de leur père, un roi qu'on a assassiné.
La folie et le suicide de Lady Macbeth répondent comme un écho à la mère de Hamlet et à la fin d'Ophélie. De même que le maléfique Claudius n'avait pas d'enfant, le couple Macbeth, empreint du mal, disparaît sans descendance.
Comment ne pas voir un clin d'œil ou un appel du pied au règne d'Elisabeth Ière, reine sans enfant, dont on sait qu'elle était probablement impliquée dans des morts louches, notamment celle de la femme de son amant ? Le souverain doit donc savoir être réceptif aux avertissements qui lui sont transmis par les esprits éclairés. Dans la vraie vie du XVIIème siècle, c'est le théâtre et notamment Shakespeare qui donne ces signaux d'alarme, dans Macbeth, ce sont les trois sorcières.
Selon Shakespeare, le pouvoir oublieux de la morale, qui ne parvient pas à décoder comme il convient les prophéties et les avertissements délivrés par le théâtre est appelé à disparaître. Macbeth reproche d'ailleurs, à la scène 7 de l'acte V, le double entente qu'on peut faire du langage et accuse les sorcières d'être des tricheuses, alors même qu'elles lui ont fidèlement tout annoncé, tout prédit, mais que lui a mal interprété leur discours.
Le lien avec les messages délivrés par le théâtre à l'adresse du pouvoir me semble évident. Le théâtre utilise le symbole, la métaphore, les analogies historiques ou les contrées lointaines, mais ce dont il parle vraiment, pour qui sait lire entre les lignes et briser les encodages, c'est du brûlant présent, de l'ici et du maintenant.
J'en terminerai, car même s'il resterait encore beaucoup de choses à dire de cette tragédie j'ai conscience que ma critique atteint déjà une longueur critique, en signalant dans le registre du cinéma qu'il y a probablement un peu (ou même beaucoup) de Macbeth dans le personnage ô combien fameux de Dark Vador dans l'épopée Star Wars. De même, Akira Kurosawa transposa Macbeth avec des samouraï japonais dans son film Le Château De L'Araignée.
En somme, une bien belle tragédie, vaguement et très librement inspirée de l'histoire réelle de l'Écosse peu après l'an Mil et dont William Shakespeare a su tirer matière à beauté et à réflexion, comme souvent. Je me dépêche de préciser, tant que mon ordinateur tient encore le coup (en effet, depuis quelques temps, mon mac baisse) que tout ceci n'est qu'un avis, pas beaucoup plus qu'un spectre de Banquo, c'est-à-dire, pas grand-chose.
On aura compris qu'il y a différents thèmes dans cette pièce en cinq actes. Celui qui m'apparaît ressortir plus que tout autre est celui de la morale et de l'acte vertueux. Restons dans le droit chemin, semble nous dire en substance Shakespeare, car chaque pas en dehors du tracé du bien en appelle un suivant de sorte que, de vilenie en vilenie, le retour à la vertu est impossible et l'on s'embourbe toujours plus profondément dans les fétides marécages du mal jusqu'à n'en plus trouver d'issue, sauf l'ultime.
Au départ, Macbeth a des valeurs, des scrupules, des freins, des remords puis, peu à peu, à chaque nouvelle action pendable, ses verrous intérieurs sautent les uns après les autres jusqu'à lui accorder toute licence dans l'atrocité ou dans la barbarie.
Il convient de signaler également dans cette fonction facilitatrice, le rôle prépondérant de Lady Macbeth, totalement dénuée de scrupules alors que son mari tergiversait. Comment interpréter cette nouvelle mouture de la consommation du fruit défendu par Adam sous la houlette d'Ève et de l'exclusion à jamais qui s'ensuit du Jardin d'Éden ?
Macbeth, de courageux et noble au départ, à mesure qu'il sombre dans les travers du mal mu par sa soif de pouvoir, devient pleutre et vil. Lady Macbeth, de forte et inflexible qu'elle nous apparaît au commencement, se métamorphose progressivement jusqu'à devenir fragile, malingre et instable.
On perçoit, je pense, le sens qu'a voulu donner l'auteur à l'aliénation du couple principal : en déviant de l'axe vertueux, on érode, on corrode, on débrode le joli fil de soie de la morale humaine, livrant au regard la trame brute et laide du textile sans fard, l'animalité crue de l'Homme, dépouillée des règles sociales et morales.
Ce qui fait l'humain, c'est qu'il ne s'abandonne pas à ses instincts primaires, c'est le respect des lois et de la morale. À mesure donc que Macbeth enfreint les règles élémentaires (hospitalité, allégeance, amitié, fidélité, loyauté, etc.), il se déshumanise graduellement jusqu'à devenir un rat acculé au coin d'une pièce, prêt à sauter au visage de n'importe qui simplement pour rester en vie.
Je ne peux m'empêcher de voir dans Macbeth un double inversé de Hamlet. Ou, plus précisément, la même pièce mais focalisée sur un point de vue différent. Dans Hamlet, le roi légitime, le vieil Hamlet, avait été trahi et assassiné par son frère Claudius avec la connivence de la reine, propre mère de Hamlet. Le point de vue était donc centralisé sur le fils du roi déchu.
Ici, au lieu d'avoir le point focal sur Hamlet, on l'a sur Claudius, et Claudius se nomme alors Macbeth. Mais c'est la même formule de base ; convertissez Hamlet en Malcolm et le vieil Hamlet en Duncan ; acceptez qu'il puisse y avoir un dédoublement du vieil Hamlet qui en plus d'être Duncan serait aussi Banquo et vous retrouvez le spectre dont le rôle est si prégnant dans Hamlet.
Pour que l'analogie soit totale, il nous faut encore un messager symbolique : c'était le jeu de la pièce de théâtre dans Hamlet, ce sont les trois sorcières dans Macbeth et, comme par magie, l'on retombe sur nos pieds. Le thème phare de Hamlet — la mort et l'inutilité de la vie ( le fameux « to be or not to be ») — s'avère être une part cruciale de Macbeth, prétexte à l'une des plus belles tirades de tout le théâtre shakespearien à la scène 5 de l'acte V où Macbeth s'écrie :
« La vie n'est qu'une ombre en marche, un pauvre acteur,
Qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène,
Et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit
Conté par un idiot, plein de bruit et de fureur,
Et qui ne signifie rien. »
Formule magistrale à laquelle un autre William (Faulkner), donnera une descendance au XXème siècle.
On pourrait poursuivre encore longtemps le parallèle entre Hamlet et Macbeth. Par exemple, Hamlet se faisait passer pour fou afin de sonder l'entourage du roi Claudius, et ici, Malcolm se fait passer pour vil afin de tester Macduff. Les deux veulent venger la mort de leur père, un roi qu'on a assassiné.
La folie et le suicide de Lady Macbeth répondent comme un écho à la mère de Hamlet et à la fin d'Ophélie. De même que le maléfique Claudius n'avait pas d'enfant, le couple Macbeth, empreint du mal, disparaît sans descendance.
Comment ne pas voir un clin d'œil ou un appel du pied au règne d'Elisabeth Ière, reine sans enfant, dont on sait qu'elle était probablement impliquée dans des morts louches, notamment celle de la femme de son amant ? Le souverain doit donc savoir être réceptif aux avertissements qui lui sont transmis par les esprits éclairés. Dans la vraie vie du XVIIème siècle, c'est le théâtre et notamment Shakespeare qui donne ces signaux d'alarme, dans Macbeth, ce sont les trois sorcières.
Selon Shakespeare, le pouvoir oublieux de la morale, qui ne parvient pas à décoder comme il convient les prophéties et les avertissements délivrés par le théâtre est appelé à disparaître. Macbeth reproche d'ailleurs, à la scène 7 de l'acte V, le double entente qu'on peut faire du langage et accuse les sorcières d'être des tricheuses, alors même qu'elles lui ont fidèlement tout annoncé, tout prédit, mais que lui a mal interprété leur discours.
Le lien avec les messages délivrés par le théâtre à l'adresse du pouvoir me semble évident. Le théâtre utilise le symbole, la métaphore, les analogies historiques ou les contrées lointaines, mais ce dont il parle vraiment, pour qui sait lire entre les lignes et briser les encodages, c'est du brûlant présent, de l'ici et du maintenant.
J'en terminerai, car même s'il resterait encore beaucoup de choses à dire de cette tragédie j'ai conscience que ma critique atteint déjà une longueur critique, en signalant dans le registre du cinéma qu'il y a probablement un peu (ou même beaucoup) de Macbeth dans le personnage ô combien fameux de Dark Vador dans l'épopée Star Wars. De même, Akira Kurosawa transposa Macbeth avec des samouraï japonais dans son film Le Château De L'Araignée.
En somme, une bien belle tragédie, vaguement et très librement inspirée de l'histoire réelle de l'Écosse peu après l'an Mil et dont William Shakespeare a su tirer matière à beauté et à réflexion, comme souvent. Je me dépêche de préciser, tant que mon ordinateur tient encore le coup (en effet, depuis quelques temps, mon mac baisse) que tout ceci n'est qu'un avis, pas beaucoup plus qu'un spectre de Banquo, c'est-à-dire, pas grand-chose.
S'il est bien une tragédie de Shakespeare qui, parmi les fameuses, divise les commentateurs, c'est bien le Roi Lear. En effet, l'écrivaine Simone Weil juge que c'est sa meilleure ; Samuel Taylor Coleridge, John Keats ou encore Victor Hugo lui trouvent des qualités inégalées.
En revanche, André Gide écrivit à son propos : « peu s'en faut que je ne trouve cette pièce exécrable ; de toutes les grandes tragédies de Shakespeare, la moins bonne, et de beaucoup. » Léon Tolstoï — nous apprend la notice de l'édition de la Pléiade —, s'est acharné à dénoncer ses défauts. Etc., etc., etc.
Donc, en soi, quel que puisse être votre avis à son propos, vous trouverez toujours une grosse pointure pour aller dans votre sens et une autre pour dire exactement le contraire. Tenez-vous-le pour dit. En ce qui me concerne, il s'agissait de la treizième pièce de l'auteur que je découvrais et je ne peux pas dire que le nombre 13 m'ait particulièrement porté chance…
En effet, je ne suis pas loin de me placer du côté de Gide et de Tolstoï, quoique je puisse lui trouver également quelques élans intéressants, à de rares moments. Je suis cependant loin, très loin, à des années-lumières d'avoir éprouvé les délices de la Tempête, d'Othello, d'Hamlet, de Macbeth ou même de Jules César.
Le thème fort de la pièce — ou du moins l'un des thèmes forts — me semble être la dénonciation de l'hypocrisie et des faux-semblants qui fourmillaient à l'époque, principalement à la cour des rois (car les paysans ne s'embarrassaient pas trop de prendre des gants), et qui, de nos jours, fourmillent un peu partout. Dire clairement ce que l'on pense, sans sucre ajouté, est, de nos jours comme à l'époque, une activité très faiblement lucrative et pour laquelle on recueille fort peu de lauriers, quand bien même l'on énoncerait une vérité indéniable ou l'on formulerait un avis touchant de sincérité.
Certes, certes, mais j'ai trouvé ça gros dès le départ : un roi (un bon roi comme dans les contes de fées) ayant trois filles (même remarque). La première est flatteuse, la seconde est flatteuse mais pas la troisième, paf !, précisément, est toute différente et se fait chasser du royaume pour cette raison-là. Bigre ! Suis-je chez Shakespeare ou chez les frères Grimm ? (Sans blague, dans l'album jeunesse Un Amour bon comme le sel, c'est exactement cela.)
Et puis il y a aussi le gentil comte Gloucester, fidèle et brave et tout et tout. Lui aussi il a un gentil fils d'un côté et un méchant fils de l'autre. Pffff... bon là, je commence à m'ennuyer ferme…
Alors évidemment, le gentil fils, il ne voit rien venir et il se fait entourlouper par le méchant, méchant fils. Les deux filles flatteuses du roi, sitôt qu'elles ont l'héritage, elles deviennent méchantes, méchantes avec le bon gentil roi, qui s'est dépouillé pour elles (façon Père Goriot) et qui, du coup, en devient fou, car dans les tréfonds de son coeur, c'était la benjamine sa préférée et ça lui a un peu troué la rate qu'elle ne lui fasse pas les jolis compliments qu'il attendait avant de recevoir sa galette. Re-pfffff (idem)…
Et comme une tragédie de Shakespeare ne serait pas vraiment une tragédie de Shakespeare s'il n'y avait une grosse flagrante révoltante injustice, donc, le gentil pauvre vieux comte Gloucester se fait éclater les deux yeux à cause du méchant, méchant fils, ingrat, arriviste et félon. Il devra se traîner sur les routes en pleurant le sang, guidé par son gentil, gentil fils (façon Œdipe et Antigone, vous voyez le genre).
Et puis, c'est la guerre, et puis c'est la folie des vieux, et puis c'est la pluie, la tempête, tout sur la tête pendant des heures comme vache qui pisse, et puis c'est les fous qui disent des choses sensées et les raisonnables qui disent des folies, et puis c'est l'animosité, et puis c'est les trahisons à n'en plus finir, et puis c'est les vengeances, et puis c'est la mort, et vas-y que ça tombe comme des mouches, encore plus que la pluie. Et puis…
… c'est la fin et je suis bien contente d'en avoir fini parce que le Lear, le délire, le collyre, la lyre, le lire ou le pas lire, le relire et pâlir, moi, j'en avais plein la tirelire et je ne savais plus quoi penser de mon avis sur Lear : l'abolear ? l'ensevelear ? ou tout au contraire l'exprimer au risque de le salear ? de l'amolear ? de le démolear ? de l'avilear ?
Bref, le Lear, sans chercher à le reluire ni à le dépolir, j'ai très faiblement apprécié : trop caricatural, trop manichéen, trop deus ex-machinéen à mon goût, surtout quand je considère la force et la subtilité qu'il déploie ailleurs dans d'autres pièces, ça me chiffonne un peu, je dois dire. Mais, une fois encore, une fois pour toutes, ce n'est que mon avis, un malheureux petit avis, léger comme une plume d'oiseau (lear) et qui sera balayé au premier souffle de la tempête.
En revanche, André Gide écrivit à son propos : « peu s'en faut que je ne trouve cette pièce exécrable ; de toutes les grandes tragédies de Shakespeare, la moins bonne, et de beaucoup. » Léon Tolstoï — nous apprend la notice de l'édition de la Pléiade —, s'est acharné à dénoncer ses défauts. Etc., etc., etc.
Donc, en soi, quel que puisse être votre avis à son propos, vous trouverez toujours une grosse pointure pour aller dans votre sens et une autre pour dire exactement le contraire. Tenez-vous-le pour dit. En ce qui me concerne, il s'agissait de la treizième pièce de l'auteur que je découvrais et je ne peux pas dire que le nombre 13 m'ait particulièrement porté chance…
En effet, je ne suis pas loin de me placer du côté de Gide et de Tolstoï, quoique je puisse lui trouver également quelques élans intéressants, à de rares moments. Je suis cependant loin, très loin, à des années-lumières d'avoir éprouvé les délices de la Tempête, d'Othello, d'Hamlet, de Macbeth ou même de Jules César.
Le thème fort de la pièce — ou du moins l'un des thèmes forts — me semble être la dénonciation de l'hypocrisie et des faux-semblants qui fourmillaient à l'époque, principalement à la cour des rois (car les paysans ne s'embarrassaient pas trop de prendre des gants), et qui, de nos jours, fourmillent un peu partout. Dire clairement ce que l'on pense, sans sucre ajouté, est, de nos jours comme à l'époque, une activité très faiblement lucrative et pour laquelle on recueille fort peu de lauriers, quand bien même l'on énoncerait une vérité indéniable ou l'on formulerait un avis touchant de sincérité.
Certes, certes, mais j'ai trouvé ça gros dès le départ : un roi (un bon roi comme dans les contes de fées) ayant trois filles (même remarque). La première est flatteuse, la seconde est flatteuse mais pas la troisième, paf !, précisément, est toute différente et se fait chasser du royaume pour cette raison-là. Bigre ! Suis-je chez Shakespeare ou chez les frères Grimm ? (Sans blague, dans l'album jeunesse Un Amour bon comme le sel, c'est exactement cela.)
Et puis il y a aussi le gentil comte Gloucester, fidèle et brave et tout et tout. Lui aussi il a un gentil fils d'un côté et un méchant fils de l'autre. Pffff... bon là, je commence à m'ennuyer ferme…
Alors évidemment, le gentil fils, il ne voit rien venir et il se fait entourlouper par le méchant, méchant fils. Les deux filles flatteuses du roi, sitôt qu'elles ont l'héritage, elles deviennent méchantes, méchantes avec le bon gentil roi, qui s'est dépouillé pour elles (façon Père Goriot) et qui, du coup, en devient fou, car dans les tréfonds de son coeur, c'était la benjamine sa préférée et ça lui a un peu troué la rate qu'elle ne lui fasse pas les jolis compliments qu'il attendait avant de recevoir sa galette. Re-pfffff (idem)…
Et comme une tragédie de Shakespeare ne serait pas vraiment une tragédie de Shakespeare s'il n'y avait une grosse flagrante révoltante injustice, donc, le gentil pauvre vieux comte Gloucester se fait éclater les deux yeux à cause du méchant, méchant fils, ingrat, arriviste et félon. Il devra se traîner sur les routes en pleurant le sang, guidé par son gentil, gentil fils (façon Œdipe et Antigone, vous voyez le genre).
Et puis, c'est la guerre, et puis c'est la folie des vieux, et puis c'est la pluie, la tempête, tout sur la tête pendant des heures comme vache qui pisse, et puis c'est les fous qui disent des choses sensées et les raisonnables qui disent des folies, et puis c'est l'animosité, et puis c'est les trahisons à n'en plus finir, et puis c'est les vengeances, et puis c'est la mort, et vas-y que ça tombe comme des mouches, encore plus que la pluie. Et puis…
… c'est la fin et je suis bien contente d'en avoir fini parce que le Lear, le délire, le collyre, la lyre, le lire ou le pas lire, le relire et pâlir, moi, j'en avais plein la tirelire et je ne savais plus quoi penser de mon avis sur Lear : l'abolear ? l'ensevelear ? ou tout au contraire l'exprimer au risque de le salear ? de l'amolear ? de le démolear ? de l'avilear ?
Bref, le Lear, sans chercher à le reluire ni à le dépolir, j'ai très faiblement apprécié : trop caricatural, trop manichéen, trop deus ex-machinéen à mon goût, surtout quand je considère la force et la subtilité qu'il déploie ailleurs dans d'autres pièces, ça me chiffonne un peu, je dois dire. Mais, une fois encore, une fois pour toutes, ce n'est que mon avis, un malheureux petit avis, léger comme une plume d'oiseau (lear) et qui sera balayé au premier souffle de la tempête.
Umberto Eco a bien parlé dans son roman Le Nom De La Rose du fait que les livres parlent aux livres, parlent des livres et se transmettent des messages, de livre en livre.
Jorge Luis Borges, quant à lui, avait abordé dans sa nouvelle La Bibliothèque De Babel le fait que la disparition des livres n’était pas un problème sur le long terme car leur effet a eu le temps de se répercuter dans la pensée des suiveurs.
Ces deux illustres décodeurs de bibliothèques me semblent tout à fait indiqués pour parler de la genèse de Roméo et Juliette.
Il faut probablement remonter jusqu’à Jean Boccace (Giovanni Boccaccio) pour comprendre l’ensemble du phénomène et la suite d’appropriations et de réappropriations d'œuvres désormais quasi oubliées qui ont conduit au chef-d’œuvre que l’on connaît.
Boccace a connu un tel succès, notamment avec son Décameron, que nombreux sont les écrivains italiens qui ont tenté d’exploiter le filon de la nouvelle tel que lui l’avait fait.
Ainsi, Masuccio de Salerne (Masuccio Salernitano, 1410 – 1475) produira un Novellino, ouvrage qui regroupe cinquante courtes nouvelles, dont la 33ème, une certaine Romeo e Giulietta.
Version certes primitive mais déjà suffisamment marquante pour avoir été repérée, reprise et enrichie par Luigi da Porto (1485 – 1529).
À son tour la version étoffée par da Porto de Romeo e Giulietta sera ré-assaisonnée par Matteo Bandello (1480 – 1561) dans son gros corpus d’histoires courtes, dont Shakespeare connaissait la traduction du français Pierre Boaistuau (1500 – 1566), également connu pour avoir édité des nouvelles de Marguerite de Navarre, la propre sœur de François Ier.
Notons au passage que la traduction de Bandello sera très profitable à Shakespeare car, outre Roméo Et Juliette, elle fournira également au dramaturge anglais le sujet de deux autres pièces restées fameuses : les comédies Beaucoup De Bruit Pour Rien et La Nuit Des Rois (de même Lope de Vega s'inspirera aussi de Bandello).
Mais, si William Shakespeare remet le couvert de Roméo Et Juliette, c’est qu’il a sûrement une ou deux idées en tête, le bougre.
L’auteur écrit sa pièce en fin du XVIème siècle, un siècle particulièrement chaud sur la question du mariage, notamment en raison du séisme que provoque la réforme protestante. Laquelle doctrine défend le mariage « d’inclination » au détriment des règles classiques du mariage dans tout le monde chrétien, à savoir, le choix des parents et l’intérêt de la famille.
De tout temps, hier comme aujourd’hui, quel meilleur symbole d’émancipation pour la jeunesse que celui de Roméo et de Juliette, deux amoureux qui n’ont que faire de l’opinion de leurs parents respectifs et qui préfèrent braver l’interdit que de s’interdire leur amour ?
Ce thème, en lui seul, suffirait presque à expliquer le succès de la pièce depuis plus de quatre siècles. Mais il n’est probablement pas tout. Aussi, vais-je hasarder une autre interprétation qui n’est pas spécialement fréquente pour cette pièce.
Shakespeare nous dresse un tableau où deux familles rivales s’opposent, pour des raisons anciennes, obscures et probablement oubliées, dans une lutte à mort. Le vieux Montague et le vieux Capulet sont deux respectables, aimables, riches citoyens de Véronne, estimés l’un et l’autre du seigneur de la ville, mais ils ne peuvent pas se sentir, c’est comme ça.
Chacun des membres du clan ne demande que le prétexte pour se lancer dans une échauffourée avec la bande rivale. C’est ce point qui me semble capital dans la compréhension des intentions de l’auteur dans cette tragi-comédie.
La première version publiée de l’œuvre remonte à 1597, mais il est clairement spécifié qu’à la date de cette publication, la pièce est déjà montée et jouée depuis un certain temps, certains avancent 1594, mais à la vérité on n’en sait rien, juste une présomption. Que ce passe-t-il dans l’Angleterre de Shakespeare à cette époque ?
1588, Francis Drake bat l’Invisible Armada espagnole mais le risque d’une invasion de l'Angleterre par les Espagnols est réel. De nombreux combats ont eu lieu avant et se poursuivent après cette date.
L’Irlande (déjà elle !) est une véritable poudrière et risque d’exploser à la figure de l’Angleterre, notamment en servant de base arrière à l’armée espagnole.
Bref, Philippe II d’Espagne (le fils de Charles Quint) et Elisabeth Ière d’Angleterre ressemblent étrangement à ces vieux Montague et Capulet, qui se crêpent le chignon sans trop savoir pourquoi, pour d’anciennes histoires de prestige (notamment liées au commerce dans les Antilles et en Amérique).
Comment s’appelle le poison, le démon des Espagnols ? Ne serait-ce un certain Francis Drake ? N’est-ce point un poison qui tue Roméo ? N’est-ce point une arme virile qui tue Juliette ? La symbolique du démon et de la folie est également évoquée dans la tirade de Juliette, juste avant qu’elle n’avale la fiole à la scène 3 de l’acte IV. Shakespeare utilise le terme de mandragore. C’est certes une plante, connue pour ses vertus hallucinogènes et de supposées propriétés magiques, mais c’est aussi une façon, en langue anglaise, d’évoquer le démon et l’occultisme. Je vous le donne en mille, comment se dit mandragore en anglais ? Mandrake ! Man Drake ! Bien évidemment, on peut toujours arguer le hasard, mais venant de Shakespeare, le doute est plus que permis.
Comment s’achève la pièce ? Les deux clans pleurent les innocents morts pour rien et leur élèvent à chacun une statue d’or. Voilà qui leur fait une belle jambe, n’est-ce pas ?
Donc, outre l’appel à l’émancipation de la jeunesse et à la fin de la férule des parents, je vois dans cette pièce un message plus politique, celui que quand les puissants s’affrontent, les enfants innocents de chaque nation payent l’addition et que tout ce qu’ils récoltent, c’est, au mieux, un monument à leur nom. En somme, une dénonciation de la folie des dirigeants qui s’engagent dans des conflits sans fondement et qui sacrifient de jeunes vies pour cela.
Merci monsieur Shakespeare pour cette sublime tragi-comédie, genre qui fera des émules, notamment côté espagnol sous la houlette de Lope de Vega, mais ça c’est une autre histoire et tout ceci n’est que mon avis, un parmi quelques millions d’autres, c’est-à-dire, pas grand-chose.
Jorge Luis Borges, quant à lui, avait abordé dans sa nouvelle La Bibliothèque De Babel le fait que la disparition des livres n’était pas un problème sur le long terme car leur effet a eu le temps de se répercuter dans la pensée des suiveurs.
Ces deux illustres décodeurs de bibliothèques me semblent tout à fait indiqués pour parler de la genèse de Roméo et Juliette.
Il faut probablement remonter jusqu’à Jean Boccace (Giovanni Boccaccio) pour comprendre l’ensemble du phénomène et la suite d’appropriations et de réappropriations d'œuvres désormais quasi oubliées qui ont conduit au chef-d’œuvre que l’on connaît.
Boccace a connu un tel succès, notamment avec son Décameron, que nombreux sont les écrivains italiens qui ont tenté d’exploiter le filon de la nouvelle tel que lui l’avait fait.
Ainsi, Masuccio de Salerne (Masuccio Salernitano, 1410 – 1475) produira un Novellino, ouvrage qui regroupe cinquante courtes nouvelles, dont la 33ème, une certaine Romeo e Giulietta.
Version certes primitive mais déjà suffisamment marquante pour avoir été repérée, reprise et enrichie par Luigi da Porto (1485 – 1529).
À son tour la version étoffée par da Porto de Romeo e Giulietta sera ré-assaisonnée par Matteo Bandello (1480 – 1561) dans son gros corpus d’histoires courtes, dont Shakespeare connaissait la traduction du français Pierre Boaistuau (1500 – 1566), également connu pour avoir édité des nouvelles de Marguerite de Navarre, la propre sœur de François Ier.
Notons au passage que la traduction de Bandello sera très profitable à Shakespeare car, outre Roméo Et Juliette, elle fournira également au dramaturge anglais le sujet de deux autres pièces restées fameuses : les comédies Beaucoup De Bruit Pour Rien et La Nuit Des Rois (de même Lope de Vega s'inspirera aussi de Bandello).
Mais, si William Shakespeare remet le couvert de Roméo Et Juliette, c’est qu’il a sûrement une ou deux idées en tête, le bougre.
L’auteur écrit sa pièce en fin du XVIème siècle, un siècle particulièrement chaud sur la question du mariage, notamment en raison du séisme que provoque la réforme protestante. Laquelle doctrine défend le mariage « d’inclination » au détriment des règles classiques du mariage dans tout le monde chrétien, à savoir, le choix des parents et l’intérêt de la famille.
De tout temps, hier comme aujourd’hui, quel meilleur symbole d’émancipation pour la jeunesse que celui de Roméo et de Juliette, deux amoureux qui n’ont que faire de l’opinion de leurs parents respectifs et qui préfèrent braver l’interdit que de s’interdire leur amour ?
Ce thème, en lui seul, suffirait presque à expliquer le succès de la pièce depuis plus de quatre siècles. Mais il n’est probablement pas tout. Aussi, vais-je hasarder une autre interprétation qui n’est pas spécialement fréquente pour cette pièce.
Shakespeare nous dresse un tableau où deux familles rivales s’opposent, pour des raisons anciennes, obscures et probablement oubliées, dans une lutte à mort. Le vieux Montague et le vieux Capulet sont deux respectables, aimables, riches citoyens de Véronne, estimés l’un et l’autre du seigneur de la ville, mais ils ne peuvent pas se sentir, c’est comme ça.
Chacun des membres du clan ne demande que le prétexte pour se lancer dans une échauffourée avec la bande rivale. C’est ce point qui me semble capital dans la compréhension des intentions de l’auteur dans cette tragi-comédie.
La première version publiée de l’œuvre remonte à 1597, mais il est clairement spécifié qu’à la date de cette publication, la pièce est déjà montée et jouée depuis un certain temps, certains avancent 1594, mais à la vérité on n’en sait rien, juste une présomption. Que ce passe-t-il dans l’Angleterre de Shakespeare à cette époque ?
1588, Francis Drake bat l’Invisible Armada espagnole mais le risque d’une invasion de l'Angleterre par les Espagnols est réel. De nombreux combats ont eu lieu avant et se poursuivent après cette date.
L’Irlande (déjà elle !) est une véritable poudrière et risque d’exploser à la figure de l’Angleterre, notamment en servant de base arrière à l’armée espagnole.
Bref, Philippe II d’Espagne (le fils de Charles Quint) et Elisabeth Ière d’Angleterre ressemblent étrangement à ces vieux Montague et Capulet, qui se crêpent le chignon sans trop savoir pourquoi, pour d’anciennes histoires de prestige (notamment liées au commerce dans les Antilles et en Amérique).
Comment s’appelle le poison, le démon des Espagnols ? Ne serait-ce un certain Francis Drake ? N’est-ce point un poison qui tue Roméo ? N’est-ce point une arme virile qui tue Juliette ? La symbolique du démon et de la folie est également évoquée dans la tirade de Juliette, juste avant qu’elle n’avale la fiole à la scène 3 de l’acte IV. Shakespeare utilise le terme de mandragore. C’est certes une plante, connue pour ses vertus hallucinogènes et de supposées propriétés magiques, mais c’est aussi une façon, en langue anglaise, d’évoquer le démon et l’occultisme. Je vous le donne en mille, comment se dit mandragore en anglais ? Mandrake ! Man Drake ! Bien évidemment, on peut toujours arguer le hasard, mais venant de Shakespeare, le doute est plus que permis.
Comment s’achève la pièce ? Les deux clans pleurent les innocents morts pour rien et leur élèvent à chacun une statue d’or. Voilà qui leur fait une belle jambe, n’est-ce pas ?
Donc, outre l’appel à l’émancipation de la jeunesse et à la fin de la férule des parents, je vois dans cette pièce un message plus politique, celui que quand les puissants s’affrontent, les enfants innocents de chaque nation payent l’addition et que tout ce qu’ils récoltent, c’est, au mieux, un monument à leur nom. En somme, une dénonciation de la folie des dirigeants qui s’engagent dans des conflits sans fondement et qui sacrifient de jeunes vies pour cela.
Merci monsieur Shakespeare pour cette sublime tragi-comédie, genre qui fera des émules, notamment côté espagnol sous la houlette de Lope de Vega, mais ça c’est une autre histoire et tout ceci n’est que mon avis, un parmi quelques millions d’autres, c’est-à-dire, pas grand-chose.
Finir oublié sous un parking avec un grand coup de poignard dans le derrière ! Quel destin, tout de même, quel destin ! C'était bien la peine de monter si haut pour finir si bas, tout compte fait. Étonnante, étonnante destinée que celle du houleux Richard III.
Je ne résiste pas à l'envie de vous entretenir de ce que vous ne trouverez pas, même dans les meilleures présentations, même dans la notice de la Pléiade, pour la bonne et simple raison que, pour la plupart, ces présentations de la pièce de William Shakespeare sont antérieures à la surprenante redécouverte du squelette de Richard III en 2012, comme je l'indiquais plus haut, sous un très ordinaire parking recouvrant l'ancien prieuré de Leicester.
À grand renfort d'ADN mitochondrial et d'analyses dernier cri ultra poussées, il fut donc démontré que le squelette scoliotique ainsi exhumé était bien celui du célèbre Richard III, mort d'un bon gros coup de hallebarde derrière la théière et mutilé par la suite (balafré, scalpé ?), enterré à la va-vite (sans doute assez peu présentable) dans le choeur d'une petite église locale, loin des fastes londoniens.
Il est intéressant, tout de même, ce personnage historique. Psychologiquement parlant, j'entends. Beaucoup de personnes ont une vie rocambolesque ou mouvementée, très sujette à être portée sur scène (ou à l'écran de nos jours). Mais parmi ceux-là, je remarque que ceux qui cristallisent le plus la fascination sont les êtres négatifs, au premier rang desquels on peut probablement citer Hitler.
Et là, je crois que William Shakespeare touche à de l'universel et, cela va peut-être vous faire sourire (ou au contraire vous allez trouver ça pathétique), mais j'ai l'impression que ma fille de huit ans m'a aidé à formuler cette réflexion. En effet, l'autre jour avec elle, j'ai re-re-regardé Kirikou et la Sorcière. Quel lien me direz-vous entre Kirikou et Richard III ? J'y viens.
Michel Ocelot dit s'être inspiré de multiples contes ou légendes africaines pour bâtir l'histoire de Kirikou. Mais ce qu'il y a mis de lui-même, c'est un questionnement d'enfant, c'est SON questionnement d'enfant, à savoir : « Pourquoi le méchant est-il méchant ? » Et ce questionnement d'enfant, même s'il est celui de Michel Ocelot est aussi et surtout un questionnement universel d'enfant : chacun de nous aime à comprendre pourquoi le méchant est méchant.
Karaba la sorcière avait une grosse épine plantée dans le dos et c'était à la fois la cause de sa haine et de sa puissance : l'énergie de la vengeance. le monde m'a fait mal ? Très bien, je ferai mal au monde et j'y mettrai toute ma haine, toute ma détestation à l'encontre de ceux qui ne souffrent pas comme moi. Car ma souffrance est injuste, le monde est injuste vis-à-vis de moi si je suis la seule à souffrir.
Revenons à Richard III. Lui aussi avait une grosse épine plantée dans le dos. L'analyse du squelette a révélé un grave cas de scoliose apparue probablement lors de la croissance entre 10 et 13 ans. Imaginez à présent ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune homme qui voit son corps se déformer à vue d'oeil, devenir hideux, faible et contrefait.
Comme ce doit être humiliant, comme ce doit être injuste, comme ce doit être douloureux de voir les autres grandir normalement, devenir grands, forts et beaux quand vous, vous devenez tordu, faible et très peu désirable. Shakespeare écrit à l'acte III, scène IV : « Que vos yeux soient témoins du mal qu'ils m'ont fait. Voyez comme je suis ensorcelé : regardez, mon bras est desséché comme un rameau flétri ! » (Be your eyes the witness of their evil. Look how I am bewitch'd : behold, mine arm is like a blasted sapling, wither'd up.)
Comme l'injustice doit vous paraître criante. Si l'on se replace dans la pensée religieuse de l'époque, comme l'on doit croire à une malédiction divine (ou orchestrée par un tiers, la suite de la tirade accuse d'ailleurs ouvertement la femme d'Édouard d'être une espèce de sorcière jetant des maléfices).
De plus, vous êtes le quatrième fils de Richard Plantagenêt, 3ème duc d'York. Les honneurs seront pour les aînés et vous, vous ? Il ne vous restera rien, rien d'autre que cette grosse rancune et cette abominable scoliose qui vous fait marcher comme un crapaud. Si par hasard il arrivait malheur à votre frère aîné, Édouard, il resterait encore Georges (car, Dieu merci, le second fils, Edmond, a eu le bon goût de mourir précocement, enfin un peu de justice en ce monde bouffi d'iniquité).
Avez-vous encore une vraie bonne raison de croire en la bonté divine ? Certes non, alors vous apprenez la ruse et le vice, vous apprenez les sales coups, faits discrètement, l'air de rien. Vous apprenez l'art des faibles : la fourberie, l'hypocrisie, le double jeu. Et cela vous réussit. Peu à peu vos desseins s'accomplissent, mieux que vous n'eussiez osé l'espérer… Cela vous encourage, un acte vil entraîne un acte pendable, un acte pendable appelle une abomination… Et les forfaits s'accumulent, dans la douleur et dans le sang des autres.
Dieu n'existe pas, vous en êtes à présent absolument certain, car avec un tel chapelet d'horreurs au fond de votre poche, IL ne pourrait laisser faire pareilles ignominies s'IL était vraiment le Dieu de bonté et de justice qu'on prétend. Et s'IL n'existe pas, qu'est-ce qui pourrait bien vous arrêter, dites-le-moi ?
Bon, je m'éloigne et je divague, me semble-t-il. Qu'en est-il de la pièce de Shakespeare là-dedans ? Eh bien, ma foi, je la trouve à l'image de son sinistre héros : boiteuse, contrefaite mais non dénuée de certaines fulgurances, notamment dans les formules, qui la rendent tout de même intéressante.
Je ne peux pas dire que j'aie trouvé Shakespeare particulièrement subtil quant à la construction de son intrigue ou de son personnage. On est loin de Jules César, par exemple, où il avait su rendre tous les personnages complexes et finement ciselés. Ici, c'est du très gros, du très caricatural, les méchants sont bien méchants et les gentils gentils.
Certes, je n'oublie pas que le dramaturge n'avait pas l'avantage du recul comme avec les pièces antiques : il écrivait à peine un siècle après les faits, notamment pour des souverains qui détenaient leur pouvoir de la chute dudit Richard III. Donc il fallait bien qu'il soit un méchant absolu pour justifier des monarques actuels. Certes, certes, mais un peu de nuance tout de même, eût été appréciable, du moins l'eus-je grandement apprécié (je sens que je glisse de plus en plus sur ma " l'eus-je ").
Non, le canevas est grossier mais le fil à broder, lui, est parfois d'une finesse exquise. C'est particulièrement flagrant si on compare, à titre d'exemple Richard III et le Roi Lear. J'ai également éprouvé beaucoup de peine avec le canevas du Roi Lear et à très peu d'endroits j'ai été séduite par le verbe ou le sens de la formule. Ici, c'est tout différent. Beaucoup de répliques fusent et sont de purs joyaux d'orfèvrerie élisabéthaine.
Bref, pas trop ma tasse de thé quant au fond, bien plus séduite en revanche par la forme. Lisez, si le coeur vous en dit « La Tragédie de Richard III, avec le débarquement du comte de Richmond et la bataille de Bosworth » (titre complet de la pièce) afin de connaître comment se termina la fameuse Guerre des deux Roses opposant les horribles Lancastre aux infâmes York (tous plus ou moins descendants de rois de France, ce n'est pas une référence !) racontée à la sauce Shakespeare.
Et encore, gardez à l'esprit que ceci n'est que mon avis, qu'il ne vaut pas grand-chose, en tout cas beaucoup moins qu'un cheval. Un cheval ! Un cheval ! Mon avis pour un cheval !
Je ne résiste pas à l'envie de vous entretenir de ce que vous ne trouverez pas, même dans les meilleures présentations, même dans la notice de la Pléiade, pour la bonne et simple raison que, pour la plupart, ces présentations de la pièce de William Shakespeare sont antérieures à la surprenante redécouverte du squelette de Richard III en 2012, comme je l'indiquais plus haut, sous un très ordinaire parking recouvrant l'ancien prieuré de Leicester.
À grand renfort d'ADN mitochondrial et d'analyses dernier cri ultra poussées, il fut donc démontré que le squelette scoliotique ainsi exhumé était bien celui du célèbre Richard III, mort d'un bon gros coup de hallebarde derrière la théière et mutilé par la suite (balafré, scalpé ?), enterré à la va-vite (sans doute assez peu présentable) dans le choeur d'une petite église locale, loin des fastes londoniens.
Il est intéressant, tout de même, ce personnage historique. Psychologiquement parlant, j'entends. Beaucoup de personnes ont une vie rocambolesque ou mouvementée, très sujette à être portée sur scène (ou à l'écran de nos jours). Mais parmi ceux-là, je remarque que ceux qui cristallisent le plus la fascination sont les êtres négatifs, au premier rang desquels on peut probablement citer Hitler.
Et là, je crois que William Shakespeare touche à de l'universel et, cela va peut-être vous faire sourire (ou au contraire vous allez trouver ça pathétique), mais j'ai l'impression que ma fille de huit ans m'a aidé à formuler cette réflexion. En effet, l'autre jour avec elle, j'ai re-re-regardé Kirikou et la Sorcière. Quel lien me direz-vous entre Kirikou et Richard III ? J'y viens.
Michel Ocelot dit s'être inspiré de multiples contes ou légendes africaines pour bâtir l'histoire de Kirikou. Mais ce qu'il y a mis de lui-même, c'est un questionnement d'enfant, c'est SON questionnement d'enfant, à savoir : « Pourquoi le méchant est-il méchant ? » Et ce questionnement d'enfant, même s'il est celui de Michel Ocelot est aussi et surtout un questionnement universel d'enfant : chacun de nous aime à comprendre pourquoi le méchant est méchant.
Karaba la sorcière avait une grosse épine plantée dans le dos et c'était à la fois la cause de sa haine et de sa puissance : l'énergie de la vengeance. le monde m'a fait mal ? Très bien, je ferai mal au monde et j'y mettrai toute ma haine, toute ma détestation à l'encontre de ceux qui ne souffrent pas comme moi. Car ma souffrance est injuste, le monde est injuste vis-à-vis de moi si je suis la seule à souffrir.
Revenons à Richard III. Lui aussi avait une grosse épine plantée dans le dos. L'analyse du squelette a révélé un grave cas de scoliose apparue probablement lors de la croissance entre 10 et 13 ans. Imaginez à présent ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune homme qui voit son corps se déformer à vue d'oeil, devenir hideux, faible et contrefait.
Comme ce doit être humiliant, comme ce doit être injuste, comme ce doit être douloureux de voir les autres grandir normalement, devenir grands, forts et beaux quand vous, vous devenez tordu, faible et très peu désirable. Shakespeare écrit à l'acte III, scène IV : « Que vos yeux soient témoins du mal qu'ils m'ont fait. Voyez comme je suis ensorcelé : regardez, mon bras est desséché comme un rameau flétri ! » (Be your eyes the witness of their evil. Look how I am bewitch'd : behold, mine arm is like a blasted sapling, wither'd up.)
Comme l'injustice doit vous paraître criante. Si l'on se replace dans la pensée religieuse de l'époque, comme l'on doit croire à une malédiction divine (ou orchestrée par un tiers, la suite de la tirade accuse d'ailleurs ouvertement la femme d'Édouard d'être une espèce de sorcière jetant des maléfices).
De plus, vous êtes le quatrième fils de Richard Plantagenêt, 3ème duc d'York. Les honneurs seront pour les aînés et vous, vous ? Il ne vous restera rien, rien d'autre que cette grosse rancune et cette abominable scoliose qui vous fait marcher comme un crapaud. Si par hasard il arrivait malheur à votre frère aîné, Édouard, il resterait encore Georges (car, Dieu merci, le second fils, Edmond, a eu le bon goût de mourir précocement, enfin un peu de justice en ce monde bouffi d'iniquité).
Avez-vous encore une vraie bonne raison de croire en la bonté divine ? Certes non, alors vous apprenez la ruse et le vice, vous apprenez les sales coups, faits discrètement, l'air de rien. Vous apprenez l'art des faibles : la fourberie, l'hypocrisie, le double jeu. Et cela vous réussit. Peu à peu vos desseins s'accomplissent, mieux que vous n'eussiez osé l'espérer… Cela vous encourage, un acte vil entraîne un acte pendable, un acte pendable appelle une abomination… Et les forfaits s'accumulent, dans la douleur et dans le sang des autres.
Dieu n'existe pas, vous en êtes à présent absolument certain, car avec un tel chapelet d'horreurs au fond de votre poche, IL ne pourrait laisser faire pareilles ignominies s'IL était vraiment le Dieu de bonté et de justice qu'on prétend. Et s'IL n'existe pas, qu'est-ce qui pourrait bien vous arrêter, dites-le-moi ?
Bon, je m'éloigne et je divague, me semble-t-il. Qu'en est-il de la pièce de Shakespeare là-dedans ? Eh bien, ma foi, je la trouve à l'image de son sinistre héros : boiteuse, contrefaite mais non dénuée de certaines fulgurances, notamment dans les formules, qui la rendent tout de même intéressante.
Je ne peux pas dire que j'aie trouvé Shakespeare particulièrement subtil quant à la construction de son intrigue ou de son personnage. On est loin de Jules César, par exemple, où il avait su rendre tous les personnages complexes et finement ciselés. Ici, c'est du très gros, du très caricatural, les méchants sont bien méchants et les gentils gentils.
Certes, je n'oublie pas que le dramaturge n'avait pas l'avantage du recul comme avec les pièces antiques : il écrivait à peine un siècle après les faits, notamment pour des souverains qui détenaient leur pouvoir de la chute dudit Richard III. Donc il fallait bien qu'il soit un méchant absolu pour justifier des monarques actuels. Certes, certes, mais un peu de nuance tout de même, eût été appréciable, du moins l'eus-je grandement apprécié (je sens que je glisse de plus en plus sur ma " l'eus-je ").
Non, le canevas est grossier mais le fil à broder, lui, est parfois d'une finesse exquise. C'est particulièrement flagrant si on compare, à titre d'exemple Richard III et le Roi Lear. J'ai également éprouvé beaucoup de peine avec le canevas du Roi Lear et à très peu d'endroits j'ai été séduite par le verbe ou le sens de la formule. Ici, c'est tout différent. Beaucoup de répliques fusent et sont de purs joyaux d'orfèvrerie élisabéthaine.
Bref, pas trop ma tasse de thé quant au fond, bien plus séduite en revanche par la forme. Lisez, si le coeur vous en dit « La Tragédie de Richard III, avec le débarquement du comte de Richmond et la bataille de Bosworth » (titre complet de la pièce) afin de connaître comment se termina la fameuse Guerre des deux Roses opposant les horribles Lancastre aux infâmes York (tous plus ou moins descendants de rois de France, ce n'est pas une référence !) racontée à la sauce Shakespeare.
Et encore, gardez à l'esprit que ceci n'est que mon avis, qu'il ne vaut pas grand-chose, en tout cas beaucoup moins qu'un cheval. Un cheval ! Un cheval ! Mon avis pour un cheval !
Que valent nos avis ? Pas grand-chose !...
Ma première rencontre avec le grand Shakespeare remonte aux temps chéris — autant que révolus — de ma fragile innocence, de ma fringante jeunesse sous le ciel immaculé de mes vingt-deux ans. Ce fut avec Hamlet que la rencontre se fit et je lus Hamlet, donc, et il ne me plut point. J'en gardais alors le souvenir d'une déconvenue, de beaucoup de bruit pour rien, d'un texte aux couleurs fades et aux contours ampoulés, bref, d'un redoutable ennui.
Je ne me sentais pourtant pas moins vive en ce temps-là, ni moins prompte à m'enflammer, ni moins sensible aux choses du verbe que je ne le suis actuellement, or — oui or, car il y a un or — or, donc, je ne fus point séduite par le verbe de naguère, qui n'est point si distant, je crois, du verbe de maintenant. Seule ma culture dramatique était à un seuil dramatiquement bas.
Aujourd'hui, forte de quelques plis supplémentaires au coin des yeux et de deux ou trois tragédies ramassées deci-delà sur mon parcours, prise d'un légitime regret je me relance à l'abordage de cette oeuvre.
Certes j'ai pris quelque temps et mis quelque zèle à choisir une traduction qui puisse me convenir. C'est sur celle d'André Marcowicz que j'ai jeté mon dévolu cette fois (l'autre fois c'était celle de François-Victor Hugo).
Et alors ? C'est le jour et la nuit. (Chapeau pour cette traduction Monsieur Marcowicz !) Je n'en reviens pas. Comment peut-on, étant la même personne, ressentir les choses aussi différemment à quelques années d'écart ?
J'ai adoré la légèreté, l'humour, la finesse, la profondeur, la qualité d'écriture de l'ensemble de la pièce (pas trop le final cependant). C'était un autre Hamlet et celui-là j'en garderai un souvenir ému et chaleureux.
Comment vous dire ?... Il y a des poussières d'Hamlet disséminées tellement partout que c'est à peine si j'ose, que je ne sais par où le prendre. Peut-être par le plus futile de tous ? Pourquoi pas ?
Les clins d'oeil à Hamlet sont fréquents dans les oeuvres destinées à la jeunesse.
Goscinny s'en donne à coeur joie dans l'album La Grande Traversée (Parodiant la réplique de Marcelus de l'acte I, le chef viking Øbsen dit en regardant un crâne : « Il y a quelque chøse de pøurri dåns mon røyåume… » Kerøsen quant à lui dit : « Suis-je un décøuvreur øu ne le suis-je pas ?... Être øu ne pås être, telle est lå questiøn… »). de même, tout le scénario du film de Walt Disney le Roi Lion est une resucée quasi-intégrale de la trame d'Hamlet. Même le fantôme du vieil Hamlet apparaissant à son fils a son pendant dans le film. Chez les écrivains un peu plus chevronnés, on peut mentionner que Rudyard Kipling, dans son ouvrage destiné à la jeunesse Histoires Comme Ça, a inséré le fameux poème « IF » qui est très largement inspiré de la tirade de Polonius (Acte I, Scène 3).
Dans la littérature dite adulte, Hamlet, en époux volage, a aussi fait des petits un peu partout (par exemple, la fameuse scène hilarante du chapitre XXXI des Grandes Espérances de Charles Dickens). Mais c'est quoi Hamlet ? À quoi ou à qui peut-il nous faire penser ?
Tout d'abord, si l'on s'intéresse à sa filiation, et l'on sait à quel point Shakespeare était féru de tragédie grecque, on y voit une ascendance très nette en la personne d'Oreste. Lui aussi est fils d'un roi qui s'est fait trucider et dont la mère s'est remariée au nouveau souverain usurpateur. (Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, frère d'Électre ne supporte pas l'assassinat de son père et décide de devenir le meurtrier de sa mère qui a fomenté le régicide.)
Le thème de la trahison, du doublage par un frère (le vieil Hamlet est assassiné par son frère Claudius) est un thème qui semble fort et important pour l'auteur (cf. Le Roi Lear, Jules César, etc.), c'est d'ailleurs le corps de l'ultime drame de Shakespeare, La Tempête, où Prospero a échappé in extremis à la mort et s'est fait subtiliser le trône par son frère.
Le thème de la mort, ou plus particulièrement de l'inutilité de la vie, est également un sujet de prédilection du grand dramaturge anglais et qui figure au coeur d'Hamlet, d'où cette fameuse tirade du « être ou ne pas être ».
Mais si tout cela est vrai et fort, ce qui me semble plus fort et plus évident que tout — et qui m'avait totalement échappé à la première lecture — c'est la réflexion sur le théâtre qui est contenue dans cette tragi-comédie et c'est la théorie que je vais défendre ci-dessous.
Pour bien analyser la question, observons l'architecture, la structure de l'oeuvre :
Acte I — révélation du meurtre de son père à Hamlet et de l'usurpation de son trône. Hamlet est par conséquent renvoyé à un rôle subalterne.
Acte II — la « folie » d'Hamlet, prise de position sur le théâtre et mise en abîme (le théâtre montre le théâtre). Révélation du stratagème du « théâtre » du roi et de la reine pour cerner Hamlet dans ses amours. Mise en évidence d'un double discours dans ce « théâtre ». Incompréhension d'Hamlet et d'Ophélie.
Acte III — Hamlet, à son tour, utilise le stratagème du théâtre. le théâtre apparaît alors en tant que révélateur de la vérité de l'âme humaine derrière les apparences. Révélation de leur propre trahison au roi et à la reine. Assassinat par Hamlet de Polonius, le courtisan intéressé et qui s'était caché.
Acte IV — le pouvoir veut emmener Hamlet en Angleterre pour le tuer. Réapparition de Laërte, fils de Polonius, sorte de dédoublement d'Hamlet, qui lui aussi veut venger la mort de son père.
Acte V — On en a oublié Ophélie qui meurt sans qu'on s'en soit trop occupé, on ne sait que la pleurer. Réflexion sur la mort à l'occasion de l'enterrement d'Ophélie. Combat organisé par le roi entre Hamlet et Laërte. Mort des deux opposants qui entraînent dans leur fin celle du roi.
Voilà, très grossièrement l'ossature de la pièce. Permettez-moi simplement maintenant de vous dire ce que ces personnages m'évoquent :
Hamlet, C'EST le théâtre, dans l'acception la plus noble du terme. C'est lui le révélateur, c'est lui qui voit clair dans le jeu orchestré par le roi et c'est lui qui est déchu par la vilenie du pouvoir.
Le roi symbolise évidemment le pouvoir, en tant qu'autorité qui muselle l'activité artistique de peur qu'elle ne montre trop explicitement ses propres exactions.
Laërte, c'est l'autre théâtre, le théâtre d'état, le théâtre qui dit ce que le roi veut entendre, celui qui est aux bottes du pouvoir.
Les deux théâtres se livrent une lutte à mort, et qui est sacrifié au milieu d'eux ? le public, évidemment, et ici le public est symbolisé par Ophélie, qui devient folle.
La reine représente la conscience, la morale à qui l'on a tordu le cou pour avaler des couleuvres.
Polonius représente les seconds couteaux, le peuple nombreux des courtisans hypocrites qui lèchent les savates de tout pouvoir, quel qu'il soit, et qui se font étriller par le théâtre (pensez aux bourgeois, aux savants ou aux religieux chez Molière, par exemple) car si l'on ne peut taper sur le pouvoir, on peut tout de même se faire la main sur les courtisans. Mais on peut aussi (et surtout) voir dans Polonius, l'archétype du puritain (voir les conseils qu'il donne à son fils), très en vogue et toujours plus près du pouvoir à l'époque de Shakespeare.
Et la moralité de tout cela, c'est qu'un pouvoir qui n'est pas capable de se regarder en face sous le révélateur, sous le miroir de vérité qu'est le théâtre, tellement il a honte de lui-même est voué à disparaître.
Pour conclure, si l'on recontextualise la genèse de cette pièce avec les événements historiques dont l'auteur était le témoin, ce qu'il faut voir dans Hamlet, ce n'est ni une tragédie (ou tragi-comédie), ni un quelconque message métaphysique, mais bien plutôt une supplique politique pour maintenir les théâtres publics élisabéthains et leur liberté d'expression face aux attaques toujours plus virulentes des puritains qui essaient d'imposer leur théâtre moralisateur. On sait par ailleurs que les craintes de Shakespeare étaient fondées car les puritains obtiendront gain de cause avec la fermeture des théâtres publics en 1642 (notamment le Théâtre du Globe où était joué Shakespeare).
Vu comme cela, cette pièce est absolument lumineuse, forte, pleine de sens et de désillusions, bref, essentielle. Une oeuvre, donc, qu'il faut absolument lire, mais, comme je l'ai expérimenté moi-même, peut-être pas trop tôt et pas sans s'être muni au préalable d'une petite patine en matière de théâtre, du moins c'est mon minuscule avis face à cette immense pièce, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Ma première rencontre avec le grand Shakespeare remonte aux temps chéris — autant que révolus — de ma fragile innocence, de ma fringante jeunesse sous le ciel immaculé de mes vingt-deux ans. Ce fut avec Hamlet que la rencontre se fit et je lus Hamlet, donc, et il ne me plut point. J'en gardais alors le souvenir d'une déconvenue, de beaucoup de bruit pour rien, d'un texte aux couleurs fades et aux contours ampoulés, bref, d'un redoutable ennui.
Je ne me sentais pourtant pas moins vive en ce temps-là, ni moins prompte à m'enflammer, ni moins sensible aux choses du verbe que je ne le suis actuellement, or — oui or, car il y a un or — or, donc, je ne fus point séduite par le verbe de naguère, qui n'est point si distant, je crois, du verbe de maintenant. Seule ma culture dramatique était à un seuil dramatiquement bas.
Aujourd'hui, forte de quelques plis supplémentaires au coin des yeux et de deux ou trois tragédies ramassées deci-delà sur mon parcours, prise d'un légitime regret je me relance à l'abordage de cette oeuvre.
Certes j'ai pris quelque temps et mis quelque zèle à choisir une traduction qui puisse me convenir. C'est sur celle d'André Marcowicz que j'ai jeté mon dévolu cette fois (l'autre fois c'était celle de François-Victor Hugo).
Et alors ? C'est le jour et la nuit. (Chapeau pour cette traduction Monsieur Marcowicz !) Je n'en reviens pas. Comment peut-on, étant la même personne, ressentir les choses aussi différemment à quelques années d'écart ?
J'ai adoré la légèreté, l'humour, la finesse, la profondeur, la qualité d'écriture de l'ensemble de la pièce (pas trop le final cependant). C'était un autre Hamlet et celui-là j'en garderai un souvenir ému et chaleureux.
Comment vous dire ?... Il y a des poussières d'Hamlet disséminées tellement partout que c'est à peine si j'ose, que je ne sais par où le prendre. Peut-être par le plus futile de tous ? Pourquoi pas ?
Les clins d'oeil à Hamlet sont fréquents dans les oeuvres destinées à la jeunesse.
Goscinny s'en donne à coeur joie dans l'album La Grande Traversée (Parodiant la réplique de Marcelus de l'acte I, le chef viking Øbsen dit en regardant un crâne : « Il y a quelque chøse de pøurri dåns mon røyåume… » Kerøsen quant à lui dit : « Suis-je un décøuvreur øu ne le suis-je pas ?... Être øu ne pås être, telle est lå questiøn… »). de même, tout le scénario du film de Walt Disney le Roi Lion est une resucée quasi-intégrale de la trame d'Hamlet. Même le fantôme du vieil Hamlet apparaissant à son fils a son pendant dans le film. Chez les écrivains un peu plus chevronnés, on peut mentionner que Rudyard Kipling, dans son ouvrage destiné à la jeunesse Histoires Comme Ça, a inséré le fameux poème « IF » qui est très largement inspiré de la tirade de Polonius (Acte I, Scène 3).
Dans la littérature dite adulte, Hamlet, en époux volage, a aussi fait des petits un peu partout (par exemple, la fameuse scène hilarante du chapitre XXXI des Grandes Espérances de Charles Dickens). Mais c'est quoi Hamlet ? À quoi ou à qui peut-il nous faire penser ?
Tout d'abord, si l'on s'intéresse à sa filiation, et l'on sait à quel point Shakespeare était féru de tragédie grecque, on y voit une ascendance très nette en la personne d'Oreste. Lui aussi est fils d'un roi qui s'est fait trucider et dont la mère s'est remariée au nouveau souverain usurpateur. (Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, frère d'Électre ne supporte pas l'assassinat de son père et décide de devenir le meurtrier de sa mère qui a fomenté le régicide.)
Le thème de la trahison, du doublage par un frère (le vieil Hamlet est assassiné par son frère Claudius) est un thème qui semble fort et important pour l'auteur (cf. Le Roi Lear, Jules César, etc.), c'est d'ailleurs le corps de l'ultime drame de Shakespeare, La Tempête, où Prospero a échappé in extremis à la mort et s'est fait subtiliser le trône par son frère.
Le thème de la mort, ou plus particulièrement de l'inutilité de la vie, est également un sujet de prédilection du grand dramaturge anglais et qui figure au coeur d'Hamlet, d'où cette fameuse tirade du « être ou ne pas être ».
Mais si tout cela est vrai et fort, ce qui me semble plus fort et plus évident que tout — et qui m'avait totalement échappé à la première lecture — c'est la réflexion sur le théâtre qui est contenue dans cette tragi-comédie et c'est la théorie que je vais défendre ci-dessous.
Pour bien analyser la question, observons l'architecture, la structure de l'oeuvre :
Acte I — révélation du meurtre de son père à Hamlet et de l'usurpation de son trône. Hamlet est par conséquent renvoyé à un rôle subalterne.
Acte II — la « folie » d'Hamlet, prise de position sur le théâtre et mise en abîme (le théâtre montre le théâtre). Révélation du stratagème du « théâtre » du roi et de la reine pour cerner Hamlet dans ses amours. Mise en évidence d'un double discours dans ce « théâtre ». Incompréhension d'Hamlet et d'Ophélie.
Acte III — Hamlet, à son tour, utilise le stratagème du théâtre. le théâtre apparaît alors en tant que révélateur de la vérité de l'âme humaine derrière les apparences. Révélation de leur propre trahison au roi et à la reine. Assassinat par Hamlet de Polonius, le courtisan intéressé et qui s'était caché.
Acte IV — le pouvoir veut emmener Hamlet en Angleterre pour le tuer. Réapparition de Laërte, fils de Polonius, sorte de dédoublement d'Hamlet, qui lui aussi veut venger la mort de son père.
Acte V — On en a oublié Ophélie qui meurt sans qu'on s'en soit trop occupé, on ne sait que la pleurer. Réflexion sur la mort à l'occasion de l'enterrement d'Ophélie. Combat organisé par le roi entre Hamlet et Laërte. Mort des deux opposants qui entraînent dans leur fin celle du roi.
Voilà, très grossièrement l'ossature de la pièce. Permettez-moi simplement maintenant de vous dire ce que ces personnages m'évoquent :
Hamlet, C'EST le théâtre, dans l'acception la plus noble du terme. C'est lui le révélateur, c'est lui qui voit clair dans le jeu orchestré par le roi et c'est lui qui est déchu par la vilenie du pouvoir.
Le roi symbolise évidemment le pouvoir, en tant qu'autorité qui muselle l'activité artistique de peur qu'elle ne montre trop explicitement ses propres exactions.
Laërte, c'est l'autre théâtre, le théâtre d'état, le théâtre qui dit ce que le roi veut entendre, celui qui est aux bottes du pouvoir.
Les deux théâtres se livrent une lutte à mort, et qui est sacrifié au milieu d'eux ? le public, évidemment, et ici le public est symbolisé par Ophélie, qui devient folle.
La reine représente la conscience, la morale à qui l'on a tordu le cou pour avaler des couleuvres.
Polonius représente les seconds couteaux, le peuple nombreux des courtisans hypocrites qui lèchent les savates de tout pouvoir, quel qu'il soit, et qui se font étriller par le théâtre (pensez aux bourgeois, aux savants ou aux religieux chez Molière, par exemple) car si l'on ne peut taper sur le pouvoir, on peut tout de même se faire la main sur les courtisans. Mais on peut aussi (et surtout) voir dans Polonius, l'archétype du puritain (voir les conseils qu'il donne à son fils), très en vogue et toujours plus près du pouvoir à l'époque de Shakespeare.
Et la moralité de tout cela, c'est qu'un pouvoir qui n'est pas capable de se regarder en face sous le révélateur, sous le miroir de vérité qu'est le théâtre, tellement il a honte de lui-même est voué à disparaître.
Pour conclure, si l'on recontextualise la genèse de cette pièce avec les événements historiques dont l'auteur était le témoin, ce qu'il faut voir dans Hamlet, ce n'est ni une tragédie (ou tragi-comédie), ni un quelconque message métaphysique, mais bien plutôt une supplique politique pour maintenir les théâtres publics élisabéthains et leur liberté d'expression face aux attaques toujours plus virulentes des puritains qui essaient d'imposer leur théâtre moralisateur. On sait par ailleurs que les craintes de Shakespeare étaient fondées car les puritains obtiendront gain de cause avec la fermeture des théâtres publics en 1642 (notamment le Théâtre du Globe où était joué Shakespeare).
Vu comme cela, cette pièce est absolument lumineuse, forte, pleine de sens et de désillusions, bref, essentielle. Une oeuvre, donc, qu'il faut absolument lire, mais, comme je l'ai expérimenté moi-même, peut-être pas trop tôt et pas sans s'être muni au préalable d'une petite patine en matière de théâtre, du moins c'est mon minuscule avis face à cette immense pièce, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Un conte déchirant qui a le goût et l'odeur du sang ; une épopée fantasmagorique où des forces néfastes s'emparent des âmes pour les souiller ; une aventure humaine, sombre et poignante, où l'ambition fait sauter toutes les digues, toutes les retenues ; où le remord lacère et grignote ; où le réel s'altère ; où les êtres s'égarent aux portes de la folie…
Le fracas des armes, et les chevauchées fantastiques à travers la lande. Dans ce château enveloppé de brumes, les cris d'effroi du roi Macbeth quand le fantôme de Banquo surgit de terre. Lui ! capable de combattre mille hommes, et le grand loup, et l'ours, et le lion, se retrouve impuissant face à cette apparition venue des ténèbres… Les couloirs venteux remplis d'ombres inquiétantes où se perd Lady Macbeth, repoussant vainement de son corps ses belles mains couvertes de sang. Tous ces « poignards dans les sourires ». Les ricanements sadiques des sorcières qui se jouent de la naïveté et de la convoitise des Hommes.
Et la prophétie qui s'accomplit quand la forêt de Birnam vient à celle de Dunsiname pour mettre fin à la course de la vie du roi Macbeth, et de son règne contre-nature…
Respirez un grand coup, serrez les dents, et laissez-vous emporter par le flot tumultueux de ce texte intemporel.
Un texte pour la légende.
Le fracas des armes, et les chevauchées fantastiques à travers la lande. Dans ce château enveloppé de brumes, les cris d'effroi du roi Macbeth quand le fantôme de Banquo surgit de terre. Lui ! capable de combattre mille hommes, et le grand loup, et l'ours, et le lion, se retrouve impuissant face à cette apparition venue des ténèbres… Les couloirs venteux remplis d'ombres inquiétantes où se perd Lady Macbeth, repoussant vainement de son corps ses belles mains couvertes de sang. Tous ces « poignards dans les sourires ». Les ricanements sadiques des sorcières qui se jouent de la naïveté et de la convoitise des Hommes.
Et la prophétie qui s'accomplit quand la forêt de Birnam vient à celle de Dunsiname pour mettre fin à la course de la vie du roi Macbeth, et de son règne contre-nature…
Respirez un grand coup, serrez les dents, et laissez-vous emporter par le flot tumultueux de ce texte intemporel.
Un texte pour la légende.
Est-ce bien ou mal de dire que la pièce Richard III de William Shakespeare, malgré l'importance littéraire et la renommée internationale de son auteur, se fait surtout l'écho de la version de l'Histoire que les Tudor ont voulu laisser après eux ? Il ne suffisait pas, en effet, à cette dynastie, que des historiens complaisants lui attribuent le beau rôle - ici celui donné à Henry VII, le vainqueur de la bataille de Bosworth, livrée en août 1485, qui permit au fils de Margareth Beaufort de ramasser sur le champ de bataille la couronne tombée à terre du roi Richard III, présenté comme le monstrueux faiseur d'homicide avec l'élimination à lui prêtée des deux fils de son frère défunt, Édouard IV (1442-1483), il leur fallait encore que la littérature s'en mêlât et fît prendre les apparences pour la réalité : qui n'est pas tenté, se référant au dramaturge anglais, d'attribuer à Richard III l'assassinat dans la White Tower d'Édouard V et de Richard de Shrewsbury, ses jeunes neveux ? Shakespeare a noirci à souhait le personnage, le montrant sous son jour le plus sombre, afin, par contraste, de faire passer Henry VII comme un pur héros et un innocent aux mains propres venu rétablir la justice dans son pays. Aussi Stanley, passant du camp de Richard à celui d'Henry VII, le jour de la grande explication, n'a-t-il pas, sous la plume de William Shakespeare les allures d'un traître mais plutôt le visage d'un homme qui, par son revirement, rend possible la revanche légitime des victimes par rapport au bourreau.
Vision simplificatrice de l'Histoire, bien évidemment, mais qui parvient si facilement à convaincre auditoire et lecteurs de cette pièce de théâtre, devenue un grand classique - c'est du grand art, forcément manichéen dans sa présentation factice de la lutte du bien contre le mal, que les historiens ont quelque difficulté, de nos jours, à nuancer tout cela.
Désormais, cependant, même si l'on aime cette pièce, on ne pourra plus dire qu'elle reflète totalement la réalité historique, même si Richard III n'est pas exempt de reproches, bien évidemment.
François Sarindar, auteur de Charles V, Dauphin, duc et régent (1338-1358)
Vision simplificatrice de l'Histoire, bien évidemment, mais qui parvient si facilement à convaincre auditoire et lecteurs de cette pièce de théâtre, devenue un grand classique - c'est du grand art, forcément manichéen dans sa présentation factice de la lutte du bien contre le mal, que les historiens ont quelque difficulté, de nos jours, à nuancer tout cela.
Désormais, cependant, même si l'on aime cette pièce, on ne pourra plus dire qu'elle reflète totalement la réalité historique, même si Richard III n'est pas exempt de reproches, bien évidemment.
François Sarindar, auteur de Charles V, Dauphin, duc et régent (1338-1358)
Othello est une tragédie sublime, au sens premier, au sens profond, dans l'acception antique du terme, c'est-à-dire, de la création d'une oeuvre artistique capable de susciter les plus vives émotions chez le spectateur, afin de gagner son empathie, de le faire vivre par procuration des émotions aussi fortes que les personnages fictifs qui évoluent devant lui.
Ici, je ne pense pas que le spectateur moderne puisse encore aller fréquemment jusqu'aux larmes, ni à la tristesse ni à l'abattement mais à l'indignation, probablement ; une forte indignation intérieure devant cet infâme complot de cet infâme Iago, sorte de copie du Maure de Titus Andronicus. Notre sens inné de la justice, même non formulé, même fort enfoui, même inconscient, même volontairement muselé, ne peut que s'insurger face à une telle ignominie, et c'est précisément ce sentiment que recherchait William Shakespeare et qu'il arrive à faire éclore admirablement, aujourd'hui comme hier et pour des siècles encore.
De multiples interprétations peuvent rendre compte d'Othello. On y a souvent trouvé une certaine énigme dans son titre car le protagoniste principal semble bien davantage Iago qu'Othello.
Il est vraiment clair, d'un simple point de vue statistique, que Iago monopolise la scène et qu'Othello n'est presque qu'un personnage secondaire, comme tous les autres d'ailleurs. C'est indéniable.
Par contre, si l'on se penche sur la signification, sur ce qu'a voulu exprimer Shakespeare, là le titre commence à prendre toute son envergure. Car c'est bien à la place d'Othello que l'auteur souhaite nous placer, et non à la place de Iago. C'est bien l'oeuvre de Iago sur Othello qui indigne et non les motifs intimes du fourbe qui présentent un intérêt.
Le message, du moins l'un des messages possibles de cette oeuvre, est le noircissement. Je ne blague pas, et le fait que Shakespeare ait choisi un personnage noir comme héros d'infortune n'a sans doute rien d'hasardeux. L'apparence. Celui qui semble noir l'est-il bien réellement ?
Tous. Tous semblent noirs à un moment ou à un autre : Cassio, Desdémone, Othello. Tous noirs et pourtant tous innocents. Malgré tout, on jurerait, selon l'angle où ils sont présentés les uns aux autres, qu'ils sont coupables.
C'est probablement ça, le plus fort du message que souhaite nous donner en pâture l'auteur. Honni soit qui mal y pense ! Il est si facile de nuire, si facile de noircir, si facile de truquer, si facile de faire dire autre chose aux faits pris indépendamment ou hors contexte. C'est cela que semble nous dire Shakespeare. Les apparences sont parfois contre nous et d'autres semblent blancs comme neige, et pourtant… et pourtant…, pourtant, quand on sait tout le fin mot, vraiment tout, la réalité est souvent loin des belles apparences et ce que l'on croyait simple, net, tranché, évident, ne l'est plus tant que cela.
Othello d'emblée est noir, ce qui jette sur lui une indéfinissable suspicion aux yeux des Vénitiens. Tout prétexte sera bon s'il fait le moindre faux-pas. Cassio est un beau subordonné prometteur, donc il est douteux. Desdémone est une noble Vénitienne blanche entichée d'un noir, donc c'est nécessairement une putain. Autant de raccourcis faciles mais que nous avons tous tendance, consciemment ou inconsciemment, à commettre ici ou là. L'histoire a donné plusieurs fois raison à Shakespeare. (Rien qu'en France, au XXème siècle, des Juifs, des Maghrébins en tant que groupe ou des individualités comme Guillaume Seznec ont tous fait l'objet d'accusations plus ou moins calomnieuses ou bâties de toute pièce, basées sur des a priori ou des apparences qui leur étaient adverses. Je ne parle évidemment pas de tous les endroits du monde et à toutes les périodes depuis Shakespeare, car il y aurait de quoi remplir tout Babelio avec.)
Si l'on cherche des fautes à quelqu'un, on en trouvera fatalement. Si l'on sait habilement les mettre en lumière, leur donner d'autres apparences, attiser le vent de la vengeance, mobiliser la justice à son avantage, n'importe qui peut être traîné dans la boue ou commettre l'irréparable.
Quels sont les mobiles de tout cela ? L'auteur reste très discret et très flou sur les motivations de Iago. Cela semble tourner autour de la jalousie, de l'orgueil bafoué, de l'envie inassouvie, du complexe d'infériorité.
Intéressons nous encore quelques instants à Iago. Ce qui est frappant dans le texte, dans les qualificatifs qu'on lui attribue, c'est le nombre de fois où reviennent, les adjectifs noble, honnête, fidèle, courageux, droit, fiable, vertueux, etc. Encore une fois, si l'on se place à l'époque de Shakespeare pour tâcher d'y voir plus clair, la meilleure explication, la principale justification à cette pièce est l'admirable travail de sape réalisé par les puritains à l'égard du théâtre élisabéthain.
Iago, dans cette optique, est donc le symbole du puritanisme, Othello, le noir à qui l'on fait commettre des abjections ne saurait être autre que Shakespeare lui-même, Cassio, représenterait alors quelque autre auteur contemporain de Shakespeare comme Christopher Marlowe ou Ben Johnson. Les abjections des uns et des autres sont les écrits vils qu'ils étaient obligés de pondre, pamphlets notamment, simplement pour pouvoir gagner moindrement leur vie.
Desdémone, celle qui est totalement innocente est qui est sacrifiée serait alors la déesse aux cent bouches, à savoir le public, qui fait les frais des fermetures de théâtres sous la houlette des Puritains.
Voilà le type de message que je vois dans Othello, la dénonciation de la calomnie à l'égard des dramaturges honnêtes qu'on accuse de toutes les perversions, mais ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose. le mieux que vous ayez à faire, c'est encore d'ouvrir un Othello et de vous en faire votre propre opinion
Ici, je ne pense pas que le spectateur moderne puisse encore aller fréquemment jusqu'aux larmes, ni à la tristesse ni à l'abattement mais à l'indignation, probablement ; une forte indignation intérieure devant cet infâme complot de cet infâme Iago, sorte de copie du Maure de Titus Andronicus. Notre sens inné de la justice, même non formulé, même fort enfoui, même inconscient, même volontairement muselé, ne peut que s'insurger face à une telle ignominie, et c'est précisément ce sentiment que recherchait William Shakespeare et qu'il arrive à faire éclore admirablement, aujourd'hui comme hier et pour des siècles encore.
De multiples interprétations peuvent rendre compte d'Othello. On y a souvent trouvé une certaine énigme dans son titre car le protagoniste principal semble bien davantage Iago qu'Othello.
Il est vraiment clair, d'un simple point de vue statistique, que Iago monopolise la scène et qu'Othello n'est presque qu'un personnage secondaire, comme tous les autres d'ailleurs. C'est indéniable.
Par contre, si l'on se penche sur la signification, sur ce qu'a voulu exprimer Shakespeare, là le titre commence à prendre toute son envergure. Car c'est bien à la place d'Othello que l'auteur souhaite nous placer, et non à la place de Iago. C'est bien l'oeuvre de Iago sur Othello qui indigne et non les motifs intimes du fourbe qui présentent un intérêt.
Le message, du moins l'un des messages possibles de cette oeuvre, est le noircissement. Je ne blague pas, et le fait que Shakespeare ait choisi un personnage noir comme héros d'infortune n'a sans doute rien d'hasardeux. L'apparence. Celui qui semble noir l'est-il bien réellement ?
Tous. Tous semblent noirs à un moment ou à un autre : Cassio, Desdémone, Othello. Tous noirs et pourtant tous innocents. Malgré tout, on jurerait, selon l'angle où ils sont présentés les uns aux autres, qu'ils sont coupables.
C'est probablement ça, le plus fort du message que souhaite nous donner en pâture l'auteur. Honni soit qui mal y pense ! Il est si facile de nuire, si facile de noircir, si facile de truquer, si facile de faire dire autre chose aux faits pris indépendamment ou hors contexte. C'est cela que semble nous dire Shakespeare. Les apparences sont parfois contre nous et d'autres semblent blancs comme neige, et pourtant… et pourtant…, pourtant, quand on sait tout le fin mot, vraiment tout, la réalité est souvent loin des belles apparences et ce que l'on croyait simple, net, tranché, évident, ne l'est plus tant que cela.
Othello d'emblée est noir, ce qui jette sur lui une indéfinissable suspicion aux yeux des Vénitiens. Tout prétexte sera bon s'il fait le moindre faux-pas. Cassio est un beau subordonné prometteur, donc il est douteux. Desdémone est une noble Vénitienne blanche entichée d'un noir, donc c'est nécessairement une putain. Autant de raccourcis faciles mais que nous avons tous tendance, consciemment ou inconsciemment, à commettre ici ou là. L'histoire a donné plusieurs fois raison à Shakespeare. (Rien qu'en France, au XXème siècle, des Juifs, des Maghrébins en tant que groupe ou des individualités comme Guillaume Seznec ont tous fait l'objet d'accusations plus ou moins calomnieuses ou bâties de toute pièce, basées sur des a priori ou des apparences qui leur étaient adverses. Je ne parle évidemment pas de tous les endroits du monde et à toutes les périodes depuis Shakespeare, car il y aurait de quoi remplir tout Babelio avec.)
Si l'on cherche des fautes à quelqu'un, on en trouvera fatalement. Si l'on sait habilement les mettre en lumière, leur donner d'autres apparences, attiser le vent de la vengeance, mobiliser la justice à son avantage, n'importe qui peut être traîné dans la boue ou commettre l'irréparable.
Quels sont les mobiles de tout cela ? L'auteur reste très discret et très flou sur les motivations de Iago. Cela semble tourner autour de la jalousie, de l'orgueil bafoué, de l'envie inassouvie, du complexe d'infériorité.
Intéressons nous encore quelques instants à Iago. Ce qui est frappant dans le texte, dans les qualificatifs qu'on lui attribue, c'est le nombre de fois où reviennent, les adjectifs noble, honnête, fidèle, courageux, droit, fiable, vertueux, etc. Encore une fois, si l'on se place à l'époque de Shakespeare pour tâcher d'y voir plus clair, la meilleure explication, la principale justification à cette pièce est l'admirable travail de sape réalisé par les puritains à l'égard du théâtre élisabéthain.
Iago, dans cette optique, est donc le symbole du puritanisme, Othello, le noir à qui l'on fait commettre des abjections ne saurait être autre que Shakespeare lui-même, Cassio, représenterait alors quelque autre auteur contemporain de Shakespeare comme Christopher Marlowe ou Ben Johnson. Les abjections des uns et des autres sont les écrits vils qu'ils étaient obligés de pondre, pamphlets notamment, simplement pour pouvoir gagner moindrement leur vie.
Desdémone, celle qui est totalement innocente est qui est sacrifiée serait alors la déesse aux cent bouches, à savoir le public, qui fait les frais des fermetures de théâtres sous la houlette des Puritains.
Voilà le type de message que je vois dans Othello, la dénonciation de la calomnie à l'égard des dramaturges honnêtes qu'on accuse de toutes les perversions, mais ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose. le mieux que vous ayez à faire, c'est encore d'ouvrir un Othello et de vous en faire votre propre opinion
Le Marchand De Venise est une pièce difficile entre toutes à interpréter de nos jours. Et cela, essentiellement en raison de l'histoire récente, c'est-à-dire du XXème siècle, mais on se rend compte en allant plus loin que cette pièce a été très diversement interprétée même auparavant, en fonction de l'air du temps.
Pourquoi cela ? Après tout, une pièce de théâtre c'est une pièce de théâtre, donne-t-on des interprétations diamétralement opposées de Roméo Et Juliette ou de Macbeth en fonction des époques ? Bien sûr, ici, on marche sur des œufs car il y est question d'un Juif en la personne de Shylock. Et comme à chaque fois qu'il est question d'un Juif autrement qu'en termes élogieux, les banderoles de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme ne sont jamais très loin.
Il y a pourtant, ce me semble, une différence notable entre un William Shakespeare, qui met des nuances, qui taille des costumes à diverses communautés, qui ne généralise jamais les travers à l'ensemble d'une communauté et un Martin Luther, par exemple, qui lui signe un véritable brûlot contre les Juifs.
De quoi est-il question dans cette pièce ? Nous sommes à Venise à une époque non clairement spécifiée mais deux ou trois indices nous portent à croire qu'il s'agit de l'époque contemporaine de Shakespeare. Nous y voyons un noble, Bassanio, beau de sa personne et de manières élégantes mais qui n'a malheureusement plus le sou à force de flamber à droite à gauche.
Il sollicite donc l'aide financière de son grand ami (certains ont vu une relation homosexuelle possible, moi, je n'en sais rien) Antonio, le marchand de Venise, afin de pouvoir aller courtiser la belle Portia, qui fait palpiter son cœur. Jusque là, rien de très intéressant, une scène sentimentale et sirupeuse comme je les déteste.
Ce qui devient plus intéressant, c'est le contraste que Shakespeare va créer entre un commerçant juif et son marchand de Venise, brave chrétien, et qui en tant que brave chrétien, aurait honte de prêter de l'argent avec intérêt. L'ennui, c'est que précisément en ce moment, il est en attente du retour de plusieurs de ses bateaux si bien qu'il manque de liquidités à présenter de suite.
Et c'est ici qu'intervient le personnage le plus intéressant (et le plus controversé) de la pièce, à savoir, le Juif Shylock, qui lui est un champion de l'usure, un vrai banquier aux dents longues. Et il est vrai que ce personnage de Shylock est extrêmement peu attachant : cupide, calculateur, procédurier, hargneux, rancunier, double, etc.
Tous les personnages principaux du Marchand De Venise ont des noms à consonance italienne ou méditerranéenne sauf lui, Shylock, un nom qui, pour le public anglais de l'époque n'est pas sans signification : shy, timide et lock, la serrure, le verrou, le cadenas. Donc un nom qui possède déjà en soi un certain potentiel comique en tant que métonymie du coffre-fort qui ne s'ouvre que timidement. De nos jours, Shylock est un nom devenu tellement célèbre qu'il désigne carrément le type même de l'usurier cupide et sans scrupule. Nul doute, donc, que c'est bien Shylock le véritable personnage principal de la pièce, bien avant celui d'Antonio.
C'est une caricature de l'usurier juif et la caricature est, ce me semble, l'un des traits saillants de la comédie. Je signale au passage que Shakespeare donne dans cette même pièce une caricature de l'Écossais type (radin), de l'Anglais type (inculte), de l'Allemand type (ivrogne) et du Français type (fanfaron écervelé), toutes moins reluisantes les unes que les autres. Faut-il s'en offusquer et y percevoir un sentiment anti écossais, anti anglais, anti allemand et anti français ?
D'ailleurs, très intelligemment, William Shakespeare montre que Shylock a été copieusement brocardé par les chrétiens et qu'au moins une partie de son comportement vient en réaction de mauvaises actions perpétrées par les chrétiens à son encontre.
Je ne pense nullement que Shakespeare ait voulu s'en prendre à l'ensemble de la communauté juive, car il présente la fille de Shylock, Jessica comme un personnage positif (qui certes se convertit au christianisme). Je crois que ce que fustige Shakespeare au travers de Shylock, c'est le comportement de l'usurier, du banquier.
Car à l'époque de Shakespeare, la mutation de la société du moral au vénal, du religieux vers l'argent est déjà très palpable (sans jeu de mot) et le personnage qui incarne le mieux cette mutation ne peut être qu'un banquier. Et comme la religion chrétienne encore très présente à tous les niveaux voyait d'un mauvais œil cette profession, celle-ci était très souvent occupée par des Juifs.
Mais de là à généraliser au fait que tous les Juifs soient banquiers, fielleux et rancuniers il y a un pas, un gigantesque pas et que, selon moi, Shakespeare ne franchit absolument pas. L'auteur s'en prend à Shylock et au seul Shylock. Son côté chicanier et procédurier est risible mais c'est justement en tombant sur un as de la chicane qu'il se fait avoir. (Je vous passe sous silence l'identité de cet as de la chicane car cela vaut son pesant de cacahuètes et je vous laisse le découvrir par vous-même.)
À aucun moment Shakespeare ne reproche une quelconque malhonnêteté à Shylock ; il spécifie même qu'il possède un véritable talent pour les affaires, un flair très aiguisé. C'est donc quelqu'un de très doué dans sa profession. Ce qu'il lui reproche, c'est de pratiquer l'usure et d'avoir tendance à passer l'amour de l'argent avant l'amour du prochain. Je vois dans son obstination à réclamer 500 grammes de chair d'Antonio une volonté de faire souffrir celui qui l'a auparavant beaucoup fait souffrir. Je vois plus du " œil pour œil, dent pour dent " qu'une réelle méchanceté gratuite.
En somme, j'ai encore le sentiment que c'est un mauvais procès qu'on fait à Shakespeare, comme souvent de nos jours quand on ose avancer la moindre critique vis-à-vis d'un Juif, on brandit illico l'étiquette antisémite. Par exemple, l'autre grand auteur anglais, Charles Dickens, qui a écrit un livre entier pour condamner l'intolérance religieuse (Barnabé Rudge) notamment pratiquée par les Protestants, mais on lui reproche toujours son fameux personnage juif de Fagin dans Oliver Twist.
Donc, maintenant que vous savez qu'aussi bien Dickens que Shakespeare sont des antisémites notoires, que peut-on encore dire de cette pièce ? Le rôle des femmes y est prépondérant mais les historiettes amoureuses à répétition qui s'y trament m'ont semblé ennuyeuses : trop de bons sentiments, trop de simplicité, trop d'intrigues téléphonées. Pour obtenir la main de la belle Portia, il faut passer l'épreuve imaginée par son père avant de mourir ; choisir parmi trois coffrets : l'un empli d'or, l'autre l'argent et le troisième de plomb. Seul le bon coffret — selon les critères du père — contient le portrait de sa fille et donc l'autorisation au mariage. Mmouais… probablement pas ce que Shakespeare a fait de mieux…
De même, le personnage malheureux du marchand de Venise, c'est-à-dire Antonio, le bon et brave chrétien, est d'un mièvre à pleurer, d'une bonté surnaturelle sauf à l'endroit du Juif qu'il ne peut supporter. De même, la belle et bonne Portia se montre franchement raciste lorsqu'il s'agit du prince Maroc, que l'auteur présente de façon plutôt élogieuse. Preuve, s'il en était besoin après Othello que Shakespeare s'attache à la valeur des hommes pris individuellement et ne s'attaque pas à des communautés en tant que communautés. Mais ça, ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose, libre à vous de penser tout autrement.
Pourquoi cela ? Après tout, une pièce de théâtre c'est une pièce de théâtre, donne-t-on des interprétations diamétralement opposées de Roméo Et Juliette ou de Macbeth en fonction des époques ? Bien sûr, ici, on marche sur des œufs car il y est question d'un Juif en la personne de Shylock. Et comme à chaque fois qu'il est question d'un Juif autrement qu'en termes élogieux, les banderoles de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme ne sont jamais très loin.
Il y a pourtant, ce me semble, une différence notable entre un William Shakespeare, qui met des nuances, qui taille des costumes à diverses communautés, qui ne généralise jamais les travers à l'ensemble d'une communauté et un Martin Luther, par exemple, qui lui signe un véritable brûlot contre les Juifs.
De quoi est-il question dans cette pièce ? Nous sommes à Venise à une époque non clairement spécifiée mais deux ou trois indices nous portent à croire qu'il s'agit de l'époque contemporaine de Shakespeare. Nous y voyons un noble, Bassanio, beau de sa personne et de manières élégantes mais qui n'a malheureusement plus le sou à force de flamber à droite à gauche.
Il sollicite donc l'aide financière de son grand ami (certains ont vu une relation homosexuelle possible, moi, je n'en sais rien) Antonio, le marchand de Venise, afin de pouvoir aller courtiser la belle Portia, qui fait palpiter son cœur. Jusque là, rien de très intéressant, une scène sentimentale et sirupeuse comme je les déteste.
Ce qui devient plus intéressant, c'est le contraste que Shakespeare va créer entre un commerçant juif et son marchand de Venise, brave chrétien, et qui en tant que brave chrétien, aurait honte de prêter de l'argent avec intérêt. L'ennui, c'est que précisément en ce moment, il est en attente du retour de plusieurs de ses bateaux si bien qu'il manque de liquidités à présenter de suite.
Et c'est ici qu'intervient le personnage le plus intéressant (et le plus controversé) de la pièce, à savoir, le Juif Shylock, qui lui est un champion de l'usure, un vrai banquier aux dents longues. Et il est vrai que ce personnage de Shylock est extrêmement peu attachant : cupide, calculateur, procédurier, hargneux, rancunier, double, etc.
Tous les personnages principaux du Marchand De Venise ont des noms à consonance italienne ou méditerranéenne sauf lui, Shylock, un nom qui, pour le public anglais de l'époque n'est pas sans signification : shy, timide et lock, la serrure, le verrou, le cadenas. Donc un nom qui possède déjà en soi un certain potentiel comique en tant que métonymie du coffre-fort qui ne s'ouvre que timidement. De nos jours, Shylock est un nom devenu tellement célèbre qu'il désigne carrément le type même de l'usurier cupide et sans scrupule. Nul doute, donc, que c'est bien Shylock le véritable personnage principal de la pièce, bien avant celui d'Antonio.
C'est une caricature de l'usurier juif et la caricature est, ce me semble, l'un des traits saillants de la comédie. Je signale au passage que Shakespeare donne dans cette même pièce une caricature de l'Écossais type (radin), de l'Anglais type (inculte), de l'Allemand type (ivrogne) et du Français type (fanfaron écervelé), toutes moins reluisantes les unes que les autres. Faut-il s'en offusquer et y percevoir un sentiment anti écossais, anti anglais, anti allemand et anti français ?
D'ailleurs, très intelligemment, William Shakespeare montre que Shylock a été copieusement brocardé par les chrétiens et qu'au moins une partie de son comportement vient en réaction de mauvaises actions perpétrées par les chrétiens à son encontre.
Je ne pense nullement que Shakespeare ait voulu s'en prendre à l'ensemble de la communauté juive, car il présente la fille de Shylock, Jessica comme un personnage positif (qui certes se convertit au christianisme). Je crois que ce que fustige Shakespeare au travers de Shylock, c'est le comportement de l'usurier, du banquier.
Car à l'époque de Shakespeare, la mutation de la société du moral au vénal, du religieux vers l'argent est déjà très palpable (sans jeu de mot) et le personnage qui incarne le mieux cette mutation ne peut être qu'un banquier. Et comme la religion chrétienne encore très présente à tous les niveaux voyait d'un mauvais œil cette profession, celle-ci était très souvent occupée par des Juifs.
Mais de là à généraliser au fait que tous les Juifs soient banquiers, fielleux et rancuniers il y a un pas, un gigantesque pas et que, selon moi, Shakespeare ne franchit absolument pas. L'auteur s'en prend à Shylock et au seul Shylock. Son côté chicanier et procédurier est risible mais c'est justement en tombant sur un as de la chicane qu'il se fait avoir. (Je vous passe sous silence l'identité de cet as de la chicane car cela vaut son pesant de cacahuètes et je vous laisse le découvrir par vous-même.)
À aucun moment Shakespeare ne reproche une quelconque malhonnêteté à Shylock ; il spécifie même qu'il possède un véritable talent pour les affaires, un flair très aiguisé. C'est donc quelqu'un de très doué dans sa profession. Ce qu'il lui reproche, c'est de pratiquer l'usure et d'avoir tendance à passer l'amour de l'argent avant l'amour du prochain. Je vois dans son obstination à réclamer 500 grammes de chair d'Antonio une volonté de faire souffrir celui qui l'a auparavant beaucoup fait souffrir. Je vois plus du " œil pour œil, dent pour dent " qu'une réelle méchanceté gratuite.
En somme, j'ai encore le sentiment que c'est un mauvais procès qu'on fait à Shakespeare, comme souvent de nos jours quand on ose avancer la moindre critique vis-à-vis d'un Juif, on brandit illico l'étiquette antisémite. Par exemple, l'autre grand auteur anglais, Charles Dickens, qui a écrit un livre entier pour condamner l'intolérance religieuse (Barnabé Rudge) notamment pratiquée par les Protestants, mais on lui reproche toujours son fameux personnage juif de Fagin dans Oliver Twist.
Donc, maintenant que vous savez qu'aussi bien Dickens que Shakespeare sont des antisémites notoires, que peut-on encore dire de cette pièce ? Le rôle des femmes y est prépondérant mais les historiettes amoureuses à répétition qui s'y trament m'ont semblé ennuyeuses : trop de bons sentiments, trop de simplicité, trop d'intrigues téléphonées. Pour obtenir la main de la belle Portia, il faut passer l'épreuve imaginée par son père avant de mourir ; choisir parmi trois coffrets : l'un empli d'or, l'autre l'argent et le troisième de plomb. Seul le bon coffret — selon les critères du père — contient le portrait de sa fille et donc l'autorisation au mariage. Mmouais… probablement pas ce que Shakespeare a fait de mieux…
De même, le personnage malheureux du marchand de Venise, c'est-à-dire Antonio, le bon et brave chrétien, est d'un mièvre à pleurer, d'une bonté surnaturelle sauf à l'endroit du Juif qu'il ne peut supporter. De même, la belle et bonne Portia se montre franchement raciste lorsqu'il s'agit du prince Maroc, que l'auteur présente de façon plutôt élogieuse. Preuve, s'il en était besoin après Othello que Shakespeare s'attache à la valeur des hommes pris individuellement et ne s'attaque pas à des communautés en tant que communautés. Mais ça, ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose, libre à vous de penser tout autrement.
Voici encore une bien belle tragédie historique de William Shakespeare qui tient toutes ses promesses. Personnellement j'ai adoré l'ambivalence qui caractérise presque tous les personnages principaux de cette pièce.
Cela en fait une pièce très subtile, tout en nuances. Certes, on retrouve chez Cassius, notamment en début de pièce, quelque chose du machiavélisme du Iago d'Othello, de Richard III ou encore du Maure de Titus Andronicus, mais l'auteur s'attache à justement le réhabiliter en en faisant un personnage certes envieux mais non dénué de qualités réelles et positives.
L'ambiguïté est encore plus affirmée et de façon croisée et symétrique entre Brutus — le traitre — d'une part et Octave — le sauveur — d'autre part. On a en effet de la peine à considérer Brutus comme un sale type et Octave comme un type bien.
Que dire enfin du somptueux personnage d'Antoine dont le discours funèbre auprès de la dépouille De César est un modèle de sophisme d'une roublardise délicieuse.
En somme, le seul qui soit vraiment très discret et d'un intérêt moindre dans cette pièce c'est… Jules César lui même ! On le voit en effet très peu, mais, du peu que l'on voit de lui, Shakespeare s'attache là encore à en faire un personnage très humain, comme tous les autres, avec ses bons et ses mauvais penchants.
Le fait que Shakespeare se soit énormément basé sur les sources antiques comme Plutarque et qu'il y soit globalement resté très fidèle, imprime une rythme particulier à la pièce qui n'est pas comme à l'ordinaire dans les tragédies une apothéose au cinquième acte, si possible baignée de sang.
Ici, le point d'orgue se situe au tout début de l'Acte III et sépare donc la pièce en deux moments très distincts : tout d'abord la conspiration contre César sous la houlette de Cassius et ensuite la contre conspiration contre les conjurés organisée par Antoine.
On retrouve dans cette tragédie bon nombre des ferments, des ficelles du scénario d'un Star Wars, par exemple. Brutus et Cassius, à eux deux, présentent à peu près les pulsions contradictoires qui animent un Dark Vador. Antoine a sûrement quelque chose d'un jeune Luke Skywalker, Portia, l'épouse de Brutus possède elle aussi certains traits de la Princesse Amidala, etc.
En somme, une trame historique aménagée pour en faire un support scénique admirable. Shakespeare ne cède à aucune facilité et l'ensemble de la pièce est remarquablement écrit. Certes on n'y trouve pas de ces tirades sensationnelles comme dans Hamlet, Macbeth, Richard III ou encore La Tempête, mais ce Jules César m'a beaucoup plu et je le place assez haut dans mon palmarès personnel des oeuvres de son auteur. Ceci dit, souvenez-vous que ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, très peu de chose.
Cela en fait une pièce très subtile, tout en nuances. Certes, on retrouve chez Cassius, notamment en début de pièce, quelque chose du machiavélisme du Iago d'Othello, de Richard III ou encore du Maure de Titus Andronicus, mais l'auteur s'attache à justement le réhabiliter en en faisant un personnage certes envieux mais non dénué de qualités réelles et positives.
L'ambiguïté est encore plus affirmée et de façon croisée et symétrique entre Brutus — le traitre — d'une part et Octave — le sauveur — d'autre part. On a en effet de la peine à considérer Brutus comme un sale type et Octave comme un type bien.
Que dire enfin du somptueux personnage d'Antoine dont le discours funèbre auprès de la dépouille De César est un modèle de sophisme d'une roublardise délicieuse.
En somme, le seul qui soit vraiment très discret et d'un intérêt moindre dans cette pièce c'est… Jules César lui même ! On le voit en effet très peu, mais, du peu que l'on voit de lui, Shakespeare s'attache là encore à en faire un personnage très humain, comme tous les autres, avec ses bons et ses mauvais penchants.
Le fait que Shakespeare se soit énormément basé sur les sources antiques comme Plutarque et qu'il y soit globalement resté très fidèle, imprime une rythme particulier à la pièce qui n'est pas comme à l'ordinaire dans les tragédies une apothéose au cinquième acte, si possible baignée de sang.
Ici, le point d'orgue se situe au tout début de l'Acte III et sépare donc la pièce en deux moments très distincts : tout d'abord la conspiration contre César sous la houlette de Cassius et ensuite la contre conspiration contre les conjurés organisée par Antoine.
On retrouve dans cette tragédie bon nombre des ferments, des ficelles du scénario d'un Star Wars, par exemple. Brutus et Cassius, à eux deux, présentent à peu près les pulsions contradictoires qui animent un Dark Vador. Antoine a sûrement quelque chose d'un jeune Luke Skywalker, Portia, l'épouse de Brutus possède elle aussi certains traits de la Princesse Amidala, etc.
En somme, une trame historique aménagée pour en faire un support scénique admirable. Shakespeare ne cède à aucune facilité et l'ensemble de la pièce est remarquablement écrit. Certes on n'y trouve pas de ces tirades sensationnelles comme dans Hamlet, Macbeth, Richard III ou encore La Tempête, mais ce Jules César m'a beaucoup plu et je le place assez haut dans mon palmarès personnel des oeuvres de son auteur. Ceci dit, souvenez-vous que ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, très peu de chose.
Ah ! C'est sûr, c'est pas du Game of Thrones™, ce truc-là ! C'est pas demain que l'insignifiant Shakespeare, avec ses faibles moyens (même pas labellisé HBO, c'est tout dire !), arrivera à la cheville du GRAND monsieur Martin™, et fera pulser le coeur de toutes les midinettes à coup de dragons et de morts-vivants !
Ah ! C'est sûr, c'est pas non plus un crac, ici, l'ami Shakespeare, en fratrie de loups extralucides, en hémoglobine bon marché, en têtes virilement sectionnées, en bacchanales baisatoires (voilà ce qui plait aux jouvenceaux, n'est-ce pas, Monsieur Martin™, c'est ça qu'est tout bon), ni en tout ce qui fait le fond de comm… euh ! la valeur artistique, voulais-je écrire, du Trône de fer ™ & associés. (Car tout le monde ne peut pas être aussi subtil que le grand, GRAND monsieur Martin™…)
(Quoique, quoique, dans le théâtre élisabéthain, j'en connais deux ou trois qui se défendent assez bien sur le registre subtil de l'hémoglobine, notamment un obscur Christopher Marlowe dans Massacre à Paris ou l'insignifiant Shakespeare, toujours lui, dans Titus Andronicus, et quoique, quoique notre inimitable et génialissime monsieur Martin™ ait peut-être un tout petit peu emprunté, oh si peu !, à l'insignifiant Shakespeare son Falstaff pour imaginer son gros roi Baratheon. Et peut-être même quelques autres… Ah ! Qui sait ? Qui sait ?…
Bref ! Triste époque que la nôtre qui porte aux nues du réchauffé de bas aloi et qui s'extasie sur des livres pour ado ! Qu'en restera-t-il dans 400 ans ?… Dormez tranquille, Messire Shakespeare.)
Bien sûr, il faut tout de même connaître un peu l'histoire anglaise du Moyen-Âge pour savourer pleinement toute les subtilités de cette tragédie historique. Basée sur des faits réels (enjolivés ou modifiés au besoin), cette pièce en cinq actes nous représente une usurpation du pouvoir légitime d'un roi par un prétendant aux dents longues, en l'espèce, son propre cousin.
C'est une fois encore chez Shakespeare très finement observé et cette pièce, dans son style, — n'ayons pas peur des mots — est un petit bijou, mais lequel style ou lequel bijou ne sont pas forcément très en vogue en ce moment, la faute à qui vous savez. La pièce s'ouvre sur un Richard II triomphant, respecté ou craint, c'est selon, et dont la légitimité ne fait aucun doute.
Très habilement, par petites touches, William Shakespeare s'applique à nous le montrer volontiers inique ou quelque peu tyran. Du moins, un roi faible, qui sait mal s'entourer et surtout mal distinguer, parmi la horde de ses courtisans, ceux qui le veulent bien conseiller de ceux qui misent pour leur propre compte.
Il s'ensuit que l'état des finances royales est un désastre et qu'il faut puiser à toutes les sources possibles pour réinjecter de l'argent frais afin de faire fonctionner l'appareil royal. La pièce débute sur un différend, une dénonciation d'un notable par un notable où seul l'arbitrage du roi pourra sceller la sentence.
Or, c'est dans cet exercice que Richard II se montre peu ferme, peu sûr et peu fiable. Le plaignant, c'est Henry Bolingbroke, le propre cousin du roi, fils de Jean de Gand, le frère du père du roi. L'accusé est un important lord — l'un des plus puissants —, en la personne de Thomas Mowbray, duc de Norfolk, comte de Nottingham, homme de confiance du roi. Henry Bolingbroke accuse Thomas Mowbray d'avoir fomenté l'assassinat de leur oncle commun au roi et à lui-même, à savoir, Thomas Woodstock, ainsi que d'avoir détourné des fonds royaux.
Le roi se révèle incapable de juger et de mettre un terme à cette querelle, probablement par un reste de scrupule religieux, car il sait très bien que c'est lui-même le commanditaire de l'assassinat en question et que s'il autorise ce qui semble être le plus naturel, à savoir un duel en bonne et due forme, le sang d'un innocent va couler inutilement.
Il va donc prendre deux mauvaises décisions : le bannissement respectif des deux plaignants, créant un fort sentiment d'injustice, notamment vis-à-vis de Bolingbroke, même si, témoin encore de sa faiblesse, le père Jean de Gand obtient facilement un amenuisement de la peine de son fils.
Gestion financière calamiteuse, écoute de mauvais conseils, décisions douteuses et jugées injustes, grogne populaire en raison de l'élévation des taxes et impôts divers destinés à combler les trésoreries du roi. Il ne manquait plus que deux petits éléments déclencheurs pour conduire un tel roi à sa propre perte : une rébellion des Irlandais à aller mater et un cruel manque d'argent pour mener cette guerre qui oblige à dépouiller les cousins bannis, par exemple.
Arrive donc un Henry Bolingbroke dans son bon droit, jouissant d'un support populaire important et victime d'une visible injustice. Peu à peu, les rouages s'enclenchent, les rats engraissés sous le règne de Richard quittent vite le navire quand le vent du changement souffle.
Très habilement, l'auteur sait nous dépeindre les mutations psychologiques réciproques qui s'opèrent chez chacun des deux cousins, l'un devenant peu à peu martyr et l'autre peu à peu tyran, c'est marrant (N. B. : il s'agit d'un calembour mathématique dont l'équation est la suivante : MARTYR — TYRAN = MARRANT car TYR — TYR = 0 … bon, OK, je sors…).
C'est étonnant comme cette histoire d'une usurpation du pouvoir m'a fait penser, toutes proportions gardées, à l'ascension de Hitler aux dépens de Hindenburg, thème qu'a exploité Bertolt Brecht dans La Résistible Ascension d'Arturo Ui. Lequel usurpateur, Henry Bolingbroke, sera sacré sous le titre de Henry IV, et deviendra le sujet d'une autre pièce de Shakespeare.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette pièce, qui m'a permis de mesurer mon niveau d'inculture en matière d'histoire médiévale britannique, mais je conçois qu'on ne soit pas forcément féru de ce genre de recherches historiques pour mieux comprendre sa lecture, d'où mon appréciation mesurée. Mais c'est pourtant, selon moi, une pièce qui vaut le détour.
Intéressante psychologiquement et politiquement, tout en étant également intéressante à replacer dans son contexte d'écriture : Elisabeth Ière n'ayant, elle non plus, pas d'héritier. Elle ne s'est d'ailleurs pas méprise sur la signification profonde de cette pièce ; à savoir semer la discorde, parmi les prétendants au trône (qui n'était pas en fer), comme ce fût le cas plus tard chez les Plantagenet, descendants d'Henry IV et ceux du duc d'York. Mais ceci est une autre histoire qui nous mènerait bien trop loin.
En somme, voici une bien belle tragédie, sans hémoglobine, sans pathos excessif, sans scène de cul, tout en nuance et en réflexion, de la belle ouvrage, loin, loin, loin du racolage trône de ferresque, mais ce n'est, bien évidemment, que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. : je ne doute pas que mes prises de positions au détriment de Game of Thrones risquent d'offusquer certains lecteurs ou lectrices. Mais comme je mets un point d'honneur à argumenter mes points de vue, je vous demande, avant de me jeter quelques pleines cagettes de tomates pourries d'aller lire, ne serait-ce que Titus Andronicus, pour vous faire votre propre opinion et constater que, grosso modo, le destin d'Eddard Stark et de sa famille dans le Trône de fer est une resucée quasi intégrale de Shakespeare.
Les fameux « changements de point de vue » tant vantés par les admirateurs de monsieur Martin™, ne sont rien d'autre, rien de plus que ce que Shakespeare a opéré en écrivant Hamlet d'un côté et Macbeth de l'autre. Le personnage de Cersei Lannister/Baratheon est un remake de Lady Macbeth. J'ai déjà parlé de Falstaff mais on retrouve également dans la série l'équivalent du personnage de Iago (Othello). Quant à Jon Snow, de ce que j'en ai compris (Je vous concède que je me suis arrêtée à la première saison quand j'ai compris que jamais décidément jamais je n'accrocherai à cette mélasse.), c'est plus ou moins un Hamlet.
Le titre même du premier bouquin de Martin™, « Le Trône de fer » est un quasi plagiat de celui des Rois maudits de Maurice Druon dont le premier volume s'intitulait « Le Roi de fer ». Et si vous regardez bien, point par point, pratiquement tout a été pompé à droite ou à gauche mais en n'omettant jamais d'y adjoindre une petite touche bien racoleuse, comme ce que fait un peu Quentin Tarentino dans ses derniers films.
Là où William Shakespeare fait de la littérature, au sens le plus noble du terme, quitte à utiliser le sang ou les plus bas instincts de l'homme, George R. R. Martin fait, lui, de la soupe, une vieille bouillabaisse qui pue, pas le poisson, malheureusement, ça ce serait encore tenable, mais bien plus puant encore : le côté obscur de la littérature, sa négation absolue contaminée par le kitsch et le retour sur investissement. Du bien bon commercial qui tache…
LUKE LITERATUREWALKER : Est-ce que le côté obscur est le plus fort ?
GUSTAVE YODA : Plus facile, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur de la littérature, mais pas meilleur il est. Si par le côté obscur de la littérature tu te laisses séduire, jamais plus tu ne…
… et vous connaissez la suite.
Ah ! C'est sûr, c'est pas non plus un crac, ici, l'ami Shakespeare, en fratrie de loups extralucides, en hémoglobine bon marché, en têtes virilement sectionnées, en bacchanales baisatoires (voilà ce qui plait aux jouvenceaux, n'est-ce pas, Monsieur Martin™, c'est ça qu'est tout bon), ni en tout ce qui fait le fond de comm… euh ! la valeur artistique, voulais-je écrire, du Trône de fer ™ & associés. (Car tout le monde ne peut pas être aussi subtil que le grand, GRAND monsieur Martin™…)
(Quoique, quoique, dans le théâtre élisabéthain, j'en connais deux ou trois qui se défendent assez bien sur le registre subtil de l'hémoglobine, notamment un obscur Christopher Marlowe dans Massacre à Paris ou l'insignifiant Shakespeare, toujours lui, dans Titus Andronicus, et quoique, quoique notre inimitable et génialissime monsieur Martin™ ait peut-être un tout petit peu emprunté, oh si peu !, à l'insignifiant Shakespeare son Falstaff pour imaginer son gros roi Baratheon. Et peut-être même quelques autres… Ah ! Qui sait ? Qui sait ?…
Bref ! Triste époque que la nôtre qui porte aux nues du réchauffé de bas aloi et qui s'extasie sur des livres pour ado ! Qu'en restera-t-il dans 400 ans ?… Dormez tranquille, Messire Shakespeare.)
Bien sûr, il faut tout de même connaître un peu l'histoire anglaise du Moyen-Âge pour savourer pleinement toute les subtilités de cette tragédie historique. Basée sur des faits réels (enjolivés ou modifiés au besoin), cette pièce en cinq actes nous représente une usurpation du pouvoir légitime d'un roi par un prétendant aux dents longues, en l'espèce, son propre cousin.
C'est une fois encore chez Shakespeare très finement observé et cette pièce, dans son style, — n'ayons pas peur des mots — est un petit bijou, mais lequel style ou lequel bijou ne sont pas forcément très en vogue en ce moment, la faute à qui vous savez. La pièce s'ouvre sur un Richard II triomphant, respecté ou craint, c'est selon, et dont la légitimité ne fait aucun doute.
Très habilement, par petites touches, William Shakespeare s'applique à nous le montrer volontiers inique ou quelque peu tyran. Du moins, un roi faible, qui sait mal s'entourer et surtout mal distinguer, parmi la horde de ses courtisans, ceux qui le veulent bien conseiller de ceux qui misent pour leur propre compte.
Il s'ensuit que l'état des finances royales est un désastre et qu'il faut puiser à toutes les sources possibles pour réinjecter de l'argent frais afin de faire fonctionner l'appareil royal. La pièce débute sur un différend, une dénonciation d'un notable par un notable où seul l'arbitrage du roi pourra sceller la sentence.
Or, c'est dans cet exercice que Richard II se montre peu ferme, peu sûr et peu fiable. Le plaignant, c'est Henry Bolingbroke, le propre cousin du roi, fils de Jean de Gand, le frère du père du roi. L'accusé est un important lord — l'un des plus puissants —, en la personne de Thomas Mowbray, duc de Norfolk, comte de Nottingham, homme de confiance du roi. Henry Bolingbroke accuse Thomas Mowbray d'avoir fomenté l'assassinat de leur oncle commun au roi et à lui-même, à savoir, Thomas Woodstock, ainsi que d'avoir détourné des fonds royaux.
Le roi se révèle incapable de juger et de mettre un terme à cette querelle, probablement par un reste de scrupule religieux, car il sait très bien que c'est lui-même le commanditaire de l'assassinat en question et que s'il autorise ce qui semble être le plus naturel, à savoir un duel en bonne et due forme, le sang d'un innocent va couler inutilement.
Il va donc prendre deux mauvaises décisions : le bannissement respectif des deux plaignants, créant un fort sentiment d'injustice, notamment vis-à-vis de Bolingbroke, même si, témoin encore de sa faiblesse, le père Jean de Gand obtient facilement un amenuisement de la peine de son fils.
Gestion financière calamiteuse, écoute de mauvais conseils, décisions douteuses et jugées injustes, grogne populaire en raison de l'élévation des taxes et impôts divers destinés à combler les trésoreries du roi. Il ne manquait plus que deux petits éléments déclencheurs pour conduire un tel roi à sa propre perte : une rébellion des Irlandais à aller mater et un cruel manque d'argent pour mener cette guerre qui oblige à dépouiller les cousins bannis, par exemple.
Arrive donc un Henry Bolingbroke dans son bon droit, jouissant d'un support populaire important et victime d'une visible injustice. Peu à peu, les rouages s'enclenchent, les rats engraissés sous le règne de Richard quittent vite le navire quand le vent du changement souffle.
Très habilement, l'auteur sait nous dépeindre les mutations psychologiques réciproques qui s'opèrent chez chacun des deux cousins, l'un devenant peu à peu martyr et l'autre peu à peu tyran, c'est marrant (N. B. : il s'agit d'un calembour mathématique dont l'équation est la suivante : MARTYR — TYRAN = MARRANT car TYR — TYR = 0 … bon, OK, je sors…).
C'est étonnant comme cette histoire d'une usurpation du pouvoir m'a fait penser, toutes proportions gardées, à l'ascension de Hitler aux dépens de Hindenburg, thème qu'a exploité Bertolt Brecht dans La Résistible Ascension d'Arturo Ui. Lequel usurpateur, Henry Bolingbroke, sera sacré sous le titre de Henry IV, et deviendra le sujet d'une autre pièce de Shakespeare.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette pièce, qui m'a permis de mesurer mon niveau d'inculture en matière d'histoire médiévale britannique, mais je conçois qu'on ne soit pas forcément féru de ce genre de recherches historiques pour mieux comprendre sa lecture, d'où mon appréciation mesurée. Mais c'est pourtant, selon moi, une pièce qui vaut le détour.
Intéressante psychologiquement et politiquement, tout en étant également intéressante à replacer dans son contexte d'écriture : Elisabeth Ière n'ayant, elle non plus, pas d'héritier. Elle ne s'est d'ailleurs pas méprise sur la signification profonde de cette pièce ; à savoir semer la discorde, parmi les prétendants au trône (qui n'était pas en fer), comme ce fût le cas plus tard chez les Plantagenet, descendants d'Henry IV et ceux du duc d'York. Mais ceci est une autre histoire qui nous mènerait bien trop loin.
En somme, voici une bien belle tragédie, sans hémoglobine, sans pathos excessif, sans scène de cul, tout en nuance et en réflexion, de la belle ouvrage, loin, loin, loin du racolage trône de ferresque, mais ce n'est, bien évidemment, que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. : je ne doute pas que mes prises de positions au détriment de Game of Thrones risquent d'offusquer certains lecteurs ou lectrices. Mais comme je mets un point d'honneur à argumenter mes points de vue, je vous demande, avant de me jeter quelques pleines cagettes de tomates pourries d'aller lire, ne serait-ce que Titus Andronicus, pour vous faire votre propre opinion et constater que, grosso modo, le destin d'Eddard Stark et de sa famille dans le Trône de fer est une resucée quasi intégrale de Shakespeare.
Les fameux « changements de point de vue » tant vantés par les admirateurs de monsieur Martin™, ne sont rien d'autre, rien de plus que ce que Shakespeare a opéré en écrivant Hamlet d'un côté et Macbeth de l'autre. Le personnage de Cersei Lannister/Baratheon est un remake de Lady Macbeth. J'ai déjà parlé de Falstaff mais on retrouve également dans la série l'équivalent du personnage de Iago (Othello). Quant à Jon Snow, de ce que j'en ai compris (Je vous concède que je me suis arrêtée à la première saison quand j'ai compris que jamais décidément jamais je n'accrocherai à cette mélasse.), c'est plus ou moins un Hamlet.
Le titre même du premier bouquin de Martin™, « Le Trône de fer » est un quasi plagiat de celui des Rois maudits de Maurice Druon dont le premier volume s'intitulait « Le Roi de fer ». Et si vous regardez bien, point par point, pratiquement tout a été pompé à droite ou à gauche mais en n'omettant jamais d'y adjoindre une petite touche bien racoleuse, comme ce que fait un peu Quentin Tarentino dans ses derniers films.
Là où William Shakespeare fait de la littérature, au sens le plus noble du terme, quitte à utiliser le sang ou les plus bas instincts de l'homme, George R. R. Martin fait, lui, de la soupe, une vieille bouillabaisse qui pue, pas le poisson, malheureusement, ça ce serait encore tenable, mais bien plus puant encore : le côté obscur de la littérature, sa négation absolue contaminée par le kitsch et le retour sur investissement. Du bien bon commercial qui tache…
LUKE LITERATUREWALKER : Est-ce que le côté obscur est le plus fort ?
GUSTAVE YODA : Plus facile, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur de la littérature, mais pas meilleur il est. Si par le côté obscur de la littérature tu te laisses séduire, jamais plus tu ne…
… et vous connaissez la suite.
"Though this be madness, yet there is method in't"
(Acte II, scène II)
Malgré la température printanière relativement douce et les oiseaux qui chantent dans le jardin, j'ai les doigts qui tremblent, quand je me décide enfin à écrire ces quelques mots sur "Hamlet".
Hamlet, c'est Hamlet. Je ne vais pas pousser ma prétention jusqu'à vouloir en faire une quelconque analyse, et je trouve superflu de raconter l'intrigue une fois de plus.
Ainsi, ceci n'est pas vraiment une "critique", et, de toute façon... "Words, words, words !"
Dans ma vie, il y avait des moments où je détestais Shakespeare de tout mon coeur. Il est vrai qu'il nous a laissé "Richard III" et les sonnets pour la Dark Lady, mais il a fait mourir Hamlet - dans cet instant crucial où tous les rouages déréglés d'un monde complètement fou s'imbriquent enfin, et recommencent à fonctionner à peu près normalement. Je n'ai jamais pu le lui pardonner.
Hamlet, l'adolescent déséquilibré, qui a envie d'en finir.
Hamlet, qui ne vit plus que pour la vengeance.
Hamlet, le seul être lucide, obligé de prétendre la folie au milieu des fous d'amour, du pouvoir, de l'ascension sociale ?
Hamlet, qui aime Ophélie à mourir, et qui l'envoie dans un couvent.
Hamlet avec le crâne de Yorick..
Si ce sont seulement des fous qui peuvent aimer Hamlet le fou, alors j'ai envie de revendiquer la folie et chercher une bande d'acteurs pour aider à démasquer les traîtres.
J'ai vu pas mal d'interprétations, et même si à chaque fois Hamlet-acteur meurt à la fin, même la plus mauvaise n'a pas tout à fait réussi à tuer Hamlet-pièce.
Mais je crois que pour moi, Hamlet va garder à tout jamais le visage de l'acteur Laurence Olivier.
Vous avez tout, dans ce film. La dépression géniale qui vous tombe dessus quand vous arpentez les fortifications glaciales d'Elseneur, le goût de la folie et le désir de régner, la terreur que vous inspirent les âmes déchirées des protagonistes principaux. Vous allez vous incliner jusqu'à terre devant les nobles dialogues - sans jamais comprendre comment ce sacré Will a pu faire.
Ses mots caressent, et en même temps, délibérément, tuent.
La terrible passion servie dans la coupe de vin empoisonné de la reine Gertrude.
"Je suis Hamlet. La violence, j'en veux pas.
Moi sur la couronne danoise, j'ai craché.
Mais, à leurs yeux, je voulais être roi
et mon rival, j'ai massacré.
Un vrai délire, cette éruption géniale.
La mort voit la vie comme une malfaçon.
Tous, nous avons une réponse déloyale
Sans jamais trouver une bonne question"
(Vladimir Vyssotski, poète et chanteur russe. Excellent Hamlet sur scène)
Cinq sur cinq, cancre de Stratford. Saura-t-on jamais qui tu étais, pour pouvoir écrire des mots pareils ?
That is the question...
(Acte II, scène II)
Malgré la température printanière relativement douce et les oiseaux qui chantent dans le jardin, j'ai les doigts qui tremblent, quand je me décide enfin à écrire ces quelques mots sur "Hamlet".
Hamlet, c'est Hamlet. Je ne vais pas pousser ma prétention jusqu'à vouloir en faire une quelconque analyse, et je trouve superflu de raconter l'intrigue une fois de plus.
Ainsi, ceci n'est pas vraiment une "critique", et, de toute façon... "Words, words, words !"
Dans ma vie, il y avait des moments où je détestais Shakespeare de tout mon coeur. Il est vrai qu'il nous a laissé "Richard III" et les sonnets pour la Dark Lady, mais il a fait mourir Hamlet - dans cet instant crucial où tous les rouages déréglés d'un monde complètement fou s'imbriquent enfin, et recommencent à fonctionner à peu près normalement. Je n'ai jamais pu le lui pardonner.
Hamlet, l'adolescent déséquilibré, qui a envie d'en finir.
Hamlet, qui ne vit plus que pour la vengeance.
Hamlet, le seul être lucide, obligé de prétendre la folie au milieu des fous d'amour, du pouvoir, de l'ascension sociale ?
Hamlet, qui aime Ophélie à mourir, et qui l'envoie dans un couvent.
Hamlet avec le crâne de Yorick..
Si ce sont seulement des fous qui peuvent aimer Hamlet le fou, alors j'ai envie de revendiquer la folie et chercher une bande d'acteurs pour aider à démasquer les traîtres.
J'ai vu pas mal d'interprétations, et même si à chaque fois Hamlet-acteur meurt à la fin, même la plus mauvaise n'a pas tout à fait réussi à tuer Hamlet-pièce.
Mais je crois que pour moi, Hamlet va garder à tout jamais le visage de l'acteur Laurence Olivier.
Vous avez tout, dans ce film. La dépression géniale qui vous tombe dessus quand vous arpentez les fortifications glaciales d'Elseneur, le goût de la folie et le désir de régner, la terreur que vous inspirent les âmes déchirées des protagonistes principaux. Vous allez vous incliner jusqu'à terre devant les nobles dialogues - sans jamais comprendre comment ce sacré Will a pu faire.
Ses mots caressent, et en même temps, délibérément, tuent.
La terrible passion servie dans la coupe de vin empoisonné de la reine Gertrude.
"Je suis Hamlet. La violence, j'en veux pas.
Moi sur la couronne danoise, j'ai craché.
Mais, à leurs yeux, je voulais être roi
et mon rival, j'ai massacré.
Un vrai délire, cette éruption géniale.
La mort voit la vie comme une malfaçon.
Tous, nous avons une réponse déloyale
Sans jamais trouver une bonne question"
(Vladimir Vyssotski, poète et chanteur russe. Excellent Hamlet sur scène)
Cinq sur cinq, cancre de Stratford. Saura-t-on jamais qui tu étais, pour pouvoir écrire des mots pareils ?
That is the question...
Une pièce superbe. Une écriture vive et belle, malgré les altérations subies par l'anglais depuis lors et l'outrage que constitue toute tentative de traduction, quelle qu'elle soit.
Comment voulez-vous rendre en polonais, en laotien, en swahili, en hindi ou en piètre français des formules aussi sublimes que : « We are such stuff as dreams are made on ; and our little life is rounded with a sleep… »
Pour vous en convaincre, essayez donc de traduire en anglais le fameux « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Vous obtenez des choses miteuses dans le genre : « Triumph without peril brings no glory » ou bien « In conquering without danger we triumph without glory. » ou bien alors l'indigent « To win without risk is to triumph without glory » ou encore l'horrible « If one beats without difficulty, one triumphs without glory ». Bref, des bredouillis insoutenables et incomparables en force et en beauté à l'original. (J'aurais pu choisir pour ma démonstration tout autre formule merveilleuse comme « Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes » ou « Couvrez ce sein que je ne saurais voir »)
Il ne faut pas espérer mieux en retour quand on s'immisce sur les terres anglophones, ou quelque terres que ce soit, d'ailleurs. Comme l'exprime si bien Umberto Eco, on ne peut s'efforcer que de dire « presque la même chose », avec tout l'abîme contenu dans le « presque ». Il nous faut donc nous contenter, nous autres francophones, de « presque » la même pièce, avec « presque » la même force et « presque » la même émotion.
Il n'en demeure pas moins, même en français, une belle pièce, que l'on pourrait qualifier de tragi-comédie, un peu à la façon de Lope de Vega, d'aucuns disent également qu'il s'agit d'une romance. Peu importe la case dans laquelle on la glisse, l'important est ce qu'il y a dedans.
Prospéro était, il y a des années de cela, le légitime duc de Milan. Il a été dépossédé de son titre par son frère Antonio avec la complicité du roi de Naples, Alonso. Échappant de peu à la mort, Prospéro et sa toute jeune fille Miranda échouent sur une île quasi déserte, à l'exception d'une sorcière et de son diable de rejeton Caliban.
Durant de nombreuses années, avec ses quelques livres, au fond de sa grotte, Prospéro a le temps de s'adonner à son art des sciences occultes et acquiert même une certaine dextérité en matière de magie. Il a aussi le temps de voir grandir sa fille et de constater l'échec de sa tentative d'éducation du petit sauvage Caliban.
Vient ensuite le moment où Prospéro, qui s'est rendu maître d'un certain nombre d'esprits en tout genre, décide de rentrer en possession de son bien, le duché de Milan. Pour se faire, il organise avec son esprit de main Ariel, le naufrage du bateau royal d'Alonso, lequel, avec toute sa suite s'était rendu au mariage de sa fille avec le roi de Tunis.
Le fils du roi Alonso, Ferdinand, l'un des seuls à conserver un coeur pur est l'objet des soins de Prospéro, qui souhaite une union entre sa fille Miranda et lui… Complots, machiavélisme à tout crin émaillent cette histoire, mais aussi des scènes carrément burlesques, notamment sous la houlette de Stéphano, le sommelier ivrogne et de Trinculo, le bouffon d'Alonso.
CQFD, ferments tragédiens + comédie = tragi-comédie. Et je dois reconnaître qu'elle est suffisamment riche pour donner lieu à de multiples interprétations. La première, et la plus classique, consiste à considérer chaque personnage un peu comme un symbole ou une allégorie d'un trait de la nature humaine avec ses multiples facettes, parfois noble, désintéressée et sublime, parfois fourbe, arriviste et pendable. On peut encore y voir une allégorie du colonialisme et de la nature féroce des rapports qu'entretiennent les autochtones et les colonisateurs.
Mais on peut aussi, bien que je ne rejette en rien les autres interprétations, y voir un clin d'oeil propre de William Shakespeare, dont on sait qu'il s'agit probablement de sa dernière pièce, suite à son choix de se retirer de la scène. le personnage de Prospéro prend alors une tout autre dimension et c'est alors, l'auteur lui-même que l'on voit poindre à travers lui. Prospéro, l'homme du livre et du savoir, qui règle ses vieux comptes avec ses pairs. Prospéro qui s'en retourne sur ses terres, loin de la sauvagerie. (Il faut alors entendre que c'est Londres, la terre de sauvagerie et d'empoignade, et que lui retourne dans son paisible pays natal de Statford, tout comme Milan représente le paisible âge d'or pour Prospéro.)
On peut y lire aussi que Prospéro ne se fait pas d'illusions sur la nature humaine, il sait qu'elle peut être belle et noble, mais aussi félonne et impitoyable. Lui range ses sortilèges tout comme Shakespeare plie ses gaules et quitte le théâtre, sur une note d'espoir, avec un peu d'humour, mais sans trop y croire tout de même.
Mais de tout ceci, vous aurez noté qu'il ne s'agit que de mon interprétation, c'est-à-dire, pas grand-chose, car nous sommes de la même étoffe dont sont faits les songes, et que notre petite vie est cernée de sommeil…
P. S. : la fabuleuse tirade de Prospéro de l'Acte IV, Scène 1 est un monument difficilement égalable que je vous recopie tel quel :
Like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all wich it inherit, shall dissolve, and, like this unsubstantial pageant faded, leave not a rack behind : we are such stuff as dreams are made on ; and our little life is rounded with a sleep...
Comment voulez-vous rendre en polonais, en laotien, en swahili, en hindi ou en piètre français des formules aussi sublimes que : « We are such stuff as dreams are made on ; and our little life is rounded with a sleep… »
Pour vous en convaincre, essayez donc de traduire en anglais le fameux « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Vous obtenez des choses miteuses dans le genre : « Triumph without peril brings no glory » ou bien « In conquering without danger we triumph without glory. » ou bien alors l'indigent « To win without risk is to triumph without glory » ou encore l'horrible « If one beats without difficulty, one triumphs without glory ». Bref, des bredouillis insoutenables et incomparables en force et en beauté à l'original. (J'aurais pu choisir pour ma démonstration tout autre formule merveilleuse comme « Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes » ou « Couvrez ce sein que je ne saurais voir »)
Il ne faut pas espérer mieux en retour quand on s'immisce sur les terres anglophones, ou quelque terres que ce soit, d'ailleurs. Comme l'exprime si bien Umberto Eco, on ne peut s'efforcer que de dire « presque la même chose », avec tout l'abîme contenu dans le « presque ». Il nous faut donc nous contenter, nous autres francophones, de « presque » la même pièce, avec « presque » la même force et « presque » la même émotion.
Il n'en demeure pas moins, même en français, une belle pièce, que l'on pourrait qualifier de tragi-comédie, un peu à la façon de Lope de Vega, d'aucuns disent également qu'il s'agit d'une romance. Peu importe la case dans laquelle on la glisse, l'important est ce qu'il y a dedans.
Prospéro était, il y a des années de cela, le légitime duc de Milan. Il a été dépossédé de son titre par son frère Antonio avec la complicité du roi de Naples, Alonso. Échappant de peu à la mort, Prospéro et sa toute jeune fille Miranda échouent sur une île quasi déserte, à l'exception d'une sorcière et de son diable de rejeton Caliban.
Durant de nombreuses années, avec ses quelques livres, au fond de sa grotte, Prospéro a le temps de s'adonner à son art des sciences occultes et acquiert même une certaine dextérité en matière de magie. Il a aussi le temps de voir grandir sa fille et de constater l'échec de sa tentative d'éducation du petit sauvage Caliban.
Vient ensuite le moment où Prospéro, qui s'est rendu maître d'un certain nombre d'esprits en tout genre, décide de rentrer en possession de son bien, le duché de Milan. Pour se faire, il organise avec son esprit de main Ariel, le naufrage du bateau royal d'Alonso, lequel, avec toute sa suite s'était rendu au mariage de sa fille avec le roi de Tunis.
Le fils du roi Alonso, Ferdinand, l'un des seuls à conserver un coeur pur est l'objet des soins de Prospéro, qui souhaite une union entre sa fille Miranda et lui… Complots, machiavélisme à tout crin émaillent cette histoire, mais aussi des scènes carrément burlesques, notamment sous la houlette de Stéphano, le sommelier ivrogne et de Trinculo, le bouffon d'Alonso.
CQFD, ferments tragédiens + comédie = tragi-comédie. Et je dois reconnaître qu'elle est suffisamment riche pour donner lieu à de multiples interprétations. La première, et la plus classique, consiste à considérer chaque personnage un peu comme un symbole ou une allégorie d'un trait de la nature humaine avec ses multiples facettes, parfois noble, désintéressée et sublime, parfois fourbe, arriviste et pendable. On peut encore y voir une allégorie du colonialisme et de la nature féroce des rapports qu'entretiennent les autochtones et les colonisateurs.
Mais on peut aussi, bien que je ne rejette en rien les autres interprétations, y voir un clin d'oeil propre de William Shakespeare, dont on sait qu'il s'agit probablement de sa dernière pièce, suite à son choix de se retirer de la scène. le personnage de Prospéro prend alors une tout autre dimension et c'est alors, l'auteur lui-même que l'on voit poindre à travers lui. Prospéro, l'homme du livre et du savoir, qui règle ses vieux comptes avec ses pairs. Prospéro qui s'en retourne sur ses terres, loin de la sauvagerie. (Il faut alors entendre que c'est Londres, la terre de sauvagerie et d'empoignade, et que lui retourne dans son paisible pays natal de Statford, tout comme Milan représente le paisible âge d'or pour Prospéro.)
On peut y lire aussi que Prospéro ne se fait pas d'illusions sur la nature humaine, il sait qu'elle peut être belle et noble, mais aussi félonne et impitoyable. Lui range ses sortilèges tout comme Shakespeare plie ses gaules et quitte le théâtre, sur une note d'espoir, avec un peu d'humour, mais sans trop y croire tout de même.
Mais de tout ceci, vous aurez noté qu'il ne s'agit que de mon interprétation, c'est-à-dire, pas grand-chose, car nous sommes de la même étoffe dont sont faits les songes, et que notre petite vie est cernée de sommeil…
P. S. : la fabuleuse tirade de Prospéro de l'Acte IV, Scène 1 est un monument difficilement égalable que je vous recopie tel quel :
Like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all wich it inherit, shall dissolve, and, like this unsubstantial pageant faded, leave not a rack behind : we are such stuff as dreams are made on ; and our little life is rounded with a sleep...
Une des plus belles histoires d’amour après « Titanic » ?
Pour être honnête j’ai regardé le film avant de lire la pièce, la version avec « DI caprio et Claire Danes »
D'ailleurs un jour sur babelio quelqu’un est venu me demander ce que j’avais avec « Di caprio »
Rien lui ai-je répondu, à une époque on était en concurrence lui et moi et il a gagné voilà tout, Toutes les nanas que je tentais maladroitement de tripoter étaient fan, j’ai bien réussi à en convaincre quelques unes, mais sur le nombre de potentielles envisageables, les statistiques étaient vraiment très mauvaises.
Enfin bref j’ai regardé ce film et j’ai trouvé ça à chier, à 15 ans « Tabatha cash » représentait de manière très convaincante mes priorités du moment, l’amour malheureusement n’en faisait pas partie.
J’ai revu ce film plus tard avec choupette, oui choupette c’est l’intello de notre duo, elle me disait :
« Arrête les joggings, arrête NTM, arrête d’être con aussi »
J’ai mis du temps, beaucoup de temps pour l’être un peu moins… Parfois elle disait aussi que j’étais incroyable, un vrai killer :
« Continue, continue » me criait telle, mais ces moments là étaient trop courts… 30 secondes, 45s les meilleurs jours…Aujourd'hui elle gueule toujours mais pas pour les mêmes raisons...
Plus tard j’ai fini par lire la pièce et quelle histoire, un grand bravo à « Will » qui a réussit à toucher mon petit cœur de midinette.
Allé on se quitte en musique :
♫ “Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on” ♫
This is the voiceeeeeeeeeeeee
http://www.youtube.com/watch?v=JIfvxXkhQeo
A plus les boloss…
Pour être honnête j’ai regardé le film avant de lire la pièce, la version avec « DI caprio et Claire Danes »
D'ailleurs un jour sur babelio quelqu’un est venu me demander ce que j’avais avec « Di caprio »
Rien lui ai-je répondu, à une époque on était en concurrence lui et moi et il a gagné voilà tout, Toutes les nanas que je tentais maladroitement de tripoter étaient fan, j’ai bien réussi à en convaincre quelques unes, mais sur le nombre de potentielles envisageables, les statistiques étaient vraiment très mauvaises.
Enfin bref j’ai regardé ce film et j’ai trouvé ça à chier, à 15 ans « Tabatha cash » représentait de manière très convaincante mes priorités du moment, l’amour malheureusement n’en faisait pas partie.
J’ai revu ce film plus tard avec choupette, oui choupette c’est l’intello de notre duo, elle me disait :
« Arrête les joggings, arrête NTM, arrête d’être con aussi »
J’ai mis du temps, beaucoup de temps pour l’être un peu moins… Parfois elle disait aussi que j’étais incroyable, un vrai killer :
« Continue, continue » me criait telle, mais ces moments là étaient trop courts… 30 secondes, 45s les meilleurs jours…Aujourd'hui elle gueule toujours mais pas pour les mêmes raisons...
Plus tard j’ai fini par lire la pièce et quelle histoire, un grand bravo à « Will » qui a réussit à toucher mon petit cœur de midinette.
Allé on se quitte en musique :
♫ “Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on” ♫
This is the voiceeeeeeeeeeeee
http://www.youtube.com/watch?v=JIfvxXkhQeo
A plus les boloss…
Lorsqu'on entre dans une boulangerie-pâtisserie, on sait parfois que le pain est très bon et la viennoiserie exécrable ou réciproquement. Bien évidemment, les deux peuvent être exécrables, auquel cas on n'en parle pas et on va voir ailleurs. Il arrive aussi, mais c'est plus rare, que les deux soient excellents, et là on devient fidèle parmi les fidèles.
Vous aurez compris qu'il est éminemment affaire de goût dans cette histoire et que celui-ci aime ce pain, celui-là le tolère et cet autre encore ne le supporte pas. Pour ma part, lorsque j'entre dans la boulangerie-pâtisserie Shakespeare, je raffole de la tragédie, j'aime plutôt bien ses tragi-comédies et par contre, j'ai beaucoup de mal avec ses comédies.
Si je vous dis que Roméo Et Juliette est une tragi-comédie et que le Songe D'Une Nuit D'Été est une comédie, vous aurez déjà compris où je veux en venir. Mais approfondissons quelque peu.
1) ROMÉO ET JULIETTE
Il faut probablement remonter jusqu'à Boccace pour comprendre l'ensemble du phénomène et la suite d'appropriations et de réappropriations d'oeuvres désormais quasi oubliées qui ont conduit au chef-d'oeuvre que l'on connaît.
Boccace a connu un tel succès avec son Décameron que nombre d'écrivains italiens ont tenté d'exploiter le filon. Ainsi, Masuccio de Salerne (1410 – 1475) produira un Novellino, ouvrage qui regroupe cinquante courtes nouvelles, dont la 33ème, qui est une certaine Romeo e Giulietta.
C'est une version certes primitive mais déjà suffisamment marquante pour avoir été repérée, reprise et enrichie par Luigi da Porto (1485 – 1529) et qui a son tour sera ré-assaisonnée par Matteo Bandello (1480 – 1561) dans son gros corpus d'histoires courtes, dont Shakespeare connaissait la traduction du français Pierre Boaistuau.
Mais, si William Shakespeare remet le couvert de Roméo Et Juliette, c'est qu'il a sûrement une ou deux idées en tête, le bougre, en cette fin du XVIème siècle, particulièrement chaude sur la question du mariage, notamment en raison du séisme que provoque la réforme protestante. Laquelle doctrine défend le mariage « d'inclination » au détriment des règles classiques du mariage dans tout le monde chrétien, à savoir, le choix des parents et l'intérêt de la famille.
De tout temps, hier comme aujourd'hui, quel meilleur symbole d'émancipation pour la jeunesse que celui de Roméo et de Juliette, deux amoureux qui n'ont que faire de l'opinion de leurs parents respectifs et qui préfèrent braver l'interdit que de s'interdire leur amour ?
Ce thème, en lui seul, suffirait presque à expliquer le succès de la pièce depuis plus de quatre siècles. Mais il n'est probablement pas tout. Aussi, vais-je hasarder une autre interprétation qui n'est pas spécialement fréquente pour cette pièce.
Shakespeare nous dresse un tableau où deux familles rivales s'opposent, pour des raisons anciennes, obscures et probablement oubliées, dans une lutte à mort. le vieux Montague et le vieux Capulet sont deux respectables, aimables, riches citoyens de Véronne, estimés l'un et l'autre du seigneur de la ville, mais ils ne peuvent pas se sentir, c'est comme ça.
Chacun des membres du clan ne demande que le prétexte pour se lancer dans une échauffourée avec la bande rivale. C'est ce point qui me semble capital dans la compréhension des intentions de l'auteur dans cette tragi-comédie.
La première version publiée de l'oeuvre remonte à 1597, mais il est clairement spécifié qu'à la date de cette publication, la pièce est déjà montée et jouée depuis un certain temps, certains avancent 1594, mais à la vérité on n'en sait rien, juste une présomption. Que ce passe-t-il dans l'Angleterre de Shakespeare à cette époque ?
1588, Francis Drake bat l'Invisible Armada espagnole mais le risque d'une invasion de l'Angleterre par les Espagnols est réel. De nombreux combats ont eu lieu avant et se poursuivent après cette date.
L'Irlande (déjà elle !) est une véritable poudrière et risque d'exploser à la figure de l'Angleterre, notamment en servant de base arrière à l'armée espagnole.
Bref, Philippe II d'Espagne (le fils de Charles Quint) et Elisabeth Ière d'Angleterre ressemblent étrangement à ces vieux Montague et Capulet, qui se crêpent le chignon sans trop savoir pourquoi, pour d'anciennes histoires de prestige (notamment liées au commerce dans les Antilles et en Amérique).
Comment s'appelle le poison, le démon des Espagnols ? Ne serait-ce un certain Francis Drake ? N'est-ce point un poison qui tue Roméo ? N'est-ce point une arme virile qui tue Juliette ? La symbolique du démon et de la folie est également évoquée dans la tirade de Juliette, juste avant qu'elle n'avale la fiole à la scène 3 de l'acte IV.
Shakespeare utilise le terme de mandragore. C'est certes une plante, connue pour ses vertus hallucinogènes et de supposées propriétés magiques, mais c'est aussi une façon, en langue anglaise, d'évoquer le démon et l'occultisme. Je vous le donne en mille, comment se dit mandragore en anglais ? Mandrake ! Man Drake !
Bien évidemment, on peut toujours arguer le hasard, mais venant de Shakespeare, le doute est plus que permis. Comment s'achève la pièce ? Les deux clans pleurent les innocents morts pour rien et leur élèvent à chacun une statue d'or. Voilà qui leur fait une belle jambe, n'est-ce pas ?
Donc, outre l'appel à l'émancipation de la jeunesse et à la fin de la férule des parents, je vois dans cette pièce un message plus politique, celui que quand les puissants s'affrontent, les enfants innocents de chaque nation payent l'addition et que tout ce qu'ils récoltent, c'est, au mieux, un monument à leur nom. En somme, une dénonciation de la folie des dirigeants qui s'engagent dans des conflits sans fondement et qui sacrifient de jeunes vies pour cela. À méditer par les temps qui courent...
Après le pain, passons maintenant à ce que je considère comme une purge tellement c'est sucré et mièvre et pâle au goût, à savoir :
LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ce que je m'y suis ennuyée : un vrai calvaire (et en plus c'était un calvaire solitaire, donc forcément ça ronge de l'intérieur) !
Les fleurs d'amour, les sortilèges, les quiproquos voireux… pfff ! ce n'est vraiment pas mon truc. J'ai pour principe de considérer que quand une comédie, à aucun moment, ne me fait rire, ni même sourire, selon mes critères, c'est une comédie ratée.
Donc, pour celles et ceux qui aiment le sucre et l'huile de palme à gogo, sachez que la pièce se déroule en Grèce à l'époque héroïque de Thésée et d'Hippolyta, la reine des Amazones. (L'auteur utilise abondamment comme source d'inspiration la tradition antique léguée notamment par Les Métamorphoses d'Ovide.)
Ces deux-là ont échafaudé de se marier mais comme l'intrigue a besoin d'un peu plus de matière grasse, Shakespeare a imaginé de fourrer son beignet avec deux ou trois autres couples boiteux histoire de compliquer la donne.
Ainsi, Lyssandre aime Hermia, fille d'Égée, et elle l'aime aussi. Tout va bien alors ? me direz-vous. Non, pas tout à fait, car Égée, lui, ne veut pas entendre parler de Lyssandre et n'a d'yeux que pour Démétrius, ce qui, évidemment, n'est pas du tout du goût d'Hermia. Vous me suivez ? Non ? Vous dormez déjà ?
Mais ce n'est pas tout, car Démétrius était au préalable amoureux d'Héléna, la meilleure copine d'Hermia, avant de changer de cap et de lorgner sur cette dernière. Mais elle, Héléna, est restée raide dingue de Démétrius. On n'en sort pas. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, voilà-t-y pas qu'il y a de l'eau dans le gaz chez les Fées également !
Obéron, le patron des farfadets, trolls et autres sortilégineux se prend le bec avec sa bourgeoise Titania, la taulière des elfes & fées. du coup, l'Obéron, qu'a plus d'un tour dans son sac se dit qu'il va lui faire mettre un coup de fleur d'amour dans le nez à la Titania pendant son sommeil et que ça va pas traîner.
Au passage, dit-il à Robin, son homme de main, en te promenant, tu vas mettre aussi un p'tit coup de fleur à Démétrius, histoire qu'il regarde à nouveau Héléna avec des yeux lubriques à son réveil.
C'est là qu'intervient la scène censée être d'anthologie où Titania se réveille et tombe en pâmoison devant un gugusse à tête d'âne. Rrrrr ! Zzzzz ! Rrrr ! Zzzzz ! [ceci symbolise les " elffets " du sortilège d'Obéron sur moi ou bien d'une digestion compliquée d'un beignet décidément trop gras]
Cependant, vu qu'Obéron donne à Robin des instructions claires comme du jus de boudin, l'autre, pas plus consciencieux qu'il ne faut, badigeonne des grands coups de fleur d'amour à… Lyssandre ! Aaah, l'innocent ! L'étoudi ! Ouh, là, là ! Ça va être dur à rattraper un coup comme ça ! J'aime mieux vous laisser découvrir la suite par vous-même.
Faut-il encore que je vous parle d'une troupe de comédiens amateurs qui essaiyent à tout prix de faire une pièce pas drôle, et que c'est vraiment pas drôle de les voir faire leur pièce pas drôle… Zzzzz ! Rideau.
Bon, à l'extrême — extrême — rigueur, on pourrait supputer une toute petite once d'intérêt à la réflexion de l'auteur à propos de l'éphémère sensation qu'est l'amour en nos vies… Ouaip. Vous aviez besoin de ça pour avancer ?
Bon, je ne vous cache pas que selon moi, ce livre vaut surtout pour sa première pièce, mais après, vous en faites ce que vous voulez car ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Vous aurez compris qu'il est éminemment affaire de goût dans cette histoire et que celui-ci aime ce pain, celui-là le tolère et cet autre encore ne le supporte pas. Pour ma part, lorsque j'entre dans la boulangerie-pâtisserie Shakespeare, je raffole de la tragédie, j'aime plutôt bien ses tragi-comédies et par contre, j'ai beaucoup de mal avec ses comédies.
Si je vous dis que Roméo Et Juliette est une tragi-comédie et que le Songe D'Une Nuit D'Été est une comédie, vous aurez déjà compris où je veux en venir. Mais approfondissons quelque peu.
1) ROMÉO ET JULIETTE
Il faut probablement remonter jusqu'à Boccace pour comprendre l'ensemble du phénomène et la suite d'appropriations et de réappropriations d'oeuvres désormais quasi oubliées qui ont conduit au chef-d'oeuvre que l'on connaît.
Boccace a connu un tel succès avec son Décameron que nombre d'écrivains italiens ont tenté d'exploiter le filon. Ainsi, Masuccio de Salerne (1410 – 1475) produira un Novellino, ouvrage qui regroupe cinquante courtes nouvelles, dont la 33ème, qui est une certaine Romeo e Giulietta.
C'est une version certes primitive mais déjà suffisamment marquante pour avoir été repérée, reprise et enrichie par Luigi da Porto (1485 – 1529) et qui a son tour sera ré-assaisonnée par Matteo Bandello (1480 – 1561) dans son gros corpus d'histoires courtes, dont Shakespeare connaissait la traduction du français Pierre Boaistuau.
Mais, si William Shakespeare remet le couvert de Roméo Et Juliette, c'est qu'il a sûrement une ou deux idées en tête, le bougre, en cette fin du XVIème siècle, particulièrement chaude sur la question du mariage, notamment en raison du séisme que provoque la réforme protestante. Laquelle doctrine défend le mariage « d'inclination » au détriment des règles classiques du mariage dans tout le monde chrétien, à savoir, le choix des parents et l'intérêt de la famille.
De tout temps, hier comme aujourd'hui, quel meilleur symbole d'émancipation pour la jeunesse que celui de Roméo et de Juliette, deux amoureux qui n'ont que faire de l'opinion de leurs parents respectifs et qui préfèrent braver l'interdit que de s'interdire leur amour ?
Ce thème, en lui seul, suffirait presque à expliquer le succès de la pièce depuis plus de quatre siècles. Mais il n'est probablement pas tout. Aussi, vais-je hasarder une autre interprétation qui n'est pas spécialement fréquente pour cette pièce.
Shakespeare nous dresse un tableau où deux familles rivales s'opposent, pour des raisons anciennes, obscures et probablement oubliées, dans une lutte à mort. le vieux Montague et le vieux Capulet sont deux respectables, aimables, riches citoyens de Véronne, estimés l'un et l'autre du seigneur de la ville, mais ils ne peuvent pas se sentir, c'est comme ça.
Chacun des membres du clan ne demande que le prétexte pour se lancer dans une échauffourée avec la bande rivale. C'est ce point qui me semble capital dans la compréhension des intentions de l'auteur dans cette tragi-comédie.
La première version publiée de l'oeuvre remonte à 1597, mais il est clairement spécifié qu'à la date de cette publication, la pièce est déjà montée et jouée depuis un certain temps, certains avancent 1594, mais à la vérité on n'en sait rien, juste une présomption. Que ce passe-t-il dans l'Angleterre de Shakespeare à cette époque ?
1588, Francis Drake bat l'Invisible Armada espagnole mais le risque d'une invasion de l'Angleterre par les Espagnols est réel. De nombreux combats ont eu lieu avant et se poursuivent après cette date.
L'Irlande (déjà elle !) est une véritable poudrière et risque d'exploser à la figure de l'Angleterre, notamment en servant de base arrière à l'armée espagnole.
Bref, Philippe II d'Espagne (le fils de Charles Quint) et Elisabeth Ière d'Angleterre ressemblent étrangement à ces vieux Montague et Capulet, qui se crêpent le chignon sans trop savoir pourquoi, pour d'anciennes histoires de prestige (notamment liées au commerce dans les Antilles et en Amérique).
Comment s'appelle le poison, le démon des Espagnols ? Ne serait-ce un certain Francis Drake ? N'est-ce point un poison qui tue Roméo ? N'est-ce point une arme virile qui tue Juliette ? La symbolique du démon et de la folie est également évoquée dans la tirade de Juliette, juste avant qu'elle n'avale la fiole à la scène 3 de l'acte IV.
Shakespeare utilise le terme de mandragore. C'est certes une plante, connue pour ses vertus hallucinogènes et de supposées propriétés magiques, mais c'est aussi une façon, en langue anglaise, d'évoquer le démon et l'occultisme. Je vous le donne en mille, comment se dit mandragore en anglais ? Mandrake ! Man Drake !
Bien évidemment, on peut toujours arguer le hasard, mais venant de Shakespeare, le doute est plus que permis. Comment s'achève la pièce ? Les deux clans pleurent les innocents morts pour rien et leur élèvent à chacun une statue d'or. Voilà qui leur fait une belle jambe, n'est-ce pas ?
Donc, outre l'appel à l'émancipation de la jeunesse et à la fin de la férule des parents, je vois dans cette pièce un message plus politique, celui que quand les puissants s'affrontent, les enfants innocents de chaque nation payent l'addition et que tout ce qu'ils récoltent, c'est, au mieux, un monument à leur nom. En somme, une dénonciation de la folie des dirigeants qui s'engagent dans des conflits sans fondement et qui sacrifient de jeunes vies pour cela. À méditer par les temps qui courent...
Après le pain, passons maintenant à ce que je considère comme une purge tellement c'est sucré et mièvre et pâle au goût, à savoir :
LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ce que je m'y suis ennuyée : un vrai calvaire (et en plus c'était un calvaire solitaire, donc forcément ça ronge de l'intérieur) !
Les fleurs d'amour, les sortilèges, les quiproquos voireux… pfff ! ce n'est vraiment pas mon truc. J'ai pour principe de considérer que quand une comédie, à aucun moment, ne me fait rire, ni même sourire, selon mes critères, c'est une comédie ratée.
Donc, pour celles et ceux qui aiment le sucre et l'huile de palme à gogo, sachez que la pièce se déroule en Grèce à l'époque héroïque de Thésée et d'Hippolyta, la reine des Amazones. (L'auteur utilise abondamment comme source d'inspiration la tradition antique léguée notamment par Les Métamorphoses d'Ovide.)
Ces deux-là ont échafaudé de se marier mais comme l'intrigue a besoin d'un peu plus de matière grasse, Shakespeare a imaginé de fourrer son beignet avec deux ou trois autres couples boiteux histoire de compliquer la donne.
Ainsi, Lyssandre aime Hermia, fille d'Égée, et elle l'aime aussi. Tout va bien alors ? me direz-vous. Non, pas tout à fait, car Égée, lui, ne veut pas entendre parler de Lyssandre et n'a d'yeux que pour Démétrius, ce qui, évidemment, n'est pas du tout du goût d'Hermia. Vous me suivez ? Non ? Vous dormez déjà ?
Mais ce n'est pas tout, car Démétrius était au préalable amoureux d'Héléna, la meilleure copine d'Hermia, avant de changer de cap et de lorgner sur cette dernière. Mais elle, Héléna, est restée raide dingue de Démétrius. On n'en sort pas. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, voilà-t-y pas qu'il y a de l'eau dans le gaz chez les Fées également !
Obéron, le patron des farfadets, trolls et autres sortilégineux se prend le bec avec sa bourgeoise Titania, la taulière des elfes & fées. du coup, l'Obéron, qu'a plus d'un tour dans son sac se dit qu'il va lui faire mettre un coup de fleur d'amour dans le nez à la Titania pendant son sommeil et que ça va pas traîner.
Au passage, dit-il à Robin, son homme de main, en te promenant, tu vas mettre aussi un p'tit coup de fleur à Démétrius, histoire qu'il regarde à nouveau Héléna avec des yeux lubriques à son réveil.
C'est là qu'intervient la scène censée être d'anthologie où Titania se réveille et tombe en pâmoison devant un gugusse à tête d'âne. Rrrrr ! Zzzzz ! Rrrr ! Zzzzz ! [ceci symbolise les " elffets " du sortilège d'Obéron sur moi ou bien d'une digestion compliquée d'un beignet décidément trop gras]
Cependant, vu qu'Obéron donne à Robin des instructions claires comme du jus de boudin, l'autre, pas plus consciencieux qu'il ne faut, badigeonne des grands coups de fleur d'amour à… Lyssandre ! Aaah, l'innocent ! L'étoudi ! Ouh, là, là ! Ça va être dur à rattraper un coup comme ça ! J'aime mieux vous laisser découvrir la suite par vous-même.
Faut-il encore que je vous parle d'une troupe de comédiens amateurs qui essaiyent à tout prix de faire une pièce pas drôle, et que c'est vraiment pas drôle de les voir faire leur pièce pas drôle… Zzzzz ! Rideau.
Bon, à l'extrême — extrême — rigueur, on pourrait supputer une toute petite once d'intérêt à la réflexion de l'auteur à propos de l'éphémère sensation qu'est l'amour en nos vies… Ouaip. Vous aviez besoin de ça pour avancer ?
Bon, je ne vous cache pas que selon moi, ce livre vaut surtout pour sa première pièce, mais après, vous en faites ce que vous voulez car ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Hamlet, Othello, Macbeth… tout de suite, le ton est donné, la barre est placée et en bons perchistes que vous êtes, vous avez, de suite, l'impression de vous élever dans les airs. Oui, dans les airs, car c'est de la fine, fine fleur de fleuron de fantastique fusée que ces trois pièces-là.
Je commence par Hamlet, la plus connue, la plus légendaire et bascule de suite sur la troisième, Macbeth, à peine un soupçon moins célébrée que la précédente et instantanément me réjouis de ce rapprochement divin entre ces deux pièces qui ont beaucoup de choses à se dire, d'une scène à l'autre.
Tout d'abord Hamlet, bien sûr, l'incontournable Hamlet. J'adore la légèreté, l'humour, la finesse, la profondeur, la qualité d'écriture de l'ensemble de la pièce (pas trop le final cependant). Je ne vais même pas m'attarder à vous faire le panégyrique de la pièce dont vous retrouvez des poussières disséminées un peu partout, de Dickens au Roi Lion en passant par Rudyard Kipling. (J'ai déjà évoqué cela ailleurs.)
Or, c'est quoi Hamlet ? Issu en droite filiation de la tragédie grecque antique (le personnage d'Oreste, notamment), Shakespeare revisite le thème de la trahison, du doublage par un frère (le vieil Hamlet est assassiné par son frère Claudius). Voilà un thème qui semble fort et important pour l'auteur, c'est d'ailleurs le corps de l'ultime drame de Shakespeare, La Tempête, où Prospero a échappé in extremis à la mort et s'est fait subtiliser le trône par son frère.
Le thème de la mort (omniprésent dans les trois pièces que voici), ou plus particulièrement de l'inutilité de la vie, est également un sujet de prédilection du grand dramaturge anglais et qui figure au coeur d'Hamlet, d'où cette fameuse tirade du « être ou ne pas être ».
Cependant, si tout cela est vrai et fort, ce qui me semble plus fort et plus évident que tout dans Hamlet, c'est la réflexion sur le théâtre qui affleure partout. Le personnage d'Hamlet, de façon symbolique, C'EST le théâtre, dans l'acception la plus noble du terme. C'est lui le révélateur, c'est lui qui voit clair dans le jeu orchestré par le roi et c'est lui qui est déchu par la vilenie du pouvoir.
Le roi symbolise évidemment le pouvoir, en tant qu'autorité qui muselle l'activité artistique de peur qu'elle ne montre trop explicitement ses propres exactions. Laërte, c'est l'autre théâtre, le théâtre d'état, le théâtre qui dit ce que le roi veut entendre, celui qui est aux bottes du pouvoir (et d'ailleurs, sur ce point, absolument rien n'a changé, voir, par exemple le livre de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens De Garde).
Les deux théâtres se livrent une lutte à mort, et qui est sacrifié au milieu d'eux ? le public, évidemment, et ici le public est symbolisé par Ophélie, qui devient folle. La reine représente la conscience, la morale à qui l'on a tordu le cou pour avaler des couleuvres (on en reparlera dans Macbeth).
Polonius représente les seconds couteaux, le peuple nombreux des courtisans hypocrites qui lèchent les savates de tout pouvoir, quel qu'il soit, et qui se font étriller par le théâtre (pensez aux bourgeois, aux savants ou aux religieux chez Molière, par exemple) car si l'on ne peut taper sur le pouvoir, on peut tout de même se faire la main sur les courtisans. Mais on peut aussi (et surtout) voir dans Polonius, l'archétype du puritain (voir les conseils qu'il donne à son fils), très en vogue et toujours plus près du pouvoir à l'époque de Shakespeare.
Et la moralité de tout cela, c'est qu'un pouvoir qui n'est pas capable de se regarder en face sous le révélateur, sous le miroir de vérité qu'est le théâtre, tellement il a honte de lui-même est voué à disparaître. Tiens, tiens, j'y vois déjà l'ombre de Macbeth, là-encore.
Pour conclure, si l'on recontextualise la genèse de cette pièce avec les événements historiques dont l'auteur était le témoin, ce qu'il faut voir dans Hamlet, ce n'est ni une tragédie (ou tragi-comédie), ni un quelconque message métaphysique, mais bien plutôt une supplique politique pour maintenir les théâtres publics élisabéthains et leur liberté d'expression face aux attaques toujours plus virulentes des puritains qui essaient d'imposer leur théâtre moralisateur.
On sait par ailleurs que les craintes de Shakespeare étaient fondées car les puritains obtiendront gain de cause avec la fermeture des théâtres publics en 1642 (notamment le Théâtre du Globe où était joué Shakespeare). Vu comme cela, cette pièce est absolument lumineuse, forte, pleine de sens et de désillusions, bref, essentielle.
Passons désormais à La Tragédie de Macbeth qui synthétise, elle aussi, beaucoup des thèmes chers à William Shakespeare : la trahison comme dans Othello que j'aborde en dessous, l'usurpation et la vengeance comme dans Hamlet, la prophétie et la destinée comme dans La Tempête, la folie et le changement dynastique comme dans Richard II, pour ne citer que celles-là.
C'est une lapalissade d'écrire qu'il y a différents thèmes dans cette pièce en cinq actes, mais celui qui m'apparaît ressortir plus que tout autre est celui de la morale et de l'acte vertueux.
Restons dans le droit chemin, semble nous dire en substance Shakespeare, car chaque pas en dehors du tracé du bien en appelle un suivant de sorte que, de vilenie en vilenie, le retour à la vertu est impossible et l'on s'embourbe toujours plus profondément dans les fétides marécages du mal jusqu'à n'en plus trouver d'issue, sauf l'ultime.
Au départ, Macbeth a des valeurs, des scrupules, des freins, des remords puis, peu à peu, à chaque nouvelle action pendable, ses verrous intérieurs sautent les uns après les autres jusqu'à lui accorder toute licence dans l'atrocité ou dans la barbarie.
Il convient de signaler également dans cette fonction facilitatrice, le rôle prépondérant de Lady Macbeth, totalement dénuée de scrupules alors que son mari tergiversait. Comment interpréter cette nouvelle mouture de la consommation du fruit défendu par Adam sous la houlette d'Ève et de l'exclusion à jamais qui s'ensuit du Jardin d'Éden ?
Macbeth, de courageux et noble au départ, à mesure qu'il sombre dans les travers du mal mu par sa soif de pouvoir, devient pleutre et vil. Lady Macbeth, de forte et inflexible qu'elle nous apparaît au commencement, se métamorphose progressivement jusqu'à devenir fragile, malingre et instable.
On perçoit, je pense, le sens qu'a voulu donner l'auteur à l'aliénation du couple principal : en déviant de l'axe vertueux, on érode, on corrode, on débrode le joli fil de soie de la morale humaine, livrant au regard la trame brute et laide du textile sans fard, l'animalité crue de l'Homme, dépouillée des règles sociales et morales.
Ce qui fait l'humain, c'est qu'il ne s'abandonne pas à ses instincts primaires, c'est le respect des lois et de la morale. À mesure donc que Macbeth enfreint les règles élémentaires (hospitalité, allégeance, amitié, fidélité, loyauté, etc.), il se déshumanise graduellement jusqu'à devenir un rat acculé au coin d'une pièce, prêt à sauter au visage de n'importe qui simplement pour rester en vie.
Comme je vous l'avais précisé au début, je ne peux m'empêcher de voir dans Macbeth un double inversé d'Hamlet, ou, plus précisément, la même pièce mais focalisée sur un point de vue différent. Dans Hamlet, le roi légitime, le vieil Hamlet, a été trahi et assassiné par son frère Claudius avec la connivence de la reine, propre mère d'Hamlet. le point de vue est donc centralisé sur le fils du roi déchu.
Ici, au lieu d'avoir le point focal sur Hamlet, on l'a sur Claudius, et Claudius se nomme alors Macbeth. Mais c'est la même formule de base ; convertissez Hamlet en Malcolm et le vieil Hamlet en Duncan ; acceptez qu'il puisse y avoir un dédoublement du vieil Hamlet qui en plus d'être Duncan serait aussi Banquo et vous retrouvez le spectre dont le rôle est si prégnant dans Hamlet.
Pour que l'analogie soit totale, il nous faut encore un messager symbolique : c'était le jeu de la pièce de théâtre dans Hamlet, ce sont les trois sorcières dans Macbeth et, comme par magie, l'on retombe sur nos pieds. le thème phare d'Hamlet — la mort et l'inutilité de la vie ( le fameux « to be or not to be ») — s'avère être une part cruciale de Macbeth, prétexte à l'une des plus belles tirades de tout le théâtre shakespearien à la scène 5 de l'acte V.
On pourrait poursuivre encore longtemps le parallèle entre Hamlet et Macbeth. Par exemple, Hamlet se faisait passer pour fou afin de sonder l'entourage du roi Claudius, et ici, Malcolm se fait passer pour vil afin de tester Macduff. Les deux veulent venger la mort de leur père, un roi qu'on a assassiné.
La folie et le suicide de Lady Macbeth répondent comme un écho à la mère de Hamlet et à la fin d'Ophélie. de même que le maléfique Claudius n'avait pas d'enfant, le couple Macbeth, empreint du mal, disparaît sans descendance.
Comment ne pas voir un clin d'oeil ou un appel du pied au règne d'Elisabeth Ière, reine sans enfant, dont on sait qu'elle était probablement impliquée dans des morts louches, notamment celle de la femme de son amant ? le souverain doit donc savoir être réceptif aux avertissements qui lui sont transmis par les esprits éclairés. Dans la vraie vie du XVIIème siècle, c'est le théâtre et notamment Shakespeare qui donne ces signaux d'alarme, dans Macbeth, ce sont les trois sorcières.
Selon Shakespeare, et comme dans Hamlet, le pouvoir oublieux de la morale, qui ne parvient pas à décoder comme il convient les prophéties et les avertissements délivrés par le théâtre est appelé à disparaître. Macbeth reproche d'ailleurs, à la scène 7 de l'acte V, le double entente qu'on peut faire du langage et accuse les sorcières d'être des tricheuses, alors même qu'elles lui ont fidèlement tout annoncé, tout prédit, mais que lui a mal interprété leur discours.
Le lien avec les messages délivrés par le théâtre à l'adresse du pouvoir me semble évident. Le théâtre utilise le symbole, la métaphore, les analogies historiques ou les contrées lointaines, mais ce dont il parle vraiment, pour qui sait lire entre les lignes et briser les encodages, c'est du brûlant présent, de l'ici et du maintenant.
J'en terminerai (car même s'il resterait encore beaucoup de choses à dire de cette superbe tragédie, j'ai conscience que ma critique a déjà atteint une longueur critique) en signalant dans le registre du cinéma qu'il y a probablement un peu (ou même beaucoup) de Macbeth dans le personnage ô combien fameux de Dark Vador dans l'épopée Star Wars. de même, Akira Kurosawa transposa Macbeth avec des samouraï japonais dans son film le Château de L'Araignée.
Et dire qu'avec tout ce que j'ai déjà écrit je n'ai pas encore abordé cet autre joyau qu'est Othello ! C'est pourtant une tragédie sublime, au sens premier, au sens profond, dans l'acception antique du terme, c'est-à-dire, de la création d'une œuvre artistique capable de susciter les plus vives émotions chez le spectateur, afin de gagner son empathie, de le faire vivre par procuration des émotions aussi fortes que les personnages fictifs qui évoluent devant lui.
Notre sens inné de la justice, même non formulé, même fort enfoui, même inconscient, même volontairement muselé, ne peut que s'insurger face à cet infâme complot de cet infâme Iago, face à une telle ignominie ; et c'est précisément ce sentiment que recherchait William Shakespeare et qu'il arrive à faire éclore admirablement, aujourd'hui comme hier et pour des siècles encore.
Même si le protagoniste principal semble bien davantage Iago qu'Othello et, d'un simple point de vue statistique, il est manifeste que Iago monopolise la scène, c'est bien à la place d'Othello que l'auteur souhaite nous placer, et non à la place de Iago. C'est bien l'œuvre de Iago sur Othello qui indigne et non les motifs intimes du fourbe qui présentent un intérêt.
Le message, du moins l'un des messages possibles de cette oeuvre, est le noircissement. Je ne blague pas, et le fait que Shakespeare ait choisi un personnage noir comme héros d'infortune n'a sans doute rien d'hasardeux. L'apparence. Celui qui semble noir l'est-il bien réellement ?
Tous. Tous semblent noirs à un moment ou à un autre : Cassio, Desdémone, Othello. Tous noirs et pourtant tous innocents. Et pourtant, on jurerait, selon l'angle où ils sont présentés les uns aux autres, on jurerait qu'ils sont coupables.
C'est probablement ça, le plus fort du message que souhaite nous donner en pâture l'auteur. Honni soit qui mal y pense ! Il est si facile de nuire, si facile de noircir, si facile de truquer, si facile de faire dire autre chose aux faits pris indépendamment ou hors contexte. C'est cela que semble nous dire Shakespeare.
Les apparences sont parfois contre nous et d'autres semblent blancs comme neige, et pourtant… et pourtant…, pourtant, quand on sait tout le fin mot, vraiment tout, la réalité est souvent loin des belles apparences et ce que l'on croyait simple, net, tranché, évident, ne l'est plus tant que cela.
Othello d'emblée est noir, ce qui jette sur lui une indéfinissable suspicion aux yeux des Vénitiens. Tout prétexte sera bon s'il fait le moindre faux-pas. Cassio est un beau subordonné prometteur, donc il est douteux. Desdémone est une noble Vénitienne blanche entichée d'un noir, donc c'est nécessairement une putain.
Autant de raccourcis faciles que nous avons tous tendance, consciemment ou inconsciemment, à commettre ici ou là. L'histoire a donné plusieurs fois raison à Shakespeare. (Rien qu'en France, au XXème siècle, des Juifs, des Maghrébins en tant que groupe ou des individualités comme Guillaume Seznec ont tous fait l'objet d'accusations plus ou moins calomnieuses ou bâties de toute pièce, basées sur des a priori ou des apparences qui leur étaient adverses. Je ne parle évidemment pas de tous les endroits du monde et à toutes les périodes depuis Shakespeare, car il y aurait de quoi remplir tout Babelio avec.)
Si l'on cherche des fautes à quelqu'un, on en trouvera fatalement. Si l'on sait habilement les mettre en lumière, leur donner d'autres apparences, attiser le vent de la vengeance, mobiliser la justice à son avantage, n'importe qui peut être traîné dans la boue ou commettre l'irréparable.
Quels sont les mobiles de tout cela ? L'auteur reste très discret et très flou sur les motivations de Iago. Cela semble tourner autour de la jalousie, de l'orgueil bafoué, de l'envie inassouvie, du complexe d'infériorité.
Intéressons nous encore quelques instants à Iago. Ce qui est frappant dans le texte, dans les qualificatifs qu'on lui attribue, c'est le nombre de fois où reviennent, les adjectifs noble, honnête, fidèle, courageux, droit, fiable, vertueux, etc. Encore une fois, si l'on se place à l'époque de Shakespeare pour tâcher d'y voir plus clair, la meilleure explication, la principale justification à cette pièce est l'admirable travail de sape réalisé par les puritains à l'égard du théâtre élisabéthain.
Iago, dans cette optique, est donc le symbole du puritanisme, Othello, le noir à qui l'on fait commettre des abjections ne saurait être autre que Shakespeare lui-même, Cassio, représenterait alors quelque autre auteur contemporain de Shakespeare comme Christopher Marlowe ou Ben Johnson.
Les abjections des uns et des autres sont les écrits vils qu'ils étaient obligés de pondre, pamphlets notamment, simplement pour pouvoir gagner moindrement leur vie.
Desdémone, celle qui est totalement innocente est qui est sacrifiée serait alors la déesse aux cent bouches, à savoir le public, qui fait les frais des fermetures de théâtres sous la houlette des Puritains.
Voilà le type de message que je vois dans Othello, la dénonciation de la calomnie à l'égard des dramaturges honnêtes qu'on accuse de toutes les perversions, mais ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose. le mieux que vous ayez à faire, c'est encore d'ouvrir ce livre et de découvrir ou bien relire ces trois pièces admirables.
Je commence par Hamlet, la plus connue, la plus légendaire et bascule de suite sur la troisième, Macbeth, à peine un soupçon moins célébrée que la précédente et instantanément me réjouis de ce rapprochement divin entre ces deux pièces qui ont beaucoup de choses à se dire, d'une scène à l'autre.
Tout d'abord Hamlet, bien sûr, l'incontournable Hamlet. J'adore la légèreté, l'humour, la finesse, la profondeur, la qualité d'écriture de l'ensemble de la pièce (pas trop le final cependant). Je ne vais même pas m'attarder à vous faire le panégyrique de la pièce dont vous retrouvez des poussières disséminées un peu partout, de Dickens au Roi Lion en passant par Rudyard Kipling. (J'ai déjà évoqué cela ailleurs.)
Or, c'est quoi Hamlet ? Issu en droite filiation de la tragédie grecque antique (le personnage d'Oreste, notamment), Shakespeare revisite le thème de la trahison, du doublage par un frère (le vieil Hamlet est assassiné par son frère Claudius). Voilà un thème qui semble fort et important pour l'auteur, c'est d'ailleurs le corps de l'ultime drame de Shakespeare, La Tempête, où Prospero a échappé in extremis à la mort et s'est fait subtiliser le trône par son frère.
Le thème de la mort (omniprésent dans les trois pièces que voici), ou plus particulièrement de l'inutilité de la vie, est également un sujet de prédilection du grand dramaturge anglais et qui figure au coeur d'Hamlet, d'où cette fameuse tirade du « être ou ne pas être ».
Cependant, si tout cela est vrai et fort, ce qui me semble plus fort et plus évident que tout dans Hamlet, c'est la réflexion sur le théâtre qui affleure partout. Le personnage d'Hamlet, de façon symbolique, C'EST le théâtre, dans l'acception la plus noble du terme. C'est lui le révélateur, c'est lui qui voit clair dans le jeu orchestré par le roi et c'est lui qui est déchu par la vilenie du pouvoir.
Le roi symbolise évidemment le pouvoir, en tant qu'autorité qui muselle l'activité artistique de peur qu'elle ne montre trop explicitement ses propres exactions. Laërte, c'est l'autre théâtre, le théâtre d'état, le théâtre qui dit ce que le roi veut entendre, celui qui est aux bottes du pouvoir (et d'ailleurs, sur ce point, absolument rien n'a changé, voir, par exemple le livre de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens De Garde).
Les deux théâtres se livrent une lutte à mort, et qui est sacrifié au milieu d'eux ? le public, évidemment, et ici le public est symbolisé par Ophélie, qui devient folle. La reine représente la conscience, la morale à qui l'on a tordu le cou pour avaler des couleuvres (on en reparlera dans Macbeth).
Polonius représente les seconds couteaux, le peuple nombreux des courtisans hypocrites qui lèchent les savates de tout pouvoir, quel qu'il soit, et qui se font étriller par le théâtre (pensez aux bourgeois, aux savants ou aux religieux chez Molière, par exemple) car si l'on ne peut taper sur le pouvoir, on peut tout de même se faire la main sur les courtisans. Mais on peut aussi (et surtout) voir dans Polonius, l'archétype du puritain (voir les conseils qu'il donne à son fils), très en vogue et toujours plus près du pouvoir à l'époque de Shakespeare.
Et la moralité de tout cela, c'est qu'un pouvoir qui n'est pas capable de se regarder en face sous le révélateur, sous le miroir de vérité qu'est le théâtre, tellement il a honte de lui-même est voué à disparaître. Tiens, tiens, j'y vois déjà l'ombre de Macbeth, là-encore.
Pour conclure, si l'on recontextualise la genèse de cette pièce avec les événements historiques dont l'auteur était le témoin, ce qu'il faut voir dans Hamlet, ce n'est ni une tragédie (ou tragi-comédie), ni un quelconque message métaphysique, mais bien plutôt une supplique politique pour maintenir les théâtres publics élisabéthains et leur liberté d'expression face aux attaques toujours plus virulentes des puritains qui essaient d'imposer leur théâtre moralisateur.
On sait par ailleurs que les craintes de Shakespeare étaient fondées car les puritains obtiendront gain de cause avec la fermeture des théâtres publics en 1642 (notamment le Théâtre du Globe où était joué Shakespeare). Vu comme cela, cette pièce est absolument lumineuse, forte, pleine de sens et de désillusions, bref, essentielle.
Passons désormais à La Tragédie de Macbeth qui synthétise, elle aussi, beaucoup des thèmes chers à William Shakespeare : la trahison comme dans Othello que j'aborde en dessous, l'usurpation et la vengeance comme dans Hamlet, la prophétie et la destinée comme dans La Tempête, la folie et le changement dynastique comme dans Richard II, pour ne citer que celles-là.
C'est une lapalissade d'écrire qu'il y a différents thèmes dans cette pièce en cinq actes, mais celui qui m'apparaît ressortir plus que tout autre est celui de la morale et de l'acte vertueux.
Restons dans le droit chemin, semble nous dire en substance Shakespeare, car chaque pas en dehors du tracé du bien en appelle un suivant de sorte que, de vilenie en vilenie, le retour à la vertu est impossible et l'on s'embourbe toujours plus profondément dans les fétides marécages du mal jusqu'à n'en plus trouver d'issue, sauf l'ultime.
Au départ, Macbeth a des valeurs, des scrupules, des freins, des remords puis, peu à peu, à chaque nouvelle action pendable, ses verrous intérieurs sautent les uns après les autres jusqu'à lui accorder toute licence dans l'atrocité ou dans la barbarie.
Il convient de signaler également dans cette fonction facilitatrice, le rôle prépondérant de Lady Macbeth, totalement dénuée de scrupules alors que son mari tergiversait. Comment interpréter cette nouvelle mouture de la consommation du fruit défendu par Adam sous la houlette d'Ève et de l'exclusion à jamais qui s'ensuit du Jardin d'Éden ?
Macbeth, de courageux et noble au départ, à mesure qu'il sombre dans les travers du mal mu par sa soif de pouvoir, devient pleutre et vil. Lady Macbeth, de forte et inflexible qu'elle nous apparaît au commencement, se métamorphose progressivement jusqu'à devenir fragile, malingre et instable.
On perçoit, je pense, le sens qu'a voulu donner l'auteur à l'aliénation du couple principal : en déviant de l'axe vertueux, on érode, on corrode, on débrode le joli fil de soie de la morale humaine, livrant au regard la trame brute et laide du textile sans fard, l'animalité crue de l'Homme, dépouillée des règles sociales et morales.
Ce qui fait l'humain, c'est qu'il ne s'abandonne pas à ses instincts primaires, c'est le respect des lois et de la morale. À mesure donc que Macbeth enfreint les règles élémentaires (hospitalité, allégeance, amitié, fidélité, loyauté, etc.), il se déshumanise graduellement jusqu'à devenir un rat acculé au coin d'une pièce, prêt à sauter au visage de n'importe qui simplement pour rester en vie.
Comme je vous l'avais précisé au début, je ne peux m'empêcher de voir dans Macbeth un double inversé d'Hamlet, ou, plus précisément, la même pièce mais focalisée sur un point de vue différent. Dans Hamlet, le roi légitime, le vieil Hamlet, a été trahi et assassiné par son frère Claudius avec la connivence de la reine, propre mère d'Hamlet. le point de vue est donc centralisé sur le fils du roi déchu.
Ici, au lieu d'avoir le point focal sur Hamlet, on l'a sur Claudius, et Claudius se nomme alors Macbeth. Mais c'est la même formule de base ; convertissez Hamlet en Malcolm et le vieil Hamlet en Duncan ; acceptez qu'il puisse y avoir un dédoublement du vieil Hamlet qui en plus d'être Duncan serait aussi Banquo et vous retrouvez le spectre dont le rôle est si prégnant dans Hamlet.
Pour que l'analogie soit totale, il nous faut encore un messager symbolique : c'était le jeu de la pièce de théâtre dans Hamlet, ce sont les trois sorcières dans Macbeth et, comme par magie, l'on retombe sur nos pieds. le thème phare d'Hamlet — la mort et l'inutilité de la vie ( le fameux « to be or not to be ») — s'avère être une part cruciale de Macbeth, prétexte à l'une des plus belles tirades de tout le théâtre shakespearien à la scène 5 de l'acte V.
On pourrait poursuivre encore longtemps le parallèle entre Hamlet et Macbeth. Par exemple, Hamlet se faisait passer pour fou afin de sonder l'entourage du roi Claudius, et ici, Malcolm se fait passer pour vil afin de tester Macduff. Les deux veulent venger la mort de leur père, un roi qu'on a assassiné.
La folie et le suicide de Lady Macbeth répondent comme un écho à la mère de Hamlet et à la fin d'Ophélie. de même que le maléfique Claudius n'avait pas d'enfant, le couple Macbeth, empreint du mal, disparaît sans descendance.
Comment ne pas voir un clin d'oeil ou un appel du pied au règne d'Elisabeth Ière, reine sans enfant, dont on sait qu'elle était probablement impliquée dans des morts louches, notamment celle de la femme de son amant ? le souverain doit donc savoir être réceptif aux avertissements qui lui sont transmis par les esprits éclairés. Dans la vraie vie du XVIIème siècle, c'est le théâtre et notamment Shakespeare qui donne ces signaux d'alarme, dans Macbeth, ce sont les trois sorcières.
Selon Shakespeare, et comme dans Hamlet, le pouvoir oublieux de la morale, qui ne parvient pas à décoder comme il convient les prophéties et les avertissements délivrés par le théâtre est appelé à disparaître. Macbeth reproche d'ailleurs, à la scène 7 de l'acte V, le double entente qu'on peut faire du langage et accuse les sorcières d'être des tricheuses, alors même qu'elles lui ont fidèlement tout annoncé, tout prédit, mais que lui a mal interprété leur discours.
Le lien avec les messages délivrés par le théâtre à l'adresse du pouvoir me semble évident. Le théâtre utilise le symbole, la métaphore, les analogies historiques ou les contrées lointaines, mais ce dont il parle vraiment, pour qui sait lire entre les lignes et briser les encodages, c'est du brûlant présent, de l'ici et du maintenant.
J'en terminerai (car même s'il resterait encore beaucoup de choses à dire de cette superbe tragédie, j'ai conscience que ma critique a déjà atteint une longueur critique) en signalant dans le registre du cinéma qu'il y a probablement un peu (ou même beaucoup) de Macbeth dans le personnage ô combien fameux de Dark Vador dans l'épopée Star Wars. de même, Akira Kurosawa transposa Macbeth avec des samouraï japonais dans son film le Château de L'Araignée.
Et dire qu'avec tout ce que j'ai déjà écrit je n'ai pas encore abordé cet autre joyau qu'est Othello ! C'est pourtant une tragédie sublime, au sens premier, au sens profond, dans l'acception antique du terme, c'est-à-dire, de la création d'une œuvre artistique capable de susciter les plus vives émotions chez le spectateur, afin de gagner son empathie, de le faire vivre par procuration des émotions aussi fortes que les personnages fictifs qui évoluent devant lui.
Notre sens inné de la justice, même non formulé, même fort enfoui, même inconscient, même volontairement muselé, ne peut que s'insurger face à cet infâme complot de cet infâme Iago, face à une telle ignominie ; et c'est précisément ce sentiment que recherchait William Shakespeare et qu'il arrive à faire éclore admirablement, aujourd'hui comme hier et pour des siècles encore.
Même si le protagoniste principal semble bien davantage Iago qu'Othello et, d'un simple point de vue statistique, il est manifeste que Iago monopolise la scène, c'est bien à la place d'Othello que l'auteur souhaite nous placer, et non à la place de Iago. C'est bien l'œuvre de Iago sur Othello qui indigne et non les motifs intimes du fourbe qui présentent un intérêt.
Le message, du moins l'un des messages possibles de cette oeuvre, est le noircissement. Je ne blague pas, et le fait que Shakespeare ait choisi un personnage noir comme héros d'infortune n'a sans doute rien d'hasardeux. L'apparence. Celui qui semble noir l'est-il bien réellement ?
Tous. Tous semblent noirs à un moment ou à un autre : Cassio, Desdémone, Othello. Tous noirs et pourtant tous innocents. Et pourtant, on jurerait, selon l'angle où ils sont présentés les uns aux autres, on jurerait qu'ils sont coupables.
C'est probablement ça, le plus fort du message que souhaite nous donner en pâture l'auteur. Honni soit qui mal y pense ! Il est si facile de nuire, si facile de noircir, si facile de truquer, si facile de faire dire autre chose aux faits pris indépendamment ou hors contexte. C'est cela que semble nous dire Shakespeare.
Les apparences sont parfois contre nous et d'autres semblent blancs comme neige, et pourtant… et pourtant…, pourtant, quand on sait tout le fin mot, vraiment tout, la réalité est souvent loin des belles apparences et ce que l'on croyait simple, net, tranché, évident, ne l'est plus tant que cela.
Othello d'emblée est noir, ce qui jette sur lui une indéfinissable suspicion aux yeux des Vénitiens. Tout prétexte sera bon s'il fait le moindre faux-pas. Cassio est un beau subordonné prometteur, donc il est douteux. Desdémone est une noble Vénitienne blanche entichée d'un noir, donc c'est nécessairement une putain.
Autant de raccourcis faciles que nous avons tous tendance, consciemment ou inconsciemment, à commettre ici ou là. L'histoire a donné plusieurs fois raison à Shakespeare. (Rien qu'en France, au XXème siècle, des Juifs, des Maghrébins en tant que groupe ou des individualités comme Guillaume Seznec ont tous fait l'objet d'accusations plus ou moins calomnieuses ou bâties de toute pièce, basées sur des a priori ou des apparences qui leur étaient adverses. Je ne parle évidemment pas de tous les endroits du monde et à toutes les périodes depuis Shakespeare, car il y aurait de quoi remplir tout Babelio avec.)
Si l'on cherche des fautes à quelqu'un, on en trouvera fatalement. Si l'on sait habilement les mettre en lumière, leur donner d'autres apparences, attiser le vent de la vengeance, mobiliser la justice à son avantage, n'importe qui peut être traîné dans la boue ou commettre l'irréparable.
Quels sont les mobiles de tout cela ? L'auteur reste très discret et très flou sur les motivations de Iago. Cela semble tourner autour de la jalousie, de l'orgueil bafoué, de l'envie inassouvie, du complexe d'infériorité.
Intéressons nous encore quelques instants à Iago. Ce qui est frappant dans le texte, dans les qualificatifs qu'on lui attribue, c'est le nombre de fois où reviennent, les adjectifs noble, honnête, fidèle, courageux, droit, fiable, vertueux, etc. Encore une fois, si l'on se place à l'époque de Shakespeare pour tâcher d'y voir plus clair, la meilleure explication, la principale justification à cette pièce est l'admirable travail de sape réalisé par les puritains à l'égard du théâtre élisabéthain.
Iago, dans cette optique, est donc le symbole du puritanisme, Othello, le noir à qui l'on fait commettre des abjections ne saurait être autre que Shakespeare lui-même, Cassio, représenterait alors quelque autre auteur contemporain de Shakespeare comme Christopher Marlowe ou Ben Johnson.
Les abjections des uns et des autres sont les écrits vils qu'ils étaient obligés de pondre, pamphlets notamment, simplement pour pouvoir gagner moindrement leur vie.
Desdémone, celle qui est totalement innocente est qui est sacrifiée serait alors la déesse aux cent bouches, à savoir le public, qui fait les frais des fermetures de théâtres sous la houlette des Puritains.
Voilà le type de message que je vois dans Othello, la dénonciation de la calomnie à l'égard des dramaturges honnêtes qu'on accuse de toutes les perversions, mais ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose. le mieux que vous ayez à faire, c'est encore d'ouvrir ce livre et de découvrir ou bien relire ces trois pièces admirables.
La p'tite bête qui monte, qui monte, qui monte…
… et qui descend.
Roméo et Juliette, ça monte, ça monte.
Hamlet, ça monte, ça monte, on atteint le zénith.
Le Songe d'une Nuit d'été, ça descend. Plouf !
J'ai vraiment aimé Roméo et Juliette, j'ai adoré Hamlet, et j'ai très très peu aimé le Songe d'une Nuit d'Été. Ces trois pièces (une tragi-comédie, une tragédie et une comédie dans cet ordre) donnent un aperçu de la diversité du talent de William Shakespeare.
Ce sont toutes des pièces bourrées de symboles, des portes à serrures et à codes. Comme toute porte forte, le mieux c'est d'avoir les clefs ou les codes avant de s'y atteler sans quoi on peut s'y casser le nef. Donc, d'après moi, il est sûrement intéressant de lire quelques petites choses sur l'époque ou le théâtre avant de s'y plonger car, à brûle-pourpoint, pour un lecteur qui débute avec Shakespeare — or ces pièces sont souvent choisies par les gens qui se frottent à Shakespeare pour la première fois — le fossé peut-être profond avec la littérature plus contemporaine.
Je pense qu'il y a un petit effort à faire pour se bien glisser dans l'époque et dans la pensée d'alors, mais aussi dans ce que représentait le théâtre en ce temps-là, qui en était le public et quel discret parfum de sédition il pouvait distiller.
J'ai déjà dis ailleurs combien j'aimais Roméo et Juliette, le long processus de création via plusieurs auteurs depuis les nouvelles italiennes où l'histoire a vu le jour. J'ai aussi dit le message codé que j'y lisais, adressé aux grands d'Angleterre et d'Espagne. Je vous renvoie à la critique spécifique de cette pièce si vous souhaitez davantage de détails.
On passe ensuite au plus gigantesque monument, au chef-d'œuvre absolu de Shakespeare avec cet Hamlet de malheur. Une tragédie réellement exceptionnelle, pièce à tiroirs où la mise en abîme sonne comme une mise en garde, là encore adressée, selon moi à la Reine elle-même, Elisabeth Ière, à propos de l'étouffement du théâtre qui est en cours sous l'action castratrice des puritains qui envahissent le royaume. Beaucoup de niveaux de lecture, une qualité d'écriture hors normes, une tragédie qui a fait beaucoup de petits dans toute la littérature mondiale : à ne pas manquer. Là encore je vous renvoie à la critique spécifique si vous souhaitez d'avantage de détails.
Enfin, on arrive à la pièce que d'aucuns considèrent comme " l'origine ", en matière de fées et d'elfes, même si c'est absolument faux puisqu'elle s'appuie sur des traditions bien plus anciennes, mais peu importe. Contrairement aux deux autres, cette pièce m'ennuie mortellement. Là encore il y a une mise en abîme, là encore il y a du surnaturel (c'était déjà le cas dans Hamlet à moindre dose) mais, en ce qui me concerne la mayonnaise ne prend pas, mais alors pas du tout. J'aurais tendance à conseiller, pour ceux qui aiment la magie, la féérie, tout en restant dans le domaine Shakespeare, sa toute dernière pièce, La Tempête, qui est, selon moi d'un tout autre calibre, réellement comparable aux deux chefs-d'œuvre sus-mentionnés.
En somme, malgré les limitations que j'apporte plus haut, selon moi un excellent livre pour les personnes désireuses de découvrir le grand Will. Bien évidemment, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
… et qui descend.
Roméo et Juliette, ça monte, ça monte.
Hamlet, ça monte, ça monte, on atteint le zénith.
Le Songe d'une Nuit d'été, ça descend. Plouf !
J'ai vraiment aimé Roméo et Juliette, j'ai adoré Hamlet, et j'ai très très peu aimé le Songe d'une Nuit d'Été. Ces trois pièces (une tragi-comédie, une tragédie et une comédie dans cet ordre) donnent un aperçu de la diversité du talent de William Shakespeare.
Ce sont toutes des pièces bourrées de symboles, des portes à serrures et à codes. Comme toute porte forte, le mieux c'est d'avoir les clefs ou les codes avant de s'y atteler sans quoi on peut s'y casser le nef. Donc, d'après moi, il est sûrement intéressant de lire quelques petites choses sur l'époque ou le théâtre avant de s'y plonger car, à brûle-pourpoint, pour un lecteur qui débute avec Shakespeare — or ces pièces sont souvent choisies par les gens qui se frottent à Shakespeare pour la première fois — le fossé peut-être profond avec la littérature plus contemporaine.
Je pense qu'il y a un petit effort à faire pour se bien glisser dans l'époque et dans la pensée d'alors, mais aussi dans ce que représentait le théâtre en ce temps-là, qui en était le public et quel discret parfum de sédition il pouvait distiller.
J'ai déjà dis ailleurs combien j'aimais Roméo et Juliette, le long processus de création via plusieurs auteurs depuis les nouvelles italiennes où l'histoire a vu le jour. J'ai aussi dit le message codé que j'y lisais, adressé aux grands d'Angleterre et d'Espagne. Je vous renvoie à la critique spécifique de cette pièce si vous souhaitez davantage de détails.
On passe ensuite au plus gigantesque monument, au chef-d'œuvre absolu de Shakespeare avec cet Hamlet de malheur. Une tragédie réellement exceptionnelle, pièce à tiroirs où la mise en abîme sonne comme une mise en garde, là encore adressée, selon moi à la Reine elle-même, Elisabeth Ière, à propos de l'étouffement du théâtre qui est en cours sous l'action castratrice des puritains qui envahissent le royaume. Beaucoup de niveaux de lecture, une qualité d'écriture hors normes, une tragédie qui a fait beaucoup de petits dans toute la littérature mondiale : à ne pas manquer. Là encore je vous renvoie à la critique spécifique si vous souhaitez d'avantage de détails.
Enfin, on arrive à la pièce que d'aucuns considèrent comme " l'origine ", en matière de fées et d'elfes, même si c'est absolument faux puisqu'elle s'appuie sur des traditions bien plus anciennes, mais peu importe. Contrairement aux deux autres, cette pièce m'ennuie mortellement. Là encore il y a une mise en abîme, là encore il y a du surnaturel (c'était déjà le cas dans Hamlet à moindre dose) mais, en ce qui me concerne la mayonnaise ne prend pas, mais alors pas du tout. J'aurais tendance à conseiller, pour ceux qui aiment la magie, la féérie, tout en restant dans le domaine Shakespeare, sa toute dernière pièce, La Tempête, qui est, selon moi d'un tout autre calibre, réellement comparable aux deux chefs-d'œuvre sus-mentionnés.
En somme, malgré les limitations que j'apporte plus haut, selon moi un excellent livre pour les personnes désireuses de découvrir le grand Will. Bien évidemment, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
"Two households, both alike in dignity,
in fair Verona, where we lay our scene..."
1595. Elisabeth I règne sur l'Angleterre, et le théâtre londonien nommé opportunément The Theatre donne pour la première fois "Romeo and Juliet", déchirant drame romantique de la plume d'un certain William Shakespeare, fils d'un gantier de Stratford. Pour la même somme modique d'un penny, vous avez alors le choix entre les très populaires combats d'ours, coqs, ou chiens, ou un peu de culture dramatique dans l'établissement rond de Mr. Burbage juste à côté. Arène contre arène, mais ce jour là, c'est le théâtre que les londoniens vont choisir.
Il y a bien d'autres couples tragiques : Tristan et Iseut, Héro et Léandre, Pyrame et Thisbé... mais désormais, Roméo et Juliette resteront à tout jamais le symbole de l'amour maudit.
On peut penser ce qu'on veut de cette pièce. Que c'est juste un mélodrame à l'eau de rose, que les protagonistes manquent de maturité (ce qui est d'ailleurs compréhensible, à 14 et 17 ans) et tombent amoureux sans se connaître vraiment. Mais ça n'a aucune importance. "Words, words, words..", dira t-on plus tard au Danemark. L'important sont les mots du grand magicien Will, qui va créer sur scène un monde de haine absolue entre deux nobles familles, et au milieu de tout cela - l'Amour.
La pièce a vu le jour bien avant les grands drames tels que "Macbeth", "Othello" ou "Le Roi Lear". Elle fut écrite en même temps que "Le songe d'une nuit d'été", et d'une certaine façon ces deux pièces sont complémentaires. Mais tandis que "Le Songe" commence d'une façon plutôt dramatique pour finir comme toute bonne comédie par un mariage heureux, pour "Roméo et Juliette" c'est le contraire.
Le prologue vous prépare aux événements tragiques, mais pendant les deux premiers actes, vous hésitez...
Tout commence par un dialogue assez drôle de deux serviteurs. Puis Roméo, tel un chantre pétrarquien, va assommer ses amis par des effusions fleuries sur l'amour, pleines de souffrance et d'oxymores très en vogue. C'est ciselé et romantique à mourir (et le jeune Shakespeare montre bien de quoi il est capable), mais Roméo est pour ainsi dire amoureux seulement de l'Amour. Il manque quelque chose...
Quand il voit Juliette pour la première fois au bal des Capulet, c'est une révélation. Il sait que c'est Elle... elle sait que c'est Lui. Et le langage va changer pour se transformer en un de ces beaux sonnets que Will tire de son encrier comme si de rien n'était.
La "scène du balcon" qui va suivre est probablement l'une des plus célèbres dans l'histoire du théâtre :
"What's Montague ? it is nor hand, nor foot
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some other name !
What's in a name ? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet !"
Ils se marient en secret, mais à partir de ce moment, le Destin se met doucement en route pour rendre leur idylle impossible. Si vous hésitez encore, tout ce qui pourrait faire penser à une comédie est mort en même temps que l'excellent cynique Mercutio, tué par Tybalt Capulet pendant l'acte III. Vous connaissez la suite. En effet, le scénario est digne des "Penny Dreadful", mais les dialogues de Shakespeare et les personnages inoubliables comme le frère Laurence en font bien plus.
Les Montague vont enfin se réconcilier avec les Capulet devant les cadavres de leurs enfants, mais cette nouvelle paix n'est pas tout à fait une "happy end". Elle apporte seulement une sorte d'apaisement mélancolique, car même les statues en or érigées en mémoire des deux amoureux ne peuvent plus rattraper le passé.
Shakespeare n'explique jamais l'origine de la haine des deux familles. Les Montague haïssent les Capulet, tout comme les gens se haïssent partout dans le monde. Pour des raisons religieuses, politiques, raciales ou personnelles... tant que ça dure, cette pièce sera intemporelle. Où que vous alliez jouer "Roméo et Juliette", chaque époque et chaque contexte va donner à la pièce son propre sens. Et ça fonctionnera toujours...
"For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo."
Je donnerais volontiers un penny, pour pouvoir me mettre devant la scène du Theatre en 1595 (avec ma pinte de bière incluse dans le prix) et voir Richard Burbage en personne dans le rôle de Roméo, et le jeune Robert Goffe en Juliette. Il paraît qu'il était excellent. Et je verrais bien Will en Mercutio, mais c'est juste une idée comme ça...
Comment noter ? 4,5/5 parce que ce n'est pas "Richard III, mais voyez-y quand-même 5/5.
in fair Verona, where we lay our scene..."
1595. Elisabeth I règne sur l'Angleterre, et le théâtre londonien nommé opportunément The Theatre donne pour la première fois "Romeo and Juliet", déchirant drame romantique de la plume d'un certain William Shakespeare, fils d'un gantier de Stratford. Pour la même somme modique d'un penny, vous avez alors le choix entre les très populaires combats d'ours, coqs, ou chiens, ou un peu de culture dramatique dans l'établissement rond de Mr. Burbage juste à côté. Arène contre arène, mais ce jour là, c'est le théâtre que les londoniens vont choisir.
Il y a bien d'autres couples tragiques : Tristan et Iseut, Héro et Léandre, Pyrame et Thisbé... mais désormais, Roméo et Juliette resteront à tout jamais le symbole de l'amour maudit.
On peut penser ce qu'on veut de cette pièce. Que c'est juste un mélodrame à l'eau de rose, que les protagonistes manquent de maturité (ce qui est d'ailleurs compréhensible, à 14 et 17 ans) et tombent amoureux sans se connaître vraiment. Mais ça n'a aucune importance. "Words, words, words..", dira t-on plus tard au Danemark. L'important sont les mots du grand magicien Will, qui va créer sur scène un monde de haine absolue entre deux nobles familles, et au milieu de tout cela - l'Amour.
La pièce a vu le jour bien avant les grands drames tels que "Macbeth", "Othello" ou "Le Roi Lear". Elle fut écrite en même temps que "Le songe d'une nuit d'été", et d'une certaine façon ces deux pièces sont complémentaires. Mais tandis que "Le Songe" commence d'une façon plutôt dramatique pour finir comme toute bonne comédie par un mariage heureux, pour "Roméo et Juliette" c'est le contraire.
Le prologue vous prépare aux événements tragiques, mais pendant les deux premiers actes, vous hésitez...
Tout commence par un dialogue assez drôle de deux serviteurs. Puis Roméo, tel un chantre pétrarquien, va assommer ses amis par des effusions fleuries sur l'amour, pleines de souffrance et d'oxymores très en vogue. C'est ciselé et romantique à mourir (et le jeune Shakespeare montre bien de quoi il est capable), mais Roméo est pour ainsi dire amoureux seulement de l'Amour. Il manque quelque chose...
Quand il voit Juliette pour la première fois au bal des Capulet, c'est une révélation. Il sait que c'est Elle... elle sait que c'est Lui. Et le langage va changer pour se transformer en un de ces beaux sonnets que Will tire de son encrier comme si de rien n'était.
La "scène du balcon" qui va suivre est probablement l'une des plus célèbres dans l'histoire du théâtre :
"What's Montague ? it is nor hand, nor foot
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some other name !
What's in a name ? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet !"
Ils se marient en secret, mais à partir de ce moment, le Destin se met doucement en route pour rendre leur idylle impossible. Si vous hésitez encore, tout ce qui pourrait faire penser à une comédie est mort en même temps que l'excellent cynique Mercutio, tué par Tybalt Capulet pendant l'acte III. Vous connaissez la suite. En effet, le scénario est digne des "Penny Dreadful", mais les dialogues de Shakespeare et les personnages inoubliables comme le frère Laurence en font bien plus.
Les Montague vont enfin se réconcilier avec les Capulet devant les cadavres de leurs enfants, mais cette nouvelle paix n'est pas tout à fait une "happy end". Elle apporte seulement une sorte d'apaisement mélancolique, car même les statues en or érigées en mémoire des deux amoureux ne peuvent plus rattraper le passé.
Shakespeare n'explique jamais l'origine de la haine des deux familles. Les Montague haïssent les Capulet, tout comme les gens se haïssent partout dans le monde. Pour des raisons religieuses, politiques, raciales ou personnelles... tant que ça dure, cette pièce sera intemporelle. Où que vous alliez jouer "Roméo et Juliette", chaque époque et chaque contexte va donner à la pièce son propre sens. Et ça fonctionnera toujours...
"For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo."
Je donnerais volontiers un penny, pour pouvoir me mettre devant la scène du Theatre en 1595 (avec ma pinte de bière incluse dans le prix) et voir Richard Burbage en personne dans le rôle de Roméo, et le jeune Robert Goffe en Juliette. Il paraît qu'il était excellent. Et je verrais bien Will en Mercutio, mais c'est juste une idée comme ça...
Comment noter ? 4,5/5 parce que ce n'est pas "Richard III, mais voyez-y quand-même 5/5.
Ce livre nous propose deux pièces ultra célèbres de Shakespeare pour lesquelles j'ai deux ressentis très différents. Tout d'abord le fameux Songe D'Une Nuit D'Été qui fut d'une cruelle déception pour moi : des fleurs d'amour, des sortilèges, des quiproquos assommants…
Je ne suis vraiment pas cliente pour ce genre de pièces et j'ai pour principe de considérer que quand une comédie, à aucun moment, ne me fait rire, ni même sourire, selon mes critères, c'est une comédie ratée.
J'ai le sentiment que si un esprit malveillant s'amusait à gommer le nom de la pièce et celui de son auteur, tous deux passés à la postérité, peu sont ceux qui s'émerveilleraient de ce spectacle rendu anonyme ou s'il était l'œuvre d'un inconnu. Je suis prête à prendre les paris que beaucoup s'y ennuieraient ferme.
Bien sûr, ce n'est que mon avis mais je sais aussi qu'il existe une espèce de snobisme — souvent inconscient d'ailleurs — qui consiste à s'extasier quand on assiste à une représentation théâtrale ou orchestrale d'un auteur ou compositeur célèbre (j'ai en tête un certain concert de Joseph Haydn et une certaine représentation de la Cantatrice Chauve mais bon, peu importe) et à regarder d'un œil dédaigneux ceux qui ne goûtent pas ce plaisir, voire à les prendre pour de sombres ignares. Je sais en outre que certains y prennent authentiquement du plaisir car la diversité des opinions et sensibilités est quasi sans limite. Je sais et j'ai expérimenté tout ça. Pensez ce que vous voudrez. J'ai dis combien j'aimais certaines tragédies de Shakespeare, je dis combien cette pièce-ci m'endort et présente peu d'intérêt à mes yeux.
Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas sujets à la narcolepsie, sachez que la pièce se déroule en Grèce à l'époque héroïque de Thésée et d'Hippolyta, la reine des Amazones. Ces deux-là ont échafaudé de se marier mais comme l'intrigue a besoin de sel, Shakespeare a imaginé de former deux ou trois autres couples boiteux histoire de compliquer la donne.
Ainsi, Lyssandre aime Hermia, fille d'Égée, et elle l'aime aussi. Tout va bien alors ? me direz-vous. Non, pas tout à fait, car Égée, lui, ne veut pas entendre parler de Lyssandre et n'a d'yeux que pour Démétrius, ce qui, évidemment, n'est pas du tout du goût d'Hermia. Et ce n'est pas tout, car Démétrius était au préalable amoureux d'Héléna, la meilleure copine d'Hermia, avant de changer de cap et de lorgner sur cette dernière. Mais elle, Héléna, est restée raide dingue de Démétrius. Vous me suivez ? Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il y a aussi de l'eau dans le gaz chez les Fées !
Obéron, le patron des farfadets, trolls et autres sortilégineux se prend le bec avec sa bourgeoise Titania, la taulière des elfes & fées. Du coup, Obéron, qui a plus d'un tour dans son sac, se dit qu'il va faire mettre un coup de fleur d'amour dans le nez à Titania pendant son sommeil. Au passage il demande à Robin, son homme de main, de mettre aussi un p'tit coup de fleur à Démétrius, histoire qu'il regarde à nouveau plaisamment Héléna à son réveil.
C'est là qu'intervient la scène censée être d'anthologie où Titania se réveille et tombe en pâmoison devant un gugusse à tête d'âne. Rrrrr ! Zzzzz ! Rrrr ! Zzzzz ! [ceci symbolise les " elffets " du sortilège d'Obéron sur moi]
Cependant, vu qu'Obéron donne à Robin des instructions claires comme du jus de boudin, l'autre, pas plus consciencieux qu'il ne faut, badigeonne des grands coups de fleur d'amour à… Lyssandre ! Aaah ! La gaffe ! Ouh, là, là ! Ça va être dur à rattraper un coup comme ça ! J'aime mieux vous laisser découvrir la suite par vous-même.
Faut-il encore que je vous parle d'une troupe de comédiens amateurs qu'essaient à tout prix de faire une pièce pas drôle, et que c'est vraiment pas drôle de les voir faire leur pièce pas drôle… Zzzzz ! Rideau. Bon, à l'extrême — extrême — rigueur, on pourrait supputer une toute petite once d'intérêt à la réflexion de l'auteur à propos de l'éphémère sensation qu'est l'amour en nos vies… Ouaip. Vous aviez sans doute besoin de ça pour avancer ? Bon, en ce qui me concerne, la pièce a des vertus soporifiques intéressantes en cas d'insomnie. À vous de voir ce que vous pourrez en faire.
Passons, sans plus tarder, à Othello, une pièce qui, elle, m'a enthousiasmé. À mes yeux, c'est une tragédie sublime, propre à susciter les plus vives émotions chez le spectateur. Même si je ne pense pas que le spectateur moderne puisse encore aller fréquemment jusqu'aux larmes, à la tristesse ou à l'abattement, il peut probablement aller jusqu'à l'indignation.
Une forte indignation intérieure devant cet infâme complot de cet infâme Iago, sorte de copie du Maure de Titus Andronicus. Notre sens inné de la justice, même non formulé, même fort enfoui, même inconscient, même volontairement muselé, ne peut que s'insurger face à une telle ignominie, et c'est précisément ce sentiment que recherchait William Shakespeare et qu'il arrive à faire éclore admirablement, aujourd'hui comme hier et pour des siècles encore.
De multiples interprétations peuvent rendre compte d'Othello. On y a souvent trouvé une certaine énigme dans son titre car le protagoniste principal semble bien davantage Iago qu'Othello. Il est vraiment clair, d'un simple point de vue statistique, que Iago monopolise la scène et qu'Othello n'est presque qu'un personnage secondaire, comme tous les autres d'ailleurs. C'est indéniable.
Par contre, si l'on se penche sur la signification, sur ce qu'a voulu exprimer Shakespeare, là le titre commence à prendre toute son envergure. Car c'est bien à la place d'Othello que l'auteur souhaite nous placer, et non à la place de Iago. C'est bien l'oeuvre de Iago sur Othello qui indigne et non les motifs intimes du fourbe qui présentent un intérêt.
Le message, du moins l'un des messages possibles de cette oeuvre, est le noircissement. Je ne blague pas, et le fait que Shakespeare ait choisi un personnage noir comme héros d'infortune n'a sans doute rien d'hasardeux. L'apparence. Celui qui semble noir l'est-il bien réellement ? Tous. Tous semblent noirs à un moment ou à un autre : Cassio, Desdémone, Othello. Tous noirs et pourtant tous innocents. Malgré tout, on jurerait, selon l'angle où ils sont présentés les uns aux autres, qu'ils sont coupables.
C'est probablement ça, le plus fort du message que souhaite nous donner en pâture l'auteur. Honni soit qui mal y pense ! Il est si facile de nuire, si facile de noircir, si facile de truquer, si facile de faire dire autre chose aux faits pris indépendamment ou hors contexte. C'est cela que semble nous dire Shakespeare. Les apparences sont parfois contre nous et d'autres semblent blancs comme neige, et pourtant… et pourtant…, pourtant, quand on sait tout le fin mot, vraiment tout, la réalité est souvent loin des belles apparences et ce que l'on croyait simple, net, tranché, évident, ne l'est plus tant que cela.
Othello d'emblée est noir, ce qui jette sur lui une indéfinissable suspicion aux yeux des Vénitiens. (Au passage, je précise qu'à l'époque de Shakespeare, une femme bronzée par le soleil estival est aussi jugée fort laide de par son bronzage.) Tout prétexte sera bon s'il fait le moindre faux-pas. Cassio est un beau subordonné prometteur, donc il est douteux. Desdémone est une noble Vénitienne blanche entichée d'un noir, donc c'est nécessairement une putain. Autant de raccourcis faciles mais que nous avons tous tendance, consciemment ou inconsciemment, à commettre ici ou là.
L'histoire a donné plusieurs fois raison à Shakespeare. (Rien qu'en France, au XXème siècle, des Juifs, des Maghrébins en tant que groupe ou des individualités comme Guillaume Seznec ont tous fait l'objet d'accusations plus ou moins calomnieuses ou bâties de toute pièce, basées sur des a priori ou des apparences qui leur étaient adverses. Je ne parle évidemment pas de tous les endroits du monde et à toutes les périodes depuis Shakespeare, car il y aurait de quoi remplir tout Babelio avec.)
Si l'on cherche des fautes à quelqu'un, on en trouvera nécessairement. Si l'on sait habilement les mettre en lumière, leur donner d'autres apparences, attiser le vent de la vengeance, mobiliser la justice à son avantage, n'importe qui peut être traîné dans la boue ou commettre l'irréparable.
Quels sont les mobiles de tout cela ? L'auteur reste très discret et très flou sur les motivations de Iago. Cela semble tourner autour de la jalousie, de l'orgueil bafoué, de l'envie inassouvie, du complexe d'infériorité.
Intéressons nous encore quelques instants à Iago. Ce qui est frappant dans le texte, dans les qualificatifs qu'on lui attribue, c'est le nombre de fois où reviennent, les adjectifs noble, honnête, fidèle, courageux, droit, fiable, vertueux, etc. Encore une fois, si l'on se place à l'époque de Shakespeare pour tâcher d'y voir plus clair, la meilleure explication, la principale justification à cette pièce est l'admirable travail de sape réalisé par les puritains à l'égard du théâtre élisabéthain.
Iago, dans cette optique, est donc le symbole du puritanisme ; Othello, le noir à qui l'on fait commettre des abjections ne saurait être autre que Shakespeare lui-même, Cassio, représenterait alors quelque autre auteur contemporain de Shakespeare comme Christopher Marlowe ou Ben Johnson. Les abjections des uns et des autres sont les écrits vils qu'ils étaient obligés de pondre, pamphlets notamment, simplement pour pouvoir gagner moindrement leur vie. Desdémone, celle qui est totalement innocente est qui est sacrifiée serait alors la déesse aux cent bouches, à savoir le public, qui fait les frais des fermetures de théâtres sous la houlette des Puritains.
Voilà le type de message que je vois dans Othello, la dénonciation de la calomnie à l'égard des dramaturges honnêtes qu'on accuse de toutes les perversions, mais ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose. Le mieux que vous ayez à faire, c'est encore d'ouvrir ce livre et de vous en faire votre propre opinion.
Je ne suis vraiment pas cliente pour ce genre de pièces et j'ai pour principe de considérer que quand une comédie, à aucun moment, ne me fait rire, ni même sourire, selon mes critères, c'est une comédie ratée.
J'ai le sentiment que si un esprit malveillant s'amusait à gommer le nom de la pièce et celui de son auteur, tous deux passés à la postérité, peu sont ceux qui s'émerveilleraient de ce spectacle rendu anonyme ou s'il était l'œuvre d'un inconnu. Je suis prête à prendre les paris que beaucoup s'y ennuieraient ferme.
Bien sûr, ce n'est que mon avis mais je sais aussi qu'il existe une espèce de snobisme — souvent inconscient d'ailleurs — qui consiste à s'extasier quand on assiste à une représentation théâtrale ou orchestrale d'un auteur ou compositeur célèbre (j'ai en tête un certain concert de Joseph Haydn et une certaine représentation de la Cantatrice Chauve mais bon, peu importe) et à regarder d'un œil dédaigneux ceux qui ne goûtent pas ce plaisir, voire à les prendre pour de sombres ignares. Je sais en outre que certains y prennent authentiquement du plaisir car la diversité des opinions et sensibilités est quasi sans limite. Je sais et j'ai expérimenté tout ça. Pensez ce que vous voudrez. J'ai dis combien j'aimais certaines tragédies de Shakespeare, je dis combien cette pièce-ci m'endort et présente peu d'intérêt à mes yeux.
Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas sujets à la narcolepsie, sachez que la pièce se déroule en Grèce à l'époque héroïque de Thésée et d'Hippolyta, la reine des Amazones. Ces deux-là ont échafaudé de se marier mais comme l'intrigue a besoin de sel, Shakespeare a imaginé de former deux ou trois autres couples boiteux histoire de compliquer la donne.
Ainsi, Lyssandre aime Hermia, fille d'Égée, et elle l'aime aussi. Tout va bien alors ? me direz-vous. Non, pas tout à fait, car Égée, lui, ne veut pas entendre parler de Lyssandre et n'a d'yeux que pour Démétrius, ce qui, évidemment, n'est pas du tout du goût d'Hermia. Et ce n'est pas tout, car Démétrius était au préalable amoureux d'Héléna, la meilleure copine d'Hermia, avant de changer de cap et de lorgner sur cette dernière. Mais elle, Héléna, est restée raide dingue de Démétrius. Vous me suivez ? Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il y a aussi de l'eau dans le gaz chez les Fées !
Obéron, le patron des farfadets, trolls et autres sortilégineux se prend le bec avec sa bourgeoise Titania, la taulière des elfes & fées. Du coup, Obéron, qui a plus d'un tour dans son sac, se dit qu'il va faire mettre un coup de fleur d'amour dans le nez à Titania pendant son sommeil. Au passage il demande à Robin, son homme de main, de mettre aussi un p'tit coup de fleur à Démétrius, histoire qu'il regarde à nouveau plaisamment Héléna à son réveil.
C'est là qu'intervient la scène censée être d'anthologie où Titania se réveille et tombe en pâmoison devant un gugusse à tête d'âne. Rrrrr ! Zzzzz ! Rrrr ! Zzzzz ! [ceci symbolise les " elffets " du sortilège d'Obéron sur moi]
Cependant, vu qu'Obéron donne à Robin des instructions claires comme du jus de boudin, l'autre, pas plus consciencieux qu'il ne faut, badigeonne des grands coups de fleur d'amour à… Lyssandre ! Aaah ! La gaffe ! Ouh, là, là ! Ça va être dur à rattraper un coup comme ça ! J'aime mieux vous laisser découvrir la suite par vous-même.
Faut-il encore que je vous parle d'une troupe de comédiens amateurs qu'essaient à tout prix de faire une pièce pas drôle, et que c'est vraiment pas drôle de les voir faire leur pièce pas drôle… Zzzzz ! Rideau. Bon, à l'extrême — extrême — rigueur, on pourrait supputer une toute petite once d'intérêt à la réflexion de l'auteur à propos de l'éphémère sensation qu'est l'amour en nos vies… Ouaip. Vous aviez sans doute besoin de ça pour avancer ? Bon, en ce qui me concerne, la pièce a des vertus soporifiques intéressantes en cas d'insomnie. À vous de voir ce que vous pourrez en faire.
Passons, sans plus tarder, à Othello, une pièce qui, elle, m'a enthousiasmé. À mes yeux, c'est une tragédie sublime, propre à susciter les plus vives émotions chez le spectateur. Même si je ne pense pas que le spectateur moderne puisse encore aller fréquemment jusqu'aux larmes, à la tristesse ou à l'abattement, il peut probablement aller jusqu'à l'indignation.
Une forte indignation intérieure devant cet infâme complot de cet infâme Iago, sorte de copie du Maure de Titus Andronicus. Notre sens inné de la justice, même non formulé, même fort enfoui, même inconscient, même volontairement muselé, ne peut que s'insurger face à une telle ignominie, et c'est précisément ce sentiment que recherchait William Shakespeare et qu'il arrive à faire éclore admirablement, aujourd'hui comme hier et pour des siècles encore.
De multiples interprétations peuvent rendre compte d'Othello. On y a souvent trouvé une certaine énigme dans son titre car le protagoniste principal semble bien davantage Iago qu'Othello. Il est vraiment clair, d'un simple point de vue statistique, que Iago monopolise la scène et qu'Othello n'est presque qu'un personnage secondaire, comme tous les autres d'ailleurs. C'est indéniable.
Par contre, si l'on se penche sur la signification, sur ce qu'a voulu exprimer Shakespeare, là le titre commence à prendre toute son envergure. Car c'est bien à la place d'Othello que l'auteur souhaite nous placer, et non à la place de Iago. C'est bien l'oeuvre de Iago sur Othello qui indigne et non les motifs intimes du fourbe qui présentent un intérêt.
Le message, du moins l'un des messages possibles de cette oeuvre, est le noircissement. Je ne blague pas, et le fait que Shakespeare ait choisi un personnage noir comme héros d'infortune n'a sans doute rien d'hasardeux. L'apparence. Celui qui semble noir l'est-il bien réellement ? Tous. Tous semblent noirs à un moment ou à un autre : Cassio, Desdémone, Othello. Tous noirs et pourtant tous innocents. Malgré tout, on jurerait, selon l'angle où ils sont présentés les uns aux autres, qu'ils sont coupables.
C'est probablement ça, le plus fort du message que souhaite nous donner en pâture l'auteur. Honni soit qui mal y pense ! Il est si facile de nuire, si facile de noircir, si facile de truquer, si facile de faire dire autre chose aux faits pris indépendamment ou hors contexte. C'est cela que semble nous dire Shakespeare. Les apparences sont parfois contre nous et d'autres semblent blancs comme neige, et pourtant… et pourtant…, pourtant, quand on sait tout le fin mot, vraiment tout, la réalité est souvent loin des belles apparences et ce que l'on croyait simple, net, tranché, évident, ne l'est plus tant que cela.
Othello d'emblée est noir, ce qui jette sur lui une indéfinissable suspicion aux yeux des Vénitiens. (Au passage, je précise qu'à l'époque de Shakespeare, une femme bronzée par le soleil estival est aussi jugée fort laide de par son bronzage.) Tout prétexte sera bon s'il fait le moindre faux-pas. Cassio est un beau subordonné prometteur, donc il est douteux. Desdémone est une noble Vénitienne blanche entichée d'un noir, donc c'est nécessairement une putain. Autant de raccourcis faciles mais que nous avons tous tendance, consciemment ou inconsciemment, à commettre ici ou là.
L'histoire a donné plusieurs fois raison à Shakespeare. (Rien qu'en France, au XXème siècle, des Juifs, des Maghrébins en tant que groupe ou des individualités comme Guillaume Seznec ont tous fait l'objet d'accusations plus ou moins calomnieuses ou bâties de toute pièce, basées sur des a priori ou des apparences qui leur étaient adverses. Je ne parle évidemment pas de tous les endroits du monde et à toutes les périodes depuis Shakespeare, car il y aurait de quoi remplir tout Babelio avec.)
Si l'on cherche des fautes à quelqu'un, on en trouvera nécessairement. Si l'on sait habilement les mettre en lumière, leur donner d'autres apparences, attiser le vent de la vengeance, mobiliser la justice à son avantage, n'importe qui peut être traîné dans la boue ou commettre l'irréparable.
Quels sont les mobiles de tout cela ? L'auteur reste très discret et très flou sur les motivations de Iago. Cela semble tourner autour de la jalousie, de l'orgueil bafoué, de l'envie inassouvie, du complexe d'infériorité.
Intéressons nous encore quelques instants à Iago. Ce qui est frappant dans le texte, dans les qualificatifs qu'on lui attribue, c'est le nombre de fois où reviennent, les adjectifs noble, honnête, fidèle, courageux, droit, fiable, vertueux, etc. Encore une fois, si l'on se place à l'époque de Shakespeare pour tâcher d'y voir plus clair, la meilleure explication, la principale justification à cette pièce est l'admirable travail de sape réalisé par les puritains à l'égard du théâtre élisabéthain.
Iago, dans cette optique, est donc le symbole du puritanisme ; Othello, le noir à qui l'on fait commettre des abjections ne saurait être autre que Shakespeare lui-même, Cassio, représenterait alors quelque autre auteur contemporain de Shakespeare comme Christopher Marlowe ou Ben Johnson. Les abjections des uns et des autres sont les écrits vils qu'ils étaient obligés de pondre, pamphlets notamment, simplement pour pouvoir gagner moindrement leur vie. Desdémone, celle qui est totalement innocente est qui est sacrifiée serait alors la déesse aux cent bouches, à savoir le public, qui fait les frais des fermetures de théâtres sous la houlette des Puritains.
Voilà le type de message que je vois dans Othello, la dénonciation de la calomnie à l'égard des dramaturges honnêtes qu'on accuse de toutes les perversions, mais ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose. Le mieux que vous ayez à faire, c'est encore d'ouvrir ce livre et de vous en faire votre propre opinion.
Un humour totalement désopilant caractérise cette pièce grandiose qui se classe parmi les comédies du grand dramaturge anglais, généralement plus célébré pour ces tragédies.
La multitude des personnages traités en profondeur, les chassés-croisés multiples et les différents intérêts des protagonistes font de "Much Ado About Nothing" un pépite théâtrale à rebondissements !
A lire absolument, à voir sur les planches si possible et à défaut, vous pouvez visionner la très bonne adaptation cinématographique réalisée en 1993 par le brillantissime Kenneth Branagh avec une très belle palette d'acteurs parmi lesquels Kenneth Branagh en personne dans le rôle de Benedict, la talentueuse Emma Thompson pour lui donner la réplique, le ténébreux Keanu Reeves, l'inimitable Michael Keaton, le séduisant Denzel Washington (oui, vous avez bien lu !), Kate Beckinsale alors débutante et le troublant Robert Sean Leonard. Et sur tout ça, une BO lumineuse !
La multitude des personnages traités en profondeur, les chassés-croisés multiples et les différents intérêts des protagonistes font de "Much Ado About Nothing" un pépite théâtrale à rebondissements !
A lire absolument, à voir sur les planches si possible et à défaut, vous pouvez visionner la très bonne adaptation cinématographique réalisée en 1993 par le brillantissime Kenneth Branagh avec une très belle palette d'acteurs parmi lesquels Kenneth Branagh en personne dans le rôle de Benedict, la talentueuse Emma Thompson pour lui donner la réplique, le ténébreux Keanu Reeves, l'inimitable Michael Keaton, le séduisant Denzel Washington (oui, vous avez bien lu !), Kate Beckinsale alors débutante et le troublant Robert Sean Leonard. Et sur tout ça, une BO lumineuse !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de William Shakespeare
Quiz
Voir plus
Roméo et Juliette
"Roméo et Juliette" est une comédie.
Vrai
Faux
10 questions
1999 lecteurs ont répondu
Thème : Roméo et Juliette de
William ShakespeareCréer un quiz sur cet auteur1999 lecteurs ont répondu