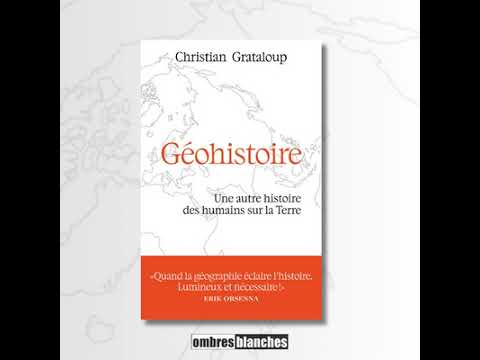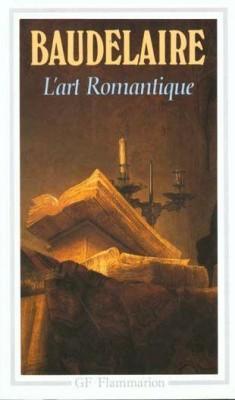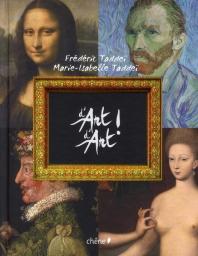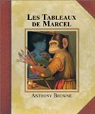Denis Diderot
Gita May (Éditeur scientifique)Jacques Chouillet (Éditeur scientifique)
Gita May (Éditeur scientifique)Jacques Chouillet (Éditeur scientifique)
EAN : 9782705666941
Hermann (16/06/2007)
/5
18 notes
Hermann (16/06/2007)
Résumé :
Ce volume réunit les textes de Diderot, les premiers Salons et les Essais sur la peinture, qui contiennent l'essentiel de ses idées sur l'art de 1759 à 1765. Diderot, dans ses écrits, tâche de ramener les artistes à une observation plus sincère de la nature. Il n'envisage pas l'oeuvre d'art sous le seul angle des qualités formelles, mais s'attache aussi à la décrire dans ses rapports ambigus, souvent déterminants, avec la société et les institutions politiques.
>Voir plus
>Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Essais sur la peinture - Salons de 1759 - 1761 - 1763 Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Il suffit d'avoir parcouru ce code du pompiérisme qu'est l'Essai de la peinture de Diderot pour comprendre comment la peinture elle-même ne se concevait que par rapport à tout un appareil de lois et de références grâce auquel la perfection était garantie: ainsi énonce-t-il les lois du "paysage historique", celles du "paysage ordinaire", qui feraient aujourd'hui hausser les épaules du lecteur le moins averti.
(Régine Pernoud_Pour en finir avec le Moyen-Age)
Voilà qui résume parfaitement mon sentiment sur cet ouvrage.
(Régine Pernoud_Pour en finir avec le Moyen-Age)
Voilà qui résume parfaitement mon sentiment sur cet ouvrage.
Comme son nom l'indique,il est ici question de peinture ! l'auteur y développe ses gouts et ses connaissances en la matière avec son brillant style habituel.Ce qui fait un grand auteur c'est sa faculté à pouvoir nous intérresser à n'importe quel sujet grace à son sens des mots !
La base pour avoir une idée de l'évolution de la critique picturale au 18ème siècle, époque passionnante des salons.
Citations et extraits (21)
Voir plus
Ajouter une citation
Examen du clair-obscur.
Si une figure est dans l’ombre, elle est trop ou trop peu ombrée, si, la comparant aux figures plus éclairées, et la faisant par la pensée avancer à leur place, elle ne nous inspire pas un pressentiment vif et certain qu’elle le serait autant qu’elles. Exemple de deux personnes qui montent d’une cave, dont l’une porte une lumière, et que l’autre suit. Si celle-ci a la quantité de lumière ou d’ombre qui lui convient, vous sentirez qu’en la plaçant sur la même marche que celle-là, elle s’éclairera successivement, de manière que, parvenue sur cette marche, elles seront toutes deux également éclairées.
Moyen technique de s’assurer si les figures sont ombrées sur le tableau comme elles le seraient en nature. C’est de tracer sur un plan celui de son tableau ; d’y disposer des objets, soit à la même distance que ceux du tableau, soit à des distances relatives, et de comparer les lumières des objets du plan aux lumières des objets du tableau. Elles doivent être, de part et d’autre, ou les mêmes, ou dans les mêmes rapports. La scène d’un peintre peut être aussi étendue qu’il le désire ; cependant il ne lui est pas permis de placer partout des objets ; il est des lointains où les formes de ces objets n’étant plus sensibles, il est ridicule de les y jeter, puisqu’on ne met un objet sur la toile que pour le faire apercevoir et distinguer tel. Ainsi, quand la distance est telle qu’à cette distance les caractères qui individualisent les êtres ne se font plus distinguer, qu’on prendrait, par exemple, un loup pour un chien, ou un chien pour un loup, il ne faut plus en mettre. Voilà peut-être un cas où il ne faut plus peindre la nature.
Tous les possibles ne doivent point avoir lieu en bonne peinture ; car il y a tel concours d’événements dont on ne peut nier la possibilité, mais dont la combinaison est telle qu’on voit que peut-être ils n’ont jamais eu lieu, et ne l’auront peut-être jamais. Les possibles qu’on peut employer, ce sont les possibles vraisemblables, ce sont ceux où il y a plus à parier pour que contre, qu’ils ont passé de l’état de possibilité à l’état d’existence dans un certain temps limité par celui de l’action. Exemple : il se peut faire qu’une femme soit surprise par les douleurs de l’enfantement en pleine campagne ; il se peut faire qu’elle y trouve une crèche ; il est possible que cette crèche soit appuyée contre les ruines d’un ancien monument ; mais la rencontre possible de cet ancien monument est à sa rencontre réelle, comme l’espace entier où il peut y avoir des crèches est à la partie de cet espace qui est occupée par d’anciens monuments. Or ce rapport est infiniment petit ; il n’y faut donc avoir aucun égard ; et cette circonstance est absurde, à moins qu’elle ne soit donnée par l’histoire, ainsi que les autres circonstances de l’action. Il n’en est pas ainsi des bergers, des chiens, des hameaux, des troupeaux, des voyageurs, des arbres, des ruisseaux, des montagnes et de tous les autres objets qui sont dispersés dans les campagnes, et qui les constituent. Pourquoi peut-on les mettre dans la peinture dont il s’agit, et sur le champ du tableau ? Parce qu’ils se trouvent plus souvent dans la scène de la nature qu’on se propose d’imiter, qu’il n’arrive qu’ils ne s’y trouvent pas. La proximité ou la rencontre d’un ancien monument est aussi ridicule que le passage d’un empereur dans le moment de l’action. Ce passage est possible, mais d’un possible trop rare pour être employé ; celui d’un voyageur ordinaire l’est aussi, mais d’un possible si commun que l’emploi n’en a rien que de naturel. Il faut que le passage de l’empereur ou la présence de la colonne soit donné par l’histoire.
Deux sortes de peintures ; l’une qui, plaçant l’œil tout aussi près du tableau qu’il est possible, sans le priver de sa faculté de voir distinctement, rend les objets dans tous les détails qu’il aperçoit à cette distance, et rend ces détails avec autant de scrupule que les formes principales ; en sorte qu’à mesure que le spectateur s’éloigne du tableau, à mesure il perd de ses détails, jusqu’à ce qu’enfin il arrive à une distance où tout disparaisse, en sorte qu’en s’approchant de cette distance où tout est confondu, les formes commencent peu à peu à se faire discerner, et successivement les détails à se recouvrer, jusqu’à ce que l’œil replacé en son premier et moindre éloignement, il voit dans les objets du tableau les variétés les plus légères et les plus minutieuses. Voilà la belle peinture, voilà la véritable imitation de la nature. Je suis, par rapport à ce tableau, ce que je suis par rapport à la nature, que le peintre a prise pour modèle ; je la vois mieux à mesure que mon œil s’en approche ; je la vois moins bien à mesure que mon œil s’en éloigne. Mais il est une autre peinture qui n’est pas moins dans la nature, mais qui ne l’imite parfaitement qu’à une certaine distance ; elle n’est, pour ainsi parler, imitatrice que dans un point ; c’est celle où le peintre n’a rendu vivement et fortement que les détails qu’il a aperçus dans les objets du point qu’il a choisi ; au delà de ce point, on ne voit plus rien ; c’est pis encore en deçà. Son tableau n’est point un tableau ; depuis sa toile jusqu’à son point de vue on ne sait ce que c’est. Il ne faut pourtant pas blâmer ce genre de peinture ; c’est celui du fameux Rembrandt. Ce nom seul en fait suffisamment l’éloge.
D’où l’on voit que la loi de tout finir a quelque restriction : elle est d’observation absolue dans le premier genre de peinture dont j’ai parlé dans l’article précédent ; elle n’est pas de même nécessité dans le second genre. Le peintre y néglige tout ce qui ne s’aperçoit dans les objets que dans les points plus voisins du tableau que celui qu’il a pris pour son point de vue.
Exemple d’une idée sublime de Rembrandt : Rembrandt a peint une Résurrection du Lazare ; son Christ a l’air d’un tristo : il est à genoux sur le bord du sépulcre ; il prie, et l’on voit s’élever deux bras du fond du sépulcre.
Exemple d’une autre espèce : il n’y aurait rien de si ridicule qu’un homme peint en habit neuf au sortir de chez son tailleur, ce tailleur fût-il le plus habile homme de son temps. Mieux un habit collerait sur les membres, plus la figure serait la figure d’un homme de bois, outre ce que le peintre perdrait du côté de la variété des formes et des lumières qui naissent des plis et du chiffonnage des vieux habits. Il y a encore une raison qui agit en nous, sans que nous nous en apercevions ; c’est qu’un habit n’est neuf que pendant quelques jours, et qu’il est vieux pendant longtemps, et qu’il faut prendre les choses dans l’état qu’elles ont d’une manière la plus durable. D’ailleurs il y a dans un habit vieux une multitude infinie de petits accidents intéressants ; de la poudre, des boutons manquants, et tout ce qui tient de l’user. Tous ces accidents rendus réveillent autant d’idées et servent à lier les différentes parties de l’ajustement : il faut de la poudre pour lier la perruque à cet habit.
Si une figure est dans l’ombre, elle est trop ou trop peu ombrée, si, la comparant aux figures plus éclairées, et la faisant par la pensée avancer à leur place, elle ne nous inspire pas un pressentiment vif et certain qu’elle le serait autant qu’elles. Exemple de deux personnes qui montent d’une cave, dont l’une porte une lumière, et que l’autre suit. Si celle-ci a la quantité de lumière ou d’ombre qui lui convient, vous sentirez qu’en la plaçant sur la même marche que celle-là, elle s’éclairera successivement, de manière que, parvenue sur cette marche, elles seront toutes deux également éclairées.
Moyen technique de s’assurer si les figures sont ombrées sur le tableau comme elles le seraient en nature. C’est de tracer sur un plan celui de son tableau ; d’y disposer des objets, soit à la même distance que ceux du tableau, soit à des distances relatives, et de comparer les lumières des objets du plan aux lumières des objets du tableau. Elles doivent être, de part et d’autre, ou les mêmes, ou dans les mêmes rapports. La scène d’un peintre peut être aussi étendue qu’il le désire ; cependant il ne lui est pas permis de placer partout des objets ; il est des lointains où les formes de ces objets n’étant plus sensibles, il est ridicule de les y jeter, puisqu’on ne met un objet sur la toile que pour le faire apercevoir et distinguer tel. Ainsi, quand la distance est telle qu’à cette distance les caractères qui individualisent les êtres ne se font plus distinguer, qu’on prendrait, par exemple, un loup pour un chien, ou un chien pour un loup, il ne faut plus en mettre. Voilà peut-être un cas où il ne faut plus peindre la nature.
Tous les possibles ne doivent point avoir lieu en bonne peinture ; car il y a tel concours d’événements dont on ne peut nier la possibilité, mais dont la combinaison est telle qu’on voit que peut-être ils n’ont jamais eu lieu, et ne l’auront peut-être jamais. Les possibles qu’on peut employer, ce sont les possibles vraisemblables, ce sont ceux où il y a plus à parier pour que contre, qu’ils ont passé de l’état de possibilité à l’état d’existence dans un certain temps limité par celui de l’action. Exemple : il se peut faire qu’une femme soit surprise par les douleurs de l’enfantement en pleine campagne ; il se peut faire qu’elle y trouve une crèche ; il est possible que cette crèche soit appuyée contre les ruines d’un ancien monument ; mais la rencontre possible de cet ancien monument est à sa rencontre réelle, comme l’espace entier où il peut y avoir des crèches est à la partie de cet espace qui est occupée par d’anciens monuments. Or ce rapport est infiniment petit ; il n’y faut donc avoir aucun égard ; et cette circonstance est absurde, à moins qu’elle ne soit donnée par l’histoire, ainsi que les autres circonstances de l’action. Il n’en est pas ainsi des bergers, des chiens, des hameaux, des troupeaux, des voyageurs, des arbres, des ruisseaux, des montagnes et de tous les autres objets qui sont dispersés dans les campagnes, et qui les constituent. Pourquoi peut-on les mettre dans la peinture dont il s’agit, et sur le champ du tableau ? Parce qu’ils se trouvent plus souvent dans la scène de la nature qu’on se propose d’imiter, qu’il n’arrive qu’ils ne s’y trouvent pas. La proximité ou la rencontre d’un ancien monument est aussi ridicule que le passage d’un empereur dans le moment de l’action. Ce passage est possible, mais d’un possible trop rare pour être employé ; celui d’un voyageur ordinaire l’est aussi, mais d’un possible si commun que l’emploi n’en a rien que de naturel. Il faut que le passage de l’empereur ou la présence de la colonne soit donné par l’histoire.
Deux sortes de peintures ; l’une qui, plaçant l’œil tout aussi près du tableau qu’il est possible, sans le priver de sa faculté de voir distinctement, rend les objets dans tous les détails qu’il aperçoit à cette distance, et rend ces détails avec autant de scrupule que les formes principales ; en sorte qu’à mesure que le spectateur s’éloigne du tableau, à mesure il perd de ses détails, jusqu’à ce qu’enfin il arrive à une distance où tout disparaisse, en sorte qu’en s’approchant de cette distance où tout est confondu, les formes commencent peu à peu à se faire discerner, et successivement les détails à se recouvrer, jusqu’à ce que l’œil replacé en son premier et moindre éloignement, il voit dans les objets du tableau les variétés les plus légères et les plus minutieuses. Voilà la belle peinture, voilà la véritable imitation de la nature. Je suis, par rapport à ce tableau, ce que je suis par rapport à la nature, que le peintre a prise pour modèle ; je la vois mieux à mesure que mon œil s’en approche ; je la vois moins bien à mesure que mon œil s’en éloigne. Mais il est une autre peinture qui n’est pas moins dans la nature, mais qui ne l’imite parfaitement qu’à une certaine distance ; elle n’est, pour ainsi parler, imitatrice que dans un point ; c’est celle où le peintre n’a rendu vivement et fortement que les détails qu’il a aperçus dans les objets du point qu’il a choisi ; au delà de ce point, on ne voit plus rien ; c’est pis encore en deçà. Son tableau n’est point un tableau ; depuis sa toile jusqu’à son point de vue on ne sait ce que c’est. Il ne faut pourtant pas blâmer ce genre de peinture ; c’est celui du fameux Rembrandt. Ce nom seul en fait suffisamment l’éloge.
D’où l’on voit que la loi de tout finir a quelque restriction : elle est d’observation absolue dans le premier genre de peinture dont j’ai parlé dans l’article précédent ; elle n’est pas de même nécessité dans le second genre. Le peintre y néglige tout ce qui ne s’aperçoit dans les objets que dans les points plus voisins du tableau que celui qu’il a pris pour son point de vue.
Exemple d’une idée sublime de Rembrandt : Rembrandt a peint une Résurrection du Lazare ; son Christ a l’air d’un tristo : il est à genoux sur le bord du sépulcre ; il prie, et l’on voit s’élever deux bras du fond du sépulcre.
Exemple d’une autre espèce : il n’y aurait rien de si ridicule qu’un homme peint en habit neuf au sortir de chez son tailleur, ce tailleur fût-il le plus habile homme de son temps. Mieux un habit collerait sur les membres, plus la figure serait la figure d’un homme de bois, outre ce que le peintre perdrait du côté de la variété des formes et des lumières qui naissent des plis et du chiffonnage des vieux habits. Il y a encore une raison qui agit en nous, sans que nous nous en apercevions ; c’est qu’un habit n’est neuf que pendant quelques jours, et qu’il est vieux pendant longtemps, et qu’il faut prendre les choses dans l’état qu’elles ont d’une manière la plus durable. D’ailleurs il y a dans un habit vieux une multitude infinie de petits accidents intéressants ; de la poudre, des boutons manquants, et tout ce qui tient de l’user. Tous ces accidents rendus réveillent autant d’idées et servent à lier les différentes parties de l’ajustement : il faut de la poudre pour lier la perruque à cet habit.
C’est celui-ci qui est un peintre ; c’est celui-ci qui est un coloriste.
Il y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin ; ils représentent presque tous des fruits avec les accessoires d’un repas. C’est la nature même ; les objets sont hors de la toile et d’une vérité à tromper les yeux.
Celui qu’on voit en montant l’escalier mérite surtout l’attention. L’artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté.
Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j’aie besoin de me faire des yeux ; pour voir ceux de Chardin, je n’ai qu’à garder ceux que la nature m’a donnés et m’en bien servir.
Si je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j’achèterais. « Copie-moi cela, lui dirais-je, copie-moi cela encore. » Mais peut-être la nature n’est-elle pas plus difficile à copier.
C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives sont réellement séparées de l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent ; c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade l’ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau.
C’est celui-ci qui entend l’harmonie des couleurs et des reflets. Ô Chardin ! ce n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile [8].
Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l’occuperais sur la Raie dépouillée du même maître. L’objet est dégoûtant, mais c’est la chair même du poisson, c’est sa peau, c’est son sang ; l’aspect même de la chose n’affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous irez à l’Académie, et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures.
On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes sur les autres et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur qu’on a soufflée sur la toile ; ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze, Loutherbourg vous expliqueraient ce faire bien mieux que moi ; tous en feront sentir l’effet à vos yeux. Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit.
On m’a dit que Greuze montant au Salon et apercevant le morceau de Chardin que je viens de décrire, le regarda et passa en poussant un profond soupir. Cet éloge est plus court et vaut mieux que le mien.
Qui est-ce qui payera les tableaux de Chardin, quand cet homme rare ne sera plus ? Il faut que vous sachiez encore que cet artiste a le sens droit et parle à merveille de son art.
Ah ! mon ami, crachez sur le rideau d’Apelle et sur les raisins de Zeuxis. On trompe sans peine un artiste impatient et les animaux sont mauvais juges en peinture. N’avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du Roi aller se casser la tête contre la plus mauvaise des perspectives ? Mais c’est vous, c’est moi que Chardin trompera quand il voudra.
1763
Il y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin ; ils représentent presque tous des fruits avec les accessoires d’un repas. C’est la nature même ; les objets sont hors de la toile et d’une vérité à tromper les yeux.
Celui qu’on voit en montant l’escalier mérite surtout l’attention. L’artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté.
Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j’aie besoin de me faire des yeux ; pour voir ceux de Chardin, je n’ai qu’à garder ceux que la nature m’a donnés et m’en bien servir.
Si je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j’achèterais. « Copie-moi cela, lui dirais-je, copie-moi cela encore. » Mais peut-être la nature n’est-elle pas plus difficile à copier.
C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives sont réellement séparées de l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent ; c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade l’ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau.
C’est celui-ci qui entend l’harmonie des couleurs et des reflets. Ô Chardin ! ce n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile [8].
Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l’occuperais sur la Raie dépouillée du même maître. L’objet est dégoûtant, mais c’est la chair même du poisson, c’est sa peau, c’est son sang ; l’aspect même de la chose n’affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous irez à l’Académie, et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures.
On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes sur les autres et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur qu’on a soufflée sur la toile ; ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze, Loutherbourg vous expliqueraient ce faire bien mieux que moi ; tous en feront sentir l’effet à vos yeux. Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit.
On m’a dit que Greuze montant au Salon et apercevant le morceau de Chardin que je viens de décrire, le regarda et passa en poussant un profond soupir. Cet éloge est plus court et vaut mieux que le mien.
Qui est-ce qui payera les tableaux de Chardin, quand cet homme rare ne sera plus ? Il faut que vous sachiez encore que cet artiste a le sens droit et parle à merveille de son art.
Ah ! mon ami, crachez sur le rideau d’Apelle et sur les raisins de Zeuxis. On trompe sans peine un artiste impatient et les animaux sont mauvais juges en peinture. N’avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du Roi aller se casser la tête contre la plus mauvaise des perspectives ? Mais c’est vous, c’est moi que Chardin trompera quand il voudra.
1763
Un jeune homme fut consulté par sa famille sur la manière dont il voulait qu’on fît peindre son père. C’était un ouvrier en fer : « Mettez-lui, dit-il, son habit de travail, son bonnet de forge, son tablier ; que je le voie à son établi avec une lancette ou autre ouvrage à la main ; qu’il éprouve ou qu’il repasse, et surtout n’oubliez pas de lui faire mettre ses lunettes sur le nez. » Ce projet ne fut point suivi ; on lui envoya un beau portrait de son père, en pied, avec une belle perruque, un bel habit, de beaux bas, une belle tabatière à la main ; le jeune homme, qui avait du goût et de la vérité dans le caractère, dit à sa famille en la remerciant : « Vous n’avez rien fait qui vaille, ni vous, ni le peintre ; je vous avais demandé mon père de tous les jours, et vous ne m’avez envoyé que mon père des dimanches…[5] » C’est par la même raison que M. de La Tour, si vrai, si sublime d’ailleurs, n’a fait, du portrait de M. Rousseau, qu’une belle chose, au lieu d’un chef-d’œuvre qu’il en pouvait faire. J’y cherche le censeur des lettres, le Caton et le Brutus de notre âge ; je m’attendais à voir Épictète en habit négligé, en perruque ébouriffée, effrayant, par son air sévère, les littérateurs, les grands et les gens du monde ; et je n’y vois que l’auteur du Devin du village, bien habillé, bien peigné, bien poudré, et ridiculement assis sur une chaise de paille ; et il faut convenir que le vers de M. de Marmontel dit très-bien ce qu’est M. Rousseau, et ce qu’on devrait trouver, et ce qu’on cherche en vain dans le tableau de M. de La Tour [6]. On a exposé cette année dans le Salon un tableau de la Mort de Socrate, qui a tout le ridicule qu’une composition de cette espèce pouvait avoir. On y fait mourir sur un lit de parade le philosophe le plus austère et le plus pauvre de la Grèce. Le peintre n’a pas conçu combien la vertu et l’innocence, près d’expirer au fond d’un cachot, sur un lit de paille, sur un grabat, ferait une représentation pathétique et sublime.
L’étude de l’écorché a sans doute ses avantages ; mais n’est-il pas à craindre que cet écorché ne reste perpétuellement dans l’imagination ; que l’artiste n’en devienne entêté de la vanité de se montrer savant ; que son œil corrompu ne puisse plus s’arrêter à la superficie ; qu’en dépit de la peau et des graisses, il n’entrevoie toujours le muscle, son origine, son attache et son insertion ; qu’il ne prononce tout trop fortement ; qu’il ne soit dur et sec ; et que je ne retrouve ce maudit écorché, même dans ses figures de femmes ? Puisque je n’ai que l’extérieur à montrer, j’aimerais bien autant qu’on m’accoutumât à le bien voir, et qu’on me dispensât d’une connaissance perfide, qu’il faut que j’oublie.
On n’étudie l’écorché, dit-on, que pour apprendre à regarder la nature ; mais il est d’expérience qu’après cette étude, on a beaucoup de peine à ne pas la voir autrement qu’elle est. Personne que vous, mon ami, ne lira ces papiers ; ainsi je puis écrire tout ce qu’il me plaît. Et ces sept ans passés à l’Académie à dessiner d’après le modèle, les croyez-vous bien employés ; et voulez-vous savoir ce que j’en pense ? C’est que c’est là, et pendant ces sept pénibles et cruelles années, qu’on prend la manière dans le dessin. Toutes ces positions académiques, contraintes, apprêtées, arrangées ; toutes ces actions froidement et gauchement exprimées par un pauvre diable, et toujours par le même pauvre diable, gagé pour venir trois fois la semaine se déshabiller et se faire mannequiner par un professeur, qu’ont-elles de commun avec les positions et les actions de la nature ? Qu’ont de commun l’homme qui tire de l’eau dans le puits de votre cour, et celui qui, n’ayant pas le même fardeau à tirer, simule gauchement cette action, avec ses deux bras en haut, sur l’estrade de l’école ? Qu’a de commun celui qui fait semblant de se mourir là, avec celui qui expire dans son lit, ou qu’on assomme dans la rue ? Qu’a de commun ce lutteur d’école avec celui de mon carrefour ? Cet homme qui implore, qui prie, qui dort, qui réfléchit, qui s’évanouit à discrétion, qu’a-t-il de commun avec le paysan étendu de fatigue sur la terre, avec le philosophe qui médite au coin de son feu, avec l’homme étouffé qui s’évanouit dans la foule ? Rien, mon ami, rien.
J’aimerais autant qu’au sortir de là, pour compléter l’absurdité, on envoyât les élèves apprendre la grâce chez Marcel ou Dupré [2] ou tel autre maître à danser qu’on voudra. Cependant, la vérité de nature s’oublie ; l’imagination se remplit d’actions, de positions et des figures fausses, apprêtées, ridicules et froides. Elles y sont emmagasinées ; et elles en sortiront pour s’attacher sur la toile. Toutes les fois que l’artiste prendra ses crayons ou son pinceau, ces maussades fantômes se réveilleront, se présenteront à lui ; il ne pourra s’en distraire ; et ce sera un prodige s’il réussit à les exorciser pour les chasser de sa tête. J’ai connu un jeune homme plein de goût, qui, avant de jeter le moindre trait sur sa toile, se mettait à genoux, et disait : « Mon Dieu, délivrez-moi du modèle. » S’il est si rare aujourd’hui de voir un tableau composé d’un certain nombre de figures, sans y retrouver, par-ci par-là, quelques-unes de ces figures, positions, actions, attitudes académiques, qui déplaisent à la mort à un homme de goût, et qui ne peuvent en imposer qu’à ceux à qui la vérité est étrangère, accusez-en l’éternelle étude du modèle de l’école.
Ce n’est pas dans l’école qu’on apprend la conspiration générale des mouvements ; conspiration qui se sent, qui se voit, qui s’étend et serpente de la tête aux pieds. Qu’une femme laisse tomber sa tête en devant [3] tous ses membres obéissent à ce poids ; qu’elle la relève et la tienne droite, même obéissance du reste de la machine.
Oui, vraiment, c’est un art, et un grand art que de poser le modèle ; il faut voir comme M. le professeur en est fier. Et ne craignez pas qu’il s’avise de dire au pauvre diable gagé : « Mon ami, pose-toi toi-même, fais ce que tu voudras. » Il aime bien mieux lui donner quelque attitude singulière, que de lui en laisser prendre une simple et naturelle : cependant il faut en passer par là.
Cent fois j’ai été tenté de dire aux jeunes élèves que je trouvais sur le chemin du Louvre, avec leur portefeuille sous le bras : « Mes amis, combien y a-t-il que vous dessinez là ? Deux ans. Eh bien ! c’est plus qu’il ne faut. Laissez-moi cette boutique de manière. Allez-vous-en aux Chartreux ; et vous y verrez la véritable attitude de la piété et de la componction. C’est aujourd’hui veille de grande fête : allez à la paroisse, rôdez autour des confessionnaux, et vous y verrez la véritable attitude du recueillement et du repentir. Demain, allez à la guinguette, et vous verrez l’action vraie de l’homme en colère. Cherchez les scènes publiques ; soyez observateurs dans les rues, dans les jardins, dans les marchés, dans les maisons, et vous y prendrez des idées justes du vrai mouvement dans les actions de la vie. Tenez, regardez vos deux camarades qui disputent ; voyez comme c’est la dispute même qui dispose à leur insu de la position de leurs membres. Examinez-les bien, et vous aurez pitié de la leçon de votre insipide professeur et de l’imitation de votre insipide modèle. Que je vous plains, mes amis, s’il faut qu’un jour vous mettiez à la place de toutes les faussetés que vous avez apprises, la simplicité et la vérité de Le Sueur ! Et il le faudra bien, si vous voulez être quelque chose.
« Autre chose est une attitude, autre chose une action. Toute attitude est fausse et petite ; toute action est belle et vraie.
« Le contraste mal entendu est une des plus funestes causes du maniéré. Il n’y a de véritable contraste que celui qui naît du fond de l’action, ou de la diversité, soit des organes, soit de l’intérêt. Voyez Raphaël, Le Sueur ; ils placent quelquefois trois, quatre, cinq figures debout les unes à côté des autres, et l’effet en est sublime. À la messe ou à vêpres aux Chartreux, on voit sur deux longues files parallèles, quarante à cinquante moines, mêmes stalles, même fonction, même vêtement, et cependant pas deux de ces moines qui se ressemblent ; ne cherchez pas d’autre contraste que celui qui les distingue [4]. Voilà le vrai : tout autre est mesquin et faux. »
On n’étudie l’écorché, dit-on, que pour apprendre à regarder la nature ; mais il est d’expérience qu’après cette étude, on a beaucoup de peine à ne pas la voir autrement qu’elle est. Personne que vous, mon ami, ne lira ces papiers ; ainsi je puis écrire tout ce qu’il me plaît. Et ces sept ans passés à l’Académie à dessiner d’après le modèle, les croyez-vous bien employés ; et voulez-vous savoir ce que j’en pense ? C’est que c’est là, et pendant ces sept pénibles et cruelles années, qu’on prend la manière dans le dessin. Toutes ces positions académiques, contraintes, apprêtées, arrangées ; toutes ces actions froidement et gauchement exprimées par un pauvre diable, et toujours par le même pauvre diable, gagé pour venir trois fois la semaine se déshabiller et se faire mannequiner par un professeur, qu’ont-elles de commun avec les positions et les actions de la nature ? Qu’ont de commun l’homme qui tire de l’eau dans le puits de votre cour, et celui qui, n’ayant pas le même fardeau à tirer, simule gauchement cette action, avec ses deux bras en haut, sur l’estrade de l’école ? Qu’a de commun celui qui fait semblant de se mourir là, avec celui qui expire dans son lit, ou qu’on assomme dans la rue ? Qu’a de commun ce lutteur d’école avec celui de mon carrefour ? Cet homme qui implore, qui prie, qui dort, qui réfléchit, qui s’évanouit à discrétion, qu’a-t-il de commun avec le paysan étendu de fatigue sur la terre, avec le philosophe qui médite au coin de son feu, avec l’homme étouffé qui s’évanouit dans la foule ? Rien, mon ami, rien.
J’aimerais autant qu’au sortir de là, pour compléter l’absurdité, on envoyât les élèves apprendre la grâce chez Marcel ou Dupré [2] ou tel autre maître à danser qu’on voudra. Cependant, la vérité de nature s’oublie ; l’imagination se remplit d’actions, de positions et des figures fausses, apprêtées, ridicules et froides. Elles y sont emmagasinées ; et elles en sortiront pour s’attacher sur la toile. Toutes les fois que l’artiste prendra ses crayons ou son pinceau, ces maussades fantômes se réveilleront, se présenteront à lui ; il ne pourra s’en distraire ; et ce sera un prodige s’il réussit à les exorciser pour les chasser de sa tête. J’ai connu un jeune homme plein de goût, qui, avant de jeter le moindre trait sur sa toile, se mettait à genoux, et disait : « Mon Dieu, délivrez-moi du modèle. » S’il est si rare aujourd’hui de voir un tableau composé d’un certain nombre de figures, sans y retrouver, par-ci par-là, quelques-unes de ces figures, positions, actions, attitudes académiques, qui déplaisent à la mort à un homme de goût, et qui ne peuvent en imposer qu’à ceux à qui la vérité est étrangère, accusez-en l’éternelle étude du modèle de l’école.
Ce n’est pas dans l’école qu’on apprend la conspiration générale des mouvements ; conspiration qui se sent, qui se voit, qui s’étend et serpente de la tête aux pieds. Qu’une femme laisse tomber sa tête en devant [3] tous ses membres obéissent à ce poids ; qu’elle la relève et la tienne droite, même obéissance du reste de la machine.
Oui, vraiment, c’est un art, et un grand art que de poser le modèle ; il faut voir comme M. le professeur en est fier. Et ne craignez pas qu’il s’avise de dire au pauvre diable gagé : « Mon ami, pose-toi toi-même, fais ce que tu voudras. » Il aime bien mieux lui donner quelque attitude singulière, que de lui en laisser prendre une simple et naturelle : cependant il faut en passer par là.
Cent fois j’ai été tenté de dire aux jeunes élèves que je trouvais sur le chemin du Louvre, avec leur portefeuille sous le bras : « Mes amis, combien y a-t-il que vous dessinez là ? Deux ans. Eh bien ! c’est plus qu’il ne faut. Laissez-moi cette boutique de manière. Allez-vous-en aux Chartreux ; et vous y verrez la véritable attitude de la piété et de la componction. C’est aujourd’hui veille de grande fête : allez à la paroisse, rôdez autour des confessionnaux, et vous y verrez la véritable attitude du recueillement et du repentir. Demain, allez à la guinguette, et vous verrez l’action vraie de l’homme en colère. Cherchez les scènes publiques ; soyez observateurs dans les rues, dans les jardins, dans les marchés, dans les maisons, et vous y prendrez des idées justes du vrai mouvement dans les actions de la vie. Tenez, regardez vos deux camarades qui disputent ; voyez comme c’est la dispute même qui dispose à leur insu de la position de leurs membres. Examinez-les bien, et vous aurez pitié de la leçon de votre insipide professeur et de l’imitation de votre insipide modèle. Que je vous plains, mes amis, s’il faut qu’un jour vous mettiez à la place de toutes les faussetés que vous avez apprises, la simplicité et la vérité de Le Sueur ! Et il le faudra bien, si vous voulez être quelque chose.
« Autre chose est une attitude, autre chose une action. Toute attitude est fausse et petite ; toute action est belle et vraie.
« Le contraste mal entendu est une des plus funestes causes du maniéré. Il n’y a de véritable contraste que celui qui naît du fond de l’action, ou de la diversité, soit des organes, soit de l’intérêt. Voyez Raphaël, Le Sueur ; ils placent quelquefois trois, quatre, cinq figures debout les unes à côté des autres, et l’effet en est sublime. À la messe ou à vêpres aux Chartreux, on voit sur deux longues files parallèles, quarante à cinquante moines, mêmes stalles, même fonction, même vêtement, et cependant pas deux de ces moines qui se ressemblent ; ne cherchez pas d’autre contraste que celui qui les distingue [4]. Voilà le vrai : tout autre est mesquin et faux. »
Tout ce que j’ai compris de ma vie du clair-obscur.
Le clair-obscur est la juste distribution des ombres et de la lumière. Problème simple et facile, lorsqu’il n’y a qu’un objet régulier ou qu’un point lumineux ; mais problème dont la difficulté s’accroît à mesure que les formes de l’objet sont variées ; à mesure que la scène s’étend, que les êtres s’y multiplient, que la lumière y arrive de plusieurs endroits, et que les lumières sont diverses. Ah ! mon ami, combien d’ombres et de lumières fausses dans une composition un peu compliquée ! combien de licences prises ! en combien d’endroits la vérité sacrifiée à l’effet !
On appelle un effet de lumière, en peinture, ce que vous avez vu dans le tableau de Corésus [1] un mélange des ombres et de la lumière, vrai, fort et piquant : moment poétique, qui vous arrête et vous étonne. Chose difficile, sans doute, mais moins peut-être qu’une distribution graduée, qui éclairerait la scène d’une manière diffuse et large, et où la quantité de lumière serait accordée à chaque point de la toile, eu égard à sa véritable exposition et à sa véritable distance du corps lumineux : quantité que les objets environnants font varier en cent manières diverses, plus ou moins sensibles, selon les pertes et les emprunts qu’ils occasionnent.
Rien de plus rare que l’unité de lumière dans une composition, surtout chez les paysagistes. Ici, c’est du soleil ; là, de la lune ; ailleurs, une lampe, un flambeau, ou quelque autre corps enflammé. Vice commun, mais difficile à discerner. Il y a aussi des caricatures d’ombres et de lumières, et toute caricature est de mauvais goût.
Si, dans un tableau, la vérité des lumières se joint à celle de la couleur, tout est pardonné, du moins dans le premier instant. Incorrections de dessin, manque d’expression, pauvreté de caractères, vices d’ordonnance, on oublie tout ; on demeure extasié, surpris, enchaîné, enchanté.
S’il nous arrive de nous promener aux Tuileries, au bois de Houlogne, ou dans quelque endroit écarté des Champs-Élysées, sous quelques-uns de ces vieux arbres épargnés parmi tant d’autres qu’on a sacrifiés au parterre et à la vue de l’hôtel de Pompadour [2] sur la fin d’un beau jour, au moment où le soleil plonge ses rayons obliques à travers la masse touffue de ces arbres, dont les branches entremêlées les arrêtent, les renvoient, les brisent, les rompent, les dispersent sur les troncs, sur la terre, entre les feuilles, et produisent autour de nous une variété infinie d’ombres fortes, d’ombres moins fortes, de parties obscures, moins obscures, éclairées, plus éclairées, tout à fait éclatantes : alors les passages de l’obscurité à l’ombre, de l’ombre à la lumière, de la lumière au grand éclat, sont si doux, si touchants, si merveilleux, que l’aspect d’une branche, d’une feuille, arrête l’œil et suspend la conversation au moment même le plus intéressant. Nos pas s’arrêtent involontairement ; nos regards se promènent sur la toile magique, et nous nous écrions : « Quel tableau ! Oh ! que cela est beau ! ». Il semble que nous considérions la nature comme le résultat de l’art ; et, réciproquement, s’il arrive que le peintre nous répète le même enchantement sur la toile, il semble que nous regardions l’effet de l’art comme celui de la nature. Ce n’est pas au Salon, c’est dans le fond d’une forêt, parmi les montagnes que le soleil ombre et éclaire, que Loutherbourg et Vernet sont grands.
Le ciel répand une teinte générale sur les objets. La vapeur de l’atmosphère se discerne au loin ; près de nous son effet est moins sensible ; autour de moi les objets gardent toute la force et toute la variété de leurs couleurs ; ils se ressentent moins de la teinte de l’atmosphère et du ciel ; au loin, ils s’effacent, ils s’éteignent ; toutes leurs couleurs se confondent ; et la distance qui produit cette confusion, cette monotonie, les montre tout gris, grisâtres, d’un blanc mat ou plus ou moins éclairé, selon le lieu de la lumière et l’effet du soleil ; c’est le même effet que celui de la vitesse avec laquelle on tourne un globe tacheté de différentes couleurs, lorsque cette vitesse est assez grande pour lier les taches et réduire leurs sensations particulières de rouge, de blanc, de noir, de bleu, de vert, à une sensation unique et simultanée.
Que celui qui n’a pas étudié et senti les effets de la lumière et de l’ombre dans les campagnes, au fond des forêts, sur les maisons des hameaux, sur les toits des villes, le jour, la nuit, laisse là les pinceaux ; surtout qu’il ne s’avise pas d’être paysagiste. Ce n’est pas dans la nature seulement, c’est sur les arbres, c’est sur les eaux de Vernet, c’est sur les collines de Loutherbourg, que le clair de la lune est beau.
Un site peut sans doute être délicieux. Il est sûr que de hautes montagnes, que d’antiques forêts, que des ruines immenses en imposent. Les idées accessoires qu’elles réveillent sont grandes. J’en ferai descendre, quand il me plaira. Moïse ou Numa. La vue d’un torrent, qui tombe à grand bruit à travers des rochers escarpés qu’il blanchit de son écume, me fera frissonner. Si je ne le vois pas, et que j’entende au loin son fracas, « C’est ainsi, me dirai-je, que ces fléaux si fameux dans l’histoire ont passé : le monde reste, et tous leurs exploits ne sont plus qu’un vain bruit perdu qui m’amuse. » Si je vois une verte prairie, de l’herbe tendre et molle, un ruisseau qui l’arrose, un coin de forêt écarté qui me promette du silence, de la fraîcheur et du secret, mon âme s’attendrira ; je me rappellerai celle que j’aime : « Où est-elle ? m’écrierai-je ; pourquoi suis-je seul ici ? » Mais ce sera la distribution variée des ombres et des lumières qui ôtera ou donnera à toute la scène son charme général. Qu’il s’élève une vapeur qui attriste le ciel, et qui répande sur l’espace un ton grisâtre et monotone, tout devient muet, rien ne m’inspire, rien ne m’arrête ; et je ramène mes pas vers ma demeure.
Le clair-obscur est la juste distribution des ombres et de la lumière. Problème simple et facile, lorsqu’il n’y a qu’un objet régulier ou qu’un point lumineux ; mais problème dont la difficulté s’accroît à mesure que les formes de l’objet sont variées ; à mesure que la scène s’étend, que les êtres s’y multiplient, que la lumière y arrive de plusieurs endroits, et que les lumières sont diverses. Ah ! mon ami, combien d’ombres et de lumières fausses dans une composition un peu compliquée ! combien de licences prises ! en combien d’endroits la vérité sacrifiée à l’effet !
On appelle un effet de lumière, en peinture, ce que vous avez vu dans le tableau de Corésus [1] un mélange des ombres et de la lumière, vrai, fort et piquant : moment poétique, qui vous arrête et vous étonne. Chose difficile, sans doute, mais moins peut-être qu’une distribution graduée, qui éclairerait la scène d’une manière diffuse et large, et où la quantité de lumière serait accordée à chaque point de la toile, eu égard à sa véritable exposition et à sa véritable distance du corps lumineux : quantité que les objets environnants font varier en cent manières diverses, plus ou moins sensibles, selon les pertes et les emprunts qu’ils occasionnent.
Rien de plus rare que l’unité de lumière dans une composition, surtout chez les paysagistes. Ici, c’est du soleil ; là, de la lune ; ailleurs, une lampe, un flambeau, ou quelque autre corps enflammé. Vice commun, mais difficile à discerner. Il y a aussi des caricatures d’ombres et de lumières, et toute caricature est de mauvais goût.
Si, dans un tableau, la vérité des lumières se joint à celle de la couleur, tout est pardonné, du moins dans le premier instant. Incorrections de dessin, manque d’expression, pauvreté de caractères, vices d’ordonnance, on oublie tout ; on demeure extasié, surpris, enchaîné, enchanté.
S’il nous arrive de nous promener aux Tuileries, au bois de Houlogne, ou dans quelque endroit écarté des Champs-Élysées, sous quelques-uns de ces vieux arbres épargnés parmi tant d’autres qu’on a sacrifiés au parterre et à la vue de l’hôtel de Pompadour [2] sur la fin d’un beau jour, au moment où le soleil plonge ses rayons obliques à travers la masse touffue de ces arbres, dont les branches entremêlées les arrêtent, les renvoient, les brisent, les rompent, les dispersent sur les troncs, sur la terre, entre les feuilles, et produisent autour de nous une variété infinie d’ombres fortes, d’ombres moins fortes, de parties obscures, moins obscures, éclairées, plus éclairées, tout à fait éclatantes : alors les passages de l’obscurité à l’ombre, de l’ombre à la lumière, de la lumière au grand éclat, sont si doux, si touchants, si merveilleux, que l’aspect d’une branche, d’une feuille, arrête l’œil et suspend la conversation au moment même le plus intéressant. Nos pas s’arrêtent involontairement ; nos regards se promènent sur la toile magique, et nous nous écrions : « Quel tableau ! Oh ! que cela est beau ! ». Il semble que nous considérions la nature comme le résultat de l’art ; et, réciproquement, s’il arrive que le peintre nous répète le même enchantement sur la toile, il semble que nous regardions l’effet de l’art comme celui de la nature. Ce n’est pas au Salon, c’est dans le fond d’une forêt, parmi les montagnes que le soleil ombre et éclaire, que Loutherbourg et Vernet sont grands.
Le ciel répand une teinte générale sur les objets. La vapeur de l’atmosphère se discerne au loin ; près de nous son effet est moins sensible ; autour de moi les objets gardent toute la force et toute la variété de leurs couleurs ; ils se ressentent moins de la teinte de l’atmosphère et du ciel ; au loin, ils s’effacent, ils s’éteignent ; toutes leurs couleurs se confondent ; et la distance qui produit cette confusion, cette monotonie, les montre tout gris, grisâtres, d’un blanc mat ou plus ou moins éclairé, selon le lieu de la lumière et l’effet du soleil ; c’est le même effet que celui de la vitesse avec laquelle on tourne un globe tacheté de différentes couleurs, lorsque cette vitesse est assez grande pour lier les taches et réduire leurs sensations particulières de rouge, de blanc, de noir, de bleu, de vert, à une sensation unique et simultanée.
Que celui qui n’a pas étudié et senti les effets de la lumière et de l’ombre dans les campagnes, au fond des forêts, sur les maisons des hameaux, sur les toits des villes, le jour, la nuit, laisse là les pinceaux ; surtout qu’il ne s’avise pas d’être paysagiste. Ce n’est pas dans la nature seulement, c’est sur les arbres, c’est sur les eaux de Vernet, c’est sur les collines de Loutherbourg, que le clair de la lune est beau.
Un site peut sans doute être délicieux. Il est sûr que de hautes montagnes, que d’antiques forêts, que des ruines immenses en imposent. Les idées accessoires qu’elles réveillent sont grandes. J’en ferai descendre, quand il me plaira. Moïse ou Numa. La vue d’un torrent, qui tombe à grand bruit à travers des rochers escarpés qu’il blanchit de son écume, me fera frissonner. Si je ne le vois pas, et que j’entende au loin son fracas, « C’est ainsi, me dirai-je, que ces fléaux si fameux dans l’histoire ont passé : le monde reste, et tous leurs exploits ne sont plus qu’un vain bruit perdu qui m’amuse. » Si je vois une verte prairie, de l’herbe tendre et molle, un ruisseau qui l’arrose, un coin de forêt écarté qui me promette du silence, de la fraîcheur et du secret, mon âme s’attendrira ; je me rappellerai celle que j’aime : « Où est-elle ? m’écrierai-je ; pourquoi suis-je seul ici ? » Mais ce sera la distribution variée des ombres et des lumières qui ôtera ou donnera à toute la scène son charme général. Qu’il s’élève une vapeur qui attriste le ciel, et qui répande sur l’espace un ton grisâtre et monotone, tout devient muet, rien ne m’inspire, rien ne m’arrête ; et je ramène mes pas vers ma demeure.
Videos de Denis Diderot (35)
Voir plusAjouter une vidéo
Rencontre avec Christian Grataloup autour de Géohistoire. Une autre histoire des humains sur la Terre paru aux éditions des Arènes, et de L'Atlas historique de la terre (Les Arènes).
Christian Grataloup, né en 1951 à Lyon, agrégé et docteur en géographie, successivement enseignant du secondaire, professeur de classes prépas, formateur d'instituteurs puis de PEGC, maître de conférences à l'université de Reims et finalement professeur à l'université Paris Diderot. Les recherches et les publications de Christian Grataloup se sont toujours situées à la charnière de la géographie et de l'histoire. Une grande partie de ses travaux concernent la didactique, en particulier par la mise au point de «jeux» pédagogiques. Il a notamment publié: Atlas historique de la France (Les Arènes, 2020), L'invention des continents et des océans. Comment l'Europe a découpé le Monde (Larousse, 2020), Cabinet de curiosité de l'histoire du Monde (Armand Colin, 2020), Atlas historique mondial (Les Arènes, 2019), Vision(s) du Monde (Armand Colin, 2018), le Monde dans nos tasses. Trois siècles de petit-déjeuner (Armand Colin, 2017), Introduction à la géohistoire (Armand Colin, 2015).
--
20/03/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite (https://ausha.co/politique-de-confidentialite) pour plus d'informations.
Christian Grataloup, né en 1951 à Lyon, agrégé et docteur en géographie, successivement enseignant du secondaire, professeur de classes prépas, formateur d'instituteurs puis de PEGC, maître de conférences à l'université de Reims et finalement professeur à l'université Paris Diderot. Les recherches et les publications de Christian Grataloup se sont toujours situées à la charnière de la géographie et de l'histoire. Une grande partie de ses travaux concernent la didactique, en particulier par la mise au point de «jeux» pédagogiques. Il a notamment publié: Atlas historique de la France (Les Arènes, 2020), L'invention des continents et des océans. Comment l'Europe a découpé le Monde (Larousse, 2020), Cabinet de curiosité de l'histoire du Monde (Armand Colin, 2020), Atlas historique mondial (Les Arènes, 2019), Vision(s) du Monde (Armand Colin, 2018), le Monde dans nos tasses. Trois siècles de petit-déjeuner (Armand Colin, 2017), Introduction à la géohistoire (Armand Colin, 2015).
--
20/03/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite (https://ausha.co/politique-de-confidentialite) pour plus d'informations.
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Art françaisVoir plus
>Histoire et géographie des beaux-arts et des arts décoratifs>Art français>Art français (39)
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Denis Diderot (151)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1084 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1084 lecteurs ont répondu