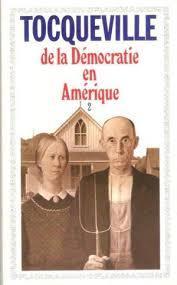Alexis de TocquevilleDe la Démocratie en Amérique tome 2 sur 2
/5 116 notes
/5 116 notes
Résumé :
Théoricien du libéralisme, Tocqueville montre dans De la démocratie en Amérique comment la démocratie s'est accompagnée des progrès de l'individualisme. Cependant, les droits individuels une fois proclamés et reconnus, ce goût pour la liberté s'est corrompu en passion pour l'égalité, favorisant la diffusion d'un esprit majoritaire et conformiste.
En effet, à force de réclamer les mêmes droits pour tous, les individus se contentent de revendiquer une ... >Voir plus
En effet, à force de réclamer les mêmes droits pour tous, les individus se contentent de revendiquer une ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après De la démocratie en Amérique, tome 2Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (9)
Voir plus
Ajouter une critique
Lorsqu'un homme a acquis un statut et une réputation, quand il a pris un peu d'âge au sein d'une carrière couronnée de succès, quand il se sent baigné dans une atmosphère de respect où ses sectateurs et confrères le placent, il devient prudent plutôt par affectation de sagesse que par sagacité véritable, parce qu'il redoute à présent de risquer ce qui lui a réclamé tant de peine à obtenir, tandis qu'à l'origine de son oeuvre il savait que c'était surtout l'audace qui pourrait lui ouvrir un chemin vers la distinction. Il devient tel le Frank Wheeler de Richard Yates dans Revolutionary road, qui, après avoir rédigé un article stupéfiant d'impertinence parce qu'il ne redoutait pas de se faire critiquer et renvoyer, trouve tout soudain que les forces insolentes qu'il a déployées pour déceler ses capacités et qui ont fait son ahurissant succès pourraient lui nuire s'il en usait une seconde fois notamment au sein d'un cercle plus élevé d'esprits policés, et il s'abstient raisonnablement de les faire paraître à ce degré d'ardeur juvénile, pour ne pas qu'on le taxât de gamin méprisable, ce dont il a échappé sans trop savoir comment à l'origine de son oeuvre. Un coup, un lançage, une sortie indéniablement réussis, ont souvent ceci de stupéfiant et d'incompréhensible qu'en d'autres circonstances moins inexplicables et propices, ils eussent été traités avec indifférence ou sévérité, de sorte qu'on hésite à retenter sa chance, qu'on balance à renouveler sa verve initiale, se méfiant du hasard qui, vous ayant fait naître au beau jour, peut demain vous replonger dans l'obscurité humiliante d'une cruelle chute que quelque excès de confiance et d'imprévoyance peut entraîner.
Vous ne vous pardonneriez pas une telle disgrâce. Vous vous jugeriez imprudent d'avoir « tenté le diable ». On se méfie du sort, particulièrement aux siècles des masses bizarres qu'un vent imprévisible meut, pas même le travail ou le talent. Rien n'est augurable dans leur transport ou dans leur nonchalance : un effort admirable peut les laisser froids, une facticité de flamme les mettre en admiration. On ne sait ce qui les agit : aucune règle, aucun ressort un tant soit peu mécanique, aucune constance ne permet de deviner leurs émois ou leur absence de réaction ; il ne reste qu'à saisir l'occasion quand elle se présente et à s'épargner le risque d'une ultérieure audace qui, elle, pourrait soudain déplaire et vous abattre. Les progrès des mentalités du confort sont tout spécifiquement propres à de tels étranges revirements : on ne veut pas ou l'on ne sait pas réfléchir à ce qu'on aime, par conséquent l'amour qu'on sent un jour ne dépend souvent que d'une humeur transitoire ; l'enthousiasme retombe dans un autre contexte, et l'on se moque de récompenser un auteur pour l'équanimité de son travail, on n'aspire qu'à s'épancher et se purger d'un certain élan spontané qui, là, est « venu » en nous, inattendue et qu'on n'examine point. Mon expertise de critique littéraire rend très sensible l'observation de la nature volatile et injustifiée des engouements de la foule : notre époque vit sous le règne trop suave et innocent de l'instantané et du « coup de coeur », elle subit donc à plein l'influence manipulatrice de la publicité et de l'épate. Les meilleurs ne sont jamais couronnés, et l'on a fait depuis longtemps bon marché du mérite et de la régularité. C'est tout logiquement que ce défaut de reconnaissance crée chez les auteurs une angoisse. Ils tâcheront à faire pareil pour ne rien se reprocher, mais ils éviteront de vouloir faire mieux : la fidélité du lecteur moderne est à ce prix. Tout triomphe aujourd'hui se paye d'une prudente paralysie – stagnation volontaire – des facultés.
Concevoir une société entière cantonnée à cette triste méthode, et comprendre pourquoi les artistes actuels ne proposent que les resucées sans variation d'un succès d'antan.
C'est ainsi que Spielberg lui-même, qui n'est pourtant pas un réalisateur foncièrement sans audace ni inspiration, eut l'idée de reprendre West side story. Il n'aventure nullement sa réputation tel projet, il le sait, et que, même si sa carrière est déjà faite et solidement respectée, il ne risque aucun péril en reprenant à se voir traité de vieux décrépit, d'étoile déchue, d'ancien surestimé… oui, mais reconnaissons que c'est encore à condition qu'il soit plutôt conforme que novateur ! Son art, ici, sera une adhésion et une continuation, il ne s'agira que d'y repérer de ponctuels effets de style, mais le génie, lui, ne pourra se rencontrer au mieux qu'en la manière, et la justesse d'une manière n'est que le déroulement exact d'une pensée. Or, rien n'est incertain comme l'appréciation de la pensée par le Contemporain : voilà pourquoi le génie de la pensée cède donc, à l'autel du triomphe le plus garanti, au génie de la manière. Voilà bien un siècle qui tourne dans le rond d'un très petit nombre de pensées mais que les artistes développent de mille manières : la technique pour impressionner et émouvoir, mais sans l'idée dont aucune grandeur même évidente ne permet d'assurer le succès. J'eusse encore préféré le contraire, pour le salut du génie profond : peu d'artisanat pour beaucoup d'art ; or, ce n'était pas chez nous offrir aux génies la sérénité dont ils ont besoin pour vivre d'une certaine fixité de revenus ainsi que de l'estime de soi que conforte l'admiration qu'on leur porte. Et donc, le résultat : prééminence d'une relative variété des présentations contre la répétition inlassable des mêmes thèmes. Voilà la synthèse artistique expliquée et irréfragable de nos temps modernes : la crainte de déchoir, exacerbée par l'irrationalité critique des gens, ne consolide que des usages établis, parce qu'une forme qui une fois n'est pas approuvée ne signifie pas qu'on ne sollicitera jamais l'artisan, et l'artisan se console ainsi de n'avoir pas trouvé le succès sans que l'essence ou que l'identité y soit de quelque chose.
C'est pourquoi généralement le temps affadit les penseurs : après l'éclat de la première réussite, ils ont fondé l'entretien de leur renommée sur la seule consolidation de leurs théories initiales, utilisant pour cela l'admiration des lecteurs qu'ils sont parvenus à impressionner. Et il leur suffit de mener leurs investigations dans ce même domaine qui leur fut favorable et où ils bénéficient déjà d'une reconnaissance qui, unanime, ne paraît plus contestable, pour y asseoir leur force et leur gloire, étendant leur place par petits abus progressifs, usurpant des autorités par décalages insensibles de domaines, et s'arrogeant des compétences graduelles hors de leur sphère comme on profite de la saisine légale d'un territoire pour déplacer subrepticement les bornes d'une frontière, faisant leur spécialité d'un sujet dont souvent rien que des circonstances ont décidé qu'il deviendrait leur piédestal et leur trône définitifs, et qui finit par englober, par dévorer, par phagocyter toute leur compétence. Alors, ils ont fort redouté de se lancer dans des entreprises inédites où quelques recommencements pourraient de nouveau les rendre ridicules et les nullifier – les réinitialiser comme on fait d'une machine qu'un simple bouton remonte à zéro (mieux vaut n'y pas toucher !) –, et ils ont compris que ce n'était pas pour eux une affaire légère que de rejouer le bénéfice de tant de louanges et d'honneur qu'ils avaient déjà reçus : ils y ont renoncé. La plupart se contenteront de ce vieil appui de leur début « prometteur » mais qui se borna ensuite à l'horizon d'attente, perpétuellement ressassé comme l'ancien fait d'arme d'un soldat devenu incapable de porter le fusil et de plus en plus infirme faute de s'entraîner à remuer, et leur meilleur triomphe dès lors sera leur unique canne, cette prothèse soutiendra toute leur carrière, tandis qu'il ne leur sera besoin que d'une sorte de pose hiératique, sur ce fond de gloire irrévoqué, pour achever de persuader partout de leur hauteur, de leur sagesse, de leur stature de conseiller de plus en plus universel et magnifique, un silence de majesté avec un oeil postiche de complicité, moins périlleux qu'une parole hardie susceptible de les discréditer. La pantomime servira à conforter leur tranquille bouffissure, chacun croira reconnaître en ces airs résolus et quiets de grands littérateurs des êtres qui se soumettent malgré eux à leur renom et à l'adulation des foules où les a élevés un talent qu'il ne faut qu'avoir manifesté une fois, et puis entretenu dans l'affectation, pour le rendre permanent et inamovible. En somme, ils arboreront la mine de sempiternalité, on les rencontrera sur les plateaux comme des Kundera de référence pourtant infondés d'expliquer l'écriture et jusqu'au principal de leur art, mais quelque fébrilité instinctive aura gagné en secret le coeur de ces hommes prisonniers d'une unique occasion et qui, hors de cette morne inertie du succès lointain, n'ont plus osé qu'être les poursuivants d'une discipline spécifique et sans doute déjà justement renouvelées depuis des ans, leurs opiniâtres et crispés continuateurs et qui se sont figés étroitement, et qui se sont inquiétés de réfléchir en-dehors de ce rond de plus en plus minuscule et écrasant, et qui, à la fin, ne savent plus du tout quoi penser de tout ce qui surprend, circonvient et subjugue la catégorie infime de leur spécialité qu'ils ont intérêt à rendre la plus étroite et immutable possible, pour en demeurer les consultants et adoubeurs attitrés, les maîtres et seigneurs vénérés uniquement sur la créance de la réalité d'un art, cependant révolu et mensonger, auquel ils s'accrochent comme à de valorisantes et opportunes chimères.
Tocqueville, cinq ans après le premier volume de de la démocratie en Amérique, m'a fait quelquefois cette impression dure, mais l'impression est à nuancer d'une sagacité toujours supérieure, à atténuer d'un reste chaleureux de volonté ambitieuse et géniale. Ascendu au faîte d'une renommée peu contestée, il s'appuie sur son rocher, regardant l'horizon de son aire, les yeux dans l'azur et les cheveux portés d'oxygène pur, pour soulever encore un génie que son bel esprit cependant suffirait seul à exhausser. Je reparlerai de ces mimiques, ce n'est pas grave, je provoque toujours, je cherche, comme on dit, attentif aux signes infinitésimaux traduisant une évolution, et par lesquels, entre deux oeuvres, on trahit une altération dans un sens ou dans l'autre de son sentiment et de son rapport au monde. Il suffit de commencer par indiquer que le sujet est, cette fois, bien plus vaste et délicat, nécessitant un sens de la prospective plus hasardé, plus conjecturé : il consiste à mesurer quelles sont les moeurs générales induites par le régime de la démocratie plutôt que, comme naguère, son fonctionnement strictement américain. Il ne lui avait fallu jusqu'en 1835 qu'un essentiel esprit d'observation et d'analyse auquel il pouvait suppléer par des visions calculées et impromptues de lucidité ; il constatait avec méthode, mais seulement secondairement, à son gré, il supputait des augures, ce que le choix de sa matière ne lui ordonnait pas principalement ; or, c'est devenu l'inverse en 1840 depuis qu'il s'est imposé une sorte de sociologie, les moeurs se décelant a contrario des institutions qui s'exposent, et il ne lui suffit plus de documents et de témoignages pour installer un compte rendu, il a besoin de sensations pour affermir des impressions – ce qu'on pourrait résumer grossièrement par ce mot : Tocqueville, de juriste et d'historien qu'il était cinq années auparavant, est devenu psychologue et comportementaliste, en sorte que, désormais, c'est secondairement qu'il doit appuyer ces considérations sur des faits.
Les moeurs pour autant ne sont pas l'objet des interprétations les plus frivoles et les plus volatiles, elles s'inscrivent dans une logique où l'observation judicieuse et exacte a largement sa part, et j'aurais des scrupules à induire que le livre serait un recueil d'allégations aventurées sans conscience ni justesse appréciable. le travail à l'oeuvre implique encore une pénétration de généalogiste, il s'agit de remonter l'esprit d'un régime, particulièrement d'induire et déduire ce que l'égalité en tant que valeur fondamentale constitue en mode de vie et comme mentalité, aussi bien individuellement que de façon homogène et sociale. Songer que c'est une véritable gageure que d'accomplir, même que d'envisager, un tel dessein : il faut rappeler que l'auteur ne connaît chez lui de la démocratie que des linéaments fort éloignés de sa teneur américaine ou contemporaine d'aujourd'hui, de sorte que toutes ses considérations sont surtout extrapolées, qu'elles consistent presque uniquement en visions, étayées d'un maximum de vraisemblance. J'ai déjà, dans plusieurs articles, essayé d'inférer sur l'avenir, et je dois admettre que c'est d'une peine presque insurmontable, aussi bien généreuse que désespérante en ce que jamais le temps de l'existence, au-delà duquel vont les prédictions, ne pourra confirmer ou infirmer les propos de l'auteur. C'est en quelque sorte, en tant que méthode, l'échafaudement rigoureux d'une thèse de naturaliste appliquée à la vie réelle ; voici ce que je veux dire :
Avec une poignée de pensées cohérentes et érigées en un dogme quasiment absolu – en l'occurrence tout ce qui environne et soutient la doctrine de l'égalité –, il s'agit de faire l'effort de bâtir presque de zéro ce qu'on pourrait appeler la conscience d'une société, en un système subtil et innervant profondément un peuple, de façon à conjecturer sans faute ou avec le moins d'écarts possibles la forme et le contenu d'une humanité qui n'est pas encore advenue. Ce labeur nécessite une scientificité impeccable et la plus absolue distanciation de sa propre volonté. Avec pour matériau la notion précisément définie et circonscrite, supposée foncière et prédominante dans la considération d'un peuple, de l'égalité, façonner non plus les règles légales (ce qui fut l'objet du premier livre) mais la consistance des pensées humaines, leur influence sur la forme des États, ainsi que, par surcroît de difficulté dont la tentative pourtant facultative suppose un grand péril en une marge considérable d'erreurs, l'avenir des sociétés du suffrage et du citoyen : rien que cette ambition est remarquable, et il fallait un esprit extraordinairement positif à la fois de synthèse et d'abstraction rien que pour entreprendre cette orgueilleuse émulation avec soi-même et qui, je le répète, ne pouvant rencontrer aucune confirmation, ne saurait produire force prestige au temps contemporain de l'auteur. Neutralité, perspicacité, clairvoyance : voilà quels sont les ressorts utiles à mener de pareilles spirituelles expériences ; Tocqueville s'en devine la faculté et le courage, et il n'hésite pas à explorer ce vertigineux fond social en des perspectives jamais envisagées si vastement, invérifiables, éloignées bien plus que quelque devin d'intérêt mesquin ne le pourrait souhaiter. Il faut y insister en préambule : combien l'on doit se savoir de forces extrêmement aiguisées pour projeter de se risquer à un pareil exercice ! Or, le recul des siècles dont nous bénéficions à présent permet de vérifier la réalisation de toutes ces assertions, et beaucoup se trouvent incroyablement confirmés, au même titre que le premier tome, comme je le signalais dans ma critique, annonçait avec une stupéfiante précision la guerre de Sécession sans qu'il fût nécessaire d'y forcer l'interprétation comme on le fit d'un Nostradamus. Rien que le florilège suivant (dont je crains qu'il n'épuise un peu l'ouvrage, je m'en défie toujours et suis marri de ce résultat quand il s'applique à des livres que je recommande comme celui-ci, mais je ne puis résister au défi de rendre des synthèses parfaitement méticuleuses, ce qui a toujours pour effet de défaire le lecteur d'une partie de son intérêt pour le texte ainsi défloré ; pour autant je ne lui retire pas l'envi de commenter l'oeuvre au-delà de ma capacité s'il s'en croit apte, et il peut fort continuer d'apprendre d'une philologie personnelle que je n'aurais, moi, pas mené jusqu'à son dernier terme), rien que ce florilège, disais-je, ne révèle-t-il pas, au sujet de notre époque, en une correspondance explicite et troublante :
- son penchant facile pour l'écologie : « Parmi les différents systèmes à l'aide desquels la philosophie cherche à expliquer l'univers, le panthéisme me paraît l'un des plus propres à séduire l'esprit humain dans les siècles démocratiques. » (page 51)
- son abandon de la littérature, c'est-à-dire son découragement du livre comme oeuvre d'art : « Ils le considèrent comme un délassement passager et nécessaire au milieu des sérieux travaux de la vie : de tels hommes ne sauraient jamais acquérir la connaissance assez approfondie de l'art littéraire pour en sentir les délicatesses ; les petites nuances leur échappent. N'ayant qu'un temps fort court à donner aux lettres, ils veulent le mettre à profit tout entier. Ils aiment les livres qu'on se procure sans peine, qui se lisent vite, qui n'exigent point de recherches savantes pour être compris. […] La forme s'y trouvera, d'ordinaire, négligée et parfois méprisée. le style s'y montrera souvent bizarre, incorrect, surchargé et mou, et presque toujours hardi et véhément. Les auteurs viseront à la rapidité de l'exécution plutôt qu'à la perfection des détails. Les petits écrits y seront plus fréquents que les gros livres, l'esprit que l'érudition, l'imagination que la profondeur. » (pages 87-88)
- sa passion pour le grossier cinéma, qu'il faut substituer dans l'extrait à « pièces de théâtre » pour un effet saisissant : « Dans les démocraties, on écoute les pièces de théâtre, mais on ne les lit point. La plupart de ceux qui assistent aux jeux de la scène n'y cherchent pas les plaisirs de l'esprit, mais les émotions vives du coeur. Ils ne s'attendent point à y trouver une oeuvre de littérature, mais un spectacle, et, pourvu que l'auteur parle assez correctement la langue du pays pour se faire entendre, et que ses personnages excitent la curiosité et éveillent la sympathie, ils sont contents ; sans rien demander de plus à la fiction, ils rentrent aussitôt dans le monde réel. » (page 118)
- la désaffection des citoyens pour le champ politique : « Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. Il n'est pas besoin d'arracher à de tels citoyens les droits qu'ils possèdent ; ils les laissent volontiers échapper eux-mêmes. L'exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un contre-temps fâcheux qui les distrait de leur industrie. S'agit-il de choisir leurs représentants, de prêter main forte à l'autorité, de traiter en commun la chose commune, le temps leur manque. » (page 196)
- l'évanescence mentale du Contemporain en général : « Il fait donc toutes choses à la hâte, se contente d'à peu près, et ne s'arrête jamais qu'un moment pour considérer chacun de ses actes. Sa curiosité est tout à la fois insatiable et satisfaite à peu de frais ; car il tient à savoir vite beaucoup, plutôt qu'à bien savoir. Il n'a guère le temps, et il perd bientôt le goût d'approfondir. Ainsi donc, les peuples démocratiques sont graves, parce que leur état social et politique les porte sans cesse à s'occuper des choses sérieuses ; et ils agissent inconsidérément, parce qu'ils ne donnent que peu de temps et d'attention à chacune de ces choses. L'habitude de l'inattention doit être considérée comme le plus grand vice de l'esprit démocratique. » (pages 308-309)
- l'uniformité des êtres et la rareté des individus : « Chez les peuples aristocratiques, chaque hom
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Vous ne vous pardonneriez pas une telle disgrâce. Vous vous jugeriez imprudent d'avoir « tenté le diable ». On se méfie du sort, particulièrement aux siècles des masses bizarres qu'un vent imprévisible meut, pas même le travail ou le talent. Rien n'est augurable dans leur transport ou dans leur nonchalance : un effort admirable peut les laisser froids, une facticité de flamme les mettre en admiration. On ne sait ce qui les agit : aucune règle, aucun ressort un tant soit peu mécanique, aucune constance ne permet de deviner leurs émois ou leur absence de réaction ; il ne reste qu'à saisir l'occasion quand elle se présente et à s'épargner le risque d'une ultérieure audace qui, elle, pourrait soudain déplaire et vous abattre. Les progrès des mentalités du confort sont tout spécifiquement propres à de tels étranges revirements : on ne veut pas ou l'on ne sait pas réfléchir à ce qu'on aime, par conséquent l'amour qu'on sent un jour ne dépend souvent que d'une humeur transitoire ; l'enthousiasme retombe dans un autre contexte, et l'on se moque de récompenser un auteur pour l'équanimité de son travail, on n'aspire qu'à s'épancher et se purger d'un certain élan spontané qui, là, est « venu » en nous, inattendue et qu'on n'examine point. Mon expertise de critique littéraire rend très sensible l'observation de la nature volatile et injustifiée des engouements de la foule : notre époque vit sous le règne trop suave et innocent de l'instantané et du « coup de coeur », elle subit donc à plein l'influence manipulatrice de la publicité et de l'épate. Les meilleurs ne sont jamais couronnés, et l'on a fait depuis longtemps bon marché du mérite et de la régularité. C'est tout logiquement que ce défaut de reconnaissance crée chez les auteurs une angoisse. Ils tâcheront à faire pareil pour ne rien se reprocher, mais ils éviteront de vouloir faire mieux : la fidélité du lecteur moderne est à ce prix. Tout triomphe aujourd'hui se paye d'une prudente paralysie – stagnation volontaire – des facultés.
Concevoir une société entière cantonnée à cette triste méthode, et comprendre pourquoi les artistes actuels ne proposent que les resucées sans variation d'un succès d'antan.
C'est ainsi que Spielberg lui-même, qui n'est pourtant pas un réalisateur foncièrement sans audace ni inspiration, eut l'idée de reprendre West side story. Il n'aventure nullement sa réputation tel projet, il le sait, et que, même si sa carrière est déjà faite et solidement respectée, il ne risque aucun péril en reprenant à se voir traité de vieux décrépit, d'étoile déchue, d'ancien surestimé… oui, mais reconnaissons que c'est encore à condition qu'il soit plutôt conforme que novateur ! Son art, ici, sera une adhésion et une continuation, il ne s'agira que d'y repérer de ponctuels effets de style, mais le génie, lui, ne pourra se rencontrer au mieux qu'en la manière, et la justesse d'une manière n'est que le déroulement exact d'une pensée. Or, rien n'est incertain comme l'appréciation de la pensée par le Contemporain : voilà pourquoi le génie de la pensée cède donc, à l'autel du triomphe le plus garanti, au génie de la manière. Voilà bien un siècle qui tourne dans le rond d'un très petit nombre de pensées mais que les artistes développent de mille manières : la technique pour impressionner et émouvoir, mais sans l'idée dont aucune grandeur même évidente ne permet d'assurer le succès. J'eusse encore préféré le contraire, pour le salut du génie profond : peu d'artisanat pour beaucoup d'art ; or, ce n'était pas chez nous offrir aux génies la sérénité dont ils ont besoin pour vivre d'une certaine fixité de revenus ainsi que de l'estime de soi que conforte l'admiration qu'on leur porte. Et donc, le résultat : prééminence d'une relative variété des présentations contre la répétition inlassable des mêmes thèmes. Voilà la synthèse artistique expliquée et irréfragable de nos temps modernes : la crainte de déchoir, exacerbée par l'irrationalité critique des gens, ne consolide que des usages établis, parce qu'une forme qui une fois n'est pas approuvée ne signifie pas qu'on ne sollicitera jamais l'artisan, et l'artisan se console ainsi de n'avoir pas trouvé le succès sans que l'essence ou que l'identité y soit de quelque chose.
C'est pourquoi généralement le temps affadit les penseurs : après l'éclat de la première réussite, ils ont fondé l'entretien de leur renommée sur la seule consolidation de leurs théories initiales, utilisant pour cela l'admiration des lecteurs qu'ils sont parvenus à impressionner. Et il leur suffit de mener leurs investigations dans ce même domaine qui leur fut favorable et où ils bénéficient déjà d'une reconnaissance qui, unanime, ne paraît plus contestable, pour y asseoir leur force et leur gloire, étendant leur place par petits abus progressifs, usurpant des autorités par décalages insensibles de domaines, et s'arrogeant des compétences graduelles hors de leur sphère comme on profite de la saisine légale d'un territoire pour déplacer subrepticement les bornes d'une frontière, faisant leur spécialité d'un sujet dont souvent rien que des circonstances ont décidé qu'il deviendrait leur piédestal et leur trône définitifs, et qui finit par englober, par dévorer, par phagocyter toute leur compétence. Alors, ils ont fort redouté de se lancer dans des entreprises inédites où quelques recommencements pourraient de nouveau les rendre ridicules et les nullifier – les réinitialiser comme on fait d'une machine qu'un simple bouton remonte à zéro (mieux vaut n'y pas toucher !) –, et ils ont compris que ce n'était pas pour eux une affaire légère que de rejouer le bénéfice de tant de louanges et d'honneur qu'ils avaient déjà reçus : ils y ont renoncé. La plupart se contenteront de ce vieil appui de leur début « prometteur » mais qui se borna ensuite à l'horizon d'attente, perpétuellement ressassé comme l'ancien fait d'arme d'un soldat devenu incapable de porter le fusil et de plus en plus infirme faute de s'entraîner à remuer, et leur meilleur triomphe dès lors sera leur unique canne, cette prothèse soutiendra toute leur carrière, tandis qu'il ne leur sera besoin que d'une sorte de pose hiératique, sur ce fond de gloire irrévoqué, pour achever de persuader partout de leur hauteur, de leur sagesse, de leur stature de conseiller de plus en plus universel et magnifique, un silence de majesté avec un oeil postiche de complicité, moins périlleux qu'une parole hardie susceptible de les discréditer. La pantomime servira à conforter leur tranquille bouffissure, chacun croira reconnaître en ces airs résolus et quiets de grands littérateurs des êtres qui se soumettent malgré eux à leur renom et à l'adulation des foules où les a élevés un talent qu'il ne faut qu'avoir manifesté une fois, et puis entretenu dans l'affectation, pour le rendre permanent et inamovible. En somme, ils arboreront la mine de sempiternalité, on les rencontrera sur les plateaux comme des Kundera de référence pourtant infondés d'expliquer l'écriture et jusqu'au principal de leur art, mais quelque fébrilité instinctive aura gagné en secret le coeur de ces hommes prisonniers d'une unique occasion et qui, hors de cette morne inertie du succès lointain, n'ont plus osé qu'être les poursuivants d'une discipline spécifique et sans doute déjà justement renouvelées depuis des ans, leurs opiniâtres et crispés continuateurs et qui se sont figés étroitement, et qui se sont inquiétés de réfléchir en-dehors de ce rond de plus en plus minuscule et écrasant, et qui, à la fin, ne savent plus du tout quoi penser de tout ce qui surprend, circonvient et subjugue la catégorie infime de leur spécialité qu'ils ont intérêt à rendre la plus étroite et immutable possible, pour en demeurer les consultants et adoubeurs attitrés, les maîtres et seigneurs vénérés uniquement sur la créance de la réalité d'un art, cependant révolu et mensonger, auquel ils s'accrochent comme à de valorisantes et opportunes chimères.
Tocqueville, cinq ans après le premier volume de de la démocratie en Amérique, m'a fait quelquefois cette impression dure, mais l'impression est à nuancer d'une sagacité toujours supérieure, à atténuer d'un reste chaleureux de volonté ambitieuse et géniale. Ascendu au faîte d'une renommée peu contestée, il s'appuie sur son rocher, regardant l'horizon de son aire, les yeux dans l'azur et les cheveux portés d'oxygène pur, pour soulever encore un génie que son bel esprit cependant suffirait seul à exhausser. Je reparlerai de ces mimiques, ce n'est pas grave, je provoque toujours, je cherche, comme on dit, attentif aux signes infinitésimaux traduisant une évolution, et par lesquels, entre deux oeuvres, on trahit une altération dans un sens ou dans l'autre de son sentiment et de son rapport au monde. Il suffit de commencer par indiquer que le sujet est, cette fois, bien plus vaste et délicat, nécessitant un sens de la prospective plus hasardé, plus conjecturé : il consiste à mesurer quelles sont les moeurs générales induites par le régime de la démocratie plutôt que, comme naguère, son fonctionnement strictement américain. Il ne lui avait fallu jusqu'en 1835 qu'un essentiel esprit d'observation et d'analyse auquel il pouvait suppléer par des visions calculées et impromptues de lucidité ; il constatait avec méthode, mais seulement secondairement, à son gré, il supputait des augures, ce que le choix de sa matière ne lui ordonnait pas principalement ; or, c'est devenu l'inverse en 1840 depuis qu'il s'est imposé une sorte de sociologie, les moeurs se décelant a contrario des institutions qui s'exposent, et il ne lui suffit plus de documents et de témoignages pour installer un compte rendu, il a besoin de sensations pour affermir des impressions – ce qu'on pourrait résumer grossièrement par ce mot : Tocqueville, de juriste et d'historien qu'il était cinq années auparavant, est devenu psychologue et comportementaliste, en sorte que, désormais, c'est secondairement qu'il doit appuyer ces considérations sur des faits.
Les moeurs pour autant ne sont pas l'objet des interprétations les plus frivoles et les plus volatiles, elles s'inscrivent dans une logique où l'observation judicieuse et exacte a largement sa part, et j'aurais des scrupules à induire que le livre serait un recueil d'allégations aventurées sans conscience ni justesse appréciable. le travail à l'oeuvre implique encore une pénétration de généalogiste, il s'agit de remonter l'esprit d'un régime, particulièrement d'induire et déduire ce que l'égalité en tant que valeur fondamentale constitue en mode de vie et comme mentalité, aussi bien individuellement que de façon homogène et sociale. Songer que c'est une véritable gageure que d'accomplir, même que d'envisager, un tel dessein : il faut rappeler que l'auteur ne connaît chez lui de la démocratie que des linéaments fort éloignés de sa teneur américaine ou contemporaine d'aujourd'hui, de sorte que toutes ses considérations sont surtout extrapolées, qu'elles consistent presque uniquement en visions, étayées d'un maximum de vraisemblance. J'ai déjà, dans plusieurs articles, essayé d'inférer sur l'avenir, et je dois admettre que c'est d'une peine presque insurmontable, aussi bien généreuse que désespérante en ce que jamais le temps de l'existence, au-delà duquel vont les prédictions, ne pourra confirmer ou infirmer les propos de l'auteur. C'est en quelque sorte, en tant que méthode, l'échafaudement rigoureux d'une thèse de naturaliste appliquée à la vie réelle ; voici ce que je veux dire :
Avec une poignée de pensées cohérentes et érigées en un dogme quasiment absolu – en l'occurrence tout ce qui environne et soutient la doctrine de l'égalité –, il s'agit de faire l'effort de bâtir presque de zéro ce qu'on pourrait appeler la conscience d'une société, en un système subtil et innervant profondément un peuple, de façon à conjecturer sans faute ou avec le moins d'écarts possibles la forme et le contenu d'une humanité qui n'est pas encore advenue. Ce labeur nécessite une scientificité impeccable et la plus absolue distanciation de sa propre volonté. Avec pour matériau la notion précisément définie et circonscrite, supposée foncière et prédominante dans la considération d'un peuple, de l'égalité, façonner non plus les règles légales (ce qui fut l'objet du premier livre) mais la consistance des pensées humaines, leur influence sur la forme des États, ainsi que, par surcroît de difficulté dont la tentative pourtant facultative suppose un grand péril en une marge considérable d'erreurs, l'avenir des sociétés du suffrage et du citoyen : rien que cette ambition est remarquable, et il fallait un esprit extraordinairement positif à la fois de synthèse et d'abstraction rien que pour entreprendre cette orgueilleuse émulation avec soi-même et qui, je le répète, ne pouvant rencontrer aucune confirmation, ne saurait produire force prestige au temps contemporain de l'auteur. Neutralité, perspicacité, clairvoyance : voilà quels sont les ressorts utiles à mener de pareilles spirituelles expériences ; Tocqueville s'en devine la faculté et le courage, et il n'hésite pas à explorer ce vertigineux fond social en des perspectives jamais envisagées si vastement, invérifiables, éloignées bien plus que quelque devin d'intérêt mesquin ne le pourrait souhaiter. Il faut y insister en préambule : combien l'on doit se savoir de forces extrêmement aiguisées pour projeter de se risquer à un pareil exercice ! Or, le recul des siècles dont nous bénéficions à présent permet de vérifier la réalisation de toutes ces assertions, et beaucoup se trouvent incroyablement confirmés, au même titre que le premier tome, comme je le signalais dans ma critique, annonçait avec une stupéfiante précision la guerre de Sécession sans qu'il fût nécessaire d'y forcer l'interprétation comme on le fit d'un Nostradamus. Rien que le florilège suivant (dont je crains qu'il n'épuise un peu l'ouvrage, je m'en défie toujours et suis marri de ce résultat quand il s'applique à des livres que je recommande comme celui-ci, mais je ne puis résister au défi de rendre des synthèses parfaitement méticuleuses, ce qui a toujours pour effet de défaire le lecteur d'une partie de son intérêt pour le texte ainsi défloré ; pour autant je ne lui retire pas l'envi de commenter l'oeuvre au-delà de ma capacité s'il s'en croit apte, et il peut fort continuer d'apprendre d'une philologie personnelle que je n'aurais, moi, pas mené jusqu'à son dernier terme), rien que ce florilège, disais-je, ne révèle-t-il pas, au sujet de notre époque, en une correspondance explicite et troublante :
- son penchant facile pour l'écologie : « Parmi les différents systèmes à l'aide desquels la philosophie cherche à expliquer l'univers, le panthéisme me paraît l'un des plus propres à séduire l'esprit humain dans les siècles démocratiques. » (page 51)
- son abandon de la littérature, c'est-à-dire son découragement du livre comme oeuvre d'art : « Ils le considèrent comme un délassement passager et nécessaire au milieu des sérieux travaux de la vie : de tels hommes ne sauraient jamais acquérir la connaissance assez approfondie de l'art littéraire pour en sentir les délicatesses ; les petites nuances leur échappent. N'ayant qu'un temps fort court à donner aux lettres, ils veulent le mettre à profit tout entier. Ils aiment les livres qu'on se procure sans peine, qui se lisent vite, qui n'exigent point de recherches savantes pour être compris. […] La forme s'y trouvera, d'ordinaire, négligée et parfois méprisée. le style s'y montrera souvent bizarre, incorrect, surchargé et mou, et presque toujours hardi et véhément. Les auteurs viseront à la rapidité de l'exécution plutôt qu'à la perfection des détails. Les petits écrits y seront plus fréquents que les gros livres, l'esprit que l'érudition, l'imagination que la profondeur. » (pages 87-88)
- sa passion pour le grossier cinéma, qu'il faut substituer dans l'extrait à « pièces de théâtre » pour un effet saisissant : « Dans les démocraties, on écoute les pièces de théâtre, mais on ne les lit point. La plupart de ceux qui assistent aux jeux de la scène n'y cherchent pas les plaisirs de l'esprit, mais les émotions vives du coeur. Ils ne s'attendent point à y trouver une oeuvre de littérature, mais un spectacle, et, pourvu que l'auteur parle assez correctement la langue du pays pour se faire entendre, et que ses personnages excitent la curiosité et éveillent la sympathie, ils sont contents ; sans rien demander de plus à la fiction, ils rentrent aussitôt dans le monde réel. » (page 118)
- la désaffection des citoyens pour le champ politique : « Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. Il n'est pas besoin d'arracher à de tels citoyens les droits qu'ils possèdent ; ils les laissent volontiers échapper eux-mêmes. L'exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un contre-temps fâcheux qui les distrait de leur industrie. S'agit-il de choisir leurs représentants, de prêter main forte à l'autorité, de traiter en commun la chose commune, le temps leur manque. » (page 196)
- l'évanescence mentale du Contemporain en général : « Il fait donc toutes choses à la hâte, se contente d'à peu près, et ne s'arrête jamais qu'un moment pour considérer chacun de ses actes. Sa curiosité est tout à la fois insatiable et satisfaite à peu de frais ; car il tient à savoir vite beaucoup, plutôt qu'à bien savoir. Il n'a guère le temps, et il perd bientôt le goût d'approfondir. Ainsi donc, les peuples démocratiques sont graves, parce que leur état social et politique les porte sans cesse à s'occuper des choses sérieuses ; et ils agissent inconsidérément, parce qu'ils ne donnent que peu de temps et d'attention à chacune de ces choses. L'habitude de l'inattention doit être considérée comme le plus grand vice de l'esprit démocratique. » (pages 308-309)
- l'uniformité des êtres et la rareté des individus : « Chez les peuples aristocratiques, chaque hom
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Si la première partie de "De la démocratie en Amérique" pouvait décevoir, il n'en est pas de même pour la seconde partie, bien plus intéressante.
Il y a toujours comme dans la première partie, des idées un peu tirées par les cheveux ; mais il y en a beaucoup moins et il s'agit d'une excellente analyse du fonctionnement des systèmes démocratiques.
Il faut dire que cette partie est beaucoup plus ambitieuse et donc, beaucoup plus intéressante ; elle est aussi beaucoup plus intemporelle, puisque Tocqueville s'y intéresse moins ici au cas spécial de la démocratie en Amérique qu'à la démocratie en général.
Très intéressant et très pertinent !
Il y a toujours comme dans la première partie, des idées un peu tirées par les cheveux ; mais il y en a beaucoup moins et il s'agit d'une excellente analyse du fonctionnement des systèmes démocratiques.
Il faut dire que cette partie est beaucoup plus ambitieuse et donc, beaucoup plus intéressante ; elle est aussi beaucoup plus intemporelle, puisque Tocqueville s'y intéresse moins ici au cas spécial de la démocratie en Amérique qu'à la démocratie en général.
Très intéressant et très pertinent !
Ce deuxième tome peut paraître répétitif, tant le sujet est creusé consciencieusement pour en atteindre la substantifique moelle. Mais quel régal! le jeu en vaut la chandelle! Alexis de Tocqueville analyse avec une grande circonspection la naissance des régimes démocratiques basés sur la primauté de la valeur d'égalité. Loin de regretter l'ancien système aristocratique inégalitaire, il se réjouit des perspectives offertes à la grande majorité des hommes par la démocratie. Mais il reste lucide sur les nouveaux dangers qui se présenteront aux sociétés égalitaires. En plein XIXe siècle, Alexis de Tocqueville annonce la dictature du prolétariat, la montée en puissance des démagogues et la société de consommation!
A l'heure de la démocratie titubante, lire Tocqueville est revigorant.
A l'heure de la démocratie titubante, lire Tocqueville est revigorant.
Deuxième volume des pensées d'Alexis de Tocqueville et comme pour le premier Indispensable !
L'un des plus grand visionnaire que la France ait engendré, le plus méconnu aussi.
Une réflexion sur la démocratie faite au 19ème siècle qui prend tout son sens au 21ème.
Si on veut comprendre notre monde, nos démocratie il faut lire Alexis de Tocqueville !!!!
L'un des plus grand visionnaire que la France ait engendré, le plus méconnu aussi.
Une réflexion sur la démocratie faite au 19ème siècle qui prend tout son sens au 21ème.
Si on veut comprendre notre monde, nos démocratie il faut lire Alexis de Tocqueville !!!!
Ce deuxième tome se détache progressivement du sujet de la démocratie américaine pour traiter d'idées plus générales et de réflexions sur la démocratie et l'Etat. Là où une grande partie du Ier tome parlait de l'histoire et des institutions des Etats-Unis, le propos de ce volume est plus philosophique et sans doute moins facilement accessible au lecteur lambda. Par exemple, j'aurais bien aimé que la réflexion de l'auteur soit agrémentée d'exemples qui la rendraient plus évidente (comme dans le Ier tome). Parfois, le sens des mots est à prendre dans une acception de 1840 et non pas tel qu'on l'entend aujourd'hui, au risque de comprendre de travers le propos de Tocqueville.
Cependant, si l'on s'y investit, le livre devient passionnant. J'ai trouvé que la dernière partie de l'oeuvre, intitulée "De l'influence qu'exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société publique", résumait le coeur de la pensée de Tocqueville. Si vous ne deviez lire qu'une seule partie, ce serait celle-là.
Cependant, si l'on s'y investit, le livre devient passionnant. J'ai trouvé que la dernière partie de l'oeuvre, intitulée "De l'influence qu'exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société publique", résumait le coeur de la pensée de Tocqueville. Si vous ne deviez lire qu'une seule partie, ce serait celle-là.
Citations et extraits (36)
Voir plus
Ajouter une citation
Je pense donc que l’espèce d’oppression, dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde ; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l’idée que je m’en forme et la renferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation a n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d’être conduits et l’envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni l’autre de ces instincts contraires, ils s’efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même, qui tient le bout de la chaîne.
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s’accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c’est au pouvoir national qu’ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance.
Chapitre VI : Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation a n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d’être conduits et l’envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni l’autre de ces instincts contraires, ils s’efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même, qui tient le bout de la chaîne.
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s’accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c’est au pouvoir national qu’ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance.
Chapitre VI : Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre.
Dans les temps d’aristocratie, chaque homme est toujours lié d’une manière très étroite à plusieurs de ses concitoyens, de telle sorte qu’on ne saurait attaquer celui-là, que les autres n’accourent à son aide. Dans les siècles d’égalité, chaque individu est naturellement isolé ; il n’a point d’amis héréditaires dont il puisse exiger le concours, point de classe dont les sympathies lui soient assurées ; on le met aisément à part, et on le foule impunément aux pieds. De nos jours, un citoyen qu’on opprime n’a donc qu’un moyen de se défendre ; c’est de s’adresser à la nation tout entière, et, si elle lui est sourde, au genre humain ; il n’a qu’un moyen de le faire, c’est la presse. Ainsi la liberté de la presse est infiniment plus précieuse chez les nations démocratiques que chez toutes les autres ; elle seule guérit la plupart des maux que l’égalité peut produire. L’égalité isole et affaiblit les hommes ; mais la presse place à côté de chacun d’eux une arme très puissante, dont le plus faible et le plus isolé peut faire usage.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s’accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c’est au pouvoir national qu’ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance.
Je ne nierai pas cependant qu’une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentré tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d’un homme ou d’un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle-ci serait assurément la pire.
Je ne nierai pas cependant qu’une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentré tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d’un homme ou d’un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle-ci serait assurément la pire.
VUE GÉNÉRALE DU SUJET
Je voudrais, avant de quitter pour jamais la carrière que je viens de parcourir, pouvoir embrasser d'un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau, et juger enfin de l'influence générale que doit exercer l'égalité sur le sort des hommes ; mais la difficulté d'une pareille entreprise m'arrête ; en présence d'un si grand objet, je sens ma vue qui se trouble et ma raison qui chancelle.
Cette société nouvelle, que j'ai cherché à peindre et que je veux juger, ne fait que de naître. Le temps n'en a point encore arrêté la forme ; la grande révolution qui l'a créée dure encore, et, dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même, et ce qui doit rester après elle.
Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et, au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d'en disparaitre.
Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit encore bien loin d'être terminée, déjà on ne saurait comparer ses œuvres avec rien de ce qui s'est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'antiquité la plus reculée ; je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres.
Cependant, au milieu de ce tableau si vaste, si nouveau, si confus, j'entrevois déjà quelques traits principaux qui se dessinent, et je les indique :
Je vois que les biens et les maux se répartissent assez également dans le monde. Les grandes richesses disparaissent ; le nombre des petites fortunes s'accroît ; les désirs et les jouissances se multiplient ; il n'y a plus de prospérités extraordinaires ni de misères irrémédiables. L'ambition est un sentiment universel, il y a peu d'ambitions vastes. Chaque individu est isolé et faible ; la société est agile, prévoyante et forte ; les particuliers font de petites choses, et l'État d'immenses.
Les âmes ne sont pas énergiques ; mais les mœurs sont douces et les législations humaines. S'il se rencontre peu de grands dévouements, de vertus très hautes, très brillantes et très pures, les habitudes sont rangées, la violence est rare, la cruauté presque inconnue. L'existence des hommes devient plus longue et leur propriété plus sûre. La vie n'est pas très ornée, mais très aisée et très paisible. Il y a peu de plaisirs très délicats et très grossiers, peu de politesses dans les manières et peu de brutalité dans les goûts. On ne rencontre guère d'hommes très savants ni de populations très ignorantes. Le génie devient plus rare et les lumières plus communes. L'esprit humain se développe par les petits efforts combinés de tous les hommes, et non par l'impulsion puissante de quelques-uns d'entre eux. Il y a moins de perfection, mais plus de fécondité dans les œuvres. Tous les liens de race, de classe, de patrie se détendent ; le grand lien de l'humanité se resserre.
Si parmi tous ces traits divers, je cherche celui qui me parait le plus général et le plus frappant, j'arrive à voir que ce qui se remarque dans les fortunes se représente sous mille autres formes. Presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent ; presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde.
Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus.
Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue ; mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse : c'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ceux qu'il me plait de contempler. Il n'en est pas de même de l'Être tout-puissant et éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses, et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme.
Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous : ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès ; ce qui me blesse lui agrée. L'égalité est moins élevée peut-être ; mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté.
Je m'efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, et c'est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines. Personne sur la terre ne peut encore affirmer d’une manière absolue et générale que l’état nouveau des sociétés soit supérieur à l'état ancien ; mais il est déjà aisé de voir qu'il est autre.
Il y a de certains vices et de certaines vertus qui étaient attachés à la constitution des nations aristocratiques, et qui sont tellement contraires au génie des peuples nouveaux qu'on ne saurait les introduire dans leur sein. Il y a de bons penchants et de mauvais instincts qui étaient étrangers aux premiers et qui sont naturels aux seconds ; des idées qui se présentent d'elles-mêmes à l'imagination des uns et que l'esprit des autres rejette. Ce sont comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres.
Il faut donc bien prendre garde de juger les sociétés qui naissent avec les idées qu'on a puisées dans celles qui ne sont plus. Cela serait injuste, car ces sociétés, différant prodigieusement entre elles, sont incomparables.
Il ne serait guère plus raisonnable de demander aux hommes de notre temps les vertus particulières qui découlaient de l'état social de leurs ancêtres, puisque cet état social lui-même est tombé, et qu'il a entraîné confusément dans sa chute tous les biens et tous les maux qu'il portait avec lui.
Mais ces choses sont encore mal comprises de nos jours.
J'aperçois un grand nombre de mes contemporains qui entreprennent de faire un choix entre les institutions, les opinions, les idées qui naissaient de la constitution aristocratique de l'ancienne société ; ils abandonneraient volontiers les unes, mais ils voudraient retenir les autres et les transporter avec eux dans le monde nouveau.
Je pense que ceux-là consument leur temps et leurs forces dans un travail honnête et stérile.
Il ne s'agit plus de retenir les avantages particuliers que l'inégalité des conditions procure aux hommes, mais d’assurer les biens nouveaux que l’égalité peut leur offrir.
Nous ne devons pas tendre à nous rendre semblables à nos pères, mais nous efforcer d'atteindre l'espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre.
Pour moi qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j'avais contemplés à part en marchant, je me sens plein de craintes et plein d'espérances. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer ; de grands maux qu'on peut éviter ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir.
Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d'eux-mêmes, et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui nait des événements antérieurs, de la race, du sol ou du climat.
Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes : la Providence n'a créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir ; mais, dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre ; ainsi des peuples.
Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales ; mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.
p. 451 - 455
Je voudrais, avant de quitter pour jamais la carrière que je viens de parcourir, pouvoir embrasser d'un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau, et juger enfin de l'influence générale que doit exercer l'égalité sur le sort des hommes ; mais la difficulté d'une pareille entreprise m'arrête ; en présence d'un si grand objet, je sens ma vue qui se trouble et ma raison qui chancelle.
Cette société nouvelle, que j'ai cherché à peindre et que je veux juger, ne fait que de naître. Le temps n'en a point encore arrêté la forme ; la grande révolution qui l'a créée dure encore, et, dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même, et ce qui doit rester après elle.
Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et, au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d'en disparaitre.
Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit encore bien loin d'être terminée, déjà on ne saurait comparer ses œuvres avec rien de ce qui s'est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'antiquité la plus reculée ; je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres.
Cependant, au milieu de ce tableau si vaste, si nouveau, si confus, j'entrevois déjà quelques traits principaux qui se dessinent, et je les indique :
Je vois que les biens et les maux se répartissent assez également dans le monde. Les grandes richesses disparaissent ; le nombre des petites fortunes s'accroît ; les désirs et les jouissances se multiplient ; il n'y a plus de prospérités extraordinaires ni de misères irrémédiables. L'ambition est un sentiment universel, il y a peu d'ambitions vastes. Chaque individu est isolé et faible ; la société est agile, prévoyante et forte ; les particuliers font de petites choses, et l'État d'immenses.
Les âmes ne sont pas énergiques ; mais les mœurs sont douces et les législations humaines. S'il se rencontre peu de grands dévouements, de vertus très hautes, très brillantes et très pures, les habitudes sont rangées, la violence est rare, la cruauté presque inconnue. L'existence des hommes devient plus longue et leur propriété plus sûre. La vie n'est pas très ornée, mais très aisée et très paisible. Il y a peu de plaisirs très délicats et très grossiers, peu de politesses dans les manières et peu de brutalité dans les goûts. On ne rencontre guère d'hommes très savants ni de populations très ignorantes. Le génie devient plus rare et les lumières plus communes. L'esprit humain se développe par les petits efforts combinés de tous les hommes, et non par l'impulsion puissante de quelques-uns d'entre eux. Il y a moins de perfection, mais plus de fécondité dans les œuvres. Tous les liens de race, de classe, de patrie se détendent ; le grand lien de l'humanité se resserre.
Si parmi tous ces traits divers, je cherche celui qui me parait le plus général et le plus frappant, j'arrive à voir que ce qui se remarque dans les fortunes se représente sous mille autres formes. Presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent ; presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde.
Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus.
Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue ; mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse : c'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ceux qu'il me plait de contempler. Il n'en est pas de même de l'Être tout-puissant et éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses, et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme.
Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous : ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès ; ce qui me blesse lui agrée. L'égalité est moins élevée peut-être ; mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté.
Je m'efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, et c'est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines. Personne sur la terre ne peut encore affirmer d’une manière absolue et générale que l’état nouveau des sociétés soit supérieur à l'état ancien ; mais il est déjà aisé de voir qu'il est autre.
Il y a de certains vices et de certaines vertus qui étaient attachés à la constitution des nations aristocratiques, et qui sont tellement contraires au génie des peuples nouveaux qu'on ne saurait les introduire dans leur sein. Il y a de bons penchants et de mauvais instincts qui étaient étrangers aux premiers et qui sont naturels aux seconds ; des idées qui se présentent d'elles-mêmes à l'imagination des uns et que l'esprit des autres rejette. Ce sont comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres.
Il faut donc bien prendre garde de juger les sociétés qui naissent avec les idées qu'on a puisées dans celles qui ne sont plus. Cela serait injuste, car ces sociétés, différant prodigieusement entre elles, sont incomparables.
Il ne serait guère plus raisonnable de demander aux hommes de notre temps les vertus particulières qui découlaient de l'état social de leurs ancêtres, puisque cet état social lui-même est tombé, et qu'il a entraîné confusément dans sa chute tous les biens et tous les maux qu'il portait avec lui.
Mais ces choses sont encore mal comprises de nos jours.
J'aperçois un grand nombre de mes contemporains qui entreprennent de faire un choix entre les institutions, les opinions, les idées qui naissaient de la constitution aristocratique de l'ancienne société ; ils abandonneraient volontiers les unes, mais ils voudraient retenir les autres et les transporter avec eux dans le monde nouveau.
Je pense que ceux-là consument leur temps et leurs forces dans un travail honnête et stérile.
Il ne s'agit plus de retenir les avantages particuliers que l'inégalité des conditions procure aux hommes, mais d’assurer les biens nouveaux que l’égalité peut leur offrir.
Nous ne devons pas tendre à nous rendre semblables à nos pères, mais nous efforcer d'atteindre l'espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre.
Pour moi qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j'avais contemplés à part en marchant, je me sens plein de craintes et plein d'espérances. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer ; de grands maux qu'on peut éviter ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir.
Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d'eux-mêmes, et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui nait des événements antérieurs, de la race, du sol ou du climat.
Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes : la Providence n'a créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir ; mais, dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre ; ainsi des peuples.
Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales ; mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.
p. 451 - 455
VUE GÉNÉRALE DU SUJET
Je voudrais, avant de quitter pour jamais la carrière que je viens de parcourir, pouvoir embrasser d'un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau, et juger enfin de l'influence générale que doit exercer l'égalité sur le sort des hommes , mais la difficulté d'une pareille entreprise m'arrête , en présence d'un si grand objet, je sens ma vue qui se trouble et ma raison qui chancelle.Cette société nouvelle, que j'ai cherché à peindre et que je veux juger, ne fait que de naître. Le temps n'en a point encore arrêté la forme , la grande révolution qui l'a créée dure encore, et, dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même, et ce qui doit rester après elle.Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et, au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d'en disparaitre.Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit encore bien loin d'être terminée, déjà on ne saurait comparer ses œuvres avec rien de ce qui s'est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'antiquité la plus reculée , je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres.Cependant, au milieu de ce tableau si vaste, si nouveau, si confus, j'entrevois déjà quelques traits principaux qui se dessinent, et je les indique : Je vois que les biens et les maux se répartissent assez également dans le monde. Les grandes richesses disparaissent , le nombre des petites fortunes s'accroît , les désirs et les jouissances se multiplient , il n'y a plus de prospérités extraordinaires ni de misères irrémédiables. L'ambition est un sentiment universel, il y a peu d'ambitions vastes. Chaque individu est isolé et faible , la société est agile, prévoyante et forte , les particuliers font de petites choses, et l'État d'immenses.Les âmes ne sont pas énergiques , mais les mœurs sont douces et les législations humaines. S'il se rencontre peu de grands dévouements, de vertus très hautes, très brillantes et très pures, les habitudes sont rangées, la violence est rare, la cruauté presque inconnue. L'existence des hommes devient plus longue et leur propriété plus sûre. La vie n'est pas très ornée, mais très aisée et très paisible. Il y a peu de plaisirs très délicats et très grossiers, peu de politesses dans les manières et peu de brutalité dans les goûts. On ne rencontre guère d'hommes très savants ni de populations très ignorantes. Le génie devient plus rare et les lumières plus communes. L'esprit humain se développe par les petits efforts combinés de tous les hommes, et non par l'impulsion puissante de quelques-uns d'entre eux. Il y a moins de perfection, mais plus de fécondité dans les œuvres. Tous les liens de race, de classe, de patrie se détendent , le grand lien de l'humanité se resserre.Si parmi tous ces traits divers, je cherche celui qui me parait le plus général et le plus frappant, j'arrive à voir que ce qui se remarque dans les fortunes se représente sous mille autres formes. Presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent , presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde.Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus.Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue , mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse : c'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ceux qu'il me plait de contempler. Il n'en est pas de même de l'Être tout-puissant et éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses, et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme.Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous : ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès , ce qui me blesse lui agrée. L'égalité est moins élevée peut-être , mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté.Je m'efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, et c'est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines. Personne sur la terre ne peut encore affirmer d’une manière absolue et générale que l’état nouveau des sociétés soit supérieur à l'état ancien , mais il est déjà aisé de voir qu'il est autre.Il y a de certains vices et de certaines vertus qui étaient attachés à la constitution des nations aristocratiques, et qui sont tellement contraires au génie des peuples nouveaux qu'on ne saurait les introduire dans leur sein. Il y a de bons penchants et de mauvais instincts qui étaient étrangers aux premiers et qui sont naturels aux seconds , des idées qui se présentent d'elles-mêmes à l'imagination des uns et que l'esprit des autres rejette. Ce sont comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres.Il faut donc bien prendre garde de juger les sociétés qui naissent avec les idées qu'on a puisées dans celles qui ne sont plus. Cela serait injuste, car ces sociétés, différant prodigieusement entre elles, sont incomparables.Il ne serait guère plus raisonnable de demander aux hommes de notre temps les vertus particulières qui découlaient de l'état social de leurs ancêtres, puisque cet état social lui-même est tombé, et qu'il a entraîné confusément dans sa chute tous les biens et tous les maux qu'il portait avec lui.Mais ces choses sont encore mal comprises de nos jours.J'aperçois un grand nombre de mes contemporains qui entreprennent de faire un choix entre les institutions, les opinions, les idées qui naissaient de la constitution aristocratique de l'ancienne société , ils abandonneraient volontiers les unes, mais ils voudraient retenir les autres et les transporter avec eux dans le monde nouveau.Je pense que ceux-là consument leur temps et leurs forces dans un travail honnête et stérile.Il ne s'agit plus de retenir les avantages particuliers que l'inégalité des conditions procure aux hommes, mais d’assurer les biens nouveaux que l’égalité peut leur offrir.Nous ne devons pas tendre à nous rendre semblables à nos pères, mais nous efforcer d'atteindre l'espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre.Pour moi qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j'avais contemplés à part en marchant, je me sens plein de craintes et plein d'espérances. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer , de grands maux qu'on peut éviter ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir.Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d'eux-mêmes, et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui nait des événements antérieurs, de la race, du sol ou du climat.Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes : la Providence n'a créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir , mais, dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre , ainsi des peuples.Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales , mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.
p. 451 - 455
Je voudrais, avant de quitter pour jamais la carrière que je viens de parcourir, pouvoir embrasser d'un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau, et juger enfin de l'influence générale que doit exercer l'égalité sur le sort des hommes , mais la difficulté d'une pareille entreprise m'arrête , en présence d'un si grand objet, je sens ma vue qui se trouble et ma raison qui chancelle.Cette société nouvelle, que j'ai cherché à peindre et que je veux juger, ne fait que de naître. Le temps n'en a point encore arrêté la forme , la grande révolution qui l'a créée dure encore, et, dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même, et ce qui doit rester après elle.Le monde qui s'élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et, au milieu de l'immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d'en disparaitre.Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit encore bien loin d'être terminée, déjà on ne saurait comparer ses œuvres avec rien de ce qui s'est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'antiquité la plus reculée , je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres.Cependant, au milieu de ce tableau si vaste, si nouveau, si confus, j'entrevois déjà quelques traits principaux qui se dessinent, et je les indique : Je vois que les biens et les maux se répartissent assez également dans le monde. Les grandes richesses disparaissent , le nombre des petites fortunes s'accroît , les désirs et les jouissances se multiplient , il n'y a plus de prospérités extraordinaires ni de misères irrémédiables. L'ambition est un sentiment universel, il y a peu d'ambitions vastes. Chaque individu est isolé et faible , la société est agile, prévoyante et forte , les particuliers font de petites choses, et l'État d'immenses.Les âmes ne sont pas énergiques , mais les mœurs sont douces et les législations humaines. S'il se rencontre peu de grands dévouements, de vertus très hautes, très brillantes et très pures, les habitudes sont rangées, la violence est rare, la cruauté presque inconnue. L'existence des hommes devient plus longue et leur propriété plus sûre. La vie n'est pas très ornée, mais très aisée et très paisible. Il y a peu de plaisirs très délicats et très grossiers, peu de politesses dans les manières et peu de brutalité dans les goûts. On ne rencontre guère d'hommes très savants ni de populations très ignorantes. Le génie devient plus rare et les lumières plus communes. L'esprit humain se développe par les petits efforts combinés de tous les hommes, et non par l'impulsion puissante de quelques-uns d'entre eux. Il y a moins de perfection, mais plus de fécondité dans les œuvres. Tous les liens de race, de classe, de patrie se détendent , le grand lien de l'humanité se resserre.Si parmi tous ces traits divers, je cherche celui qui me parait le plus général et le plus frappant, j'arrive à voir que ce qui se remarque dans les fortunes se représente sous mille autres formes. Presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent , presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde.Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus.Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue , mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse : c'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ceux qu'il me plait de contempler. Il n'en est pas de même de l'Être tout-puissant et éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses, et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme.Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous : ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès , ce qui me blesse lui agrée. L'égalité est moins élevée peut-être , mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté.Je m'efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, et c'est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines. Personne sur la terre ne peut encore affirmer d’une manière absolue et générale que l’état nouveau des sociétés soit supérieur à l'état ancien , mais il est déjà aisé de voir qu'il est autre.Il y a de certains vices et de certaines vertus qui étaient attachés à la constitution des nations aristocratiques, et qui sont tellement contraires au génie des peuples nouveaux qu'on ne saurait les introduire dans leur sein. Il y a de bons penchants et de mauvais instincts qui étaient étrangers aux premiers et qui sont naturels aux seconds , des idées qui se présentent d'elles-mêmes à l'imagination des uns et que l'esprit des autres rejette. Ce sont comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres.Il faut donc bien prendre garde de juger les sociétés qui naissent avec les idées qu'on a puisées dans celles qui ne sont plus. Cela serait injuste, car ces sociétés, différant prodigieusement entre elles, sont incomparables.Il ne serait guère plus raisonnable de demander aux hommes de notre temps les vertus particulières qui découlaient de l'état social de leurs ancêtres, puisque cet état social lui-même est tombé, et qu'il a entraîné confusément dans sa chute tous les biens et tous les maux qu'il portait avec lui.Mais ces choses sont encore mal comprises de nos jours.J'aperçois un grand nombre de mes contemporains qui entreprennent de faire un choix entre les institutions, les opinions, les idées qui naissaient de la constitution aristocratique de l'ancienne société , ils abandonneraient volontiers les unes, mais ils voudraient retenir les autres et les transporter avec eux dans le monde nouveau.Je pense que ceux-là consument leur temps et leurs forces dans un travail honnête et stérile.Il ne s'agit plus de retenir les avantages particuliers que l'inégalité des conditions procure aux hommes, mais d’assurer les biens nouveaux que l’égalité peut leur offrir.Nous ne devons pas tendre à nous rendre semblables à nos pères, mais nous efforcer d'atteindre l'espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre.Pour moi qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j'avais contemplés à part en marchant, je me sens plein de craintes et plein d'espérances. Je vois de grands périls qu'il est possible de conjurer , de grands maux qu'on peut éviter ou restreindre, et je m'affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir.Je n'ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d'eux-mêmes, et qu'ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui nait des événements antérieurs, de la race, du sol ou du climat.Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes : la Providence n'a créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir , mais, dans ses vastes limites, l'homme est puissant et libre , ainsi des peuples.Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales , mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.
p. 451 - 455
Videos de Alexis de Tocqueville (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Communiquer et monter des partenariats autour d'un espace Facile à lire
Avec Ludovic CHARRIER, coordinateur du Réseau Territoire Lecture, bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
Dans la catégorie :
Régimes démocratiquesVoir plus
>Science politique>Types d'Etats et de gouvernements>Régimes démocratiques (48)
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Alexis de Tocqueville (48)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
438 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu