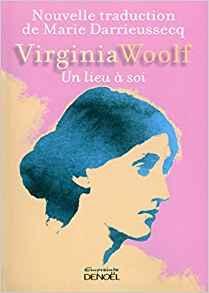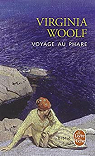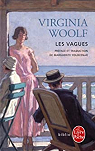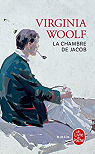Critiques filtrées sur 5 étoiles
Plus qu'un essai pour expliquer à quel point un lieu à soi est important à la créativité. J'ai pris un véritable cours d'écriture. Une révélation ! Woolf, je vous aime, vous êtes merveilleuse de génie...
Plus qu'un essai pour expliquer à quel point un lieu à soi est important à la créativité. J'ai pris un véritable cours d'écriture. Une révélation ! Woolf, je vous aime, vous êtes merveilleuse de génie...
Je n'avais jamais lu Virginia Woolf ! C'est en voyant le beau portrait d'elle sur la couverture d' « Une chambre à soi » que je me suis décidé à l'acheter. Quelle photo magnifique ! Elle a tout juste 20 ans et le portrait réalisé en 1902 est signé d'un célèbre photographe britannique nommé George Charles Beresford.
Une nouvelle traduction de Marie Darrieussecq est parue en 2016, avec un style plus vif, sous le titre « Un lieu à soi ». Ayant comparé quelques passages, je trouve la traduction de Clara Malraux plus littéraire, mais les nouvelles traductions sont utiles, elles font vivre les textes, les régénèrent en quelque sorte.
Il s'agit d'un essai à partir de conférences données dans deux collèges réservés aux femmes. On lui a demandé de parler du thème de « la femme et le roman ».
Dans la première partie l'auteure pose longuement le sujet et part dans la rêverie, les digressions et quelques poèmes où la nature a toute sa place :
« Sur l'autre rive des saules, chevelure éparse, continuaient de se lamenter. La rivière reflétait ce qui lui plaisait du ciel et du pont et de l'arbre flamboyant. »
Ensuite, elle expose ses conclusions quant à la faible représentation des femmes dans la création en général et dans la production d'oeuvres de fiction en particulier. Il leur faut « une chambre à soi » et des moyens de subsistance en propre (elle dit : cinq cents livres de rente).
Le ton est très humoristique, voire caustique. Elle se moque avec finesse et délectation des hommes de son époque, de ses professeurs, exprimant des avis péremptoires – et ridicules, lus aujourd'hui – quant à l'incapacité des femmes à devenir des artistes à l'égal des hommes.
Une bonne partie de ce petit livre de 171 pages est consacrée à combattre l'infériorité supposée des femmes : « Il est absurde de blâmer une classe ou un sexe en leur totalité. Les grands groupes humains ne sont jamais responsables de ce qu'ils font. »
Ce thème est souvent mis en avant quand on entend parler du livre et j'ai été très surpris d'y trouver bien d'autres réflexions et critiques qui n'ont pas dû faire plaisir à la bonne société de Londres dont elle était issue. La critique de l'argent pour l'argent est terrible sous sa plume : « Regardez, à la clarté du soleil printanier, l'agent de change et le grand avocat entrer dans une maison afin de gagner de l'argent, et encore de l'argent, toujours de l'argent, alors que cinq cents livres par an vous permettent de vivre à la clarté du jour. »
Ou encore :
« N'est-t-il pas absurde pourtant, pensais-je, tournant la page du journal, qu'un homme avec tout le pouvoir qu'il a, se mette en colère ? Ou bien, me demandais-je avec curiosité, la colère ne serait-elle pas quelque chose comme le démon familier, le lutin qui vous suit au pouvoir ? Les riches, par exemple, sont souvent en colère, parce qu'ils soupçonnent les pauvres de vouloir s'emparer de leurs biens ? »
Cet essai est publié pour la première fois en 1929. Virginia Woolf insiste sur le contexte historique du mouvement féministe naissant. Elle s'inscrit dans la dynamique des progrès timides réalisés : deux collèges de femmes fonctionnent depuis 1866 ; les femmes mariées ont été autorisées à posséder des biens en propre depuis 1880 et elles ont acquis le droit de vote en 1919 (les dates sont celles de Virginia Woolf dans cet essai... Il semble en fait que ce soit en 1918). Elle évoque la lutte des suffragettes ayant permis d'obtenir, par des luttes très dures depuis le début du siècle, des résultats décisifs.
Elle donne un avis très ironique et plein de courage sur la poésie et le fascisme : « Il est à craindre que le poète fasciste ne soit un affreux petit avorton tel qu'on peut en voir dans les bocaux de verre des musées provinciaux. Cette sorte de monstre ne vit jamais très longtemps, dit-on ; on n'a jamais vu ce genre de prodige brouter l'herbe d'un champ. » Il vivra assez de temps pour faire beaucoup de mal à l'humanité et la bête immonde est toujours vivante mais c'était bien vu et bien dit.
Virginia Woolf me surprend totalement. J'en étais resté à la femme dépressive, effacée, voire folle telle qu'on l'a souvent dépeinte, une sorte de romantique éthérée et passée de mode. Autant dire que je ne me sentais pas du tout attiré pour la lire. Je découvre une femme engagée, à l'honnêteté totale, à la critique joyeuse, qui va remonter les troupes dans les collèges, elle qui demande aux jeunes filles venues écouter ses conférences « de diriger le monde vers des fins plus hautes. »
La Pléiade a édité, en 2012, l'intégralité de son oeuvre romanesque en 2 tomes, laissant curieusement de côté tous ses autres écrits, essais, articles, textes expérimentaux... Virginie Despentes s'était alarmée de l'absence de « La chambre à soi ». On voit bien pourtant le côté moderne de cet essai. On peut aussi s'étonner des images de dépressive et de folle qui lui ont collé à la peau très longtemps. Il n'est pourtant pas difficile de trouver bien des éléments dans sa vie qui ont dû peser lourd dans cette décision de 1941, de se suicider par noyade – elle a alors 59 ans. Elle a bataillé dur toute sa vie, tellement en avance et à contre-courant sur son milieu social et son époque. Les disparitions familiales ainsi qu'une reconnaissance partielle de son oeuvre ont dû jouer également, sans oublier son mari juif dans un contexte d'antisémitisme nazi et pas seulement... Nul doute que sa modernité, son exigence artistique, n'ont pas dû être faciles à assumer. Elle rejoint, en partie, Stéphan Zweig dans cette voie, dont on n'a jamais dit qu'il était fou. Peut-être est-ce une façon de discréditer une voix rebelle, une femme revendiquant sa liberté par rapport aux hommes, que de mettre en avant des troubles mentaux. Cela m'évoque Camille Claudel... et aussi l'hystérie dont on accusait bien des femmes, façon de disqualifier en refusant l'écoute.
C'est un livre édifiant et une lecture passionnante, un beau texte en lien avec les luttes féministes toujours actuelles. J'ai eu le sentiment de lire une auteure majeure du 20ème siècle – les rééditions, les films, les émissions de radio dont celle d'Adèle van Reeth sur France Culture cette semaine, voire les chansons et musiques lui rendant hommage en témoignent, avec une influence sur la culture encore cent ans après, comme elle le prédit pour ces femmes conquérantes dont elle fait partie.
*****
Pour avoir les illustrations, ainsi que la musique "For Virginia" du jazzman Sébastien Lovato, visitez mon blog clesbibliofeel. A bientôt !
Lien : https://clesbibliofeel.blog
Une nouvelle traduction de Marie Darrieussecq est parue en 2016, avec un style plus vif, sous le titre « Un lieu à soi ». Ayant comparé quelques passages, je trouve la traduction de Clara Malraux plus littéraire, mais les nouvelles traductions sont utiles, elles font vivre les textes, les régénèrent en quelque sorte.
Il s'agit d'un essai à partir de conférences données dans deux collèges réservés aux femmes. On lui a demandé de parler du thème de « la femme et le roman ».
Dans la première partie l'auteure pose longuement le sujet et part dans la rêverie, les digressions et quelques poèmes où la nature a toute sa place :
« Sur l'autre rive des saules, chevelure éparse, continuaient de se lamenter. La rivière reflétait ce qui lui plaisait du ciel et du pont et de l'arbre flamboyant. »
Ensuite, elle expose ses conclusions quant à la faible représentation des femmes dans la création en général et dans la production d'oeuvres de fiction en particulier. Il leur faut « une chambre à soi » et des moyens de subsistance en propre (elle dit : cinq cents livres de rente).
Le ton est très humoristique, voire caustique. Elle se moque avec finesse et délectation des hommes de son époque, de ses professeurs, exprimant des avis péremptoires – et ridicules, lus aujourd'hui – quant à l'incapacité des femmes à devenir des artistes à l'égal des hommes.
Une bonne partie de ce petit livre de 171 pages est consacrée à combattre l'infériorité supposée des femmes : « Il est absurde de blâmer une classe ou un sexe en leur totalité. Les grands groupes humains ne sont jamais responsables de ce qu'ils font. »
Ce thème est souvent mis en avant quand on entend parler du livre et j'ai été très surpris d'y trouver bien d'autres réflexions et critiques qui n'ont pas dû faire plaisir à la bonne société de Londres dont elle était issue. La critique de l'argent pour l'argent est terrible sous sa plume : « Regardez, à la clarté du soleil printanier, l'agent de change et le grand avocat entrer dans une maison afin de gagner de l'argent, et encore de l'argent, toujours de l'argent, alors que cinq cents livres par an vous permettent de vivre à la clarté du jour. »
Ou encore :
« N'est-t-il pas absurde pourtant, pensais-je, tournant la page du journal, qu'un homme avec tout le pouvoir qu'il a, se mette en colère ? Ou bien, me demandais-je avec curiosité, la colère ne serait-elle pas quelque chose comme le démon familier, le lutin qui vous suit au pouvoir ? Les riches, par exemple, sont souvent en colère, parce qu'ils soupçonnent les pauvres de vouloir s'emparer de leurs biens ? »
Cet essai est publié pour la première fois en 1929. Virginia Woolf insiste sur le contexte historique du mouvement féministe naissant. Elle s'inscrit dans la dynamique des progrès timides réalisés : deux collèges de femmes fonctionnent depuis 1866 ; les femmes mariées ont été autorisées à posséder des biens en propre depuis 1880 et elles ont acquis le droit de vote en 1919 (les dates sont celles de Virginia Woolf dans cet essai... Il semble en fait que ce soit en 1918). Elle évoque la lutte des suffragettes ayant permis d'obtenir, par des luttes très dures depuis le début du siècle, des résultats décisifs.
Elle donne un avis très ironique et plein de courage sur la poésie et le fascisme : « Il est à craindre que le poète fasciste ne soit un affreux petit avorton tel qu'on peut en voir dans les bocaux de verre des musées provinciaux. Cette sorte de monstre ne vit jamais très longtemps, dit-on ; on n'a jamais vu ce genre de prodige brouter l'herbe d'un champ. » Il vivra assez de temps pour faire beaucoup de mal à l'humanité et la bête immonde est toujours vivante mais c'était bien vu et bien dit.
Virginia Woolf me surprend totalement. J'en étais resté à la femme dépressive, effacée, voire folle telle qu'on l'a souvent dépeinte, une sorte de romantique éthérée et passée de mode. Autant dire que je ne me sentais pas du tout attiré pour la lire. Je découvre une femme engagée, à l'honnêteté totale, à la critique joyeuse, qui va remonter les troupes dans les collèges, elle qui demande aux jeunes filles venues écouter ses conférences « de diriger le monde vers des fins plus hautes. »
La Pléiade a édité, en 2012, l'intégralité de son oeuvre romanesque en 2 tomes, laissant curieusement de côté tous ses autres écrits, essais, articles, textes expérimentaux... Virginie Despentes s'était alarmée de l'absence de « La chambre à soi ». On voit bien pourtant le côté moderne de cet essai. On peut aussi s'étonner des images de dépressive et de folle qui lui ont collé à la peau très longtemps. Il n'est pourtant pas difficile de trouver bien des éléments dans sa vie qui ont dû peser lourd dans cette décision de 1941, de se suicider par noyade – elle a alors 59 ans. Elle a bataillé dur toute sa vie, tellement en avance et à contre-courant sur son milieu social et son époque. Les disparitions familiales ainsi qu'une reconnaissance partielle de son oeuvre ont dû jouer également, sans oublier son mari juif dans un contexte d'antisémitisme nazi et pas seulement... Nul doute que sa modernité, son exigence artistique, n'ont pas dû être faciles à assumer. Elle rejoint, en partie, Stéphan Zweig dans cette voie, dont on n'a jamais dit qu'il était fou. Peut-être est-ce une façon de discréditer une voix rebelle, une femme revendiquant sa liberté par rapport aux hommes, que de mettre en avant des troubles mentaux. Cela m'évoque Camille Claudel... et aussi l'hystérie dont on accusait bien des femmes, façon de disqualifier en refusant l'écoute.
C'est un livre édifiant et une lecture passionnante, un beau texte en lien avec les luttes féministes toujours actuelles. J'ai eu le sentiment de lire une auteure majeure du 20ème siècle – les rééditions, les films, les émissions de radio dont celle d'Adèle van Reeth sur France Culture cette semaine, voire les chansons et musiques lui rendant hommage en témoignent, avec une influence sur la culture encore cent ans après, comme elle le prédit pour ces femmes conquérantes dont elle fait partie.
*****
Pour avoir les illustrations, ainsi que la musique "For Virginia" du jazzman Sébastien Lovato, visitez mon blog clesbibliofeel. A bientôt !
Lien : https://clesbibliofeel.blog
J'écoutais récemment un podcast des masterclass littéraires de France Inter avec pour invitée Maylis de de Kerangal, auteure d'une dizaine de romans tels que Corniche Kennedy, Naissance d'un pont et Réparer les vivants pour ne citer que les plus connus. Alors qu'elle nous parlait de ses méthodes et habitudes d'écriture, un élément m'a frappé. Elle dispose d'une petite chambre de bonne qu'elle occupe pour écrire. Un lieu où elle est libre de penser, dormir, réfléchir, écrire. Un lieu où elle peut fumer à loisir et laisser son regard se perdre en regardant par la fenêtre. Un lieu loin des distractions du quotidien et des interruptions que nous impose la vie. Un lieu calme et privé. Un lieu… à soi.
Voilà exactement la thèse qu'avance Virginia Woolf dans son essai, lorsqu'un collège prestigieux lui demande de donner une conférence sur la production (ou plutôt le trop peu) de fiction féminine : pendant la plus grande partie de l'histoire, les femmes ont été privées de deux éléments clefs pour l'imagination et la rédaction de pièces de théâtre, de romans de poésie et d'ouvrages en tout genre. La première, une somme suffisante dont elles peuvent disposer personnellement – en d'autres termes, pas gérée par un mari qui décide pour soi – qui leur laisse le temps de se consacrer à leur travail. La seconde, un endroit privé et exclusif pour se retirer et demeurer seule avec leurs pensées, leurs idées et leurs réflexions. Notons que dans cette nouvelle traduction de A room of one's own, le terme « room » a été traduit par « lieu » à défaut du mot « chambre », qui renvoyait déjà aux enfants, à la maison, la famille ou la chambre commune. Je trouve le terme de lieu plus juste, s'élargissant à la possibilité d'un bureau, d'une salle d'étude ou même d'un café.
"La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, pas seulement depuis deux cents ans, mais depuis le début des temps."
Au cours de plusieurs promenades, dîners et après-midis consacrés aux études, Virginia Woolf mène une réflexion approfondie et tente d'expliquer pourquoi, depuis toujours, les femmes ont toujours été mises au second plan. Shakespeare a eu la chance de devenir l'un des plus grandes dramaturges du monde, mais pas sa soeur. Peut-être n'avait-elle pas son génie, mais elle n'est aussi jamais allée étudier le latin en lisant Horace, Virgile et Ovide. le talent est une chose, mais la grande différence réside dans l'inégalité fondamentale instaurée entre les deux sexes depuis le début de notre histoire.
"Quels encouragements supplémentaires puis-je vous donner pour plonger dans le chantier de la vie ? Jeunes femmes, pourrais-je dire (…) vous êtes à mon avis détestablement ignorantes. Vous n'avez jamais fait aucune découverte d'une quelconque importance. Vous n'avez jamais ébranlé un empire ou mené une armée au front. Les pièces de Shakespeare ne sont pas de vous, et vous n'avez jamais introduit une race barbare aux bienfaits de la civilisation. Quelle est votre excuse ? (…) Nous avons eu bien autre chose à faire."
"Sans notre travail à nous, ces mers resteraient inexplorées et ces terres fertiles seraient un désert. Nous avons mis au monde et nourri et lavé et éduqué, jusque vers l'âge de six ou sept ans, le milliard et six cent vingt-trois millions d'êtres humains qui sont, selon les statistiques, en ce moment présent à l'existence ; et ça, même en admettant que certaines avaient de l'aide, ça prend du temps."
Un essai plein d'intelligence qui ne tombe pas dans la critique pure et dure du patriarcat d'une manière vindicative. Les choses sont comme elles sont, il ne sert à rien de chercher des coupables chez les hommes ou les femmes. L'importance et de prendre conscience de la totale égalité de nos âmes et de nos inspirations. Selon Woolf, l'homme et la femme sont différents, mais nous avons tous une part de masculin et de féminin en nous. Écrire avec uniquement l'un de ces deux côtés mène forcément à un appauvrissement de notre oeuvre : il manque une dimension de féminité aux hommes, comme il manque une dimension de masculinité aux femmes. Femmes, hommes, citoyens du monde, empressez-vous de lire cet essai qui fait fit de la haine et de la rancune pour faire avancer la littérature ensemble, peu importe votre sexe.
"Alors l'occasion viendra et la poétesse morte qui était la soeur de Shakespeare revêtira ce corps si souvent tombé. Tirant sa vie des inconnues qui l'ont précédée, comme fit son frère avant elle, elle naîtra. Mais nous ne pouvons compter sur sa venue sans cette préparation, sans cet effort de votre part, sans cette détermination qu'une fois revenue à la vie elle trouve possible de vivre et d'écrire sa poésie, car sinon ce serait impossible. Mais je maintiens qu'elle viendra si nous travaillons pour elle, et que ce travail, même dans la pauvreté et l'obscurité, vaut la peine."
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Voilà exactement la thèse qu'avance Virginia Woolf dans son essai, lorsqu'un collège prestigieux lui demande de donner une conférence sur la production (ou plutôt le trop peu) de fiction féminine : pendant la plus grande partie de l'histoire, les femmes ont été privées de deux éléments clefs pour l'imagination et la rédaction de pièces de théâtre, de romans de poésie et d'ouvrages en tout genre. La première, une somme suffisante dont elles peuvent disposer personnellement – en d'autres termes, pas gérée par un mari qui décide pour soi – qui leur laisse le temps de se consacrer à leur travail. La seconde, un endroit privé et exclusif pour se retirer et demeurer seule avec leurs pensées, leurs idées et leurs réflexions. Notons que dans cette nouvelle traduction de A room of one's own, le terme « room » a été traduit par « lieu » à défaut du mot « chambre », qui renvoyait déjà aux enfants, à la maison, la famille ou la chambre commune. Je trouve le terme de lieu plus juste, s'élargissant à la possibilité d'un bureau, d'une salle d'étude ou même d'un café.
"La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, pas seulement depuis deux cents ans, mais depuis le début des temps."
Au cours de plusieurs promenades, dîners et après-midis consacrés aux études, Virginia Woolf mène une réflexion approfondie et tente d'expliquer pourquoi, depuis toujours, les femmes ont toujours été mises au second plan. Shakespeare a eu la chance de devenir l'un des plus grandes dramaturges du monde, mais pas sa soeur. Peut-être n'avait-elle pas son génie, mais elle n'est aussi jamais allée étudier le latin en lisant Horace, Virgile et Ovide. le talent est une chose, mais la grande différence réside dans l'inégalité fondamentale instaurée entre les deux sexes depuis le début de notre histoire.
"Quels encouragements supplémentaires puis-je vous donner pour plonger dans le chantier de la vie ? Jeunes femmes, pourrais-je dire (…) vous êtes à mon avis détestablement ignorantes. Vous n'avez jamais fait aucune découverte d'une quelconque importance. Vous n'avez jamais ébranlé un empire ou mené une armée au front. Les pièces de Shakespeare ne sont pas de vous, et vous n'avez jamais introduit une race barbare aux bienfaits de la civilisation. Quelle est votre excuse ? (…) Nous avons eu bien autre chose à faire."
"Sans notre travail à nous, ces mers resteraient inexplorées et ces terres fertiles seraient un désert. Nous avons mis au monde et nourri et lavé et éduqué, jusque vers l'âge de six ou sept ans, le milliard et six cent vingt-trois millions d'êtres humains qui sont, selon les statistiques, en ce moment présent à l'existence ; et ça, même en admettant que certaines avaient de l'aide, ça prend du temps."
Un essai plein d'intelligence qui ne tombe pas dans la critique pure et dure du patriarcat d'une manière vindicative. Les choses sont comme elles sont, il ne sert à rien de chercher des coupables chez les hommes ou les femmes. L'importance et de prendre conscience de la totale égalité de nos âmes et de nos inspirations. Selon Woolf, l'homme et la femme sont différents, mais nous avons tous une part de masculin et de féminin en nous. Écrire avec uniquement l'un de ces deux côtés mène forcément à un appauvrissement de notre oeuvre : il manque une dimension de féminité aux hommes, comme il manque une dimension de masculinité aux femmes. Femmes, hommes, citoyens du monde, empressez-vous de lire cet essai qui fait fit de la haine et de la rancune pour faire avancer la littérature ensemble, peu importe votre sexe.
"Alors l'occasion viendra et la poétesse morte qui était la soeur de Shakespeare revêtira ce corps si souvent tombé. Tirant sa vie des inconnues qui l'ont précédée, comme fit son frère avant elle, elle naîtra. Mais nous ne pouvons compter sur sa venue sans cette préparation, sans cet effort de votre part, sans cette détermination qu'une fois revenue à la vie elle trouve possible de vivre et d'écrire sa poésie, car sinon ce serait impossible. Mais je maintiens qu'elle viendra si nous travaillons pour elle, et que ce travail, même dans la pauvreté et l'obscurité, vaut la peine."
Lien : https://www.instagram.com/p/..
J'écoutais récemment un podcast des masterclass littéraires de France Inter avec pour invitée Maylis de de Kerangal, auteure d'une dizaine de romans tels que Corniche Kennedy, Naissance d'un pont et Réparer les vivants pour ne citer que les plus connus. Alors qu'elle nous parlait de ses méthodes et habitudes d'écriture, un élément m'a frappé. Elle dispose d'une petite chambre de bonne qu'elle occupe pour écrire. Un lieu où elle est libre de penser, dormir, réfléchir, écrire. Un lieu où elle peut fumer à loisir et laisser son regard se perdre en regardant par la fenêtre. Un lieu loin des distractions du quotidien et des interruptions que nous impose la vie. Un lieu calme et privé. Un lieu… à soi.
Voilà exactement la thèse qu'avance Virginia Woolf dans son essai, lorsqu'un collège prestigieux lui demande de donner une conférence sur la production (ou plutôt le trop peu) de fiction féminine : pendant la plus grande partie de l'histoire, les femmes ont été privées de deux éléments clefs pour l'imagination et la rédaction de pièces de théâtre, de romans de poésie et d'ouvrages en tout genre. La première, une somme suffisante dont elles peuvent disposer personnellement – en d'autres termes, pas gérée par un mari qui décide pour soi – qui leur laisse le temps de se consacrer à leur travail. La seconde, un endroit privé et exclusif pour se retirer et demeurer seule avec leurs pensées, leurs idées et leurs réflexions. Notons que dans cette nouvelle traduction de A room of one's own, le terme « room » a été traduit par « lieu » à défaut du mot « chambre », qui renvoyait déjà aux enfants, à la maison, la famille ou la chambre commune. Je trouve le terme de lieu plus juste, s'élargissant à la possibilité d'un bureau, d'une salle d'étude ou même d'un café.
La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, pas seulement depuis deux cents ans, mais depuis le début des temps.
Au cours de plusieurs promenades, dîners et après-midis consacrés aux études, Virginia Woolf mène une réflexion approfondie et tente d'expliquer pourquoi, depuis toujours, les femmes ont toujours été mises au second plan. Shakespeare a eu la chance de devenir l'un des plus grandes dramaturges du monde, mais pas sa soeur. Peut-être n'avait-elle pas son génie, mais elle n'est aussi jamais allée étudier le latin en lisant Horace, Virgile et Ovide. le talent est une chose, mais la grande différence réside dans l'inégalité fondamentale instaurée entre les deux sexes depuis le début de notre histoire.
"Quels encouragements supplémentaires puis-je vous donner pour plonger dans le chantier de la vie ? Jeunes femmes, pourrais-je dire (…) vous êtes à mon avis détestablement ignorantes. Vous n'avez jamais fait aucune découverte d'une quelconque importance. Vous n'avez jamais ébranlé un empire ou mené une armée au front. Les pièces de Shakespeare ne sont pas de vous, et vous n'avez jamais introduit une race barbare aux bienfaits de la civilisation. Quelle est votre excuse ? (…) Nous avons eu bien autre chose à faire."
"Sans notre travail à nous, ces mers resteraient inexplorées et ces terres fertiles seraient un désert. Nous avons mis au monde et nourri et lavé et éduqué, jusque vers l'âge de six ou sept ans, le milliard et six cent vingt-trois millions d'êtres humains qui sont, selon les statistiques, en ce moment présent à l'existence ; et ça, même en admettant que certaines avaient de l'aide, ça prend du temps."
Un essai plein d'intelligence qui ne tombe pas dans la critique pure et dure du patriarcat d'une manière vindicative. Les choses sont comme elles sont, il ne sert à rien de chercher des coupables chez les hommes ou les femmes. L'importance et de prendre conscience de la totale égalité de nos âmes et de nos inspirations. Selon Woolf, l'homme et la femme sont différents, mais nous avons tous une part de masculin et de féminin en nous. Écrire avec uniquement l'un de ces deux côtés mène forcément à un appauvrissement de notre oeuvre : il manque une dimension de féminité aux hommes, comme il manque une dimension de masculinité aux femmes. Femmes, hommes, citoyens du monde, empressez-vous de lire cet essai qui fait fit de la haine et de la rancune pour faire avancer la littérature ensemble, peu importe votre sexe.
"Alors l'occasion viendra et la poétesse morte qui était la soeur de Shakespeare revêtira ce corps si souvent tombé. Tirant sa vie des inconnues qui l'ont précédée, comme fit son frère avant elle, elle naîtra. Mais nous ne pouvons compter sur sa venue sans cette préparation, sans cet effort de votre part, sans cette détermination qu'une fois revenue à la vie elle trouve possible de vivre et d'écrire sa poésie, car sinon ce serait impossible. Mais je maintiens qu'elle viendra si nous travaillons pour elle, et que ce travail, même dans la pauvreté et l'obscurité, vaut la peine."
Lien : https://www.instagram.com/p/..
Voilà exactement la thèse qu'avance Virginia Woolf dans son essai, lorsqu'un collège prestigieux lui demande de donner une conférence sur la production (ou plutôt le trop peu) de fiction féminine : pendant la plus grande partie de l'histoire, les femmes ont été privées de deux éléments clefs pour l'imagination et la rédaction de pièces de théâtre, de romans de poésie et d'ouvrages en tout genre. La première, une somme suffisante dont elles peuvent disposer personnellement – en d'autres termes, pas gérée par un mari qui décide pour soi – qui leur laisse le temps de se consacrer à leur travail. La seconde, un endroit privé et exclusif pour se retirer et demeurer seule avec leurs pensées, leurs idées et leurs réflexions. Notons que dans cette nouvelle traduction de A room of one's own, le terme « room » a été traduit par « lieu » à défaut du mot « chambre », qui renvoyait déjà aux enfants, à la maison, la famille ou la chambre commune. Je trouve le terme de lieu plus juste, s'élargissant à la possibilité d'un bureau, d'une salle d'étude ou même d'un café.
La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, pas seulement depuis deux cents ans, mais depuis le début des temps.
Au cours de plusieurs promenades, dîners et après-midis consacrés aux études, Virginia Woolf mène une réflexion approfondie et tente d'expliquer pourquoi, depuis toujours, les femmes ont toujours été mises au second plan. Shakespeare a eu la chance de devenir l'un des plus grandes dramaturges du monde, mais pas sa soeur. Peut-être n'avait-elle pas son génie, mais elle n'est aussi jamais allée étudier le latin en lisant Horace, Virgile et Ovide. le talent est une chose, mais la grande différence réside dans l'inégalité fondamentale instaurée entre les deux sexes depuis le début de notre histoire.
"Quels encouragements supplémentaires puis-je vous donner pour plonger dans le chantier de la vie ? Jeunes femmes, pourrais-je dire (…) vous êtes à mon avis détestablement ignorantes. Vous n'avez jamais fait aucune découverte d'une quelconque importance. Vous n'avez jamais ébranlé un empire ou mené une armée au front. Les pièces de Shakespeare ne sont pas de vous, et vous n'avez jamais introduit une race barbare aux bienfaits de la civilisation. Quelle est votre excuse ? (…) Nous avons eu bien autre chose à faire."
"Sans notre travail à nous, ces mers resteraient inexplorées et ces terres fertiles seraient un désert. Nous avons mis au monde et nourri et lavé et éduqué, jusque vers l'âge de six ou sept ans, le milliard et six cent vingt-trois millions d'êtres humains qui sont, selon les statistiques, en ce moment présent à l'existence ; et ça, même en admettant que certaines avaient de l'aide, ça prend du temps."
Un essai plein d'intelligence qui ne tombe pas dans la critique pure et dure du patriarcat d'une manière vindicative. Les choses sont comme elles sont, il ne sert à rien de chercher des coupables chez les hommes ou les femmes. L'importance et de prendre conscience de la totale égalité de nos âmes et de nos inspirations. Selon Woolf, l'homme et la femme sont différents, mais nous avons tous une part de masculin et de féminin en nous. Écrire avec uniquement l'un de ces deux côtés mène forcément à un appauvrissement de notre oeuvre : il manque une dimension de féminité aux hommes, comme il manque une dimension de masculinité aux femmes. Femmes, hommes, citoyens du monde, empressez-vous de lire cet essai qui fait fit de la haine et de la rancune pour faire avancer la littérature ensemble, peu importe votre sexe.
"Alors l'occasion viendra et la poétesse morte qui était la soeur de Shakespeare revêtira ce corps si souvent tombé. Tirant sa vie des inconnues qui l'ont précédée, comme fit son frère avant elle, elle naîtra. Mais nous ne pouvons compter sur sa venue sans cette préparation, sans cet effort de votre part, sans cette détermination qu'une fois revenue à la vie elle trouve possible de vivre et d'écrire sa poésie, car sinon ce serait impossible. Mais je maintiens qu'elle viendra si nous travaillons pour elle, et que ce travail, même dans la pauvreté et l'obscurité, vaut la peine."
Lien : https://www.instagram.com/p/..
On retrouve dans ce petit livre le style de Virginia Woolf, allant au gré de ses réflexions. Il faut à la fois lâcher prise pour la suivre et rester concentré pour bien saisir la portée de ce qu'elle défend, portée considérable en 1928, dans une Grande Bretagne à peine sortie du carcan elisabetain.
C'est dense et la démonstration est magistrale, sur les obstacles considérables qu'ont pu rencontrer toute les femmes pour exercer leur créativité, et encore plus pour vivre de leur art. de l'humour et de l'ironie ajoutent à la pertinence du propos, ce qui en rend la lecture des plus plaisante.
Les idées reçues masculines, en particulier chez les auteurs, le carcan social et financier, les tentatives de contrer toute initiative féminine hors du rôle assigné, sont passées en revue : je comprends maintenant la place fondamentale de Virginia Woolf dans le féminisme moderne.
C'est dense et la démonstration est magistrale, sur les obstacles considérables qu'ont pu rencontrer toute les femmes pour exercer leur créativité, et encore plus pour vivre de leur art. de l'humour et de l'ironie ajoutent à la pertinence du propos, ce qui en rend la lecture des plus plaisante.
Les idées reçues masculines, en particulier chez les auteurs, le carcan social et financier, les tentatives de contrer toute initiative féminine hors du rôle assigné, sont passées en revue : je comprends maintenant la place fondamentale de Virginia Woolf dans le féminisme moderne.
La primera vez que leí este ensayo feminista, me lo tomé como algo muy personal porque ella me apasiona. Hoy os lo recomiendo un millón de veces. A cualquiera de vosotr@s, que estáis en esa búsqueda de una habitación propia, de un camino que recorrer con paso firme y a l@s que vivís para crear.
On ressort de cette lecture avec l'impression vivante d'avoir partagé un moment avec une femme d'exception, dont l'écriture porte la pensée dans un souffle naturel et lumineux.
Voilà quelques jours, je suis tombée sur « La Grande Traversée » de France culture, une émission retraçant en cinq épisodes de deux heures la vie et l'oeuvre de la brillante Virginia Woolf. J'en ai été autant bouleversée qu'émerveillée et suis entrée dans une sorte « d'obsession » pour l'écrivaine, la femme et la grande féministe qu'elle était. Je me suis mise à écouter et lire tout ce que je pouvais attraper au vol à son sujet, ai eu le sentiment de percevoir la vie - la réalité comme elle l'appelle – sous un angle bien différent, me suis sentie infiniment proche d'elle et me suis précipitée à la librairie pour acheter son superbe essai : Une chambre à soi, ouvrage culte s'il en est et merveille d'écriture.
Virginia Woolf m'avait effectivement toujours fascinée. Elle portait encore, collée contre sa peau, cette image de petite chose frêle, éthérée et déprimée, vivant pour et par la littérature dans un savoureux mélange qui, pour les chroniqueurs de l'époque et nombre de ses biographes, ne pouvait finir que par un suicide…Tout en étant couverte d'un voile mystérieux qui ne demandait qu'à s'ôter.
J'avais bien entendu vu (et aimé) le film The Hours de Stephan Daldry, mais je n'avais jamais réussi à aller au bout de Mrs Dalloway pour une raison qui m'échappe encore.
C'est sans doute mieux car c'est, dotée de ce très beau bagage de connaissance (les dizaines d'heures d'émissions écoutées en quelques jours), que je recommence mon petit bout de chemin avec Virginia. J'ai le sentiment d'avoir appris à la connaître, à l'apprivoiser, d'avoir compris son fonctionnement, mais surtout, son immense force (malgré toutes les étiquettes que l'on a pu lui coller), la pureté de sa langue, et sa puissance littéraire. J'ai redécouvert une écrivaine bravant les conventions avec une magnifique ironie, une femme infiniment libre, une acrobate de la littérature voltigeant entre les styles et les genres, une funambule de génie cheminant entre l'imaginaire et le réel, l'amour et la haine, le calme et la folie. Une iconoclaste somme toute, une frondeuse, une femme hautement inflammable.
Dans Une chambre à soi, Virginia Woolf analyse avec ironie, force et légèreté, les causes du silence littéraire des femmes pendant de très nombreuses décennies. Elle rappelle comment, jusqu'à une époque toute récente (qui semble parfois résonner encore aujourd'hui), les femmes étaient savamment placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et nécessairement réduites au silence. Elle développe une théorie selon laquelle ce dont elles auraient « simplement » eu besoin pour affirmer leur génie et développer leur talent, était du temps, de l'argent (la capacité de le gagner seule, entend-elle) et une chambre à elles.
Une chambre à soi, c'est le cheminement de Virginia Woolf sur le sujet : Les femmes et le roman.
Son questionnement, elle l'entame au bord d'une rivière (celle qui la vit se donner la mort) et le poursuit dans le parc de l'université. Elle se voit refoulée à l'entrée de la bibliothèque universitaire en tant que femme non accompagnée, puis se retranche chez elle, observant depuis sa fenêtre le tout Londres se mouvoir à ses pieds.
Pourquoi y a-t-il si peu, voire pas du tout, de femmes écrivains jusqu'au XVIIIème siècle ? Et pourquoi, au milieu du XXème siècle, celles qui résistent ont tant de peine à faire éclater leur génie et leur puissance ?
Virginia aborde avec force et fantaisie le peu de liberté accordée aux femmes, leur dépendance financière, leur manque d'instruction, la nécessité de garder leur vertu, leur réclusion dans les maisons et toutes les considérations masculines plaidant en défaveur des femmes créatrices :
« Tous ces siècles, les femmes ont servi de miroirs, dotés du pouvoir magique et délicieux de refléter la figure de l'homme en doublant ses dimensions naturelles ».
Le tout se trouve cité avec un humour et une ironie délicieusement anglaise. Une chambre à soi se transforme autant en véritable petit plaisir de lecture qu'en admirable réflexion sur la femme et la littérature de manière générale. On y découvre son admiration pour Shakespeare, Jane Austen, Charlotte Brontë, on se trouve baigné dans son univers empli de poésie, chahuté dans ses combats radicalement féministes, emporté par sa verve et sa force.
Virginia Woolf, au travers de ce superbe essai, se donne les moyens de vivre encore un peu en nous toutes. Délicatement, elle nous tape sur l'épaule alors que nous faisons la vaisselle ou couchons les enfants, et nous rappelle la force des mots.
Elle nous rappelle que si nous parvenons à gagner « cinq cent livres » par an,
à nous ménager une chambre à nous, fermée à clefs dans laquelle, comme les hommes dans leur bureau, nous ne serons pas en permanence dérangées,
si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons,
si nous parvenons à échapper un peu au salon commun,
si nous apprenons à voir les humains non pas seulement dans leurs rapports avec les autres mais dans leur rapport avec la réalité, avec « la vie vivifiante », avec le ciel, avec la terre, avec le Beau,
si nous parvenons à regarder plus loin,
à marcher seule,
à comprendre que nous aussi, nous sommes en relation avec le monde,
alors la poétesse qui est en chaque femme (quelle qu'en soit la forme prise) pourra jaillir avec une puissance infinie.
Lien : http://www.mespetiteschroniq..
Virginia Woolf m'avait effectivement toujours fascinée. Elle portait encore, collée contre sa peau, cette image de petite chose frêle, éthérée et déprimée, vivant pour et par la littérature dans un savoureux mélange qui, pour les chroniqueurs de l'époque et nombre de ses biographes, ne pouvait finir que par un suicide…Tout en étant couverte d'un voile mystérieux qui ne demandait qu'à s'ôter.
J'avais bien entendu vu (et aimé) le film The Hours de Stephan Daldry, mais je n'avais jamais réussi à aller au bout de Mrs Dalloway pour une raison qui m'échappe encore.
C'est sans doute mieux car c'est, dotée de ce très beau bagage de connaissance (les dizaines d'heures d'émissions écoutées en quelques jours), que je recommence mon petit bout de chemin avec Virginia. J'ai le sentiment d'avoir appris à la connaître, à l'apprivoiser, d'avoir compris son fonctionnement, mais surtout, son immense force (malgré toutes les étiquettes que l'on a pu lui coller), la pureté de sa langue, et sa puissance littéraire. J'ai redécouvert une écrivaine bravant les conventions avec une magnifique ironie, une femme infiniment libre, une acrobate de la littérature voltigeant entre les styles et les genres, une funambule de génie cheminant entre l'imaginaire et le réel, l'amour et la haine, le calme et la folie. Une iconoclaste somme toute, une frondeuse, une femme hautement inflammable.
Dans Une chambre à soi, Virginia Woolf analyse avec ironie, force et légèreté, les causes du silence littéraire des femmes pendant de très nombreuses décennies. Elle rappelle comment, jusqu'à une époque toute récente (qui semble parfois résonner encore aujourd'hui), les femmes étaient savamment placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et nécessairement réduites au silence. Elle développe une théorie selon laquelle ce dont elles auraient « simplement » eu besoin pour affirmer leur génie et développer leur talent, était du temps, de l'argent (la capacité de le gagner seule, entend-elle) et une chambre à elles.
Une chambre à soi, c'est le cheminement de Virginia Woolf sur le sujet : Les femmes et le roman.
Son questionnement, elle l'entame au bord d'une rivière (celle qui la vit se donner la mort) et le poursuit dans le parc de l'université. Elle se voit refoulée à l'entrée de la bibliothèque universitaire en tant que femme non accompagnée, puis se retranche chez elle, observant depuis sa fenêtre le tout Londres se mouvoir à ses pieds.
Pourquoi y a-t-il si peu, voire pas du tout, de femmes écrivains jusqu'au XVIIIème siècle ? Et pourquoi, au milieu du XXème siècle, celles qui résistent ont tant de peine à faire éclater leur génie et leur puissance ?
Virginia aborde avec force et fantaisie le peu de liberté accordée aux femmes, leur dépendance financière, leur manque d'instruction, la nécessité de garder leur vertu, leur réclusion dans les maisons et toutes les considérations masculines plaidant en défaveur des femmes créatrices :
« Tous ces siècles, les femmes ont servi de miroirs, dotés du pouvoir magique et délicieux de refléter la figure de l'homme en doublant ses dimensions naturelles ».
Le tout se trouve cité avec un humour et une ironie délicieusement anglaise. Une chambre à soi se transforme autant en véritable petit plaisir de lecture qu'en admirable réflexion sur la femme et la littérature de manière générale. On y découvre son admiration pour Shakespeare, Jane Austen, Charlotte Brontë, on se trouve baigné dans son univers empli de poésie, chahuté dans ses combats radicalement féministes, emporté par sa verve et sa force.
Virginia Woolf, au travers de ce superbe essai, se donne les moyens de vivre encore un peu en nous toutes. Délicatement, elle nous tape sur l'épaule alors que nous faisons la vaisselle ou couchons les enfants, et nous rappelle la force des mots.
Elle nous rappelle que si nous parvenons à gagner « cinq cent livres » par an,
à nous ménager une chambre à nous, fermée à clefs dans laquelle, comme les hommes dans leur bureau, nous ne serons pas en permanence dérangées,
si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons,
si nous parvenons à échapper un peu au salon commun,
si nous apprenons à voir les humains non pas seulement dans leurs rapports avec les autres mais dans leur rapport avec la réalité, avec « la vie vivifiante », avec le ciel, avec la terre, avec le Beau,
si nous parvenons à regarder plus loin,
à marcher seule,
à comprendre que nous aussi, nous sommes en relation avec le monde,
alors la poétesse qui est en chaque femme (quelle qu'en soit la forme prise) pourra jaillir avec une puissance infinie.
Lien : http://www.mespetiteschroniq..
A Room on One's Own m'a passionné du début à la fin ! le livre dans la main gauche, et un copy book et un stylo dans la main droite, j'ai d'abord commencé à noter les passages pertinents et les réflexions qu'il m'inspirait quand je me suis rendu compte que je notais presque chaque page écrite par Virginia Woolf !
Donc, comme je ne voudrais surtout pas vous ennuyer avec une longue paraphrase du texte, je vais plutôt vous livrer, au hasard, quelques passages qui m'ont particulièrement interpellée.
Avoir du temps pour soi est un luxe :
Ô combien je comprends Virginia quand elle évoque l'harmonie entre soi, le lieu et le temps où l'on est présent de corps mais où l'esprit va plus loin. Je me souviens des rares fois où j'ai ressenti cela. Rares, parce que peut-être cette sensation n'est donnée qu'aux êtres qui ont le loisir de laisser aller leurs pensées au gré de l'eau. Et quand, comme moi et vous sûrement, on a un travail, des responsabilités envers des enfants qui dépendent de soi, on n'a malheureusement guère le loisir de méditer au calme, en un lieu assez paisible pour inciter à la rêverie de l'esprit.
Alors, comme Virginia, quand me vient un début d'idée de roman ou de personnage et que je n'ai pas le temps de la noter, et que, désespérée, le soir, après ma journée de travail, je me rends compte que l'idée s'est échappée, j'enrage !
Les intellectuels et la nourriture :
En tant que gourmande (et Française peut-être ?), j'apprécie la remarque de Virginia sur le fait que les romanciers et écrivains anglais, lorsqu'ils se rappellent un repas, ne mentionnent pas ce qu'ils ont mangé, mais uniquement ce qu'ils ont pensé et dit. Et je suis bien d'accord avec Virginia : une conversation lors d'un repas est totalement différente si vous mangez des mets de qualité ou de la soupe de cailloux !
Ce fait m'a surprise car, les écrivains dont j'aime la vie et les livres : Théophile Gautier, Dumas, Balzac, George Sand, Flaubert et d'autres, parlent toujours dans leurs mémoires, souvenirs ou correspondances, ce qu'ils ont mangé. Ils s'invitaient aussi souvent que possible les uns chez les autres et je suis sûre qu'un bon repas délie plus facilement un esprit ! Un être humain n'est pas un pur esprit. Un écrivain ne peut pas se résumer à son esprit : c'est aussi un corps qui mange et qui aime. La façon dont on mange et la façon dont on aime font intégralement partie de soi, de sa pensée.
Les femmes et la maternité :
Virginia soulève la question de la maternité.
Une femme n'est pas moins femme parce qu'elle ne veut pas ou ne peut pas avoir d'enfants.
Mais qu'en est-il de celles qui en ont ? Tout comme Virginia, je pense qu'avoir un enfant prend bien plus que neuf mois : cela prend des années, car une maman accompagne son enfant dans le début de sa vie. Cela prend du temps physiquement ; pendant ce temps-là, une mère ne peut quasiment ni lire ni travailler. Travailler dans le sens gagner l'argent qui donne la liberté, et encore moins « faire carrière ». Mais avoir des enfants prend aussi un temps immatériel : une mère a l'esprit tourné vers son enfant et donc, elle a peu de temps pour penser à autre chose. Certes, ce n'est pas une généralité, mais personnellement, cela a été mon cas.
Pour autant, je ne crois pas que ce soit un temps perdu pour soi. C'est une expérience qui enrichit l'affect, le coeur et l'esprit d'une femme.
Le problème, pour une femme qui voudrait et pourrait s'exprimer dans une carrière, quelle qu'elle soit, n'est pas la maternité. La maternité peut durer des années, si une femme a deux ou trois enfants et qu'elle les accompagne un bout de chemin. le problème est que, pendant ce temps, les hommes, eux, font carrière, et qu'ensuite, ils n'accompagnent pas la femme dans son retour au travail. Ils considèrent que la femme n'a rien fait. le problème est donc toujours le même : quelle place l'homme laisse-t-il à la femme dans la société ?
La civilité est la fille du luxe :
Virginia écrit que urbanity, geniality and dignity are the offspring of luxury and privacy and space. Ce petit passage m'a rappelé le Germinal par Zola : il est vrai que de la misère, d'un travail trop dur et de la promiscuité dans un logement ne peut pas naître une élévation de l'âme et de l'esprit.
Faire ou ne pas faire d'études universitaires, là est la question :
Virginia thinks how unpleasant it is to be locked out of the university; and then she thinks how it's worse perhaps to be locked in !
Et moi je pense à Théophile Gautier, à Balzac, à Dumas, à George Sand et tant d'autres brillants écrivains qui se sont tant ennuyés au lycée qu'ils ont préféré suivre leur propre voie. Être libre de sa pensée, être maître de ses recherches, penser et écrire exactement ce que l'on veut, selon ses propres goûts et non pas ceux de professeurs, cela n'a pas de prix.
La confiance en soi :
Virginia écrit : « Life for both sexes is arduous, difficult, a perpetual struggle. It calls for gigantic courage and strength. More than anything, perhaps, it calls for confidence in oneself. Without self-confidence we are as babes in the cradle. »
Virginia a totalement raison ! Sans la confiance en soi, on ne fait rien ! Je peux le dire, je l'ai expérimenté, cela a même été une révélation pour moi, il y a quelques années. Pour certains, du fait de leur éducation ou de leur parcours sans agression, la confiance en soi est naturelle. Pour d'autres, la confiance en soi est une chose qui doit s'acquérir, parfois dans les larmes. Mais alors, une fois qu'on l'a, quelle victoire, quel bonheur !
Et la confiance en soi est peut-être, pour moi du moins, et contrairement à Virginia, ce qui est plus important pour s'exprimer, que de posséder une chambre à soi ou de l'argent.
Le monde n'a pas besoin de la littérature :
Virginia écrit : « Further, accentuating all these difficulties and making them harder to bear is the world's notorious indifference. It does not ask people to write poems and novels and histories; it does not need them. It does not care whether Flaubert finds the right word… »
Et là, je suis sûre qu'elle avait dû lire la correspondance de Flaubert avec George Sand, car c'est exactement ce qu'écrivait Flaubert à sa chère amie George Sand : il se désolait que le monde n'eût pas besoin de la littérature ! Ah, ce vieux troubadour aimait bien à se plaindre !
L'argent et le génie :
L'argent, certes, est important. Il est si difficile de vivre sans. Mais je ne crois pas, pour continuer sur cette page du chapitre trois, que sans argent il ne puisse pas y avoir de génie. Flaubert, puisque Virginia le prend, à de nombreuses reprises, pour exemple, aurait aussi écrit avec moins d'argent ; de même que Balzac qui a passé sa vie à courir après l'argent alors que les huissiers couraient après lui ! Et les exemples sont nombreux… Avec une plus grande ou une plus petite aisance financière, tous ces écrivains auraient quand même écrit. Peut-être pas sur les mêmes sujets et de la même façon, mais ils auraient écrit, car le génie était en eux.
Écrire dans la chambre commune :
Dans le chapitre quatre, à partir du paragraphe commençant par : « Here, then, one had reached the early nineteenth century. » Qu'est-ce que j'y retrouve ma vie ! Je veux dire, bien entendu, non pas dans le talent d'une Jane Austen, mais dans les conditions dans lesquelles ces auteurs femmes écrivaient.
C'est dans la pièce commune de ma maison que j'ai commencé à écrire et que j'écris encore ! Quelle chance d'avoir un cerveau de femme qui peut se démultiplier ! Comment, sinon, aurais-je pu avoir l'esprit à mes romans, en même temps qu'un oeil sur l'horloge du salon pour ne pas manquer le rendez-vous de ma fille chez le dentiste, ou surveiller que mon fils mette le couvert pour dîner ? Alors, quand le neveu de Jane Austen s'étonne qu'elle ait pu écrire dans de telles conditions, c'est parce qu'il est un homme et qu'il n'a pas la capacité de démultiplier son attention sans bâcler ni son travail ni ses enfants !
Ce qu'il nous reste à faire, à nous, les femmes :
Tout le long du livre on peut penser que ces réflexions sur la condition des femmes, bien qu'instructives, sont du domaine de l'histoire ; aujourd'hui, malheureusement pas dans tous les pays, les femmes sont presque les égales des hommes, si ce n'est pas dans les faits, du moins dans les droits.
On peut aussi penser que quand Virginia exhorte les femmes à écrire, même n'importe quoi, presque, afin d'ouvrir la voie à une grande poétesse ou romancière, oui, on peut penser : D'accord, Virginia, mais moi, douée ou banale, je ne suis ni écrivain, ni poète ; alors, pourquoi me demander cela ?
C'est à la toute fin de cette chambre à soi que madame Woolf nous ouvre le fond de sa pensée : ce livre ne s'adresse pas aux hommes, il ne s'adresse pas non plus à chaque femme en particulier qui le lira. Ce livre s'adresse à toutes les femmes du monde !
Et c'est là le génie de Virginia qui nous dit à chacune de nous : libérez votre pensée, libérez vos actions. C'est la somme de toutes ces femmes libérées, chacune selon ses forces et ses faiblesses, selon ses moyens intellectuels et matériels, c'est cette progression commune qui ouvrira, un jour, la voie à quelques femmes d'exceptions. Des femmes qui écriront des pages si belles, si profondes, qu'elles éclaireront à leur tour les générations de femmes à venir.
Quel souffle sur le monde, quelle ouverture d'esprit, quelle généreuse vision !
On comprend que Virginia Woolf, avec un esprit si au-dessus du commun des mortels (et des hommes !), ait désespéré parmi nos pensées étriquées.
Virginia Woolf voulait un futur où les femmes auraient leur place, faisons-le aujourd'hui !©
Gabrielle Dubois
Lien : https://www.gabrielle-dubois..
Donc, comme je ne voudrais surtout pas vous ennuyer avec une longue paraphrase du texte, je vais plutôt vous livrer, au hasard, quelques passages qui m'ont particulièrement interpellée.
Avoir du temps pour soi est un luxe :
Ô combien je comprends Virginia quand elle évoque l'harmonie entre soi, le lieu et le temps où l'on est présent de corps mais où l'esprit va plus loin. Je me souviens des rares fois où j'ai ressenti cela. Rares, parce que peut-être cette sensation n'est donnée qu'aux êtres qui ont le loisir de laisser aller leurs pensées au gré de l'eau. Et quand, comme moi et vous sûrement, on a un travail, des responsabilités envers des enfants qui dépendent de soi, on n'a malheureusement guère le loisir de méditer au calme, en un lieu assez paisible pour inciter à la rêverie de l'esprit.
Alors, comme Virginia, quand me vient un début d'idée de roman ou de personnage et que je n'ai pas le temps de la noter, et que, désespérée, le soir, après ma journée de travail, je me rends compte que l'idée s'est échappée, j'enrage !
Les intellectuels et la nourriture :
En tant que gourmande (et Française peut-être ?), j'apprécie la remarque de Virginia sur le fait que les romanciers et écrivains anglais, lorsqu'ils se rappellent un repas, ne mentionnent pas ce qu'ils ont mangé, mais uniquement ce qu'ils ont pensé et dit. Et je suis bien d'accord avec Virginia : une conversation lors d'un repas est totalement différente si vous mangez des mets de qualité ou de la soupe de cailloux !
Ce fait m'a surprise car, les écrivains dont j'aime la vie et les livres : Théophile Gautier, Dumas, Balzac, George Sand, Flaubert et d'autres, parlent toujours dans leurs mémoires, souvenirs ou correspondances, ce qu'ils ont mangé. Ils s'invitaient aussi souvent que possible les uns chez les autres et je suis sûre qu'un bon repas délie plus facilement un esprit ! Un être humain n'est pas un pur esprit. Un écrivain ne peut pas se résumer à son esprit : c'est aussi un corps qui mange et qui aime. La façon dont on mange et la façon dont on aime font intégralement partie de soi, de sa pensée.
Les femmes et la maternité :
Virginia soulève la question de la maternité.
Une femme n'est pas moins femme parce qu'elle ne veut pas ou ne peut pas avoir d'enfants.
Mais qu'en est-il de celles qui en ont ? Tout comme Virginia, je pense qu'avoir un enfant prend bien plus que neuf mois : cela prend des années, car une maman accompagne son enfant dans le début de sa vie. Cela prend du temps physiquement ; pendant ce temps-là, une mère ne peut quasiment ni lire ni travailler. Travailler dans le sens gagner l'argent qui donne la liberté, et encore moins « faire carrière ». Mais avoir des enfants prend aussi un temps immatériel : une mère a l'esprit tourné vers son enfant et donc, elle a peu de temps pour penser à autre chose. Certes, ce n'est pas une généralité, mais personnellement, cela a été mon cas.
Pour autant, je ne crois pas que ce soit un temps perdu pour soi. C'est une expérience qui enrichit l'affect, le coeur et l'esprit d'une femme.
Le problème, pour une femme qui voudrait et pourrait s'exprimer dans une carrière, quelle qu'elle soit, n'est pas la maternité. La maternité peut durer des années, si une femme a deux ou trois enfants et qu'elle les accompagne un bout de chemin. le problème est que, pendant ce temps, les hommes, eux, font carrière, et qu'ensuite, ils n'accompagnent pas la femme dans son retour au travail. Ils considèrent que la femme n'a rien fait. le problème est donc toujours le même : quelle place l'homme laisse-t-il à la femme dans la société ?
La civilité est la fille du luxe :
Virginia écrit que urbanity, geniality and dignity are the offspring of luxury and privacy and space. Ce petit passage m'a rappelé le Germinal par Zola : il est vrai que de la misère, d'un travail trop dur et de la promiscuité dans un logement ne peut pas naître une élévation de l'âme et de l'esprit.
Faire ou ne pas faire d'études universitaires, là est la question :
Virginia thinks how unpleasant it is to be locked out of the university; and then she thinks how it's worse perhaps to be locked in !
Et moi je pense à Théophile Gautier, à Balzac, à Dumas, à George Sand et tant d'autres brillants écrivains qui se sont tant ennuyés au lycée qu'ils ont préféré suivre leur propre voie. Être libre de sa pensée, être maître de ses recherches, penser et écrire exactement ce que l'on veut, selon ses propres goûts et non pas ceux de professeurs, cela n'a pas de prix.
La confiance en soi :
Virginia écrit : « Life for both sexes is arduous, difficult, a perpetual struggle. It calls for gigantic courage and strength. More than anything, perhaps, it calls for confidence in oneself. Without self-confidence we are as babes in the cradle. »
Virginia a totalement raison ! Sans la confiance en soi, on ne fait rien ! Je peux le dire, je l'ai expérimenté, cela a même été une révélation pour moi, il y a quelques années. Pour certains, du fait de leur éducation ou de leur parcours sans agression, la confiance en soi est naturelle. Pour d'autres, la confiance en soi est une chose qui doit s'acquérir, parfois dans les larmes. Mais alors, une fois qu'on l'a, quelle victoire, quel bonheur !
Et la confiance en soi est peut-être, pour moi du moins, et contrairement à Virginia, ce qui est plus important pour s'exprimer, que de posséder une chambre à soi ou de l'argent.
Le monde n'a pas besoin de la littérature :
Virginia écrit : « Further, accentuating all these difficulties and making them harder to bear is the world's notorious indifference. It does not ask people to write poems and novels and histories; it does not need them. It does not care whether Flaubert finds the right word… »
Et là, je suis sûre qu'elle avait dû lire la correspondance de Flaubert avec George Sand, car c'est exactement ce qu'écrivait Flaubert à sa chère amie George Sand : il se désolait que le monde n'eût pas besoin de la littérature ! Ah, ce vieux troubadour aimait bien à se plaindre !
L'argent et le génie :
L'argent, certes, est important. Il est si difficile de vivre sans. Mais je ne crois pas, pour continuer sur cette page du chapitre trois, que sans argent il ne puisse pas y avoir de génie. Flaubert, puisque Virginia le prend, à de nombreuses reprises, pour exemple, aurait aussi écrit avec moins d'argent ; de même que Balzac qui a passé sa vie à courir après l'argent alors que les huissiers couraient après lui ! Et les exemples sont nombreux… Avec une plus grande ou une plus petite aisance financière, tous ces écrivains auraient quand même écrit. Peut-être pas sur les mêmes sujets et de la même façon, mais ils auraient écrit, car le génie était en eux.
Écrire dans la chambre commune :
Dans le chapitre quatre, à partir du paragraphe commençant par : « Here, then, one had reached the early nineteenth century. » Qu'est-ce que j'y retrouve ma vie ! Je veux dire, bien entendu, non pas dans le talent d'une Jane Austen, mais dans les conditions dans lesquelles ces auteurs femmes écrivaient.
C'est dans la pièce commune de ma maison que j'ai commencé à écrire et que j'écris encore ! Quelle chance d'avoir un cerveau de femme qui peut se démultiplier ! Comment, sinon, aurais-je pu avoir l'esprit à mes romans, en même temps qu'un oeil sur l'horloge du salon pour ne pas manquer le rendez-vous de ma fille chez le dentiste, ou surveiller que mon fils mette le couvert pour dîner ? Alors, quand le neveu de Jane Austen s'étonne qu'elle ait pu écrire dans de telles conditions, c'est parce qu'il est un homme et qu'il n'a pas la capacité de démultiplier son attention sans bâcler ni son travail ni ses enfants !
Ce qu'il nous reste à faire, à nous, les femmes :
Tout le long du livre on peut penser que ces réflexions sur la condition des femmes, bien qu'instructives, sont du domaine de l'histoire ; aujourd'hui, malheureusement pas dans tous les pays, les femmes sont presque les égales des hommes, si ce n'est pas dans les faits, du moins dans les droits.
On peut aussi penser que quand Virginia exhorte les femmes à écrire, même n'importe quoi, presque, afin d'ouvrir la voie à une grande poétesse ou romancière, oui, on peut penser : D'accord, Virginia, mais moi, douée ou banale, je ne suis ni écrivain, ni poète ; alors, pourquoi me demander cela ?
C'est à la toute fin de cette chambre à soi que madame Woolf nous ouvre le fond de sa pensée : ce livre ne s'adresse pas aux hommes, il ne s'adresse pas non plus à chaque femme en particulier qui le lira. Ce livre s'adresse à toutes les femmes du monde !
Et c'est là le génie de Virginia qui nous dit à chacune de nous : libérez votre pensée, libérez vos actions. C'est la somme de toutes ces femmes libérées, chacune selon ses forces et ses faiblesses, selon ses moyens intellectuels et matériels, c'est cette progression commune qui ouvrira, un jour, la voie à quelques femmes d'exceptions. Des femmes qui écriront des pages si belles, si profondes, qu'elles éclaireront à leur tour les générations de femmes à venir.
Quel souffle sur le monde, quelle ouverture d'esprit, quelle généreuse vision !
On comprend que Virginia Woolf, avec un esprit si au-dessus du commun des mortels (et des hommes !), ait désespéré parmi nos pensées étriquées.
Virginia Woolf voulait un futur où les femmes auraient leur place, faisons-le aujourd'hui !©
Gabrielle Dubois
Lien : https://www.gabrielle-dubois..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Virginia Woolf (144)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Virginia Woolf
Virginia Woolf a grandi dans une famille que nous qualifierions de :
classique
monoparentale
recomposée
10 questions
199 lecteurs ont répondu
Thème :
Virginia WoolfCréer un quiz sur ce livre199 lecteurs ont répondu