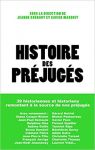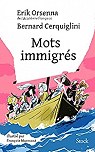Nationalité : France
Né(e) à : Lyon , le 08/04/1947
Né(e) à : Lyon , le 08/04/1947
Biographie :
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, né en 1947 à Lyon. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il est professeur de linguistique à Paris VII.
Il a notamment exercé les fonctions de directeur des écoles au ministère français de l'Éducation nationale (1985-1987), de directeur de l’Institut national de la langue française, de vice-président du Conseil supérieur de la langue française (dont le président en titre est le Premier ministre), de délégué général à la langue française et aux langues de France (à deux reprises), de président de l’Observatoire national de la lecture. Il a été chargé d’une mission sur la réforme de l’orthographe, puis d’un rapport sur les langues de France, par différents Premiers ministres.
Bernard Cerquiglini est entré en 1995 à l’Oulipo. Auteur d’une « autobiographie de l’accent circonflexe » sous le titre L'Accent du souvenir, il y joue le rôle de « gardien de la langue ».
Après avoir été le directeur du Center for French and Francophone Studies de l’Université d'État de Louisiane à Bâton-Rouge, en Louisiane. il est depuis décembre 2007 recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie.
Il présente également l'émission linguistique quotidienne de format court, Merci professeur!, sur TV5 Monde.
+ Voir plusBernard Cerquiglini est un linguiste français, né en 1947 à Lyon. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il est professeur de linguistique à Paris VII.
Il a notamment exercé les fonctions de directeur des écoles au ministère français de l'Éducation nationale (1985-1987), de directeur de l’Institut national de la langue française, de vice-président du Conseil supérieur de la langue française (dont le président en titre est le Premier ministre), de délégué général à la langue française et aux langues de France (à deux reprises), de président de l’Observatoire national de la lecture. Il a été chargé d’une mission sur la réforme de l’orthographe, puis d’un rapport sur les langues de France, par différents Premiers ministres.
Bernard Cerquiglini est entré en 1995 à l’Oulipo. Auteur d’une « autobiographie de l’accent circonflexe » sous le titre L'Accent du souvenir, il y joue le rôle de « gardien de la langue ».
Après avoir été le directeur du Center for French and Francophone Studies de l’Université d'État de Louisiane à Bâton-Rouge, en Louisiane. il est depuis décembre 2007 recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie.
Il présente également l'émission linguistique quotidienne de format court, Merci professeur!, sur TV5 Monde.
Source : Wikipedia
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (18)
Voir plusAjouter une vidéo
Bernard Cerquiglini vous présente son ouvrage "La langue anglaise n'existe pas : c'est du français mal prononcé" aux éditions Folio.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/3041266/bernard-cerquiglini-la-langue-anglaise-n-existe-pas-c-est-du-francais-mal-prononce
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
Citations et extraits (25)
Voir plus
Ajouter une citation
Depuis quand parle-t-on français ?
Comme le disait avec humour Vendryes, le français est le latin parlé, actuellement, dans la région qui est aujourd’hui la France. Et l’on pourrait dire que l’on n’a jamais cessé de parler latin. Toutefois, l’accumulation de traits nouveaux apportés au latin a produit un idiome qui, aux yeux du savant comme du commun des mortels, est tout autre. On peut se demander, dès lors, en quel point de cette évolution les deux idiomes se disjoignent.
Cette question du continu et du discontinu est une des apories de la linguistique historique. Très influencée par le néolamarckisme ambiant, cette science de l’évolution des langues s’est naturellement coulée dans le transformisme : les langues évoluent comme les espèces, héritent des modifications acquises, se distinguent par spéciations successives. Conception organiciste de la langue, dont le destin, par suite, est celui de tous les êtres vivants. Métaphore des sciences naturelles, cependant, qui bute sur la complexité intrinsèque de la langue, et tout particulièrement sur la difficulté à définir les traits pertinents du processus évolutif. Dans la langue, point de branchies, de nageoires ou d’ailes, éléments au sein d’un système organique, mais des domaines (syntaxe, lexique, sémantique, etc.) hétérogènes, complexes en eux-mêmes, et ayant leur propre historicité.
Comme le disait avec humour Vendryes, le français est le latin parlé, actuellement, dans la région qui est aujourd’hui la France. Et l’on pourrait dire que l’on n’a jamais cessé de parler latin. Toutefois, l’accumulation de traits nouveaux apportés au latin a produit un idiome qui, aux yeux du savant comme du commun des mortels, est tout autre. On peut se demander, dès lors, en quel point de cette évolution les deux idiomes se disjoignent.
Cette question du continu et du discontinu est une des apories de la linguistique historique. Très influencée par le néolamarckisme ambiant, cette science de l’évolution des langues s’est naturellement coulée dans le transformisme : les langues évoluent comme les espèces, héritent des modifications acquises, se distinguent par spéciations successives. Conception organiciste de la langue, dont le destin, par suite, est celui de tous les êtres vivants. Métaphore des sciences naturelles, cependant, qui bute sur la complexité intrinsèque de la langue, et tout particulièrement sur la difficulté à définir les traits pertinents du processus évolutif. Dans la langue, point de branchies, de nageoires ou d’ailes, éléments au sein d’un système organique, mais des domaines (syntaxe, lexique, sémantique, etc.) hétérogènes, complexes en eux-mêmes, et ayant leur propre historicité.
Depuis quand le français existe-t-il ? Depuis le jour où son altérité et sa spécificité, dues à son développement interne, sont reconnues et désignées. Du jour que celles-ci sont utilisées consciemment, dans un but de communication, dans une relation de pouvoir, et que cet emploi prend la forme du savoir, c’est-à-dire l’écriture. Depuis quand parle-t-on français ? Depuis qu’on l’écrit.
[A propos de La formule de Soissons]
Un poème latin, conservé dans le Psautier de Soissons, exécuté à la fin du VIIe siècle, ajoute au nom de Charlemagne et de son épouse tu lo juva (« Dieu protège-le »), forme traditionnelle sans doute d’ovation populaire et sans doute la plus ancienne phrase conservée en français.
Un poème latin, conservé dans le Psautier de Soissons, exécuté à la fin du VIIe siècle, ajoute au nom de Charlemagne et de son épouse tu lo juva (« Dieu protège-le »), forme traditionnelle sans doute d’ovation populaire et sans doute la plus ancienne phrase conservée en français.
Il en est ainsi : l’attachement à la langue française est si fort et communément partagé que toute innovation langagière incommode.
[A propos des Les Gloses de Reichenau]
Préparé à la fin du VIIIe siècle ou au tout début du IXe dans le nord de la France, […] il contient environ 1280 gloses interprétant des termes de la Vulgate, traduction latine officielle de la Bible, que saint Jérôme donna autour de l’an 400. On voit, au passage, l’évolution de la langue latine, devenue langue romane puis protofrançais, puisque, quatre siècles passés, one ne comprenait plus parfaitement la langue de saint Jérôme […].
Préparé à la fin du VIIIe siècle ou au tout début du IXe dans le nord de la France, […] il contient environ 1280 gloses interprétant des termes de la Vulgate, traduction latine officielle de la Bible, que saint Jérôme donna autour de l’an 400. On voit, au passage, l’évolution de la langue latine, devenue langue romane puis protofrançais, puisque, quatre siècles passés, one ne comprenait plus parfaitement la langue de saint Jérôme […].
[La grammaire historique] est pensée de l’origine, d’une origine parfaite et regrettable ; pensée essentiellement mélancolique, elle ne peut faire deuil du moment primordial. La thèse de la copie comme dégénérescence, qui fonde la philologie, présuppose un original sans faute : l’auteur n’a pas droit au lapsus.
La question des origines
Rédigeant les premières lignes d’une monumentale Histoire de la langue française, Ferdinand Brunot ne veut « retenir pour le moment que ce seul fait primordial : le français est du latin parlé » (t. I, p. 16). Fait primordial et fondateur, certes, énoncé simple et bref tel un axiome, déclaration enfin d’une évidence qui frise la banalité. Que la langue française provienne du latin, nul n’en doute aujourd’hui, et moins que tout autre les défenseurs de l’enseignement du latin, et les candidats aux concours d’orthographe. C’est oublier qu’un tel savoir, devenu connaissance assurée mais tiède, cadre mental diffus, est des plus récents, que son apparence naturelle possède une histoire. Si la linguistique historique du français est une discipline scientifique, et si tel est son axiome, il convient d’examiner la constitution, lente il est vrai, mais exemplaire de cette science.
Les acquis, tenus pour définitifs, sont clairement énoncés par Brunot (t. I, p. 15) :
« Le français n’est autre chose que le latin parlé dans Paris et la contrée qui l’avoisine, dont les générations qui se sont succédé depuis tant de siècles ont transformé peu à peu la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, quelquefois profondément et même totalement, mais toujours par une progression graduelle et régulière, suivant des instincts propres, ou sous des influences extérieures, dont la science étudie l’effet et détermine les lois. »
L’origine (« le français n’est autre chose que le latin… ») fonde, on le voit, le discours scientifique tenu sur l’évolution de la langue…
Rédigeant les premières lignes d’une monumentale Histoire de la langue française, Ferdinand Brunot ne veut « retenir pour le moment que ce seul fait primordial : le français est du latin parlé » (t. I, p. 16). Fait primordial et fondateur, certes, énoncé simple et bref tel un axiome, déclaration enfin d’une évidence qui frise la banalité. Que la langue française provienne du latin, nul n’en doute aujourd’hui, et moins que tout autre les défenseurs de l’enseignement du latin, et les candidats aux concours d’orthographe. C’est oublier qu’un tel savoir, devenu connaissance assurée mais tiède, cadre mental diffus, est des plus récents, que son apparence naturelle possède une histoire. Si la linguistique historique du français est une discipline scientifique, et si tel est son axiome, il convient d’examiner la constitution, lente il est vrai, mais exemplaire de cette science.
Les acquis, tenus pour définitifs, sont clairement énoncés par Brunot (t. I, p. 15) :
« Le français n’est autre chose que le latin parlé dans Paris et la contrée qui l’avoisine, dont les générations qui se sont succédé depuis tant de siècles ont transformé peu à peu la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, quelquefois profondément et même totalement, mais toujours par une progression graduelle et régulière, suivant des instincts propres, ou sous des influences extérieures, dont la science étudie l’effet et détermine les lois. »
L’origine (« le français n’est autre chose que le latin… ») fonde, on le voit, le discours scientifique tenu sur l’évolution de la langue…
Dans une salle reposait sur une longue table un squelette incomplet : c’était Nithard. Je saluai sa dépouille, m’attardant à contempler, empreint d’émotion, saisi de pitié, le crâne ouvert de celui qui avait célébré le français. Singulière rencontre, pour un chercheur familier d’écrits sans visage et sans nom, dont les siècles ont affaibli la vigueur et l’écho, avec le reste palpable de ce qui fut une ardeur, la trace pathétique d’un élan brisé. Un destin se donnait à voir, et la vérité d’une œuvre. Ces ossements, dérobés par miracle à l’opacité des siècles, confirmaient ce que suggérait la chronique : un chagrin du monde et des hommes, qu’avaient rémunéré l’intelligence solitaire du siècle et la grandeur de l’écriture. Au laboratoire de Ribemont-sur-Ancre reposait le premier écrivain français.
Nithard avait surgi de sa tombe et d’un millénaire d’oubli, ouvrant le cortège des officiants du français, pour recueillir notre légitime gratitude, afin que j’écrivisse son Tombeau.
Nithard avait surgi de sa tombe et d’un millénaire d’oubli, ouvrant le cortège des officiants du français, pour recueillir notre légitime gratitude, afin que j’écrivisse son Tombeau.
On a écrit en français, première des langues romanes à pratiquer l’écriture, dès le IXe siècle : quelques lignes, perdues dans l’immense latinité, mais des plus précieuses. Cet ouvrage entend expliquer l’émergence précoce, inattendue voire paradoxale d’un usage écrit, politique et littéraire de cet idiome qui en était encore à ses balbutiements : le protofrançais acquiert promptement ses lettres de noblesse. Cet exploit n’a pas peu contribué à l’image d’une langue française idiome d’ancienne culture écrite, instrument familier du pouvoir ; il éclaire son destin et sa vocation à rayonner. Nous proposons ici des raisons radicalement nouvelles de ce coup d’éclat inaugural. La question est austère et devrait requérir l’impassibilité de la science ; on nous pardonnera toutefois un ton parfois familier, et en préambule quelques remarques personnelles.
Ce livre résulte d’une rencontre ; il tient à la découverte, puis à la fréquentation régulière, mêlée d’estime et d’affection, d’un homme mort il y a plus d’un millénaire. Dans une étude publiée il y a vingt-cinq ans, consacrée à l’apparition de la langue française, je reprenais la question, ancienne et jamais vraiment résolue, de la date à laquelle le latin, même très tardif, s’était transformé en protofrançais. À l’interrogation « Depuis quand parle-t-on français ? » je répondais de façon tranchée : « Depuis qu’on l’écrit. » C’est-à-dire depuis qu’on a perçu, estimé et valorisé sa divergence d’avec le latin, en lui attribuant
une fonction sociale, en le faisant accéder au prestige et à la permanence de l’écrit. Dans cette perspective, les Serments de Strasbourg, traité d’alliance bilingue (français/germanique) échangé en 842 par Charles le Chauve et Louis le Germanique, n’étaient plus seulement le premier texte rédigé en français, digne d’être salué comme tel, attestation initiale et presque aléatoire d’une langue en devenir ; ils se révélaient l’instrument d’une opération politico-linguistique impliquant la promotion des langues vernaculaires. Charles et Louis, faisant alliance contre leur frère, Lothaire, pourtant empereur proclamé, se reconnaissaient mutuellement une autorité sur les parties francophone et germanophone de l’Empire ;
délaissant le latin de l’unité impériale, les serments faisaient des langues vulgaires l’expression de l’alliance, la délimitation des territoires attribués (et officiellement partagés, quelques mois plus tard, par le traité de Verdun), presque leur identité.
Ce livre résulte d’une rencontre ; il tient à la découverte, puis à la fréquentation régulière, mêlée d’estime et d’affection, d’un homme mort il y a plus d’un millénaire. Dans une étude publiée il y a vingt-cinq ans, consacrée à l’apparition de la langue française, je reprenais la question, ancienne et jamais vraiment résolue, de la date à laquelle le latin, même très tardif, s’était transformé en protofrançais. À l’interrogation « Depuis quand parle-t-on français ? » je répondais de façon tranchée : « Depuis qu’on l’écrit. » C’est-à-dire depuis qu’on a perçu, estimé et valorisé sa divergence d’avec le latin, en lui attribuant
une fonction sociale, en le faisant accéder au prestige et à la permanence de l’écrit. Dans cette perspective, les Serments de Strasbourg, traité d’alliance bilingue (français/germanique) échangé en 842 par Charles le Chauve et Louis le Germanique, n’étaient plus seulement le premier texte rédigé en français, digne d’être salué comme tel, attestation initiale et presque aléatoire d’une langue en devenir ; ils se révélaient l’instrument d’une opération politico-linguistique impliquant la promotion des langues vernaculaires. Charles et Louis, faisant alliance contre leur frère, Lothaire, pourtant empereur proclamé, se reconnaissaient mutuellement une autorité sur les parties francophone et germanophone de l’Empire ;
délaissant le latin de l’unité impériale, les serments faisaient des langues vulgaires l’expression de l’alliance, la délimitation des territoires attribués (et officiellement partagés, quelques mois plus tard, par le traité de Verdun), presque leur identité.
La langue est en France une affaire Dreyfus permanente.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Bernard Cerquiglini
Quiz
Voir plus
Autobiographies de l'enfance
C’est un roman autobiographique publié en 1894 par Jules Renard, qui raconte l'enfance et les déboires d'un garçon roux mal aimé.
Confession d’un enfant du siècle
La mare au diable
Poil de Carotte
12 questions
39 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur39 lecteurs ont répondu