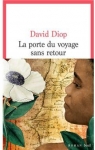Bernard Cerquiglini vous présente son ouvrage "La langue anglaise n'existe pas : c'est du français mal prononcé" aux éditions Folio.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/3041266/bernard-cerquiglini-la-langue-anglaise-n-existe-pas-c-est-du-francais-mal-prononce
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Bernard Cerquiglini/5
9 notes
Résumé :
Le Ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms
La querelle de la féminisation des noms de métiers (titres, grades, fonctions…) est exemplaire du rôle de la langue dans notre pays. En dix ans, elle a rythmé un des changements les plus rapides et les plus étendus de son histoire. Mêlant, tout comme l’interminable débat orthographique, le linguistique et le politique, opposant les conservateurs et les interventionnistes, confr... >Voir plus
La querelle de la féminisation des noms de métiers (titres, grades, fonctions…) est exemplaire du rôle de la langue dans notre pays. En dix ans, elle a rythmé un des changements les plus rapides et les plus étendus de son histoire. Mêlant, tout comme l’interminable débat orthographique, le linguistique et le politique, opposant les conservateurs et les interventionnistes, confr... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le ministre est enceinteVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Ecrivaine, auteure, professeure, … dans l'essai « le (la) ministre est enceinte » Bernard Cerquiglini, linguiste reconnu, aborde avec humour la querelle de la féminisation des fonctions, titres et professions en France. Ceci peut paraître un détail, est-ce vraiment le cas ?
Peut-on légiférer sur le français et imposer par décret des changements ? Doit-on dire « Madame le ministre » ou « Madame la ministre » ? Ce qui touche notre langue n'est pas seulement l'affaire de spécialistes, chaque personne a son mot à dire et les hommes ou femmes politiques s'en mêlent (et s'emmêlent).
La féminisation de la langue a été enclenchée très tardivement en France et un des objectifs de l'essai est de répondre à une interrogation : pourquoi les instances françaises sont-elles restées si longtemps passives ? L'auteur revient sur les avancées et les reculs de la langue française. Dans le passé, la langue était plus « souple », moins « corsetée » qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bernard Cerquiglini attaque vivement l'Académie française qui a toujours défendu le terme de « genre non marqué » en considérant qu'il n'y avait aucune forme de discrimination dans cette règle. Après s'y être longuement opposé, l'Académie française a finalement donné son aval à la féminisation des noms de professions le 28 février 2019. Des mots tels que « professeure » « proviseure » ou « présidente » sont désormais acceptés, « l'ambassadrice » n'est plus l'épouse de l'ambassadeur. Selon Cerquiglini, l'histoire de la langue est révélatrice d'un retard de l'égalité homme femme en France, il souligne les rapports entre langue et pouvoir. Il faut une norme mais il faut également tenir compte de l'usage. Il invite le lecteur à considérer les néologismes comme un signe de vitalité de la langue, selon lui, l'innovation linguistique est indispensable pour que la langue soit en phase avec le monde actuel.
On ne se lasse jamais en tournant les pages de cet essai, impatient de comprendre le phénomène de résistance à la féminisation de la langue. Il n'est pas nécessaire d'être féministe pour accepter la féminisation de certains mots, même si parfois l'intérêt n'est pas évident (doit-on, par exemple, réciproquement masculiniser le mot vedette ?) Par contre, comme une très large majorité de spécialistes, l'auteur met en garde contre l'écriture inclusive qui entrave la clarté des textes, détruit la concentration, complique encore l'orthographe déjà si durement malmenée et rend la prononciation impossible. Or une langue qui ne se parle pas n'est plus une langue.
Peut-on légiférer sur le français et imposer par décret des changements ? Doit-on dire « Madame le ministre » ou « Madame la ministre » ? Ce qui touche notre langue n'est pas seulement l'affaire de spécialistes, chaque personne a son mot à dire et les hommes ou femmes politiques s'en mêlent (et s'emmêlent).
La féminisation de la langue a été enclenchée très tardivement en France et un des objectifs de l'essai est de répondre à une interrogation : pourquoi les instances françaises sont-elles restées si longtemps passives ? L'auteur revient sur les avancées et les reculs de la langue française. Dans le passé, la langue était plus « souple », moins « corsetée » qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bernard Cerquiglini attaque vivement l'Académie française qui a toujours défendu le terme de « genre non marqué » en considérant qu'il n'y avait aucune forme de discrimination dans cette règle. Après s'y être longuement opposé, l'Académie française a finalement donné son aval à la féminisation des noms de professions le 28 février 2019. Des mots tels que « professeure » « proviseure » ou « présidente » sont désormais acceptés, « l'ambassadrice » n'est plus l'épouse de l'ambassadeur. Selon Cerquiglini, l'histoire de la langue est révélatrice d'un retard de l'égalité homme femme en France, il souligne les rapports entre langue et pouvoir. Il faut une norme mais il faut également tenir compte de l'usage. Il invite le lecteur à considérer les néologismes comme un signe de vitalité de la langue, selon lui, l'innovation linguistique est indispensable pour que la langue soit en phase avec le monde actuel.
On ne se lasse jamais en tournant les pages de cet essai, impatient de comprendre le phénomène de résistance à la féminisation de la langue. Il n'est pas nécessaire d'être féministe pour accepter la féminisation de certains mots, même si parfois l'intérêt n'est pas évident (doit-on, par exemple, réciproquement masculiniser le mot vedette ?) Par contre, comme une très large majorité de spécialistes, l'auteur met en garde contre l'écriture inclusive qui entrave la clarté des textes, détruit la concentration, complique encore l'orthographe déjà si durement malmenée et rend la prononciation impossible. Or une langue qui ne se parle pas n'est plus une langue.
4e de couverture : Un ministre peut-il vraiment se retrouver enceinte ? La question ne relève pas tant de progrès de la génétique que des fluctuations de l'expression verbale. À ce titre, la querelle de la féminisation des fonctions officielles et des noms de métiers illustre à merveille le rôle singulier que tient la langue française auprès de ceux qui la parlent. Mêlant, comme l'interminable débat orthographique, le linguistique et le politique, opposant les conservateurs et les interventionnistes, l'Académie française à l'État, elle a rythmé pendant vingt ans l'un des changements les plus rapides et les plus étendus qu'ait connus notre langue. En confrontant le patrimonial et le fonctionnel, elle fait du français une langue querelle. La récente controverse autour de l'écriture inclusive l'a montré de nouveau.
Mon avis : Bernard Cerguiglini est un linguiste que j'aime beaucoup. Il reste toujours assez mesuré dans ses propos et j'admire son érudition. Outre l'écriture d'ouvrages, il intervient souvent sur France Culture.
Étant moi-même une femme (bah, oui), je me bats souvent pour la féminisation des mots. Par exemple, je trouve parfois agaçant que le masculin soit souvent plus flatteur que le féminin , par exemple : un chauffeur/une chauffeuse – un gourmet/une gourmette – un chevalier/une chevalière -
un médecin/une médecine ; dans ces exemples le masculin est un homme, le féminin un objet !
Par contre, l'écriture inclusive à tout crin (chanteur-euse) comme je l'ai déjà vu (ou éditeur-rice), là je dis non, il vaut mieux choisir un mot épicène qui contente tout le monde.
N'oublions pas que la francophonie régresse, alors avant tout, il faut penser à simplifier légèrement la langue française, afin de la rendre plus accessible et qu'elle ne soit pas constamment phagocytée par des anglicismes, ce qui est trop souvent le cas actuellement.
Vaste débat...
Instagram : @la_cath_a_strophes
Mon avis : Bernard Cerguiglini est un linguiste que j'aime beaucoup. Il reste toujours assez mesuré dans ses propos et j'admire son érudition. Outre l'écriture d'ouvrages, il intervient souvent sur France Culture.
Étant moi-même une femme (bah, oui), je me bats souvent pour la féminisation des mots. Par exemple, je trouve parfois agaçant que le masculin soit souvent plus flatteur que le féminin , par exemple : un chauffeur/une chauffeuse – un gourmet/une gourmette – un chevalier/une chevalière -
un médecin/une médecine ; dans ces exemples le masculin est un homme, le féminin un objet !
Par contre, l'écriture inclusive à tout crin (chanteur-euse) comme je l'ai déjà vu (ou éditeur-rice), là je dis non, il vaut mieux choisir un mot épicène qui contente tout le monde.
N'oublions pas que la francophonie régresse, alors avant tout, il faut penser à simplifier légèrement la langue française, afin de la rendre plus accessible et qu'elle ne soit pas constamment phagocytée par des anglicismes, ce qui est trop souvent le cas actuellement.
Vaste débat...
Instagram : @la_cath_a_strophes
Ne riez pas! L'on a pu apprendre dans les journaux (à l'époque) que le capitaine Prieur avait été rapatrié, parce qu'il commençait une grossesse. "Le capitaine Dominique Prieur était enceinte.". Ou bien le ministre des sports, qui était enceinte, n'a pu sauter en parachute comme prévu." (le monde du 16 octobre 92, à propos de Frédérique Bredin).
Bernard Cerquiglini suit l'affaire de la féminisation des mots depuis un certain temps, et c'est avec humour qu'il rappelle l'évolution des dernières années, en particulier la résistance de l'Académie française. Un feuilleton assez franco-français, puisque les francophones non français se posent moins de questions, et les québécois, en particulier, entourés du monde anglophone, se défendent et font preuve d'une belle inventivité. Il semble qu'on soit sur le bon chemin.
Des linguistes belges rappellent d'ailleurs qu'on peut féminiser intuitivement tous les substantifs animés humains du français, et citent des exemples, avoué, bourgmestre, échevin, ministre, etc., avec même des noms fictifs, tels calefrier, chapporé, ciremel, damilin, filiciste (je parie que vous y arrivez!)
Un chapitre fort gouleyant rappelle comment c'était dans le passé, là où on ne s'embarrassait pas de l'Académie, qui d'ailleurs n'existait pas. La féminisation s'en donnait à coeur joie, ou plutôt, tout ou presque existait, suivant ces règles intuitives.
Puis le masculin est venu établir sa loi, moquant certaines féminisations (pourtant avérées au Moyen âge...) et chipotant pas mal, par exemple on accepte une secrétaire si c'est une employée assez subalterne, mais pas une secrétaire si c'est la perpétuelle de l'Académie...
La langue reflète les moeurs, avec l'exemple d'étudiante, dont le sens aujourd'hui est évident, mais qui au 19ème siècle, puisque les jeunes filles n'accédaient pas à l'université, désignait plutôt les petites copines des étudiants.
Certaines prises de position datant de peu d'années semblent ahurissantes, mais la langue est vivante et refuse les carcans. A vous de plonger dans ce livre vraiment fort intéressant et pas difficile d'accès (l'auteur, citant une fois un truc jargonnant, se permet de 'traduire'; merci à lui). Il reste pas mal à découvrir dans ces pages si riches et amenant à la réflexion. Perso, je ne sais si je dis auteur, auteure ou autrice?
Citons une partie de la conclusion
"Il est urgent que l'instance chargée du magistère de la langue rappelle que l'historie du lexique des métiers et fonctions fut marquée d'un resserrement social; qu'elle prenne acte de la disparition du féminin conjugal [ambassadrice = femme d'ambassadeur] [et pourtant Catherine de Médicis était régente, en tant que mère du roi trop jeune!], témoin d'une époque de minoration de la femme; qu'elle appelle à une féminisation de ce lexique: qu'elle encourage son emploi, se conformant à la distinction réaffirmée entre le spécifique particulier, désignant une personne, et le générique signifiant une fonction (une académicienne occupera un jour les fonctions de chancelier de l'Institut); qu'elle souligne par là même la richesse de l'expression linguistique (offrant plus de nuances, par exemple, qu'une abréviation à finalité inclusive);qu'elle se montre bienveillante envers les formes anciennes (écrivaine) pu néologiques (magistrate) formées dans les règles; qu'elle fasse preuve d'un peu d'audace en acceptant le commode suffixe francophone -eure. Au passage, quelle gratifie enfin le ministre d'une âme soeur."
ainsi qu'un passage sur l'écriture inclusive
"Nous recommandons la réduplication, c'est à dire l'explicitation lexicale (et non abréviative)de la mixité d'un groupe humain.Mais -et cette restriction nous paraît capitale - seulement quand une telle explication est requise ou souhaitée. En d'autres termes, le bon usage ainsi que la communication performante requièrent de faire diffuser dans un train le message : 'Tous les voyageurs sont priés de descendre.' Les formulations 'Tous les voyageurs et toutes les voyageuses', ainsi que 'Tout.es les voyageur.ses' sont en l'occurrence inappropriées. En revanche, informer que 'les candidats et les candidates passeront une épreuve de lancer de poids' est bienvenu. Où gît la différence? Dans l'intérêt reconnu d'exposer la mixité sexuelle du groupe considéré. Qui en est juge? Celui ou celle qui formule l'assertion , qui doit avoir conscience de l'enjeu et une certaine maîtrise du fonctionnement linguistique. Nous ne nous affilierons donc ni au purisme androcentriste ni au féminisme rudimentaire : nous suivrons la langue, en faisant confiance à ses locuteurs."
Lien : http://enlisantenvoyageant.b..
Bernard Cerquiglini suit l'affaire de la féminisation des mots depuis un certain temps, et c'est avec humour qu'il rappelle l'évolution des dernières années, en particulier la résistance de l'Académie française. Un feuilleton assez franco-français, puisque les francophones non français se posent moins de questions, et les québécois, en particulier, entourés du monde anglophone, se défendent et font preuve d'une belle inventivité. Il semble qu'on soit sur le bon chemin.
Des linguistes belges rappellent d'ailleurs qu'on peut féminiser intuitivement tous les substantifs animés humains du français, et citent des exemples, avoué, bourgmestre, échevin, ministre, etc., avec même des noms fictifs, tels calefrier, chapporé, ciremel, damilin, filiciste (je parie que vous y arrivez!)
Un chapitre fort gouleyant rappelle comment c'était dans le passé, là où on ne s'embarrassait pas de l'Académie, qui d'ailleurs n'existait pas. La féminisation s'en donnait à coeur joie, ou plutôt, tout ou presque existait, suivant ces règles intuitives.
Puis le masculin est venu établir sa loi, moquant certaines féminisations (pourtant avérées au Moyen âge...) et chipotant pas mal, par exemple on accepte une secrétaire si c'est une employée assez subalterne, mais pas une secrétaire si c'est la perpétuelle de l'Académie...
La langue reflète les moeurs, avec l'exemple d'étudiante, dont le sens aujourd'hui est évident, mais qui au 19ème siècle, puisque les jeunes filles n'accédaient pas à l'université, désignait plutôt les petites copines des étudiants.
Certaines prises de position datant de peu d'années semblent ahurissantes, mais la langue est vivante et refuse les carcans. A vous de plonger dans ce livre vraiment fort intéressant et pas difficile d'accès (l'auteur, citant une fois un truc jargonnant, se permet de 'traduire'; merci à lui). Il reste pas mal à découvrir dans ces pages si riches et amenant à la réflexion. Perso, je ne sais si je dis auteur, auteure ou autrice?
Citons une partie de la conclusion
"Il est urgent que l'instance chargée du magistère de la langue rappelle que l'historie du lexique des métiers et fonctions fut marquée d'un resserrement social; qu'elle prenne acte de la disparition du féminin conjugal [ambassadrice = femme d'ambassadeur] [et pourtant Catherine de Médicis était régente, en tant que mère du roi trop jeune!], témoin d'une époque de minoration de la femme; qu'elle appelle à une féminisation de ce lexique: qu'elle encourage son emploi, se conformant à la distinction réaffirmée entre le spécifique particulier, désignant une personne, et le générique signifiant une fonction (une académicienne occupera un jour les fonctions de chancelier de l'Institut); qu'elle souligne par là même la richesse de l'expression linguistique (offrant plus de nuances, par exemple, qu'une abréviation à finalité inclusive);qu'elle se montre bienveillante envers les formes anciennes (écrivaine) pu néologiques (magistrate) formées dans les règles; qu'elle fasse preuve d'un peu d'audace en acceptant le commode suffixe francophone -eure. Au passage, quelle gratifie enfin le ministre d'une âme soeur."
ainsi qu'un passage sur l'écriture inclusive
"Nous recommandons la réduplication, c'est à dire l'explicitation lexicale (et non abréviative)de la mixité d'un groupe humain.Mais -et cette restriction nous paraît capitale - seulement quand une telle explication est requise ou souhaitée. En d'autres termes, le bon usage ainsi que la communication performante requièrent de faire diffuser dans un train le message : 'Tous les voyageurs sont priés de descendre.' Les formulations 'Tous les voyageurs et toutes les voyageuses', ainsi que 'Tout.es les voyageur.ses' sont en l'occurrence inappropriées. En revanche, informer que 'les candidats et les candidates passeront une épreuve de lancer de poids' est bienvenu. Où gît la différence? Dans l'intérêt reconnu d'exposer la mixité sexuelle du groupe considéré. Qui en est juge? Celui ou celle qui formule l'assertion , qui doit avoir conscience de l'enjeu et une certaine maîtrise du fonctionnement linguistique. Nous ne nous affilierons donc ni au purisme androcentriste ni au féminisme rudimentaire : nous suivrons la langue, en faisant confiance à ses locuteurs."
Lien : http://enlisantenvoyageant.b..
Le titre provocateur et humoristique donne le ton : cet ouvrage est consacré à la féminisation des noms de métiers, et plus particulièrement des hautes fonctions publiques. L'auteur ne parle pas de l'écriture inclusive, un thème qui commence à émerger, mais se concentre sur le féminin des hautes fonctions : doit-on dire une préfète ? une procureure ? une députée ? ... L'auteur est lui-même spécialisé dans la linguistique et la grammaire.
La langue n'est pas neutre, il montre qu'elle est éminemment politique, surtout en France où elle est un instrument de pouvoir, du pouvoir, depuis le XVIIème siècle et l'instauration de l'Académie française qui se pose en gardien (au masculin) des règles, souvent contournées par l'usage ou la réalité.
En effet, le "masculin conjugal" n'est que de la misogynie. "Le genre neutre" n'est qu'un prétexte pour dire que le masculin doit l'emporter sur un féminin dit faible, les "néologismes absurdes et barbares " dénoncés par les Académiciens sont souvent hérités du Moyen-Âge.
Un ouvrage clair et savant, facile à lire grâce à l'humour et à l'engagement de l'auteur qui est féministe et pratique.
La langue n'est pas neutre, il montre qu'elle est éminemment politique, surtout en France où elle est un instrument de pouvoir, du pouvoir, depuis le XVIIème siècle et l'instauration de l'Académie française qui se pose en gardien (au masculin) des règles, souvent contournées par l'usage ou la réalité.
En effet, le "masculin conjugal" n'est que de la misogynie. "Le genre neutre" n'est qu'un prétexte pour dire que le masculin doit l'emporter sur un féminin dit faible, les "néologismes absurdes et barbares " dénoncés par les Académiciens sont souvent hérités du Moyen-Âge.
Un ouvrage clair et savant, facile à lire grâce à l'humour et à l'engagement de l'auteur qui est féministe et pratique.
Avec l'humour que tout le monde lui connait et qui fait un peu sa marque dans le monde linguistique, Bernard Cerquiglini retrace "l'épopée" de la féminisation de noms de métiers que l'Académie française s'est, pendant de longues années, évertuée à refuser. Pimenté d'exemples d'une drôlerie incroyable quand ça ne frôle pas le ridicule, ce récit du célèbre linguiste démontre comment ce refus de la féminisation des noms de métiers est lié, dans notre société, à une machisme éculé dont n'hésitent pas à user les noms moins célèbres, Maurice Druon ou Lévi-Strauss, pour ne citer qu'eux. Jusqu'au XVIIème siècle, le féminin existait dans tous les noms de métiers et pas seulement le féminin conjugal. La langue française a été dévoyée, détournée de son usage et de son histoire pour refuser aux femmes de reconnaitre le fait qu'elles puissent accéder à des métiers, des emplois, des fonctions que certains considéraient, voire, considèrent encore, comme réservés aux hommes. Mais, le français est une langue vivante. Et n'en déplaisent aux soi-disants puristes et notamment aux académiciens, le français est une langue parlée et,... parlée dans de nombreux pays dans lesquels les locuteurs (Québec, Belgique, Suisse, pays d'Afrique,....) l'ont fait évoluer, l'ont adaptée à l'évolution des moeurs et ont donc sans hésiter utilisé les noms de métiers dans leurs formes féminines lorsqu'ils sont occupés par des femmes. En France, il a fallu attendre les années 80 et l'arrivée de jeunes femmes audacieuses pour que les choses commencent à évoluer. Qui oserait encore aujourd'hui contester de nous appeler professeure, procureure, autrice ou auteure, écrivaine, etc.....
critiques presse (1)
Dans son dernier ouvrage, «Le ministre est enceinte», le linguiste Bernard Cerquiglini retrace avec humour et brio le difficile parcours de la féminisation des noms de métiers.
Lire la critique sur le site : Liberation
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Car la répulsion pour la néologie, le dépit dû à ce qui paraît une désinvolture francophone, la condescendance envers les femmes, la connivence acrimonieuse des mâles ne pourraient seuls justifier un tel entêtement. Nous sommes en France, où la langue tient du pouvoir, lequel ne se partage pas. Le Premier Ministre (avec l'accord du chef de l'Etat) était certes fondé à adopter, pour son administration, une néologie linguistique favorable à l'identité féminine ; l'Académie avait le droit de réprouver toute néologie. Nous sommes en France, où l'Etat prodigue charges et fonctions, protège une langue qui tout à la fois l'énonce et l'illustre. [...] On ne pouvait guère lier davantage l'action publique et l'innovation lexicale ; on ne pouvait affirmer autrement un dessin politique de stimuler la langue.
Il en est ainsi : l’attachement à la langue française est si fort et communément partagé que toute innovation langagière incommode.
Nous nous sommes attardé sur écrivaine, autrice, etc., jugeant ces termes révélateurs. Ils concentrent, tout d'abord, le mépris masculin. Les choses de l'esprit étant par excellence du domaine du mâle, toute femme se mêlant des lettres ne fait que singer : femmes savantes, bas-bleus, précieuses, ect., sont des caricatures. Une femme qui ose échapper à sa condition adopte une conduite simiesque. Le thème court la littérature ; il se veut parfois bienveillant, la femme étant glorifiée de rester parfaitement féminine.
Videos de Bernard Cerquiglini (18)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : féminisationVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Bernard Cerquiglini (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les emmerdeuses de la littérature
Les femmes écrivains ont souvent rencontré l'hostilité de leurs confrères. Mais il y a une exception parmi eux, un homme qui les a défendues, lequel?
Houellebecq
Flaubert
Edmond de Goncourt
Maupassant
Eric Zemmour
10 questions
563 lecteurs ont répondu
Thèmes :
écriture
, féminisme
, luttes politiquesCréer un quiz sur ce livre563 lecteurs ont répondu