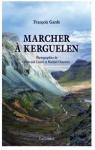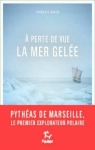Critiques de François Garde (379)
Narcisse Pelletier , dix-huit ans, alors que des matelots sont descendus sur une plage du nord de l'Australie à la recherche d'un peu d'eau, se retrouve abandonné sur la plage.
Sans eau ni nourriture, pendant plusieurs jours, il se rapproche d'une vieille aborigène qui va s'occuper de lui, l'intégrer au clan et lui permettre de survivre.
Dix-huit années passent et des marins anglais le découvrent sur la plage , nu et ne parlant qu'un langage qu'ils ne comprennent pas. Ils le ramènent vers la civilisation où l'on essaie de comprendre son origine et son histoire.
Inspiré d'une histoire vraie, ce livre a reçu huit prix littéraires et m'a fait passer un bon moment de lecture.
Sans eau ni nourriture, pendant plusieurs jours, il se rapproche d'une vieille aborigène qui va s'occuper de lui, l'intégrer au clan et lui permettre de survivre.
Dix-huit années passent et des marins anglais le découvrent sur la plage , nu et ne parlant qu'un langage qu'ils ne comprennent pas. Ils le ramènent vers la civilisation où l'on essaie de comprendre son origine et son histoire.
Inspiré d'une histoire vraie, ce livre a reçu huit prix littéraires et m'a fait passer un bon moment de lecture.
Un très beau récit qui m'a permis de découvrir Kergulen. Île que je ne connaissais nullement avant de tomber sur ce livre. J'affectionne les récits de voyage, d'aventure et une fois encore ce qui me frappe souvent et je pense ne pas me tromper en affirmant ceci : les grands marcheurs sont aussi de grands poètes. Une seule fois durant ma vie de lectrice j'ai été déçue par la plume d'une voyageuse qui n'avait fait que nous citer comme un inventaire ses différentes étapes sans un vrai regard ni émotion sur l'environnement. Et encore moins de poésie.
Bref, ici, je suis ravie et enchantée de parcourir ce lieu, et la générosité de l'auteur de nous faire partager son ressenti quant à cette marche pas toujours facile ni toujours agréable avec une météo tout autant peu facile et peu agréable. Et pourtant quel plaisir de se plonger au coeur de ce récit et de découvrir des paysages différents.
J'ai toujours une grande estime et admiration pour ces personnes qui s'engagent dans un périple où elles savent qu'un rien peu tout faire basculer, qu'ils devront souffrir, subir les affres de la nature, se contenter du rudimentaire, avoir parfois faim, froid, et que le seul fait d'avoir un refuge avec un toit, c'est Versailles.
Si j'aime autant ce genre de lecture, c'est qu'il permet au lecteur de vivre à travers ces témoignages la prise de conscience de la fragilité d'une vie, et que le bonheur n'est pas toujours là où l'on croit.
Certes je n'aurai pas les conditions physiques pour un exploit tel mais il me plairait de vivre une parcelle de cette aventure.
Marcher vous procure beaucoup de bienfait, et nous vide la tête, nous recentre sur l'essentiel d'être vivant tout simplement.
Une lecture qui répond et fait écho à bien d'autres grands marcheurs que j'ai pu lire et apprécier. Cet auteur va donc rejoindre les connus et moins connus sur les rayons de ma bibliothèque.
Bref, ici, je suis ravie et enchantée de parcourir ce lieu, et la générosité de l'auteur de nous faire partager son ressenti quant à cette marche pas toujours facile ni toujours agréable avec une météo tout autant peu facile et peu agréable. Et pourtant quel plaisir de se plonger au coeur de ce récit et de découvrir des paysages différents.
J'ai toujours une grande estime et admiration pour ces personnes qui s'engagent dans un périple où elles savent qu'un rien peu tout faire basculer, qu'ils devront souffrir, subir les affres de la nature, se contenter du rudimentaire, avoir parfois faim, froid, et que le seul fait d'avoir un refuge avec un toit, c'est Versailles.
Si j'aime autant ce genre de lecture, c'est qu'il permet au lecteur de vivre à travers ces témoignages la prise de conscience de la fragilité d'une vie, et que le bonheur n'est pas toujours là où l'on croit.
Certes je n'aurai pas les conditions physiques pour un exploit tel mais il me plairait de vivre une parcelle de cette aventure.
Marcher vous procure beaucoup de bienfait, et nous vide la tête, nous recentre sur l'essentiel d'être vivant tout simplement.
Une lecture qui répond et fait écho à bien d'autres grands marcheurs que j'ai pu lire et apprécier. Cet auteur va donc rejoindre les connus et moins connus sur les rayons de ma bibliothèque.
Régulièrement, je me replonge dans l'épopée napoléonienne. Tout ça à cause de mon grand-père qui m'offrit un livre illustré sur Napoléon quand j'étais gamine. le vieil homme était un conteur hors pair. Il sut me transmettre sa nostalgie de l'Empire. La biographie romancée de François Grade est moins érudite que les ouvrages d'un Jean Tulard et moins épique que les romans d'un Patrick Rambaud, mais elle est sincère. Comme nombre de protagonistes de l'épopée napoléonienne, Murat n'est pas un aristocrate ou un « fils de ». C'est un autodidacte issu d'une famille du Quercy. L'auteur est fasciné par la capacité de l'Empire à faire grimper des hommes du peuple en haut de l'échelle sociale. Il y a quelque chose de romantique dans cette gloire obtenue par l'ambition et la bravoure. le livre est construit autour de trois personnages, l'Empereur, sa soeur Caroline et celui sur lequel elle jeta son dévolu dès l'âge de 15 ans, le beau et vaillant Murat. Ce dernier passera sa vie à quémander la reconnaissance de son beau-frère, toujours un peu dédaigneux à son égard (p156). L'assentiment ne viendra qu'une fois, sous la forme d'une boutade (p260). Murat était pourtant prévenu, « jamais Bonaparte de s'est considéré comme redevable de quoi que ce soit envers quiconque ». On peut reprocher à François Garde de s'étonner de l'ingratitude de Napoléon sans jamais vraiment l'expliquer. Ce mystère constitue le ressort dramatique de ce livre aux accents shakespeariens – l'émancipation du fils. Avec plaisir, on traverse le siècle et l'Italie. La famille Murat n'a pas seulement mené une « vie d'expat. » dans le Golfe de Naples. Elle s'est imprégnée de cette terre accueillante, jusqu'à la marquer durablement de son empreinte (p280) – à noter le savoureux passage sur la robe de corail de Caroline et ses effets collatéraux sur la mode et le commerce (p201). Un bon moment de lecture donc, malgré les hésitations de l'auteur (comme beaucoup d'autres, « fascinés » avant lui) : retranscrire les faits historiques ou magnifier la force de ce destin hors norme.
Bilan : 🌹
Bilan : 🌹
François Garde nous raconte dans ce livre l'histoire de Narcisse Pelletier, jeune matelot de 18 ans qui va être abandonné sur une côte sauvage de l'Australie par l'équipage avec qui il naviguait. S'étant éloigné de ses camarades, lorsqu'il reviendra sur la plage sur laquelle ils ont débarqué, tout le monde ainsi que la goélette auront disparu. Difficile pour Narcisse d'envisager que le Saint Paul ne revienne le chercher. En attendant, sans eau et sans nourriture, il ne pourra pas survivre longtemps. C'est une vieille femme aborigène qui va le secourir. Évidemment, la communication est quasi impossible. Narcisse va suivre cette vieille femme et son clan, sans perdre l'espoir du retour du Saint-Paul. Ce n'est que 17 ans plus tard qu'il sera récupéré par un équipage et confié au gouverneur de Sydney. Celui-ci va chercher tout d'abord à savoir quelle est la nationalité de Narcisse avant de le mettre sous la protection d'Octave de Vallombrun, jeune explorateur français. On va alors assister au retour très progressif de Narcisse à la civilisation. En effet, après 17 ans passés parmi les aborigènes, celui-ci a tout oublié, sa langue, d'où il vient, qui était sa famille... Le retour en France sera difficile. Narcisse ne racontera que très peu de choses de sa vie parmi les aborigènes et pour sa famille, il avait été déclaré mort par le capitaine du bateau sur lequel il avait embarqué et ils avaient fait leur deuil. Difficile de renouer les liens avec quelqu'un qui leur est totalement étranger.
Ce livre a reçu le prix Goncourt du premier roman en 2012 et c'est largement mérité. Cette lecture est très intéressante, et très abordable.
Ce livre a reçu le prix Goncourt du premier roman en 2012 et c'est largement mérité. Cette lecture est très intéressante, et très abordable.
L'auteur s'intéresse à une certain oncle dont personne n'a jamais parlé dans la famille, sauf une fois une grande-tante.
Cette évocation éveille sa curiosité et il se lance dans des recherches pour savoir qui était ce fameux oncle Marcel, qui serait parti en Australie vers 1900 à l'âge de vingt ans.
Étrange qu'il ne soit jamais mentionné, sauf dans les carnets de son père qui malheureusement n'en savait pas grand chose, victime lui aussi de ce lourd secret familial.
Alors, François Garde écrit une première partie où il imagine l'existence de l'oncle Marcel débarquant seul en Australie.
Puis il poursuit ses recherches dans les archives militaires et découvre alors une toute autre réalité dont il ne parlera pas à son père alors âgé de 93 ans.
C'est lui alors le seul détenteur de ce secret de famille qui aura duré un siècle.
A priori lui seul détiendra la vérité.
Une histoire très intéressante qui en dit long sur les secrets de famille.
Il mettra huit ans à le terminer, entre les doutes, les incertitudes, les découragements.
Mais il ira finalement a u bout, pour faire revivre l'oncle Marcel et le réhabiliter après cette centaine d années de silence.
C'est très bien écrit, et l'on ressent tout ce qu'a du ressentir l'auteur au cours de sa quête.
Un beau partage d'un pas de sa vie.
Merci Myriam
Cette évocation éveille sa curiosité et il se lance dans des recherches pour savoir qui était ce fameux oncle Marcel, qui serait parti en Australie vers 1900 à l'âge de vingt ans.
Étrange qu'il ne soit jamais mentionné, sauf dans les carnets de son père qui malheureusement n'en savait pas grand chose, victime lui aussi de ce lourd secret familial.
Alors, François Garde écrit une première partie où il imagine l'existence de l'oncle Marcel débarquant seul en Australie.
Puis il poursuit ses recherches dans les archives militaires et découvre alors une toute autre réalité dont il ne parlera pas à son père alors âgé de 93 ans.
C'est lui alors le seul détenteur de ce secret de famille qui aura duré un siècle.
A priori lui seul détiendra la vérité.
Une histoire très intéressante qui en dit long sur les secrets de famille.
Il mettra huit ans à le terminer, entre les doutes, les incertitudes, les découragements.
Mais il ira finalement a u bout, pour faire revivre l'oncle Marcel et le réhabiliter après cette centaine d années de silence.
C'est très bien écrit, et l'on ressent tout ce qu'a du ressentir l'auteur au cours de sa quête.
Un beau partage d'un pas de sa vie.
Merci Myriam
Pythéas ?
C'est toujours un nom qui dit quelque chose mais cela reste souvent un peu brumeux.
Pythéas un lien avec l'antiquité ? un lien avec le voyage ? un lien peut être avec Marseille ou Massalia.
Peut être tout cela à la fois.
Il faut dire qu'il nous aide pas trop Pythéas ! il a fait des choses extraordinaires mais tous ces écrits et récits ont disparu.
Donc résumons , Pythéas est un phocéen venu s'installer à Massalia vers 330 avant JC. Il fut commerçant , navigateur, édile de Massalia. Il rencontra Alexandre le Grand à Babylone .
Avec ses bateaux il fit du commerce dans la Méditerranée mais surtout dans l'Atlantique Nord vers l'Ile Verte , l'Autre Bretagne et l'énigmatique Thulé. Il découvrit les marées , les aurores boréales et les Mers gelées.
La plupart des élites de l'Antiquité le traitèrent d'affabulateur. Ses écrits ayant disparus il tomba dans l'oubli.
Fermez le ban.
C'est sans compter sur François Garde qui nous propose une biographie imaginaire magnifique.
A travers cette biographie, il interroge le parcours de Pytheas et la notion d'explorateur de terres inconnues.
c'est toujours palpitant , curieux et écrit élégamment.
Jusqu'ou s'agit il d'une biographie imaginaire ? Les personnages qui entourent Pythéas sont imaginaires mais ce qu'à vécu Pythéas est réel. Comment croire qu'il fut un affabulateur.
Tout donne à penser que Pytheas fut le 1er explorateur des terres inconnues de l'Atlantique Nord.
Malheureusement il a mal choisi sa ville.
Marseille ou Massalia , une ville tournée vers le Sud et non vers le Nord .
Un agréable dépaysement , à perte de vue.
Lien : https://auventdesmots.wordpr..
C'est toujours un nom qui dit quelque chose mais cela reste souvent un peu brumeux.
Pythéas un lien avec l'antiquité ? un lien avec le voyage ? un lien peut être avec Marseille ou Massalia.
Peut être tout cela à la fois.
Il faut dire qu'il nous aide pas trop Pythéas ! il a fait des choses extraordinaires mais tous ces écrits et récits ont disparu.
Donc résumons , Pythéas est un phocéen venu s'installer à Massalia vers 330 avant JC. Il fut commerçant , navigateur, édile de Massalia. Il rencontra Alexandre le Grand à Babylone .
Avec ses bateaux il fit du commerce dans la Méditerranée mais surtout dans l'Atlantique Nord vers l'Ile Verte , l'Autre Bretagne et l'énigmatique Thulé. Il découvrit les marées , les aurores boréales et les Mers gelées.
La plupart des élites de l'Antiquité le traitèrent d'affabulateur. Ses écrits ayant disparus il tomba dans l'oubli.
Fermez le ban.
C'est sans compter sur François Garde qui nous propose une biographie imaginaire magnifique.
A travers cette biographie, il interroge le parcours de Pytheas et la notion d'explorateur de terres inconnues.
c'est toujours palpitant , curieux et écrit élégamment.
Jusqu'ou s'agit il d'une biographie imaginaire ? Les personnages qui entourent Pythéas sont imaginaires mais ce qu'à vécu Pythéas est réel. Comment croire qu'il fut un affabulateur.
Tout donne à penser que Pytheas fut le 1er explorateur des terres inconnues de l'Atlantique Nord.
Malheureusement il a mal choisi sa ville.
Marseille ou Massalia , une ville tournée vers le Sud et non vers le Nord .
Un agréable dépaysement , à perte de vue.
Lien : https://auventdesmots.wordpr..
Une aventure improbable : traverser Kerguelen du nord au sud. Une aventure de vingt-cinq jours que François Garde relate d'une plume très agréable.
Vingt-cinq jours de vent, de pluie, de froid à traverser un paysage austère fait de rocailles, de souilles, de lacs, de rivières où il faut tracer sa voie car ces terres sont vierges.
Vingt-cinq jours à passer de fjords en éboulis, de moraines désertes en manchotières grouillantes de manchots et d'éléphants de mers indifférents.
Vingt cinq jours où le paysage est toujours le même et toujours changeant, baptisé des noms les plus divers et dont on se demande bien pour qui.
Enfin vingt-cinq jours partagés à quatre dans une tente pour trois, peinant sous le poids de sacs de vingt cinq kilos, où Michel Garde décrit admirablement le spectacle fascinant de ces Terres Australes en nous faisant partager les pensées profondes qui le traversent.
Une pérégrination qui cependant ne lui apporté ni sagesse, ni philosophie, car il n'en demandait pas tant et parce que Kerguelen ne se laisse pas conquérir.
Vingt-cinq jours de vent, de pluie, de froid à traverser un paysage austère fait de rocailles, de souilles, de lacs, de rivières où il faut tracer sa voie car ces terres sont vierges.
Vingt-cinq jours à passer de fjords en éboulis, de moraines désertes en manchotières grouillantes de manchots et d'éléphants de mers indifférents.
Vingt cinq jours où le paysage est toujours le même et toujours changeant, baptisé des noms les plus divers et dont on se demande bien pour qui.
Enfin vingt-cinq jours partagés à quatre dans une tente pour trois, peinant sous le poids de sacs de vingt cinq kilos, où Michel Garde décrit admirablement le spectacle fascinant de ces Terres Australes en nous faisant partager les pensées profondes qui le traversent.
Une pérégrination qui cependant ne lui apporté ni sagesse, ni philosophie, car il n'en demandait pas tant et parce que Kerguelen ne se laisse pas conquérir.
Quand le matelot Narcisse Pelletier, oublié sur une plage déserte d'Australie, regarde s'éloigner la goélette Saint Paul, il fait le serment de survivre.
18 ans plus tard, le vicomte Octave de Vallombrun, rencontre ce 'sauvage blanc' amnésique, capturé par les Anglais, extraordinaire relation lors de laquelle Narcisse réapprend le français et ses coutumes sans jamais raconter son séjour avec les sauvages mais en laissant transparaître à travers son comportement les bribes d'une culture idéale, paisible.
Nous suivons alternativement le matelot recueilli par les sauvages et sa rééducation à l'occidentale, tour de force qui ne laisse aucun temps mort et j'ai passé 7 excellentes heures d'écoute!
18 ans plus tard, le vicomte Octave de Vallombrun, rencontre ce 'sauvage blanc' amnésique, capturé par les Anglais, extraordinaire relation lors de laquelle Narcisse réapprend le français et ses coutumes sans jamais raconter son séjour avec les sauvages mais en laissant transparaître à travers son comportement les bribes d'une culture idéale, paisible.
Nous suivons alternativement le matelot recueilli par les sauvages et sa rééducation à l'occidentale, tour de force qui ne laisse aucun temps mort et j'ai passé 7 excellentes heures d'écoute!
On pourrait se contenter du titre pour résumer l’histoire de ce matelot français, Narcisse Pelletier qui, après avoir été recueilli dix-sept ans au sein d’une tribu aborigène du Nord Est de l’Australie, est miraculeusement « sauvé » pour réintégrer la société civilisée.
Pourtant il y a bien plus qu’une histoire réelle romancée dans ce récit. Ces quelques trois cent pages interrogent notre rapport à la civilisation et à l’autre, bousculent s’il en est besoin nos idées sur les sociétés dites sauvage et civilisée car « ce qui a commencé sur une plage déserte d’Australie oblige à penser l’Homme autrement ».
Oublié sur une terre inconnue en apparence hostile, sans eau potable ni nourriture, muni d’un seul couteau et d’un pantalon pour seuls biens, le jeune matelot a dû apprendre à survivre pour espérer un jour être retrouvé par une chaloupe…
Fortuitement découvert par un équipage en route pour Sydney, on aurait pu croire son calvaire terminé. Et pourtant le retour à la société n’est pas aisé pour celui qui a oublié sa langue, ses origines, sa culture.
Comment un « homme blanc » que le récit ne privera pas d’intelligence a pu s’oublier soi-même au point de ne plus reconnaître les codes et les usages « des siens » et s’exprimer uniquement avec une voix gutturale et des claquements de langue ?
C’est l’énigme que tente de résoudre Octave, géographe de formation et enthousiaste sous l’œil de la communauté scientifique puis de la population.
Avec un style appliqué et une rigueur méthodique, François Garde s’intéresse à cette question de l’homme sauvage, maintenue en suspens par un sentiment permanent de fragilité et de tâtonnement mêlés. On suit les observations et les raisonnements de chacun sur cette aventure inédite. On arpente le chemin parsemé d’obstacles et parfois douloureux de ces deux hommes confrontés à des questions nouvelles dans ce qui apparaît comme une démarche plus ou moins volontaire de rapprocher deux mondes différents.
Vont-ils y parvenir ? Rien n’est moins sûr dés lors que l’on franchit les portes de l’inconnu. La progression lente du récit maintient habilement le doute et la perplexité : on parcourt un récit à double voix qui alterne entre le poids écrasant de la culture occidentale au sein d’une tribu primitive et la volonté farouche de réveiller les sonorités familières comme les apprentissages élémentaires chez ce sauvage blanc pour qu’il se réapproprie ce qu’il a gardé au fond de lui et auquel il a renoncé.
Ainsi présenté, on se dit que les récits sont amenés à ne jamais se croiser. Mais c’est un roman où rien n’est acquis, rien n’est intangible. Les frontières du monde connu vacillent.
Si l’auteur privilégie la dimension romanesque de ce fait divers, il n’oublie pas pour autant de faire cohabiter le récit avec un formidable élan en faveur de quelques perspectives anthropologiques inédites pour l’époque en introduisant la nécessité de redéfinir l’Homme et son environnement. Il annonce l’ouverture de nouveaux champs d’interprétation pour la science mais le talent de François Garde est certainement de raconter cette histoire avec les perspectives, les enthousiasmes et les déceptions du XIXe.
Pourtant il y a bien plus qu’une histoire réelle romancée dans ce récit. Ces quelques trois cent pages interrogent notre rapport à la civilisation et à l’autre, bousculent s’il en est besoin nos idées sur les sociétés dites sauvage et civilisée car « ce qui a commencé sur une plage déserte d’Australie oblige à penser l’Homme autrement ».
Oublié sur une terre inconnue en apparence hostile, sans eau potable ni nourriture, muni d’un seul couteau et d’un pantalon pour seuls biens, le jeune matelot a dû apprendre à survivre pour espérer un jour être retrouvé par une chaloupe…
Fortuitement découvert par un équipage en route pour Sydney, on aurait pu croire son calvaire terminé. Et pourtant le retour à la société n’est pas aisé pour celui qui a oublié sa langue, ses origines, sa culture.
Comment un « homme blanc » que le récit ne privera pas d’intelligence a pu s’oublier soi-même au point de ne plus reconnaître les codes et les usages « des siens » et s’exprimer uniquement avec une voix gutturale et des claquements de langue ?
C’est l’énigme que tente de résoudre Octave, géographe de formation et enthousiaste sous l’œil de la communauté scientifique puis de la population.
Avec un style appliqué et une rigueur méthodique, François Garde s’intéresse à cette question de l’homme sauvage, maintenue en suspens par un sentiment permanent de fragilité et de tâtonnement mêlés. On suit les observations et les raisonnements de chacun sur cette aventure inédite. On arpente le chemin parsemé d’obstacles et parfois douloureux de ces deux hommes confrontés à des questions nouvelles dans ce qui apparaît comme une démarche plus ou moins volontaire de rapprocher deux mondes différents.
Vont-ils y parvenir ? Rien n’est moins sûr dés lors que l’on franchit les portes de l’inconnu. La progression lente du récit maintient habilement le doute et la perplexité : on parcourt un récit à double voix qui alterne entre le poids écrasant de la culture occidentale au sein d’une tribu primitive et la volonté farouche de réveiller les sonorités familières comme les apprentissages élémentaires chez ce sauvage blanc pour qu’il se réapproprie ce qu’il a gardé au fond de lui et auquel il a renoncé.
Ainsi présenté, on se dit que les récits sont amenés à ne jamais se croiser. Mais c’est un roman où rien n’est acquis, rien n’est intangible. Les frontières du monde connu vacillent.
Si l’auteur privilégie la dimension romanesque de ce fait divers, il n’oublie pas pour autant de faire cohabiter le récit avec un formidable élan en faveur de quelques perspectives anthropologiques inédites pour l’époque en introduisant la nécessité de redéfinir l’Homme et son environnement. Il annonce l’ouverture de nouveaux champs d’interprétation pour la science mais le talent de François Garde est certainement de raconter cette histoire avec les perspectives, les enthousiasmes et les déceptions du XIXe.
Au milieu du XIXe siècle, Narcisse, jeune matelot à bord de la goélette Saint Paul est oublié sur une plage d'Australie, lors d'une aiguade (trouver de l'eau douce pour l'équipage). Or, le mouillage est dangereux, la mer est mauvaise, un gros temps pointe à l'horizon. Le capitaine,impatient décide de prendre le large...
Narcisse, après sa recherche sans succès, de retour sur la plage découvre que la goélette ne l'a pas attendu.
Que faire ? l'espoir du retour du Saint Paul diminue, au fil des heures, des jours. La peur de l'inconnu, le désespoir l'oblige, pour sa survie, à découvrir cette île qui semble déserte.
L'aventure commence... Qu'adviendra-t-il de ce jeune garçon abandonné en pleine nature n'ayant pour se défendre que son couteau de poche.
Voici un roman-récit lu avec beaucoup de plaisir.
Au fur et à masure des découvertes que rencontrera Narcisse, il est abordé un sujet qui incite à la réflexion : l'identité. Narcisse est resté 17 ans sans revoir un homme blanc. Il a dû s'adapter à vivre dans un milieu primitif qui l'a transformé.
Sauvé par hasard et avec bienveillance par un homme dévoué, il devra pour son bien (?) renouer avec le mode de vie civilisée dont il a tout oublié.
Interrogé sur sa vie sauvage narcisse refuse de parler "parler c'est mourir" dit-il. (Page 350) Parler, c'est parler de l'indicible de ces journées là-bas c'est raconter, c'est mettre en mots ses souvenirs à jamais frappés d'interdit. S'il répondait aux questions, il se mettait dans le danger le plus extrême. Mourir, non pas de mort clinique, mais mourir de ne pas pouvoir être en même temps blanc et sauvage.
Il ne pouvait pas répondre. Il s'est enfui (page 351).
Pourquoi sa fuite ? après tant d'épreuves ?et qu'est-il advenu du sauvage blanc ?
Ecrit dans une langue claire, élégante, voici un beau roman qui incite à la réflexion.
Narcisse, après sa recherche sans succès, de retour sur la plage découvre que la goélette ne l'a pas attendu.
Que faire ? l'espoir du retour du Saint Paul diminue, au fil des heures, des jours. La peur de l'inconnu, le désespoir l'oblige, pour sa survie, à découvrir cette île qui semble déserte.
L'aventure commence... Qu'adviendra-t-il de ce jeune garçon abandonné en pleine nature n'ayant pour se défendre que son couteau de poche.
Voici un roman-récit lu avec beaucoup de plaisir.
Au fur et à masure des découvertes que rencontrera Narcisse, il est abordé un sujet qui incite à la réflexion : l'identité. Narcisse est resté 17 ans sans revoir un homme blanc. Il a dû s'adapter à vivre dans un milieu primitif qui l'a transformé.
Sauvé par hasard et avec bienveillance par un homme dévoué, il devra pour son bien (?) renouer avec le mode de vie civilisée dont il a tout oublié.
Interrogé sur sa vie sauvage narcisse refuse de parler "parler c'est mourir" dit-il. (Page 350) Parler, c'est parler de l'indicible de ces journées là-bas c'est raconter, c'est mettre en mots ses souvenirs à jamais frappés d'interdit. S'il répondait aux questions, il se mettait dans le danger le plus extrême. Mourir, non pas de mort clinique, mais mourir de ne pas pouvoir être en même temps blanc et sauvage.
Il ne pouvait pas répondre. Il s'est enfui (page 351).
Pourquoi sa fuite ? après tant d'épreuves ?et qu'est-il advenu du sauvage blanc ?
Ecrit dans une langue claire, élégante, voici un beau roman qui incite à la réflexion.
Narcisse Pelletier n'a que dix-huit ans lorsque, en compagnie de quelques matelots, il pose les pieds sur une plage en apparence déserte du nord-est de l'Australie. Ils ont débarqué d'une chaloupe avec pour mission de trouver de l'eau potable à rapporter à bord de la goélette Saint-Paul. Parti seul de son côté explorer les arrières du rivage, Narcisse revient bredouille.
"Quand il parvint au sommet de la petite falaise, il découvrit qu'il y était seul. La chaloupe n'était plus tirée sur la plage, ne nageait pas sur les eaux turquoises. La goélette n'était plus au mouillage à l'entrée de la baie, aucune voile n'apparaissait même à l'horizon. Il ferma les yeux, secoua la tête. Rien n'y fit. Ils étaient partis."
Ainsi débute cet excellent roman.
Dix-sept années plus tard, en 1861, Octave de Vallombrun, membre de la Société de Géographie, faisant escale à Sydney se voit sollicité par le gouverneur et convié à une réunion cosmopolite permettant de statuer sur la nationalité d'un blanc qu'un navire anglais à découvert sur une plage, nu, tatoué et s'exprimant dans un langage inconnu. Il apparaît bien vite que cet homme est Narcisse Pelletier. Mais de Vallombrun ne le découvrira que petit à petit car celui qu'on appelle désormais le sauvage blanc a non seulement oublié sa langue mais aussi sa culture d'origine. Vallombrun est officiellement chargé de le ramener en France, il a devant lui de longs mois de voyage pour rééduquer ce drôle de sauvage.
Si l'on découvre d'abord les premiers pas de Narcisse au sein de la tribu aborigène qui l'a sauvé d'une mort certaine, on pourrait se croire embarquer pour un simple roman d'aventures anthropologiques. Mais très vite on abandonne provisoirement ce genre pour le registre épistolaire puisque de Vallombrun va entretenir une longue correspondance avec le président de la Société de Géographie auquel il livre ses observations, l'évolution de ses relations avec Narcisse, ses interrogations, ses doutes, et cela même bien après le retour en France. Les chapitres donnent voix alternativement au naufragé et au scientifique.
C'est un roman bourré de charme et de talent.
Charme de l'aventure humaine qui va lier ces deux hommes : point trop d'angélisme, puisque d'un côté de Vallombrun compte bien sur cette expérience pour redorer son blason d'explorateur et asseoir ainsi son autorité au sein de la Société de Géographie, et que de l'autre Narcisse garde une part de son mystère. Il y a cependant beaucoup d'humanité dans cette relation qui réunit des mondes opposés, un noble et un matelot, un civilisé et un sauvage ayant pourtant appartenu au monde du premier.
Talent du style et de l'écriture qui eux aussi alternent avec aisance selon les chapitres. L'élégance des lettres de de Vallombrun et de ses questionnements sont un réel plaisir littéraire, et le cheminement intérieur de Narcisse, plus naïf et touchant, trouvent un équilibre parfait pour aborder le thème de la différence et du lien aux autres. Au-delà de la réflexion sur la notion de civilité ou, comme disent certains, de civilisation, se profile le thème de la double appartenance avec les conflits qu'elle génère qui peuvent aller jusqu'à la folie. Au final, le tout nous ramène inéluctablement à notre époque...
Premiers pas dans la fiction pour un auteur qui un temps porta un titre un peu ronflant et qu'on dirait venu d'un autre siècle, puisqu'il fut de 2000 à 2005 "Administrateur supérieur des Terres australes et antartiques françaises", si, si, ça existe encore... Cela étant, ce livre est une belle réussite dont on a peu entendu parler, un de plus !
Lien : http://moustafette.canalblog..
"Quand il parvint au sommet de la petite falaise, il découvrit qu'il y était seul. La chaloupe n'était plus tirée sur la plage, ne nageait pas sur les eaux turquoises. La goélette n'était plus au mouillage à l'entrée de la baie, aucune voile n'apparaissait même à l'horizon. Il ferma les yeux, secoua la tête. Rien n'y fit. Ils étaient partis."
Ainsi débute cet excellent roman.
Dix-sept années plus tard, en 1861, Octave de Vallombrun, membre de la Société de Géographie, faisant escale à Sydney se voit sollicité par le gouverneur et convié à une réunion cosmopolite permettant de statuer sur la nationalité d'un blanc qu'un navire anglais à découvert sur une plage, nu, tatoué et s'exprimant dans un langage inconnu. Il apparaît bien vite que cet homme est Narcisse Pelletier. Mais de Vallombrun ne le découvrira que petit à petit car celui qu'on appelle désormais le sauvage blanc a non seulement oublié sa langue mais aussi sa culture d'origine. Vallombrun est officiellement chargé de le ramener en France, il a devant lui de longs mois de voyage pour rééduquer ce drôle de sauvage.
Si l'on découvre d'abord les premiers pas de Narcisse au sein de la tribu aborigène qui l'a sauvé d'une mort certaine, on pourrait se croire embarquer pour un simple roman d'aventures anthropologiques. Mais très vite on abandonne provisoirement ce genre pour le registre épistolaire puisque de Vallombrun va entretenir une longue correspondance avec le président de la Société de Géographie auquel il livre ses observations, l'évolution de ses relations avec Narcisse, ses interrogations, ses doutes, et cela même bien après le retour en France. Les chapitres donnent voix alternativement au naufragé et au scientifique.
C'est un roman bourré de charme et de talent.
Charme de l'aventure humaine qui va lier ces deux hommes : point trop d'angélisme, puisque d'un côté de Vallombrun compte bien sur cette expérience pour redorer son blason d'explorateur et asseoir ainsi son autorité au sein de la Société de Géographie, et que de l'autre Narcisse garde une part de son mystère. Il y a cependant beaucoup d'humanité dans cette relation qui réunit des mondes opposés, un noble et un matelot, un civilisé et un sauvage ayant pourtant appartenu au monde du premier.
Talent du style et de l'écriture qui eux aussi alternent avec aisance selon les chapitres. L'élégance des lettres de de Vallombrun et de ses questionnements sont un réel plaisir littéraire, et le cheminement intérieur de Narcisse, plus naïf et touchant, trouvent un équilibre parfait pour aborder le thème de la différence et du lien aux autres. Au-delà de la réflexion sur la notion de civilité ou, comme disent certains, de civilisation, se profile le thème de la double appartenance avec les conflits qu'elle génère qui peuvent aller jusqu'à la folie. Au final, le tout nous ramène inéluctablement à notre époque...
Premiers pas dans la fiction pour un auteur qui un temps porta un titre un peu ronflant et qu'on dirait venu d'un autre siècle, puisqu'il fut de 2000 à 2005 "Administrateur supérieur des Terres australes et antartiques françaises", si, si, ça existe encore... Cela étant, ce livre est une belle réussite dont on a peu entendu parler, un de plus !
Lien : http://moustafette.canalblog..
Prix Goncourt du premier roman particulièrement mérité, ce livre m'a fasciné/
Nous sommes en présence d’un Robinson atypique, resté 18 ans ( la moitié de sa vie) sur une île (peut-être) de la côte Est australienne en compagnie d’une tribu sans doute aborigène et qui perd peu à peu ses marques et son histoire de mousse vendéen parti tôt vers les tropiques.
Lorsque le Vicomte Octave de Vallombrun, membre de la société de géographie, le récupère à Sidney il va tenter de le faire revenir à la civilisation. Un choix de lettre à son mentor parisien décrit les « progrès » de Narcisse Pelletier, sauvage blanc, qui redécouvre le langage mais pas le sens des mots. En parallèle Narcisse raconte une partie de son histoire jusqu’au moment sans doute où sa raison bascule d’une société à une autre.
Ce conte basé sur une histoire vraie est particulièrement bien tourné et le récit est passionnant d’autant qu’il ne tombe pas dans les pièges habituels. Il nous égare avec ravissement.
Où est sa vraie patrie, quelle est sa vraie famille, la notion même d’amitié sont les questions que l’on se pose à propos de Narcisse (prénom particulièrement bien choisi pour un homme qui regarde sa vie à l’envers, dans un reflet). Octave ne sait même pas lui-même quels sont les sentiments que lui inspire avec tant de passion retenue, son cadet de 4 ans.
Voici donc une perle, comme celle que Narcisse découvre dans une huitre et qu’il faut garder précieusement dans la bibliothèque.
Lorsqu’il accepte la mission que lui confie la veuve de son 106ème client, Philippe Zafar est loin de se douter qu’il va s’embarquer dans une enquête qui le mènera sur trois continents.
Dans les archives de Thomas Colbert, il découvre un mystérieux courrier apparemment de la main du défunt relatant la relation d’un jeune matelot recruté lors d’une escale pour « honorer » une jeune femme masquée, avec 3 couronnes d’or pour salaire.
Est-ce une confession ou une pure fiction ?
Madame Colbert qui n’a pas eu d’enfant avec son mari demande alors à Zafar de percer ce mystère afin de savoir si un héritier est né de cette rencontre.
François Garde nous entraîne alors dans une lecture passionnante entre polar et roman d’aventure.
« Pour trois couronnes » j’ai fait un bien beau voyage !
Dans les archives de Thomas Colbert, il découvre un mystérieux courrier apparemment de la main du défunt relatant la relation d’un jeune matelot recruté lors d’une escale pour « honorer » une jeune femme masquée, avec 3 couronnes d’or pour salaire.
Est-ce une confession ou une pure fiction ?
Madame Colbert qui n’a pas eu d’enfant avec son mari demande alors à Zafar de percer ce mystère afin de savoir si un héritier est né de cette rencontre.
François Garde nous entraîne alors dans une lecture passionnante entre polar et roman d’aventure.
« Pour trois couronnes » j’ai fait un bien beau voyage !
Agréable découverte de cette rentrée littéraire, ce roman dont je n'avais pas entendu parler m'a accrochée grâce à sa quatrième de couverture. Elle suffit amplement à planter le décors et donner envie d'en savoir plus. Et je n'ai pas été déçue. Bien écrit, le suspense est maintenu, et le sujet donne à réfléchir.
Un auteur à suivre...
Un auteur à suivre...
Abandonné à 18 ans au 19 ème siècle par son bateau et par ses compagnons sur une plage d'Australie, Narcisse Pelletier y restera presque 17 ans. Il allait chercher de l'eau pour ravitailler son bateau. Mais celui-ci lèvera l'ancre sans lui. Pourquoi a t-il été abandonné ? Le jeune homme préfère ne pas penser à un oubli de ses compagnons :"Ce n'était pas un abandon délibéré, une trahison qui le visait personnellement, mais la conséquence d'une situation périlleuse."
Retrouvé et "adopté" par une vieille femme noire, membre d'une tribu aborigène, il va, après s'être fait dépouiller de ses habits, de son couteau, de ses habits et de son anneau de laiton dans l'oreille, suivre, nu, la vie de cette tribu d'aborigènes et en adopter les meurs et coutumes.
Il est finalement retrouvé par un navire anglais qui le ramènera à Sydney. Il sera rapatrié en France par Octave de Vallombrun, qui en qualité d'explorateur, et de scientifique membre de la Société de Géographie le prendra en charge, se passionnera pour lui, pour son expérience. Narcisse sauvage redevenu homme civilisé a toutefois perdu toute notion de ses origines et de sa de sa langue natale.
A la lecture du premier chapitre on pense relire le roman de Robinson Crusoé, mais dès le début du deuxième, on voit apparaitre ce scientifique écrivant à un mystérieux "Président", nous confirmant qu'il a pris en charge un "sauvage blanc", un scientifique qui essayera de comprendre ce qui s'est passé
Tout le roman est construit sur cette alternance de chapitres décrivant le drame de Narcisse après son abandon, ses réflexions, son désespoir et sa lente acclimatation à cette nouvelle vie, sa lente intégration à la tribu, à ses modes de vie, son apprentissage de cette nouvelle langue, des outils aborigènes, ses espoirs et désespoirs et de chapitres dans lesquels Octave de Vallombrun écrit au Président de la Société de Géographie en décrivant le lent travail de reconstruction et d'apprentissage qu'il mène pour réapprendre le français à Narcisse. Un Narcisse qui a tout perdu, langage, mémoire, passé et même son nom. Il devra tout réapprendre pour s'intégrer à la vie du 19ème siècle.
Narcisse parlera t-il, racontera t-il le détail de sa vie de sauvage, se souviendra t-il de sa vie de marin ?
Cette alternance de chapitres, cette suite d'interrogations rend ce roman agréable à lire et instructif.
Un roman inspiré d'une histoire vraie
Un auteur, une histoire et une période que j'ai eu plaisir à découvrir.
Lien : https://mesbelleslectures.co..
Retrouvé et "adopté" par une vieille femme noire, membre d'une tribu aborigène, il va, après s'être fait dépouiller de ses habits, de son couteau, de ses habits et de son anneau de laiton dans l'oreille, suivre, nu, la vie de cette tribu d'aborigènes et en adopter les meurs et coutumes.
Il est finalement retrouvé par un navire anglais qui le ramènera à Sydney. Il sera rapatrié en France par Octave de Vallombrun, qui en qualité d'explorateur, et de scientifique membre de la Société de Géographie le prendra en charge, se passionnera pour lui, pour son expérience. Narcisse sauvage redevenu homme civilisé a toutefois perdu toute notion de ses origines et de sa de sa langue natale.
A la lecture du premier chapitre on pense relire le roman de Robinson Crusoé, mais dès le début du deuxième, on voit apparaitre ce scientifique écrivant à un mystérieux "Président", nous confirmant qu'il a pris en charge un "sauvage blanc", un scientifique qui essayera de comprendre ce qui s'est passé
Tout le roman est construit sur cette alternance de chapitres décrivant le drame de Narcisse après son abandon, ses réflexions, son désespoir et sa lente acclimatation à cette nouvelle vie, sa lente intégration à la tribu, à ses modes de vie, son apprentissage de cette nouvelle langue, des outils aborigènes, ses espoirs et désespoirs et de chapitres dans lesquels Octave de Vallombrun écrit au Président de la Société de Géographie en décrivant le lent travail de reconstruction et d'apprentissage qu'il mène pour réapprendre le français à Narcisse. Un Narcisse qui a tout perdu, langage, mémoire, passé et même son nom. Il devra tout réapprendre pour s'intégrer à la vie du 19ème siècle.
Narcisse parlera t-il, racontera t-il le détail de sa vie de sauvage, se souviendra t-il de sa vie de marin ?
Cette alternance de chapitres, cette suite d'interrogations rend ce roman agréable à lire et instructif.
Un roman inspiré d'une histoire vraie
Un auteur, une histoire et une période que j'ai eu plaisir à découvrir.
Lien : https://mesbelleslectures.co..
J'ai découvert François GARDE avec son dernier livre « LA BALEINE DANS TOUS SES ETATS ».
J’ai beaucoup aimé son approche et sa façon de parler du vivant, alors je viens de lire son premier roman inspiré d'une histoire vraie: celle d' un marin breton abandonné sur les côtes australiennes au milieu du XIX° siècle puis sa rencontre avec une tribu pacifique à laquelle il a fini par s’intégrer pendant 17 ans mais aussi le récit de voyages et des efforts continus de son découvreur et tuteur, un français membre de la Société Nationale de Géographie, qui espérait pouvoir le ramener à la civilisation occidentale.
Une analyse anthropologique passionnante sur un être blanc perdant sa culture au contact des aborigènes et qui ne la retrouve que partiellement et difficilement à son retour en France. Par la proximité de son tuteur avec le milieu des intellectuels et scientifiques et leurs différents échanges, on les voit douter de la sincérité du marin et ne pas comprendre l'intérêt et la persistance d’intégration du tuteur; En pleine période de colonisation, pouvait-on admettre que l’homme blanc puisse se déciviliser ?
Francois GARDE est un grand romancier d’aventures ayant une approche très pure de l’être humain. Passionnant et rare.
J’ai beaucoup aimé son approche et sa façon de parler du vivant, alors je viens de lire son premier roman inspiré d'une histoire vraie: celle d' un marin breton abandonné sur les côtes australiennes au milieu du XIX° siècle puis sa rencontre avec une tribu pacifique à laquelle il a fini par s’intégrer pendant 17 ans mais aussi le récit de voyages et des efforts continus de son découvreur et tuteur, un français membre de la Société Nationale de Géographie, qui espérait pouvoir le ramener à la civilisation occidentale.
Une analyse anthropologique passionnante sur un être blanc perdant sa culture au contact des aborigènes et qui ne la retrouve que partiellement et difficilement à son retour en France. Par la proximité de son tuteur avec le milieu des intellectuels et scientifiques et leurs différents échanges, on les voit douter de la sincérité du marin et ne pas comprendre l'intérêt et la persistance d’intégration du tuteur; En pleine période de colonisation, pouvait-on admettre que l’homme blanc puisse se déciviliser ?
Francois GARDE est un grand romancier d’aventures ayant une approche très pure de l’être humain. Passionnant et rare.
Un homme s'est caché toute sa vie.
Un grand patron au passé inconnu, planqué derrière sa réussite professionnelle, ses mariages, son discret mode de vie personnel.
Il laisse à sa mort le récit manuscrit insolite d'un jeune marin en escale, recruté pour don de gamètes contre trois couronnes (acte qui ne se faisait pas en éprouvettes dans les années 40...).
Le jeune enquêteur, mandaté par une veuve suspicieuse pour élucider cet insolite testament, ouvre une boite de Pandore de recherches en éventuelle filiation. Il va s'imprégner totalement des découvertes faites et des sentiments d'inconnus disparus, mettant en résonance sa propre histoire familiale.
Une enquête basée sur des rencontres insolites et variées, des entretiens, pour y parler pèle-mêle de numismatique, baleines, guerre civile et attentats, gynécologie, généalogie et filiation, combat syndical et politique.
Un très sympathique roman sur fond de secret de famille, aux destins intimes et collectifs.
Un grand patron au passé inconnu, planqué derrière sa réussite professionnelle, ses mariages, son discret mode de vie personnel.
Il laisse à sa mort le récit manuscrit insolite d'un jeune marin en escale, recruté pour don de gamètes contre trois couronnes (acte qui ne se faisait pas en éprouvettes dans les années 40...).
Le jeune enquêteur, mandaté par une veuve suspicieuse pour élucider cet insolite testament, ouvre une boite de Pandore de recherches en éventuelle filiation. Il va s'imprégner totalement des découvertes faites et des sentiments d'inconnus disparus, mettant en résonance sa propre histoire familiale.
Une enquête basée sur des rencontres insolites et variées, des entretiens, pour y parler pèle-mêle de numismatique, baleines, guerre civile et attentats, gynécologie, généalogie et filiation, combat syndical et politique.
Un très sympathique roman sur fond de secret de famille, aux destins intimes et collectifs.
Je ne connaissais pas l'histoire de Narcisse Pelletier. François Garde a écrit là un bon roman. Un roman et non une biographie. Ce qui peut être m'a un peu "gênée". Narcisse Pelletier n'est à vrai pas un personnage mais un homme. L'auteur pouvait-il à souhait modifier les lignes de sa vie? Je laisse à chacun-e la liberté d'y réfléchir. Pour ma part je n'aime pas que l'on écrive une "autre" histoire. Romancer, oui. Modifier, non. Surtout qu'un soucis d'exactitude, à bien y réfléchir, n'aurait véritablement rien enlevé au récit. Toutefois, je tiens à souligner que ce roman m'a permis de réfléchir quant à l’émergence d'une activation sans pareil d'une conscience et d'un questionnement scientifique, en Europe, en ce 19e siècle, qui permettra aux sciences de l'homme , (aux sciences humaines et sociales ) de sdévelopper, de faire converger, d'entre-croiser, d'enrichir toutes ses disciplines et au-delà. On comprend que la route sera encore longue concernant le changement du regard de l'occident sur l'immense, riche, et fabuleux continent que représente "l'Autre". Mais là, on comprend, , à travers ces lignes, qu'on ne peut intelligemment interroger l'Autre sans s'interroger soi-même. Et qu'il faut parfois considérer la frontière entre le savoir et le non-savoir. Tout est question de conscience, de regard, de respect, et d'altérité.
Astrid Shriqui Garain
Astrid Shriqui Garain
En surface, voilà un livre que j’aurais classé dans la catégorie des « sans plus ni moins » : de ceux qu’on lit facilement, mais qui ne vous emporte pas très loin. Et pourtant, lorsque je me suis donnée la peine de creuser un peu, ma vision de ce livre a pris une toute autre tournure..
Le récit alterne les points de vue de Narcisse, lorsqu’il est abandonné sur une plage en Australie, et d’Octave, qui recueille dix-huit ans plus tard un homme que l’on surnomme « le sauvage blanc ». J’ai toujours apprécié cette forme d’écriture car elle donnait du dynamisme à la lecture.
Toutefois, et à mon sens, l’intérêt d’alterner deux points de vue, c’est de pouvoir se mettre à la place d’un personnage ou d’un autre à un même moment dans le roman et d’avoir une vision différente pour des faits identiques ; c’est aussi de pouvoir croiser les deux récits à la fin.
Or, cela n’a pas été du tout le cas ici. Tout d’abord parce que le point de départ entre les deux récits est chronologiquement différent, car espacé de dix-huit ans, et ensuite parce que non seulement les récits ne se croisent pas, mais ils ne présentent aucune cohérence à la fin. Et par conséquent, il n’y a aucun dénouement commun à la fin, ni pour Narcisse, ni pour Octave.
Si l’on s’intéresse au fond, l’auteur essaie de nous faire réfléchir sur la place que peut occuper un personnage tel que Narcisse dans notre société. Narcisse aurait passé dix- huit ans auprès d’une tribu aborigène australienne et se serait approprié leur langage, leurs us et coutumes, à tel point qu’il en aurait oublié sa vie (occidentale) antérieure.
Du coup, sous couvert d’un prétendu intérêt scientifique, des hommes ont cru bon de l’arracher au milieu qu’il avait apprivoisé pour le ramener à la civilisation, puisqu’il ne pouvait en être autrement. Comment pourrait-on en effet laisser un homme blanc parmi les « sauvages » ?
Je suis assez réservée sur le terme de « sauvage » que je trouve à tendance légèrement raciste et colonialiste. Mais bon, passons..
Si le récit de François Garde est inspiré d’une histoire vraie, il est fort regrettable que l’auteur n’ait jamais pris la peine de se renseigner sur le vrai Narcisse Pelletier et sur la fameuse tribu de « sauvages » qui l’a recueilli.
Il s’avère en effet que, contrairement à ce que François Garde décrit dans son roman, la vraie tribu parmi laquelle a vécu Narcisse Pelletier ne vivait pas complètement nue et ne pratiquait pas non plus le viol comme spectacle. Les « sandbeach people » (leur vrai nom) étaient très doués pour la chasse, n’étaient absolument pas dénués d’humanité (la vraie histoire veut qu’ils aient accueilli Narcisse dès qu’ils l’ont retrouvé sur le plage) et possédaient une culture très riche et complexe.
Pour en savoir plus : http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?article415&lang=fr
Par la suite, l’auteur a d’ailleurs avoué qu’il « ne s’était pas documenté » sur Narcisse Pelletier ou sur la tribu des Sandbeach people lorsqu’il a écrit son bouquin, et qu’il « espérait » que ses « sauvages » étaient « vraisemblables » (http://www.chronobook.fr/evenement-entretien-exclusif-avec-francois-garde-482.html)..
Un regrettable oubli..
Lien : http://mademoiselle-christel..
Le récit alterne les points de vue de Narcisse, lorsqu’il est abandonné sur une plage en Australie, et d’Octave, qui recueille dix-huit ans plus tard un homme que l’on surnomme « le sauvage blanc ». J’ai toujours apprécié cette forme d’écriture car elle donnait du dynamisme à la lecture.
Toutefois, et à mon sens, l’intérêt d’alterner deux points de vue, c’est de pouvoir se mettre à la place d’un personnage ou d’un autre à un même moment dans le roman et d’avoir une vision différente pour des faits identiques ; c’est aussi de pouvoir croiser les deux récits à la fin.
Or, cela n’a pas été du tout le cas ici. Tout d’abord parce que le point de départ entre les deux récits est chronologiquement différent, car espacé de dix-huit ans, et ensuite parce que non seulement les récits ne se croisent pas, mais ils ne présentent aucune cohérence à la fin. Et par conséquent, il n’y a aucun dénouement commun à la fin, ni pour Narcisse, ni pour Octave.
Si l’on s’intéresse au fond, l’auteur essaie de nous faire réfléchir sur la place que peut occuper un personnage tel que Narcisse dans notre société. Narcisse aurait passé dix- huit ans auprès d’une tribu aborigène australienne et se serait approprié leur langage, leurs us et coutumes, à tel point qu’il en aurait oublié sa vie (occidentale) antérieure.
Du coup, sous couvert d’un prétendu intérêt scientifique, des hommes ont cru bon de l’arracher au milieu qu’il avait apprivoisé pour le ramener à la civilisation, puisqu’il ne pouvait en être autrement. Comment pourrait-on en effet laisser un homme blanc parmi les « sauvages » ?
Je suis assez réservée sur le terme de « sauvage » que je trouve à tendance légèrement raciste et colonialiste. Mais bon, passons..
Si le récit de François Garde est inspiré d’une histoire vraie, il est fort regrettable que l’auteur n’ait jamais pris la peine de se renseigner sur le vrai Narcisse Pelletier et sur la fameuse tribu de « sauvages » qui l’a recueilli.
Il s’avère en effet que, contrairement à ce que François Garde décrit dans son roman, la vraie tribu parmi laquelle a vécu Narcisse Pelletier ne vivait pas complètement nue et ne pratiquait pas non plus le viol comme spectacle. Les « sandbeach people » (leur vrai nom) étaient très doués pour la chasse, n’étaient absolument pas dénués d’humanité (la vraie histoire veut qu’ils aient accueilli Narcisse dès qu’ils l’ont retrouvé sur le plage) et possédaient une culture très riche et complexe.
Pour en savoir plus : http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?article415&lang=fr
Par la suite, l’auteur a d’ailleurs avoué qu’il « ne s’était pas documenté » sur Narcisse Pelletier ou sur la tribu des Sandbeach people lorsqu’il a écrit son bouquin, et qu’il « espérait » que ses « sauvages » étaient « vraisemblables » (http://www.chronobook.fr/evenement-entretien-exclusif-avec-francois-garde-482.html)..
Un regrettable oubli..
Lien : http://mademoiselle-christel..
J'ai fini ce livre voici déjà plusieurs semaines, et depuis il a traîné sur mon bureau comme une sorte de reproche mal formulé. Le reproche, hélas récurrent, que je ne trouve décidément pas assez de temps pour me consacrer à Babelio. Et puis, plus précisément, le reproche de ne pas trop savoir quoi penser de ma lecture. S'agissant de livres, je trouve toujours cet entre-deux très pénible.
Le propos du livre, situé au milieu du XIXe siècle, est alléchant : Narcisse Pelletier, un matelot français oublié par son équipage sur une plage australienne, est adopté par une tribu aborigène dans laquelle il passe de longues années en perdant tout contact avec son monde d'origine, jusqu'à ce que le hasard l'amène à être récupéré par un navire anglais. L'auteur construit son livre sur le mode du récit alterné : d'un côté la découverte au jour le jour de la la vie quotidienne de la tribu à travers les yeux de Narcisse ; de l'autre les comptes-rendus que rédige Octave de Vallombrun, un savant à qui on a confié Narcisse après son retour, et qui tente avec bonne foi de démêler l'énigme que représente son histoire.
On voit tout de suite la promesse d'un tel sujet : en pleine colonisation, la question du rapport à l'autre, la confrontation du « sauvage » et du « civilisé », etc. Une mine d'or.
Mais je dois bien reconnaître que je suis resté sur ma faim, peut-être parce que François Garde ne va pas assez loin dans la logique de son propos : dans les chapitres où il découvre la tribu, Narcisse est tout entier tourné vers le regret de sa vie de marin et le rejet de ce qui lui arrive. Dans les textes de Vallombrun, le savant constate à quel point son retour est inachevé, et il échoue régulièrement à le faire parler des dix-sept années de son séjour australien. Dans les deux cas, le personnage est comme bloqué dans un passé qui s'oppose à son présent. Au bout du compte, le livre promet sans cesse une réflexion sur le passage entre les cultures, et il donne pourtant la curieuse impression de s'y dérober, comme si, en définitive, cette expérience relevait de l'incommunicable. Malheureusement ce ne sont pas les dernières pages, assez expéditives, qui ont pu m'amener à modifier ma perception.
Une semi-déception, donc... Et il me fallait sans doute écrire cette chronique pour arriver à trancher...
Le propos du livre, situé au milieu du XIXe siècle, est alléchant : Narcisse Pelletier, un matelot français oublié par son équipage sur une plage australienne, est adopté par une tribu aborigène dans laquelle il passe de longues années en perdant tout contact avec son monde d'origine, jusqu'à ce que le hasard l'amène à être récupéré par un navire anglais. L'auteur construit son livre sur le mode du récit alterné : d'un côté la découverte au jour le jour de la la vie quotidienne de la tribu à travers les yeux de Narcisse ; de l'autre les comptes-rendus que rédige Octave de Vallombrun, un savant à qui on a confié Narcisse après son retour, et qui tente avec bonne foi de démêler l'énigme que représente son histoire.
On voit tout de suite la promesse d'un tel sujet : en pleine colonisation, la question du rapport à l'autre, la confrontation du « sauvage » et du « civilisé », etc. Une mine d'or.
Mais je dois bien reconnaître que je suis resté sur ma faim, peut-être parce que François Garde ne va pas assez loin dans la logique de son propos : dans les chapitres où il découvre la tribu, Narcisse est tout entier tourné vers le regret de sa vie de marin et le rejet de ce qui lui arrive. Dans les textes de Vallombrun, le savant constate à quel point son retour est inachevé, et il échoue régulièrement à le faire parler des dix-sept années de son séjour australien. Dans les deux cas, le personnage est comme bloqué dans un passé qui s'oppose à son présent. Au bout du compte, le livre promet sans cesse une réflexion sur le passage entre les cultures, et il donne pourtant la curieuse impression de s'y dérober, comme si, en définitive, cette expérience relevait de l'incommunicable. Malheureusement ce ne sont pas les dernières pages, assez expéditives, qui ont pu m'amener à modifier ma perception.
Une semi-déception, donc... Et il me fallait sans doute écrire cette chronique pour arriver à trancher...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Musique & Littérature
BiblioJoy
60 livres
Auteurs proches de François Garde
Quiz
Voir plus
Ce qu'il advint du sauvage blanc
Pour François Garde, ce livre est son
1er ouvrage
3ème ouvrage
5ème ouvrage
7ème ouvrage
8 questions
131 lecteurs ont répondu
Thème : Ce qu'il advint du sauvage blanc de
François GardeCréer un quiz sur cet auteur131 lecteurs ont répondu