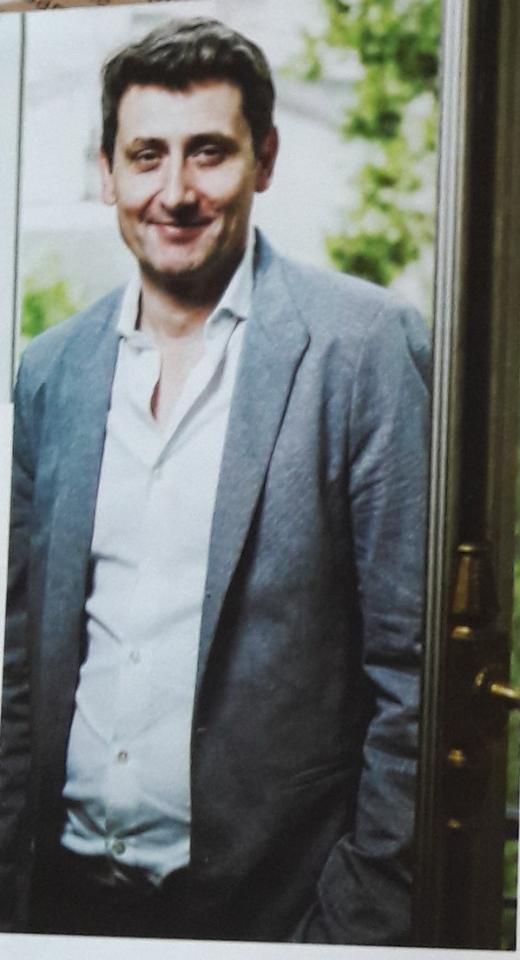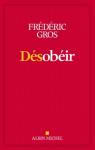Critiques de Frédéric Gros (146)
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu un intellectuel s’emparer d’un tel sujet avec autant d’aisance et de clarté. Il était urgent de redéfinir la désobéissance — pour une démocratie fragile — d’en rappeler les modalités, les moyens d’action, comme d’évoquer ses incontournables traitements littéraires, philosophiques et historiques.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Un essai très intéressant, très documenté, une étude critique de la politique en partant des notions d'obéissance et de désobéissance, qui s'appuie sur des études philosophiques menées par Kant, Socrate, Foucault, Arendt..., sur des emblèmes culturels de résistance (Antigone, la fille d'Œdipe, Diogène...) ou au contraire sur des figures très/trop obéissantes ayant banalisées le mal (Adolf Eichmann...). Absolument passionnant.
«Ce livre pose la question de la désobéissance à partir de celle de l'obéissance, parce que la désobéissance, face à l'absurdité, à l'irrationalité du monde comme il va, c'est l'évidence. Elle exige peu d'explications. Pourquoi désobéir ? Il suffit d'ouvrir les yeux. Elle est même à ce point justifiée, normale, que ce qui choque, c'est l'absence de réaction, la passivité.»
Un éclairage sur notre monde, notre piètre démocratie, qui nous amène à comprendre pourquoi face pourtant aux situations évidentes de désespérance, d'indignation, d'injustice ... dans lesquelles le monde actuel est plongé, l'obéissance reste majoritairement de mise.
Un essai qui interpelle, un véritable appel à résister au conformisme et à la tyrannie.
Très brillant ! Nécessaire, essentiel. A lire, picorer, relire, et surtout à méditer !
«... désobéir est une déclaration d'humanité»
Lien : https://seriallectrice.blogs..
«Ce livre pose la question de la désobéissance à partir de celle de l'obéissance, parce que la désobéissance, face à l'absurdité, à l'irrationalité du monde comme il va, c'est l'évidence. Elle exige peu d'explications. Pourquoi désobéir ? Il suffit d'ouvrir les yeux. Elle est même à ce point justifiée, normale, que ce qui choque, c'est l'absence de réaction, la passivité.»
Un éclairage sur notre monde, notre piètre démocratie, qui nous amène à comprendre pourquoi face pourtant aux situations évidentes de désespérance, d'indignation, d'injustice ... dans lesquelles le monde actuel est plongé, l'obéissance reste majoritairement de mise.
Un essai qui interpelle, un véritable appel à résister au conformisme et à la tyrannie.
Très brillant ! Nécessaire, essentiel. A lire, picorer, relire, et surtout à méditer !
«... désobéir est une déclaration d'humanité»
Lien : https://seriallectrice.blogs..
Le point de départ de cet essai magnifique, splendide, merveilleux, superbe, magistral (en lice pour mériter le titre de mon coup de cœur de l'année), c'est l'aphorisme de Wilhelm Reich, qui peut être reconduit directement à La Boétie : « La vraie question n'est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se révoltent pas. »
Il ne s'attarde cependant ni sur les raisons de la désobéissance politique, ni sur les instances réelles de contestation. Ce qui s'y développe, c'est une redéfinition des concepts, à partir de la déclinaison des notions relatives à ou parentes de l'obéissance et qui contiennent la notion opposée, dans la pensée philosophique – pas uniquement éthique ni uniquement politique –, en opérant des allers-retours surprenants entre les penseurs anciens (les Grecs en particuliers) et les contemporains (Hannah Arendt et Michel Foucault étant très souvent conviés). Mine de rien, cette catégorisation par couples de contraires conduit l'auteur à tester ses propres idées sur la possibilité et, incessamment, la nécessité de la désobéissance, en termes de la découverte du « moi irremplaçable » plutôt que par une morale universelle, métaphysique ou surplombante. Pourtant, la construction n'est pas progressive et unidirectionnelle ; le procédé ressemble davantage à une maïeutique par laquelle on s'achemine sur plusieurs sentiers, on les abandonne au profit d'autres, avant de découvrir presque fortuitement qu'ils convergeaient...
Table expliquée :
Chapitre introductif : « Nous avons accepté l'inacceptable », où l'on liquide en quatre points la question de ce qui est inacceptable dans l'état actuel du monde ;
Ch. 1 : « Le renversement des monstruosités », où il est question de Dostoïevski hanté par le Christ et l'Église et de Kant à qui on a fait un mauvais procès ;
Ch. 2 : « De la soumission à la rébellion », où l'on parle avec Aristote des esclaves, d'hier et d'aujoud'hui, l'on dresse une typologie de l'obéissance du soumis, l'on évoque l'éventualité que la soumission aboutisse à la rébellion, et où fait apparition la notion de responsabilité ;
Ch. 3 : « Surobéissance », où l'on interroge surtout La Boétie ;
Ch. 4 : « De la subordination au droit de résistance », où l'on décrit des hiérarchies, peu ou prou « naturelles », depuis Aristote jusqu'à Marx, en passant par Augustin (« concordia ordinata ») et par beaucoup d'autres philosophes chrétiens, y compris les mystiques de l'abnégation ;
Ch. 5 : « Fille d'Œdipe », ou les enjeux de la désobéissance d'Antigone, depuis Sophocle jusqu'à Brecht ;
Ch. 6 : « Du conformisme à la transgression », où apparaît la question de la Shoah, et l'on fait remonter l'antidote (la transgression) à Diogène – mais l'argumentation est plus complexe, dont l'excipit est : « L'universel, c'est toujours la protestation d'une différence » (p. 118) ;
Ch. 7 : « L'année 1961 », sur le procès d'Adolf Eichmann, son interprétation par Arendt, le récit noir, le récit gris, ce qu'Eichmann dit lui-même, ainsi que sur l'expérience de Stanley Milgram à Yale, sur les électrochocs, qui, en fin de comptes, démontre la « banalité du mal » tout autrement que ne le supposait Arendt... ;
Ch. 8 : « Du consentement à la désobéissance civile », où l'on parle beaucoup des contractualistes et de Rousseau, « mais il demeure cependant – Arendt et Habermas l'ont bien compris – quelque chose d'explosif, de secrètement subversif dans l'idée du contrat social [...] » (p. 157) : c'est ce qu'on nomme pour finir la « démocratie critique »...
Ch. 9 : « La promenade de Thoreau » ou la raison pour laquelle, au premier degré, tant de lecteurs (même Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King !) ont tellement surestimé la « désobéissance civile » de ce monsieur, sans doute par effet projectif provoqué par sa célèbre phrase : « Si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place ? » [effet projectif qui opère spectaculairement sur Frédéric Gros aussi...] ;
Ch. 10 : « Dissidence civique », retour sur Kant – sur les Lumières –, retour sur Socrate – sur son « démon » –, pour aboutir à une définition de la dissidence ;
Ch. 11 : « L'obligation éthique », où l'on chemine de l'inactualité de la démocratie athénienne et de l'obéissance hoplitique selon Aristote – relation entre commandement et rapport d'égalité – au moi comme « deux-en-un » d'Arendt ou du « rapport de soi à soi » de Foucault, en d'autres termes : de la morale à l'éthique...
Ch. 12 : « La responsabilité sans limites », où sont déclinées quatre figures de la responsabilité « illimitée » : intégrale, absolue, infinie et globale ;
Ch. 13 : « Penser, désobéir. Sous forme d'envoi : la République », lecture détaillée par Fr. Gros de la République de Platon, en particulier sur l'histoire de l'anneau de Gygès ;
Chapitre conclusif : « L'humanité nous décale » : « Désobéir, c'est donc, suprêmement, obéir. Obéir à soi. […] Obéir, c'est se faire "le traître de soi-même". » ou le « pari insensé » du « soi indélégable »...
Il ne s'attarde cependant ni sur les raisons de la désobéissance politique, ni sur les instances réelles de contestation. Ce qui s'y développe, c'est une redéfinition des concepts, à partir de la déclinaison des notions relatives à ou parentes de l'obéissance et qui contiennent la notion opposée, dans la pensée philosophique – pas uniquement éthique ni uniquement politique –, en opérant des allers-retours surprenants entre les penseurs anciens (les Grecs en particuliers) et les contemporains (Hannah Arendt et Michel Foucault étant très souvent conviés). Mine de rien, cette catégorisation par couples de contraires conduit l'auteur à tester ses propres idées sur la possibilité et, incessamment, la nécessité de la désobéissance, en termes de la découverte du « moi irremplaçable » plutôt que par une morale universelle, métaphysique ou surplombante. Pourtant, la construction n'est pas progressive et unidirectionnelle ; le procédé ressemble davantage à une maïeutique par laquelle on s'achemine sur plusieurs sentiers, on les abandonne au profit d'autres, avant de découvrir presque fortuitement qu'ils convergeaient...
Table expliquée :
Chapitre introductif : « Nous avons accepté l'inacceptable », où l'on liquide en quatre points la question de ce qui est inacceptable dans l'état actuel du monde ;
Ch. 1 : « Le renversement des monstruosités », où il est question de Dostoïevski hanté par le Christ et l'Église et de Kant à qui on a fait un mauvais procès ;
Ch. 2 : « De la soumission à la rébellion », où l'on parle avec Aristote des esclaves, d'hier et d'aujoud'hui, l'on dresse une typologie de l'obéissance du soumis, l'on évoque l'éventualité que la soumission aboutisse à la rébellion, et où fait apparition la notion de responsabilité ;
Ch. 3 : « Surobéissance », où l'on interroge surtout La Boétie ;
Ch. 4 : « De la subordination au droit de résistance », où l'on décrit des hiérarchies, peu ou prou « naturelles », depuis Aristote jusqu'à Marx, en passant par Augustin (« concordia ordinata ») et par beaucoup d'autres philosophes chrétiens, y compris les mystiques de l'abnégation ;
Ch. 5 : « Fille d'Œdipe », ou les enjeux de la désobéissance d'Antigone, depuis Sophocle jusqu'à Brecht ;
Ch. 6 : « Du conformisme à la transgression », où apparaît la question de la Shoah, et l'on fait remonter l'antidote (la transgression) à Diogène – mais l'argumentation est plus complexe, dont l'excipit est : « L'universel, c'est toujours la protestation d'une différence » (p. 118) ;
Ch. 7 : « L'année 1961 », sur le procès d'Adolf Eichmann, son interprétation par Arendt, le récit noir, le récit gris, ce qu'Eichmann dit lui-même, ainsi que sur l'expérience de Stanley Milgram à Yale, sur les électrochocs, qui, en fin de comptes, démontre la « banalité du mal » tout autrement que ne le supposait Arendt... ;
Ch. 8 : « Du consentement à la désobéissance civile », où l'on parle beaucoup des contractualistes et de Rousseau, « mais il demeure cependant – Arendt et Habermas l'ont bien compris – quelque chose d'explosif, de secrètement subversif dans l'idée du contrat social [...] » (p. 157) : c'est ce qu'on nomme pour finir la « démocratie critique »...
Ch. 9 : « La promenade de Thoreau » ou la raison pour laquelle, au premier degré, tant de lecteurs (même Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King !) ont tellement surestimé la « désobéissance civile » de ce monsieur, sans doute par effet projectif provoqué par sa célèbre phrase : « Si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place ? » [effet projectif qui opère spectaculairement sur Frédéric Gros aussi...] ;
Ch. 10 : « Dissidence civique », retour sur Kant – sur les Lumières –, retour sur Socrate – sur son « démon » –, pour aboutir à une définition de la dissidence ;
Ch. 11 : « L'obligation éthique », où l'on chemine de l'inactualité de la démocratie athénienne et de l'obéissance hoplitique selon Aristote – relation entre commandement et rapport d'égalité – au moi comme « deux-en-un » d'Arendt ou du « rapport de soi à soi » de Foucault, en d'autres termes : de la morale à l'éthique...
Ch. 12 : « La responsabilité sans limites », où sont déclinées quatre figures de la responsabilité « illimitée » : intégrale, absolue, infinie et globale ;
Ch. 13 : « Penser, désobéir. Sous forme d'envoi : la République », lecture détaillée par Fr. Gros de la République de Platon, en particulier sur l'histoire de l'anneau de Gygès ;
Chapitre conclusif : « L'humanité nous décale » : « Désobéir, c'est donc, suprêmement, obéir. Obéir à soi. […] Obéir, c'est se faire "le traître de soi-même". » ou le « pari insensé » du « soi indélégable »...
Voici un tome d'actualité proposant un questionnement intéressant.
"Désobéir" propose ainsi une histoire de la désobéissance, dont le début m'a paru quelque peu obscur et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour démêler les divers fils de la trame, abordant la désobéissance avant tout à travers les mécanismes de l'obéissance. Aussi passionnant qu'effrayant.
Un seul petit bémol, même pour une lectrice de non-fiction stimulée par la complexité de sujets à mille lieues de ses lectures principales, j'ai trouvé le livre difficile à lire, malgré de nombreux exemples concrets et clairs, dans un contexte de décompression intense et le mois aloué par Babélio pour lire et livrer une petite critique était bien nécessaire: tant d'angles sont couverts dans "Désobéir" et mes références philosophiques étant bien superficielle, que j'ai souvent dû relire en diagonale un chapitre avant de passer au suivant.
Néanmoins, je recommanderais sans hésiter ce livre à mes amis férus de philosophie et de politique et friands de désobéissance par les temps qui courent.
"Désobéir" propose ainsi une histoire de la désobéissance, dont le début m'a paru quelque peu obscur et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour démêler les divers fils de la trame, abordant la désobéissance avant tout à travers les mécanismes de l'obéissance. Aussi passionnant qu'effrayant.
Un seul petit bémol, même pour une lectrice de non-fiction stimulée par la complexité de sujets à mille lieues de ses lectures principales, j'ai trouvé le livre difficile à lire, malgré de nombreux exemples concrets et clairs, dans un contexte de décompression intense et le mois aloué par Babélio pour lire et livrer une petite critique était bien nécessaire: tant d'angles sont couverts dans "Désobéir" et mes références philosophiques étant bien superficielle, que j'ai souvent dû relire en diagonale un chapitre avant de passer au suivant.
Néanmoins, je recommanderais sans hésiter ce livre à mes amis férus de philosophie et de politique et friands de désobéissance par les temps qui courent.
Dès tout petit nous sommes conditionnés à l'obéissance comme naturelle, à l'école il parait qu'on nous apprend l'esprit critique, (à voir), mais en tout cas l’obéissance (apprendre ses leçons, faire ses devoirs, entrer en rang, ne pas répondre, etc) elle est reine et jamais personne ne nous apprendra qu'il y a dans la notion de désobéissance (comme dans le mensonge et la fuite) des degrés, que la désobéissance est une option permanente dans nos décisions dans tous les domaines.Dans ce monde et pour ce monde, nous avons besoin d’espérance. Cette espérance nous la puiserons en nous-mêmes. Elle déterminera notre résistance, nos désobéissances et peut-être de nouveaux horizons politiques.
Pour terminer, je vous laisse cette phrase de Frédéric Gros qui suggère beaucoup. Même sortie de son contexte, elle reste une belle pensée philosophique :
« Ce que l’on partage vraiment, ce n’est ni l’ignorance ni le savoir, c’est une exigence de vérité. » Cet essai est relativement simple abordable par tous et incite à une réflexion. philosophique
Lien : https://www.babelio.com/ajou..
Pour terminer, je vous laisse cette phrase de Frédéric Gros qui suggère beaucoup. Même sortie de son contexte, elle reste une belle pensée philosophique :
« Ce que l’on partage vraiment, ce n’est ni l’ignorance ni le savoir, c’est une exigence de vérité. » Cet essai est relativement simple abordable par tous et incite à une réflexion. philosophique
Lien : https://www.babelio.com/ajou..
J’ai eu la possibilité de recevoir Désobéir de Frédéric Gros avant sa sortie en librairie par l’intermédiaire de Babelio, probablement suite à ma critique de Désobéissance civile et démocratie d’Howard Zinn sur des thématiques extrêmement similaires. En effet, dès la première page de l’introduction intitulée « Nous avons accepté l’inacceptable », l’auteur reprend la phrase qui exprime le renversement idéologique génial effectué par l’historien américain, c'est-à-dire « le problème ce n’est pas la désobéissance, le problème c’est l’obéissance ». Cette assertion provocatrice n’est précédée que par une citation de Primo Lévi exprimant une réalité assez proche : « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux; ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. » Une fois ces principes posés et la désobéissance définie comme une « déclaration d’humanité » face aux crimes commis partout dans le monde, le philosophe précise son propos : son but n’est pas de réaliser une histoire de la désobéissance civile (cela, d’autres l’ont déjà fait) mais de proposer une réflexion éthique sur le sujet. Pour cela il convoque dans un langage clair et agréable de nombreux exemples, de l’incontournable passage du grand inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski au mythe d’Antigone, en passant par l’expérience de Milgram et la « banalité du mal » décrite par Hanna Arendt ; afin d’expliquer la difficulté que nous avons à nous rebeller quand tout devrait nous y pousser. En différents chapitres il énumère la peur de la liberté, la soumission, la « surobéissance » dénoncée par La Boétie dans son discours sur la servitude volontaire, la déresponsabilisation, le conformisme, le consentement à l’horreur… Face à cela, pourquoi désobéir ? Frédéric Gros fait le pari que le désobéissant répond en réalité à une obéissance plus grande qui ne vient pas de l’extérieur mais d’une éthique personnelle et s’appuie pour cela sur le « souci de soi » des anciens grecs. A la fin du livre l’auteur rentre dans des considérations philosophiques qui m’ont paru un peu abstraites, mais il a néanmoins le mérite de ne pas laisser de questions en suspens. En effet, si peu d’idées nouvelles sont finalement apportées, il s’agit d’un ouvrage qui constitue une très bonne initiation sur un sujet nécessaire et pourtant pas assez abordé.
Dés-obéir est un petit livre rouge à lire aujourd'hui.
Une langue accessible, des références documentées et explicitées, une progression claire de la pensée incitent la lectrice·le lecteur à ce voyage vers soi-même et vers sa dés·obéissance.
Dés·obéir, c'est obéir à soi-même comme responsable dans le monde, non pas que mon action va être déterminante et changer le monde. Mais si je n'entreprend pas cette action, je dois accepter mon choix de vivre tout le reste de mon existence avec celle·celui qui a renoncé: moi-même.
La dés·obéissance est encore autre chose qu'un principe ou une valeur. Elle demande une démarche philosophique: quelle est l'instance devant laquelle j'assume ma responsabilité de dés·obéissance?
Un livre politique au sens où il incite à un engagement dans la cité, c'est à dire dans la société et le monde dont je fais partie.
Une langue accessible, des références documentées et explicitées, une progression claire de la pensée incitent la lectrice·le lecteur à ce voyage vers soi-même et vers sa dés·obéissance.
Dés·obéir, c'est obéir à soi-même comme responsable dans le monde, non pas que mon action va être déterminante et changer le monde. Mais si je n'entreprend pas cette action, je dois accepter mon choix de vivre tout le reste de mon existence avec celle·celui qui a renoncé: moi-même.
La dés·obéissance est encore autre chose qu'un principe ou une valeur. Elle demande une démarche philosophique: quelle est l'instance devant laquelle j'assume ma responsabilité de dés·obéissance?
Un livre politique au sens où il incite à un engagement dans la cité, c'est à dire dans la société et le monde dont je fais partie.
Frédéric Gros, entame son livre sur trois citations importantes, l’une de Primo Levi
« Les montres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. »
, et les deux autres complémentaires, l’une de Howard Zinn
« Le problème ce n’est pas la désobéissance, le problème c’est l’obéissance. »
Qui comme l’écrit notre philosophe fait écho à cette phrase de Wilhem Reich
« La vraie question n’est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne révoltent pas. »
Tout au long de ce traité sur la désobéissance Frédéric gros va nous parfaire de sa réflexion, de ces lectures, d’exemples historiques pour étudier l’origine de l’obéissance, C’est revenir au constat provocant de Howard Zinn, comprendre l’un c’est de réfléchir à son contraire.
Notre société est celle de toute les inégalités, le fossé se creuse de plus en plus, le XXème siècle est celui des plus grands génocides, des tyrannies modernes, ouvrant notre réflexion vers cette question que déjà soulevé au XXVIème Siècles avec Discours de la servitude volontaire de La Boétie. Frédéric Gros veut comprendre pourquoi nous obéissant face au chaos du monde.
Beaucoup d’exemples sont parsemés dans ce texte d’une grande richesse pour décrire notre société et soulever la péripétie humaine. L’espèce humaine semble être ordonné à être une masse à la multitude facette asservi à quelque élite dirigeante, je ne vais pas approfondir la pensée de notre philosophe pour en extraire juste la quintessence et affaiblir l’esprit du livre.
Je vais juste souligner les exemples choisis pour alimenter et structurer cette pensée de la servitude humaine face à la religion, la politique, la hiérarchie du travail, les fonctionnaires zélés et ceux que j’oublie.
Frédéric Gros utilise un passage de Dostoïevski Les frères Karamazov, un poète d’Ivan pour son frère Aliocha, monologue entre le Christ muet ressuscité et l’inquisiteur en Espagne du XVème siècle puis diserte sur les trois refus du tentateur, pour méditer sur la liberté à défaut de l’obéissance pour une dignité humaine, en outre au début Frédéric Gros semble associer la loi de Dieu et celle économique dans une soumission aveugle, avec une similarité de la loi économique et des décrets de Dieu.
Puis Frédéric Gros en s’appuyant sur le texte de La Boétie érige avec pragmatique la surobéissance, puis d’Antigone de Sophocle rend la désobéissance de cette jeune femme vierge comme une opposition entre le pouvoir politique de Créon et celui du code familiale, une révolte Obéissante.
Puis Frédéric poursuit son livre avec des exemples plus précis, comme le procès d’Eichmann en 1961, coordinateur logistique des transports, entrainant indirectement à la mort de 6 millions de juifs, Duch torturant au centre S21 des milliers de Cambodgiens, leurs réponses à leur acte
« Nous avons juste obéis. »
C’est un monde, de fonctionnaires zélés, de technicités, d’industries, d’obéissance mécanique……
La masse englobe l’unicité pour l’étouffer et la rendre incertaine pour subir la loi de l’ensemble, c’est ce qui se passe dans notre société, la marginalité des idées se tarit face la nauséabonde obéissance civile.
Je vous laisse découvrir plus en détail ce livre, une réflexion de l’homme face à ses choix et de ce monde qui l’avale pour le diriger dans une obéissance dès l’enfance puis le vomit dans une dialectique de lois diverses l’asservissant et l’aliénant à une obéissance mécanique froide sans réflexion, comme une respiration continuelle pour tenter de survivre.
« Les montres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. »
, et les deux autres complémentaires, l’une de Howard Zinn
« Le problème ce n’est pas la désobéissance, le problème c’est l’obéissance. »
Qui comme l’écrit notre philosophe fait écho à cette phrase de Wilhem Reich
« La vraie question n’est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne révoltent pas. »
Tout au long de ce traité sur la désobéissance Frédéric gros va nous parfaire de sa réflexion, de ces lectures, d’exemples historiques pour étudier l’origine de l’obéissance, C’est revenir au constat provocant de Howard Zinn, comprendre l’un c’est de réfléchir à son contraire.
Notre société est celle de toute les inégalités, le fossé se creuse de plus en plus, le XXème siècle est celui des plus grands génocides, des tyrannies modernes, ouvrant notre réflexion vers cette question que déjà soulevé au XXVIème Siècles avec Discours de la servitude volontaire de La Boétie. Frédéric Gros veut comprendre pourquoi nous obéissant face au chaos du monde.
Beaucoup d’exemples sont parsemés dans ce texte d’une grande richesse pour décrire notre société et soulever la péripétie humaine. L’espèce humaine semble être ordonné à être une masse à la multitude facette asservi à quelque élite dirigeante, je ne vais pas approfondir la pensée de notre philosophe pour en extraire juste la quintessence et affaiblir l’esprit du livre.
Je vais juste souligner les exemples choisis pour alimenter et structurer cette pensée de la servitude humaine face à la religion, la politique, la hiérarchie du travail, les fonctionnaires zélés et ceux que j’oublie.
Frédéric Gros utilise un passage de Dostoïevski Les frères Karamazov, un poète d’Ivan pour son frère Aliocha, monologue entre le Christ muet ressuscité et l’inquisiteur en Espagne du XVème siècle puis diserte sur les trois refus du tentateur, pour méditer sur la liberté à défaut de l’obéissance pour une dignité humaine, en outre au début Frédéric Gros semble associer la loi de Dieu et celle économique dans une soumission aveugle, avec une similarité de la loi économique et des décrets de Dieu.
Puis Frédéric Gros en s’appuyant sur le texte de La Boétie érige avec pragmatique la surobéissance, puis d’Antigone de Sophocle rend la désobéissance de cette jeune femme vierge comme une opposition entre le pouvoir politique de Créon et celui du code familiale, une révolte Obéissante.
Puis Frédéric poursuit son livre avec des exemples plus précis, comme le procès d’Eichmann en 1961, coordinateur logistique des transports, entrainant indirectement à la mort de 6 millions de juifs, Duch torturant au centre S21 des milliers de Cambodgiens, leurs réponses à leur acte
« Nous avons juste obéis. »
C’est un monde, de fonctionnaires zélés, de technicités, d’industries, d’obéissance mécanique……
La masse englobe l’unicité pour l’étouffer et la rendre incertaine pour subir la loi de l’ensemble, c’est ce qui se passe dans notre société, la marginalité des idées se tarit face la nauséabonde obéissance civile.
Je vous laisse découvrir plus en détail ce livre, une réflexion de l’homme face à ses choix et de ce monde qui l’avale pour le diriger dans une obéissance dès l’enfance puis le vomit dans une dialectique de lois diverses l’asservissant et l’aliénant à une obéissance mécanique froide sans réflexion, comme une respiration continuelle pour tenter de survivre.
Cet opus est une révélation !
Les notions d’obéir/désobéir sont complexes.
Entre responsabilité ou non, entre volonté ou soumission...
Sommes-nous des "malgré-nous" ?
Peut-on dire "Je ne suis pas responsable, j'avais des ordres" ?
Désobéir n'est-ce pas accepter d'obéir à quelqu'un d'autre ou à sa conscience ?
Obéir, n'est-ce pas se commander à soi-même d'obéir ?
L'auteur nous transporte des grecs anciens aux philosophes contemporains (avec des étapes), il nous propose une synthèse des différentes pensées et de leurs histoires.
J'ai été séduit.
Mon ressenti de 1ère lecture est +++.
Mais il devra être conforté (ou infirmé) par des lectures ultérieures.
A lire, ne serait-ce que pour titiller vos neurones et votre propre pensée.
Les notions d’obéir/désobéir sont complexes.
Entre responsabilité ou non, entre volonté ou soumission...
Sommes-nous des "malgré-nous" ?
Peut-on dire "Je ne suis pas responsable, j'avais des ordres" ?
Désobéir n'est-ce pas accepter d'obéir à quelqu'un d'autre ou à sa conscience ?
Obéir, n'est-ce pas se commander à soi-même d'obéir ?
L'auteur nous transporte des grecs anciens aux philosophes contemporains (avec des étapes), il nous propose une synthèse des différentes pensées et de leurs histoires.
J'ai été séduit.
Mon ressenti de 1ère lecture est +++.
Mais il devra être conforté (ou infirmé) par des lectures ultérieures.
A lire, ne serait-ce que pour titiller vos neurones et votre propre pensée.
Aujourd’hui, de nombreuses circonstances devraient nous amener à nous révolter : l’accentuation des injustices sociales, la dégradation progressive de notre environnement, et « ce qu’on appelle le ‘’capitalisme’’ diffus » qui enveloppe les deux précédents.
Alors, pourquoi laisser faire, pourquoi ne pas désobéir ?
Frédéric Gros va poser la question de la désobéissance à la lumière de ce qu’est l’obéissance. Il ne va donc pas aborder les mouvements sociaux d’opposition qui font entendre leur voix, mais va tenter d’analyser pourquoi il est si facile de suivre sans bouger. C’est donc une réflexion avant tout philosophique de la désobéissance. Un peu ardu mais intéressant à lire, avec de nombreuses références, de textes aussi bien religieux que philosophiques et historiques.
Alors, pourquoi laisser faire, pourquoi ne pas désobéir ?
Frédéric Gros va poser la question de la désobéissance à la lumière de ce qu’est l’obéissance. Il ne va donc pas aborder les mouvements sociaux d’opposition qui font entendre leur voix, mais va tenter d’analyser pourquoi il est si facile de suivre sans bouger. C’est donc une réflexion avant tout philosophique de la désobéissance. Un peu ardu mais intéressant à lire, avec de nombreuses références, de textes aussi bien religieux que philosophiques et historiques.
Qu'attendre d'un essai qui prend pour titre Désobéir ? Un peu d'eau au moulin de vos désirs de résistance ? Allez, avouez, vous avez tous eu un jour envie de tout faire valser, espéré le grand soir révolutionnaire, pensé un instant dire non face au char pseudo-démocratique, planifié un Vézelay-Compostelle avec un sac à dos minimaliste, Thoreau en poche. Après avoir refait le monde toute une soirée, bien arrosée si possible, en compagnie de bons vieux camarades, vous allez vous coucher sur vos rêves de rébellion, parce qu'il faut entrer dans le rang demain ! Désobéir se résume à un fantasme pour la plupart d'entre nous. On salue la bravoure de ceux qui veulent bien se battre à notre place, les Bové, Snowden, plus récemment Cédric Herrou et tant d'autres. Mais dès qu'il s'agit de mettre la main à la pâte, ça devient difficile. On est comme gêné aux entournures, coincé par un je ne sais quoi de culpabilisant. Pour expliquer ce que signifie "désobéir", il faut donc remonter le courant, comprendre comment et pourquoi on obéit. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple (ça devient sérieux là, on oublie le bock de bière avec les copains) se soumet à l'autorité, même dans "la désespérance de l'ordre actuel du monde" ? L'éducation, l'école, les lois, nous enseignent très tôt que désobéir c'est" mal", vu comme "de la sauvagerie" mue par un "instinct anarchique". Frédéric Gros applique la piqûre de rappel du bon philosophe : surtout ne pas se contenter des évidences! Et si désobéir était LA condition pour redonner à la démocratie son sens noble ? Si désobéir était le moyen de sauver l'humain en l'homme ? Pour développer cette réflexion, l'auteur s'appuie sur les piliers du concept : de Platon à Simone Weil, en passant par La Boétie et Thoreau (of course!). Le raisonnement est solide, il nous éclaire sur ce qui fait de la désobéissance un choix possible, certes, mais aussi tortueux, difficile pour nos esprits conditionnés.
Prêts à ne plus suivre le troupeau ? Lisez, d'abord. On en reparle ensuite...
Prêts à ne plus suivre le troupeau ? Lisez, d'abord. On en reparle ensuite...
« Ce livre pose la question de la désobéissance à partir de celle de l'obéissance, parce que la désobéissance, face à l'absurdité, à l'irrationalité du monde comme il va, c'est l'évidence. »
Dès les premières pages, Frédéric Gros s'interroge sur les raisons qui nous font accepter l'inacceptable dans un monde qui va mal. Il décrit les motifs qui auraient dû et devraient encore susciter notre désobéissance. Pourquoi avons-nous laissé faire ? Pourquoi cette passivité collective ? Pourquoi chacun d'entre nous obéit ?
«Affirmer qu'une fois les lois votées par la majorité, elles ne peuvent être contestées sous peine de trahir la volonté populaire est une mystification», prévient Frédéric Gros. «Etre un sujet politique, assure-t-il, c'est d'abord se poser la question de la désobéissance».
Frédéric Gros reprend la provocation de Howard Zinn qui affirmait : le problème ce n'est pas l'obéissance, le problème c'est l'obéissance…
Toutefois, au lieu de se demander pourquoi on désobéit, Frédéric Gros analyse les mécanismes de l'obéissance. Il questionne non seulement notre volonté de désobéir mais également notre malaise à le faire. «Les raisons de ne plus accepter l'état actuel du monde sont presque trop nombreuses. Et pourtant rien n'arrive, personne ou presque ne se lève. » Son propos, tout au long de l'essai, est de démontrer que la désobéissance est justifiée, ainsi ce qui le choque c'est l'absence de réaction et la passivité qui sont les conséquences de l'obéissance. Désobéir est un acte par lequel l'individu exprime sa dignité en affirmant sa liberté par son refus d'obéir.
Le premier chapitre s'intitule : « Nous avons accepté l'inacceptable ». Pourquoi et comment obéissons-nous ? Pourquoi sommes-nous si soumis, alors que les motifs de rébellion sont de plus en plus nombreux ? Désobéir prend plusieurs formes et Frédéric Gros explore quatre styles d'obéissance : la soumission, la subordination, le conformisme et le consentement.
La soumission est un rapport de force contrainte car elle repose sur le sentiment d'une impossibilité de désobéir. Nous devons pourtant apprendre à ne plus accepter l'inacceptable car les circonstances devraient nous amener à réagir : injustice sociale, accroissement des inégalités, privilèges injustifiés d'une minorité, dégradation de notre environnement. L'essai défend l'idée d'une démocratie critique, la désobéissance civile ne doit être ni délinquance, ni anarchie.
Le conformisme est la principale cause de la servitude volontaire, c'est la coutume qui entraine l'inertie passive, la peur de sortir du rang et de se singulariser. Chacun aligne son comportement sur celui des autres, on obéit par conformisme. La soumission à l'autorité s'est longtemps imposée par la force de la tradition. La désobéissance civile est pour Frédéric Gros un des moyens d'action les plus pertinents dans notre démocratie, aussi, tout au long de son essai le philosophe nous incite à abandonner les conduites conformistes qui sont si confortables et sécurisantes.
« Désobéir » nous entraine ensuite du conformisme au consentement qui est une obéissance libre, une aliénation volontaire, une contrainte pleinement acceptée.
Frédéric Gros ne défend pas la désobéissance à tout prix, ce serait aussi dangereux que de faire de l'obéissance une vertu inconditionnelle. Il s'agit pour lui de toujours savoir à quoi l'on obéit ou désobéit.
L'obéissance est confortable car on laisse les autres décider et penser à sa place, la responsabilité est un fardeau et l'obéissance permet de se décharger auprès d'un autre du poids de sa liberté.
Frédéric Gros interroge ce que signifient la démocratie et la désobéissance pour le sujet politique. Pour illustrer ses propos, il cite de nombreux auteurs et philosophes, de l'antiquité à nos jours, en s'appuyant sur des exemples concrets et réels afin de dégager une ligne de conduite à tenir.
Le philosophe américain Thoreau refuse de payer ses impôts au nom d'une certaine conception de la justice, il ne veut rient verser au fisc d'un état qui admet l'esclavage. La désobéissance civile, dont il va rédiger le manifeste, est l'acte réfléchi d'un homme chez qui l'éthique et le sens de l'avenir entrainent l'insoumission.
Il convient de s'interroger sur la nature de l'obéissance et de son illégitimité. C'est ce qu'expose Hannah Arendt dans son ouvrage, « Eichmnan à Jérusalem », où ce dernier apparait plus comme un exécutant contraint que comme un décideur antisémite. D'un point de vue philosophique Eichmann obéit illégitimement à une morale détestable. le danger est que chacun peut en rajouter dans son obéissance, ce qu'on appelle la surobéissance qui fait tenir le pouvoir politique mais les expériences totalitaires ont fait apparaitre des monstres d'obéissance. L'histoire nous apprend ainsi que la démocratie est plus souvent menacée par l'obéissance aveugle des citoyens que par leur désobéissance. Avec leurs procès, leur obéissance apparait inhumaine et la désobéissance comme une démarche d'humanité.
Frédéric Gros est souvent provocateur dans le but de réveiller les consciences et d'attiser la réflexion du lecteur pour le confronter à sa propre expérience. Finalement, dans cet essai qui est toujours clair, abordable, passionnant et qui comporte de nombreux textes et références historiques, le philosophe souligne combien le choix entre obéissance et désobéissance tient principalement à une affaire de responsabilité éthique. Il explique avec habileté les mécanismes de la soumission et de la résignation. La désobéissance civile, loin d'être une posture commode ou immature, est un moyen de questionner et de faire évoluer les lois sous une forme d'action politique acceptable ; elle n'affaiblit pas la démocratie mais au contraire la protège et la renforce. « Désobéir » n'est pas un essai faisant appel à la désobéissance mais il interroge sur ce que signifient la désobéissance et l'obéissance pour le sujet politique, comment s'opposer à ce qu'on estime être de mauvaises décisions. On peut donc accorder une valeur morale à l'acte de désobéissance. Cette responsabilité éthique doit conduire le citoyen à choisir ce qui offre le plus de possibilités de favoriser la justice et la liberté dans le monde. Cet essai a pour objectif de nous faire réfléchir et de nous inciter à garder une certaine distance critique par rapport à sa propre docilité et à rester attentif.
Dès les premières pages, Frédéric Gros s'interroge sur les raisons qui nous font accepter l'inacceptable dans un monde qui va mal. Il décrit les motifs qui auraient dû et devraient encore susciter notre désobéissance. Pourquoi avons-nous laissé faire ? Pourquoi cette passivité collective ? Pourquoi chacun d'entre nous obéit ?
«Affirmer qu'une fois les lois votées par la majorité, elles ne peuvent être contestées sous peine de trahir la volonté populaire est une mystification», prévient Frédéric Gros. «Etre un sujet politique, assure-t-il, c'est d'abord se poser la question de la désobéissance».
Frédéric Gros reprend la provocation de Howard Zinn qui affirmait : le problème ce n'est pas l'obéissance, le problème c'est l'obéissance…
Toutefois, au lieu de se demander pourquoi on désobéit, Frédéric Gros analyse les mécanismes de l'obéissance. Il questionne non seulement notre volonté de désobéir mais également notre malaise à le faire. «Les raisons de ne plus accepter l'état actuel du monde sont presque trop nombreuses. Et pourtant rien n'arrive, personne ou presque ne se lève. » Son propos, tout au long de l'essai, est de démontrer que la désobéissance est justifiée, ainsi ce qui le choque c'est l'absence de réaction et la passivité qui sont les conséquences de l'obéissance. Désobéir est un acte par lequel l'individu exprime sa dignité en affirmant sa liberté par son refus d'obéir.
Le premier chapitre s'intitule : « Nous avons accepté l'inacceptable ». Pourquoi et comment obéissons-nous ? Pourquoi sommes-nous si soumis, alors que les motifs de rébellion sont de plus en plus nombreux ? Désobéir prend plusieurs formes et Frédéric Gros explore quatre styles d'obéissance : la soumission, la subordination, le conformisme et le consentement.
La soumission est un rapport de force contrainte car elle repose sur le sentiment d'une impossibilité de désobéir. Nous devons pourtant apprendre à ne plus accepter l'inacceptable car les circonstances devraient nous amener à réagir : injustice sociale, accroissement des inégalités, privilèges injustifiés d'une minorité, dégradation de notre environnement. L'essai défend l'idée d'une démocratie critique, la désobéissance civile ne doit être ni délinquance, ni anarchie.
Le conformisme est la principale cause de la servitude volontaire, c'est la coutume qui entraine l'inertie passive, la peur de sortir du rang et de se singulariser. Chacun aligne son comportement sur celui des autres, on obéit par conformisme. La soumission à l'autorité s'est longtemps imposée par la force de la tradition. La désobéissance civile est pour Frédéric Gros un des moyens d'action les plus pertinents dans notre démocratie, aussi, tout au long de son essai le philosophe nous incite à abandonner les conduites conformistes qui sont si confortables et sécurisantes.
« Désobéir » nous entraine ensuite du conformisme au consentement qui est une obéissance libre, une aliénation volontaire, une contrainte pleinement acceptée.
Frédéric Gros ne défend pas la désobéissance à tout prix, ce serait aussi dangereux que de faire de l'obéissance une vertu inconditionnelle. Il s'agit pour lui de toujours savoir à quoi l'on obéit ou désobéit.
L'obéissance est confortable car on laisse les autres décider et penser à sa place, la responsabilité est un fardeau et l'obéissance permet de se décharger auprès d'un autre du poids de sa liberté.
Frédéric Gros interroge ce que signifient la démocratie et la désobéissance pour le sujet politique. Pour illustrer ses propos, il cite de nombreux auteurs et philosophes, de l'antiquité à nos jours, en s'appuyant sur des exemples concrets et réels afin de dégager une ligne de conduite à tenir.
Le philosophe américain Thoreau refuse de payer ses impôts au nom d'une certaine conception de la justice, il ne veut rient verser au fisc d'un état qui admet l'esclavage. La désobéissance civile, dont il va rédiger le manifeste, est l'acte réfléchi d'un homme chez qui l'éthique et le sens de l'avenir entrainent l'insoumission.
Il convient de s'interroger sur la nature de l'obéissance et de son illégitimité. C'est ce qu'expose Hannah Arendt dans son ouvrage, « Eichmnan à Jérusalem », où ce dernier apparait plus comme un exécutant contraint que comme un décideur antisémite. D'un point de vue philosophique Eichmann obéit illégitimement à une morale détestable. le danger est que chacun peut en rajouter dans son obéissance, ce qu'on appelle la surobéissance qui fait tenir le pouvoir politique mais les expériences totalitaires ont fait apparaitre des monstres d'obéissance. L'histoire nous apprend ainsi que la démocratie est plus souvent menacée par l'obéissance aveugle des citoyens que par leur désobéissance. Avec leurs procès, leur obéissance apparait inhumaine et la désobéissance comme une démarche d'humanité.
Frédéric Gros est souvent provocateur dans le but de réveiller les consciences et d'attiser la réflexion du lecteur pour le confronter à sa propre expérience. Finalement, dans cet essai qui est toujours clair, abordable, passionnant et qui comporte de nombreux textes et références historiques, le philosophe souligne combien le choix entre obéissance et désobéissance tient principalement à une affaire de responsabilité éthique. Il explique avec habileté les mécanismes de la soumission et de la résignation. La désobéissance civile, loin d'être une posture commode ou immature, est un moyen de questionner et de faire évoluer les lois sous une forme d'action politique acceptable ; elle n'affaiblit pas la démocratie mais au contraire la protège et la renforce. « Désobéir » n'est pas un essai faisant appel à la désobéissance mais il interroge sur ce que signifient la désobéissance et l'obéissance pour le sujet politique, comment s'opposer à ce qu'on estime être de mauvaises décisions. On peut donc accorder une valeur morale à l'acte de désobéissance. Cette responsabilité éthique doit conduire le citoyen à choisir ce qui offre le plus de possibilités de favoriser la justice et la liberté dans le monde. Cet essai a pour objectif de nous faire réfléchir et de nous inciter à garder une certaine distance critique par rapport à sa propre docilité et à rester attentif.
Spécialiste de Michel Foucault, Frédéric Gros est l'auteur de « Marcher une philosophie » qui, en 2009 connut un succès commercial légitime. Quelques années après Michel Onfray et notamment son « Anti manuel de philosophie », dans un style plus sobre, Frédéric Gros faisait oeuvre pédagogique en démontrant que la philosophie pouvait être appréhendée à travers des situations du quotidien, telles que la marche, qu'il s'agisse du simple déplacement urbain ou au grand air.
Frédéric Gros reprend la recette de « Marcher.. », il met en ordre de bataille les stars de la sagesse (occidentale) pour argumenter sur la dialectique obéissance/désobéissance, dans un propos qui se veut clair et didactique, sans être académique.
L'obéissance est le ciment de la société, en premier lieu avec l'ordre judéo-chrétien même si celui-ci n'exerce plus son pouvoir comme par le passé. La malédiction du péché originel provoquée par le refus d'obéissance à Dieu, la tentation de la chair et de la connaissance. L'homme doit faire soumission au Dieu biblique.
Il faudra attendre Spinoza, Marx et Nietzsche dans des registres différents pour dévoiler et dénoncer les ressorts de la création et du pouvoir de ce Dieu anthropomorphe, qui punit, culpabilise…
Mais si en apparence l'homme s'est libéré de cette aliénation religieuse d'autres formes d'idéologies, d'autres idoles asservissent le monde contemporain.
Si dans « Marcher… » Frédéric Gros prend le lecteur par la main pour l'introduire à l'univers de sages le faire cheminer paisiblement, comme on alimenterait un herbier, on guetterait le lever du soleil sur les crêtes dentelées, dans « Désobéir » c'est le poing levé que le philosophe accueille le lecteur.
Poing levé pour appeler à la révolte, ne plus accepter l'inacceptable. Ne plus accepter ce « modèle » planétaire qui produit la paupérisation de l'immense majorité et entretient les privilèges injustifiés d'une minorité, provoque une désertification spirituelle, conduit à une catastrophe écologique fatale.
En cela, le philosophe rejoint d'autres réquisitoires incisifs, comme ceux (liste non exhaustive…) de Stiglitz sur les méfaits de la finance (« La grande désillusion » 1997) et la grande récession de 2008 (« le triomphe de la cupidité » 2013), de Valérie Charolles sur les manipulations idéologiques relatives aux problèmes budgétaires et macroéconomiques s (« le libéralisme contre le capitalisme » 2006, « Et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité ? 2008), de Pierre Rabhi et Jean-Pierre Dupuy sur la crise écologique et spirituelle (« La convergence des consciences » 2016 « La marque du sacré » 2009). Assez curieusement, alors que ces questions existentielles d'actualité constituent la rampe de lancement de son livre, l'auteur de « Désobéir » ne cite aucun de ces analystes ou d'autres dans la même radicalité et préfère appeler à la barre les philosophes du panthéon classique, antiques ou contemporains.
Les politiques sont imposées comme répondant à des lois scientifiques, une réalité « objective » qui devient un impératif catégorique kantien, les « marchés » ces idoles modernes auxquelles il faut faire des sacrifices pour ne pas provoquer leur courroux et leur colère. On pense au « salammbô » de Flaubert. Sacrifier à Baal les enfants pour apaiser la divinité et faire pleuvoir.
Iconoclaste le rapprochement ? Est-ce que le sacrifice des droits sociaux sur l'autel du « CAC 40 », le démembrement de ce qui reste de l'Etat providence sont légitimes ? Est-ce que l'existence de ces droits sociaux est à l'origine de la grande récession apparue en 2008 ?
Dans ces politiques d'austérité sans fin il y a incontestablement une dimension punitive, comme si la vie pouvait se résumer à la fable de « la cigale et la fourmi » de la Fontaine.
On retrouve Nietzsche et sa seconde dissertation (« La faute »…) de « la généalogie de la morale », la culpabilisation, comme instrument de domination.
Le propos de Frédéric Gros est sans ambiguïté, Il est plus qu'urgent de désobéir de ne plus accepter cet « ordre »politique, économique, idéologique mortifère.
Comment désobéir, remettre en cause l'ordre, alors que depuis Hobbes, Locke, Rousseau il semble établi que hors du contrat politique, point de salut, c'est le retour à l'état sauvage le plus brutal ?
Le conformisme est si confortable, si sécurisant et le prix à payer n'est-il pas exorbitant ? Perdre sa place dans la chaine alimentaire, tous ces sacrifices, ces souffrances pour un statut social ou tout simplement pour survivre. Dans l'univers romanesque mais pas si éloigné que cela de la réalité, Winston Smith le héros de « 1984 » de Georges Orwell qui se révolte avec l'issue épouvantable que l'on sait. Non cité par l'auteur, on pense aussi à Tomas dans le chef d'oeuvre de Kundera, «L'Insoutenable légèreté de l'être », le courage de pas obéir, avec la menace de tout perdre y compris la vie..
La motivation et les causes des actes d'obéissance/désobéissance sont complexes et en définitive il existe une réversibilité une ambivalence.
Le cas de Socrate, figure de proue de la philosophie occidentale, interpelle à cet égard. Condamné à mort injustement, son ami Criton lui offre la liberté par la fuite. C'est le dialogue du même nom inséré dans le fameux triptyque Apologie de Socrate/Criton/Phédon. Socrate choisit d'obéir à la décision de justice fut-elle révoltante. En réalité cet acte d'obéissance correspond à un choix individuel, après un débat argumenté dans le dialogue du Criton. Dans cet esprit, c'est Socrate qui choisit sa condamnation et fait éclater pour l'éternité la puissance de son choix. Ce n'est pas un message de servilité par principe.
Servilité que l'on retrouve dans l'affaire Eichmann développée par l'auteur. le contexte historique est aussi bien connu. le maitre d'oeuvre de la mort industrielle, de la solution finale est jugé en 1961 à Jérusalem. le monde entier retient son souffle pour découvrir dans le box, sinon Lucifer en personne, tout au moins un avatar de Faust.
En réalité, pas l'ombre de la trace d'un pied fourchu, ce qui est fourchu c'est le courage de cet homme et de tous ceux qui ont oeuvré au fonctionnement de la terreur nazie. Hannah Arendt découvre un chef de service médiocre, la terrible banalité du mal qui permet à chacun(e) ou presque de devenir bourreau. Oui naturellement il y avait cet abominable appareil répressif mais une chose est d'obéir sous la contrainte pour sauver sa peau et une autre de servir.
Car le rappelle fort à propos Frédéric Gros, contrairement aux apparences, l'univers nazi se caractérisait d'abord par l'irrationnel, le chaos, au niveau de la gouvernance, des institutions. Il y avait des rivalités féroces entre dignitaires, leurs réseaux. Dans ce contexte, Il faut le zèle des petites mains..
C'est ainsi que Eichmann ne peut se remparer dans sa posture d'exécutant contraint par un système coercitif irrésistible. Si l'extermination a pris cette dimension c'est bien parce qu'Eichmann et un réseau d'acteurs convaincus ont porté le fer et le feu avec conviction.
On retrouve là toute la force et la profondeur du « Discours de la servitude volontaire » de la Boétie écrit au XVI siècle
« D'où il a pris tant d'yeux par lesquels il vous épie, si vous ne les lui donnez ? »
« Comment il a tant de mains pour vous frappez, s'il ne els prend de vous ? »
« Les pieds dont il foule vos cités d'où les a-t-il s'ils ne sont pas les vôtres ? »
Cette prise de conscience suppose que chacun puisse intérieurement s'exfiltrer des mécanismes de domination, ce qui signifie (re)trouver, son existence, sa dimension, son propre destin, le fameux « connais toi toi même », l'injonction de Socrate, mais aussi la connaissance de soi libératrice de Spinoza ou plus récemment l'irremplaçabilité de Cynthia Fleury.
Ne plus être un exécutant servile, un simple rouage sans conscience, sans histoire, sans racine au sens de Simone Weil.
Etre irremplaçable, être conscient de son irremplaçabilité, c'est d'abord se nourrir d'une pensée libre, qui vit notamment par un langage qui permet de mettre les mots sur les émotions intimes, résister aux injonctions, en trouvant également les mots pour les identifier, les qualifier. C'est le péril de la tentation totalitaire de la « novlangue » de 1984 d'Orwell, quand le pouvoir supprime les mots, les défigure, les dissous dans des raccourcis utilitaires. Somme nous si éloignés de ce cauchemar ?
Ce livre zoome aussi sur la pensée de philosophes, sur des oeuvres que le format du présent exercice ne permet pas de développer (Thoreau, Sophocle…)
Ombres au tableau, ce livre compte de mon point de vue, deux faiblesses.
La première est certains emprunts « sans rendre à César ce qui est à César ». Je pense en particulier à Cynthia Fleury évoquée précédemment, dont le nom n'apparait pas. La seconde est la faiblesse de la conclusion, comme si après avoir, avec réussite, mis en ordre de bataille les principes, les analyses, Frédéric Gros ne savait plus trop comment les utiliser.
Le livre s'achève sur un retour à Platon, sur « la République », le guerrier, le sage, le travailleur, et leurs vertus respectives présumées, courage, sagesse, tempérance. Il faut certes « retrouver la lumière grecque ».
Voilà une conclusion qui ne fâchera personne.
Le lecteur n'attendait pas un programme politique mais la partie finale manque de souffle.
Quoiqu'il en soit, un livre d'une grande richesse, stimulant à lire, en profitant de cette période estivale qui permet en principe, de se « pauser », pour bénéficier d'un peu plus de nourriture spirituelle.
Contribution faite dans le cadre de masse critique. Je remercie babelio et les éditions Albin Michel.
Frédéric Gros reprend la recette de « Marcher.. », il met en ordre de bataille les stars de la sagesse (occidentale) pour argumenter sur la dialectique obéissance/désobéissance, dans un propos qui se veut clair et didactique, sans être académique.
L'obéissance est le ciment de la société, en premier lieu avec l'ordre judéo-chrétien même si celui-ci n'exerce plus son pouvoir comme par le passé. La malédiction du péché originel provoquée par le refus d'obéissance à Dieu, la tentation de la chair et de la connaissance. L'homme doit faire soumission au Dieu biblique.
Il faudra attendre Spinoza, Marx et Nietzsche dans des registres différents pour dévoiler et dénoncer les ressorts de la création et du pouvoir de ce Dieu anthropomorphe, qui punit, culpabilise…
Mais si en apparence l'homme s'est libéré de cette aliénation religieuse d'autres formes d'idéologies, d'autres idoles asservissent le monde contemporain.
Si dans « Marcher… » Frédéric Gros prend le lecteur par la main pour l'introduire à l'univers de sages le faire cheminer paisiblement, comme on alimenterait un herbier, on guetterait le lever du soleil sur les crêtes dentelées, dans « Désobéir » c'est le poing levé que le philosophe accueille le lecteur.
Poing levé pour appeler à la révolte, ne plus accepter l'inacceptable. Ne plus accepter ce « modèle » planétaire qui produit la paupérisation de l'immense majorité et entretient les privilèges injustifiés d'une minorité, provoque une désertification spirituelle, conduit à une catastrophe écologique fatale.
En cela, le philosophe rejoint d'autres réquisitoires incisifs, comme ceux (liste non exhaustive…) de Stiglitz sur les méfaits de la finance (« La grande désillusion » 1997) et la grande récession de 2008 (« le triomphe de la cupidité » 2013), de Valérie Charolles sur les manipulations idéologiques relatives aux problèmes budgétaires et macroéconomiques s (« le libéralisme contre le capitalisme » 2006, « Et si les chiffres ne disaient pas toute la vérité ? 2008), de Pierre Rabhi et Jean-Pierre Dupuy sur la crise écologique et spirituelle (« La convergence des consciences » 2016 « La marque du sacré » 2009). Assez curieusement, alors que ces questions existentielles d'actualité constituent la rampe de lancement de son livre, l'auteur de « Désobéir » ne cite aucun de ces analystes ou d'autres dans la même radicalité et préfère appeler à la barre les philosophes du panthéon classique, antiques ou contemporains.
Les politiques sont imposées comme répondant à des lois scientifiques, une réalité « objective » qui devient un impératif catégorique kantien, les « marchés » ces idoles modernes auxquelles il faut faire des sacrifices pour ne pas provoquer leur courroux et leur colère. On pense au « salammbô » de Flaubert. Sacrifier à Baal les enfants pour apaiser la divinité et faire pleuvoir.
Iconoclaste le rapprochement ? Est-ce que le sacrifice des droits sociaux sur l'autel du « CAC 40 », le démembrement de ce qui reste de l'Etat providence sont légitimes ? Est-ce que l'existence de ces droits sociaux est à l'origine de la grande récession apparue en 2008 ?
Dans ces politiques d'austérité sans fin il y a incontestablement une dimension punitive, comme si la vie pouvait se résumer à la fable de « la cigale et la fourmi » de la Fontaine.
On retrouve Nietzsche et sa seconde dissertation (« La faute »…) de « la généalogie de la morale », la culpabilisation, comme instrument de domination.
Le propos de Frédéric Gros est sans ambiguïté, Il est plus qu'urgent de désobéir de ne plus accepter cet « ordre »politique, économique, idéologique mortifère.
Comment désobéir, remettre en cause l'ordre, alors que depuis Hobbes, Locke, Rousseau il semble établi que hors du contrat politique, point de salut, c'est le retour à l'état sauvage le plus brutal ?
Le conformisme est si confortable, si sécurisant et le prix à payer n'est-il pas exorbitant ? Perdre sa place dans la chaine alimentaire, tous ces sacrifices, ces souffrances pour un statut social ou tout simplement pour survivre. Dans l'univers romanesque mais pas si éloigné que cela de la réalité, Winston Smith le héros de « 1984 » de Georges Orwell qui se révolte avec l'issue épouvantable que l'on sait. Non cité par l'auteur, on pense aussi à Tomas dans le chef d'oeuvre de Kundera, «L'Insoutenable légèreté de l'être », le courage de pas obéir, avec la menace de tout perdre y compris la vie..
La motivation et les causes des actes d'obéissance/désobéissance sont complexes et en définitive il existe une réversibilité une ambivalence.
Le cas de Socrate, figure de proue de la philosophie occidentale, interpelle à cet égard. Condamné à mort injustement, son ami Criton lui offre la liberté par la fuite. C'est le dialogue du même nom inséré dans le fameux triptyque Apologie de Socrate/Criton/Phédon. Socrate choisit d'obéir à la décision de justice fut-elle révoltante. En réalité cet acte d'obéissance correspond à un choix individuel, après un débat argumenté dans le dialogue du Criton. Dans cet esprit, c'est Socrate qui choisit sa condamnation et fait éclater pour l'éternité la puissance de son choix. Ce n'est pas un message de servilité par principe.
Servilité que l'on retrouve dans l'affaire Eichmann développée par l'auteur. le contexte historique est aussi bien connu. le maitre d'oeuvre de la mort industrielle, de la solution finale est jugé en 1961 à Jérusalem. le monde entier retient son souffle pour découvrir dans le box, sinon Lucifer en personne, tout au moins un avatar de Faust.
En réalité, pas l'ombre de la trace d'un pied fourchu, ce qui est fourchu c'est le courage de cet homme et de tous ceux qui ont oeuvré au fonctionnement de la terreur nazie. Hannah Arendt découvre un chef de service médiocre, la terrible banalité du mal qui permet à chacun(e) ou presque de devenir bourreau. Oui naturellement il y avait cet abominable appareil répressif mais une chose est d'obéir sous la contrainte pour sauver sa peau et une autre de servir.
Car le rappelle fort à propos Frédéric Gros, contrairement aux apparences, l'univers nazi se caractérisait d'abord par l'irrationnel, le chaos, au niveau de la gouvernance, des institutions. Il y avait des rivalités féroces entre dignitaires, leurs réseaux. Dans ce contexte, Il faut le zèle des petites mains..
C'est ainsi que Eichmann ne peut se remparer dans sa posture d'exécutant contraint par un système coercitif irrésistible. Si l'extermination a pris cette dimension c'est bien parce qu'Eichmann et un réseau d'acteurs convaincus ont porté le fer et le feu avec conviction.
On retrouve là toute la force et la profondeur du « Discours de la servitude volontaire » de la Boétie écrit au XVI siècle
« D'où il a pris tant d'yeux par lesquels il vous épie, si vous ne les lui donnez ? »
« Comment il a tant de mains pour vous frappez, s'il ne els prend de vous ? »
« Les pieds dont il foule vos cités d'où les a-t-il s'ils ne sont pas les vôtres ? »
Cette prise de conscience suppose que chacun puisse intérieurement s'exfiltrer des mécanismes de domination, ce qui signifie (re)trouver, son existence, sa dimension, son propre destin, le fameux « connais toi toi même », l'injonction de Socrate, mais aussi la connaissance de soi libératrice de Spinoza ou plus récemment l'irremplaçabilité de Cynthia Fleury.
Ne plus être un exécutant servile, un simple rouage sans conscience, sans histoire, sans racine au sens de Simone Weil.
Etre irremplaçable, être conscient de son irremplaçabilité, c'est d'abord se nourrir d'une pensée libre, qui vit notamment par un langage qui permet de mettre les mots sur les émotions intimes, résister aux injonctions, en trouvant également les mots pour les identifier, les qualifier. C'est le péril de la tentation totalitaire de la « novlangue » de 1984 d'Orwell, quand le pouvoir supprime les mots, les défigure, les dissous dans des raccourcis utilitaires. Somme nous si éloignés de ce cauchemar ?
Ce livre zoome aussi sur la pensée de philosophes, sur des oeuvres que le format du présent exercice ne permet pas de développer (Thoreau, Sophocle…)
Ombres au tableau, ce livre compte de mon point de vue, deux faiblesses.
La première est certains emprunts « sans rendre à César ce qui est à César ». Je pense en particulier à Cynthia Fleury évoquée précédemment, dont le nom n'apparait pas. La seconde est la faiblesse de la conclusion, comme si après avoir, avec réussite, mis en ordre de bataille les principes, les analyses, Frédéric Gros ne savait plus trop comment les utiliser.
Le livre s'achève sur un retour à Platon, sur « la République », le guerrier, le sage, le travailleur, et leurs vertus respectives présumées, courage, sagesse, tempérance. Il faut certes « retrouver la lumière grecque ».
Voilà une conclusion qui ne fâchera personne.
Le lecteur n'attendait pas un programme politique mais la partie finale manque de souffle.
Quoiqu'il en soit, un livre d'une grande richesse, stimulant à lire, en profitant de cette période estivale qui permet en principe, de se « pauser », pour bénéficier d'un peu plus de nourriture spirituelle.
Contribution faite dans le cadre de masse critique. Je remercie babelio et les éditions Albin Michel.
Une méditation sereine sur la mise en œuvre de la « désobéissance » par quelques figures héroïques du passé.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
L'exergue de Primo Levi donne le ton de l'essai "les montres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être dangereux ; ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter".
"Désobéir" nous invite à cesser d'être des êtres ordinaires pour devenir des êtres libres ce qui signifie aussi des individus responsables qui agissent et décident en conscience. Et c'est bien plus compliqué qu'il y parait, car il s'agit surtout de désobéir pour une bonne raison : obéir à soi-même ! un soi-même exigeant et lucide qui renoncerait à "laisser pulluler les ambitions médiocres, céder à la facilité, laisser enfler le vulgaire, rapetisser le magnanime" afin que "la maîtrise parfaite de soi et l'obéissance souveraine à soi-même produisent un ordre intérieur". En quelque sorte il s'agit de redevenir un sujet politique et éthique. La clarté de la définition de l'éthique par Gros facilite grandement la lecture "ce que j'appelle ici éthique c'est la manière dont chacun se construit et travaille un certain "rapport" à partir duquel il s'autorise à accomplir telle chose, à faire ceci, plutôt que cela (...) Obéir, désobéir, c'est donner une forme à sa liberté".
Dès le début de l'essai, Frédéric Gros énonce en quelques pages comment nous avons accepter l'inacceptable et décrit les motifs qui "auraient dû depuis longtemps susciter notre désobéissance et devraient la provoquer encore aujourd'hui". En premier lieu, le creusement des injustices sociales, des inégalités de fortune et son corollaire la cupidité qui entraine l'enrichissement des riches, l'appauvrissement des pauvres et l'effondrement progressif de la classe moyenne ; le second point intolérable est la dégradation de notre environnement, la Nature selon les mots de Gros "suffoque" et nous avec. La dernière chose inacceptable se résume en un mot : capitalisme. Spéculation financière, endettement généralisé, accélérations par les nouvelles technologies... conduisent à une course en avant suicidaire qui épuise à la fois les humains et la Nature. Dès lors, "La vraie question ce n'est pas pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se révoltent pas"( Wilhem Reich). Pour rétablir un certain équilibre intérieur et retrouver une forme d'intégrité morale et politique désobéir s'avère d'abord un remède et une victoire sur soi-même. En refusant le conformisme généralisé et l'inertie du monde, chacun peut redevenir un sujet politique s'autorisant une dissidence civique.
La lecture passionnante de l'essai déroule les nombreuses inepties du monde moderne, les soumissions et les résignations politiques qui conduisent aux catastrophes humaines et écologiques. Mais cet ouvrage ne fait pas que lister les formes d'esclavage de la pensée et de l'action, il propose des "remèdes" dont le plus absolu et le plus difficile à avaler, sans doute, est le recouvrement de sa propre liberté afin de ne pas être ce que La Boétie nomme dans Discours sur la servitude volontaire "les traitres de vous-même". "Penser c'est se désobéir, désobéir à ses certitudes, son confort, ses habitudes"
Une lecture hautement recommandable qui devrait être dans toutes les bibliothèques publiques et privées. Un livre à lire, relire et offrir.
"Désobéir" nous invite à cesser d'être des êtres ordinaires pour devenir des êtres libres ce qui signifie aussi des individus responsables qui agissent et décident en conscience. Et c'est bien plus compliqué qu'il y parait, car il s'agit surtout de désobéir pour une bonne raison : obéir à soi-même ! un soi-même exigeant et lucide qui renoncerait à "laisser pulluler les ambitions médiocres, céder à la facilité, laisser enfler le vulgaire, rapetisser le magnanime" afin que "la maîtrise parfaite de soi et l'obéissance souveraine à soi-même produisent un ordre intérieur". En quelque sorte il s'agit de redevenir un sujet politique et éthique. La clarté de la définition de l'éthique par Gros facilite grandement la lecture "ce que j'appelle ici éthique c'est la manière dont chacun se construit et travaille un certain "rapport" à partir duquel il s'autorise à accomplir telle chose, à faire ceci, plutôt que cela (...) Obéir, désobéir, c'est donner une forme à sa liberté".
Dès le début de l'essai, Frédéric Gros énonce en quelques pages comment nous avons accepter l'inacceptable et décrit les motifs qui "auraient dû depuis longtemps susciter notre désobéissance et devraient la provoquer encore aujourd'hui". En premier lieu, le creusement des injustices sociales, des inégalités de fortune et son corollaire la cupidité qui entraine l'enrichissement des riches, l'appauvrissement des pauvres et l'effondrement progressif de la classe moyenne ; le second point intolérable est la dégradation de notre environnement, la Nature selon les mots de Gros "suffoque" et nous avec. La dernière chose inacceptable se résume en un mot : capitalisme. Spéculation financière, endettement généralisé, accélérations par les nouvelles technologies... conduisent à une course en avant suicidaire qui épuise à la fois les humains et la Nature. Dès lors, "La vraie question ce n'est pas pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se révoltent pas"( Wilhem Reich). Pour rétablir un certain équilibre intérieur et retrouver une forme d'intégrité morale et politique désobéir s'avère d'abord un remède et une victoire sur soi-même. En refusant le conformisme généralisé et l'inertie du monde, chacun peut redevenir un sujet politique s'autorisant une dissidence civique.
La lecture passionnante de l'essai déroule les nombreuses inepties du monde moderne, les soumissions et les résignations politiques qui conduisent aux catastrophes humaines et écologiques. Mais cet ouvrage ne fait pas que lister les formes d'esclavage de la pensée et de l'action, il propose des "remèdes" dont le plus absolu et le plus difficile à avaler, sans doute, est le recouvrement de sa propre liberté afin de ne pas être ce que La Boétie nomme dans Discours sur la servitude volontaire "les traitres de vous-même". "Penser c'est se désobéir, désobéir à ses certitudes, son confort, ses habitudes"
Une lecture hautement recommandable qui devrait être dans toutes les bibliothèques publiques et privées. Un livre à lire, relire et offrir.
Face à l'accroissement des inégalités sociales, à la dégradation progressive de notre environnement, au processus de création des richesses par la dette et la spéculation, au détriment de l'humanité à venir, tout cet inacceptable que nous avons accepté, Frédéric Gros en appelle à une « démocratique critique", définie par le refus des évidences consensuelles, des conformismes sociaux, du prêt-à-penser. Ce "soi politique" alimente la désobéissance.
Considérée pendant des siècles comme l'expression de « l'instinct sauvage », la désobéissance s'humanise avec Eichman, Hannah Arendte et la banalité du mal.
Frédéric Gros décortique les mécanismes de l'obéissance, qui dérive en sur-obéissance et de ses réponses : insoumission, objection de conscience et désobéissance civique. Celles-ci se basent sur une éthique de la responsabilité, responsabilité face au monde et face à soi-même
C'est un livre relativement bref quoique très dense, qui s'appuie sur l'apport de nombreux philosophes, de Socrate à Foucault en passant par Kant et La Boétie, et s'appuie sur des exemples d'obéisseurs (Eichman, expériences de Asch et de Stanley Milgram) et de désobéisseurs célèbres (Antigone, Adam et Eve, Thoreau... ). L’érudition n'empêche pas les talents de conteur et la fluidité d'écriture; l'intelligence de l'auteur donne à la lectrice l'impression qu'elle la partage, ou du moins est apte à en cueillir de nombreuses retombées enrichissantes. C'est une belle stimulation intellectuelle, à l'exacte portée de mes faibles compétences "philosophiques", une invitation à s'engager, encourageante en ces temps où la rébellion devrait le disputer à l'uniformité.
Considérée pendant des siècles comme l'expression de « l'instinct sauvage », la désobéissance s'humanise avec Eichman, Hannah Arendte et la banalité du mal.
Frédéric Gros décortique les mécanismes de l'obéissance, qui dérive en sur-obéissance et de ses réponses : insoumission, objection de conscience et désobéissance civique. Celles-ci se basent sur une éthique de la responsabilité, responsabilité face au monde et face à soi-même
C'est un livre relativement bref quoique très dense, qui s'appuie sur l'apport de nombreux philosophes, de Socrate à Foucault en passant par Kant et La Boétie, et s'appuie sur des exemples d'obéisseurs (Eichman, expériences de Asch et de Stanley Milgram) et de désobéisseurs célèbres (Antigone, Adam et Eve, Thoreau... ). L’érudition n'empêche pas les talents de conteur et la fluidité d'écriture; l'intelligence de l'auteur donne à la lectrice l'impression qu'elle la partage, ou du moins est apte à en cueillir de nombreuses retombées enrichissantes. C'est une belle stimulation intellectuelle, à l'exacte portée de mes faibles compétences "philosophiques", une invitation à s'engager, encourageante en ces temps où la rébellion devrait le disputer à l'uniformité.
Voilà un essai assez décoiffant. La désobéissance à travers un questionnement sur notre obéissance, c'e'st le voyage que l'auteur nous propose ici. Nous sommes bien sûr tous concernés car dans la moindre de nos actions, nous pouvons avoir cette problématique? Et quel miroir ! C'est un essai très nourrissant qui nous permet de "justifier" nos désobéissances spontanées sans que nous puissions vraiment nous l'expliquer. Cet essai jette des ponts. L'auteur nous aide à nous comprendre, à prendre du recul ! De plus, l'avantage de ce livre, c'est qu'il est dans l'ensemble très compréhensible. Enrichissant !
Je trouve que ce livre mérite bien une première critique. Très intéressant et illustré de nombreux domaines où la honte agit comme un poison (viol/inceste, ségrégations sociales...), il met des mots sur un impensé de la société et permet surtout d'en appréhender la dimension collective, propre à redonner du peps dans la quête de sens nécessaires aux transformations en cours, qui ont bien besoin qu'on sorte de la dimension individualiste (via la culpabilité) pour retrouver une juste dose de colère et d'énergie pour construire les solutions désirables.
En s’appuyant sur ses propres recherches et sur ses propres expériences, Frédéric Gros raconte, avec beaucoup de justesse, la vie fascinante de Mesmer.
Lien : https://www.journaldequebec...
Lien : https://www.journaldequebec...
Naviguer entre Vienne et Paris fin XVIIIe siècle. Musique et vibrations à chaque page. Des évoqués prestigieux : Mozart, Lavoisier... et les plus discrets comme ces femmes qui sont allées chercher le roi à Versailles.
Le contexte est très intéressant.
La naissance du magnétisme est superbement bien écrite et appréhendée. On aimerait participer au bain magnétisé au son des instrumentistes et dans la lumière tamisée.
Le contexte est très intéressant.
La naissance du magnétisme est superbement bien écrite et appréhendée. On aimerait participer au bain magnétisé au son des instrumentistes et dans la lumière tamisée.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Frédéric Gros
Quiz
Voir plus
Quiz Sur Le Royaume de Kensuké
A quelle personne le livre est-il écrit ?
1ere personne
3eme personne
13 questions
1313 lecteurs ont répondu
Thème : Le royaume de Kensuké de
Michael MorpurgoCréer un quiz sur cet auteur1313 lecteurs ont répondu