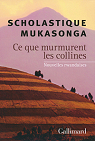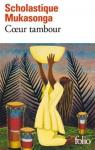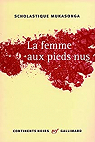Critiques de Scholastique Mukasonga (326)
Lycéennes entre éducation et géopolitique au cœur du Rwanda.
Dans une ambiance de lycée de filles toutes les tensions du Rwanda sont palpables. Si les Tutsi ont eu les faveurs des colonisateurs belges, ils se trouvent marginalisés après l'indépendance et stigmatisés par les Hutus, ethnie majoritaire arrivée au pouvoir.
Pourtant au lycée, et dans les emplois de fonctionnaires, un quota est réservé aux Tutsis. Dans cette fin des années 1960, la tension semble maîtrisée même si elle reste palpable. La moindre étincelle peut raviver cette haine séculaire.
Dans ce contexte de ségrégation et de haine larvée, les adolescentes vivent leur vie de filles, entre rivalités et jalousies. Elles qui représentent la future élite féminine du pays, sont tenues par la poigne de fer de la mère supérieure. L'éducation, l'accès au diplôme prime.
A travers quelques portraits poignants, l'auteure nous conduit dans ce pays de montagnes et de forêts, où la tradition orale est encore bien présente à côté du désir d'émancipation née de la période coloniale. On découvre un pays déchiré et les préludes du massacre humanitaire qui va le frapper quelques années plus tard. Les relations entre élèves peu à peu se transforment , au fur et à mesure que l'antagonisme prend forme et que la politique prend le pas sur l’éducation.
Un beau roman, même s'il n'a pas de qualités littéraires exceptionnelles, touchant, drôle et dur à la fois.
Lien : http://animallecteur.canalbl..
Dans une ambiance de lycée de filles toutes les tensions du Rwanda sont palpables. Si les Tutsi ont eu les faveurs des colonisateurs belges, ils se trouvent marginalisés après l'indépendance et stigmatisés par les Hutus, ethnie majoritaire arrivée au pouvoir.
Pourtant au lycée, et dans les emplois de fonctionnaires, un quota est réservé aux Tutsis. Dans cette fin des années 1960, la tension semble maîtrisée même si elle reste palpable. La moindre étincelle peut raviver cette haine séculaire.
Dans ce contexte de ségrégation et de haine larvée, les adolescentes vivent leur vie de filles, entre rivalités et jalousies. Elles qui représentent la future élite féminine du pays, sont tenues par la poigne de fer de la mère supérieure. L'éducation, l'accès au diplôme prime.
A travers quelques portraits poignants, l'auteure nous conduit dans ce pays de montagnes et de forêts, où la tradition orale est encore bien présente à côté du désir d'émancipation née de la période coloniale. On découvre un pays déchiré et les préludes du massacre humanitaire qui va le frapper quelques années plus tard. Les relations entre élèves peu à peu se transforment , au fur et à mesure que l'antagonisme prend forme et que la politique prend le pas sur l’éducation.
Un beau roman, même s'il n'a pas de qualités littéraires exceptionnelles, touchant, drôle et dur à la fois.
Lien : http://animallecteur.canalbl..
Notre-Dame du Nil, c'est d'abord la vierge au visage noir qui bénit la source du Nil, mais aussi une école de filles dans les hauteurs rwandaises. Le lycée est dirigé par les soeurs et l'enseignement y est assuré par les blancs (belges et français), sa mission est de former l'élite féminine de demain, et ce à travers une formation chrétienne et démocratique.
On suivra alors tout au long des chapitres, la vie des filles Hutus (entre autres)
- Gloriosa : fille d'un ministre et assoiffée de pouvoir et qui à travers son appartenance au parti majoritaire se permet toutes les dérives.....
- Immaculée : fille d'un homme d'affaire, qui ne semble s'intéresser qu'à sa beauté....
Les filles Tutsi :
- Veronica : qui rêve de partir en Europe...
- Virginia : qui a les pieds sur terre...
et enfin
+ Modesta : la métisse, d'une mère Tutsi et d'un père Hutu et qui enfin de compte n'appartient à aucun camp....
Grâce à ces personnages , on a une représentation des composants de la société et une description de la réalité de la vie au Rwanda poste coloniale, et ce à travers le mode de vie, les croyances et les traditions mais aussi les tensions ethniques et la montée de la haine raciale.
Pour moi c'était une belle lecture, surtout à partir du 4éme chapitre .
On suivra alors tout au long des chapitres, la vie des filles Hutus (entre autres)
- Gloriosa : fille d'un ministre et assoiffée de pouvoir et qui à travers son appartenance au parti majoritaire se permet toutes les dérives.....
- Immaculée : fille d'un homme d'affaire, qui ne semble s'intéresser qu'à sa beauté....
Les filles Tutsi :
- Veronica : qui rêve de partir en Europe...
- Virginia : qui a les pieds sur terre...
et enfin
+ Modesta : la métisse, d'une mère Tutsi et d'un père Hutu et qui enfin de compte n'appartient à aucun camp....
Grâce à ces personnages , on a une représentation des composants de la société et une description de la réalité de la vie au Rwanda poste coloniale, et ce à travers le mode de vie, les croyances et les traditions mais aussi les tensions ethniques et la montée de la haine raciale.
Pour moi c'était une belle lecture, surtout à partir du 4éme chapitre .
Notre-Dame du Nil est un lycée de jeunes filles au Rwanda. Ces jeunes Rwandaises sont destinées à devenir l'élite du pays, en épousant des hommes choisis soigneusement par les familles dans l'intérêt de leur lignage. Isolé près des sources du Nil afin que les tentations ne parviennent pas jusqu'aux jeunes filles, le lycée est dirigé par le père Herménégilde et la mère supérieure, et emploie des professeurs belges, français et rwandais. Chaque année, au mois de mai, un pèlerinage est organisé en l'honneur de la Vierge Marie et tous se rendent auprès de sa statue. L'occasion pour les jeunes filles de sortir de leur lycée et de se mêler à la population, sous la vigilance constante de la mère supérieure....
Au lycée, il y a un quota ethnique : 10% des élèves doivent être Tutsi, et toutes les autres font partie du peuple majoritaire, les Hutus. Car même au lycée où tout pourrait être idyllique, la politique et la haine s'insinuent dans la vie des jeunes filles. Gloriosa, qui se voit bien en chef du lycée et représentante du peuple majoritaire, dira : "C'est cela le quota : vingt élèves, deux Tutsi, et à cause de cela, j'ai des amies, des vraies Rwandaises du peuple majoritaire, du peuple de la houe, qui n'ont pas eu de place en secondaire. Comme mon père le répète, il faudra bien nous débarrasser un jour de ces quotas, c'est une histoire de Belges !". La belle Veronica et Virginia Mutamuriza (celle qui ne pleure jamais), les deux tutsi de la classe secondaire, vont devenir les objets principaux de sa haine... Car les Tutsi sont considérés comme des Inyenzi, des cafards, des moins que rien.
Et pourtant, pas très loin du lycée, vit Monsieur de Fontenaille, un vieux fou, peintre et anthropologue, persuadé que les Tutsi descendent des pharaons. En rencontrant Veronica, il croit voir la déesse Isis et construit un temple en son honneur.
Scholastique Mukasonga nous fait partager un an de la vie de ces jeunes filles, leurs amitiés, leurs découvertes, et puis la haine raciale, la jalousie, les complots qui s'insinuent petit à petit dans le lycée. Son écriture est très forte et les portraits des jeunes filles sont captivants. Ce roman est poignant et m'a profondément marquée. Lorsque l'on referme le livre, on ne cesse de penser au destin dramatique des jeunes filles et on se souvient alors que Scholastique Mukasonga a elle-même échappé au massacre des Tutsi. A travers le destin des lycéennes, on aperçoit le destin du peuple rwandais qui se déchire.
Lien : http://leschroniquesassidues..
Au lycée, il y a un quota ethnique : 10% des élèves doivent être Tutsi, et toutes les autres font partie du peuple majoritaire, les Hutus. Car même au lycée où tout pourrait être idyllique, la politique et la haine s'insinuent dans la vie des jeunes filles. Gloriosa, qui se voit bien en chef du lycée et représentante du peuple majoritaire, dira : "C'est cela le quota : vingt élèves, deux Tutsi, et à cause de cela, j'ai des amies, des vraies Rwandaises du peuple majoritaire, du peuple de la houe, qui n'ont pas eu de place en secondaire. Comme mon père le répète, il faudra bien nous débarrasser un jour de ces quotas, c'est une histoire de Belges !". La belle Veronica et Virginia Mutamuriza (celle qui ne pleure jamais), les deux tutsi de la classe secondaire, vont devenir les objets principaux de sa haine... Car les Tutsi sont considérés comme des Inyenzi, des cafards, des moins que rien.
Et pourtant, pas très loin du lycée, vit Monsieur de Fontenaille, un vieux fou, peintre et anthropologue, persuadé que les Tutsi descendent des pharaons. En rencontrant Veronica, il croit voir la déesse Isis et construit un temple en son honneur.
Scholastique Mukasonga nous fait partager un an de la vie de ces jeunes filles, leurs amitiés, leurs découvertes, et puis la haine raciale, la jalousie, les complots qui s'insinuent petit à petit dans le lycée. Son écriture est très forte et les portraits des jeunes filles sont captivants. Ce roman est poignant et m'a profondément marquée. Lorsque l'on referme le livre, on ne cesse de penser au destin dramatique des jeunes filles et on se souvient alors que Scholastique Mukasonga a elle-même échappé au massacre des Tutsi. A travers le destin des lycéennes, on aperçoit le destin du peuple rwandais qui se déchire.
Lien : http://leschroniquesassidues..
Dans Inyenzi ou les cafards , Mukasonga, née au Rwanda en 1956, montre comment elle et sa famille, comme tous les Tutsis, ont vécu dans la peur constante d'être assassinés par leurs compatriotes hutus. Elle est l'une des très rares survivantes de sa famille, après les massacres qui ont commencé dés 1959, et que, seul, dans le désert de lâcheté universelle, Bertand Russell a dénoncé comme étant les prémices d'un génocide,
quant à eux les organismes internationaux, les dirigeants des états et l'église catholique, ont su détourner pudiquement leurs âmes charitables... Les meurtres se sont intensifiés jusqu'en 1994, lorsque quelque 800 000 Tutsis ont effectivement été massacrés dans une "solution finale" dont les rafles et les meurtres - à la machette - ressemblaient par leur méticulosité systématique aux arrestations massives, aux camps d'extermination et au gaz. chambres utilisées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme dans l'Allemagne nazie, les Hutus ont méthodiquement planifié et exécuté une extermination. Considérés comme des Inyenzi (cafards) par les Hutus politiquement dominants, les Tutsis ont d'abord été persécutés lors d'un pogrom qui a eu lieu le jour de la Toussaint 1959. « La machinerie du génocide avait été mise en branle », écrit Mukasonga . "Ça ne s'arrêterait jamais." Bien que l'auteur n'ait que trois ans à l'époque, les images de cette journée continuent de la hanter en France, où elle vit depuis 1992 :
“Tout à coup nous vîmes partout des panaches de fumée qui montaient des pentes du mont Makwaza, de la vallée de la Rususa, où la mère de Ruvebana, Suzanne, qui était comme une grand-mère pour moi, avait une maison. Et puis nous avons entendu des bruits, des cris, un bourdonnement comme un essaim d'abeilles monstrueuses, un grognement emplissant l'air. J'entends encore ce grognement aujourd'hui, comme une menace gonflée derrière moi. Parfois j'entends ce grognement en France, dans la rue ; Je n'ose pas me retourner, je marche plus vite, n'est-ce pas ce même rugissement qui me suit toujours ?”
N'habitant plus au Rwanda en 1994, Mukasonga a échappé au génocide. dans laquelle trente-sept membres de sa famille ont péri, y compris ses parents, presque tous ses frères et sœurs et leurs nombreux descendants. Le livre leur est dédié ainsi qu'aux « quelques-uns qui ont le chagrin de survivre ». À la fin du livre, elle évoque certains de ceux qui ont miraculeusement échappé aux machettes, par pur hasard. Inyenzi ou les Cafards revient surtout sur les années de formation de l'auteur, à commencer par un exil forcé de sa ville natale, dans la province de Gikongoro près d'une forêt tropicale d'altitude, vers un lieu-dit Nyamata, dans une région insalubre, le Bugesera. « Pour chaque Rwandais », écrit Mukasonga, « il y avait quelque chose de sinistre dans ce nom. C'était une savane presque inhabitée, abritant de gros animaux sauvages, infestés de mouches tsé-tsé. Mukasonga décrit graphiquement la vie difficile là-bas, mais ce ne sera pas son dernier exil forcé, sans parler des évasions ultérieures, de l'autre côté de la frontière vers le Burundi, de la capture et de la mort imminente au Rwanda.
Dès le début de ce premier exil, la scolarisation pose problème. Mukasonga évoque les obstacles quasi insurmontables qui empêchent les enfants tutsis d'aller à l'école. Il n'y a en effet aucune école dans ce pays de brousse abandonné où les adultes doivent défricher, construire des huttes et creuser des latrines. Enfin, certains missionnaires installent des salles de classe sous les arbres. A douze ans, Mukasonga a accepté l'idée qu'elle sera toujours paysanne. « Dans mon pagne déchiré , se souvient-elle, un foulard crasseux noué autour de la tête, je binais la terre. Je ferais ça toute ma vie, en supposant que les Hutus me laissent vivre.” Puis la jeune fille remporte un « succès inespéré » au « fameux et redoutable examen national ». L'examen détermine les quelques privilégiés qui seront admis à l'école secondaire. "Le défi", écrit l'auteur, "était encore plus de taille pour les Tutsis, car les quotas ethniques mis en place par le régime hutu ne leur permettaient pas plus de dix pour cent des admissions". Mais la jeune fille réussit brillamment l'examen et est admise au Lycée Notre Dame de Cîteaux, le meilleur lycée du pays. C”est l'éducation qui va la sauver, tout comme son frère aîné André, qui devient médecin.
Mukasonga raconte les détails de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse dans une prose précise et convaincante qui met l'accent sur la souffrance des autres, tant dans sa famille que parmi ses voisins tutsis. C'est un récit poignant dans lequel l'écrivaine se concentre sur des faits révélateurs et relate des expériences personnelles instructives, tout en révélant sobrement ses propres émotions lorsque, par exemple, elle voit ses parents pour la dernière fois, en mai 1986, alors qu'elle est en voyage avec son mari français et leurs deux enfants. Elle possède désormais un passeport français. Une grande fête a lieu, mais le lendemain sa mère lui dit discrètement qu'il vaudrait mieux qu'ils partent. « Notre présence était une menace pour mes parents, précise-t-elle, et pour toute la famille. La dernière image de sa mère est une "forme légère" dans un pagne, "une petite silhouette qui disparaît au détour de la route."
Un livre important, très important. On en sait plus , grâce à Jean Hatzfeld, qui a écrit des livres essentiels sur le génocide de 1994, mais Mukasonga apporte un témoignage sur la vie au Rwanda, la haine envers les tutsis, les atrocités, les humiliations pendant les trois décennies qui ont précédé les crimes de 1994,
crimes commis sous les yeux des casques bleus, et des dirigeants humanistes des belles démocraties occidentales...
qui continuent de regarder...
Lien : http://holophernes.over-blog..
Dans ce recueil de nouvelles, Scholastique Mukasonga nous promène dans son passé de façon tendre et poétique telle une géographe et historienne d'un hier révolu.
On est le long de sa chère rivière Rukarara qui a bercé son enfance.
Elle évoque l'arbre sacré de Kivumu, personnage à part entière du peuple rwandais avant colonisation, au travers d'un conte que lui faisait sa mère. Ce qui donne aussi l'occasion d'illustrer l'endoctrinement religieux des missionnaires, la violence de ceux-ci.
Titicarabi, le chien faiseur de mirage, autre conte ancestrale, permet la réminiscence de sa scolarité insouciante, joyeuse, inscrite dans l'injustice des codes sociaux en vigueur à l'époque pour les Batwa et relate une école de la discrimination.
Son histoire familiale n'est pas en reste lorsqu'elle raconte le rôle de son grand-père qui fut l'hôte du dernier Mwami Musinga, donnant l'occasion de dresser la genèse de la destruction par les colons belges et l'implication de leurs missionnaires, de la structure sociale rwandaise.
Le malheur s'inscrit dans les croyances, la mort est un « tribut coutumier » que l'on paye au malheur.
Le Mungu, « bon » dieu des blancs se confronte aux multiples dieux des Rwandais, les Imana, parfois mauvais qu'il ne faut pas froisser. Certains Rwandais se convertissent par le Baptême.
Il y a également une approche du concept de l'amour entre deux être qui est quelques chose d'étranger sur les collines.
Un survol toujours agréable sous la plume de Scholastique Mukasonga de son beau pays tel qu'il a été et qu'elle l'a connu où plane l'effroyable désastre né à l'arrivé du blanc colonisateur sans que ce soit le sujet de ses nouvelles.
Et c'est ce qui m'a plu, pour avoir déjà beaucoup lu sur le génocide. Elle arrive à s'en détacher et à nous transmettre son bonheur perdu.
On est le long de sa chère rivière Rukarara qui a bercé son enfance.
Elle évoque l'arbre sacré de Kivumu, personnage à part entière du peuple rwandais avant colonisation, au travers d'un conte que lui faisait sa mère. Ce qui donne aussi l'occasion d'illustrer l'endoctrinement religieux des missionnaires, la violence de ceux-ci.
Titicarabi, le chien faiseur de mirage, autre conte ancestrale, permet la réminiscence de sa scolarité insouciante, joyeuse, inscrite dans l'injustice des codes sociaux en vigueur à l'époque pour les Batwa et relate une école de la discrimination.
Son histoire familiale n'est pas en reste lorsqu'elle raconte le rôle de son grand-père qui fut l'hôte du dernier Mwami Musinga, donnant l'occasion de dresser la genèse de la destruction par les colons belges et l'implication de leurs missionnaires, de la structure sociale rwandaise.
Le malheur s'inscrit dans les croyances, la mort est un « tribut coutumier » que l'on paye au malheur.
Le Mungu, « bon » dieu des blancs se confronte aux multiples dieux des Rwandais, les Imana, parfois mauvais qu'il ne faut pas froisser. Certains Rwandais se convertissent par le Baptême.
Il y a également une approche du concept de l'amour entre deux être qui est quelques chose d'étranger sur les collines.
Un survol toujours agréable sous la plume de Scholastique Mukasonga de son beau pays tel qu'il a été et qu'elle l'a connu où plane l'effroyable désastre né à l'arrivé du blanc colonisateur sans que ce soit le sujet de ses nouvelles.
Et c'est ce qui m'a plu, pour avoir déjà beaucoup lu sur le génocide. Elle arrive à s'en détacher et à nous transmettre son bonheur perdu.
Plongez au coeur du Rwanda avec Scholastique Mukasonga...
L'auteure nous narre l'histoire de Prisca, jeune écolière, qui se retrouve possédée par l'esprit d'une grande reine, Kitami. L'auteure nous envoûte à l'aide d'une ambiance mystique et sonore. Les scènes musicales sont décrites avec tant de vivacité qu'on a l'impression d'entendre au loin le battement des tambours.
Dès les premières lignes, on apprend que la chanteuse Kitami est morte. Le narrateur revient sur son succès, la formation de son groupe, les rumeurs qui courraient sur elle et son entourage. Puis, l'auteure donne la parole à Prisca qui nous narre son enfance au Rwanda, sa famille, ses études, sa possession jusqu'à son émancipation. Enfin, la troisième partie revient sur les circonstances de la mort de Kitami, soulevant de nombreuses interrogations.
L'intrigue est très bien ficelée, jusqu'à la fin on se demande ce qui a pu arriver à cette reine, à cette chanteuse aux multiples masques. On découvre comment certains tambours sont vénérés, idolâtrés dans certaines cultures. On danse, chante au côté de Kitami et de ces batteurs de tambours. On est impressionnée par le caractère de Prisca, jamais défaitiste, une vraie battante. Et on aperçoit les inégalités existantes entre les hutu et les tutsi à travers le parcours chaotique de Prisca pour parvenir à aller à l'université, on sent un grand Malheur qui se rapproche petit à petit.
Lien : https://www.labullederealita..
L'auteure nous narre l'histoire de Prisca, jeune écolière, qui se retrouve possédée par l'esprit d'une grande reine, Kitami. L'auteure nous envoûte à l'aide d'une ambiance mystique et sonore. Les scènes musicales sont décrites avec tant de vivacité qu'on a l'impression d'entendre au loin le battement des tambours.
Dès les premières lignes, on apprend que la chanteuse Kitami est morte. Le narrateur revient sur son succès, la formation de son groupe, les rumeurs qui courraient sur elle et son entourage. Puis, l'auteure donne la parole à Prisca qui nous narre son enfance au Rwanda, sa famille, ses études, sa possession jusqu'à son émancipation. Enfin, la troisième partie revient sur les circonstances de la mort de Kitami, soulevant de nombreuses interrogations.
L'intrigue est très bien ficelée, jusqu'à la fin on se demande ce qui a pu arriver à cette reine, à cette chanteuse aux multiples masques. On découvre comment certains tambours sont vénérés, idolâtrés dans certaines cultures. On danse, chante au côté de Kitami et de ces batteurs de tambours. On est impressionnée par le caractère de Prisca, jamais défaitiste, une vraie battante. Et on aperçoit les inégalités existantes entre les hutu et les tutsi à travers le parcours chaotique de Prisca pour parvenir à aller à l'université, on sent un grand Malheur qui se rapproche petit à petit.
Lien : https://www.labullederealita..
L'auteur rend hommage à sa mère, Stefania, une paysanne rwandaise à qui elle avait promis de recouvrir son corps d'un pagne à sa mort. Elle n'a pu le faire, sa mère étant victime du génocide tutsi en 1994 avec nombre de membres de sa famille. Elle lui dédie ce récit dans lequel elle conte son enfance.
Les massacres des Tutsi par les Hutu ne datent pas des années 1990. Dès l'indépendance, les Belges ont laissé aux commandes des Hutu. Les Tutsi de la famille de l'auteur ont été déplacés dans la région défavorisée et malsaine du Bugesera. en 1963, fuyant les massacres perpétrés plus au nord.
L'auteur décrit les traditions de la société rurale rwandaise que sa mère s'évertue à maintenir : la maison traditionnelle (inzu), les contes, le sorgho, les mariages, les contes, les femmes, gardiennes des traditions. Stefania ne vit que pour nourrir ses cinq enfants, les protéger des exactions, brimadesn, arrestations, saccages, viols...
Un témoignage terrible dans lequel l'humour n'est pas absent ( les mariages).
Il manque un lexique à la fin du livre qui reprendrait les nombreux termes traditionnels.
Les massacres des Tutsi par les Hutu ne datent pas des années 1990. Dès l'indépendance, les Belges ont laissé aux commandes des Hutu. Les Tutsi de la famille de l'auteur ont été déplacés dans la région défavorisée et malsaine du Bugesera. en 1963, fuyant les massacres perpétrés plus au nord.
L'auteur décrit les traditions de la société rurale rwandaise que sa mère s'évertue à maintenir : la maison traditionnelle (inzu), les contes, le sorgho, les mariages, les contes, les femmes, gardiennes des traditions. Stefania ne vit que pour nourrir ses cinq enfants, les protéger des exactions, brimadesn, arrestations, saccages, viols...
Un témoignage terrible dans lequel l'humour n'est pas absent ( les mariages).
Il manque un lexique à la fin du livre qui reprendrait les nombreux termes traditionnels.
Tout au long du livre je me suis demandé quelle est la part de souvenirs, quelle est la part de roman. Il me faudrait lire ses récits autobiographiques pour le savoir.
Dans les années 70 au-dessus des villes et villages de ce haut plateau, à 2493 m, près des sources du Nil, le lycée Notre Dame du Nil accueille les jeunes filles de l’élite. Enfin celle de la majorité, les Hutus, pour les Tutsies un quota de dix pour cent a été instauré. La plupart des professeurs et encadrants sont blancs.
Comme partout il y a des clans, des moqueries sauf que là il y a autre chose que les jalousies habituelles. Ce qui couve dans toute la société se répercute dans cette communauté assez fermée. Une des jeunes, fille de ministre, se fait porte-paroles du Parti, et prend au fil des jours de plus en plus de poids. Elle ne reculera devant aucun mensonge pour déchaîner les violences, avec plus ou moins la complicité des encadrants ou tout au moins leur aveuglement.
A quelque distance un ancien planteur de café essaie de prouver au monde que les Tutsis sont descendants des pharaons noirs. Il peint des fresques représentant ses fantasmes avec pour modèle une des jeunes Tutsies.
L’épisode du nez de la statue, fin puisqu'il s'agit d’une statue classique de la vierge repeinte en noir, et qui met en colère Gloriosa la meneuse parce qu’elle correspond aux traits tutsis me semble être une des clés de compréhension. Réputés ne pas avoir les traits négroïdes habituels, les Tutsis sont des étrangers.
Il semble que les colonisateurs belges aient beaucoup exacerbé des rivalités qui n’étaient peut être pas si grandes avant qu’il n'exige que la mention hutu, tutsi ou twa soit inscrite sur la carte d’identité. Et qu’il favorise l’un puis l’autre groupe. Mais je m'éloigne du roman.
Ce livre en appelle d'autres pour cerner ce moment de l'histoire du Rwanda.
Le génocide au Rwanda en 1994, nous en avons bien sûr entendu parler. Nous avons vu les images, malgré nous, avons entendu ces témoignages, ces cris d’appel à l’aide, de désespoir… Mais avant ? Qu’est-ce qui a pu mener à cette catastophe humaine ?
Voilà en somme ce que nous raconte ce roman. Situé temporairement entre la décolonisation du pays et le génocide, Notre-Dame du Nil nous dépeint une chronique de la vie dans un lycée de jeunes filles.
Le lycée Notre-Dame du Nil n’est pas n’importe quelle institution. Ici, y sont admises les jeunes filles de bonnes familles. Filles d’ambassadeur, de militaire, de ministre, elles sont promises à un bel avenir, pour autant qu’elles arrivent vierges au mariage, ou au moins qu’elles ne tombent pas enceinte avant. Mais aussi avec quelque chose dans le ciboulot, car le diplôme est une garantie non négligeable pour conclure un mariage avec les meilleurs partis. Et puis il y a ces filles qui sont là parce qu’il faut le « quotat tutsi ». Dans ce pays à très forte majorité hutu, le minimum de tutsi exigé par classe est de 10%. Et nul doute que ce minimum est très rarement dépassé.
Ainsi, Virginia et Veronica, les deux Tutsis de la dernière classe du lycée, vont cotoyer Modesta, Gloriosa ou encore Goretti. Et ce n’est pas tous les jours facile ! Car dès les début, on sent les premières tensions. Virginia et Veronica subissent le mépris et le sarcasme de leurs camarades, Gloriosa en tête, dont l’ambition et le désir de popularité n’ont d’égal que sa haine pour les Tutsis. A travers la vie de ces jeunes filles, nous assistons à la montée en puissance de cette haine entre les deux ethnies, jusqu’au point de non-retour. La politique du pays à rattrapé le lycée. Les étudiantes, bien qu’étant dans un lycée isolé, tenu par des religieuses blanches et des professeurs belges ou français, ne peuvent échapper à l’histoire de leur nation.
Alors on peut se demander si, justement, le lycée Notre-Dame du Nil n’est-il pas un symbole d’une nation qui prône la supériorité du « peuple majoritaire » ? Ces jeunes femmes ne sont-elles pas en quelque sorte des esprits préfabriqués, destinées à pérenniser d’un côté ce sentiment de supériorité, de l’autre côté la soumission ?
Notre-Dame du Nil est un roman fort, et s’il s’agit d’une fiction le lien avec l’Histoire ne fait aucun doute. On peut d’ailleurs clairement voir apparaître la part de l’auteure, d’origine Tutsi dans ce récit. Car oui, dans cette histoire, Les Tutsis sembent innofensives et innocentes, tandis que les hutus sont de viles filles pétries de haine et responsables de toutes les horreurs. Bien sûr que dans la réalité il en va autrement… Je doute personnellement que les Tutsis aient toujours eu le beau rôle, et que les Hutus soient les seuls responsables de ces événements tragiques. Mais peut-on reprocher à quelqu’un qui a perdu une vingtaine de personnes de sa propre famille dans un massacre de ne pas partager cette opinion ?
Notre-Dame du Nil est un très beau roman, sur un sujet hélas toujours d’actualité au Rwanda, où les tensions entre les deux ethnies sont encore très présentes.
Lien : http://voyageauboutdelapage...
Voilà en somme ce que nous raconte ce roman. Situé temporairement entre la décolonisation du pays et le génocide, Notre-Dame du Nil nous dépeint une chronique de la vie dans un lycée de jeunes filles.
Le lycée Notre-Dame du Nil n’est pas n’importe quelle institution. Ici, y sont admises les jeunes filles de bonnes familles. Filles d’ambassadeur, de militaire, de ministre, elles sont promises à un bel avenir, pour autant qu’elles arrivent vierges au mariage, ou au moins qu’elles ne tombent pas enceinte avant. Mais aussi avec quelque chose dans le ciboulot, car le diplôme est une garantie non négligeable pour conclure un mariage avec les meilleurs partis. Et puis il y a ces filles qui sont là parce qu’il faut le « quotat tutsi ». Dans ce pays à très forte majorité hutu, le minimum de tutsi exigé par classe est de 10%. Et nul doute que ce minimum est très rarement dépassé.
Ainsi, Virginia et Veronica, les deux Tutsis de la dernière classe du lycée, vont cotoyer Modesta, Gloriosa ou encore Goretti. Et ce n’est pas tous les jours facile ! Car dès les début, on sent les premières tensions. Virginia et Veronica subissent le mépris et le sarcasme de leurs camarades, Gloriosa en tête, dont l’ambition et le désir de popularité n’ont d’égal que sa haine pour les Tutsis. A travers la vie de ces jeunes filles, nous assistons à la montée en puissance de cette haine entre les deux ethnies, jusqu’au point de non-retour. La politique du pays à rattrapé le lycée. Les étudiantes, bien qu’étant dans un lycée isolé, tenu par des religieuses blanches et des professeurs belges ou français, ne peuvent échapper à l’histoire de leur nation.
Alors on peut se demander si, justement, le lycée Notre-Dame du Nil n’est-il pas un symbole d’une nation qui prône la supériorité du « peuple majoritaire » ? Ces jeunes femmes ne sont-elles pas en quelque sorte des esprits préfabriqués, destinées à pérenniser d’un côté ce sentiment de supériorité, de l’autre côté la soumission ?
Notre-Dame du Nil est un roman fort, et s’il s’agit d’une fiction le lien avec l’Histoire ne fait aucun doute. On peut d’ailleurs clairement voir apparaître la part de l’auteure, d’origine Tutsi dans ce récit. Car oui, dans cette histoire, Les Tutsis sembent innofensives et innocentes, tandis que les hutus sont de viles filles pétries de haine et responsables de toutes les horreurs. Bien sûr que dans la réalité il en va autrement… Je doute personnellement que les Tutsis aient toujours eu le beau rôle, et que les Hutus soient les seuls responsables de ces événements tragiques. Mais peut-on reprocher à quelqu’un qui a perdu une vingtaine de personnes de sa propre famille dans un massacre de ne pas partager cette opinion ?
Notre-Dame du Nil est un très beau roman, sur un sujet hélas toujours d’actualité au Rwanda, où les tensions entre les deux ethnies sont encore très présentes.
Lien : http://voyageauboutdelapage...
Ce roman m'a attirée parce qu'il se passe au Rwanda et qu'il se focalise sur les filles. Du Rwanda, je n'ai lu que les essais de Jean Hatzfled et je les avais trouvés si forts que j'avais un peu peur que la fiction ne me semble pas à la hauteur. Si je garde ma préférence pour les essais d'Hatzfeld, je trouve tout de même le roman de Scholastique Mukangosa très attachant et je regrette qu'il n'ait pas figuré sur la liste du Goncourt car il aurait sans doute beaucoup plu à mes élèves qui participaient avec moi au prix Goncourt des lycéens. On y retrouve les problèmes de toutes les filles, on y sourit en découvrant que les élèves sont récompensées par des images de Nana Mouskouri et Brigitte Bardot (mais celles de Brigitte Bardot sont confisquées par le prêtre qui les gardent pour lui). On est dépaysée et pourtant, on retrouve des caractéristiques propres à toutes l'humanité, les personnages sont à la fois rwandais et universels. Et la tension monte lentement, jusqu'à atteindre l'horreur et l'on voit que les filles ne sont exemptes ni de soif de pouvoir, ni de violence.
Lien : http://vallit.canalblog.com/..
Lien : http://vallit.canalblog.com/..
Vingt-sept membres de la famille de l'écrivaine ont été massacrés pendant le génocide rwandais. Stefania, sa mère tutsie, était des victimes et ce livre rend un hommage magnifique à cette femme africaine contrainte à l'exil avec sa famille à Nyamata, sous la perpétuelle menace des soldats hutus du camp Gako. Nous sommes dans la région inhospitalière du Bugesera, là où sont déportés les tutsis du nord depuis les massacres ethniques qui les ravagèrent en vagues successives depuis 1959.
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu’il avait droit au premier des droits de l’homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu’il avait droit au premier des droits de l’homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
Notre Dame du Nil est un pensionnat "modèle" pour jeunes filles de bonne famille rwandaise, en l’occurrence de l'ethnie Hutu, celle au pouvoir et pour faire bonne figure avec son quota de Tutsis considérées comme des parasites.
Ce lycée, censé formé l'élite féminine de demain est surtout un établissement suffisamment éloigné pour tenter de préserver la virginité des demoiselles avant le mariage.
Ce microcosme reproduit la société rwandaise avec ,d'une part, ses différentes ethnies et les querelles ancestrales reproduisant les violences que connait de façon chronique le pays, la rigidité des religieuses et l’ambiguïté du prêtre plus occupé à regarder les jolies filles qu'à donner un vrai sens à une foi importée lors de la colonisation du Rwanda, les jeunes enseignants arrivés de Belgique ou de France, un peu perdus dans cette fournaise et d'autre part les reliquats nostalgiques de l'ancienne colonie belge.
Se détache de tout ce petit monde , Monsieur de Fontenaille, qui apporte une touche originale, voire exotique, avec son obsession de l'histoire ancienne des Tutsis et de leur mémoire oubliée et qui dans sa folie entrainera à sa perte sa déesse réincarnée.
Bien sûr, il est difficile de ne pas prendre le parti des opprimés, mais ce livre ayant été écrit par une Tutsi rescapée des génocides, peut-être n'avons nous pas une vision totalement objective.
Cela reste cependant un livre intéressant, de lecture aisée avec une langue agréable et qui m'a plu.
Ce lycée, censé formé l'élite féminine de demain est surtout un établissement suffisamment éloigné pour tenter de préserver la virginité des demoiselles avant le mariage.
Ce microcosme reproduit la société rwandaise avec ,d'une part, ses différentes ethnies et les querelles ancestrales reproduisant les violences que connait de façon chronique le pays, la rigidité des religieuses et l’ambiguïté du prêtre plus occupé à regarder les jolies filles qu'à donner un vrai sens à une foi importée lors de la colonisation du Rwanda, les jeunes enseignants arrivés de Belgique ou de France, un peu perdus dans cette fournaise et d'autre part les reliquats nostalgiques de l'ancienne colonie belge.
Se détache de tout ce petit monde , Monsieur de Fontenaille, qui apporte une touche originale, voire exotique, avec son obsession de l'histoire ancienne des Tutsis et de leur mémoire oubliée et qui dans sa folie entrainera à sa perte sa déesse réincarnée.
Bien sûr, il est difficile de ne pas prendre le parti des opprimés, mais ce livre ayant été écrit par une Tutsi rescapée des génocides, peut-être n'avons nous pas une vision totalement objective.
Cela reste cependant un livre intéressant, de lecture aisée avec une langue agréable et qui m'a plu.
Petites misères des pensionnaires!
Dans un Rwanda à l'atmosphère gangrénée par les luttes inter-ethniques Tutsi-Hutu, un lycée catholique regroupe en microcosme les élèves "méritantes", protégées, éduquées pour leur destin d'épouse, destinées à devenir l'élite féminine de leur pays. Elles représentent avant tout des marchandises négociables pour leur famille.
Jalousies entre pensionnaires, manipulations et dominations, pouvoir, concupiscence et scandales dessinent le tableau des petites perversions ordinaires. L'établissement reproduit à l'échelle la situation politique du pays.
Le ton est direct, non dépourvu d'humour et de légère ironie.
Je suis entrée dans ce livre un peu à reculons, n'aimant pas en général cette Afrique si rude, violente, clanique, aux croyances pagano-catholiques. Quand, par les élucubrations de vieux chaman, les mondes des esprits et des vivants se mêlent, je sens poindre mon ennui. J'ai donc tourné quelques pages un peu vite...
Je concède tout de même quelques beaux portraits de femmes, et la force du témoignage, par la description de l'intérieur d'une société irréconciliable, une vision noire et sans grand espoir, sur fond d'épuration ethnique larvée.
Dans un Rwanda à l'atmosphère gangrénée par les luttes inter-ethniques Tutsi-Hutu, un lycée catholique regroupe en microcosme les élèves "méritantes", protégées, éduquées pour leur destin d'épouse, destinées à devenir l'élite féminine de leur pays. Elles représentent avant tout des marchandises négociables pour leur famille.
Jalousies entre pensionnaires, manipulations et dominations, pouvoir, concupiscence et scandales dessinent le tableau des petites perversions ordinaires. L'établissement reproduit à l'échelle la situation politique du pays.
Le ton est direct, non dépourvu d'humour et de légère ironie.
Je suis entrée dans ce livre un peu à reculons, n'aimant pas en général cette Afrique si rude, violente, clanique, aux croyances pagano-catholiques. Quand, par les élucubrations de vieux chaman, les mondes des esprits et des vivants se mêlent, je sens poindre mon ennui. J'ai donc tourné quelques pages un peu vite...
Je concède tout de même quelques beaux portraits de femmes, et la force du témoignage, par la description de l'intérieur d'une société irréconciliable, une vision noire et sans grand espoir, sur fond d'épuration ethnique larvée.
J'ai lu ce livre dans le cadre de la Lecture commune de février 2012 sur Babelio.
Malgré le prix Renaudot 2012 que Notre-Dame du Nil a reçu, je n'ai pas été emballé par l'histoire...
Le récit est intéressant, j'y ai appris pleins de termes nouveaux, que je n'entendrais probablement plus jamais, mais qu'importe, maintenant, je les connais. La découverte de peuples différents est quelque peu inimaginable pour nous, européens, et très plaisant. On y apprend leurs conditions de vie, leurs religions, leurs habitudes... j'ai été plongé au coeur de ce lycée pour filles du Rwanda, emportée avec elles dans les aventures exceptionnelles qu'elles vont vivre.
Notre-Dame du Nil m'a certes intéressé, mais je n'ai pas eu cette envie de découvrir rapidement la suite de l'histoire...
J'ai quand même trouvé le récit un peu long... je m'ennuyais pendant certains passages, je lisais sans vraiment lire, je perdais le cours de ma lecture. Je ne suis pas réellement entré dans l'histoire, tous les peuples se mélangeaient dans ma tête, les noms des filles également, mais c'est surtout le côté politique qui m'a dérangé... je n'ai pas tout compris au roman, et je trouvais l'histoire un peu brouillon. De plus, je n'ai ressenti aucune émotions à lire ce roman : les personnages ne m'ont pas touchés, leurs histoires non plus... ce sont juste leurs conditions de vie qui m'ont émues, que je trouve horribles, monstrueuses, même.
Notre-Dame du Nil m'a néanmoins permis de découvrir un autre univers, car l'Histoire africaine m'était encore inconnue à ce jour.
Lien : http://addictbooks.skyrock.c..
Malgré le prix Renaudot 2012 que Notre-Dame du Nil a reçu, je n'ai pas été emballé par l'histoire...
Le récit est intéressant, j'y ai appris pleins de termes nouveaux, que je n'entendrais probablement plus jamais, mais qu'importe, maintenant, je les connais. La découverte de peuples différents est quelque peu inimaginable pour nous, européens, et très plaisant. On y apprend leurs conditions de vie, leurs religions, leurs habitudes... j'ai été plongé au coeur de ce lycée pour filles du Rwanda, emportée avec elles dans les aventures exceptionnelles qu'elles vont vivre.
Notre-Dame du Nil m'a certes intéressé, mais je n'ai pas eu cette envie de découvrir rapidement la suite de l'histoire...
J'ai quand même trouvé le récit un peu long... je m'ennuyais pendant certains passages, je lisais sans vraiment lire, je perdais le cours de ma lecture. Je ne suis pas réellement entré dans l'histoire, tous les peuples se mélangeaient dans ma tête, les noms des filles également, mais c'est surtout le côté politique qui m'a dérangé... je n'ai pas tout compris au roman, et je trouvais l'histoire un peu brouillon. De plus, je n'ai ressenti aucune émotions à lire ce roman : les personnages ne m'ont pas touchés, leurs histoires non plus... ce sont juste leurs conditions de vie qui m'ont émues, que je trouve horribles, monstrueuses, même.
Notre-Dame du Nil m'a néanmoins permis de découvrir un autre univers, car l'Histoire africaine m'était encore inconnue à ce jour.
Lien : http://addictbooks.skyrock.c..
L'on retrouve dès les premières pages cette ambiance créée par ce protectorat si particulier qui ne pouvait que marquer profondément l'histoire du Rwanda et, qui sait l'a peut-être conduit à ces troubles si dramatiques étalés sur plusieurs générations en espérant que leurs pratiques de tribunaux populaires les aident à surpasser cette si sombre et lamentable période qui a décimé tant de rwandais face à une grande paralysie internationale.
Ce sens de la hiérarchie, ce respect des religieux, puis cette haine fabriquée contre ceux qui sont vos voisins, vos interlocuteurs habituels et qui les désarçonne, c'est une ambiance cynique, terriblement meurtrière laisse des traces dont on se relève mal, un livre à lire, oui, certainement.
Ce sens de la hiérarchie, ce respect des religieux, puis cette haine fabriquée contre ceux qui sont vos voisins, vos interlocuteurs habituels et qui les désarçonne, c'est une ambiance cynique, terriblement meurtrière laisse des traces dont on se relève mal, un livre à lire, oui, certainement.
"Le Rwanda est un pays de mort"
Au lycée Notre dame du Nil viennent s'extérioriser tous les conflits concentrés dans ce petit pays. Religions, croyances traditionnelles, Hutu, Tutsi, Français, Belges, confiances, trahisons, mensonges et vérités. Ici se résument les aspects les plus sombres de la société rwandaise.
Ce livre m'avait été recommandé par une lectrice Babelio, alors que nous discutions de "Petit Pays" de Gaël Faye, livre qui m'avait coupé le souffle.
Notre dame du Nil nous plonge dans un bain anthropologique, sociétal, politique et culturel.
Au lycée Notre dame du Nil viennent s'extérioriser tous les conflits concentrés dans ce petit pays. Religions, croyances traditionnelles, Hutu, Tutsi, Français, Belges, confiances, trahisons, mensonges et vérités. Ici se résument les aspects les plus sombres de la société rwandaise.
Ce livre m'avait été recommandé par une lectrice Babelio, alors que nous discutions de "Petit Pays" de Gaël Faye, livre qui m'avait coupé le souffle.
Notre dame du Nil nous plonge dans un bain anthropologique, sociétal, politique et culturel.
Une année au lycée rwandais Notre-Dame du Nil pour jeunes filles de bonne famille, les sœurs qui le dirigent, les professeurs européens, les scènes quotidiennes ou plus exceptionnelles, mais année brouillée par l’arrivée des violences entre Hutus et Tutsis. Une plongée également dans certaines coutumes, mythes ou croyances. Un roman inégal, longtemps anecdotique, voire joyeux, avant d’arriver au cœur du sujet. Un récit au final pas entièrement convaincant malgré la gravité des événements.
Roman autobiographique de l'enfance à l'âge adulte d'une jeune Rwandaise. D'avant le massacre au retour après le génocide alors que toute sa famille a été exterminée.
Elle, elle s'en sortira car son père lui a imposé d'obtenir un diplôme, n'importe lequel ; c'était selon lui le Graal pour s'en sortir.
Elle veut donc devenir assistante sociale ; nous la suivons de l'enfance, au Burundi en exil dans l'école pour décrocher le fameux diplôme, puis ensuite sa vie de jeune fille, de femme, son arrivée en France, son retour au Rwanda.
C'est un roman émouvant mais aussi drôle parfois. La narratrice ne se ménage pas, décrit les hommes qu'elles a croisé, les jalousies, les freins qu'elle a surmontés, les joies, les déceptions et la tristesse qui ont parsemé son chemin.
Un roman vraiment intéressant à lire même si j'ai trouvé que son arrivée en France était trop peu développée.
Elle, elle s'en sortira car son père lui a imposé d'obtenir un diplôme, n'importe lequel ; c'était selon lui le Graal pour s'en sortir.
Elle veut donc devenir assistante sociale ; nous la suivons de l'enfance, au Burundi en exil dans l'école pour décrocher le fameux diplôme, puis ensuite sa vie de jeune fille, de femme, son arrivée en France, son retour au Rwanda.
C'est un roman émouvant mais aussi drôle parfois. La narratrice ne se ménage pas, décrit les hommes qu'elles a croisé, les jalousies, les freins qu'elle a surmontés, les joies, les déceptions et la tristesse qui ont parsemé son chemin.
Un roman vraiment intéressant à lire même si j'ai trouvé que son arrivée en France était trop peu développée.
Trois contes composent ce recueil : le bois de la croix, La vache du roi Musinga et Un pygmée à l'école.
Trois contes présentés comme souvenirs par l'auteur. le sont-ils réellement ? Je ne sais pas.
Dans le premier une femme venue vivre en Europe, porte sous sa robe autour de la taille un morceau de bois. Elle nous raconte l'histoire de l'arbre d'où vient ce morceau de bois, histoire différente selon qu'elle est raconté par les gens du crû ou par les missionnaires.
Dans la seconde il est encore questions de l'intervention des Blancs dans l'histoire du Ruanda et de l a déposition du roi Musinga.
La troisième expose comment un pygmée particulièrement intelligent et que les missionnaires ont essayé d'intégrer dans une école a été ostracisé par les villageois.
J'ai surtout apprécié la troisième, plus facile à appréhender, mais les trois ont un certain charme.
Challenge ABC 2019-2020
Trois contes présentés comme souvenirs par l'auteur. le sont-ils réellement ? Je ne sais pas.
Dans le premier une femme venue vivre en Europe, porte sous sa robe autour de la taille un morceau de bois. Elle nous raconte l'histoire de l'arbre d'où vient ce morceau de bois, histoire différente selon qu'elle est raconté par les gens du crû ou par les missionnaires.
Dans la seconde il est encore questions de l'intervention des Blancs dans l'histoire du Ruanda et de l a déposition du roi Musinga.
La troisième expose comment un pygmée particulièrement intelligent et que les missionnaires ont essayé d'intégrer dans une école a été ostracisé par les villageois.
J'ai surtout apprécié la troisième, plus facile à appréhender, mais les trois ont un certain charme.
Challenge ABC 2019-2020
Excellent roman, basé sur des faits hélas tristement réels: le massacre des Tutsis et les horreurs qui se sont déroulées au Rwanda dans les années 90.
Le roman prend la base d'un huis-clos brillant dans un lycée très chic tenu par des religieuses, juste à côté des sources du Nil. Ici, filles de banquiers,de ministres, de généraux, reçoivent la meilleure éducation possible en attendant d'être mariées pour l'intérêt de leurs clans...et ici aussi, les quotas ethniques assurent qu'on ne peut refuser quelques Tutsis, faisant participer les lieux à la tension qui monte dans le pays.
C'est un livre facile d'accès, même si vos connaissances sur le sujet sont des plus floues: j'avoue une ou deux virées sur Wikipedia en cours de route, et c'est un livre qui donne aussi l'envie d'en savoir plus; bien plus, sur cette région du monde et ses secrets, les plus terribles comme les plus beaux.
Le roman prend la base d'un huis-clos brillant dans un lycée très chic tenu par des religieuses, juste à côté des sources du Nil. Ici, filles de banquiers,de ministres, de généraux, reçoivent la meilleure éducation possible en attendant d'être mariées pour l'intérêt de leurs clans...et ici aussi, les quotas ethniques assurent qu'on ne peut refuser quelques Tutsis, faisant participer les lieux à la tension qui monte dans le pays.
C'est un livre facile d'accès, même si vos connaissances sur le sujet sont des plus floues: j'avoue une ou deux virées sur Wikipedia en cours de route, et c'est un livre qui donne aussi l'envie d'en savoir plus; bien plus, sur cette région du monde et ses secrets, les plus terribles comme les plus beaux.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Scholastique Mukasonga
Lecteurs de Scholastique Mukasonga (1437)Voir plus
Quiz
Voir plus
La pluie comme on l'aime
Quel auteur attend "La pluie avant qu'elle tombe"?
Olivier Norek
Jonathan Coe
10 questions
203 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur203 lecteurs ont répondu