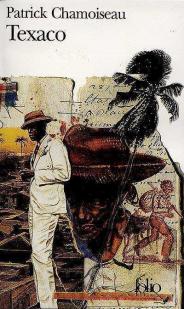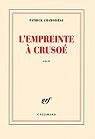Marie-Sophie Laborieux est la mémoire vivante, le point focal de Texaco. le quartier, tenant son nom du complexe pétrolifère niché dans la mangrove et qu'il surplombe en partie, est une sorte d'excroissance de "l'En-ville", Fort-de-France. Ensemble hétéroclite d'habitations faites de bric et de broc, il s'est développé, tel un madrépore, sous le regard hostile du béké propriétaire du terrain, qui n'a eu de cesse d'aller quérir les "céhêresses" pour mettre un terme à cette violation patente du droit de propriété. Aussitôt démantelé, aussitôt reconstruit. Sous l'impulsion de la câpresse - qui en a vu d'autres, et avec l'aide providentielle du maire charismatique et populaire Aimé Césaire, le quartier, phénix renaissant de ses cendres ou chancre incurable selon que vous en soyez l'habitant ou un représentant de la loi et des possédants, demeure, insubmersible.
Scandé par des extraits apocryphes des Cahiers de Marie-Sophie Laborieux ainsi que de Notes de l'urbaniste au Marqueur de paroles, traduisant la mise en abîme du récit et la valeur mémorielle et orale d'un patrimoine immatériel de la créolité, Texaco retrace les tribulations d'une famille depuis le XIXème siècle, chassée De Saint-Pierre par l'irruption de la montagne Pelée, ballottée par les remous de l'histoire, jusqu'à son installation dans le bidonville aux marges de la capitale martiniquaise. A travers cette famille, c'est la destinée du peuple antillais, son émancipation progressive de l'idéologie colonisatrice dominante de la France de la métropole qui est retracée. L'argument du roman tiens sa force dans le partit pris formel de l'auteur, dont la langue est un mélange savoureux de français et de créole. Très franchement, on ne comprend pas tout, à moins d'avoir recours continuellement aux moteurs de recherche, au risque de nuire au rythme du récit, pas spécialement ébouriffant en lui-même. En l'absence de notes de bas de page, qu'on aurait fort apprécié, le texte étant loin d'être dénué de qualités littéraires, on se laisse porter par la puissance évocatrice des vocables inusités du récit, ce qui crée un certain flou poétique que certains apprécieront ; je n'en suis pas. L'ensemble, assez inégal, requiert une lecture soutenue, sous peine de se perdre quelque peu dans cette masse narrative.
Scandé par des extraits apocryphes des Cahiers de Marie-Sophie Laborieux ainsi que de Notes de l'urbaniste au Marqueur de paroles, traduisant la mise en abîme du récit et la valeur mémorielle et orale d'un patrimoine immatériel de la créolité, Texaco retrace les tribulations d'une famille depuis le XIXème siècle, chassée De Saint-Pierre par l'irruption de la montagne Pelée, ballottée par les remous de l'histoire, jusqu'à son installation dans le bidonville aux marges de la capitale martiniquaise. A travers cette famille, c'est la destinée du peuple antillais, son émancipation progressive de l'idéologie colonisatrice dominante de la France de la métropole qui est retracée. L'argument du roman tiens sa force dans le partit pris formel de l'auteur, dont la langue est un mélange savoureux de français et de créole. Très franchement, on ne comprend pas tout, à moins d'avoir recours continuellement aux moteurs de recherche, au risque de nuire au rythme du récit, pas spécialement ébouriffant en lui-même. En l'absence de notes de bas de page, qu'on aurait fort apprécié, le texte étant loin d'être dénué de qualités littéraires, on se laisse porter par la puissance évocatrice des vocables inusités du récit, ce qui crée un certain flou poétique que certains apprécieront ; je n'en suis pas. L'ensemble, assez inégal, requiert une lecture soutenue, sous peine de se perdre quelque peu dans cette masse narrative.
TEXACO raconte la grande aventure du peuple antillais. " L'oiseau Cham " le " marqueur de paroles " recueillent les confidences d'une vieille femme, qui lui raconte cent cinquante ans de l'histoire de l'île. Depuis les chaînes des navires négriers, la vie dans les plantations esclavagistes jusqu'aux difficultés de vivre dans les quartiers périphériques de Fort de France dans la Martinique contemporaine, il nous fait partager les souffrances, les luttes, ainsi que les réussites, les joies, de ces habitants issus d'une d'une multitude de cultures. La langue, mélange de beau français et de créole, est magnifique, riche, imagée, à la fois grave et pleine d'humour. Deux, trois mots suffisent parfois pour décrire un personnage. (exemple : le chanteur des rues qui subtilise, Ninon, la compagne d'Esternome devient quelques pages plus loin " le chien à sérénades "). Les descriptions de la vie quotidienne, tant au 19 ème siècle qu'au 20 ème sont enivrantes de mouvements, de sons, de couleurs, de parfums. Ce roman décrit formidablement le vent de liberté qui a soufflé sur ces territoires, il montre aussi les inquiétudes, les incertitudes, le bonheur, mais également les déceptions, les bouleversements, qui ont émaillés la période de l'abolition. Il contient les éléments qui permettent de décoder, en partie, les événements qui ont secoué les Antilles en 2009. Les prix littéraires sont souvent décriés. En 1992, les jurés Goncourt ont récompensé un grand roman.
Texaco est un bidonville de Fort-de-France en Martinique. L'auteur, Patrick CHAMOISEAU, est lui-même natif de Fort-de-France où il est né en 1953. Pas étonnant alors que son livre respire le vrai et la complexité des espoirs et déchirements d'un peuple qui lentement a su créé sa place juste à côté de l'En-ville et y défendre son histoire, ses valeurs, sa dignité. Parallèlement à la construction et l'évolution de ce bidonville, Patrick CHAMOISEAU nous relate l'histoire du peuple martiniquais qui se redresse, grandit en dignité et sort de l'esclavage et de l'inexistence sociale que l'administration leur a trop longtemps concédés bien malgré eux.
Les propos de Marie-Sophie Laborieux sont le fil conducteur choisi par l'auteur. Cette femme fut la première à poser une cabane dans ce quartier et, à ce titre, elle a incarné la mémoire des habitants et des valeurs et principes qui président à l'organisation de la vie à Texaco.
Le ton du récit est donné d'entrée de jeu. le mélange d'un français parfaitement maîtrisé et d'expressions créoles hautes et chaudes en couleurs rend ce texte savoureux mais parfois difficile à lire.
En 1992, Patrick CHAMOISEAU a obtenu le Prix Goncourt pour ce livre qui est une vraie tranche d'histoire. Et il ne fait pas de doute qu'il peut nous dire 'quelque chose' à propos des peuples et des 'camps' qui, aujourd'hui, font l'objet de projets de destructions totales dans notre vieille Europe! Malheureusement, la sortie de l'esclavage et la construction d'un lieu à vivre restent des thèmes d'actualité.
Les propos de Marie-Sophie Laborieux sont le fil conducteur choisi par l'auteur. Cette femme fut la première à poser une cabane dans ce quartier et, à ce titre, elle a incarné la mémoire des habitants et des valeurs et principes qui président à l'organisation de la vie à Texaco.
Le ton du récit est donné d'entrée de jeu. le mélange d'un français parfaitement maîtrisé et d'expressions créoles hautes et chaudes en couleurs rend ce texte savoureux mais parfois difficile à lire.
En 1992, Patrick CHAMOISEAU a obtenu le Prix Goncourt pour ce livre qui est une vraie tranche d'histoire. Et il ne fait pas de doute qu'il peut nous dire 'quelque chose' à propos des peuples et des 'camps' qui, aujourd'hui, font l'objet de projets de destructions totales dans notre vieille Europe! Malheureusement, la sortie de l'esclavage et la construction d'un lieu à vivre restent des thèmes d'actualité.
Rare, une écriture et une histoire qui me touchent. Quels types de fée ou magicien se sont penchés sur lle berceau du bébé Chamoiseau pour avoir un tel don de conteur du merveilleux ?
L'essence de l'âme antillaise
Une partie de l'Histoire de la Martinique nous est contée dans une langue savoureuse panachée ici et là de phrases créoles ….avec traduction instantanée, je vous rassure.
C'est d'abord à travers le vécu d' 'Esternome Laborieux et d'Idoménée Carmélite Lapidaille – le papa et la « manman » de Marie-Sophie Laborieux, l'héroïne du roman – que l'on suit l'évolution de ce TOM français. À l'époque de leur naissance, les toits des cases des plus démunis sont encore constitués de paille de canne à sucre. Mais même les structures plus dures ne résisteront pas à l'éruption de la montagne pelée faisant 30.000 morts dont Ninon, le grand amour d' « Esternome mon papa » comme l'appelle affectueusement Marie-So. En ce temps-là, l'esclavage a beau avoir été aboli, les anciens esclaves forment une sorte de caste reconnaissable à la couleur de leur peau et qui continue à être exploitée par les Békés – les Créoles d'origine européenne. À chaque velléité de protestation contre les conditions de travail, des Koulis indiens sont engagés en remplacement des travailleurs contestataires.
Tout en accumulant les « djobs » chez les « Milâtres » et les « Blancs-France » de l' « En-ville » où en tant que toute jeune fille elle est rarement respectée avec tous les abus que cela sous-entend, Marie-So va peu à peu prendre de l'envergure au sein de la communauté noire, jusqu'à en devenir l'âme. C'est ainsi qu'elle fondera un nouveau quartier à l'ombre d'une usine Texaco pour que ses semblables et elle-même n'aient pas à vivre dans ces « casiers d'achélème » qui paraissent leur avoir été destinés. Mais la lutte est âpre contre les Békés qui ne veulent pas de ce quartier dérangeant, l'évacuent plusieurs fois, sans toutefois réussir à le raser complètement, ce qui était pourtant le projet initial du « Christ », l'urbaniste chargé de mettre de l'ordre dans l'aménagement de ce faubourg naissant de Fort-de-France.
Elle compte bien profiter d'une visite du Général de Gaulle pour le sensibiliser à la cause de sa communauté. Hélas, le protocole et son rang l'empêchent d'approcher le chef d'Etat ; pire elle ne peut percevoir que des bribes de discours parmi lesquels l'exclamation suivante « Mon Dieu, mon Dieu, que vous êtes Français ! ». Encore que dans le brouhaha, d'autres ont cru comprendre « Mon Dieu, mon Dieu, comme vous êtes foncés !».
Bref, le combat continuera sans l'aide des décideurs de la Métropole pour que Marie-So et sa communauté puissent poursuivre leur « benzine de vie » à Texaco, qu'ils considèrent désormais comme leur patrie. Mais ne devrait-on pas plutôt dire « matrie », vu le genre de la fondatrice ?
Une partie de l'Histoire de la Martinique nous est contée dans une langue savoureuse panachée ici et là de phrases créoles ….avec traduction instantanée, je vous rassure.
C'est d'abord à travers le vécu d' 'Esternome Laborieux et d'Idoménée Carmélite Lapidaille – le papa et la « manman » de Marie-Sophie Laborieux, l'héroïne du roman – que l'on suit l'évolution de ce TOM français. À l'époque de leur naissance, les toits des cases des plus démunis sont encore constitués de paille de canne à sucre. Mais même les structures plus dures ne résisteront pas à l'éruption de la montagne pelée faisant 30.000 morts dont Ninon, le grand amour d' « Esternome mon papa » comme l'appelle affectueusement Marie-So. En ce temps-là, l'esclavage a beau avoir été aboli, les anciens esclaves forment une sorte de caste reconnaissable à la couleur de leur peau et qui continue à être exploitée par les Békés – les Créoles d'origine européenne. À chaque velléité de protestation contre les conditions de travail, des Koulis indiens sont engagés en remplacement des travailleurs contestataires.
Tout en accumulant les « djobs » chez les « Milâtres » et les « Blancs-France » de l' « En-ville » où en tant que toute jeune fille elle est rarement respectée avec tous les abus que cela sous-entend, Marie-So va peu à peu prendre de l'envergure au sein de la communauté noire, jusqu'à en devenir l'âme. C'est ainsi qu'elle fondera un nouveau quartier à l'ombre d'une usine Texaco pour que ses semblables et elle-même n'aient pas à vivre dans ces « casiers d'achélème » qui paraissent leur avoir été destinés. Mais la lutte est âpre contre les Békés qui ne veulent pas de ce quartier dérangeant, l'évacuent plusieurs fois, sans toutefois réussir à le raser complètement, ce qui était pourtant le projet initial du « Christ », l'urbaniste chargé de mettre de l'ordre dans l'aménagement de ce faubourg naissant de Fort-de-France.
Elle compte bien profiter d'une visite du Général de Gaulle pour le sensibiliser à la cause de sa communauté. Hélas, le protocole et son rang l'empêchent d'approcher le chef d'Etat ; pire elle ne peut percevoir que des bribes de discours parmi lesquels l'exclamation suivante « Mon Dieu, mon Dieu, que vous êtes Français ! ». Encore que dans le brouhaha, d'autres ont cru comprendre « Mon Dieu, mon Dieu, comme vous êtes foncés !».
Bref, le combat continuera sans l'aide des décideurs de la Métropole pour que Marie-So et sa communauté puissent poursuivre leur « benzine de vie » à Texaco, qu'ils considèrent désormais comme leur patrie. Mais ne devrait-on pas plutôt dire « matrie », vu le genre de la fondatrice ?
Je n'ai pas vraiment accroché à l'histoire que nous présente Patrick Chamoiseau mais j'ai encore moins aimé son style d'écriture, pas de la tarte quand le roman fait cinq cent pages...
J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le roman avec cette écriture décousue et l'hétérolinguisme. Des mots, voire des phrases entières ne sont pas traduites et certains mots en français mal orthographiés, l'effet d'écriture est unique mais pas à mon goût. Ca ralentissait excessivement ma lecture et rendait plus difficile la compréhension de l'histoire.
Le récit est également toujours coupé d'extrait d'archives qui s'intègrent au texte et fragmentent encore plus le récit.
En plus, on commence dans le quartier de Texaco et les premières dizaines de pages sont à propos d'un Christ... j'en était venue à me demander si ce n'était pas réellement Jésus mais non... c'était seulement un agent de la mairie.
Le commencement me rendait déjà confuse et je mon obligation de le lire pour mon cours de postcolonial ne m'a pas vraiment aidé à apprécier pleinement cette lecture.
Je crois que je sature de littérature postcoloniale pour l'instant, une pause s'impose.
Mais dans l'idée la trame m'a un peu rappelé celle de la Maison aux esprits d'Allende. On nous présente la vie d'une famille sur plusieurs génération et c'est en réalité un excuse pour nous présenter la vie d'un pays et ses évolutions politiques. On retrouve même un peu de ce réalisme magique avec un voyant/guérisseur qui parle par énigme.
La partie que j'ai adoré était le dernier chapitre. L'auteur y explique sa démarche et c'est à mon avis le passage le plus émouvant du livre. le fait qu'il soit la touche finale fait un peu remonter le livre dans mon estime.
Je n'ai pas trouvé les personnages plus attachants que ça. D'un grand réalisme mais certains plutôt détestables. La narratrice Marie-Sophie était finalement ma préférée.
En bref, pas la meilleure des lecture post-coloniales que j'ai pu avoir. Je n'ai pas accroché ni à l'histoire ni au style.
J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le roman avec cette écriture décousue et l'hétérolinguisme. Des mots, voire des phrases entières ne sont pas traduites et certains mots en français mal orthographiés, l'effet d'écriture est unique mais pas à mon goût. Ca ralentissait excessivement ma lecture et rendait plus difficile la compréhension de l'histoire.
Le récit est également toujours coupé d'extrait d'archives qui s'intègrent au texte et fragmentent encore plus le récit.
En plus, on commence dans le quartier de Texaco et les premières dizaines de pages sont à propos d'un Christ... j'en était venue à me demander si ce n'était pas réellement Jésus mais non... c'était seulement un agent de la mairie.
Le commencement me rendait déjà confuse et je mon obligation de le lire pour mon cours de postcolonial ne m'a pas vraiment aidé à apprécier pleinement cette lecture.
Je crois que je sature de littérature postcoloniale pour l'instant, une pause s'impose.
Mais dans l'idée la trame m'a un peu rappelé celle de la Maison aux esprits d'Allende. On nous présente la vie d'une famille sur plusieurs génération et c'est en réalité un excuse pour nous présenter la vie d'un pays et ses évolutions politiques. On retrouve même un peu de ce réalisme magique avec un voyant/guérisseur qui parle par énigme.
La partie que j'ai adoré était le dernier chapitre. L'auteur y explique sa démarche et c'est à mon avis le passage le plus émouvant du livre. le fait qu'il soit la touche finale fait un peu remonter le livre dans mon estime.
Je n'ai pas trouvé les personnages plus attachants que ça. D'un grand réalisme mais certains plutôt détestables. La narratrice Marie-Sophie était finalement ma préférée.
En bref, pas la meilleure des lecture post-coloniales que j'ai pu avoir. Je n'ai pas accroché ni à l'histoire ni au style.
C'est dans la belle et difficile aventure de la création d'un quartier et de l'histoire de l'île, que Patrick Chamoiseau nous emmène sous le soleil de la Martinique, sur les pas de Marie-Sophie Laborieux accompagnée de la mémoire de son père Esternome.
Le début peut paraître un peu ardu avec une langue qui est belle, teintée de créole (« des phrases emmêlées où je m'emprisonnais ») mais que l'on apprivoise au fur et à mesure des pages, jusqu'à se laisser envoûter et emporter. Une histoire pleine d'émotion avec des personnages épiques.
Le début peut paraître un peu ardu avec une langue qui est belle, teintée de créole (« des phrases emmêlées où je m'emprisonnais ») mais que l'on apprivoise au fur et à mesure des pages, jusqu'à se laisser envoûter et emporter. Une histoire pleine d'émotion avec des personnages épiques.
Chef d'oeuvre absolu. D'abord pour la langue créole si poétique et musicale, marquée par l'histoire de la Martinique qui sert de trame à ce récit édifiant de la résistance d'une petite fille d'esclave qui vivra amours, abandons, violence et magie pour finalement devenir l'icône de la résistance d'un bidonville contre la dépossession de son milieu.
Le quartier de Texaco à Fort de France est sur le point d'être rasé par les autorités. C'est alors que survient la visite du “Christ”, un urbaniste ainsi surnommé pour le rôle qu'il jouera. Il va à la rencontre de Marie-Sophie Laborieux, une vieille négresse à l'origine du quartier. Elle va lui raconter son histoire qui commence avec celle de ses parents, Esternome un nègre esclave qui va devoir s'inventer un mode d'existence au moment de la “libération” lorsqu'il a quitté la plantation et sa “manman”. “La misère le suivra partout De Saint-Pierre à Fort de France où il voudrait bien pénétrer l'En-ville mais où il se tiendra toujours confiné aux abords dans des cases qu'il rafistolera patiemment. Dans sa jeunesse, il sera lui-même à l'origine d'un quartier De Saint-Pierre élevé sur les pentes de la ville, le Noutéka des mornes où il vivra avec Ninon son amour. Une sorte de paradis retrouvé. La société martiniquaise évolue mais l'exploitation ne disparaît pas. Finalement, Ninon part en ville avec un donneur de sérénades juste avant l'éruption de la Montagne Pelée : “Soufrière a pété…!”. Esternome meurtri quittera finalement Saint-Pierre pour Fort de France où il rencontrera Idoménée, l'aveugle, soeur de l'Adrienne Carmélite Lapidaille, et mère de Marie-Sophie.
Da la parole emmêlée des personnages, Chamoiseau tisse le fil de l'histoire de la Martinique le roman Texaco chante la parole créole et sa "force", la porte pour le lecteur. La langue est imagée, poétique, crue, émotion. Elle dit tout avec une puissance d'évocation phénoménale et modeste. La vie, le sexe et la mort. La littérature avec le personnage de Ti-Cirique. La littérature et l'espoir avec l'arrivée de Césaire. (en parlant de Jacques Stephen Alexis, “mort récemment sous la griffe des tontons-macoutes. (…) c'était un Gouverneur de la rosée, madame, comme notre compatriote Jacques Roumain utilisa ce terme dans un très beau roman, nous voulûmes déchouker Duvalier” )Avec Marie-Sophie Laborieux, on découvre les nègres-Force et les Majors, les misères des femmes qui doivent résister, violées, obligées d'utiliser l'herbe grasse pour ne pas avoir charge d'enfants. Tout un monde coloré et métissé, des nègres-marron aux mulâtres, des békés des bitations à ceux de l'En-ville. Fabuleux.
Da la parole emmêlée des personnages, Chamoiseau tisse le fil de l'histoire de la Martinique le roman Texaco chante la parole créole et sa "force", la porte pour le lecteur. La langue est imagée, poétique, crue, émotion. Elle dit tout avec une puissance d'évocation phénoménale et modeste. La vie, le sexe et la mort. La littérature avec le personnage de Ti-Cirique. La littérature et l'espoir avec l'arrivée de Césaire. (en parlant de Jacques Stephen Alexis, “mort récemment sous la griffe des tontons-macoutes. (…) c'était un Gouverneur de la rosée, madame, comme notre compatriote Jacques Roumain utilisa ce terme dans un très beau roman, nous voulûmes déchouker Duvalier” )Avec Marie-Sophie Laborieux, on découvre les nègres-Force et les Majors, les misères des femmes qui doivent résister, violées, obligées d'utiliser l'herbe grasse pour ne pas avoir charge d'enfants. Tout un monde coloré et métissé, des nègres-marron aux mulâtres, des békés des bitations à ceux de l'En-ville. Fabuleux.
Un des rares romans que j'ai conservé malgré de nombreux déménagements depuis ma jeunesse et sa date de parution!
C'est dire si je l'ai aimé!
C'est dire si je l'ai aimé!
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les 100 romans du Monde
Cronos
100 livres

un auteur par département
mylena
93 livres
Autres livres de Patrick Chamoiseau (43)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3249 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3249 lecteurs ont répondu