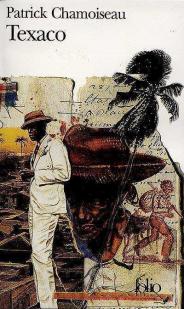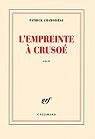Voilà, un roman total !
Avec du politique, du sociologique, de l'anthropologique, du psychologique, des histoires d'amour entre humains et entre un territoire et tout cela baignant dans une langue bien particulière.
Chamoiseau jongle et insère tout ça sans que rien ne soit à jeter, on pourrait citer tout le livre, tellement ça pisse bien et fort tout le temps.
Je ne sais pas si on peut dire qu'après cette lecture qu'on connais un peu la Martinique, les Antilles, en tout cas on a un éclairage peu commun. Et c'est bien. C'est édifiant. Un édifice de guingois, de lutte, foutraque, mêle-tout, entre-tout à l'image de ce quartier : Texaco.
Pour la 5e étoile entière, j'attends encore quelques dizaine d'années, voir si ce magistral travail crève le mur du temps.
Avec du politique, du sociologique, de l'anthropologique, du psychologique, des histoires d'amour entre humains et entre un territoire et tout cela baignant dans une langue bien particulière.
Chamoiseau jongle et insère tout ça sans que rien ne soit à jeter, on pourrait citer tout le livre, tellement ça pisse bien et fort tout le temps.
Je ne sais pas si on peut dire qu'après cette lecture qu'on connais un peu la Martinique, les Antilles, en tout cas on a un éclairage peu commun. Et c'est bien. C'est édifiant. Un édifice de guingois, de lutte, foutraque, mêle-tout, entre-tout à l'image de ce quartier : Texaco.
Pour la 5e étoile entière, j'attends encore quelques dizaine d'années, voir si ce magistral travail crève le mur du temps.
En lisant Texaco, j'ai parfois eu l'impression de lire une oeuvre de fantasy ! Sans doute parce que la Martinique de Chamoiseau est magique, à la manière d'un Gabriel Garcia Marquez, exubérante, pleine de défauts et de qualités, traînant son Histoire comme un boulet. L'île rêvée enchante grâce à une langue inventive, drôle, violente. On suit les destinées sans cesse bouleversées par les événements extérieurs et intérieurs. Un grand roman de la caraïbe !
Marie-Sophie raconte l'histoire de Texaco, un bidonville antillais. de son père et ses deux épouses à son homme chasseur de requins, elle retrace la vie des Antillais. Entre esclavage et promesses vaines de développement moderne, le peuple antillais se montre toujours fort et résolu à défendre ses possessions et sa culture.
Le texte est intéressant. J'y ai trouvé des longueurs. Ou alors, c'est que je suis hermétique à certains types de narration.
Le texte est intéressant. J'y ai trouvé des longueurs. Ou alors, c'est que je suis hermétique à certains types de narration.
La diversité de la population martiniquaise, la langue incontournable du créole venue se tisser avec l'arrivée des indiens avec une multitude de mots. Pourtant pour revenir au créole les indiens de la Martinique n'a pas le même rapport complexe codifié à leur langue que celle des habitants issus de l'esclavage. Toutefois cette dynamique de la langue créole se traduit par une reconfiguration de la société, la théorie postulant la déracialisation et la disparition des frontières ethniques des martiniquais. Entre ses deux pôles on peut accentuer une réflexion sur la Diversité dans le monde créole, et les nombreuses épopées de la Martinique racontées à l'auteur par Marie-Sophie Laborieux. Patrick Chamoiseau: Oiseau de Cham dépeint de véritables fresques historiques et politiques avec des visages certes parfois singuliers mais réalistes que ce soit dans leur foi religieuse ou leurs actes civils. Ils portent tous un nom signifiant chaque représentation individuelle ayant opéré dans la construction d'un peuple porté par l'espoir d'un changement radical tout en revendiquant sa négritude dans l'éclatement de l'identité créole.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel choc esthétique. Lire Texaco, c'est renouer avec une langue française telle qu'on ne la reconnait plus. Chamoiseau a une écriture vraiment particulière, mélange poétique de français de la métropole et de créole. C'est assez déroutant au début, cette lecture exige un effort comme si je ne savais plus de quelle langue il est question tout en sachant que c'est la mienne. Et puis au fil des pages, une sorte de charme agit et cela devient plus fluide, on dépasse le sentiment d'étrangeté pour seulement se plonger dans le récit. [pour lire la suite]
Lien : http://liremoijeveuxbien.ove..
Lien : http://liremoijeveuxbien.ove..
Un livre envoûtant, extrêmement riche et précis dans sa reconstitution de l'histoire de la Martinique dans ce qu'elle a de plus de vigoureux, sa diversité ethnique et culturelle, son imaginaire débordant et la résilience de ses habitants.
C'était mon premier livre de Chamoiseau, le langage utilisé y est poétique et unique par l'association d'un français magnifique et de nombreuses locutions créoles qui lui confèrent une touche créole locale. (Qui aura forcément interpellé le locuteur de créole que je suis).
Les personnages y sont vraiment profonds et les références à des figures littéraires ou historiques (l'Amiral Robert, De Gaulle, Césaire etc...) sont juste excellentes. Voici un livre qui donne envie de lire. On y décrit le point de vue de l'opprimé et ses "nègres" opprimés prennent une dimension mythique à travers la plume de l'auteur. On y redonne toute sa place aux traditions populaires créoles notamment les pratiques agricoles et architecturales. La réflexion sur les modes de vie à la campagne et En-Ville y est très pertinente parmi tant d'autres richesses que je recommande vivement de découvrir.
Seul bémol, le livre est assez long (500 pages) néanmoins il semble y avoir un tel travail de recherche historique et esthétique de l'auteur que cela peut expliquer cette longueur.
PS: le personnage d'Esternome est juste inoubliable. J'ai également adoré Ti-Cirique
C'était mon premier livre de Chamoiseau, le langage utilisé y est poétique et unique par l'association d'un français magnifique et de nombreuses locutions créoles qui lui confèrent une touche créole locale. (Qui aura forcément interpellé le locuteur de créole que je suis).
Les personnages y sont vraiment profonds et les références à des figures littéraires ou historiques (l'Amiral Robert, De Gaulle, Césaire etc...) sont juste excellentes. Voici un livre qui donne envie de lire. On y décrit le point de vue de l'opprimé et ses "nègres" opprimés prennent une dimension mythique à travers la plume de l'auteur. On y redonne toute sa place aux traditions populaires créoles notamment les pratiques agricoles et architecturales. La réflexion sur les modes de vie à la campagne et En-Ville y est très pertinente parmi tant d'autres richesses que je recommande vivement de découvrir.
Seul bémol, le livre est assez long (500 pages) néanmoins il semble y avoir un tel travail de recherche historique et esthétique de l'auteur que cela peut expliquer cette longueur.
PS: le personnage d'Esternome est juste inoubliable. J'ai également adoré Ti-Cirique
Sacré livre ! J'aime les livres qui réinventent le français. ça a été des livres de personnes d'autres cultures que celles de notre métropole (Kateb Yacine..) mais pas que : Claude Simon, Lautréamont, Pierre Guyotat.. et celui-là sera pour moi, jusqu'à ce que j'en lise un autre, LE livre du créole ! (j'ai entendu un peu de Césaire et je sais que c'est l'un des plus grands..). Je comprends que certain(e)s aient eu du mal à lire jusqu'au bout : moi-même j'ai renoncé à "tout" comprendre (mais ça va quand même, même si je ne connais rien de la Martinique)jusqu'à la page 120 environ (un lexique créole ne serait pas superflu) mais il faut lire ce livre en entier car la seconde partie - celle censée être écrite par la fille du personnage du père, Esternome" - est beaucoup plus facile à comprendre que les 100 premières pages, ce sont même souvent des alexandrins, à la Hugo, en prose. A la page 248 (édition d'origine) Chamoiseau commence à expliquer sa démarche et complètement dans la dernière partie ("Résurrection"), aussi, si vous êtes au bord d'abandonner, lisez cette partie qui explique comment il a procédé.
L'écrivain évoque Rabelais (il y en a ), Joyce (les pensées intimes des personnes, le rapport à une ville..), Lautréamont.. Tiens justement, tous auteurs que j'apprécie !
Sur le fond : c'est le récit parfait, de l'intime des pensées vagabondes, de ce qu'ont vécu ceux qui étaient esclaves à la Martinique, puis "libres" mais matériellement si pauvres. Des personnes inoubliables - Esternome le père, Marie-Sophie la fille et tant d'autres personnes - que Chamoiseau fait revivre par l'écriture et à qui il rend un puissant et bel hommage.
L'écrivain évoque Rabelais (il y en a ), Joyce (les pensées intimes des personnes, le rapport à une ville..), Lautréamont.. Tiens justement, tous auteurs que j'apprécie !
Sur le fond : c'est le récit parfait, de l'intime des pensées vagabondes, de ce qu'ont vécu ceux qui étaient esclaves à la Martinique, puis "libres" mais matériellement si pauvres. Des personnes inoubliables - Esternome le père, Marie-Sophie la fille et tant d'autres personnes - que Chamoiseau fait revivre par l'écriture et à qui il rend un puissant et bel hommage.
A travers Marie-Sophie et toute une galerie de personnages colorés, Chamoiseau retrace l'histoire d'une île et d'un quartier. Nous revivons la fin de l'esclave, son abolition, la perception de cet acte par les populations directement concernés. Il nous apporte un regard sur la société de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. COmment les anciens esclaves perçoivent-ils les blancs? les métis? la France?Comment cette population loin de la métropole vit-elle l'histoire de la ''Mère-Patrie''? Comment les guerres sont-elle perçues? Quels en sont les lointains soubresauts?
Le parler créole riche en couleur apporte une note d'authenticité, sans tomber dans les abus. Chamoiseau est un virtuose, et la langue pourrait être un personnage à part entière de ce roman. Les personnages sonnent vrais, et sont les vecteurs de la culure créole. Ce livre est plaisir des yeux et des oreilles, quand on apprécie cette langue qu'il est intéressant de lire à haute voix.
Tout le passé sert à présenter la naissance d'un nouveau quartier, et les combats de Marie-Sophie Laborieux pour l'installer et le sauver, contre le Christ venu le raser. Ce personnage apparait dès le début, et est ensuite le prétexte pour le plongeon dans le passé.
Le parler créole riche en couleur apporte une note d'authenticité, sans tomber dans les abus. Chamoiseau est un virtuose, et la langue pourrait être un personnage à part entière de ce roman. Les personnages sonnent vrais, et sont les vecteurs de la culure créole. Ce livre est plaisir des yeux et des oreilles, quand on apprécie cette langue qu'il est intéressant de lire à haute voix.
Tout le passé sert à présenter la naissance d'un nouveau quartier, et les combats de Marie-Sophie Laborieux pour l'installer et le sauver, contre le Christ venu le raser. Ce personnage apparait dès le début, et est ensuite le prétexte pour le plongeon dans le passé.
Goncourt 1992. Projet ambitieux de Patrick Chamoiseau de vouloir expliquer la grande histoire de la Martinique par la petite histoire de la chronique de vie - ou même de survie - de trois générations qui vont passer de l'esclavage au monde moderne où tout n'est évidemment pas rose dans une île qui se construit. Prendre l'angle de l'urbanisation de Fort de France est assez orginal et permet d'avoir beaucoup d'empathie avec les personnages qui en se battant pour leur quartier bidonville, lutte en fait pour leur condition de vie et leur aspiration à une vie plus juste. le mélange de créole et de français peut déranger au début et il faut quand même batailler un peu pour ne pas lâcher le livre. Heureusement les personnages sont attachants et le propos n'est pas larmoyant... Intéressant pour donner une autre vision de la Martinique que l'image d'Epinal de l'ile paradisiaque...
Que raconte Chamoiseau par le biais de ce bouquin? Cette histoire, c'est celle de la Martinique sur cent cinquante ans à travers le regard d'une femme Marie-Sophie. Durant les six parties du roman :
Annonciation
Temps de paille
Temps de bois-caisse
Temps de fibrociment
Temps de béton
Résurrection
Le lecteur suit la quête identitaire du peuple antillais marqué par l'esclavagisme et le colonialisme. Dès les premières pages du livre, le lecteur prend conscience de la lutte entre deux populations : les gens du quartier Texaco et ceux de l'En-ville. Texaco, c'est au départ un bidonville de Fort-de-France qui se transforme progressivement en quartier, c'est le symbole de la lutte, c'est un espace habité par des gens qui ont réussi à se libérer de leur état d'esclave, c'est la vie en communauté. Mais encore, dans les premières pages, le lecteur découvre le merveilleux personnage de Marie-Sophie Laborieux. Elle est le centre du quartier Texaco, elle est sa fondatrice. Ce dernier s'est construit autour d'elle et des réservoirs de pétrole de la célèbre compagnie. On apprend dans cette partie que la survie du quartier Texaco dépend de ce que Marie-Sophie a à raconter à un urbaniste qui souhaite voir le quartier détruit en raison, entre autres, de son insalubrité.
Alors, j'inspirai profond : j'avais soudain compris que c'était moi, autour de cette table et d'un pauvre rhum vieux, avec pour seule arme la persuasion de ma parole, qui devrais mener seule – à mon âge- la décisive bataille pour la survie de Texaco. (p. 19)
Il y a donc un profond enracinement dans l'oral qui est présenté (spécificité de la créolité dans le roman et de l'imaginaire antillais). La parole semble représenter la mémoire collective de ce peuple. En replongeant dans son passé, Marie-Sophie Laborieux (signifiant faisant référence à la mère, à la sagesse et au labeur) tente de démystifier l'idée que son quartier est primitif, qu'il ne possède aucune organisation sociale et qu'il est sans culture. La parole devient son arme. Par son discours, elle souhaite qu'il y ait une prise de conscience positive envers les siens.
De plus, par sa parole, Marie-Sophie amène l'urbaniste à changer sa position par rapport à Texaco. Elle lui fait prendre conscience de la dimension cachée de son quartier : l'harmonie.
En écoutant la Dame, j'eus soudain le sentiment qu'il n'y avait dans cet enchevêtrement, cette poétique de cases vouée au désir de vivre, aucun contresens majeur qui ferait de ce lieu, Texaco, une aberration. Au-delà des bouleversements insolites des cloisons, du béton, du fibrociment et des tôles […], il existait une cohérence à décoder, qui permettait à ces gens-là de vivre aussi parfaitement, et aussi harmonieusement qu'il était possible d'y vivre, à ce niveau de conditions. (p. 269)
Grâce à la force de sa parole, Marie-Sophie convainc l'urbaniste de la nécessité et de l'importance du quartier Texaco.
Mais encore, il est question d'une quête liée à la liberté à la fois individuelle et collective dans ce récit. Marie-Sophie aborde l'histoire de son grand-père et de son père qui ont dû vivre une prise de conscience par rapport à leur droit à l'égalité. Ils ont dû s'éveiller et lutter. À cet égard, le symbole de la liberté est associé à l'En-ville dans le roman. L'En-ville apparaît comme étant la lumière au bout du tunnel pour les noirs. Marie-Sophie ira elle-aussi y travailler afin de poursuivre le chemin amorcé par ses pères. Elle réalise que le milieu urbain n'est qu'un endroit de passage pour elle et ses semblables. Il est marqué par la solitude et le repliement sur soi. Les habitants du quartier Texaco partagent le même rêve : entrer dans l'En-ville. Ils souhaitent être enfin acceptés pour qui ils sont. En faisant annexer Texaco à l'En-ville, ils ne perdront pas leur créolité et leurs valeurs. En faisant partie de l'En-ville, les gens de Texaco auront la chance de bénéficier des biens élémentaires, ce qui constitue la base pour être dans le monde. de ce fait, ils deviendront libres et ils auront lutté ensemble tout en gardant leur identité.
Il est question aussi d'Aimé Césaire dans ce récit ce que j'ai beaucoup apprécié. Marie-Sophie aborde son importance. Elle mentionne que les noirs deviennent très sensibles, grâce à lui, à des mots comme autonomie et assimilation. Césaire devient le drapeau de l'espoir :
Il nous porta l'espoir d'être autre chose. (p. 275)
Césaire permet aux noirs de réaliser qu'ils peuvent conquérir l'En-ville. Il leur démontre qu'ils peuvent réussir en étant des personnes noires. Il leur fait réintégrer leur couleur, leur âme.
Le dernier désir de Marie-Sophie Laborieux est directement relié à la parole. Elle ne souhaite pas que le nom du quartier soit changé.
Je lui demandai une faveur, Oiseau de Cham, faveur que j'aimerais que tu notes et que tu lui rappelles : que jamais en aucun temps, dans les siècles, on n'enlève à ce lieu son nom de TEXACO, au nom de mon Esternome, au nom de nos souffrances, au nom de nos combats, dans la loi la plus intangible de nos plus hautes mémoires, et celle bien plus intime de mon cher nom secret qui – je te l'avoue enfin- n'est autre que celui-là. (417-418).
Le nom du quartier ne peut qu'évoquer le discours de l'endroit. le nom Texaco est en fait le véhicule de la mémoire et de la parole du coeur.
Dans la dernière partie du roman, les gens du quartier sont enfin libres et autonomes. le livre est d'ailleurs clôt sur cette vision :
Je voulais qu'il soit chanté quelque part, dans l'écoute des générations à venir, que nous nous étions battus avec l'En-ville, non pour le conquérir (lui qui nous gobait), mais pour nous conquérir nous-mêmes dans l'inédit créole qu'il nous fallait nommer-en nous-mêmes pour nous-mêmes- jusqu'à notre pleine autorité. (p. 427)
Marie-Sophie devait raconter la spécificité de l'histoire de la Martinique. Il fallait qu'elle refasse ce voyage dans le temps pour plonger dans l'identité antillaise, la nommer, l'affirmer et célébrer la créolité en reconnaissant l'existence d'un quartier : Texaco. C'est la réappropriation individuelle et collective de la créolité dans toute sa grandeur qui est exprimée.
Il y a également de nombreux référents à la religion dans ce récit. L'urbaniste semble associé au Christ et les différents temps relèvent d'une symphonie quasi-biblique débutant avec le sermon jusqu'à la résurrection symbolisant la renaissance du quartier.
https://madamelit.ca/2018/12/21/madame-lit-texaco-de-patrick-chamoiseau/
Lien : https://madamelit.ca/2018/12..
Annonciation
Temps de paille
Temps de bois-caisse
Temps de fibrociment
Temps de béton
Résurrection
Le lecteur suit la quête identitaire du peuple antillais marqué par l'esclavagisme et le colonialisme. Dès les premières pages du livre, le lecteur prend conscience de la lutte entre deux populations : les gens du quartier Texaco et ceux de l'En-ville. Texaco, c'est au départ un bidonville de Fort-de-France qui se transforme progressivement en quartier, c'est le symbole de la lutte, c'est un espace habité par des gens qui ont réussi à se libérer de leur état d'esclave, c'est la vie en communauté. Mais encore, dans les premières pages, le lecteur découvre le merveilleux personnage de Marie-Sophie Laborieux. Elle est le centre du quartier Texaco, elle est sa fondatrice. Ce dernier s'est construit autour d'elle et des réservoirs de pétrole de la célèbre compagnie. On apprend dans cette partie que la survie du quartier Texaco dépend de ce que Marie-Sophie a à raconter à un urbaniste qui souhaite voir le quartier détruit en raison, entre autres, de son insalubrité.
Alors, j'inspirai profond : j'avais soudain compris que c'était moi, autour de cette table et d'un pauvre rhum vieux, avec pour seule arme la persuasion de ma parole, qui devrais mener seule – à mon âge- la décisive bataille pour la survie de Texaco. (p. 19)
Il y a donc un profond enracinement dans l'oral qui est présenté (spécificité de la créolité dans le roman et de l'imaginaire antillais). La parole semble représenter la mémoire collective de ce peuple. En replongeant dans son passé, Marie-Sophie Laborieux (signifiant faisant référence à la mère, à la sagesse et au labeur) tente de démystifier l'idée que son quartier est primitif, qu'il ne possède aucune organisation sociale et qu'il est sans culture. La parole devient son arme. Par son discours, elle souhaite qu'il y ait une prise de conscience positive envers les siens.
De plus, par sa parole, Marie-Sophie amène l'urbaniste à changer sa position par rapport à Texaco. Elle lui fait prendre conscience de la dimension cachée de son quartier : l'harmonie.
En écoutant la Dame, j'eus soudain le sentiment qu'il n'y avait dans cet enchevêtrement, cette poétique de cases vouée au désir de vivre, aucun contresens majeur qui ferait de ce lieu, Texaco, une aberration. Au-delà des bouleversements insolites des cloisons, du béton, du fibrociment et des tôles […], il existait une cohérence à décoder, qui permettait à ces gens-là de vivre aussi parfaitement, et aussi harmonieusement qu'il était possible d'y vivre, à ce niveau de conditions. (p. 269)
Grâce à la force de sa parole, Marie-Sophie convainc l'urbaniste de la nécessité et de l'importance du quartier Texaco.
Mais encore, il est question d'une quête liée à la liberté à la fois individuelle et collective dans ce récit. Marie-Sophie aborde l'histoire de son grand-père et de son père qui ont dû vivre une prise de conscience par rapport à leur droit à l'égalité. Ils ont dû s'éveiller et lutter. À cet égard, le symbole de la liberté est associé à l'En-ville dans le roman. L'En-ville apparaît comme étant la lumière au bout du tunnel pour les noirs. Marie-Sophie ira elle-aussi y travailler afin de poursuivre le chemin amorcé par ses pères. Elle réalise que le milieu urbain n'est qu'un endroit de passage pour elle et ses semblables. Il est marqué par la solitude et le repliement sur soi. Les habitants du quartier Texaco partagent le même rêve : entrer dans l'En-ville. Ils souhaitent être enfin acceptés pour qui ils sont. En faisant annexer Texaco à l'En-ville, ils ne perdront pas leur créolité et leurs valeurs. En faisant partie de l'En-ville, les gens de Texaco auront la chance de bénéficier des biens élémentaires, ce qui constitue la base pour être dans le monde. de ce fait, ils deviendront libres et ils auront lutté ensemble tout en gardant leur identité.
Il est question aussi d'Aimé Césaire dans ce récit ce que j'ai beaucoup apprécié. Marie-Sophie aborde son importance. Elle mentionne que les noirs deviennent très sensibles, grâce à lui, à des mots comme autonomie et assimilation. Césaire devient le drapeau de l'espoir :
Il nous porta l'espoir d'être autre chose. (p. 275)
Césaire permet aux noirs de réaliser qu'ils peuvent conquérir l'En-ville. Il leur démontre qu'ils peuvent réussir en étant des personnes noires. Il leur fait réintégrer leur couleur, leur âme.
Le dernier désir de Marie-Sophie Laborieux est directement relié à la parole. Elle ne souhaite pas que le nom du quartier soit changé.
Je lui demandai une faveur, Oiseau de Cham, faveur que j'aimerais que tu notes et que tu lui rappelles : que jamais en aucun temps, dans les siècles, on n'enlève à ce lieu son nom de TEXACO, au nom de mon Esternome, au nom de nos souffrances, au nom de nos combats, dans la loi la plus intangible de nos plus hautes mémoires, et celle bien plus intime de mon cher nom secret qui – je te l'avoue enfin- n'est autre que celui-là. (417-418).
Le nom du quartier ne peut qu'évoquer le discours de l'endroit. le nom Texaco est en fait le véhicule de la mémoire et de la parole du coeur.
Dans la dernière partie du roman, les gens du quartier sont enfin libres et autonomes. le livre est d'ailleurs clôt sur cette vision :
Je voulais qu'il soit chanté quelque part, dans l'écoute des générations à venir, que nous nous étions battus avec l'En-ville, non pour le conquérir (lui qui nous gobait), mais pour nous conquérir nous-mêmes dans l'inédit créole qu'il nous fallait nommer-en nous-mêmes pour nous-mêmes- jusqu'à notre pleine autorité. (p. 427)
Marie-Sophie devait raconter la spécificité de l'histoire de la Martinique. Il fallait qu'elle refasse ce voyage dans le temps pour plonger dans l'identité antillaise, la nommer, l'affirmer et célébrer la créolité en reconnaissant l'existence d'un quartier : Texaco. C'est la réappropriation individuelle et collective de la créolité dans toute sa grandeur qui est exprimée.
Il y a également de nombreux référents à la religion dans ce récit. L'urbaniste semble associé au Christ et les différents temps relèvent d'une symphonie quasi-biblique débutant avec le sermon jusqu'à la résurrection symbolisant la renaissance du quartier.
https://madamelit.ca/2018/12/21/madame-lit-texaco-de-patrick-chamoiseau/
Lien : https://madamelit.ca/2018/12..
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les 100 romans du Monde
Cronos
100 livres

un auteur par département
mylena
93 livres
Autres livres de Patrick Chamoiseau (43)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3249 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3249 lecteurs ont répondu