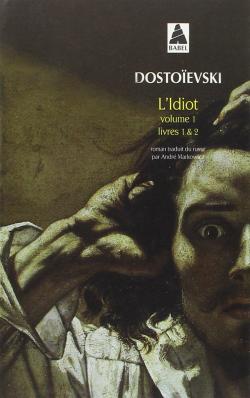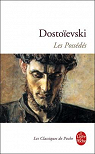Critiques filtrées sur 5 étoiles
Ceci est un des livres les plus connus de l'auteur, et non sans raison ! En effet, Dostoïevski signe là une oeuvre magistrale, et ce malgré les difficultés qu'il a dû rencontrer quand à la vitesse d'écriture du livre -poursuivi par ses créanciers, il ne pouvait sans cesse modifier le texte- . L'auteur représente un homme incroyablement bon, surprenant par sa fragilité maladive et son extraordinaire propension à une "éloquence cérébrale", un développement d'idées fourmillantes et quasi-pures, inattendues ... Ses réactions lors de situations déplaisantes ne cessent de nous étonner, parfois nous agaçant par leur innocence, parfois nous bouleversant par leur candeur délicieuse. Mais voilà, la société et ses codes imbéciles, l'amour insaisissable, vont malgré lui changer une personne de lumière, en qui j'aurais beaucoup plus cru qu'un dieu aveugle et sourd. Cet "idiot" est ensorcelant, invraisemblable et en même temps imaginable, passionnant à découvrir, et pourra vous apporter beaucoup quant à la profondeur des réflexions humaines. N'hésitez surtout pas, la plume de Dostoïevski, souvent trempée dans l'encre sombre de ses expériences, fait des merveilles, et arrivera à vous garder en haleine jusqu'à une fin soupçonnable, mais pleine d'enseignements.
Délaissant un emps mes lectures actuelles, je me suis plongée avec délice dans ce beau livre de Dostoievski, tellement typique de cet auteur russe qui sait si bien analyser les âmes! Portrait poignant et émouvant de cet homme foncièrement bon mais atteint d'épilepsie (dont souffrait d'ailleurs aussi l'auteur, je crois), dans la société russe du XIXe s. Publié chez Ranaan dans la traduction d'André Markowicz, ce livre profond et sensible décrit avec brio l'atmosphère tempêtueuse de la Russie de l'èpoque. Il m'a beaucoup plu et je le recommande vivement aux lecteurs qui ont aimé Dostoievski apr ses autres écrits.
« Car ils sont méchants, méchants, méchants ».
J'avais été déçu par L'Idiot il y a 20 ans de cela. Méfiance si vous sortez de Crime et Châtiment, comme c'était mon cas : ne vous attendez pas à une intrigue angoissante, serrée autour d'un noeud dramatique tendu à l'extrême. L'Idiot tient davantage d'une longue pièce de théâtre, entre Gogol et Tchekhov, avec parfois l'engluement cauchemardesque d'un futur Kafka. Les critiques littéraires de l'époque classaient le livre comme un roman clinique, non recommandable aux lettrés, mais conseillé de préférence aux médecins, aux physiologistes, aux philosophes – voir par ex. la préface de Freud avec à sa grille de lecture « tuer le père » et « onanisme » (ce même Freud qui reproche à Dostoïevski de s'être « limité à la vie psychique anormale » !).
Cela pourrait s'appeler « Orgueil et perversion » même si l'intrigue est assez difficile à résumer dans la mesure où des scènes paroxysmiques, passionnées ou loufoques se suivent sans réel fil rouge, sinon ce personnage de l'Idiot, particulièrement imperméable à toute définition, réceptacle et miroir de chaque époque, un peu comme le sera Tintin (Dostoïevski prétend lui-même que, s'il ne caractérise pas telle ou telle attitude de ses personnages, c'est parce qu'elle est aussi énigmatique pour lui que pour le lecteur) : un naïf christique d'une bonté à toute épreuve ? une âme d'enfant dans un corps d'homme ? un éternel d'adolescent, une pensée sans filtre, un adulte Asperger (ex. utilisation atypique du langage et maladresse physique lors de la scène du vase) ? Et ce charisme qu'il dégage comme à son insu, presque embarrassé, impuissant et passif séducteur, captivant ces femmes qui gravitent autour lui, comment le comprendre ? le fantasme d'un timide (d'un homosexuel refoulé nous expliquerait Freud) ? Il désarçonne et fait pitié mais Dostoïevski – en fier russe qui sait tourner en dérision les coups du sort – ne lui réserve pas un traitement pathétiquement triste comme le Hugo de L'Homme qui rit ou le Zola de L'Oeuvre. La fin est dure, mais le livre ne verse pas dans le pathos dramatique, malgré un dénouement aussi poignant que déroutant (cf. triangle amoureux morbide – encore du pain béni pour une analyse psy), dans un chapitre façon Crime et Châtiment et une sorte de préfiguration des dernières années de Nietzsche.
Quel visage mettre sur l'Idiot, quel acteur pourrait le jouer ? Je n'ai pas de réponse à cette question, tant le personnage du prince Mychkine est sans doute une sorte de concept philosophico-théologique dont notre auteur se sert pour aborder les thèmes qui le hantent, dont (mais pas que) celui de l'idiotie de l'amoureux qu'on observe du dehors, ou (et au fond c'est pareil) de l'idiotie de n'importe qui se trouve plongé dans un milieu auquel il n'appartient pas. Etrangement pourtant, m'est soudain venu à l'esprit Abraham Lincoln (sa notoriété précède de peu l'écriture du roman…) dont douceur et bon sens venaient à bout de n'importe qui, après que, passée les premiers étonnements, on ne finisse par succomber au désarçonnant charisme de ce profond humaniste.
Mais l'idiotie n'est qu'un thème parmi d'autre. Il y a aussi la perversion des hommes (pitoyable histoire de Marie au début du roman) ; l'abaissement revendiqué (« je suis bas ») ou quand faire l'aveu de sa faute est plus qu'une libération (« Je suis de ces êtres qui éprouvent à s'abaisser une volupté et même un sentiment d'orgueil ») avec cet intriguant Lébédev et son excellent et cauteleux « Au revoir, très-estimé prince ! A la sourdine... à la sourdine... et, ensemble. ». Il y a le fait que cette bassesse puisse cohabiter avec un sursaut d'orgueil ou même de la grandeur, illustré par ex. avec le test de la liasse au feu. On y trouve encore les minutes du condamné gracié ou du mourant en sursis : ici la lettre d'Hyppolyte est, pour moi, contrairement à d'autres avis, un plat de résistance à lui tout seul, rappelant par ex. Les Carnets du sous-sol et annonçant là encore Nietzsche (ex. Ecce Homo) sans compter le dégoût face à la platitude des masses, au mimétisme du troupeau – et puis tout de même, rien que ça, est-ce que ça n'est pas savoureux : « Explication nécessaire ! Épigraphe : Après moi le déluge ! ». Également le ridicule inflammable et effrontément révolutionnaire des humiliations bafouées (« Mais rappelez-vous que nous exigeons et ne quémandons pas. Nous exigeons ; nous ne quémandons pas !... », préfigurant les pages sombres du XXième siècle et qu'on retrouve encore chez certains de nos tribuns contemporains à la personne sacrée). Et puis quelques passages de burlesque pur et parfaitement gogoliens, dont j'avais oublié que notre auteur (pourtant celui du « Bourg de Stépantchikovo et sa population » ou du « Crocodile ») était capable : l'anthropophage de moines et l'opinion quant aux chemins de fer (qui illustre bouffonnement une réflexion tout à fait sérieuse), l'enfant qui a connu Napoléon et son « tu ne mentiras pas », le portefeuille (non-)volé, ou (dans une moindre mesure) la private joke du chevalier pauvre (qui m'évoque un cas personnel tout à fait similaire).
Les personnages sont mis en place en quelques traits sur les 100 premières pages avant que l'auteur ne les entrechoquent les uns contre les autres, comme des jouets, devenant le spectateur du drame sorti de son propre cerveau. Parmi ces protagonistes, la femme-concept chère à Dostoïevski qu'est la prostituée rédemptrice / bouc émissaire, ainsi que les 2 autres personnages féminins très bien campées que sont la générale (solide et pragmatique dans son sympathique bon sens « C'est à devenir folle ! ») et la jeune, naïve autant que sérieuse, impulsive, orgueilleuse, usante, impertinente, indécise et passionnée Aglaé, équivalent russe des anglaises Catherine des Hauts de Hurlevent (« Peut-on vous parler sérieusement, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie ? dit Aglaé en éclatant de colère sans savoir pourquoi, mais sans pouvoir se maîtriser »). Bref, un grand et profond roman, sans le classicisme d'Anna Karénine (amour terrestre chez Tolstoï ; amour onirique chez Dostoïevski), mais aussi riche qu'il peut paraître décousu ou déconcertant à la première lecture.
A ce titre, je m'en rends compte que Dostoïevski est beaucoup plus russe que ne l'est Tolstoï. Les deux, psychologues à leur façon particulière, reportent ce qu'ils voient : Tolstoï essentiellement tourné vers l'observation du monde extérieur, tandis que Dostoïevski fouille son monde intérieur, ce qui occasionne une profondeur et une fièvre décuplées chez ce dernier, flirtant avec la folie. Tolstoï s'interroge en face d'une société qui change et auquel il s'intègre malgré tout, en homme issu de la noblesse et conscient de son rang. Dostoïevski est en constant mouvement dans un monde où aucune place ne semble lui convenir (« la beauté sauvera le monde » - parole d'idiot, d'amoureux bête, comme disent certains protagonistes - est à confronter à cette étonnante pensée « de quel intérêt est pour moi toute cette beauté quand, à chaque minute, à chaque seconde, je sais et je suis forcé de savoir que seul j'ai été traité en paria par la nature, alors que la petite mouche qui bourdonne autour de moi dans un rayon de soleil a elle-même sa place au banquet, la connaît et est heureuse ? » ; telle ou telle mouche se retrouvera plusieurs fois dans le roman). Bref : Tolstoï d'un classicisme occidental, sociable quoique plutôt ferme dans des opinions horizontales ; Dostoïevski asocial, cherchant à s'intégrer mais sans cesse en mouvement, se dupliquant d'une crise l'autre (ces mains qu'on claque nerveusement l'une contre l'autre) comme les cellules se divisent, les idées s'engendrent (façon poupées… russes), et se contredisent l'une l'autre, pétillements de l'imminente attaque d'épilepsie : Dostoïevski quant à lui, braque les projecteurs tout en bas ou les tourne vers le haut, sur les rapports de l'individu (slavophile) avec lui-même, et avec Dieu.
J'avais été déçu par L'Idiot il y a 20 ans de cela. Méfiance si vous sortez de Crime et Châtiment, comme c'était mon cas : ne vous attendez pas à une intrigue angoissante, serrée autour d'un noeud dramatique tendu à l'extrême. L'Idiot tient davantage d'une longue pièce de théâtre, entre Gogol et Tchekhov, avec parfois l'engluement cauchemardesque d'un futur Kafka. Les critiques littéraires de l'époque classaient le livre comme un roman clinique, non recommandable aux lettrés, mais conseillé de préférence aux médecins, aux physiologistes, aux philosophes – voir par ex. la préface de Freud avec à sa grille de lecture « tuer le père » et « onanisme » (ce même Freud qui reproche à Dostoïevski de s'être « limité à la vie psychique anormale » !).
Cela pourrait s'appeler « Orgueil et perversion » même si l'intrigue est assez difficile à résumer dans la mesure où des scènes paroxysmiques, passionnées ou loufoques se suivent sans réel fil rouge, sinon ce personnage de l'Idiot, particulièrement imperméable à toute définition, réceptacle et miroir de chaque époque, un peu comme le sera Tintin (Dostoïevski prétend lui-même que, s'il ne caractérise pas telle ou telle attitude de ses personnages, c'est parce qu'elle est aussi énigmatique pour lui que pour le lecteur) : un naïf christique d'une bonté à toute épreuve ? une âme d'enfant dans un corps d'homme ? un éternel d'adolescent, une pensée sans filtre, un adulte Asperger (ex. utilisation atypique du langage et maladresse physique lors de la scène du vase) ? Et ce charisme qu'il dégage comme à son insu, presque embarrassé, impuissant et passif séducteur, captivant ces femmes qui gravitent autour lui, comment le comprendre ? le fantasme d'un timide (d'un homosexuel refoulé nous expliquerait Freud) ? Il désarçonne et fait pitié mais Dostoïevski – en fier russe qui sait tourner en dérision les coups du sort – ne lui réserve pas un traitement pathétiquement triste comme le Hugo de L'Homme qui rit ou le Zola de L'Oeuvre. La fin est dure, mais le livre ne verse pas dans le pathos dramatique, malgré un dénouement aussi poignant que déroutant (cf. triangle amoureux morbide – encore du pain béni pour une analyse psy), dans un chapitre façon Crime et Châtiment et une sorte de préfiguration des dernières années de Nietzsche.
Quel visage mettre sur l'Idiot, quel acteur pourrait le jouer ? Je n'ai pas de réponse à cette question, tant le personnage du prince Mychkine est sans doute une sorte de concept philosophico-théologique dont notre auteur se sert pour aborder les thèmes qui le hantent, dont (mais pas que) celui de l'idiotie de l'amoureux qu'on observe du dehors, ou (et au fond c'est pareil) de l'idiotie de n'importe qui se trouve plongé dans un milieu auquel il n'appartient pas. Etrangement pourtant, m'est soudain venu à l'esprit Abraham Lincoln (sa notoriété précède de peu l'écriture du roman…) dont douceur et bon sens venaient à bout de n'importe qui, après que, passée les premiers étonnements, on ne finisse par succomber au désarçonnant charisme de ce profond humaniste.
Mais l'idiotie n'est qu'un thème parmi d'autre. Il y a aussi la perversion des hommes (pitoyable histoire de Marie au début du roman) ; l'abaissement revendiqué (« je suis bas ») ou quand faire l'aveu de sa faute est plus qu'une libération (« Je suis de ces êtres qui éprouvent à s'abaisser une volupté et même un sentiment d'orgueil ») avec cet intriguant Lébédev et son excellent et cauteleux « Au revoir, très-estimé prince ! A la sourdine... à la sourdine... et, ensemble. ». Il y a le fait que cette bassesse puisse cohabiter avec un sursaut d'orgueil ou même de la grandeur, illustré par ex. avec le test de la liasse au feu. On y trouve encore les minutes du condamné gracié ou du mourant en sursis : ici la lettre d'Hyppolyte est, pour moi, contrairement à d'autres avis, un plat de résistance à lui tout seul, rappelant par ex. Les Carnets du sous-sol et annonçant là encore Nietzsche (ex. Ecce Homo) sans compter le dégoût face à la platitude des masses, au mimétisme du troupeau – et puis tout de même, rien que ça, est-ce que ça n'est pas savoureux : « Explication nécessaire ! Épigraphe : Après moi le déluge ! ». Également le ridicule inflammable et effrontément révolutionnaire des humiliations bafouées (« Mais rappelez-vous que nous exigeons et ne quémandons pas. Nous exigeons ; nous ne quémandons pas !... », préfigurant les pages sombres du XXième siècle et qu'on retrouve encore chez certains de nos tribuns contemporains à la personne sacrée). Et puis quelques passages de burlesque pur et parfaitement gogoliens, dont j'avais oublié que notre auteur (pourtant celui du « Bourg de Stépantchikovo et sa population » ou du « Crocodile ») était capable : l'anthropophage de moines et l'opinion quant aux chemins de fer (qui illustre bouffonnement une réflexion tout à fait sérieuse), l'enfant qui a connu Napoléon et son « tu ne mentiras pas », le portefeuille (non-)volé, ou (dans une moindre mesure) la private joke du chevalier pauvre (qui m'évoque un cas personnel tout à fait similaire).
Les personnages sont mis en place en quelques traits sur les 100 premières pages avant que l'auteur ne les entrechoquent les uns contre les autres, comme des jouets, devenant le spectateur du drame sorti de son propre cerveau. Parmi ces protagonistes, la femme-concept chère à Dostoïevski qu'est la prostituée rédemptrice / bouc émissaire, ainsi que les 2 autres personnages féminins très bien campées que sont la générale (solide et pragmatique dans son sympathique bon sens « C'est à devenir folle ! ») et la jeune, naïve autant que sérieuse, impulsive, orgueilleuse, usante, impertinente, indécise et passionnée Aglaé, équivalent russe des anglaises Catherine des Hauts de Hurlevent (« Peut-on vous parler sérieusement, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie ? dit Aglaé en éclatant de colère sans savoir pourquoi, mais sans pouvoir se maîtriser »). Bref, un grand et profond roman, sans le classicisme d'Anna Karénine (amour terrestre chez Tolstoï ; amour onirique chez Dostoïevski), mais aussi riche qu'il peut paraître décousu ou déconcertant à la première lecture.
A ce titre, je m'en rends compte que Dostoïevski est beaucoup plus russe que ne l'est Tolstoï. Les deux, psychologues à leur façon particulière, reportent ce qu'ils voient : Tolstoï essentiellement tourné vers l'observation du monde extérieur, tandis que Dostoïevski fouille son monde intérieur, ce qui occasionne une profondeur et une fièvre décuplées chez ce dernier, flirtant avec la folie. Tolstoï s'interroge en face d'une société qui change et auquel il s'intègre malgré tout, en homme issu de la noblesse et conscient de son rang. Dostoïevski est en constant mouvement dans un monde où aucune place ne semble lui convenir (« la beauté sauvera le monde » - parole d'idiot, d'amoureux bête, comme disent certains protagonistes - est à confronter à cette étonnante pensée « de quel intérêt est pour moi toute cette beauté quand, à chaque minute, à chaque seconde, je sais et je suis forcé de savoir que seul j'ai été traité en paria par la nature, alors que la petite mouche qui bourdonne autour de moi dans un rayon de soleil a elle-même sa place au banquet, la connaît et est heureuse ? » ; telle ou telle mouche se retrouvera plusieurs fois dans le roman). Bref : Tolstoï d'un classicisme occidental, sociable quoique plutôt ferme dans des opinions horizontales ; Dostoïevski asocial, cherchant à s'intégrer mais sans cesse en mouvement, se dupliquant d'une crise l'autre (ces mains qu'on claque nerveusement l'une contre l'autre) comme les cellules se divisent, les idées s'engendrent (façon poupées… russes), et se contredisent l'une l'autre, pétillements de l'imminente attaque d'épilepsie : Dostoïevski quant à lui, braque les projecteurs tout en bas ou les tourne vers le haut, sur les rapports de l'individu (slavophile) avec lui-même, et avec Dieu.
Chef d'oeuvre, tout simplement. Un peu compliqué de jongler avec les noms russes où un personnage peut être désigné de plusieurs façons. La complexité des caractères dépeints est extraordinaire parfois un peu déroutante. La leçon que j'en tire, c'est qu'il ne suffit pas d'être sage et philosophe pour résister aux esprits tordus, malfaisants, toxiques dirait-on maintenant, que le destin met sur notre route.
Etoiles notabénistes : *****
Идиот
Traduction : G. & G. Arout
Commentaires : Louis Martinez
ISBN : 9782253067085
... Mais qui est réellement l'Idiot ?
Drôle de question, n'est-ce pas, tant il est sûr et certain que l'Idiot en question ne peut être que le prince Lev Nikolaïevitch Muichkine, dont nous faisons la connaissance dès les premières pages du roman, dans un wagon de troisième classe, à bord d'un train qui le ramène à Pétersbourg, suite à un long exil en Suisse nécessité par sa santé.
Qu'ils l'appellent clairement "l'Idiot" ou se contentent de chuchoter poliment le mot lorsque l'incroyable franchise - pour ne pas parler de naïveté pure et simple - et le mysticisme quasi christique de nombre des réactions du prince les font sourire ou, ce qui est bien plus désagréable pour eux, les déstabilisent complètement, les autres personnages - et, comme toujours chez l'auteur, il y en a une belle flopée - n'en doutent pas. Pas même ceux qui apprécient sa bonté et sa générosité. La générale Elisabeth Prokofievna Epantchine, la seule et lointaine parente directe qu'il lui reste, femme elle-même au caractère atypique, impulsif et d'une très grande sensibilité, le considère au minimum comme bien "atteint" et frémit à l'idée qu'il puisse épouser un jour sa fille, Aglaé.
Dernier rejeton mâle de la très noble et très antique famille des princes Muichkine, Lev Nikolaïevitch a passé son enfance dans une sorte de torpeur. On le prit longtemps pour un attardé mais, bien sûr, on tenta, par tous les moyens, de redresser la barre. La méthode d'un médecin suisse, chez qui on l'expédia sans se soucier que ce fût le praticien lui-même - le Dr Scheider - intéressé par le cas qui s'offrait à lui, qui réglât les frais, parut obtenir d'excellents résultats. Peu à peu, les crises d'épilepsie s'estompèrent, le prince put parler, raisonner, étudier. Mais il restait timide et, en société, était capable de passer d'une aisance étrange à une sorte de paranoïa incompréhensible et se perdait parfois dans une sorte d'état second qu'on pouvait, il est vrai, voir comme une sorte de rêverie.
La société, bien sûr, surtout celle dans laquelle il est né, il ne la côtoie qu'à Petersbourg, après avoir renoué avec la famille Epantchine - la générale l'a pris en affection, il amuse plus ou moins ses filles et le général lui-même, d'abord surpris, croyant au début à l'imposture, est vite séduit par le jeune homme et son talent pour la calligraphie. Si sa santé s'est remise, la Fortune aussi lui fait les yeux doux et lui, qui avait quitté la Suisse habillé très simplement et sans guère d'argent, possède désormais, suite à une mesure de l'homme qui lui a servi en quelque sorte de tuteur, Pavlistchev, une fortune des plus honorables, d'un montant de 135 000 roubles. Une bagatelle face à l'ancienne puissance financière des Muichkine mais une bagatelle qui impressionne et permet de fermer les yeux sur certaines étrangetés du prince - lequel, au physique, est d'ailleurs plutôt séduisant, ce qui ne gâte rien.
En raison de l'ancienneté de son nom, de la réalité de son titre et de sa filiation, qu'on ne parvient pas à lui contester, et de sa fortune récente mais qui lui permet désormais de vivre selon son rang, Lev Nikolaïevitch, prince Muichkine, bien qu'il admette lui-même "ne pas être guéri", pourrait cependant vivre à Pétersbourg et, l'été, à Pskov, dans une relative tranquillité.
Mais le Destin, bien sûr, s'en est mêlé. Et dès lors même qu'il se trouvait encore dans le wagon de troisième classe qui le ramenait à Pétersbourg.
S'y trouvaient en effet également deux hommes, Parfione Simonovitch Rogojine, fils cadet d'une famille de riches marchands, qui, ayant appris la mort de son père, vient réclamer sa part d'héritage, et Loukian Timofeïevitch Lebedev, incroyable personnage purement "dostoievskien", ancien fonctionnaire devenu prêteur sur gages. C'est dans ce wagon où tous trois grelottent plus ou moins - surtout le prince, habillé, comme ricanent les deux autres "à la Suisse - que Muichkine entend parler pour la première fois de la passion vouée par Rogojine à Nastassia Philippovna, pupille devenue contre son gré la maîtresse du propriétaire pour lequel travaillait son père disparu et qui, longtemps entretenue par cet homme, Totski, lui a peu à peu rendu la vie si impossible en se révoltant contre lui qu'il en est venu à la décision de la marier au secrétaire du général Epantchine en personne, Gabriel Ardalionovitch Ivolguine, en dotant le jeune couple de la somme, à la fois ridicule (pour Nastassia) et énorme (pour Gania, qui appartient à une famille déchue) de 75 000 roubles.
Mais le retour de Rogojine, amoureux fou de Nastassia, va compromettre gravement l'affaire, d'autant que, introduit chez le général Epantchine pour tenter d'y rencontrer la femme de celui-ci, sa seule parente encore en vie, nous l'avons dit, Elisabeth Prokofievna, le prince Muichkine tombe sur le portrait de Nastassia, que celle-ci vient d'offrir à Gania, et qu'il tombe en même temps instantanément amoureux de cette femme d'une beauté rare certes mais sur le visage de laquelle il ne décerne - peut-être parce qu'il est "fou" ou "idiot", ou parce qu'il l'a été, ou parce qu'il le redeviendra - que l'intense douleur morale.
Comme d'habitude, j'ai pris la peine de lire deux fois de suite ce roman - il est très difficile, selon moi, de faire autrement si l'on veut saisir au mieux la pensée de Dostoievski. On retrouve bien sûr ici le tourbillon classique des personnages, procédé si cher à l'auteur, les intrigues qui s'entremêlent, les rencontres en principe improbables qui se font pourtant et obtiennent des résultats surprenants - ainsi Aglaé Ivanovna Epantchine, la dernière et la plus belle des filles de la générale, est-elle, oui ou non, amoureuse du prince ou ne fait-elle que se moquer de lui ? - mais ce que l'on finit par ressentir (enfin, je ne parle ici que pour moi et cela explique en partie la question que je posais au tout début de cette fiche), c'est que, chacun à sa manière, tous les personnages, à l'exception notable de quelques uns dont le prince Stch., sa fiancée, Adélaïde Epantchine, Barbara Ardalionovna Ivolguine (la soeur de Gabriel), et Ptitsine, son futur époux, semblent, à un moment ou un autre, pouvoir être taxés d'"idiots", au sens médical du terme. Parmi eux, Rogojine, meurtrier en puissance, en est sans doute l'exemple le plus frappant.
La relation qu'il entretient avec Nastassia Philippovna, relation pourtant recherchée à la folie par l'un et consentie avec une espèce de ferveur par l'autre, se fonde sur un sado-masochisme à la fois physique et psychique que Dostoievski traite avec délicatesse sans, pour autant, le laisser dans l'ombre. D'ailleurs, Nastassia est à coup sûr bel et bien amoureuse de Muichkine mais l'impuissance de celui-ci, suggérée par l'auteur mais jamais avouée, s'oppose à cette relation qui, pourtant, apaiserait l'âme tourmentée de la jeune femme. Autre trait marquant : la culpabilité ressentie par Nastassia (plus ou moins violée cependant jadis par Totski) et qu'elle tient à toutes forces à expier. Enfin, le comportement final d'Aglaé Ivanovna Epantchine, qui s'enfuit avec un escroc, n'est-il pas, après tout ce que nous avons vu de ses caprices et de ses sautes d'humeur tout au long du livre, le signe d'un déséquilibre après tout peut-être génétique et qui la relierait à "l'idiotie" du prince ?
Et comme si cela ne suffisait pas, on peut ajouter la perversité foncière de Ferdistchenko, ivrogne et locataire des Ivolguine, pique-assiette qui suit Rogojine et Nastassia dans tous leurs excès ; celle de Lebedev, ce fonctionnaire à la retraite et prêteur sur gages qui apparaît dès le premier chapitre, connaît tous les ragots de Pétersbourg, possède une villa à Pskov, et qui joue au général Ivolguine, par ailleurs buveur invétéré, militaire déchu et monomaniaque, un si mauvais tour que le malheureux finira par en avoir une attaque, puis une autre, celle-là mortelle.
Ivolguine lui-même, qui emprunte à tout-va non pour entretenir sa famille mais bel et bien pour une quadragénaire qu'il a pour maîtresse, présente lui aussi des points qui forcent à s'interroger sur son bon sens. L'alcool ne suffit pas à expliquer sa lâcheté, même si, certainement, son addiction l'aggrave.
Les envolées sociales, que l'on rencontre communément chez Dostoievski, sont moins nombreuses que d'habitude, peut-être parce que, le plus souvent, c'est Muichkine, l'Idiot disons officiel, qui est son porte-parole et que l'auteur perçoit ici le paradoxe. La slavophilie demeure par contre une cause ardemment défendue par l'écrivain, qui le fait fort habilement en opposant le prince à un groupe de pseudo-nihilistes, préfiguration des bolcheviks, qui tentent plus ou moins d'escroquer de l'argent à Muichkine qu'ils accusent d'avoir détourné l'héritage légué par son protecteur. Ils exhibent, pour ce faire, l'un de leurs camarades, Antipe Bourdovski, communément surnommé "le fils de Pavlistchev" bien avant l'apparition du prince, alors que, preuves à l'appui (acte de naissance, etc, etc ...), Bourdovski est bel et bien le fils de l'homme dont il porte le nom. Cela permet du coup à Dostoievski d'introduire le personnage d'Hippolyte Terentiev, carrément le meneur de la bande malgré la phtisie qui le ronge, et dont le prince, dans sa bonté quasi christique, finira par s'occuper en dépit, là encore, de la perversité morale du quasi-moribond.
Et partout, partout, outre la Folie - comme ces "yeux", ceux de Rogojine ? ceux de Nastassia ? qu'il arrive au prince de voir ici et là, avant ses crises d'épilepsie qui commencent à réapparaître - la Culpabilité. Les personnages de Dostoievski se frappent la poitrine avec délice et implorent leur pardon avec volupté. Pardon de quoi ? de qui, surtout ? Cette culpabilité va bien au-delà d'un acte mauvais accompli dans la vie quotidienne : elle atteint une dimension universelle qui culminera dans "Les Frères Karamazov" dont l'écrivain russe est encore loin.
Est-ce celle que dut ressentir Dostoievski en apprenant que sa condamnation à mort, au temps de sa jeunesse, était commuée en exil, alors que lui-même estimait, consciemment ou non, ne pas être digne de cette grâce ? Mais pourquoi ? Car l'écrivain ne fut pas vraiment un comploteur dangereux. En ce cas, cette culpabilité serait largement antérieure à l'histoire de sa condamnation à mort ...
Et puis, en y réfléchissant, l'oeuvre tout entière ne repose-t-elle pas sur la culpabilité tapie au fond de l'être humain parce qu'y gisent aussi les pires instincts (voir le passage non édité à l'époque des "Démons" où Dostoievski évoque carrément la pédophilie) ? Dans "L'Idiot", dans "Crime & Châtiment" (où le meurtre, accompli pour des raisons soi-disant sociales, voire expérimentales, n'est ni plus ni moins que celui d'un psychopathe), dans "Les Démons" et, bien sûr, dans "Les Frères Karamazov", le Mal est toujours à l'arrière-plan, entraînant le péché qui doit, lui-même, amener la culpabilité et le châtiment. Mais le repentir, lui, étape ultime de la démarche, semble avoir au final peu d'importance, en tout cas pour un lecteur qui s'imagine - peut-être à tort, d'ailleurs - commencer à comprendre l'esprit oh ! combien tourmenté de Dostoievski. Or, nul ne l'ignore - un mystique comme l'écrivain russe moins que tout autre - le Repentir est tout, justement. Cependant, il semble, après la lecture de "L'Idiot", que la jouissance ne soit réservée qu'au crime et aux excès. L'auteur ne nie pas la nécessité du repentir - il la met dans un coin, c'est tout, et c'est comme s'il voulait l'oublier.
Provisoirement ou pour toujours ? ... ;o)
Идиот
Traduction : G. & G. Arout
Commentaires : Louis Martinez
ISBN : 9782253067085
... Mais qui est réellement l'Idiot ?
Drôle de question, n'est-ce pas, tant il est sûr et certain que l'Idiot en question ne peut être que le prince Lev Nikolaïevitch Muichkine, dont nous faisons la connaissance dès les premières pages du roman, dans un wagon de troisième classe, à bord d'un train qui le ramène à Pétersbourg, suite à un long exil en Suisse nécessité par sa santé.
Qu'ils l'appellent clairement "l'Idiot" ou se contentent de chuchoter poliment le mot lorsque l'incroyable franchise - pour ne pas parler de naïveté pure et simple - et le mysticisme quasi christique de nombre des réactions du prince les font sourire ou, ce qui est bien plus désagréable pour eux, les déstabilisent complètement, les autres personnages - et, comme toujours chez l'auteur, il y en a une belle flopée - n'en doutent pas. Pas même ceux qui apprécient sa bonté et sa générosité. La générale Elisabeth Prokofievna Epantchine, la seule et lointaine parente directe qu'il lui reste, femme elle-même au caractère atypique, impulsif et d'une très grande sensibilité, le considère au minimum comme bien "atteint" et frémit à l'idée qu'il puisse épouser un jour sa fille, Aglaé.
Dernier rejeton mâle de la très noble et très antique famille des princes Muichkine, Lev Nikolaïevitch a passé son enfance dans une sorte de torpeur. On le prit longtemps pour un attardé mais, bien sûr, on tenta, par tous les moyens, de redresser la barre. La méthode d'un médecin suisse, chez qui on l'expédia sans se soucier que ce fût le praticien lui-même - le Dr Scheider - intéressé par le cas qui s'offrait à lui, qui réglât les frais, parut obtenir d'excellents résultats. Peu à peu, les crises d'épilepsie s'estompèrent, le prince put parler, raisonner, étudier. Mais il restait timide et, en société, était capable de passer d'une aisance étrange à une sorte de paranoïa incompréhensible et se perdait parfois dans une sorte d'état second qu'on pouvait, il est vrai, voir comme une sorte de rêverie.
La société, bien sûr, surtout celle dans laquelle il est né, il ne la côtoie qu'à Petersbourg, après avoir renoué avec la famille Epantchine - la générale l'a pris en affection, il amuse plus ou moins ses filles et le général lui-même, d'abord surpris, croyant au début à l'imposture, est vite séduit par le jeune homme et son talent pour la calligraphie. Si sa santé s'est remise, la Fortune aussi lui fait les yeux doux et lui, qui avait quitté la Suisse habillé très simplement et sans guère d'argent, possède désormais, suite à une mesure de l'homme qui lui a servi en quelque sorte de tuteur, Pavlistchev, une fortune des plus honorables, d'un montant de 135 000 roubles. Une bagatelle face à l'ancienne puissance financière des Muichkine mais une bagatelle qui impressionne et permet de fermer les yeux sur certaines étrangetés du prince - lequel, au physique, est d'ailleurs plutôt séduisant, ce qui ne gâte rien.
En raison de l'ancienneté de son nom, de la réalité de son titre et de sa filiation, qu'on ne parvient pas à lui contester, et de sa fortune récente mais qui lui permet désormais de vivre selon son rang, Lev Nikolaïevitch, prince Muichkine, bien qu'il admette lui-même "ne pas être guéri", pourrait cependant vivre à Pétersbourg et, l'été, à Pskov, dans une relative tranquillité.
Mais le Destin, bien sûr, s'en est mêlé. Et dès lors même qu'il se trouvait encore dans le wagon de troisième classe qui le ramenait à Pétersbourg.
S'y trouvaient en effet également deux hommes, Parfione Simonovitch Rogojine, fils cadet d'une famille de riches marchands, qui, ayant appris la mort de son père, vient réclamer sa part d'héritage, et Loukian Timofeïevitch Lebedev, incroyable personnage purement "dostoievskien", ancien fonctionnaire devenu prêteur sur gages. C'est dans ce wagon où tous trois grelottent plus ou moins - surtout le prince, habillé, comme ricanent les deux autres "à la Suisse - que Muichkine entend parler pour la première fois de la passion vouée par Rogojine à Nastassia Philippovna, pupille devenue contre son gré la maîtresse du propriétaire pour lequel travaillait son père disparu et qui, longtemps entretenue par cet homme, Totski, lui a peu à peu rendu la vie si impossible en se révoltant contre lui qu'il en est venu à la décision de la marier au secrétaire du général Epantchine en personne, Gabriel Ardalionovitch Ivolguine, en dotant le jeune couple de la somme, à la fois ridicule (pour Nastassia) et énorme (pour Gania, qui appartient à une famille déchue) de 75 000 roubles.
Mais le retour de Rogojine, amoureux fou de Nastassia, va compromettre gravement l'affaire, d'autant que, introduit chez le général Epantchine pour tenter d'y rencontrer la femme de celui-ci, sa seule parente encore en vie, nous l'avons dit, Elisabeth Prokofievna, le prince Muichkine tombe sur le portrait de Nastassia, que celle-ci vient d'offrir à Gania, et qu'il tombe en même temps instantanément amoureux de cette femme d'une beauté rare certes mais sur le visage de laquelle il ne décerne - peut-être parce qu'il est "fou" ou "idiot", ou parce qu'il l'a été, ou parce qu'il le redeviendra - que l'intense douleur morale.
Comme d'habitude, j'ai pris la peine de lire deux fois de suite ce roman - il est très difficile, selon moi, de faire autrement si l'on veut saisir au mieux la pensée de Dostoievski. On retrouve bien sûr ici le tourbillon classique des personnages, procédé si cher à l'auteur, les intrigues qui s'entremêlent, les rencontres en principe improbables qui se font pourtant et obtiennent des résultats surprenants - ainsi Aglaé Ivanovna Epantchine, la dernière et la plus belle des filles de la générale, est-elle, oui ou non, amoureuse du prince ou ne fait-elle que se moquer de lui ? - mais ce que l'on finit par ressentir (enfin, je ne parle ici que pour moi et cela explique en partie la question que je posais au tout début de cette fiche), c'est que, chacun à sa manière, tous les personnages, à l'exception notable de quelques uns dont le prince Stch., sa fiancée, Adélaïde Epantchine, Barbara Ardalionovna Ivolguine (la soeur de Gabriel), et Ptitsine, son futur époux, semblent, à un moment ou un autre, pouvoir être taxés d'"idiots", au sens médical du terme. Parmi eux, Rogojine, meurtrier en puissance, en est sans doute l'exemple le plus frappant.
La relation qu'il entretient avec Nastassia Philippovna, relation pourtant recherchée à la folie par l'un et consentie avec une espèce de ferveur par l'autre, se fonde sur un sado-masochisme à la fois physique et psychique que Dostoievski traite avec délicatesse sans, pour autant, le laisser dans l'ombre. D'ailleurs, Nastassia est à coup sûr bel et bien amoureuse de Muichkine mais l'impuissance de celui-ci, suggérée par l'auteur mais jamais avouée, s'oppose à cette relation qui, pourtant, apaiserait l'âme tourmentée de la jeune femme. Autre trait marquant : la culpabilité ressentie par Nastassia (plus ou moins violée cependant jadis par Totski) et qu'elle tient à toutes forces à expier. Enfin, le comportement final d'Aglaé Ivanovna Epantchine, qui s'enfuit avec un escroc, n'est-il pas, après tout ce que nous avons vu de ses caprices et de ses sautes d'humeur tout au long du livre, le signe d'un déséquilibre après tout peut-être génétique et qui la relierait à "l'idiotie" du prince ?
Et comme si cela ne suffisait pas, on peut ajouter la perversité foncière de Ferdistchenko, ivrogne et locataire des Ivolguine, pique-assiette qui suit Rogojine et Nastassia dans tous leurs excès ; celle de Lebedev, ce fonctionnaire à la retraite et prêteur sur gages qui apparaît dès le premier chapitre, connaît tous les ragots de Pétersbourg, possède une villa à Pskov, et qui joue au général Ivolguine, par ailleurs buveur invétéré, militaire déchu et monomaniaque, un si mauvais tour que le malheureux finira par en avoir une attaque, puis une autre, celle-là mortelle.
Ivolguine lui-même, qui emprunte à tout-va non pour entretenir sa famille mais bel et bien pour une quadragénaire qu'il a pour maîtresse, présente lui aussi des points qui forcent à s'interroger sur son bon sens. L'alcool ne suffit pas à expliquer sa lâcheté, même si, certainement, son addiction l'aggrave.
Les envolées sociales, que l'on rencontre communément chez Dostoievski, sont moins nombreuses que d'habitude, peut-être parce que, le plus souvent, c'est Muichkine, l'Idiot disons officiel, qui est son porte-parole et que l'auteur perçoit ici le paradoxe. La slavophilie demeure par contre une cause ardemment défendue par l'écrivain, qui le fait fort habilement en opposant le prince à un groupe de pseudo-nihilistes, préfiguration des bolcheviks, qui tentent plus ou moins d'escroquer de l'argent à Muichkine qu'ils accusent d'avoir détourné l'héritage légué par son protecteur. Ils exhibent, pour ce faire, l'un de leurs camarades, Antipe Bourdovski, communément surnommé "le fils de Pavlistchev" bien avant l'apparition du prince, alors que, preuves à l'appui (acte de naissance, etc, etc ...), Bourdovski est bel et bien le fils de l'homme dont il porte le nom. Cela permet du coup à Dostoievski d'introduire le personnage d'Hippolyte Terentiev, carrément le meneur de la bande malgré la phtisie qui le ronge, et dont le prince, dans sa bonté quasi christique, finira par s'occuper en dépit, là encore, de la perversité morale du quasi-moribond.
Et partout, partout, outre la Folie - comme ces "yeux", ceux de Rogojine ? ceux de Nastassia ? qu'il arrive au prince de voir ici et là, avant ses crises d'épilepsie qui commencent à réapparaître - la Culpabilité. Les personnages de Dostoievski se frappent la poitrine avec délice et implorent leur pardon avec volupté. Pardon de quoi ? de qui, surtout ? Cette culpabilité va bien au-delà d'un acte mauvais accompli dans la vie quotidienne : elle atteint une dimension universelle qui culminera dans "Les Frères Karamazov" dont l'écrivain russe est encore loin.
Est-ce celle que dut ressentir Dostoievski en apprenant que sa condamnation à mort, au temps de sa jeunesse, était commuée en exil, alors que lui-même estimait, consciemment ou non, ne pas être digne de cette grâce ? Mais pourquoi ? Car l'écrivain ne fut pas vraiment un comploteur dangereux. En ce cas, cette culpabilité serait largement antérieure à l'histoire de sa condamnation à mort ...
Et puis, en y réfléchissant, l'oeuvre tout entière ne repose-t-elle pas sur la culpabilité tapie au fond de l'être humain parce qu'y gisent aussi les pires instincts (voir le passage non édité à l'époque des "Démons" où Dostoievski évoque carrément la pédophilie) ? Dans "L'Idiot", dans "Crime & Châtiment" (où le meurtre, accompli pour des raisons soi-disant sociales, voire expérimentales, n'est ni plus ni moins que celui d'un psychopathe), dans "Les Démons" et, bien sûr, dans "Les Frères Karamazov", le Mal est toujours à l'arrière-plan, entraînant le péché qui doit, lui-même, amener la culpabilité et le châtiment. Mais le repentir, lui, étape ultime de la démarche, semble avoir au final peu d'importance, en tout cas pour un lecteur qui s'imagine - peut-être à tort, d'ailleurs - commencer à comprendre l'esprit oh ! combien tourmenté de Dostoievski. Or, nul ne l'ignore - un mystique comme l'écrivain russe moins que tout autre - le Repentir est tout, justement. Cependant, il semble, après la lecture de "L'Idiot", que la jouissance ne soit réservée qu'au crime et aux excès. L'auteur ne nie pas la nécessité du repentir - il la met dans un coin, c'est tout, et c'est comme s'il voulait l'oublier.
Provisoirement ou pour toujours ? ... ;o)
Dostoïevski Fiodor (1821-1881) – "L'Idiot" – Gallimard/Livre de poche 1967 – 2 volumes – traduction d'Albert Mousset - préface de Raymond Abellio.
Lors d'une brocante de l'automne passé, j'étais tombé par hasard sur l'édition publiée en 1967 au «Livre de poche» par Gallimard, avec une préface de Raymond Abellio. Il se trouve que c'est précisément dans cette édition (de fort méchante qualité : petits caractères, papier jaunasse) que je m'étais acheté les deux tomes de ce roman lors de sa sortie, séduit par les deux couvertures. Je suppose que celle du tome 1 représente le prince Mychkine et celle du tome 2 sa fiancée Aglaia Ivanovna Epantchine, toujours est-il que ces images m'avaient bien plu.
J'avais quatorze quinze ans, je lisais (dévorais) couramment plusieurs gros romans du 19ème siècle par semaine, y compris la nuit (à la lampe de poche car les parents passaient éteindre ma lampe pour que je dorme), et l'histoire du trop gentil prince me plut énormément, bien que je me souvienne avoir éprouvé de la difficulté à m'y retrouver dans ces noms et prénoms russes aussi imprononçables que difficiles à mémoriser.
J'avais donc emporté ces deux volumes dans mes bagages et je les ai relus avec encore plus de plaisir (et d'admiration). Cette oeuvre est celle d'un écrivain dans sa maturité, ayant acquis une extraordinaire maîtrise de la narration, du croisement de personnages complexes, de la description de scènes mobilisant une foule de personnages etc.
Inutile d'épiloguer longuement en lieux communs, c'est sans aucun doute l'un des romans majeurs de la littérature du 19ème siècle. Dommage que je ne sache pas lire le russe : la traduction n'est pas mauvaise, mais on reste quand même sur l'impression d'une perte en saveur.
Excellent.
Lors d'une brocante de l'automne passé, j'étais tombé par hasard sur l'édition publiée en 1967 au «Livre de poche» par Gallimard, avec une préface de Raymond Abellio. Il se trouve que c'est précisément dans cette édition (de fort méchante qualité : petits caractères, papier jaunasse) que je m'étais acheté les deux tomes de ce roman lors de sa sortie, séduit par les deux couvertures. Je suppose que celle du tome 1 représente le prince Mychkine et celle du tome 2 sa fiancée Aglaia Ivanovna Epantchine, toujours est-il que ces images m'avaient bien plu.
J'avais quatorze quinze ans, je lisais (dévorais) couramment plusieurs gros romans du 19ème siècle par semaine, y compris la nuit (à la lampe de poche car les parents passaient éteindre ma lampe pour que je dorme), et l'histoire du trop gentil prince me plut énormément, bien que je me souvienne avoir éprouvé de la difficulté à m'y retrouver dans ces noms et prénoms russes aussi imprononçables que difficiles à mémoriser.
J'avais donc emporté ces deux volumes dans mes bagages et je les ai relus avec encore plus de plaisir (et d'admiration). Cette oeuvre est celle d'un écrivain dans sa maturité, ayant acquis une extraordinaire maîtrise de la narration, du croisement de personnages complexes, de la description de scènes mobilisant une foule de personnages etc.
Inutile d'épiloguer longuement en lieux communs, c'est sans aucun doute l'un des romans majeurs de la littérature du 19ème siècle. Dommage que je ne sache pas lire le russe : la traduction n'est pas mauvaise, mais on reste quand même sur l'impression d'une perte en saveur.
Excellent.
Relecture d'un classique lu il y a longtemps qui représente pour moi parfaitement l'esprit russe. Ou tout du moins l'esprit russe selon Dostoïevski. Je ne me lancerai pas dans un résumé détaillé car ce serait long et à mon sens assez inutile dans une "critique"...
Pour faire simple nous suivons le parcours du prince Muichkine, surnommé "l'Idiot", car il est fragilisé par son épilepsie. Personnage christique pas du tout habitué aux codes de la société bourgeoise de Saint-Petersbourg (il a passé son enfance en Suisse pour soigner son épilepsie), celui-ci va confronter son innocence au culte des apparences et aux intrigues amoureuses. Il va être le jouet des femmes - Nastassia Philippovna et Aglaé Epantchine- qui vont le faire souffrir par peur de le dénaturer.
La société russe est cruellement décrite et Dostoïevski n'a pas son pareil pour façonner des personnages puissants: la complexité maternelle d'Elisabeth Prokofievna, la folie pure de Parfione Rogojine, la faiblesse digne de compassion de Gania Ivolguine, la sénilité du général Ivolguine et ce peuple d'usuriers parfaitement symbolisé par Lebedev sont des caractères marquants.
Malgré quelques longueurs dispensables dans les troisième et quatrième parties, la tension est constante. J'apprécie tout particulièrement ces scènes fortes en dramaturgie qui reflètent la violence qui coule dans les veines du peuple russe. Que ce soit la visite de Nastassia Philippovna chez les Ivolguine, ou la soirée anniversaire de Nastassia Philippovna, ces moments touchent au sublime.
Pour faire simple nous suivons le parcours du prince Muichkine, surnommé "l'Idiot", car il est fragilisé par son épilepsie. Personnage christique pas du tout habitué aux codes de la société bourgeoise de Saint-Petersbourg (il a passé son enfance en Suisse pour soigner son épilepsie), celui-ci va confronter son innocence au culte des apparences et aux intrigues amoureuses. Il va être le jouet des femmes - Nastassia Philippovna et Aglaé Epantchine- qui vont le faire souffrir par peur de le dénaturer.
La société russe est cruellement décrite et Dostoïevski n'a pas son pareil pour façonner des personnages puissants: la complexité maternelle d'Elisabeth Prokofievna, la folie pure de Parfione Rogojine, la faiblesse digne de compassion de Gania Ivolguine, la sénilité du général Ivolguine et ce peuple d'usuriers parfaitement symbolisé par Lebedev sont des caractères marquants.
Malgré quelques longueurs dispensables dans les troisième et quatrième parties, la tension est constante. J'apprécie tout particulièrement ces scènes fortes en dramaturgie qui reflètent la violence qui coule dans les veines du peuple russe. Que ce soit la visite de Nastassia Philippovna chez les Ivolguine, ou la soirée anniversaire de Nastassia Philippovna, ces moments touchent au sublime.
Je ne sais pas vous, mais je trouve ça vraiment très marrant, l'idée de se mettre à son clavier, d'ouvrir son petit onglet et de se mettre à écrire une critique d'un énorme pavé représentant plus ou moins le sommet de la littérature russe du XIXème siècle, avec morgue et assurance.
C'est bien entendu ce que je m'apprête à (tenter de) faire, sous vos yeux (je l'espère) ébahis. Il sera encore mieux entendu qu'on part tous ensemble du principe qu'on se trouve là face un texte admirablement construit, très long, vraiment unique d'un point de vue stylistique, un peu long quand même, tout à fait passionnant, et beaucoup trop long sans que jamais ça ne soit vraiment dérangeant.
L'Idiot est un texte marquant par son génial taux d'ironie constante, sa capacité à se jouer de tout, des codes, de ses personnages, de son ton, de ses symboliques et de ses clichés, de juxtaposer en tous temps le grotesque et le grandiose. C'est parcouru d'histoires d'amour particulièrement tordues, de dîners mondains interrompus par des perturbations de toutes sortes (et toujours divertissantes), de longs dialogues torturés et particulièrement vivaces, d'analyses toujours éclairantes du comportement et des usages d'une certaine "haute classe moyenne" russe au XIXème siècle.
Le personnage de l'Idiot (un prince du nom de Mychkine) s'avère être un formidable outil romanesque, puisqu'il agit comme un déclencheur, une forme de révélateur sur lequel vont venir se frotter (pas littéralement, fort heureusement) l'ensemble des personnages de ce petit pavé. Au début du roman, le prince débarque en effet tout juste d'une clinique suisse où il vient de passer des années à (tenter de) soigner l'épilepsie qui lui gâche la vie depuis toujours, et redécouvre ainsi d'un coup les coutumes et les codes d'une société russe qu'il n'a plus fréquentée depuis bien longtemps. Seul, pauvre et globalement assez démuni, il se tourne vers une lointaine cousine avec pour vague projet de faire valoir auprès d'elle leur parenté et se faire prendre sous son aile le temps de trouver quoi faire de sa vie. C'est ainsi qu'il rencontre des cousines, de futurs potentiels alliés, d'autres individus avec lesquels il ne trouve au contraire aucun atome crochu, et surtout, surtout, la splendide Nastassia Filippovna, dont il tombe tout de suite passionnément amoureux et qui n'aura de cesse de, on peut le dire, le torturer émotionnellement.
C'est bien entendu très (très) bavard, et il n'est pas rare qu'on se perde un peu entre les océans de dialogues auxquels Dostoïevski nous introduit, mais on trouve toujours très vite de quoi se repérer à nouveau, qu'il s'agisse d'une scène particulièrement frappante, d'une tirade déchirante ou d'une simple pique ironique tout à fait savoureuse. L'intrigue fonctionne, avec juste ce qu'il faut de tension et juste ce qu'il faut d'évidence tragique, et laisse le lecteur avec tout juste ce qu'il faut de frustration et de mystère pour donner de l'amplitude à l'ensemble de tractations et autres péripéties auxquelles on vient d'assister.
L'atmosphère est très particulière, l'écriture très hachée, les dialogues intenses, l'action resserrée sur une durée assez restreinte, on est bien loin d'un roman contemplatif. Non, ici, ce qui intéresse Dostoïevski, ce sont les contradictions humaines, l'amour et combien on en fait n'importe quoi, la loyauté, l'honneur, l'intégrité, toutes ces valeurs qu'on brandit vite et dont on a vite fait de se détourner. C'est surtout la possibilité même du bien qui l'obsède, la façon dont toute personne pourvue d'un tant soit peu de bonté semble condamnée à être manipulée ou bien à devenir tout simplement le dindon de la farce, et l'existence même d'une possibilité de survivre à cette vaste supercherie qu'est la vie en société. C'est très cruel sans être indigeste, trop long certes mais tellement rythmé qu'on se laisse malgré tout emporter, et on en ressort un peu sonné, comme imprégné dans cette plume à la fois très particulière et très "transparente". Bref, sans doute ce qu'on peut appeler un sacré roman russe.
Lien : https://mademoisellebouquine..
C'est bien entendu ce que je m'apprête à (tenter de) faire, sous vos yeux (je l'espère) ébahis. Il sera encore mieux entendu qu'on part tous ensemble du principe qu'on se trouve là face un texte admirablement construit, très long, vraiment unique d'un point de vue stylistique, un peu long quand même, tout à fait passionnant, et beaucoup trop long sans que jamais ça ne soit vraiment dérangeant.
L'Idiot est un texte marquant par son génial taux d'ironie constante, sa capacité à se jouer de tout, des codes, de ses personnages, de son ton, de ses symboliques et de ses clichés, de juxtaposer en tous temps le grotesque et le grandiose. C'est parcouru d'histoires d'amour particulièrement tordues, de dîners mondains interrompus par des perturbations de toutes sortes (et toujours divertissantes), de longs dialogues torturés et particulièrement vivaces, d'analyses toujours éclairantes du comportement et des usages d'une certaine "haute classe moyenne" russe au XIXème siècle.
Le personnage de l'Idiot (un prince du nom de Mychkine) s'avère être un formidable outil romanesque, puisqu'il agit comme un déclencheur, une forme de révélateur sur lequel vont venir se frotter (pas littéralement, fort heureusement) l'ensemble des personnages de ce petit pavé. Au début du roman, le prince débarque en effet tout juste d'une clinique suisse où il vient de passer des années à (tenter de) soigner l'épilepsie qui lui gâche la vie depuis toujours, et redécouvre ainsi d'un coup les coutumes et les codes d'une société russe qu'il n'a plus fréquentée depuis bien longtemps. Seul, pauvre et globalement assez démuni, il se tourne vers une lointaine cousine avec pour vague projet de faire valoir auprès d'elle leur parenté et se faire prendre sous son aile le temps de trouver quoi faire de sa vie. C'est ainsi qu'il rencontre des cousines, de futurs potentiels alliés, d'autres individus avec lesquels il ne trouve au contraire aucun atome crochu, et surtout, surtout, la splendide Nastassia Filippovna, dont il tombe tout de suite passionnément amoureux et qui n'aura de cesse de, on peut le dire, le torturer émotionnellement.
C'est bien entendu très (très) bavard, et il n'est pas rare qu'on se perde un peu entre les océans de dialogues auxquels Dostoïevski nous introduit, mais on trouve toujours très vite de quoi se repérer à nouveau, qu'il s'agisse d'une scène particulièrement frappante, d'une tirade déchirante ou d'une simple pique ironique tout à fait savoureuse. L'intrigue fonctionne, avec juste ce qu'il faut de tension et juste ce qu'il faut d'évidence tragique, et laisse le lecteur avec tout juste ce qu'il faut de frustration et de mystère pour donner de l'amplitude à l'ensemble de tractations et autres péripéties auxquelles on vient d'assister.
L'atmosphère est très particulière, l'écriture très hachée, les dialogues intenses, l'action resserrée sur une durée assez restreinte, on est bien loin d'un roman contemplatif. Non, ici, ce qui intéresse Dostoïevski, ce sont les contradictions humaines, l'amour et combien on en fait n'importe quoi, la loyauté, l'honneur, l'intégrité, toutes ces valeurs qu'on brandit vite et dont on a vite fait de se détourner. C'est surtout la possibilité même du bien qui l'obsède, la façon dont toute personne pourvue d'un tant soit peu de bonté semble condamnée à être manipulée ou bien à devenir tout simplement le dindon de la farce, et l'existence même d'une possibilité de survivre à cette vaste supercherie qu'est la vie en société. C'est très cruel sans être indigeste, trop long certes mais tellement rythmé qu'on se laisse malgré tout emporter, et on en ressort un peu sonné, comme imprégné dans cette plume à la fois très particulière et très "transparente". Bref, sans doute ce qu'on peut appeler un sacré roman russe.
Lien : https://mademoisellebouquine..
Trois inconnus se retrouvent dans le même wagon d'un train se dirigeant vers St Pétersbourg. Ces trois hommes vont faire connaissance durant leur trajet. Leurs vies seront inextricablement liées à partir de cet instant : le prince Mychkine, Parfione Semionovitch Rogojine, un jeune marchand, et Lebedev un petit fonctionnaire. le prince revient d'un long séjour en Suisse où il soignait son épilepsie. de retour en Russie, il va prendre contact avec le général Epantchine dont la femme serait de sa famille. Lors de son voyage en train et de sa visite chez le général, Mychkine entend parler d'une jeune femme d'une beauté extraordinaire : Nastassia Filippovna. le soir même, elle organise une soirée pour son anniversaire. le prince Mychkine la rencontre alors et en tombe amoureux. Mais il n'est pas le seul : Gania Yvolguine, le secrétaire du général, veut l'épouser, Rogojine veut l'acheter cent mille roubles, le général aimerait l'avoir comme maîtresse. Les choix de Nastassia Filippovna scelleront les destinées des autres personnages.
« L'idiot » est un immense roman, extrêmement dense et fourmillant de personnages. Il y a tout d'abord le quatuor central dont je reparlerai : le prince Mychkine, Rogojine, Nastassia Filippovna et Aglaïa Ivanovna Epantchine. Et autour d'eux, une myriade de personnages secondaires se déploie. Je tiens à préciser que l'on ne s'y perd pas car les personnages secondaires existent complètement, ce ne sont pas simplement des ombres évoluant autour des héros. Ils ont tous une voix bien déterminée et à ce titre on peut parler de roman choral. C'est d'autant plus vrai que les dialogues sont nombreux. Il y a beaucoup de scènes de groupe où les discussions sont passionnées. Elles se finissent très souvent par l'éclat d'un personnage, par un paroxysme dans son exaltation. Les thématiques abordées, lors de ces rencontres, sont très variées. Mais ce qui en ressort c'est une critique de la société russe. Dostoïevski constate un nihilisme grandissant parmi ses contemporains (c'est ce que reprochait également Lermontov à son héros Petchorine). Lui, le grand croyant, ne peut que déplorer cet abaissement de la spiritualité du peuple russe.
Revenons au coeur du livre, au quatuor amoureux et à celui autour de qui tout ce petit monde tourne : le prince Lev Nicolaevitch Mychkine. Pour Dostoïevski, il est l'image du Christ, un messie épileptique qui va semer le chaos autour de lui. Mychkine est en effet un être pur, humble, naïf, pardonnant à tous. D'où l'impression qu'il peut donner aux autres d'être un idiot alors qu'il s'agit de grandeur d'âme. Celle qui le définit le mieux est Aglaïa : « - Ici, il n'y a personne qui soit digne de ces paroles ! éclatait Aglaïa. Ici, personne, personne ne vaut même votre petit doigt, ni votre intelligence, ni votre coeur ! Vous êtes plus honnête que tous les autres, plus noble, vous êtes meilleur, vous êtes plus gentil, vous êtes plus intelligent ! Ici il y a des gens qui sont indignes de se baisser pour ramasser ce mouchoir que vous venez de faire tomber… Pourquoi vous humiliez-vous donc, pourquoi vous placez-vous plus bas que tous les autres ? Pourquoi avez-vous donc dénaturé ce que vous avez en vous, pourquoi n'avez-vous donc aucune fierté ? »
Face au prince, Rogojine est son double sombre, aussi brun que Mychkine est blond, aussi voyou que le prince est honnête. Les deux hommes se déchirent pour la même femme, la sublime Nastassia Filippovna. C'est l'âme perdue du roman. Rogojine veut la posséder, allant donc jusqu'à l'acheter. Mychkine veut la sauver. Il a de la compassion pour elle, même s'il pense qu'elle est folle et qu'il a peur de son visage. Nastassia aime le prince mais elle refuse de causer sa perte en l'épousant. Son admiration pour lui l'amène à se sacrifier. Au milieu de ce trio se trouve Aglaïa, la fille du général Epantchine. Double de Nastassia, elle est elle-même amoureuse du prince tout en refusant de l'admettre. L'incandescence de leurs sentiments, leurs revirements ne peuvent que les conduire à la tragédie.
L'écriture de Dostoïevski, au rythme épileptique et à l'oralité forte, transcrit magistralement l'exacerbation des sentiments, l'excès si russe des personnages. J'ai été happée par le flux de mots et la puissante incarnation des personnages. Mychkine, à l'instar de Raskolnikov, reste un personnage inoubliable.
Lien : http://plaisirsacultiver.wor..
« L'idiot » est un immense roman, extrêmement dense et fourmillant de personnages. Il y a tout d'abord le quatuor central dont je reparlerai : le prince Mychkine, Rogojine, Nastassia Filippovna et Aglaïa Ivanovna Epantchine. Et autour d'eux, une myriade de personnages secondaires se déploie. Je tiens à préciser que l'on ne s'y perd pas car les personnages secondaires existent complètement, ce ne sont pas simplement des ombres évoluant autour des héros. Ils ont tous une voix bien déterminée et à ce titre on peut parler de roman choral. C'est d'autant plus vrai que les dialogues sont nombreux. Il y a beaucoup de scènes de groupe où les discussions sont passionnées. Elles se finissent très souvent par l'éclat d'un personnage, par un paroxysme dans son exaltation. Les thématiques abordées, lors de ces rencontres, sont très variées. Mais ce qui en ressort c'est une critique de la société russe. Dostoïevski constate un nihilisme grandissant parmi ses contemporains (c'est ce que reprochait également Lermontov à son héros Petchorine). Lui, le grand croyant, ne peut que déplorer cet abaissement de la spiritualité du peuple russe.
Revenons au coeur du livre, au quatuor amoureux et à celui autour de qui tout ce petit monde tourne : le prince Lev Nicolaevitch Mychkine. Pour Dostoïevski, il est l'image du Christ, un messie épileptique qui va semer le chaos autour de lui. Mychkine est en effet un être pur, humble, naïf, pardonnant à tous. D'où l'impression qu'il peut donner aux autres d'être un idiot alors qu'il s'agit de grandeur d'âme. Celle qui le définit le mieux est Aglaïa : « - Ici, il n'y a personne qui soit digne de ces paroles ! éclatait Aglaïa. Ici, personne, personne ne vaut même votre petit doigt, ni votre intelligence, ni votre coeur ! Vous êtes plus honnête que tous les autres, plus noble, vous êtes meilleur, vous êtes plus gentil, vous êtes plus intelligent ! Ici il y a des gens qui sont indignes de se baisser pour ramasser ce mouchoir que vous venez de faire tomber… Pourquoi vous humiliez-vous donc, pourquoi vous placez-vous plus bas que tous les autres ? Pourquoi avez-vous donc dénaturé ce que vous avez en vous, pourquoi n'avez-vous donc aucune fierté ? »
Face au prince, Rogojine est son double sombre, aussi brun que Mychkine est blond, aussi voyou que le prince est honnête. Les deux hommes se déchirent pour la même femme, la sublime Nastassia Filippovna. C'est l'âme perdue du roman. Rogojine veut la posséder, allant donc jusqu'à l'acheter. Mychkine veut la sauver. Il a de la compassion pour elle, même s'il pense qu'elle est folle et qu'il a peur de son visage. Nastassia aime le prince mais elle refuse de causer sa perte en l'épousant. Son admiration pour lui l'amène à se sacrifier. Au milieu de ce trio se trouve Aglaïa, la fille du général Epantchine. Double de Nastassia, elle est elle-même amoureuse du prince tout en refusant de l'admettre. L'incandescence de leurs sentiments, leurs revirements ne peuvent que les conduire à la tragédie.
L'écriture de Dostoïevski, au rythme épileptique et à l'oralité forte, transcrit magistralement l'exacerbation des sentiments, l'excès si russe des personnages. J'ai été happée par le flux de mots et la puissante incarnation des personnages. Mychkine, à l'instar de Raskolnikov, reste un personnage inoubliable.
Lien : http://plaisirsacultiver.wor..
Je garde un excellent souvenir de ce roman de Dostoïevski lu il y a quelques années...
Le livre m'avait marqué par la multitude de ses personnages tous peints avec détail et par l'intrigue passionnante qui nous faisait découvrir la société Russe des Tsars et des princes.
Et j'en étais arrivé finalement à la conclusion que comme souvent, l'idiot n'est pas toujours celui qu'on croit.
Une très bonne lecture que je conseille vivement,
Et l'évoquer me donne d'ailleurs l'envie de me plonger dans d'autres oeuvres de l'auteur
Le livre m'avait marqué par la multitude de ses personnages tous peints avec détail et par l'intrigue passionnante qui nous faisait découvrir la société Russe des Tsars et des princes.
Et j'en étais arrivé finalement à la conclusion que comme souvent, l'idiot n'est pas toujours celui qu'on croit.
Une très bonne lecture que je conseille vivement,
Et l'évoquer me donne d'ailleurs l'envie de me plonger dans d'autres oeuvres de l'auteur
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Fiodor Dostoïevski (142)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Idiot
Qui est le héros du récit ?
Le Prince Mychkine
Rogojine
Lebedev
Le Roi Mychkine
10 questions
52 lecteurs ont répondu
Thème : L'Idiot de
Fiodor DostoïevskiCréer un quiz sur ce livre52 lecteurs ont répondu