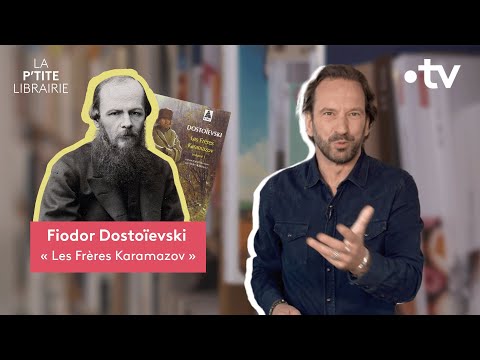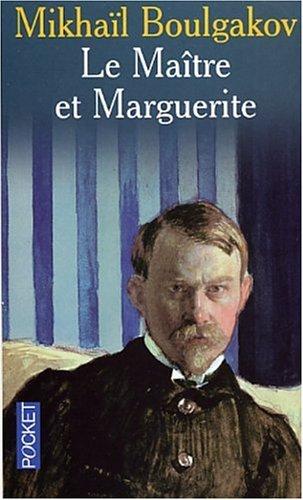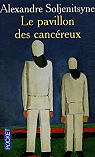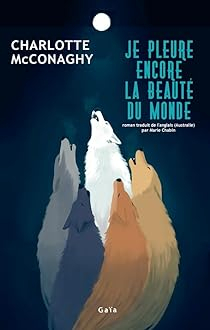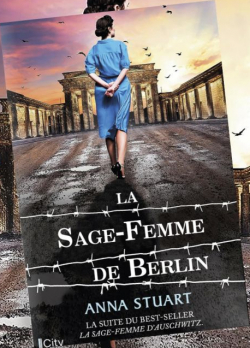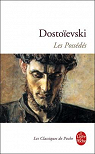Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quel est le plus impressionnant des romans russes ? Un roman-fleuve, une dinguerie sublime qui met en scène quatre frères qui sont surtout quatre fils, autour d'un père détesté et détestable ?
« Les frères Karamazov » , de Dostoïevski, c'est à lire en poche chez Actes Sud Babel.

Fiodor Dostoïevski/5
2523 notes
Résumé :
Dernier grand roman de F. M. Dostoïevski (1821-1881) Les Frères Karamazov paraissent en revue de 1879 à 1880 dans Le Messager russe. À mesure des livraisons, le succès va grandissant, renforcé par les lectures qu'en donne l'écrivain aux soirées littéraires du moins dans le public car la presse réagit en fonction de ses convictions démocrates ou conservatrices. Les attentats terroristes se multiplient, les pendaisons aussi. L'empereur Alexandre II est déjà condamné p... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les Frères KaramazovVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (159)
Voir plus
Ajouter une critique
Dostoïevski a écrit son meilleur roman en dernier et il en était parfaitement conscient.
Les Frères Karamazov sont un véritable drame spirituel où il reprend génialement tous les problèmes qui hantent son oeuvre. Dostoïevski y explore en effet tous ses thèmes favoris, en projetant les unes contre les autres diverses perspectives existentielles concernant la foi, la rationalité, le bien et le mal, le rapport au religieux ou a l'athéisme, etc.
Le chapitre intitulé « le Grand Inquisiteur » est un chef d'oeuvre littéraire, philosophique, moral et religieux en soi. Il s'agit d'un conte philosophique rempli d'ironie fait par Ivan à son frère Aliocha pour lui présenter la question de la responsabilité de l'humain envers le divin. Jésus s'y fait reprocher par un inquisiteur espagnol à la Renaissance de nuire à l'Église et de rendre malheureuse l'humanité. En refusant l'omnipuissance, Jésus surestimerait l'humanité en lui laissant une liberté dont cette dernière serait indigne et qu'elle ne saurait utiliser. L'inquisiteur croit que l'Église toute-puissante permet de palier à ce manque de jugement commis par Jésus en enlevant cette liberté à l'humanité de manière à lui rendre son bonheur rendu impossible par son divin fondateur.
Une autre idée forte que l'on trouve dans le roman, c'est la conclusion que, si Dieu n'existe pas, l'humanité est livrée à elle-même dans l'amoralité la plus totale. Cette pensée n'a rien d'originale puisqu'on la trouve déjà chez Paul dans le Nouveau Testament : « Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » (1 Cor 15, 37), mais elle est explorée de manière très marquante par Dostoïevski, qui aborde les travers d'une vie purement matérielle aux désirs infinis condamnée à l'insatisfaction sans repos.
La croyance en Dieu permettant, au contraire, exactement comme dans la Critique de la raison pratique de Kant, d'ouvrir la possibilité d'une existence morale digne de ce nom et une espérance permettant de vivre dans la sérénité.
Dostoïevski prévoyait une suite dans les derniers mois de sa vie, l'action aurait repris vingt années plus tard. Peut-être l'a-t-il écrit au Paradis? Si Dieu existe, peut-être aurons nous l'occasion de la lire dans l'autre monde...
Les Frères Karamazov sont un véritable drame spirituel où il reprend génialement tous les problèmes qui hantent son oeuvre. Dostoïevski y explore en effet tous ses thèmes favoris, en projetant les unes contre les autres diverses perspectives existentielles concernant la foi, la rationalité, le bien et le mal, le rapport au religieux ou a l'athéisme, etc.
Le chapitre intitulé « le Grand Inquisiteur » est un chef d'oeuvre littéraire, philosophique, moral et religieux en soi. Il s'agit d'un conte philosophique rempli d'ironie fait par Ivan à son frère Aliocha pour lui présenter la question de la responsabilité de l'humain envers le divin. Jésus s'y fait reprocher par un inquisiteur espagnol à la Renaissance de nuire à l'Église et de rendre malheureuse l'humanité. En refusant l'omnipuissance, Jésus surestimerait l'humanité en lui laissant une liberté dont cette dernière serait indigne et qu'elle ne saurait utiliser. L'inquisiteur croit que l'Église toute-puissante permet de palier à ce manque de jugement commis par Jésus en enlevant cette liberté à l'humanité de manière à lui rendre son bonheur rendu impossible par son divin fondateur.
Une autre idée forte que l'on trouve dans le roman, c'est la conclusion que, si Dieu n'existe pas, l'humanité est livrée à elle-même dans l'amoralité la plus totale. Cette pensée n'a rien d'originale puisqu'on la trouve déjà chez Paul dans le Nouveau Testament : « Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » (1 Cor 15, 37), mais elle est explorée de manière très marquante par Dostoïevski, qui aborde les travers d'une vie purement matérielle aux désirs infinis condamnée à l'insatisfaction sans repos.
La croyance en Dieu permettant, au contraire, exactement comme dans la Critique de la raison pratique de Kant, d'ouvrir la possibilité d'une existence morale digne de ce nom et une espérance permettant de vivre dans la sérénité.
Dostoïevski prévoyait une suite dans les derniers mois de sa vie, l'action aurait repris vingt années plus tard. Peut-être l'a-t-il écrit au Paradis? Si Dieu existe, peut-être aurons nous l'occasion de la lire dans l'autre monde...
Tuer le père en trois leçons.
Après les écrits de Freud, Camus et Zweig sur ce roman, il était important qu'ODP vienne un peu baisser le niveau.
Le psy rêveur à barbe a qualifié l'auteur des Frères Karamazov de névrosé, bisexuel refoulé épileptique dans une préface dont j'ai compris une phrase sur trois. le copain de Sartre et des platanes (désolé) a de son côté (passager) puisé dans ce monument de 950 pages la genèse de « l'Homme révolté », celui qui dit toujours non. Enfin, le grand biographe des vedettes à ombrelles (et éventails) ou rouflaquettes sortait de chez Jardiland quand il compara sans emphase les personnages Dostoïevski à « des géants de la forêt, bruissants et vivants, dont les cimes touchent le ciel, tandis que par des milliers de filaments nerveux ils prennent racine dans le sol de l'épopée et que leur réseau sanguin se ramifie à travers des milliers de pages ». Il avait la chlorophylle poétique entre deux nouvelles de héros suicidés. Avec son meurtre aux circonstances mystérieuses, son enquête et son procès théâtralisé, Les Frères Karamazov suit la trame d'un roman policier. Fiodor Karamazov, la victime, n'a pas volé son sort d'homicidé. Être détestable, il a plumé et rendu folles ses deux épouses et il n'a pas une once d'affection pour ses trois fils : Aliocha (ou Alexis selon les pages), le benjamin, le saint du roman qui consacre sa vie à la religion et à répandre le bien autour de lui, le cadet Dimitri (Mitia pour les intimes), fêtard romantique, panier percé en dette d'affection et Ivan, aîné cultivé qui cultive son nihilisme. Cette progéniture légitime, complétée par un bâtard envieux et épileptique, au nom de bousin, Smerdiakov, a toutes les raisons d'hâter la succession. Dimitri ne cache pas sa détestation pour ce vieux qui lui refuse sa part d'héritage et qui convoite l'élue de son coeur ardent.
Si ce roman est un monument de la littérature, c'est qu'il explore avec génie les questions existentielles de tous ses personnages autour de la foi, de la liberté, du mal et du libre-arbitre (non, pas celui qui fait appel à la VAR, amis footeux).
Certains passages, et notamment celui consacré au poème d'Ivan, « le Grand Inquisiteur », sont incandescents et inflammables. Je vous le résume à ma sauce. La foi reposant sur la liberté de croire sans preuve, la résurrection du Christ tant attendue survient à Séville en pleine inquisition, barbecues d'infidèles et planchas de fornicateurs. Après quelques miracles recyclés des évangiles, le Grand Inquisiteur décide de brûler l'ancien crucifié (pas étonnant qu'il se fasse attendre quand on voit comme il est reçu !) en toute connaissance de cause, pour qu'il ne prive pas l'homme du doute, de l'espoir et de la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Sans Dieu, il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal. Avec, comment lui pardonner nos souffrances et accepter la justice des hommes ? Les absents n'ont pas toujours tort.
J'ai bien mis deux cents pages et une bonne partie de mes fêtes de fin d'année à rentrer dans le roman tant les digressions morales et la présentation des personnages m'ont parfois demandé une endurance de moine copiste, dont j'ai déjà hélas la coupe, et une patience de pêcheur face à mon impatience de pécheur. La suite du roman est une expérience de lecture assez unique par la richesse des personnages et des dialogues qui portent la narration à un niveau de quasi perfection.
Dernier roman de Dostoïevski, auteur avec qui il ne faut pas compter ses heures, il ne me reste plus qu'à remonter le temps de sa bibliographie.
Incontournable.
Après les écrits de Freud, Camus et Zweig sur ce roman, il était important qu'ODP vienne un peu baisser le niveau.
Le psy rêveur à barbe a qualifié l'auteur des Frères Karamazov de névrosé, bisexuel refoulé épileptique dans une préface dont j'ai compris une phrase sur trois. le copain de Sartre et des platanes (désolé) a de son côté (passager) puisé dans ce monument de 950 pages la genèse de « l'Homme révolté », celui qui dit toujours non. Enfin, le grand biographe des vedettes à ombrelles (et éventails) ou rouflaquettes sortait de chez Jardiland quand il compara sans emphase les personnages Dostoïevski à « des géants de la forêt, bruissants et vivants, dont les cimes touchent le ciel, tandis que par des milliers de filaments nerveux ils prennent racine dans le sol de l'épopée et que leur réseau sanguin se ramifie à travers des milliers de pages ». Il avait la chlorophylle poétique entre deux nouvelles de héros suicidés. Avec son meurtre aux circonstances mystérieuses, son enquête et son procès théâtralisé, Les Frères Karamazov suit la trame d'un roman policier. Fiodor Karamazov, la victime, n'a pas volé son sort d'homicidé. Être détestable, il a plumé et rendu folles ses deux épouses et il n'a pas une once d'affection pour ses trois fils : Aliocha (ou Alexis selon les pages), le benjamin, le saint du roman qui consacre sa vie à la religion et à répandre le bien autour de lui, le cadet Dimitri (Mitia pour les intimes), fêtard romantique, panier percé en dette d'affection et Ivan, aîné cultivé qui cultive son nihilisme. Cette progéniture légitime, complétée par un bâtard envieux et épileptique, au nom de bousin, Smerdiakov, a toutes les raisons d'hâter la succession. Dimitri ne cache pas sa détestation pour ce vieux qui lui refuse sa part d'héritage et qui convoite l'élue de son coeur ardent.
Si ce roman est un monument de la littérature, c'est qu'il explore avec génie les questions existentielles de tous ses personnages autour de la foi, de la liberté, du mal et du libre-arbitre (non, pas celui qui fait appel à la VAR, amis footeux).
Certains passages, et notamment celui consacré au poème d'Ivan, « le Grand Inquisiteur », sont incandescents et inflammables. Je vous le résume à ma sauce. La foi reposant sur la liberté de croire sans preuve, la résurrection du Christ tant attendue survient à Séville en pleine inquisition, barbecues d'infidèles et planchas de fornicateurs. Après quelques miracles recyclés des évangiles, le Grand Inquisiteur décide de brûler l'ancien crucifié (pas étonnant qu'il se fasse attendre quand on voit comme il est reçu !) en toute connaissance de cause, pour qu'il ne prive pas l'homme du doute, de l'espoir et de la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Sans Dieu, il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal. Avec, comment lui pardonner nos souffrances et accepter la justice des hommes ? Les absents n'ont pas toujours tort.
J'ai bien mis deux cents pages et une bonne partie de mes fêtes de fin d'année à rentrer dans le roman tant les digressions morales et la présentation des personnages m'ont parfois demandé une endurance de moine copiste, dont j'ai déjà hélas la coupe, et une patience de pêcheur face à mon impatience de pécheur. La suite du roman est une expérience de lecture assez unique par la richesse des personnages et des dialogues qui portent la narration à un niveau de quasi perfection.
Dernier roman de Dostoïevski, auteur avec qui il ne faut pas compter ses heures, il ne me reste plus qu'à remonter le temps de sa bibliographie.
Incontournable.
Dostoïevski achève et publie Les Frères Karamazov en 1880, quelques mois avant sa mort. La Russie connaît alors son apogée territoriale, mais se trouve écartelée entre une volonté de modernité soutenue par le Tsar Alexandre II et par les intellectuels, au rang desquels Dostoïevski et Tolstoï, et des fondements archaïques reposant sur le servage des moujiks.
Ayant connu dansa jeunesse, la Sibérie et le bagne du fait de ses idées progressistes, Dostoïevski est, à la fin de sa vie, ayant acquis notoriété et sécurité matérielle, un nationaliste russe convaincu, attaché à la monarchie et à l'église, fondements de son pays, contre les dévoiements qu'il a pu observer durant ses années d'errance en Europe Occidentale. Cet homme n'est plus le Joueur, ni même le Raskolnikov en quête d'exception de 1866, et il est certain qu'il écrit là son "chef" d' "oeuvre", au sens propre.
Paradoxalement, l'ayant lu il y a quelques années, j'avais fini par mélanger les personnages entre eux et l'histoire se confondait avec celle de Crimes et Châtiments, et d'autres romans, alors que le Joueur par exemple, premier roman lu de lui, se détache toujours clairement.
Faux paradoxe en fait, car cela s'explique très bien par le style inimitable de Dostoïevski : Les Frères Karamazov sont des personnages archétypes ne cessant de s'opposer et se rapprocher, souvent par paires, dans une démarche dialectique visant en fait à analyser l'âme humaine -ou l'âme russe- dans toutes ses facettes et contradictions. Dostoïevski nous restitue ainsi une fresque romanesque, mais surtout tout un monde, digne de la meilleure fantasy, ou de Zola et Balzac, sauf que l'action ou la société ne sont pas au coeur du récit ; ce sont les transports de l'âme que met à nu Dostoïevski. Ses personnages sont en perpétuel mouvement intérieur, totalement déconstruits, et souvent dans l'outrance. Les nihilistes ou les grandes spiritualités ne trouveraient sans doute rien à redire à cette vision de la condition humaine : l'homme, en dehors du monde spirituel, chez Dostoïevski, erre dans le néant, n'est qu'une planche de bois ballotée par l'océan.
En fait, l'élément qui redonne cohérence au récit de Dostoïevski -bien qu'il puisse être lu et relu à différents niveaux de lecture- est sans doute sa réflexion philosophique permanente.
On ne s'ennuie pas en le lisant. Ses dialogues sont riches et variés, par leurs thèmes et leur style moderne. Le scénario est riche, construit autour de l'énigme (quasi policière) d'un parricide, et des sentiments complexes et flottants entre personnages. Il y a aussi de la tragédie Shakespearienne chez Dostoïevski.
Mais ses dialogues et rebondissements, pour moi, ne sont que prétexte, et sans doute est-ce pourquoi je les avais partiellement oubliés. le questionnement de Dostoïevski, et c'est ce qui marque le lecteur à mon sens, plane en permanence sur la scène des hommes ; et il y participe parfois -tel les dieux homériques- par un commentaire de leurs actes et pensées.
Pour autant, cette pensée omnipotente reste questionnement plus que science, et des philosophes aussi différents que Nietzche, Camus et Freud ont pu s'inspirer de lui pour des conclusions toutes différentes. Contrairement à Tolstoï, à la fois plus terrien et mystique convaincu, Dostoïevski continue de plâner dans un doute aérien, ne tranche rien. Il n'est pas étonnant qu'il ait séduit le père de la psychanalyse. Dostoïevski, faisant taire ses propres inquiétudes, est un analyste des passions humaines, dont il observe de manière quasi-scientifique tel ou tel impact sur les êtres et les rapports humains.
Pour finir, nous avons donc là un très grand livre -dont le nombre de pages ne doit pas rebuter : il se lit d'un traite dès que l'on est pris par le souffle de son auteur, comme dans un Victor Hugo-, plein d'une sagesse incertaine -qu'on retrouve chez Camus par exemple-.
Je n'aurai qu'un seul regret : que mon baluchon pour l'île déserte babeliesque soit trop étroit pour y caler mes deux tomes des Frères Karamazov.
Ayant connu dansa jeunesse, la Sibérie et le bagne du fait de ses idées progressistes, Dostoïevski est, à la fin de sa vie, ayant acquis notoriété et sécurité matérielle, un nationaliste russe convaincu, attaché à la monarchie et à l'église, fondements de son pays, contre les dévoiements qu'il a pu observer durant ses années d'errance en Europe Occidentale. Cet homme n'est plus le Joueur, ni même le Raskolnikov en quête d'exception de 1866, et il est certain qu'il écrit là son "chef" d' "oeuvre", au sens propre.
Paradoxalement, l'ayant lu il y a quelques années, j'avais fini par mélanger les personnages entre eux et l'histoire se confondait avec celle de Crimes et Châtiments, et d'autres romans, alors que le Joueur par exemple, premier roman lu de lui, se détache toujours clairement.
Faux paradoxe en fait, car cela s'explique très bien par le style inimitable de Dostoïevski : Les Frères Karamazov sont des personnages archétypes ne cessant de s'opposer et se rapprocher, souvent par paires, dans une démarche dialectique visant en fait à analyser l'âme humaine -ou l'âme russe- dans toutes ses facettes et contradictions. Dostoïevski nous restitue ainsi une fresque romanesque, mais surtout tout un monde, digne de la meilleure fantasy, ou de Zola et Balzac, sauf que l'action ou la société ne sont pas au coeur du récit ; ce sont les transports de l'âme que met à nu Dostoïevski. Ses personnages sont en perpétuel mouvement intérieur, totalement déconstruits, et souvent dans l'outrance. Les nihilistes ou les grandes spiritualités ne trouveraient sans doute rien à redire à cette vision de la condition humaine : l'homme, en dehors du monde spirituel, chez Dostoïevski, erre dans le néant, n'est qu'une planche de bois ballotée par l'océan.
En fait, l'élément qui redonne cohérence au récit de Dostoïevski -bien qu'il puisse être lu et relu à différents niveaux de lecture- est sans doute sa réflexion philosophique permanente.
On ne s'ennuie pas en le lisant. Ses dialogues sont riches et variés, par leurs thèmes et leur style moderne. Le scénario est riche, construit autour de l'énigme (quasi policière) d'un parricide, et des sentiments complexes et flottants entre personnages. Il y a aussi de la tragédie Shakespearienne chez Dostoïevski.
Mais ses dialogues et rebondissements, pour moi, ne sont que prétexte, et sans doute est-ce pourquoi je les avais partiellement oubliés. le questionnement de Dostoïevski, et c'est ce qui marque le lecteur à mon sens, plane en permanence sur la scène des hommes ; et il y participe parfois -tel les dieux homériques- par un commentaire de leurs actes et pensées.
Pour autant, cette pensée omnipotente reste questionnement plus que science, et des philosophes aussi différents que Nietzche, Camus et Freud ont pu s'inspirer de lui pour des conclusions toutes différentes. Contrairement à Tolstoï, à la fois plus terrien et mystique convaincu, Dostoïevski continue de plâner dans un doute aérien, ne tranche rien. Il n'est pas étonnant qu'il ait séduit le père de la psychanalyse. Dostoïevski, faisant taire ses propres inquiétudes, est un analyste des passions humaines, dont il observe de manière quasi-scientifique tel ou tel impact sur les êtres et les rapports humains.
Pour finir, nous avons donc là un très grand livre -dont le nombre de pages ne doit pas rebuter : il se lit d'un traite dès que l'on est pris par le souffle de son auteur, comme dans un Victor Hugo-, plein d'une sagesse incertaine -qu'on retrouve chez Camus par exemple-.
Je n'aurai qu'un seul regret : que mon baluchon pour l'île déserte babeliesque soit trop étroit pour y caler mes deux tomes des Frères Karamazov.
« Les Karamazov de Dosto, c'est le roman philosophique ! »
Voilà comment l'imposture sur pattes qui m'a tenu lieu de prof de philo qualifia il y a trente ans ce roman. Qualification jetée comme un slogan publicitaire, et hélas (la formule lapidaire étant le seul moyen d'expression de cette « prof » incapable d'assurer des cours qu'elle délégua toute l'année à ses élèves sous forme d'exposés, se contentant d'éructer ici et là) non étayée.
Ainsi m'a t-il fallu une éternité pour oser briser le totem de cette assertion tétanisante et me lancer dans ce Dostoievski-là qui me faisait si peur, persuadée que je n'y comprendrai rien. Perception fausse bien sûr, mais j'en veux encore à cette incapable de n'avoir pas su éclairer en son temps ses jeunes élèves sur ce roman qui aborde en effet la quasi-totalité du programme de philo : la religion – la spiritualité – le mysticisme, la conscience, la morale, la justice, le droit, la beauté, le bien – le mal, l'inné – l'acquis …
Tout cela encapsulé dans ce drame familial et magnifié par les personnages incandescents des trois frères positionnés chacun, qui dans la souffrance, qui dans l'extase, à des degrés opposés sur ces questions essentielles : Yvan l'athée cynique, Aliocha le pur religieux, et Dimitri, tiraillé entre ses deux figures. Autant dire qu'il est difficile au lecteur de ne pas se questionner lui-même à un moment ou un autre du roman quand celui-ci, par le biais de l'un des personnages, lui tend un miroir. Difficile aussi de ne pas s'extasier devant l'énormité de ce roman, sa profondeur, sa portée, sa sensibilité, que, faute de savoir l'appréhender d'un point de vue philosophique, j'ai savouré sur le plan littéraire et adoré retrouver la plume heurtée et à vif de l'auteur, en particulier dans des chapitres comme « le grand Inquisiteur », « Les femmes croyantes », « Illioucha »…
Grande expérience de lecture que ce roman qui enrichit son lecteur !
Voilà comment l'imposture sur pattes qui m'a tenu lieu de prof de philo qualifia il y a trente ans ce roman. Qualification jetée comme un slogan publicitaire, et hélas (la formule lapidaire étant le seul moyen d'expression de cette « prof » incapable d'assurer des cours qu'elle délégua toute l'année à ses élèves sous forme d'exposés, se contentant d'éructer ici et là) non étayée.
Ainsi m'a t-il fallu une éternité pour oser briser le totem de cette assertion tétanisante et me lancer dans ce Dostoievski-là qui me faisait si peur, persuadée que je n'y comprendrai rien. Perception fausse bien sûr, mais j'en veux encore à cette incapable de n'avoir pas su éclairer en son temps ses jeunes élèves sur ce roman qui aborde en effet la quasi-totalité du programme de philo : la religion – la spiritualité – le mysticisme, la conscience, la morale, la justice, le droit, la beauté, le bien – le mal, l'inné – l'acquis …
Tout cela encapsulé dans ce drame familial et magnifié par les personnages incandescents des trois frères positionnés chacun, qui dans la souffrance, qui dans l'extase, à des degrés opposés sur ces questions essentielles : Yvan l'athée cynique, Aliocha le pur religieux, et Dimitri, tiraillé entre ses deux figures. Autant dire qu'il est difficile au lecteur de ne pas se questionner lui-même à un moment ou un autre du roman quand celui-ci, par le biais de l'un des personnages, lui tend un miroir. Difficile aussi de ne pas s'extasier devant l'énormité de ce roman, sa profondeur, sa portée, sa sensibilité, que, faute de savoir l'appréhender d'un point de vue philosophique, j'ai savouré sur le plan littéraire et adoré retrouver la plume heurtée et à vif de l'auteur, en particulier dans des chapitres comme « le grand Inquisiteur », « Les femmes croyantes », « Illioucha »…
Grande expérience de lecture que ce roman qui enrichit son lecteur !
Ce roman captivant est un des livres que j'emporterais sur une île déserte tant il est riche de significations et de multiples interprétations possibles ! J'avais dévoré cet énorme pavé l'été de mes dix-sept ans, profitant d'une vaste plage de temps libre tant l'isolement rural est propice à la méditation poétique et métaphysique, et les questions sans réponses des personnages et plus largement celles de l'auteur sur le sens de la vie, Dieu, la mort, le bien, le mal avaient fait écho aux miennes.
L'odieux Féodor Karamazov est assassiné. de ses trois fils : Dimitri, le débauché, Ivan, le savant, Aliocha, l'ange, tous ont pu le tuer, tous ont au moins désiré sa mort. Mais qui est le vrai coupable ? Comme dans Crime et Châtiment, Dostoïevski part d'une intrigue de roman policier pour nous emmener sur d'autres terrains : philosophiques, politiques, religieux, métaphysiques.
Aliocha est un jeune homme altruiste, ce qui lui vaut d'être aimé de tous, même de son père. Il est persuadé que Dieu existe, a foi dans l'homme, malgré la méchanceté et la question problématique du mal. Il a soif d'absolu et veut vivre dans un monastère auprès d'un saint, le staretz Zossima, dont les qualités morales et humaines l'ont profondément marqué. Il se positionne par rapport au socialisme, idée nouvelle dans les cercles intellectuels, qui n'est pas que la question ouvrière mais aussi celle de l'athéisme : créer un paradis sur terre sans Dieu. S'il avait été sûr que Dieu n'existe pas, il aurait été socialiste.
Ivan est un étudiant qui, comme Raskolnikov dans Crime et Châtiment, écrit des articles pour gagner sa vie. Ce savant athée écrit des articles de théologie sur les tribunaux ecclésiastiques. À la différence de son frère, il est persuadé que Dieu n'existe pas mais il est tourmenté par le problème du mal, de la cruauté inhérente à l'espèce humaine et finit par conclure que « si Dieu n'est plus, tout est permis ». La justice humaine est trop faible, un homme intelligent peut user de duplicité, de dissimulation pour la contourner, y échapper. Sans l'idée de Dieu que les hommes ont créée pour assurer la cohésion sociale, celle de la vertu disparaît et il n'y a plus de limite morale, le crime est permis dans la mesure où le criminel n'est pas pris, il n'est même pas soupçonné.
Dimitri, surnommé Mitia, est un homme de mauvaise vie qui aime cependant son frère Aliocha, qu'il considère comme sa conscience morale, tant à ses yeux, il est charismatique. Lui seul a le pouvoir de le ramener sur le droit chemin. Mitia est le coupable idéal du meurtre de son père : il l'a forcément tué et lui a volé son argent, vu ses antécédents. Ce ne peut être que lui mais est-il vraiment coupable ? A-t-il vraiment envie d'être innocenté ? Ne se considère-t-il pas coupable d'une autre façon, d'autres crimes qu'il doit expier par rapport à l'ensemble de sa vie ? En sera-t-il capable ? Aura-t-il le courage d'affronter la rudesse de l'existence au bagne, s'il est condamné ?
Dostoïevski nous fait découvrir la société russe de la deuxième moitié du XIXe siècle et ses débats idéologiques houleux entre jeunes révolutionnaires, théoriciens de l'anarchisme, du socialisme, du nihilisme : la négation de Dieu et la destruction radicale des anciennes structures sociales, des institutions. Lui-même était tiraillé entre l'idéal chrétien, au point d'écrire dans une lettre : « Si quelqu'un me prouvait que le Christ est hors de la vérité et qu'il fût réel que la vérité soit hors du Christ, je voudrais plutôt rester avec le Christ qu'avec la vérité », et l'idéal socialiste. Il avait été membre d'un mouvement révolutionnaire remettant en cause le pouvoir absolu du tsar avant d'être condamné à mort puis envoyé au bagne. La question sociale le préoccupe : comment résoudre le problème de la misère ? Kolia, qui n'a que quatorze ans et se dit socialiste, admire Aliocha et est l'ami d'Ilioucha, qu'il veut défendre car il est petit, faible et pauvre mais ne se laisse pas faire. Kolia et Aliocha sont des doubles parfaits des réflexions de Dostoïevski. Pour autant, la destruction radicale vaut-elle mieux que le conservatisme ? Engendre-t-elle le paradis sur terre ou le chaos ? Une oeuvre majeure pour qui s'intéresse à la politique au sens noble du terme : l'histoire des idées et de l'organisation sociale, ainsi qu'aux débats philosophiques et métaphysiques.
L'odieux Féodor Karamazov est assassiné. de ses trois fils : Dimitri, le débauché, Ivan, le savant, Aliocha, l'ange, tous ont pu le tuer, tous ont au moins désiré sa mort. Mais qui est le vrai coupable ? Comme dans Crime et Châtiment, Dostoïevski part d'une intrigue de roman policier pour nous emmener sur d'autres terrains : philosophiques, politiques, religieux, métaphysiques.
Aliocha est un jeune homme altruiste, ce qui lui vaut d'être aimé de tous, même de son père. Il est persuadé que Dieu existe, a foi dans l'homme, malgré la méchanceté et la question problématique du mal. Il a soif d'absolu et veut vivre dans un monastère auprès d'un saint, le staretz Zossima, dont les qualités morales et humaines l'ont profondément marqué. Il se positionne par rapport au socialisme, idée nouvelle dans les cercles intellectuels, qui n'est pas que la question ouvrière mais aussi celle de l'athéisme : créer un paradis sur terre sans Dieu. S'il avait été sûr que Dieu n'existe pas, il aurait été socialiste.
Ivan est un étudiant qui, comme Raskolnikov dans Crime et Châtiment, écrit des articles pour gagner sa vie. Ce savant athée écrit des articles de théologie sur les tribunaux ecclésiastiques. À la différence de son frère, il est persuadé que Dieu n'existe pas mais il est tourmenté par le problème du mal, de la cruauté inhérente à l'espèce humaine et finit par conclure que « si Dieu n'est plus, tout est permis ». La justice humaine est trop faible, un homme intelligent peut user de duplicité, de dissimulation pour la contourner, y échapper. Sans l'idée de Dieu que les hommes ont créée pour assurer la cohésion sociale, celle de la vertu disparaît et il n'y a plus de limite morale, le crime est permis dans la mesure où le criminel n'est pas pris, il n'est même pas soupçonné.
Dimitri, surnommé Mitia, est un homme de mauvaise vie qui aime cependant son frère Aliocha, qu'il considère comme sa conscience morale, tant à ses yeux, il est charismatique. Lui seul a le pouvoir de le ramener sur le droit chemin. Mitia est le coupable idéal du meurtre de son père : il l'a forcément tué et lui a volé son argent, vu ses antécédents. Ce ne peut être que lui mais est-il vraiment coupable ? A-t-il vraiment envie d'être innocenté ? Ne se considère-t-il pas coupable d'une autre façon, d'autres crimes qu'il doit expier par rapport à l'ensemble de sa vie ? En sera-t-il capable ? Aura-t-il le courage d'affronter la rudesse de l'existence au bagne, s'il est condamné ?
Dostoïevski nous fait découvrir la société russe de la deuxième moitié du XIXe siècle et ses débats idéologiques houleux entre jeunes révolutionnaires, théoriciens de l'anarchisme, du socialisme, du nihilisme : la négation de Dieu et la destruction radicale des anciennes structures sociales, des institutions. Lui-même était tiraillé entre l'idéal chrétien, au point d'écrire dans une lettre : « Si quelqu'un me prouvait que le Christ est hors de la vérité et qu'il fût réel que la vérité soit hors du Christ, je voudrais plutôt rester avec le Christ qu'avec la vérité », et l'idéal socialiste. Il avait été membre d'un mouvement révolutionnaire remettant en cause le pouvoir absolu du tsar avant d'être condamné à mort puis envoyé au bagne. La question sociale le préoccupe : comment résoudre le problème de la misère ? Kolia, qui n'a que quatorze ans et se dit socialiste, admire Aliocha et est l'ami d'Ilioucha, qu'il veut défendre car il est petit, faible et pauvre mais ne se laisse pas faire. Kolia et Aliocha sont des doubles parfaits des réflexions de Dostoïevski. Pour autant, la destruction radicale vaut-elle mieux que le conservatisme ? Engendre-t-elle le paradis sur terre ou le chaos ? Une oeuvre majeure pour qui s'intéresse à la politique au sens noble du terme : l'histoire des idées et de l'organisation sociale, ainsi qu'aux débats philosophiques et métaphysiques.
Citations et extraits (384)
Voir plus
Ajouter une citation
- De quel isolement parlez-vous ?
- De l’isolement dans lequel vivent les hommes, en notre siècle tout particulièrement, et qui se manifeste dans tous les domaines. Ce règne-là n’a pas encore pris fin et il n’a même pas atteint son apogée. A l’heure actuelle, chacun s’efforce de goûter la plénitude de la vie en s’éloignant de ses semblables et en recherchant son bonheur individuel. Mais ces efforts, loin d’aboutir à une plénitude de vie, ne mènent qu’à l’anéantissement total de l’âme, à une sorte de suicide moral par un isolement étouffant. A notre époque, la société s’est décomposée en individus, qui vivent chacun dans leur tanière comme des bêtes, se fuient les uns les autres et ne songent qu’à se cacher mutuellement leurs richesses. Ils en viennent ainsi à se détester et à se rendre détestables eux-mêmes. L’homme amasse des biens dans la solitude et se réjouit de la puissance des biens qu’il croit acquérir, se disant que ses jours sont désormais assurés. Il ne voit pas, l’insensé, que plus il en amasse et plus il s’enlise dans une impuissance mortelle. Il s’habitue en effet à ne compter que sur lui-même, ne croit plus à l’entraide, oublie, dans sa solitude, les vraies lois de l’humanité, et en vient finalement à trembler chaque jour pour son argent, dont la perte le priverait de tout. Les hommes ont tout à fait perdu de vue, de nos jours, que la vraie sécurité de la vie ne s’obtient pas dans la solitude, mais dans l’union des efforts et dans la coordination des actions individuelles.
- De l’isolement dans lequel vivent les hommes, en notre siècle tout particulièrement, et qui se manifeste dans tous les domaines. Ce règne-là n’a pas encore pris fin et il n’a même pas atteint son apogée. A l’heure actuelle, chacun s’efforce de goûter la plénitude de la vie en s’éloignant de ses semblables et en recherchant son bonheur individuel. Mais ces efforts, loin d’aboutir à une plénitude de vie, ne mènent qu’à l’anéantissement total de l’âme, à une sorte de suicide moral par un isolement étouffant. A notre époque, la société s’est décomposée en individus, qui vivent chacun dans leur tanière comme des bêtes, se fuient les uns les autres et ne songent qu’à se cacher mutuellement leurs richesses. Ils en viennent ainsi à se détester et à se rendre détestables eux-mêmes. L’homme amasse des biens dans la solitude et se réjouit de la puissance des biens qu’il croit acquérir, se disant que ses jours sont désormais assurés. Il ne voit pas, l’insensé, que plus il en amasse et plus il s’enlise dans une impuissance mortelle. Il s’habitue en effet à ne compter que sur lui-même, ne croit plus à l’entraide, oublie, dans sa solitude, les vraies lois de l’humanité, et en vient finalement à trembler chaque jour pour son argent, dont la perte le priverait de tout. Les hommes ont tout à fait perdu de vue, de nos jours, que la vraie sécurité de la vie ne s’obtient pas dans la solitude, mais dans l’union des efforts et dans la coordination des actions individuelles.
A présent chacun aspire à séparer sa personnalité des autres, chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie ; cependant, loin d’atteindre le but, tous les efforts humains n’aboutissent qu’à un suicide total, car, au lieu d’affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous sont fractionnés en unités. Chacun s’isole dans son trou, s’écarte des autres, se cache, lui et son bien, s’éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence ; il ignore, l’insensé, que plus il amasse plus il s’enlise dans une impuissance fatale.
Le monde a proclamé la liberté, ces dernières années surtout ; mais que représente cette liberté ! Rien que l'esclavage et le suicide ! Car le monde dit : "Tu as des besoins, assouvis-les, tu possèdes les mêmes droits que les grands, et les riches. Ne crains donc pas de les assouvir, accrois-les même" ; voilà ce qu'on enseigne maintenant. Telle est leur conception de la liberté. Et que résulte-t-il de ce droit à accroître les besoins ? Chez les riches, la solitude et le suicide spirituel ; chez les pauvres, l'envie et le meurtre, car on a conféré des droits, mais on n'a pas encore indiqué les moyens d'assouvir les besoins. On assure que le monde, en abrégeant les distances, en transmettant la pensée dans les airs, s'unira toujours davantage, que la fraternité règnera. Hélas ! ne croyez pas à cette union des hommes. Concevant la liberté comme l'accroissement des besoins et leur prompte satisfaction, ils altèrent leur nature, car ils font naître en eux une foule de désirs insensés, d'habitudes et d'imaginations absurdes. Ils ne vivent que pour s'envier mutuellement, pour la sensualité et l'ostentation. Donner des dîners, voyager, posséder des équipages, des grades, des valets, passe pour une nécessité à laquelle on sacrifie jusqu'à sa vie, son honneur et l'amour de l'humanité, on se tuera même, faute de pouvoir la satisfaire. Il en est de même chez ceux qui ne sont pas riches ; quant aux pauvres, l'inassouvissement des besoins et l'envie sont pour le moment noyés dans l'ivresse. Mais bientôt, au lieu de vin, ils s'enivreront de sang, c'est le but vers lequel on les mène. Dites-moi si un tel homme est libre.
Pour rénover le monde, il faut que les hommes eux-mêmes changent de voie. Tant que chacun ne sera pas vraiment le frère de son prochain, il n'y aura pas de fraternité. Jamais les hommes ne sauront, au nom de la science ou de l'intérêt, répartir paisiblement entre eux, la propriété et les droits. Personne ne s'estimera satisfait, et tous murmureront, s'envieront, s'extermineront les uns les autres. Vous demandez quand cela se réalisera ? Cela viendra, mais seulement quand sera terminé la période d'isolement humain.
(...) Car à présent, chacun aspire à séparer sa personnalité des autres, chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie ; cependant, loin d'atteindre le but, tous les efforts des hommes n'aboutissent qu'à un suicide total, car, au lieu d'affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous se sont fractionnés en unités. Chacun s'isole dans son trou, s'écarte des autres, se cache, lui et son bien, s'éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence ; il ignore, l'insensé, que plus il amasse plus il s'enlise dans une impuissance fatale. Car il est habitué à ne compter que sur lui-même et s'est détaché de la collectivité ; il s'est accoutumé à ne pas croire à l'entraide, à son prochain, à l'humanité et tremble seulement à l'idée de perdre sa fortune et les droits qu'elle lui confère. Partout, de nos jours, l'esprit humain commence ridiculement à perdre de vue que la véritable garantie de l'individu consiste, non dans son effort personnel isolé, mais dans la solidarité.
(Page 413)
(...) Car à présent, chacun aspire à séparer sa personnalité des autres, chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie ; cependant, loin d'atteindre le but, tous les efforts des hommes n'aboutissent qu'à un suicide total, car, au lieu d'affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous se sont fractionnés en unités. Chacun s'isole dans son trou, s'écarte des autres, se cache, lui et son bien, s'éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence ; il ignore, l'insensé, que plus il amasse plus il s'enlise dans une impuissance fatale. Car il est habitué à ne compter que sur lui-même et s'est détaché de la collectivité ; il s'est accoutumé à ne pas croire à l'entraide, à son prochain, à l'humanité et tremble seulement à l'idée de perdre sa fortune et les droits qu'elle lui confère. Partout, de nos jours, l'esprit humain commence ridiculement à perdre de vue que la véritable garantie de l'individu consiste, non dans son effort personnel isolé, mais dans la solidarité.
(Page 413)
Hélas ! ne croyez pas à cette union des hommes. Concevant la liberté comme l'accroissement des besoins et leur prompte satisfaction, ils altèrent leur nature, car ils font naître en eux une foule de désirs insensés, d'habitudes et d'imaginations absurdes. Ils ne vivent que pour s'envier mutuellement, pour la sensualité et l'ostentation. Donner des dîners, voyager, posséder des équipages, des grades, des valets, passe pour une nécessité à laquelle on sacrifie jusqu'à sa vie, son honneur et l'amour de l'humanité, on se tuera même, faute de pouvoir la satisfaire.
(page 426)
(page 426)
Videos de Fiodor Dostoïevski (59)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature russeVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Fiodor Dostoïevski (141)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Crime et Châtiment
Qui est le meurtrier ?
Raskolnikov
Raspoutine
Raton-Laveur
Razoumikhine
9 questions
195 lecteurs ont répondu
Thème : Crime et Châtiment de
Fiodor DostoïevskiCréer un quiz sur ce livre195 lecteurs ont répondu