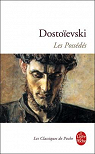Le livre brosse le portrait, à la première personne, d'un personnage détestable sous de multiples aspects:
- un homme qui vit seul, cradement, dans son "sous-sol".
- un homme qui, lorsqu'il sort dudit sous-sol, se complaît dans une antipathie qu'il provoque et entretient.
- un homme geignard, qui trouve en lui-même mille motifs de détestation (avec un motif de plainte privilégié: son intelligence = son fardeau).
- un homme retors, qui dira une chose puis son contraire et laissera au lecteur le soin de démêler le vrai du faux (ex: "Mais oui je plaisante, Messieurs..." P.46).
Justement, quant à ce dernier point. On voit peu dans l'esprit du narrateur de ces rassurantes séparations vrai/faux. Il est d'abord pétri de paradoxes. Il pense une chose et son contraire, successivement, voire simultanément. Il ne cesse de remettre en cause la position qu'il vient d'avancer - et son flot de paroles est à la mesure de son incertitude fondamentale.
Son rapport à lui-même est particulièrement ambivalent. Par exemple il s'adore et il se déteste. Il s'adore parce qu'il se déteste (->il est singulier), il se déteste parce qu'il s'adore (->péché d'orgueil). L'intelligence ne lui amène pas la clarté en démêlant les fils, elle en rajoute à l'écheveau.
Quant à cette question de l'intelligence, j'avais senti en lisant Les Frères Karamazov une forte défiance de Dostoïevski pour l'intelligence athée, matérialiste, torturée d'Ivan Karamazov, en comparaison de la sagesse apaisée d'Aliocha (-> celui qui ne calcule pas, fonde sa confiance et sa connaissance sur sa foi). L'oeil lucide VS l'oeil bon.
De manière très nette, le narrateur tient son intelligence pour pernicieuse. À tel point qu'il se préférerait "insecte", car: "avoir une conscience trop développée, c'est une maladie, une maladie dans le plein sens du terme" (P.15). Une maladie à plusieurs niveaux:
- Maladie comportementale: l'intelligence bloque l'action par le regard critique porté sur elle. La conscience accrue entraîne l'inertie.
- Maladie sociale: elle marginalise en induisant un regard négatif, dépréciateur sur l'entourage.
- Maladie morale: elle provoque un vil plaisir d'autosatisfaction.
Le narrateur apparaît en effet méprisant, hautain, rempli du sentiment de sa supériorité intellectuelle. Il jouit de se faire détester pour de "bonnes raisons". Avoir raison et seul contre tous, quitte à casser l'ambiance à table en opposant aux rires imbéciles des vérités crasses, voilà bien un motif de réjouissance.
Voir le plaisir que le narrateur éprouve à se sentir centre de l'attention, lors de ses rares apparitions au soleil. À table avec ses camarades, il se réjouit des impressions désastreuses que son comportement suscite. La majeure partie du temps, il se morfond dans son trou. Lorsqu'il en sort, c'est pour faire valoir, par la provocation et la méchanceté, son ego esseulé en manque de reconnaissance.
Ci-dessous une analyse entendue chez Gilles Deleuze, dont j'ai retrouvé dans le livre une illustration directe.
Deleuze: "Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences, et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu'il y a une question encore plus urgente, et ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête."
(Conférence "Qu'est-ce que l'acte de création?", 16:30: https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw)
P.34: "[...] est-ce qu'il n'existe pas un intérêt qui est le plus intéressant [...], un intérêt primordial, plus intéressant que tous les autres intérêts et au nom duquel, si cela s'avère nécessaire, les hommes sont prêts à braver toutes les lois - parfaitement, à se dresser contre le bon sens, l'honneur, le calme, le bien-être - bref, à se dresser contre tout ce qui est utile et beau, dans le seul but d'atteindre cet intérêt premier, cet intérêt le plus intéressant et qui leur est plus cher que tout?"
Parmi d'autres questions soulevées:
- n'y a-t-il pas quelque part plus de plaisir dans la souffrance que dans le bien-être? Ou, quelle serait cette souffrance, quel serait ce bien-être?
- n'y a-t-il pas plus de plaisir à espérer dans la démarche que dans l'accomplissement? etc.
Une proposition, posée frontalement par Dostoïevski: l'homme (supérieur?) souhaite avant tout disposer de sa volonté en toute indépendance. Une pleine liberté, voilà le souverain bien! Être libre, si l'envie lui venait, de se rouler éventuellement dans la fange.
Une conséquence directe: cet homme est ingrat. Si on le comble de bienfaits, il préfère qu'on l'en dispense, pour n'être l'obligé de personne.
Cet homme marginal cherche son plaisir dans la liberté dont il dispose, mais ne trouve à la fin qu'un plaisir sale, source de culpabilité. En ce sens, sa liberté est un poison, mais lui reste mille fois préférable à toutes formes de contraintes. La souffrance libre peut encore être source de plaisir, à la différence de la souffrance contrainte. La liberté lui serait la dernière chose encore désirable à la fin.
Mais qu'en est-il, si cette liberté ne sait être correctement gérée par l'esprit humain? A voir les tourments du narrateur, combien son "droit à exécrer en paix" est une impasse, on ressent toute l'ambiguïté du propos de Dostoïevski. le dialogue interne des voix, tel qu'il se constitue dans cet esprit torturé, ne trouve nul compromis, uniquement des clivages irrémédiables, et l'emprise dominatrice des affects. le retranchement du corps social n'est pas pour lui la liberté intérieure. A moins d'une révolution intérieure (spirituelle, christique?), sa pensée bouillonnante n'a aucune chance de connaître la paix.
D'où la quasi-irrésolution du récit, à l'image de ses nombreuses problématiques, difficilement solubles dans la complexité humaine. Dostoïevski pousse les paradoxes à un haut point d'incandescence, en tant que chez certains, ils sont à la fois obligés et sources de conflits intérieurs insoutenables. Par son narrateur des sous-sols, l'inénarrable en l'homme a trouvé un visage éventuel, un possible support de compréhension.
Voilà, en résumé, quelques commentaires sur un livre qui demanderait des pages et des pages de traitement. Mais comme le dit le rapporteur des Carnets, "c'est ici que l'on peut s'arrêter".
NB: le sous-sol n'est jamais décrit que par des qualificatifs sensoriels, olfactifs, il est "sale", il empeste, etc., tel un souterrain nauséabond dont on ne saurait (grammaticalement) distinguer les murs. le narrateur rampe laborieusement dans les ténèbres de son esprit, comme emprisonné sous le plancher des vaches.
- un homme qui vit seul, cradement, dans son "sous-sol".
- un homme qui, lorsqu'il sort dudit sous-sol, se complaît dans une antipathie qu'il provoque et entretient.
- un homme geignard, qui trouve en lui-même mille motifs de détestation (avec un motif de plainte privilégié: son intelligence = son fardeau).
- un homme retors, qui dira une chose puis son contraire et laissera au lecteur le soin de démêler le vrai du faux (ex: "Mais oui je plaisante, Messieurs..." P.46).
Justement, quant à ce dernier point. On voit peu dans l'esprit du narrateur de ces rassurantes séparations vrai/faux. Il est d'abord pétri de paradoxes. Il pense une chose et son contraire, successivement, voire simultanément. Il ne cesse de remettre en cause la position qu'il vient d'avancer - et son flot de paroles est à la mesure de son incertitude fondamentale.
Son rapport à lui-même est particulièrement ambivalent. Par exemple il s'adore et il se déteste. Il s'adore parce qu'il se déteste (->il est singulier), il se déteste parce qu'il s'adore (->péché d'orgueil). L'intelligence ne lui amène pas la clarté en démêlant les fils, elle en rajoute à l'écheveau.
Quant à cette question de l'intelligence, j'avais senti en lisant Les Frères Karamazov une forte défiance de Dostoïevski pour l'intelligence athée, matérialiste, torturée d'Ivan Karamazov, en comparaison de la sagesse apaisée d'Aliocha (-> celui qui ne calcule pas, fonde sa confiance et sa connaissance sur sa foi). L'oeil lucide VS l'oeil bon.
De manière très nette, le narrateur tient son intelligence pour pernicieuse. À tel point qu'il se préférerait "insecte", car: "avoir une conscience trop développée, c'est une maladie, une maladie dans le plein sens du terme" (P.15). Une maladie à plusieurs niveaux:
- Maladie comportementale: l'intelligence bloque l'action par le regard critique porté sur elle. La conscience accrue entraîne l'inertie.
- Maladie sociale: elle marginalise en induisant un regard négatif, dépréciateur sur l'entourage.
- Maladie morale: elle provoque un vil plaisir d'autosatisfaction.
Le narrateur apparaît en effet méprisant, hautain, rempli du sentiment de sa supériorité intellectuelle. Il jouit de se faire détester pour de "bonnes raisons". Avoir raison et seul contre tous, quitte à casser l'ambiance à table en opposant aux rires imbéciles des vérités crasses, voilà bien un motif de réjouissance.
Voir le plaisir que le narrateur éprouve à se sentir centre de l'attention, lors de ses rares apparitions au soleil. À table avec ses camarades, il se réjouit des impressions désastreuses que son comportement suscite. La majeure partie du temps, il se morfond dans son trou. Lorsqu'il en sort, c'est pour faire valoir, par la provocation et la méchanceté, son ego esseulé en manque de reconnaissance.
Ci-dessous une analyse entendue chez Gilles Deleuze, dont j'ai retrouvé dans le livre une illustration directe.
Deleuze: "Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences, et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu'il y a une question encore plus urgente, et ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête."
(Conférence "Qu'est-ce que l'acte de création?", 16:30: https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw)
P.34: "[...] est-ce qu'il n'existe pas un intérêt qui est le plus intéressant [...], un intérêt primordial, plus intéressant que tous les autres intérêts et au nom duquel, si cela s'avère nécessaire, les hommes sont prêts à braver toutes les lois - parfaitement, à se dresser contre le bon sens, l'honneur, le calme, le bien-être - bref, à se dresser contre tout ce qui est utile et beau, dans le seul but d'atteindre cet intérêt premier, cet intérêt le plus intéressant et qui leur est plus cher que tout?"
Parmi d'autres questions soulevées:
- n'y a-t-il pas quelque part plus de plaisir dans la souffrance que dans le bien-être? Ou, quelle serait cette souffrance, quel serait ce bien-être?
- n'y a-t-il pas plus de plaisir à espérer dans la démarche que dans l'accomplissement? etc.
Une proposition, posée frontalement par Dostoïevski: l'homme (supérieur?) souhaite avant tout disposer de sa volonté en toute indépendance. Une pleine liberté, voilà le souverain bien! Être libre, si l'envie lui venait, de se rouler éventuellement dans la fange.
Une conséquence directe: cet homme est ingrat. Si on le comble de bienfaits, il préfère qu'on l'en dispense, pour n'être l'obligé de personne.
Cet homme marginal cherche son plaisir dans la liberté dont il dispose, mais ne trouve à la fin qu'un plaisir sale, source de culpabilité. En ce sens, sa liberté est un poison, mais lui reste mille fois préférable à toutes formes de contraintes. La souffrance libre peut encore être source de plaisir, à la différence de la souffrance contrainte. La liberté lui serait la dernière chose encore désirable à la fin.
Mais qu'en est-il, si cette liberté ne sait être correctement gérée par l'esprit humain? A voir les tourments du narrateur, combien son "droit à exécrer en paix" est une impasse, on ressent toute l'ambiguïté du propos de Dostoïevski. le dialogue interne des voix, tel qu'il se constitue dans cet esprit torturé, ne trouve nul compromis, uniquement des clivages irrémédiables, et l'emprise dominatrice des affects. le retranchement du corps social n'est pas pour lui la liberté intérieure. A moins d'une révolution intérieure (spirituelle, christique?), sa pensée bouillonnante n'a aucune chance de connaître la paix.
D'où la quasi-irrésolution du récit, à l'image de ses nombreuses problématiques, difficilement solubles dans la complexité humaine. Dostoïevski pousse les paradoxes à un haut point d'incandescence, en tant que chez certains, ils sont à la fois obligés et sources de conflits intérieurs insoutenables. Par son narrateur des sous-sols, l'inénarrable en l'homme a trouvé un visage éventuel, un possible support de compréhension.
Voilà, en résumé, quelques commentaires sur un livre qui demanderait des pages et des pages de traitement. Mais comme le dit le rapporteur des Carnets, "c'est ici que l'on peut s'arrêter".
NB: le sous-sol n'est jamais décrit que par des qualificatifs sensoriels, olfactifs, il est "sale", il empeste, etc., tel un souterrain nauséabond dont on ne saurait (grammaticalement) distinguer les murs. le narrateur rampe laborieusement dans les ténèbres de son esprit, comme emprisonné sous le plancher des vaches.
J'ai emmené Notes d'un souterrain de Dostoïevski lors de mon voyage à Saint-Pétersbourg pour mieux apprécier le décor dans lequel, le héros abject qu'il a concocté se mêle au monde d'en haut lorsqu'il ne le commente pas d'en bas ...Une perspective plutôt réussi que celle de cette part d'humanité montrée dans ses aspects les plus cyniques, les plus vils et repoussants.
Notes d'un souterrain
F.M. Dostoievski (1864)
traduction : Lily Denis
récit, 1972, Aubier Montaigne
C'est un livre qui ne se donne pas.
Il s'agirait d'une confession, mais pas à la manière de ce vaniteux de Rousseau, d'un narrateur tiraillé entre ce qu'il refuse et ce qu'il voudrait, entre la domination de puissance et la recherche de l'humiliation, entre sa tête méchante et son coeur qui aimerait tant être bon, entre la raison trop simpliste et catégorique et l'impulsion intérieure.
Mais s'agit-il d'une confession puisque le narrateur dit qu'il invente tout ? Alors ce serait une interrogation sur lui-même et une explication de ce qu'il est, par un processus de creusement pour ainsi dire exceptionnel puisque les autres ont peur de creuser si profond. de nombreuses parenthèses rectifient la pensée et les dires du narrateur, pour qu'on soit au plus près de la vérité, s'il en existe une. En même temps, le narrateur se vautre dans la jouissance de la souffrance, tout en éprouvant constamment le sentiment de honte.
C'est dire si le narrateur est troublé, et il est aussi paradoxal : Je suis méchant, dit-il, puis il dit qu'il n'est pas méchant. Il se dit parce de quoi un homme peut-il parler avec le plus de plaisir, sinon de lui-même ? le narrateur a quarante ans, c'est un ex-fonctionnaire. Il est intelligent, aussi ne peut-il être quelqu'un, la preuve, c'est qu'il n'a pas même réussi à être un insecte. le narrateur est adepte de l'autodénigrement. Il est un homme de pensée, donc d'inaction. Heureux les hommes d'action qui n'ont pas à penser. Cependant il préfère suivre ses désirs et ses idéaux qu'une société qui ne lui dit rien, régie par le deux fois deux, logique qui ne correspond qu'à vingt pour cent de l'homme, et oublie toute l'étendue des désirs. Suivre son sot plaisir, son caprice, c'est éviter l'ennui par lequel la mort commence.
Cette confession, pour employer ce terme, est écrite dans un souterrain, où le narrateur fuit les êtres vivants, mais elle s'adresse à quelqu'un, « Messieurs », dit le narrateur. Seraient-ils des juges ? Elle s'adresse évidemment au lecteur qui pourrait se reconnaître dans le narrateur. Ils pourraient être des admirateurs, mais admirer un anti-héros, est-ce pensable ? Elle crée donc un dialogue, mais c'est le narrateur qui assure les réponses.
Ce n'est pas qu'une confession, car c'est un texte à visée polémique. le narrateur confronte dans sa solitude ses pensées avec celles de ses contemporains, Rousseau par exemple qui prêche une vie dans la nature, une vie d'action donc, et les romantiques, qu'il envie pourtant et de qui il fait partie.
C'est un livre en deux parties, la seconde s'intitulant « A propos de la neige fondue » qui caractérise Saint-Pétersbourg. La neige ne recouvre pas la ville de blanc, et ne l'enchante pas, à peine tombée, elle est sale, elle fait flac. Elle n'enfante pas de héros. L'homme y patauge, comme le narrateur qui ressasse son humiliation. Il voudrait, à l'instar du romantique, qu'on le distingue, qu'on le reconnaisse, ou au moins qu'on le traite comme un égal, quitte à se faire sortir par une fenêtre, mais l'officier ne le voit pas, ses camarades le fuient. Il a des rêves de puissance, alors qu'il a tendance à s'éprouver comme inférieur, mais il se fourvoie tout seul dans des situations qui le discréditent, il dit ce qu'il fera résolument, et fait tout l'inverse, comme pour se rabaisser davantage, il est incapable d'action et de réaction ; réduit à l'inertie, puisqu'il n'y a pas de cause première, il philosophaille, il bavarde, transvase du creux dans du vide. Il discute de la liberté, est-ce une tirette d'orgue ou pas, soutient la personnalité et l'individualité au détriment du collectif, reconnaît l'impossibilité pour les hommes d'être sans tutelle. Il se soucie du qu'en dira-t-on, souffre d'être pauvre, se sent méprisé. Il est en fait dans la posture : « Je faillis oublier que je devais prendre un air vexé ». Il est incapable d'être lui-même, parce qu'il ne peut vivre sans le regard des autres, et parce qu'il ne s'aime pas.
Il dit qu'il est malade du foie, et qu'il ne se soigne pas par méchanceté, envers lui-même donc, c'est un atrabilaire qui est remonté contre tout et tous, parce qu'il ne trouve pas sa place. Cela crée des scènes cocasses, comme ces pantomimes échangées avec son valet. Cela crée aussi des scènes pathétiques. le narrateur l'a dit : « Plus j'étais conscient du beau et du sublime », de la générosité et de l'amour, « plus je me roulais dans la fange ». Ainsi il attend de façon obsédante Lisa, la jeune prostituée, à qui il a conseillé de quitter le plus vite possible ce milieu sordide. Quand elle est enfin là, ses nerfs à lui, comme ceux d'une femme, finissent de craquer, et il pleure. Elle lui témoigne de l'amour pur. Alors qu'il pourrait se laisser aller dans cette tendresse, il humilie sciemment la jeune femme, déjà déchue de par sa profession, qui s'en va et qu'il recherche mollement. L'homme est une créature bipède et ingrate, dit-il. Il souffre en fait d'un excès de conscience, qui fait qu'il s'imagine des choses, et qui provoque la souffrance, de laquelle le narrateur se délecte. Tout le monde n'a pas la chance d'être un homme normal et bête. Il n'a pas la souffrance triste, car il se moque sans arrêt de lui-même. Il a une vanité d'écorché. Ce qui le rend incohérent, contradictoire, et exacerbe ses sentiments qui en deviennent extrêmes. Une colère est en lui, qui le ronge. Ou alors il est mort-né, accouché d'une idée. Il ne sait pas faire avec la vie vivante. C'est un inquiet, et cette inquiétude, il ne peut l'apaiser, étant seul et dépourvu d'affection et croyant ne pas pouvoir aimer.
Il s'épanche longuement, car il faut qu'il en sorte, de ce souterrain où il s'est terré. Son parler est coléreux. Ses évocations sont très visuelles. Son style est oral et lyrique. Il use d'expressions familières, qui donnent du sel à son discours. Il a du souffle, ses phrases sont longues. Il couche sur le papier ses réflexions, et ne veut subir aucune contrainte. Preuve qu'il veut être entendu, et qu'il peut exister une autobiographie sincère, contrairement à ce que Heine dit, et malgré cette propension à la posture.
Cet homme tourmenté crée le type du anti-héros. Notes d'un souterrain joue un rôle central dans l'oeuvre de Dostoievski et dans le mythe dostoievskien.
La légende du grand Inquisiteur, le type de confession, appellent Camus, et son personnage de Clamence dans La Chute.
C'est une lecture qui muscle et tonifie. Et qui me donne envie de lire le rêve d'un homme ridicule.
F.M. Dostoievski (1864)
traduction : Lily Denis
récit, 1972, Aubier Montaigne
C'est un livre qui ne se donne pas.
Il s'agirait d'une confession, mais pas à la manière de ce vaniteux de Rousseau, d'un narrateur tiraillé entre ce qu'il refuse et ce qu'il voudrait, entre la domination de puissance et la recherche de l'humiliation, entre sa tête méchante et son coeur qui aimerait tant être bon, entre la raison trop simpliste et catégorique et l'impulsion intérieure.
Mais s'agit-il d'une confession puisque le narrateur dit qu'il invente tout ? Alors ce serait une interrogation sur lui-même et une explication de ce qu'il est, par un processus de creusement pour ainsi dire exceptionnel puisque les autres ont peur de creuser si profond. de nombreuses parenthèses rectifient la pensée et les dires du narrateur, pour qu'on soit au plus près de la vérité, s'il en existe une. En même temps, le narrateur se vautre dans la jouissance de la souffrance, tout en éprouvant constamment le sentiment de honte.
C'est dire si le narrateur est troublé, et il est aussi paradoxal : Je suis méchant, dit-il, puis il dit qu'il n'est pas méchant. Il se dit parce de quoi un homme peut-il parler avec le plus de plaisir, sinon de lui-même ? le narrateur a quarante ans, c'est un ex-fonctionnaire. Il est intelligent, aussi ne peut-il être quelqu'un, la preuve, c'est qu'il n'a pas même réussi à être un insecte. le narrateur est adepte de l'autodénigrement. Il est un homme de pensée, donc d'inaction. Heureux les hommes d'action qui n'ont pas à penser. Cependant il préfère suivre ses désirs et ses idéaux qu'une société qui ne lui dit rien, régie par le deux fois deux, logique qui ne correspond qu'à vingt pour cent de l'homme, et oublie toute l'étendue des désirs. Suivre son sot plaisir, son caprice, c'est éviter l'ennui par lequel la mort commence.
Cette confession, pour employer ce terme, est écrite dans un souterrain, où le narrateur fuit les êtres vivants, mais elle s'adresse à quelqu'un, « Messieurs », dit le narrateur. Seraient-ils des juges ? Elle s'adresse évidemment au lecteur qui pourrait se reconnaître dans le narrateur. Ils pourraient être des admirateurs, mais admirer un anti-héros, est-ce pensable ? Elle crée donc un dialogue, mais c'est le narrateur qui assure les réponses.
Ce n'est pas qu'une confession, car c'est un texte à visée polémique. le narrateur confronte dans sa solitude ses pensées avec celles de ses contemporains, Rousseau par exemple qui prêche une vie dans la nature, une vie d'action donc, et les romantiques, qu'il envie pourtant et de qui il fait partie.
C'est un livre en deux parties, la seconde s'intitulant « A propos de la neige fondue » qui caractérise Saint-Pétersbourg. La neige ne recouvre pas la ville de blanc, et ne l'enchante pas, à peine tombée, elle est sale, elle fait flac. Elle n'enfante pas de héros. L'homme y patauge, comme le narrateur qui ressasse son humiliation. Il voudrait, à l'instar du romantique, qu'on le distingue, qu'on le reconnaisse, ou au moins qu'on le traite comme un égal, quitte à se faire sortir par une fenêtre, mais l'officier ne le voit pas, ses camarades le fuient. Il a des rêves de puissance, alors qu'il a tendance à s'éprouver comme inférieur, mais il se fourvoie tout seul dans des situations qui le discréditent, il dit ce qu'il fera résolument, et fait tout l'inverse, comme pour se rabaisser davantage, il est incapable d'action et de réaction ; réduit à l'inertie, puisqu'il n'y a pas de cause première, il philosophaille, il bavarde, transvase du creux dans du vide. Il discute de la liberté, est-ce une tirette d'orgue ou pas, soutient la personnalité et l'individualité au détriment du collectif, reconnaît l'impossibilité pour les hommes d'être sans tutelle. Il se soucie du qu'en dira-t-on, souffre d'être pauvre, se sent méprisé. Il est en fait dans la posture : « Je faillis oublier que je devais prendre un air vexé ». Il est incapable d'être lui-même, parce qu'il ne peut vivre sans le regard des autres, et parce qu'il ne s'aime pas.
Il dit qu'il est malade du foie, et qu'il ne se soigne pas par méchanceté, envers lui-même donc, c'est un atrabilaire qui est remonté contre tout et tous, parce qu'il ne trouve pas sa place. Cela crée des scènes cocasses, comme ces pantomimes échangées avec son valet. Cela crée aussi des scènes pathétiques. le narrateur l'a dit : « Plus j'étais conscient du beau et du sublime », de la générosité et de l'amour, « plus je me roulais dans la fange ». Ainsi il attend de façon obsédante Lisa, la jeune prostituée, à qui il a conseillé de quitter le plus vite possible ce milieu sordide. Quand elle est enfin là, ses nerfs à lui, comme ceux d'une femme, finissent de craquer, et il pleure. Elle lui témoigne de l'amour pur. Alors qu'il pourrait se laisser aller dans cette tendresse, il humilie sciemment la jeune femme, déjà déchue de par sa profession, qui s'en va et qu'il recherche mollement. L'homme est une créature bipède et ingrate, dit-il. Il souffre en fait d'un excès de conscience, qui fait qu'il s'imagine des choses, et qui provoque la souffrance, de laquelle le narrateur se délecte. Tout le monde n'a pas la chance d'être un homme normal et bête. Il n'a pas la souffrance triste, car il se moque sans arrêt de lui-même. Il a une vanité d'écorché. Ce qui le rend incohérent, contradictoire, et exacerbe ses sentiments qui en deviennent extrêmes. Une colère est en lui, qui le ronge. Ou alors il est mort-né, accouché d'une idée. Il ne sait pas faire avec la vie vivante. C'est un inquiet, et cette inquiétude, il ne peut l'apaiser, étant seul et dépourvu d'affection et croyant ne pas pouvoir aimer.
Il s'épanche longuement, car il faut qu'il en sorte, de ce souterrain où il s'est terré. Son parler est coléreux. Ses évocations sont très visuelles. Son style est oral et lyrique. Il use d'expressions familières, qui donnent du sel à son discours. Il a du souffle, ses phrases sont longues. Il couche sur le papier ses réflexions, et ne veut subir aucune contrainte. Preuve qu'il veut être entendu, et qu'il peut exister une autobiographie sincère, contrairement à ce que Heine dit, et malgré cette propension à la posture.
Cet homme tourmenté crée le type du anti-héros. Notes d'un souterrain joue un rôle central dans l'oeuvre de Dostoievski et dans le mythe dostoievskien.
La légende du grand Inquisiteur, le type de confession, appellent Camus, et son personnage de Clamence dans La Chute.
C'est une lecture qui muscle et tonifie. Et qui me donne envie de lire le rêve d'un homme ridicule.
Un chef d'oeuvre en tout point. L'introspection, la plume, tout y est. J'ai redécouvert la lecture grâce à cette oeuvre et j'ai rencontré mon auteur fétiche grâce à ces carnets.
DE PROFUNDIS CLAMAVI
Quelle est donc cette voix qui nous parle du fond de la nuit ?
Elle nous semble si familière que nous hésitons à croire qu'elle n'est pas sortie de notre propre bouche fiévreuse, un soir de cauchemar, le petit matin suintant lentement dans notre conscience, chargé des paroles terribles.
Il parle, il parle, il parle, nous dit Dostoïevski de son personnage, enfermé dans une cave pendant quarante années et, lorsqu'il en sort, pour quelque virée nocturne avec des soudards qui se terminera auprès d'une jeune prostituée qu'il souillera dans sa touchante pureté, c'est encore précédé des ténèbres de l'humiliation volontaire, de la soif de l'abaissement (1), de mille paroles bruissantes et rampantes, comme si l'homme du souterrain avait donné un coup de pied dans un nid de vipères dont il ne pouvait plus se débarrasser.
Pour Pietro Citati, cette ivresse de la haine et du mépris qu'un homme peut retourner contre lui-même bien plus que contre les autres est une des caractéristiques du Mal absolu sur lequel Francis Marmande, auteur d'une postface sans intérêt (pour la collection Babel) citant Guibert, Bataille, Leiris et même Duras, n'écrit pas un seul mot. Inexistence de ces pré et postfaciers qui semblent ne point savoir lire.
C'est encore Pietro Citati qui écrit que le héros, ou plutôt l'anti-héros absolu peint par Dostoïevski est un exemple, le premier sans doute, d'homme creux. L'image est facile et en partie fausse. C'est peut-être, en effet, ne pas tenir compte d'un certain nombre d'indices allant contre l'opinion de Citati, indices pour le moins insistants, le premier d'entre eux étant que Dostoïevski n'a pas voulu imaginer un homme qui fut complètement médiocre. le bavard des Carnets du sous-sol n'est certainement pas le minable Peredonov de Sologoub, un personnage absolument grotesque qui semble, décidément, hors de portée du plus puissant des bons samaritains, comme s'il se tenait, ainsi que Monsieur Ouine, hors de toute atteinte. Ne se révolte-t-il pas, même, contre le cartésianisme qui, à ses yeux, paraît avoir aplani le monde ?
L'homme médiocre est plat. Il refuse le risque de la profondeur, celle de l'amour ou celle du Mal volontaire.
Le médiocre est l'homme qui ne veut point du secours des autres hommes. Il est l'idiot, au sens étymologique du terme, celui qui ne veut point être relié à la communauté des vivants, l'îlot de perdition.
Notre médiocre, lui, même s'il appartient peut-être à cette catégorie, plus maudite que celle des «âmes perverties», des «âmes habituées» selon Charles Péguy, est tiraillé par la pureté, qu'il flaire d'ailleurs, comme un démon véritable, dans le coeur de la jeune prostituée venant chez lui après leur première rencontre, avec laquelle il couchera et qu'il humiliera en lui glissant un billet dans la main au moment de sa fuite, entièrement provoquée par les lamentables propos qu'il tient contre elle. Ne pouvant accomplir le bien, il lui reste à devenir vil. Comprenant que cette femme pourrait le sauver dans son infernale misère, le personnage de Dostoïevski tentera par tous les moyens de la blesser, de salir la petite flamme claire qui danse dans son coeur. Cette haine de la lumière n'est que la forme extrême de la conscience de sa propre misère, lorsque l'angoisse est la conséquence d'une certitude aussi douloureuse qu'aveuglante, ramassée en peu de mots par le grand Pascal lorsqu'il écrivit misère de l'homme : «Je sentais quelque chose qui refusait de mourir au fond de moi, dans le fond de mon coeur, de ma conscience, qui s'obstinait à ne pas mourir, qui se traduisait en angoisse brûlante» (p. 139).
Comme un véritable démon écrivais-je, car lui seul, comprenant que le bien qu'il ne peut toucher et qui brûle son regard est l'unique réalité, n'a de cesse de s'enfoncer dans le désespoir qu'il creuse, par l'action de sa propre volonté. En clair, il se dévore : «Plus je prenais conscience du bien, de tout ce «beau» et ce «sublime», écrit ainsi Dostoïevski, plus je m'engluais dans mon marais, et plus j'étais capable de m'y noyer complètement» (2).
C'est que l'homme creux tel que nous le peint l'écrivain russe n'est pas, à proprement parler, un médiocre ou alors il s'agit d'un médiocre d'un type particulier, parfaitement moderne, fruit de «notre époque négative» (p. 31), au savoir purement livresque et qui joue la comédie, devant les autres, en récitant les grandes phrases qu'il a lues et qui remplissent sa boursouflure d'un mauvais rêve éternellement bavard : «Que je vous explique : cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement; du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade; et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux; qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre; que, même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer; et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer» (pp. 16-7).
Notre homme du souterrain tourne en rond, sa volonté porte à vide, n'a plus de poids, n'a plus la moindre importance dans un monde qui se moque des vieilles grandeurs antagonistes que sont le bien et le mal : «Parce que je suis coupable, enfin du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouverais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité» (p. 18).
L'homme creux, ce surgeon maléfique né dans la littérature du XIXe siècle et qui ne cessera de réapparaître au travers de centaines de masques (Folantin, Monsieur du Paur, Roquentin, Monsieur Ouine, etc.), veut faire le bien mais ne comprend guère quel hypothétique intérêt il va pouvoir en tirer. Faire le mal, alors, ne sera pas tant le résultat d'une décision mûrement réfléchie que la pente suivie d'une torturante facilité.
Le médiocre se laisse aller, comme on dit.
Tel un démon écrivais-je, ce qui signifie encore que le diable n'existe pas réellement dans Les Carnets du sous-sol en tant que personnage, mais bel et bien en tant que volonté maligne, de la part de l'écrivain, de conduire jusqu'à ses ultimes limites la conscience d'un homme qui ne s'aime pas. Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons comprendre le jugement de Charles du Bos qui écrit : «Pour ma part, je n'éprouve son action [celle de Satan] sans cesse présente que dans l'oeuvre de Dostoïevsky (sic). Son action comme facteur, car nous vivons ici un phénomène qui se situe en une zone autrement profonde que celle d'où relève l'apparition ou au moins l'abstention d'un personnage. Ce n'est pas parce que Dostoïevski fait intervenir le diable dans ses romans, mais bien à cause de l'espèce fuligineuse de son génie, des procédés de son art d'une casuistique d'autant plus retorse que fallacieusement ingénue, de certains traits de la nature de l'homme […] que je le tiens pour démoniaque; — et, si je le tiens pour démoniaque, il va de soi que c'est parce que je me rallie de tous points à cette vue de Gide le concernant : «Je crois que nous atteignons avec [les Notes d'un souterrain] le sommet de la carrière de Dostoïevski. Je considère ce livre (et je ne suis pas le seul) comme la clef de voûte de son oeuvre entière». Or, [cette oeuvre] figure, à mon gré, le chef-d'oeuvre du démon dans l'ordre littéraire. Il le figure non seulement en fonction de «la rumination du cerveau», mais davantage encore pour le caractère du cheminement, tout ensemble par le labeur de la sape et par le dédale des boyaux. le démon est avant tout souterrain […]» (3).
Souterrain et incroyablement bavard, aussi, l'anti-héros de l'écrivain russe étant finalement le père, dont l'esprit est accablé de lectures (4), des personnages de Camus (le Jean-Baptiste Clamence de la Chute) et de Louis-René des Forêts (dans le Bavard) : «[…] je ne suis qu'un bavard inoffensif, rien qu'un bavard inoffensif et contrariant, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire quand la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage, c'est-à-dire d'agiter les bras pour faire du vent ?» (p. 29).
Ainsi, parce qu'il s'est réfugié dans un anti-monde qui a de moins en moins de liens avec le monde véritable et la vie réelle, la bouche d'ombre du souterrain est décrite par Dostoïevski comme une espèce de chimère, la création véritablement malade d'une époque ayant perdu, pour employer une expression de Kierkegaard, le sens de la verte primitivité, une civilisation dont l'unique but, semble-t-il, est d'accroître une sensibilité privée d'objet (5), tout entière dévorée par une intelligence qui est condamnée à un monologue perpétuel, un ressassement infini : «Car raconter, par exemple, de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt; le roman a besoin d'un héros et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros et puis, surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude, même, qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la «vie vivante», et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ?» (p. 164).
Nous en sommes arrivés à un monde qui, comme s'il s'agissait d'une réunion de sabbat, hurle autour du feu en ravageant la création et en brûlant les pauvres, dont les cendres alimentent l'immense machine dont le rêve ultime est de prendre notre place et puis, peut-être, de s'élancer dans les gouffres de l'espace pour y retrouver son créateur, dont elle gardera la très lointaine nostalgie.
«Nous sommes tous morts-nés, conclut Dostoïevski, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes, et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt nous inventerons un moyen pour naître d'une idée» (p. 165).
En attendant ce jour qui, à vrai dire, est déjà le nôtre, annonçant le long monologue de l'homme ayant trébuché ou plutôt chuté comme l'imaginera Albert Camus, faux-pas et chute qui lui apprendront qu'il n'est plus rien de vivant puisqu'il a failli à sa tâche, Dostoïevski aura tendu à notre apocalypse festive et légère un miroir où grimace sa face de démon, son plus fidèle portrait sans doute (6).
L'enregistrement aussi, effrayant dans sa monotonie, d'une voix d'outre-tombe, la voix de la nuit évoquée par Marcel Beyer.
Notes
(1) «Oui, est-ce possible, enfin, est-ce possible que l'on s'estime encore un tant soit peu si l'on a essayé de chercher du plaisir même dans la sensation de son propre abaissement ?» (Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol [1864], Éditions Actes Sud, coll. Babel, traduction d'André Markowicz, lecture de Francis Marmande, 1993), p. 26.
(2) Op. cit., p. 16.
(3) Charles du Bos, Qu'est-ce que la littérature ? (Plon, coll. Présences, 1946), pp. 308-9.
(4) «[…] et une idylle, encore, de poudre aux yeux, livresque, inventée […]» (p. 141).
(5) «Qu'est-ce donc qu'elle adoucit en nous, la civilisation ? Tout ce que fait la civilisation, c'est qu'elle amène à une plus grande complexité de sensations… absolument rien d'autre» (p. 35).
(6) «Car s'il est une conviction chez Dostoïevski, c'est bien l'irrémissible rupture, à partir des Lumières, que provoque l'autodéification de l'homme, fêlure ontologique qui excède le cours des révolutions et par laquelle l'homme, singeant l'Absent, se fuit, précipite sa perte et rencontre l'échec en affirmant une impossible liberté, d'abord tragi-comique, puis proprement infernale. Loin de réécrire les mythes anciens du vol solaire ou du feu dérobé, c'est à une descente dans les basses-fosses de la modernité, là où s'élabore la fiction du sujet autonome, qu'il s'emploie», in Jean-François Colosimo, L'Apocalypse russe. Dieu au pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), p. 177.
Cette très acérée chronique fut - lamentablement - captée, et illico reproduite ici par votre humble chroniqueur (paresseux), sur le blog de Juan Asensio qu'il a intitulé Stalker (en référence au célèbre film de Tarkovski).
Le lien pour ceux qui chercheraient à en savoir plus sur cette plume très accrocheuse, c'est ici : http://www.juanasensio.com/archive/2010/09/20/les-carnets-du-sous-sol-dostoievski-zapiski-iz-podpolia.html
Un autre point de vue sur ce texte incroyable du grand romancier russe, avec un angle d'attaque vraiment intéressant, se trouve ici : http://revuepostures.com/fr/articles/leguerrier-18
Quelle est donc cette voix qui nous parle du fond de la nuit ?
Elle nous semble si familière que nous hésitons à croire qu'elle n'est pas sortie de notre propre bouche fiévreuse, un soir de cauchemar, le petit matin suintant lentement dans notre conscience, chargé des paroles terribles.
Il parle, il parle, il parle, nous dit Dostoïevski de son personnage, enfermé dans une cave pendant quarante années et, lorsqu'il en sort, pour quelque virée nocturne avec des soudards qui se terminera auprès d'une jeune prostituée qu'il souillera dans sa touchante pureté, c'est encore précédé des ténèbres de l'humiliation volontaire, de la soif de l'abaissement (1), de mille paroles bruissantes et rampantes, comme si l'homme du souterrain avait donné un coup de pied dans un nid de vipères dont il ne pouvait plus se débarrasser.
Pour Pietro Citati, cette ivresse de la haine et du mépris qu'un homme peut retourner contre lui-même bien plus que contre les autres est une des caractéristiques du Mal absolu sur lequel Francis Marmande, auteur d'une postface sans intérêt (pour la collection Babel) citant Guibert, Bataille, Leiris et même Duras, n'écrit pas un seul mot. Inexistence de ces pré et postfaciers qui semblent ne point savoir lire.
C'est encore Pietro Citati qui écrit que le héros, ou plutôt l'anti-héros absolu peint par Dostoïevski est un exemple, le premier sans doute, d'homme creux. L'image est facile et en partie fausse. C'est peut-être, en effet, ne pas tenir compte d'un certain nombre d'indices allant contre l'opinion de Citati, indices pour le moins insistants, le premier d'entre eux étant que Dostoïevski n'a pas voulu imaginer un homme qui fut complètement médiocre. le bavard des Carnets du sous-sol n'est certainement pas le minable Peredonov de Sologoub, un personnage absolument grotesque qui semble, décidément, hors de portée du plus puissant des bons samaritains, comme s'il se tenait, ainsi que Monsieur Ouine, hors de toute atteinte. Ne se révolte-t-il pas, même, contre le cartésianisme qui, à ses yeux, paraît avoir aplani le monde ?
L'homme médiocre est plat. Il refuse le risque de la profondeur, celle de l'amour ou celle du Mal volontaire.
Le médiocre est l'homme qui ne veut point du secours des autres hommes. Il est l'idiot, au sens étymologique du terme, celui qui ne veut point être relié à la communauté des vivants, l'îlot de perdition.
Notre médiocre, lui, même s'il appartient peut-être à cette catégorie, plus maudite que celle des «âmes perverties», des «âmes habituées» selon Charles Péguy, est tiraillé par la pureté, qu'il flaire d'ailleurs, comme un démon véritable, dans le coeur de la jeune prostituée venant chez lui après leur première rencontre, avec laquelle il couchera et qu'il humiliera en lui glissant un billet dans la main au moment de sa fuite, entièrement provoquée par les lamentables propos qu'il tient contre elle. Ne pouvant accomplir le bien, il lui reste à devenir vil. Comprenant que cette femme pourrait le sauver dans son infernale misère, le personnage de Dostoïevski tentera par tous les moyens de la blesser, de salir la petite flamme claire qui danse dans son coeur. Cette haine de la lumière n'est que la forme extrême de la conscience de sa propre misère, lorsque l'angoisse est la conséquence d'une certitude aussi douloureuse qu'aveuglante, ramassée en peu de mots par le grand Pascal lorsqu'il écrivit misère de l'homme : «Je sentais quelque chose qui refusait de mourir au fond de moi, dans le fond de mon coeur, de ma conscience, qui s'obstinait à ne pas mourir, qui se traduisait en angoisse brûlante» (p. 139).
Comme un véritable démon écrivais-je, car lui seul, comprenant que le bien qu'il ne peut toucher et qui brûle son regard est l'unique réalité, n'a de cesse de s'enfoncer dans le désespoir qu'il creuse, par l'action de sa propre volonté. En clair, il se dévore : «Plus je prenais conscience du bien, de tout ce «beau» et ce «sublime», écrit ainsi Dostoïevski, plus je m'engluais dans mon marais, et plus j'étais capable de m'y noyer complètement» (2).
C'est que l'homme creux tel que nous le peint l'écrivain russe n'est pas, à proprement parler, un médiocre ou alors il s'agit d'un médiocre d'un type particulier, parfaitement moderne, fruit de «notre époque négative» (p. 31), au savoir purement livresque et qui joue la comédie, devant les autres, en récitant les grandes phrases qu'il a lues et qui remplissent sa boursouflure d'un mauvais rêve éternellement bavard : «Que je vous explique : cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement; du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade; et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux; qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre; que, même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer; et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer» (pp. 16-7).
Notre homme du souterrain tourne en rond, sa volonté porte à vide, n'a plus de poids, n'a plus la moindre importance dans un monde qui se moque des vieilles grandeurs antagonistes que sont le bien et le mal : «Parce que je suis coupable, enfin du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouverais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité» (p. 18).
L'homme creux, ce surgeon maléfique né dans la littérature du XIXe siècle et qui ne cessera de réapparaître au travers de centaines de masques (Folantin, Monsieur du Paur, Roquentin, Monsieur Ouine, etc.), veut faire le bien mais ne comprend guère quel hypothétique intérêt il va pouvoir en tirer. Faire le mal, alors, ne sera pas tant le résultat d'une décision mûrement réfléchie que la pente suivie d'une torturante facilité.
Le médiocre se laisse aller, comme on dit.
Tel un démon écrivais-je, ce qui signifie encore que le diable n'existe pas réellement dans Les Carnets du sous-sol en tant que personnage, mais bel et bien en tant que volonté maligne, de la part de l'écrivain, de conduire jusqu'à ses ultimes limites la conscience d'un homme qui ne s'aime pas. Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons comprendre le jugement de Charles du Bos qui écrit : «Pour ma part, je n'éprouve son action [celle de Satan] sans cesse présente que dans l'oeuvre de Dostoïevsky (sic). Son action comme facteur, car nous vivons ici un phénomène qui se situe en une zone autrement profonde que celle d'où relève l'apparition ou au moins l'abstention d'un personnage. Ce n'est pas parce que Dostoïevski fait intervenir le diable dans ses romans, mais bien à cause de l'espèce fuligineuse de son génie, des procédés de son art d'une casuistique d'autant plus retorse que fallacieusement ingénue, de certains traits de la nature de l'homme […] que je le tiens pour démoniaque; — et, si je le tiens pour démoniaque, il va de soi que c'est parce que je me rallie de tous points à cette vue de Gide le concernant : «Je crois que nous atteignons avec [les Notes d'un souterrain] le sommet de la carrière de Dostoïevski. Je considère ce livre (et je ne suis pas le seul) comme la clef de voûte de son oeuvre entière». Or, [cette oeuvre] figure, à mon gré, le chef-d'oeuvre du démon dans l'ordre littéraire. Il le figure non seulement en fonction de «la rumination du cerveau», mais davantage encore pour le caractère du cheminement, tout ensemble par le labeur de la sape et par le dédale des boyaux. le démon est avant tout souterrain […]» (3).
Souterrain et incroyablement bavard, aussi, l'anti-héros de l'écrivain russe étant finalement le père, dont l'esprit est accablé de lectures (4), des personnages de Camus (le Jean-Baptiste Clamence de la Chute) et de Louis-René des Forêts (dans le Bavard) : «[…] je ne suis qu'un bavard inoffensif, rien qu'un bavard inoffensif et contrariant, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire quand la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage, c'est-à-dire d'agiter les bras pour faire du vent ?» (p. 29).
Ainsi, parce qu'il s'est réfugié dans un anti-monde qui a de moins en moins de liens avec le monde véritable et la vie réelle, la bouche d'ombre du souterrain est décrite par Dostoïevski comme une espèce de chimère, la création véritablement malade d'une époque ayant perdu, pour employer une expression de Kierkegaard, le sens de la verte primitivité, une civilisation dont l'unique but, semble-t-il, est d'accroître une sensibilité privée d'objet (5), tout entière dévorée par une intelligence qui est condamnée à un monologue perpétuel, un ressassement infini : «Car raconter, par exemple, de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt; le roman a besoin d'un héros et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros et puis, surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude, même, qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la «vie vivante», et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ?» (p. 164).
Nous en sommes arrivés à un monde qui, comme s'il s'agissait d'une réunion de sabbat, hurle autour du feu en ravageant la création et en brûlant les pauvres, dont les cendres alimentent l'immense machine dont le rêve ultime est de prendre notre place et puis, peut-être, de s'élancer dans les gouffres de l'espace pour y retrouver son créateur, dont elle gardera la très lointaine nostalgie.
«Nous sommes tous morts-nés, conclut Dostoïevski, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes, et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt nous inventerons un moyen pour naître d'une idée» (p. 165).
En attendant ce jour qui, à vrai dire, est déjà le nôtre, annonçant le long monologue de l'homme ayant trébuché ou plutôt chuté comme l'imaginera Albert Camus, faux-pas et chute qui lui apprendront qu'il n'est plus rien de vivant puisqu'il a failli à sa tâche, Dostoïevski aura tendu à notre apocalypse festive et légère un miroir où grimace sa face de démon, son plus fidèle portrait sans doute (6).
L'enregistrement aussi, effrayant dans sa monotonie, d'une voix d'outre-tombe, la voix de la nuit évoquée par Marcel Beyer.
Notes
(1) «Oui, est-ce possible, enfin, est-ce possible que l'on s'estime encore un tant soit peu si l'on a essayé de chercher du plaisir même dans la sensation de son propre abaissement ?» (Fédor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol [1864], Éditions Actes Sud, coll. Babel, traduction d'André Markowicz, lecture de Francis Marmande, 1993), p. 26.
(2) Op. cit., p. 16.
(3) Charles du Bos, Qu'est-ce que la littérature ? (Plon, coll. Présences, 1946), pp. 308-9.
(4) «[…] et une idylle, encore, de poudre aux yeux, livresque, inventée […]» (p. 141).
(5) «Qu'est-ce donc qu'elle adoucit en nous, la civilisation ? Tout ce que fait la civilisation, c'est qu'elle amène à une plus grande complexité de sensations… absolument rien d'autre» (p. 35).
(6) «Car s'il est une conviction chez Dostoïevski, c'est bien l'irrémissible rupture, à partir des Lumières, que provoque l'autodéification de l'homme, fêlure ontologique qui excède le cours des révolutions et par laquelle l'homme, singeant l'Absent, se fuit, précipite sa perte et rencontre l'échec en affirmant une impossible liberté, d'abord tragi-comique, puis proprement infernale. Loin de réécrire les mythes anciens du vol solaire ou du feu dérobé, c'est à une descente dans les basses-fosses de la modernité, là où s'élabore la fiction du sujet autonome, qu'il s'emploie», in Jean-François Colosimo, L'Apocalypse russe. Dieu au pays de Dostoïevski (Fayard, 2008), p. 177.
Cette très acérée chronique fut - lamentablement - captée, et illico reproduite ici par votre humble chroniqueur (paresseux), sur le blog de Juan Asensio qu'il a intitulé Stalker (en référence au célèbre film de Tarkovski).
Le lien pour ceux qui chercheraient à en savoir plus sur cette plume très accrocheuse, c'est ici : http://www.juanasensio.com/archive/2010/09/20/les-carnets-du-sous-sol-dostoievski-zapiski-iz-podpolia.html
Un autre point de vue sur ce texte incroyable du grand romancier russe, avec un angle d'attaque vraiment intéressant, se trouve ici : http://revuepostures.com/fr/articles/leguerrier-18
Quelques mots enfin, pour vous parler d'un roman de Dostoïevski (1821-1881) un peu moins connu que ses grands classiques que sont « l'Idiot », « les frères Karamazov » et qui s'intitule donc « Les carnets du sous-sol ». C'est là aussi un de mes livres de chevet, d'une beauté à couper le souffle tant l'on est emporté par son style. Si Dostoïevski est un génie absolu de la littérature c'est parce qu'il a su comme personne parler de nos travers, de nos forces mais aussi de nos faiblesses, de ce vide qui parfois nous saisis d'effroi. le narrateur vit à Saint Pétersbourg où il n'est qu'un petit fonctionnaire comme tant d'autres. C'est dans ses carnets qu'il peut laisser jaillir toute la rancoeur qui s'est accumulée contre ce monde qui lui paraît insupportable. Ce roman est considéré par certains intellectuels comme étant l'un des tous premiers textes existentialistes. Un livre absolument fascinant peuplé d'une galerie de personnages qui ne semblent pas si éloignés de nos revendications d'homme « moderne « perdu entre ce besoin d'amour, de l'autre et en même tant cette incapacité profonde à se sentir bien ensemble, ou comment la solitude et l'amélioration des moyens de communication moderne semble curieusement allez de paire, contradiction de nos sociétés modernes.
Lien : https://thedude524.com/2009/..
Lien : https://thedude524.com/2009/..
L'homme dont il est question se présente d'emblée comme un homme méchant, détestable, voire monstrueux, mais au fil des pages, on le découvre bien davantage d'une lucidité acérée, pour dénoncer les tentatives "scientifiques" de faire le bonheur de l'homme. Et l'avenir, le goulag, lui donneront bien raison. Il recherche en outre la vérité absolue et donc la dégage de toute tartuferie, bons sentiment pour arriver à l'os - en prémice de la psychanalyse. L'homme n'est pas guidé par ce qui est bon pour lui, mais par des moteurs plus obscurs - on pourrait appeler ça les bénéfices cachés dont parle la psychanalyse. Dans un format court, Dostoïevsky parvient efficacement à imposer la littérature comme vecteur de connaissance de soi - et non comme "évasion", "distraction", et "recettes du bonheur". Il pose déjà les bases du personnage dostoïevskien que l'on retrouvera dans ses autres romans, comme l'Idiot, les Démons, où les personnages semblent animés par des pulsions chaotiques. L'orgueil aussi, le décalage du personnage par rapport à ses contemporains, qui grandit, au point de devenir une barrière empêchant toute évolution. Ces contemporains, "des moutons", exacerbent cette colère qui le renvoie également à son incapacité à donner une autre tournure à sa destinée, dans un mécanisme pervers et irrépressible. le décalage, ce surcroît d'intelligence et de sensibilité, naît aussi de sa condition - il est orphelin - comme plus tard le héros de l'Adolescent.
Donc un ouvrage court mais dense, qui prépare déjà les oeuvres magistrales à venir et qui consacre la littérature comme élément puissant et incontournable de la connaissance, de la résistance aux recettes de bonheur toutes faites et d'une universalité à fonder dans une introspection sans concessions - "Madame Bovary c'est moi", disait déjà Flaubert.
L'option "sourcière" de la traduction d'André Markowicz trouve ici également toute sa légitimité et sa pertinence. L'homme dont il est question habite dans un sous-sol comme il en existe beaucoup dans les villes modernes et non dans un mythique souterrain !
Donc un ouvrage court mais dense, qui prépare déjà les oeuvres magistrales à venir et qui consacre la littérature comme élément puissant et incontournable de la connaissance, de la résistance aux recettes de bonheur toutes faites et d'une universalité à fonder dans une introspection sans concessions - "Madame Bovary c'est moi", disait déjà Flaubert.
L'option "sourcière" de la traduction d'André Markowicz trouve ici également toute sa légitimité et sa pertinence. L'homme dont il est question habite dans un sous-sol comme il en existe beaucoup dans les villes modernes et non dans un mythique souterrain !
Pour une fois qu'il fait court Fédor Dostoïevski aurait pu faire encore plus court pour nous décrire la névrose de son personnage résumée par:
(...) D'abord, déjà, je ne pouvais pas l'aimer, parce que, je le répète, aimer, pour moi, cela signifiait tyranniser et dominer moralement"(...) p.159
Voir aussi l'analyse de l'ouvrage par Alain Finkielkraut dans "Un coeur intelligent"
(...) D'abord, déjà, je ne pouvais pas l'aimer, parce que, je le répète, aimer, pour moi, cela signifiait tyranniser et dominer moralement"(...) p.159
Voir aussi l'analyse de l'ouvrage par Alain Finkielkraut dans "Un coeur intelligent"
Lorsque l'on parle Fiodor Dostoïevki, on ne pense pas nécessairement à ces « Carnets du sous-sol » (ou « Notes d'un souterrain », « Dans mon souterrain ». Pourtant ce court roman (ou nouvelle longue) mérite que l'on s'y attarde. L'ouvrage se divise en deux parties différentes mais ayant pour trait commun d'être racontées par le même narrateur, un quadragénaire aigri, amer et solitaire qui jette un oeil peu amène sur sa société et son prochain. Tout est fait pour nous le rendre antipathique... et ça marche ! L'intention de l'auteur fut, à travers ce personnage execrable, de « montrer au public, avec plus de force que d'habitude, l'un de ces caractères de l'époque contemporaine » (F. Dostoïevski). Dans la forme, le roman se présente comme un journal intime.
La première partie nous plonge dans les pensées du narrateur ; long monologue pessimiste et noir imprégné de philosophie. C'est une charge cynique et satirique venant d'un homme désabusé et orgueilleux sur la société de son temps et des hommes qui la composent. Je dois admettre ne pas avoir adhéré à ce long réquisitoire. Ce dernier m'a plus ennuyé que captivé. L'exercice de style et les réflexions déployés m'ont paru indigestes et je n'ai finalement retenu que peu de choses de ces pensées.
Dans la seconde partie, ce même narrateur nous dévoile un de ses souvenirs, datant de l'époque de ses vingt-quatre ans. Dostoïevski fait partager au lecteur à la fois les pensées introspectives de son personnage mais aussi son regard et son comportement vis-à-vis des autres. Autant dire que sa mentalité et ses actions sont dominées par la méchanceté, qu'il justifie lui-même par une enfance difficile. le lecteur est dès lors secoué par de nombreuses sensations et sentiments : malaise, pitié, exaspération,... mais rarement de la compassion. Nul doute qu'un telle personnalité, aussi exagérée soit-elle, possède un profond intérêt psychologique. Cette plongée dans l'esprit torturé du narrateur nous bouscule comme on aime être bousculé.
En conclusion, si j'ai beaucoup apprécié le second texte de ces « Carnets du sous-sol », le premier plombe un peu plus mon enthousiasme. Ce livre est à lire à la fois pour les émotions qu'il véhicule mais aussi pour son apport intellectuel.
La première partie nous plonge dans les pensées du narrateur ; long monologue pessimiste et noir imprégné de philosophie. C'est une charge cynique et satirique venant d'un homme désabusé et orgueilleux sur la société de son temps et des hommes qui la composent. Je dois admettre ne pas avoir adhéré à ce long réquisitoire. Ce dernier m'a plus ennuyé que captivé. L'exercice de style et les réflexions déployés m'ont paru indigestes et je n'ai finalement retenu que peu de choses de ces pensées.
Dans la seconde partie, ce même narrateur nous dévoile un de ses souvenirs, datant de l'époque de ses vingt-quatre ans. Dostoïevski fait partager au lecteur à la fois les pensées introspectives de son personnage mais aussi son regard et son comportement vis-à-vis des autres. Autant dire que sa mentalité et ses actions sont dominées par la méchanceté, qu'il justifie lui-même par une enfance difficile. le lecteur est dès lors secoué par de nombreuses sensations et sentiments : malaise, pitié, exaspération,... mais rarement de la compassion. Nul doute qu'un telle personnalité, aussi exagérée soit-elle, possède un profond intérêt psychologique. Cette plongée dans l'esprit torturé du narrateur nous bouscule comme on aime être bousculé.
En conclusion, si j'ai beaucoup apprécié le second texte de ces « Carnets du sous-sol », le premier plombe un peu plus mon enthousiasme. Ce livre est à lire à la fois pour les émotions qu'il véhicule mais aussi pour son apport intellectuel.
Enfin j'en termine avec cette première incursion dans la littérature russe. Un petit roman de moins de 200 pages que j'ai mis plus de 3 semaines à lire, pas que le récit soit inintéressant, bien au contraire. C'est dense et certains passages méritent qu'on s'y arrête. J'ai été tantôt happée par le récit de ce narrateur dépressif et paranoïaque, tantôt ennuyée par sa vision négative et noire de la vie et de la société dans lesquelles il vit. Mais c'est globalement une bonne surprise et le texte est très intéressant et puissant. Aucun doute que ma découverte de la littérature russe ne va pas s'arrêter là.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Fiodor Dostoïevski (141)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Crime et Châtiment
Qui est le meurtrier ?
Raskolnikov
Raspoutine
Raton-Laveur
Razoumikhine
9 questions
197 lecteurs ont répondu
Thème : Crime et Châtiment de
Fiodor DostoïevskiCréer un quiz sur ce livre197 lecteurs ont répondu