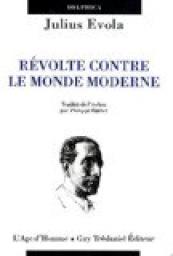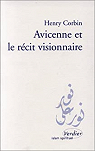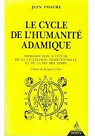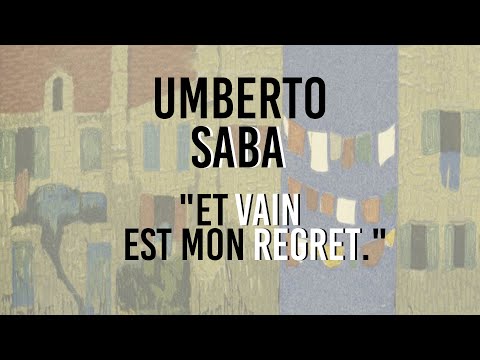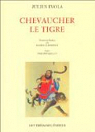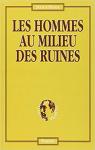« […] Jour après jour, Saba - de son vrai nom Umberto Poli (1883-1957) - compose le “livre d'heures“ d'un poète en situation de frontière, il scrute cette âme et ce coeurs singuliers qui, par leur tendresse autant que leur perversité, par la profondeur de leur angoisse, estiment pouvoir parler une langue exemplaire. […]
[…] Au secret du coeur, dans une nuit pétrie d'angoisse mais consolée par la valeur que le poète attribue à son tourment, cette poésie est une étreinte : à fleur de peau, de voix, une fois encore sentir la présence de l'autre, porteur d'une joie qu'on n'espérait plus. […]
Jamais Saba n'avait été aussi proche de son modèle de toujours, Leopardi (1798-1837) ; jamais poèmes n'avaient avoué semblable dette à l'égard de l'Infini. le Triestin rejoint l'auteur des Canti dans une sorte d'intime immensité. […]
[…] Comme le souligne Elsa Morante (1912-1985), Saba est plutôt l'un des rares poètes qui, au prix d'une tension infinie, ait élevé la complexité du destin moderne à hauteur d'un chant limpide. Mais limpidité n'est pas édulcoration, et permet au lecteur de percevoir deux immensités : le dédale poétique, l'infinie compassion. » (Bernard Simeone, L'étreinte.)
« […] La première édition du Canzoniere, qui regroupe tous ses poèmes, est fort mal accueillie par la critique en 1921. […] Le Canzoniere est un des premiers livres que publie Einaudi après la guerre […] L'important prix Vareggio de poésie, obtenu en 1946, la haute reconnaissance du prix Etna-Taormina ou du prix de l'Accademia dei Lincei, ne peuvent toutefois tirer le poète d'une profonde solitude, à la fois voulue et subie : il songe au suicide, s'adonne à la drogue. En 1953, il commence la rédaction d'Ernesto, son unique roman, qui ne paraîtra, inachevé, qu'en 1975. […] »
0:00 - Titre
0:06 - Trieste
1:29 - le faubourg
5:27 - Lieu cher
5:57 - Une nuit
6:32 - Variations sur la rose
7:15 - Épigraphe
7:30 - Générique
Contenu suggéré :
Giacomo Leopardi : https://youtu.be/osdD2h8C0uw
Marco Martella : https://youtu.be/R9PPjIgdF2c
Iginio Ugo Tarchetti : https://youtu.be/hnV93QZ6O1s
Guido Ceronetti : https://youtu.be/mW1avxXaSKI
Alberto Moravia : https://youtu.be/MgIVofYEad4
Pier Paolo Pasolini : https://youtu.be/-sWZYlXVZ-U
Cesare Pavese : https://youtu.be/uapKHptadiw
Dino Buzzati : https://youtu.be/ApugRpPDpeQ
Sibilla Aleramo : https://youtu.be/Y24Vb0zEg7I
Julius Evola : https://youtu.be/coQoIwvu7Pw
Giovanni Papini : https://youtu.be/tvirKnRd7zU
Alessandro Baricco : https://youtu.be/¤££¤74Giuseppe Ungaretti64¤££¤80
Giuseppe Ungaretti : https://youtu.be/_k1bTPRkZrk
LES FILS DE LA LOUVE : https://youtu.be/ar3uUF-iuK0
INTRODUCTION À LA POÉSIE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQQhGn9_3w8rtiqkMjM0D1L-33¤££¤76LES FILS DE LA LOUVE77¤££¤
AUTEURS DU MONDE (P-T) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQQhGn9_3w8pPO4gzs6¤££¤39LES FILS DE LA LOUVE75¤££¤8
PÈLERINS DANS LA NUIT SOMBRE : https://youtu.be/yfv8JJcgOVM
Référence bibliographique :
Umberto Saba, du Canzoniere, choix traduit par Philippe et Bernard Simeone, Paris, Orphée/La Différence, 1992.
Image d'illustration :
https://itinerari.comune.trieste.it/en/the-trieste-of-umberto-saba/
Bande sonore originale : Maarten Schellekens - Hesitation
Hesitation by Maarten Schellekens is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Site :
https://freemusicarchive.org/music/maarten-schellekens/soft-piano-and-guitar/hesitation/
#UmbertoSaba #Canzoniere #PoésieItalienne

Julius Evola/5
21 notes
Résumé :
Initialement paru en 1934, traduit en allemand un an après, " Révolte contre le monde moderne " est considéré comme l'ouvrage le plus important de Julius Evola (1898-1974). Ce livre prouve que déjà à cette époque, les bases d'une révolte globale contre la civilisation contemporaine avaient été posées, révolte en comparaison de laquelle la " contestation " qui s'est exprimée à la fin des années soixante du XXe siècle apparaît chaotique et invertébrée. Au-delà des der... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Révolte contre le monde moderneVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Livre très intéressant. Je vais essayer d'en faire un résumé impersonnel pour que personne ne vienne me faire chier avec ses petites opinions personnelles politiques à deux francs cinquante.
Sujet principal : la décadence dont serait victime notre monde moderne suite à l'éloignement de l'homme d'avec la Tradition.
Moyen de la démonstration : Etude de l'involution parcourue depuis l'âge d'or jusqu'au dernier âge (le kalî-yuga hindou décrit dans le Vishnu-Purâna).
Première partie : Qu'est-ce que le monde de la Tradition ?
- Une conception de la réalité plus vaste.
- Une royauté qui garde la qualité symbolique et solaire de l'invictus : juste milieu, centralité.
- Une royauté également rattachée au symbole polaire avec l'idée effective d'un centre du monde exerçant une fonction suprême sur terre.
- Caractère divin de la loi. (on pense que c'est un droit de contester la loi mais c'est en fait la conséquence de son usurpation ; on ne conteste pas ce qui est bon).
- Respect du rite comme véritable ciment de l'unité familiale, de la gens.
- Caractère primordial du patriciat.
- Importance de la virilité spirituelle qui définit la primauté de la loi de l'action plutôt qu'un état de contemplation reclus du monde.
- Respect naturel de la hiérarchie comme ordre du monde n'incluant aucun jugement de valeur ou de mérite, excluant d'emblée la compétition pour des fins égoïstes et personnelles. Doctrine des castes.
- Initiation de la royauté.
- La royauté a la primauté sur le sacerdoce.
- Ame de la chevalerie.
- Profession considérée comme un art, comme une vocation, porteuse d'une véritable initiation par le biais de la transmission.
- Ascèse virile et aristocratique, dictée par la force et non pas le besoin. Alimente les forces de stabilité et de centralité.
- Petite et grande guerre saintes au coeur de l'homme pour surmonter sa nature inférieure, son attachement matériel.
- Nature du temps non linéaire mais en devenir : « le temps n'est pas une quantité, mais une qualité ; il n'est pas série, mais rythme. Il ne s'écoule pas uniformément et indéfiniment, mais se fracture en cycles, en périodes, dont chaque moment a un sens, donc une valeur spécifique par rapport à tous les autres moments, une individualité vivante et une fonctionnalité propre ».
- Caractère sacré de la terre : sa possession ou sa maîtrise est un engagement spirituel, pas seulement politique.
Deuxième partie : Signes de la dégénérescence moderne :
- Passage d'une terre individuelle à une terre collective : « L'idée […] que l'apparition du « testament » au sens d'une liberté individualiste laissée aux possédants de diviser leur propriété, de la désintégrer d'une manière ou d'une autre, de la détacher de l'héritage du sang et des normes rigoureuses du droit patriarcal et du droit d'aînesse, est un des signes typiques de la dégénérescence de la mentalité traditionnelle […] ».
- Féminisation de la spiritualité : apparition des figures divines chtoniennes, civilisation de la Mère. Transposition métaphysique de la femme en tant que principe et substance de la génération. Chaque être, conçu comme son fils, lui est conditionné, subordonné, privé de vie propre.
- Féminisme dénaturé, qui ignore la force traditionnelle de la femme, celle-ci ne pouvant s'affirmer qu'à condition qu'il existe une force virile, centrale, solaire : « Après des siècles d' « esclavage », la femme a donc voulu être libre, vivre pour elle-même. Mais le « féminisme » a été incapable de concevoir pour la femme une personnalité, sinon en imitant la personnalité masculine, de sorte qu'il n'est pas excessif de dire que ses « revendications » masquent une défiance fondamentale de la nouvelle femme envers elle-même, son impuissance à être et à valoir en tant que femme, et non en tant qu'homme. [De plus, cet homme qu'elle imagine n'est] en rien l'homme vrai, mais […] l'homme-construction, l'homme fantoche d'une civilisation standardisée, rationalisée, n'impliquant quasiment plus rien de vraiment différencié et qualitatif ».
- Involution de la hiérarchie des castes. le pouvoir, initialement détenu par la royauté solaire, passe ensuite à l'oligarchie, puis à la bourgeoisie, enfin aux dominateurs illégitimes qui s'appuient sur le démos. « L'aristocratie cède le pas à la ploutocratie. le guerrier s'efface devant le banquier et l'industriel. L'économie triomphe sur toute la ligne. »
- Passage de l'universalité à la collectivité : « Il y a régression vers le collectif et non progrès vers l'universel, l'individu apparaissant de plus en plus incapable de s'affirmer, sinon en fonction de quelque chose qui lui fait perdre son identité. »
- Emancipation laïque de l'Etat par rapport à l'Eglise, celle-ci devenant l'associée de la caste bourgeoise et marchande, incapable d'assumer ses fonctions spirituelles.
- Apparition de l'humanisme qui justifie l'individualisme « comme constitution d'un centre illusoire en dehors du centre, comme prétention prévaricatrice d'un Moi qui est simplement le Moi mortel du corps […] ».
Que faire ? Rien, sinon informer de ce qui est en train de se passer pour mieux se préparer. Les civilisations ont des cycles : apogée, déclin, fin. Nous sommes sur le déclin, et proches de la fin. La civilisation va se tuer par ses propres défauts. Notre culte moderne de l'action, « au lieu d'être une voie vers le supra-individuel […] est une voie vers l'infra-individuel. Ce culte favorise et provoque des irruptions destructrices de l'irrationnel et du collectif dans les structures déjà vacillantes de la personnalité humaine ». Les anciens enseignements traditionnels disent qu'une « espèce de hiatus sépare deux cycles : il n'y aurait pas renaissance et relèvement progressifs, mais un nouveau commencement, une mutation brusque, correspondant à une manifestation d'ordre divin et métaphysique ». Les veilleurs prendront peut-être le flambeau pour constituer les germes de la nouvelle civilisation à venir. Ainsi, la Tradition ne meurt jamais. Espoir : « Si le dernier âge, le kalî-yuga, est un âge de destructions terribles, ceux qui y vivent et qui pourtant restent debout peuvent obtenir des fruits difficilement accessibles aux hommes des autres âges ».
Réfutation des préjugés qui pourraient servir à disqualifier cette oeuvre :
- Evola serait raciste. Non : pour Evola, la race biologique compte moins que le ralliement spirituel à la Tradition. « On défend parfois l'idée de la race. L'unité et la pureté du sang seraient au fondement de la vie et de la force d'une civilisation ; le mélange du sang serait la cause initiale de sa décadence. Mais il s'agit […] d'une illusion : une illusion qui rabaisse en outre l'idée de civilisation sur le plan naturaliste et biologique, puisque tel est le plan où l'on envisage aujourd'hui […] la race. »
- Evola serait misogyne. Pas plus que les autres : il reconnaît même une puissance supérieure de la femme qui s'affirme selon sa nature (méta-femme) : « La femme traditionnelle, la femme absolue, en se donnant, en ne vivant pas pour soi, mais en voulant être tout entière pour un autre être, avec simplicité et pureté, s'accomplissait […] avec un héroïsme spécifique –et, au fond, s'élevait au-dessus de l'homme commun ».
Limites de la démonstration :
- Dualisme exacerbé entre des peuples solaire/lunaire. Pousse-au-combat, un peu lassant.
- Disqualification de toute objection possible du fait de l'appartenance du lecteur à l'âge sombre. Evola pourrait dire : si vous jugez que mes propos sont immoraux, c'est parce que vous vivez dans l'âge sombre et que vous avez perdu tout rapport de réalité vraie avec la Tradition. (sauf si, bien sûr, on fait partie des quelques veilleurs ou excédés de la modernité). C'est peut-être vrai. Je ne sais pas encore.
Pour terminer, un extrait résumant bien le chaos qui secoue notre époque et qui, s'il peut aussi renvoyer à d'autres explications qu'à celles avancées par Evola, peut aussi très bien s'expliquer par sa démonstration :
« Lorsque le rythme est brisé, lorsque les contacts sont bloqués, lorsque le regard ne sait plus rien des grandes distances, toutes les voies semblent ouvertes et chaque domaine est saturé d'actions désordonnées, inorganiques privés de base et de sens profond, dominées par des motivations exclusivement temporelles et individuelles […]. La « culture », alors, ne veut plus dire réaliser son être propre dans l'adhérence sérieuse et la fidélité –elle signifie « se construire ». Et puisque la base de cette construction n'est autre que le sable mouvant de cette nullité qu'est le Moi empirique humain sans nom et sans tradition, on voit s'avancer la prétention à l'égalité, le droit pour chacun de pouvoir être, en théorie, tout ce qu'un autre peut être aussi.
[…] C'est alors le chaos des possibilités existentielles et psychiques, qui condamne la plupart des hommes à un état de disharmonie et de déchirement : chose qui se vérifie aujourd'hui. »
Parfois chiant parce qu'il se pose en « sujet supposé savoir », et parfois passionnant parce qu'il semble effectivement savoir.
Sujet principal : la décadence dont serait victime notre monde moderne suite à l'éloignement de l'homme d'avec la Tradition.
Moyen de la démonstration : Etude de l'involution parcourue depuis l'âge d'or jusqu'au dernier âge (le kalî-yuga hindou décrit dans le Vishnu-Purâna).
Première partie : Qu'est-ce que le monde de la Tradition ?
- Une conception de la réalité plus vaste.
- Une royauté qui garde la qualité symbolique et solaire de l'invictus : juste milieu, centralité.
- Une royauté également rattachée au symbole polaire avec l'idée effective d'un centre du monde exerçant une fonction suprême sur terre.
- Caractère divin de la loi. (on pense que c'est un droit de contester la loi mais c'est en fait la conséquence de son usurpation ; on ne conteste pas ce qui est bon).
- Respect du rite comme véritable ciment de l'unité familiale, de la gens.
- Caractère primordial du patriciat.
- Importance de la virilité spirituelle qui définit la primauté de la loi de l'action plutôt qu'un état de contemplation reclus du monde.
- Respect naturel de la hiérarchie comme ordre du monde n'incluant aucun jugement de valeur ou de mérite, excluant d'emblée la compétition pour des fins égoïstes et personnelles. Doctrine des castes.
- Initiation de la royauté.
- La royauté a la primauté sur le sacerdoce.
- Ame de la chevalerie.
- Profession considérée comme un art, comme une vocation, porteuse d'une véritable initiation par le biais de la transmission.
- Ascèse virile et aristocratique, dictée par la force et non pas le besoin. Alimente les forces de stabilité et de centralité.
- Petite et grande guerre saintes au coeur de l'homme pour surmonter sa nature inférieure, son attachement matériel.
- Nature du temps non linéaire mais en devenir : « le temps n'est pas une quantité, mais une qualité ; il n'est pas série, mais rythme. Il ne s'écoule pas uniformément et indéfiniment, mais se fracture en cycles, en périodes, dont chaque moment a un sens, donc une valeur spécifique par rapport à tous les autres moments, une individualité vivante et une fonctionnalité propre ».
- Caractère sacré de la terre : sa possession ou sa maîtrise est un engagement spirituel, pas seulement politique.
Deuxième partie : Signes de la dégénérescence moderne :
- Passage d'une terre individuelle à une terre collective : « L'idée […] que l'apparition du « testament » au sens d'une liberté individualiste laissée aux possédants de diviser leur propriété, de la désintégrer d'une manière ou d'une autre, de la détacher de l'héritage du sang et des normes rigoureuses du droit patriarcal et du droit d'aînesse, est un des signes typiques de la dégénérescence de la mentalité traditionnelle […] ».
- Féminisation de la spiritualité : apparition des figures divines chtoniennes, civilisation de la Mère. Transposition métaphysique de la femme en tant que principe et substance de la génération. Chaque être, conçu comme son fils, lui est conditionné, subordonné, privé de vie propre.
- Féminisme dénaturé, qui ignore la force traditionnelle de la femme, celle-ci ne pouvant s'affirmer qu'à condition qu'il existe une force virile, centrale, solaire : « Après des siècles d' « esclavage », la femme a donc voulu être libre, vivre pour elle-même. Mais le « féminisme » a été incapable de concevoir pour la femme une personnalité, sinon en imitant la personnalité masculine, de sorte qu'il n'est pas excessif de dire que ses « revendications » masquent une défiance fondamentale de la nouvelle femme envers elle-même, son impuissance à être et à valoir en tant que femme, et non en tant qu'homme. [De plus, cet homme qu'elle imagine n'est] en rien l'homme vrai, mais […] l'homme-construction, l'homme fantoche d'une civilisation standardisée, rationalisée, n'impliquant quasiment plus rien de vraiment différencié et qualitatif ».
- Involution de la hiérarchie des castes. le pouvoir, initialement détenu par la royauté solaire, passe ensuite à l'oligarchie, puis à la bourgeoisie, enfin aux dominateurs illégitimes qui s'appuient sur le démos. « L'aristocratie cède le pas à la ploutocratie. le guerrier s'efface devant le banquier et l'industriel. L'économie triomphe sur toute la ligne. »
- Passage de l'universalité à la collectivité : « Il y a régression vers le collectif et non progrès vers l'universel, l'individu apparaissant de plus en plus incapable de s'affirmer, sinon en fonction de quelque chose qui lui fait perdre son identité. »
- Emancipation laïque de l'Etat par rapport à l'Eglise, celle-ci devenant l'associée de la caste bourgeoise et marchande, incapable d'assumer ses fonctions spirituelles.
- Apparition de l'humanisme qui justifie l'individualisme « comme constitution d'un centre illusoire en dehors du centre, comme prétention prévaricatrice d'un Moi qui est simplement le Moi mortel du corps […] ».
Que faire ? Rien, sinon informer de ce qui est en train de se passer pour mieux se préparer. Les civilisations ont des cycles : apogée, déclin, fin. Nous sommes sur le déclin, et proches de la fin. La civilisation va se tuer par ses propres défauts. Notre culte moderne de l'action, « au lieu d'être une voie vers le supra-individuel […] est une voie vers l'infra-individuel. Ce culte favorise et provoque des irruptions destructrices de l'irrationnel et du collectif dans les structures déjà vacillantes de la personnalité humaine ». Les anciens enseignements traditionnels disent qu'une « espèce de hiatus sépare deux cycles : il n'y aurait pas renaissance et relèvement progressifs, mais un nouveau commencement, une mutation brusque, correspondant à une manifestation d'ordre divin et métaphysique ». Les veilleurs prendront peut-être le flambeau pour constituer les germes de la nouvelle civilisation à venir. Ainsi, la Tradition ne meurt jamais. Espoir : « Si le dernier âge, le kalî-yuga, est un âge de destructions terribles, ceux qui y vivent et qui pourtant restent debout peuvent obtenir des fruits difficilement accessibles aux hommes des autres âges ».
Réfutation des préjugés qui pourraient servir à disqualifier cette oeuvre :
- Evola serait raciste. Non : pour Evola, la race biologique compte moins que le ralliement spirituel à la Tradition. « On défend parfois l'idée de la race. L'unité et la pureté du sang seraient au fondement de la vie et de la force d'une civilisation ; le mélange du sang serait la cause initiale de sa décadence. Mais il s'agit […] d'une illusion : une illusion qui rabaisse en outre l'idée de civilisation sur le plan naturaliste et biologique, puisque tel est le plan où l'on envisage aujourd'hui […] la race. »
- Evola serait misogyne. Pas plus que les autres : il reconnaît même une puissance supérieure de la femme qui s'affirme selon sa nature (méta-femme) : « La femme traditionnelle, la femme absolue, en se donnant, en ne vivant pas pour soi, mais en voulant être tout entière pour un autre être, avec simplicité et pureté, s'accomplissait […] avec un héroïsme spécifique –et, au fond, s'élevait au-dessus de l'homme commun ».
Limites de la démonstration :
- Dualisme exacerbé entre des peuples solaire/lunaire. Pousse-au-combat, un peu lassant.
- Disqualification de toute objection possible du fait de l'appartenance du lecteur à l'âge sombre. Evola pourrait dire : si vous jugez que mes propos sont immoraux, c'est parce que vous vivez dans l'âge sombre et que vous avez perdu tout rapport de réalité vraie avec la Tradition. (sauf si, bien sûr, on fait partie des quelques veilleurs ou excédés de la modernité). C'est peut-être vrai. Je ne sais pas encore.
Pour terminer, un extrait résumant bien le chaos qui secoue notre époque et qui, s'il peut aussi renvoyer à d'autres explications qu'à celles avancées par Evola, peut aussi très bien s'expliquer par sa démonstration :
« Lorsque le rythme est brisé, lorsque les contacts sont bloqués, lorsque le regard ne sait plus rien des grandes distances, toutes les voies semblent ouvertes et chaque domaine est saturé d'actions désordonnées, inorganiques privés de base et de sens profond, dominées par des motivations exclusivement temporelles et individuelles […]. La « culture », alors, ne veut plus dire réaliser son être propre dans l'adhérence sérieuse et la fidélité –elle signifie « se construire ». Et puisque la base de cette construction n'est autre que le sable mouvant de cette nullité qu'est le Moi empirique humain sans nom et sans tradition, on voit s'avancer la prétention à l'égalité, le droit pour chacun de pouvoir être, en théorie, tout ce qu'un autre peut être aussi.
[…] C'est alors le chaos des possibilités existentielles et psychiques, qui condamne la plupart des hommes à un état de disharmonie et de déchirement : chose qui se vérifie aujourd'hui. »
Parfois chiant parce qu'il se pose en « sujet supposé savoir », et parfois passionnant parce qu'il semble effectivement savoir.
Alors que pour la plupart des historiens ou des politologues, la fracture entre l'ancien monde et le nouveau se situe à la Révolution Française, pour Julius Evola il faut remonter beaucoup plus loin, quasiment à la nuit des temps, quand le monde de la Tradition céda peu à peu la place à la modernité. Il faut aller jusqu'aux temps lointains de l'Egypte des Pharaons, de la Rome antique voire de l'Empire Inca pour retrouver trace de cette tradition primordiale. Dans ces mondes ignorant la modernité, toute la société était organisée autour du surnaturel, de la spiritualité dans une harmonie confondante. le monarque, de quelque nature qu'il fût, se devait d'être un être supérieur, d'essence divine ou quasi divine. Sans discussion possible, il était le centre, l'âme agissante de son Etat et le père aimant et aimé de son peuple. Quiconque aurait voulu s'opposer à sa volonté se se serait retrouvé à aller contre la volonté de Dieu lui-même. Il se serait mis lui-même au ban de la société. Ainsi, à l'origine ou à la disparition de toute civilisation se trouve la présence ou l'absence du fait divin…
« Révolte contre le monde moderne » est un essai de philosophie politique basé à la fois sur l'Histoire telle que nous l'entendons et sur les mythes, légendes et autres hypothèses archéologiques ou non (Atlantide, règne des Titans, traditions nordiques, iraniennes, hindoues, etc.) Evola base sa théorie sur les quatre cycles de l'Humanité (or, argent, bronze et fer). le premier serait celui de la divinité, celui du grand Monarque. Il aurait dégénéré en âge d'argent avec la prépondérance des guerriers avant de tomber dans celui du bronze le pouvoir passant entre les mains des bourgeois et des marchands. Depuis 1789 et surtout depuis la révolution russe de 1917, le fait spirituel aurait totalement disparu et le pouvoir serait tombé aux mains de la plèbe, de la caste la plus basse et la moins intelligente. Nous en serions au stade le plus bas de la décadence, à l'âge du fer, du Kali-Yuga. Pour aussi troublante qu'elle soit, cette théorie n'en demeure pas moins basée sur des prémisses discutables vu le peu de documents disponibles sur certaines époques. D'une lecture assez laborieuse, cet ouvrage important donne cependant énormément à réfléchir sur le fait que tout a sans doute toujours pas très bien fonctionné et que notre état de décadence semble déjà bien avancé !
Lien : http://www.bernardviallet.fr
« Révolte contre le monde moderne » est un essai de philosophie politique basé à la fois sur l'Histoire telle que nous l'entendons et sur les mythes, légendes et autres hypothèses archéologiques ou non (Atlantide, règne des Titans, traditions nordiques, iraniennes, hindoues, etc.) Evola base sa théorie sur les quatre cycles de l'Humanité (or, argent, bronze et fer). le premier serait celui de la divinité, celui du grand Monarque. Il aurait dégénéré en âge d'argent avec la prépondérance des guerriers avant de tomber dans celui du bronze le pouvoir passant entre les mains des bourgeois et des marchands. Depuis 1789 et surtout depuis la révolution russe de 1917, le fait spirituel aurait totalement disparu et le pouvoir serait tombé aux mains de la plèbe, de la caste la plus basse et la moins intelligente. Nous en serions au stade le plus bas de la décadence, à l'âge du fer, du Kali-Yuga. Pour aussi troublante qu'elle soit, cette théorie n'en demeure pas moins basée sur des prémisses discutables vu le peu de documents disponibles sur certaines époques. D'une lecture assez laborieuse, cet ouvrage important donne cependant énormément à réfléchir sur le fait que tout a sans doute toujours pas très bien fonctionné et que notre état de décadence semble déjà bien avancé !
Lien : http://www.bernardviallet.fr
Cet ouvrage majeur de Julius Evola est véritablement un monument et l'on comprend pourquoi.
Tout d'abord, l'auteur est un homme de la Tradition mais qui utilise avec rigueur les puissants outils intellectuels « modernes » afin de nous faire comprendre le monde de la Tradition, et c'est cet « aller-retour » qui nous permet de plonger dans ce paradigme perdu dans les entrailles du temps et nous le fait ressusciter d'une façon totale et limpide par le moyen de la métaphysique.
L'ouvrage se scinde en deux parties : premièrement, ce qu'est le monde de la Tradition, puis, comment le monde entre dans un processus de dissolution par le biais de la modernité.
Toute une anthropologie est donc rétablie à l'aune des principes indestructibles de la Tradition : les relations homme-femme, la royauté, le sacerdoce, la loi et l'état, la race, les castes, l'ascèse, l'héroïsme par la voie de l'action et de la contemplation, les jeux, la guerre... C'est en cela que l'ouvrage est immense : tous les pans de l'existence sont totalement remis en cause de par la pertinence de l'analyse d'Evola, et cela ne peut pas laisser indifférent.
Chacun pourra établir ses propres conclusions car il y réside tout de même une certaine subjectivité de l'auteur qui peut être critiquable (doctrine des quatre âges, sentimentalisme et pathos du christianisme, dimension virile et olympienne qui n'admet aucune repentance ou humilité, opposition brutale entre un Nord solaire et un Sud lunaire...). Mais en tout état de cause, Julius Evola tente de nous faire retrouver ce qui a été perdu et explique l'importance de remonter le fil que l'entropie de la modernité continue encore de nous faire perdre.
Je conseille donc cet ouvrage imposant et politiquement incorrect à toute personne qui ne se sent pas de ce monde et qui cherche à retrouver les vérités principielles qui permettraient de donner plus de sens à sa vie, ou plus de compréhension à sa chute...
Tout d'abord, l'auteur est un homme de la Tradition mais qui utilise avec rigueur les puissants outils intellectuels « modernes » afin de nous faire comprendre le monde de la Tradition, et c'est cet « aller-retour » qui nous permet de plonger dans ce paradigme perdu dans les entrailles du temps et nous le fait ressusciter d'une façon totale et limpide par le moyen de la métaphysique.
L'ouvrage se scinde en deux parties : premièrement, ce qu'est le monde de la Tradition, puis, comment le monde entre dans un processus de dissolution par le biais de la modernité.
Toute une anthropologie est donc rétablie à l'aune des principes indestructibles de la Tradition : les relations homme-femme, la royauté, le sacerdoce, la loi et l'état, la race, les castes, l'ascèse, l'héroïsme par la voie de l'action et de la contemplation, les jeux, la guerre... C'est en cela que l'ouvrage est immense : tous les pans de l'existence sont totalement remis en cause de par la pertinence de l'analyse d'Evola, et cela ne peut pas laisser indifférent.
Chacun pourra établir ses propres conclusions car il y réside tout de même une certaine subjectivité de l'auteur qui peut être critiquable (doctrine des quatre âges, sentimentalisme et pathos du christianisme, dimension virile et olympienne qui n'admet aucune repentance ou humilité, opposition brutale entre un Nord solaire et un Sud lunaire...). Mais en tout état de cause, Julius Evola tente de nous faire retrouver ce qui a été perdu et explique l'importance de remonter le fil que l'entropie de la modernité continue encore de nous faire perdre.
Je conseille donc cet ouvrage imposant et politiquement incorrect à toute personne qui ne se sent pas de ce monde et qui cherche à retrouver les vérités principielles qui permettraient de donner plus de sens à sa vie, ou plus de compréhension à sa chute...
Sur certains aspects cet ouvrage fait beaucoup malgré son pérennialisme qui en repoussera un certain nombre - le rationaliste queje suis doit souvent faire des efforts . Il faut l'accepter à la lecture et éviter le jugement hâtif moderne, précisément. A moins de vouloir ne pas le comprendre
chef d'oeuvre absolu
Citations et extraits (99)
Voir plus
Ajouter une citation
Le monde moderne, s'il a dénoncé l'« injustice » du régime des castes, a stigmatisé davantage encore les civilisations antiques qui connurent l'esclavage, et a considéré comme un mérite des temps nouveaux d'avoir affirmé le principe de la « dignité humaine ». Mais il ne s'agit, là encore, que de pure rhétorique.
On oublie que les Européens eux-mêmes réintroduisirent et maintinrent jusqu'au XIXe siècle, dans les territoires d'outre-mer, une forme d'esclavage souvent odieuse, que le monde antique ne connut presque jamais. Ce qu'il faut plutôt mettre en relief, c'est que si jamais une civilisation pratiqua l'esclavage sur une grande échelle, c'est bien la civilisation moderne.
Aucune civilisation traditionnelle ne vit jamais des masses aussi nombreuses condamnées à un travail obscur, sans âme, automatique, à un esclavage qui n'a même pas pour contrepartie la haute stature et la réalité tangible de figures de seigneurs et de dominateurs, mais se trouve imposé d'une façon apparemment anodine par la tyrannie du facteur économique et les structures absurdes d'une société plus ou moins collectivisée. Et du fait que la vision moderne de la vie, dans son matérialisme, a enlevé à l'individu toute possibilité d'introduire dans son destin un élément de transfiguration, d'y voir un signe et un symbole, l'esclavage d'aujourd'hui est le plus lugubre et le plus désespéré de tous ceux que l'on ait jamais connus.
Il n'est donc pas surprenant que les forces obscures de la subversion mondiale aient trouvé dans les masses des esclaves modernes un instrument docile et obtus, adapté à la poursuite de leurs buts : là où elles ont déjà triomphé, dans les immenses « camps de travail », on voit pratiquer méthodiquement, sataniquement, l'asservissement physique et moral de l'homme en vue de la collectivisation et du déracinement de toutes les valeurs de la personnalité. (pp. 154-155)
On oublie que les Européens eux-mêmes réintroduisirent et maintinrent jusqu'au XIXe siècle, dans les territoires d'outre-mer, une forme d'esclavage souvent odieuse, que le monde antique ne connut presque jamais. Ce qu'il faut plutôt mettre en relief, c'est que si jamais une civilisation pratiqua l'esclavage sur une grande échelle, c'est bien la civilisation moderne.
Aucune civilisation traditionnelle ne vit jamais des masses aussi nombreuses condamnées à un travail obscur, sans âme, automatique, à un esclavage qui n'a même pas pour contrepartie la haute stature et la réalité tangible de figures de seigneurs et de dominateurs, mais se trouve imposé d'une façon apparemment anodine par la tyrannie du facteur économique et les structures absurdes d'une société plus ou moins collectivisée. Et du fait que la vision moderne de la vie, dans son matérialisme, a enlevé à l'individu toute possibilité d'introduire dans son destin un élément de transfiguration, d'y voir un signe et un symbole, l'esclavage d'aujourd'hui est le plus lugubre et le plus désespéré de tous ceux que l'on ait jamais connus.
Il n'est donc pas surprenant que les forces obscures de la subversion mondiale aient trouvé dans les masses des esclaves modernes un instrument docile et obtus, adapté à la poursuite de leurs buts : là où elles ont déjà triomphé, dans les immenses « camps de travail », on voit pratiquer méthodiquement, sataniquement, l'asservissement physique et moral de l'homme en vue de la collectivisation et du déracinement de toutes les valeurs de la personnalité. (pp. 154-155)
L'Amérique aussi, dans sa façon essentielle de considérer la vie et le monde, a créé une « civilisation », qui se trouve en parfaite contradiction avec l'ancienne tradition européenne. Elle a définitivement instauré la religion de l'utilitarisme et du rendement, elle a placé l'intérêt pour le gain, la grande production industrielle, la réalisation mécanique, visible, quantitative, au-dessus de tout autre. Elle a donné naissance à une grandeur sans âme de nature purement technico-collective, privée de tout arrière-plan de transcendance, de toute lumière d'intériorité et de vraie spiritualité. Elle aussi a opposé à la conception de l'homme intégré en tant que qualité et personnalité dans un système organique, une conception où il n'est plus qu'un simple instrument de production et de rendement matériel dans un conglomérat social conformiste.
(...)
Ainsi, bien que l'Amérique ne pense pas du tout à bannir tout ce qui est intellectualité, il est certain qu'elle éprouve à l'égard de celle-ci, dans la mesure où elle n'apparaît pas comme l'instrument d'une réalisation pratique, une indifférence instinctive, comme à l'égard d'un luxe auquel ne doit pas trop s'attarder celui qui est porté vers les choses sérieuses telles que le « get rich quick », le « service », une campagne en faveur de tel ou tel préjugé social et ainsi de suite.
(...)
Si l'Amérique n'a pas banni officiellement, comme le communisme, l'ancienne philosophie, elle a fait mieux : par la bouche d'un William James, elle a déclaré que l'utile est le critère du vrai et que la valeur de toute conception, même métaphysique, doit être mesurée à son efficacité pratique, c'est-à-dire, en fin de compte, selon la mentalité américaine, son efficacité économico-sociale. Le pragmatisme est une des marques les plus caractéristiques de la civilisation américaine envisagée dans son ensemble, ainsi que la théorie de Dewey et le behaviorisme, qui correspond exactement aux théories tirées, en U.R.S.S., des vues de Pavlov sur les réflexes conditionnés et, comme celles-ci, exclut totalement le Moi et la conscience en tant que principe substantiel. L'essence de cette théorie typiquement « démocratique » est que n'importe qui peut devenir n'importe quoi - moyennant un certain training et une certaine pédagogie - ce qui revient à dire que l'homme, en soi, est une substance informe, malléable, tout comme le conçoit le communisme, qui considère comme anti-révolutionnaire et anti-marxiste la théorie génétique des qualités innées. La puissance de la publicité, de l'advertising, en Amérique, s'explique d'ailleurs par l'inconsistance intérieure et la passivité de l'âme américaine, qui, à maint égard, présente les caractéristiques bidimensionnelles, non de la jeunesse, mais de l'infantilisme. (pp. 409-411)
(...)
Ainsi, bien que l'Amérique ne pense pas du tout à bannir tout ce qui est intellectualité, il est certain qu'elle éprouve à l'égard de celle-ci, dans la mesure où elle n'apparaît pas comme l'instrument d'une réalisation pratique, une indifférence instinctive, comme à l'égard d'un luxe auquel ne doit pas trop s'attarder celui qui est porté vers les choses sérieuses telles que le « get rich quick », le « service », une campagne en faveur de tel ou tel préjugé social et ainsi de suite.
(...)
Si l'Amérique n'a pas banni officiellement, comme le communisme, l'ancienne philosophie, elle a fait mieux : par la bouche d'un William James, elle a déclaré que l'utile est le critère du vrai et que la valeur de toute conception, même métaphysique, doit être mesurée à son efficacité pratique, c'est-à-dire, en fin de compte, selon la mentalité américaine, son efficacité économico-sociale. Le pragmatisme est une des marques les plus caractéristiques de la civilisation américaine envisagée dans son ensemble, ainsi que la théorie de Dewey et le behaviorisme, qui correspond exactement aux théories tirées, en U.R.S.S., des vues de Pavlov sur les réflexes conditionnés et, comme celles-ci, exclut totalement le Moi et la conscience en tant que principe substantiel. L'essence de cette théorie typiquement « démocratique » est que n'importe qui peut devenir n'importe quoi - moyennant un certain training et une certaine pédagogie - ce qui revient à dire que l'homme, en soi, est une substance informe, malléable, tout comme le conçoit le communisme, qui considère comme anti-révolutionnaire et anti-marxiste la théorie génétique des qualités innées. La puissance de la publicité, de l'advertising, en Amérique, s'explique d'ailleurs par l'inconsistance intérieure et la passivité de l'âme américaine, qui, à maint égard, présente les caractéristiques bidimensionnelles, non de la jeunesse, mais de l'infantilisme. (pp. 409-411)
Lorsque le rythme est brisé, lorsque les contacts sont bloqués, lorsque le regard ne sait plus rien des grandes distances, toutes les voies semblent ouvertes et chaque domaine est saturé d’actions désordonnées, inorganiques privés de base et de sens profond, dominées par des motivations exclusivement temporelles et individuelles […]. La « culture », alors, ne veut plus dire réaliser son être propre dans l’adhérence sérieuse et la fidélité –elle signifie « se construire ». Et puisque la base de cette construction n’est autre que le sable mouvant de cette nullité qu’est le Moi empirique humain sans nom et sans tradition, on voit s’avancer la prétention à l’égalité, le droit pour chacun de pouvoir être, en théorie, tout ce qu’un autre peut être aussi.
[…] C’est alors le chaos des possibilités existentielles et psychiques, qui condamne la plupart des hommes à un état de disharmonie et de déchirement : chose qui se vérifie aujourd’hui.
[…] C’est alors le chaos des possibilités existentielles et psychiques, qui condamne la plupart des hommes à un état de disharmonie et de déchirement : chose qui se vérifie aujourd’hui.
Si la naissance n’est pas un hasard, le fait – tout particulièrement – qu’on s’éveille à soi-même dans un corps masculin ou dans un corps féminin ne sera pas non plus le fruit du hasard. Ici aussi, la différence physique doit être conçue comme le pendant d’une différence spirituelle ; il suit de là qu’on est physiquement homme ou femme que parce qu’on l’est transcendantalement, et que l’appartenance à tel ou tel sexe, loin d’être chose insignifiante dans l’ordre de l’esprit, est le signe révélateur d’une voie, d’un dharma distinct. On sait que la volonté d’ordre et de « forme » constitue la base de toute civilisation traditionnelle ; que la loi traditionnelle ne pousse pas vers l’in-qualifié, l’égal, l’indéfini – vers ce qui rendrait les différentes parties du tout semblables, sous l’effet de l’homogénéisation ou de l’atomisation -, mais veut que ces parties soient elles-même expriment de plus en plus parfaitement leur nature propre. Aussi, dans le domaine spécifique des sexes, homme et femme se présentent-ils comme deux types. Celui qui naît homme doit s’accomplir en tant que tel, celle qui nait femme doit se réaliser comme telle, en tout et pour tout, dépassant toute promiscuité et tout mélange. Quant à l’orientation surnaturelle, homme et femme doivent avoir, chacun, leur voie propre, qui ne peut pas être modifiée, sauf à tomber dans un mode d’être contradictoire et inorganique.
[Postface Alain de Benoist]
[Postface Alain de Benoist]
Si difficilement concevable que cela soit pour les modernes, il faut partir de l’idée que l’homme traditionnel connaissait la réalité d’un ordre de l’être bien plus vaste que ce à quoi correspond aujourd’hui, en règle générale, le mot « réel ». De nos jours, au fond, on entend seulement par « réalité » le monde des corps dans l’espace et dans le temps […].
Videos de Julius Evola (5)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : théorie politiqueVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Julius Evola (35)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
764 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre764 lecteurs ont répondu