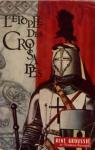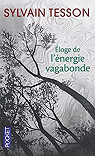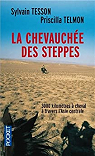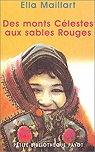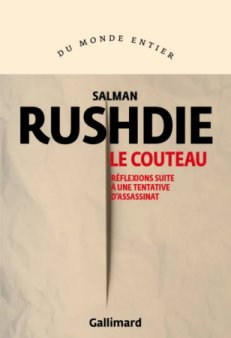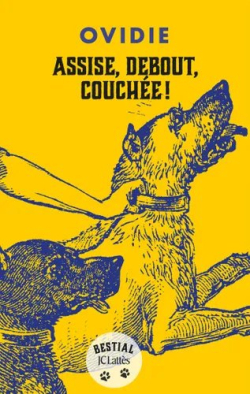Étienne de La Vaissière/5
4 notes
Résumé :
L’Asie centrale forme le coeur des échanges eurasiatiques médiévaux, ce que l’on appelle, pas totalement à tort, la « route de la soie ». Caravanes et conquérants, moines et artistes, tous passent par Samarcande, Dunhuang ou Bactres, pour aller de la Chine à Byzance ou de l’Iran et l’Inde à la steppe. C’est l’époque de la première globalisation, mille ans avant l’expansion européenne. Mais cette histoire est en lambeaux, et, à l’apogée de ces contacts, de la chevauc... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Asie centrale 300-850 : Des routes et des royaumesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
L'histoire de l'Asie centrale entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge peut paraître à première vue assez obscure, susceptible de n'intéresser qu'une poignée d'érudits... Étienne de la Vaissière, historien spécialiste de cette région ayant notamment mené des fouilles archéologiques en Ouzbékistan et en Afghanistan, nous montre dans cet ouvrage à quel point l'Asie centrale d'il y a un millénaire et demi peut être fascinante, quand elle était littéralement un carrefour où se mêlaient les modes de vie (nomades, sédentaires, pastoralisme, agriculture...), les religions (bouddhisme, islam, zoroastrisme, chamanisme...), les langues et les cultures (turque, chinoise, perse, tibétaine...). Une forme de mondialisation, en somme, s'était développée dans les oasis et sur les pistes commerciales du côté de Merv, Samarcande, Bactres ou Dunhuang, jusqu'aux bouleversements du 8ème siècle qui mirent un coup d'arrêt aux échanges.
Ce livre est une mine d'informations sur un sujet méconnu et peu traité. Vouloir résumer son contenu serait vain, tant il embrasse un grand nombre d'aspects. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'une histoire événementielle de l'Asie centrale, loin de là : on a certes un récit chronologique de la formation et de la chute des empires, des guerres et des rois, mais une grande place est également réservée à l'économie, l'art et la culture, les croyances... et même l'histoire du climat, présentée dans les premiers chapitres, celui-ci ayant une importance primordiale dans ces régions où une bonne part de l'activité humaine découle de la recherche de l'eau et des meilleurs pâturages.
Dans un premier temps, j'ai abordé cet ouvrage comme tant d'autres essais historiques : en commençant au premier chapitre pour finir au dernier, en progressant page par page. Mais je me suis rapidement rallié à la vision de l'auteur, qui dans son introduction en forme de note d'intention nous invite à nous perdre, feuilleter, sauter des passages ou revenir en arrière... Et effectivement, ce n'est pas un livre destiné à être lu de manière linéaire puis rangé dans sa bibliothèque une fois qu'on l'a refermé. Il s'agit plutôt d'un ouvrage de référence, à parcourir et à consulter au gré des envies ou des besoins. Je n'ai pas lu chacune de ses 500 pages (sans compter les annexes) avec la même attention, il y a des chapitres sur lesquels je me suis arrêté et d'autres que je n'ai fait que survoler... mais dont je sais que j'y reviendrai, dans un mois, dans un an ou plus tard.
Si le fond est d'une grande richesse, la forme n'est pas en reste, et la réalisation de l'ouvrage a bénéficié d'un grand soin qui le rend particulièrement agréable à lire : il faut relever la clarté de la mise en page, la qualité du papier, et la présence de très nombreuses illustrations tout en couleurs : cartes, peintures, pièces archéologiques, photos des lieux actuels... si bien que le prix de vente (33 euros) n'est pas du tout excessif. Merci aux éditions des Belles Lettres de proposer de tels ouvrages, loin des modes et des tendances actuelles, sur des sujets pointus tout en se voulant accessibles aux non-spécialistes. Et merci à Babelio de nous les proposer dans le cadre de Masse Critique.
Ce livre est une mine d'informations sur un sujet méconnu et peu traité. Vouloir résumer son contenu serait vain, tant il embrasse un grand nombre d'aspects. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'une histoire événementielle de l'Asie centrale, loin de là : on a certes un récit chronologique de la formation et de la chute des empires, des guerres et des rois, mais une grande place est également réservée à l'économie, l'art et la culture, les croyances... et même l'histoire du climat, présentée dans les premiers chapitres, celui-ci ayant une importance primordiale dans ces régions où une bonne part de l'activité humaine découle de la recherche de l'eau et des meilleurs pâturages.
Dans un premier temps, j'ai abordé cet ouvrage comme tant d'autres essais historiques : en commençant au premier chapitre pour finir au dernier, en progressant page par page. Mais je me suis rapidement rallié à la vision de l'auteur, qui dans son introduction en forme de note d'intention nous invite à nous perdre, feuilleter, sauter des passages ou revenir en arrière... Et effectivement, ce n'est pas un livre destiné à être lu de manière linéaire puis rangé dans sa bibliothèque une fois qu'on l'a refermé. Il s'agit plutôt d'un ouvrage de référence, à parcourir et à consulter au gré des envies ou des besoins. Je n'ai pas lu chacune de ses 500 pages (sans compter les annexes) avec la même attention, il y a des chapitres sur lesquels je me suis arrêté et d'autres que je n'ai fait que survoler... mais dont je sais que j'y reviendrai, dans un mois, dans un an ou plus tard.
Si le fond est d'une grande richesse, la forme n'est pas en reste, et la réalisation de l'ouvrage a bénéficié d'un grand soin qui le rend particulièrement agréable à lire : il faut relever la clarté de la mise en page, la qualité du papier, et la présence de très nombreuses illustrations tout en couleurs : cartes, peintures, pièces archéologiques, photos des lieux actuels... si bien que le prix de vente (33 euros) n'est pas du tout excessif. Merci aux éditions des Belles Lettres de proposer de tels ouvrages, loin des modes et des tendances actuelles, sur des sujets pointus tout en se voulant accessibles aux non-spécialistes. Et merci à Babelio de nous les proposer dans le cadre de Masse Critique.
"Asie centrale, 300-850, Des routes et des royaumes" est un beau et fort volume broché, à la couverture soignée, à la riche cartographie accompagnant le texte, avec de belles illustrations. Une fois lancé dans sa lecture, le lecteur, même un peu frotté d'histoire, est vite perdu dans une série de toponymes et autres noms desquels il n'a nulle connaissance : nous sommes habitués au monde méditerranéen, proche-oriental et européen. La composition du livre n'aide guère, puisque l'auteur, archéologue, doit consacrer de longs passages à décrire, analyser et introduire des réalités (commerce, agriculture, société) qui n'ont rien de familier. Si donc l'ouvrage est beau, il ne faudra pas s'attendre à prendre grand plaisir à le lire, sauf vers la fin, disons après les trois cents premières pages, quand on commence à s'habituer un peu. L'auteur, conscient de cela, nous fournit un guide de lecture dans son propre livre.
C'est en fait le sujet proprement dit qui impose ces contraintes, au point que l'on doute de l'existence même du sujet : on appelle "Asie centrale" l'espace immense et original où se brassent avec les cultures locales, et se heurtent entre eux, les pouvoirs hun, turc, persan, chinois et indien. Sous tant de couches d'influence, on a du mal à repérer ce que cet espace possède en propre. D'autre part, même la géographie permet de douter qu'il existe vraiment une "Asie centrale". Les réalités qui s'imposent à Etienne de la Vaissière l'obligent à forger son propre instrument historique, ce qui donne à ce livre un grand intérêt épistémologique.
En gros, l'auteur décrit l'évolution de cet espace : vers 300, l'Asie centrale est un monde de relations entre empires successifs, auxquelles participent et dont profitent les nations locales (surtout les Sogdiens, ancêtres des actuels Tadjiks) ; en 850, on aboutit à une tout autre situation : les transferts de la Chine à la Perse s'interrompent, de même que vers l'Inde, et donc tout se cloisonne. La dynastie T'ang connaît une série de troubles politiques, et une nouvelle puissance bouleverse la civilisation centre-asiatique : l'islam, qui n'est pas seulement une domination politique, mais un vrai changement de civilisation (bien au-delà de la seule "religion"), imposant un certain cloisonnement.
La lecture de cet ouvrage, le temps de l'adaptation passé, est d'un grand profit : l'auteur, pour un historien et archéologue, ne massacre pas le français, et nous donne un incomparable observatoire d'où l'on peut voir l'Iran, la Chine et les steppes, à travers des documents et des objets inédits.
C'est en fait le sujet proprement dit qui impose ces contraintes, au point que l'on doute de l'existence même du sujet : on appelle "Asie centrale" l'espace immense et original où se brassent avec les cultures locales, et se heurtent entre eux, les pouvoirs hun, turc, persan, chinois et indien. Sous tant de couches d'influence, on a du mal à repérer ce que cet espace possède en propre. D'autre part, même la géographie permet de douter qu'il existe vraiment une "Asie centrale". Les réalités qui s'imposent à Etienne de la Vaissière l'obligent à forger son propre instrument historique, ce qui donne à ce livre un grand intérêt épistémologique.
En gros, l'auteur décrit l'évolution de cet espace : vers 300, l'Asie centrale est un monde de relations entre empires successifs, auxquelles participent et dont profitent les nations locales (surtout les Sogdiens, ancêtres des actuels Tadjiks) ; en 850, on aboutit à une tout autre situation : les transferts de la Chine à la Perse s'interrompent, de même que vers l'Inde, et donc tout se cloisonne. La dynastie T'ang connaît une série de troubles politiques, et une nouvelle puissance bouleverse la civilisation centre-asiatique : l'islam, qui n'est pas seulement une domination politique, mais un vrai changement de civilisation (bien au-delà de la seule "religion"), imposant un certain cloisonnement.
La lecture de cet ouvrage, le temps de l'adaptation passé, est d'un grand profit : l'auteur, pour un historien et archéologue, ne massacre pas le français, et nous donne un incomparable observatoire d'où l'on peut voir l'Iran, la Chine et les steppes, à travers des documents et des objets inédits.
Merci à Babelio et aux éditions des belles lettres de m'avoir fait parvenir cet ouvrage dans le cadre d'une masse critique.
Les historiens ou tout au moins les amateurs d'histoire perdent souvent l'Asie centrale des yeux après l'époque hellenistique ou les luttes entre l'Empire romain et les Parthes, puis l'Empire sassanide.
L'ouvrage sur les routes et les royaumes permet de retourner vers ces régions de la Bactriane, de la Sogdiane, du Turfan et au-delà des oasis de la steppe jusqu'à la frontière chinoise sur la période de 300 à 850.
L'auteur nous livre une réflexion qu'il dit lui même comme tissée sans fil rouge bien distinct et nous invite à voyager dans son ouvrage tels les nomades qu'il nous décrit. Il y a quand même de grandes têtes de chapitres autour de phases clés de cette vaste aire géographique, mais l'invitation au voyage tient ses promesses.
Il analyse d'abord le milieu et nous livre une réflexion sur le nomadisme faite de la connaissance des espace, des herbages et des climats qui nous transmet l'image de peuples nomades qui loin d'errer au hasard sont des techniciens de la transhumance pour le bien être de leurs troupeau et donc de leur richesse.
On voit au travers de ces analyses la structuration sociale propre à ces sociétés et leurs interactions autour du grand commerce avec le rôle majeur de Sogdiens dans ces mouvements de richesses à dos de caravanes.
Alors que les peuples de la steppe se succèdent (Rouran, Xiongnus, Huns, Alains, Turcs, Ouighours...) dans une plus ou moins grande continuité culturelle ; ces derniers se confrontent à leurs voisins perses, chinois, tibétains, puis musulmans, tous intégrés dans des structures étatiques fortes et les inspirations sont fortes entre ces sphères culturelles.
Les échangent ne se font pas que sur la base des marchandises. Ce sont aussi les idées, les techniques et les religions (manichéisme, bouddhisme, islam...) qui suivent les mêmes routes et s'y mêlent parfois dans un syncrétisme propre à la région. Là encore, passés les noms de régions et de peuples qui pourront paraître très exotiques pour certains, le récit et l'analyse demeurent passionnants.
On mesure derrière cette histoire de l'Asie centrale le travail ardu de l'historien qui a dû faire avec des sources extérieures souvent lacunaires pour nous transmettre un portait de la région et des interactions qui s'y sont jouées .
Les historiens ou tout au moins les amateurs d'histoire perdent souvent l'Asie centrale des yeux après l'époque hellenistique ou les luttes entre l'Empire romain et les Parthes, puis l'Empire sassanide.
L'ouvrage sur les routes et les royaumes permet de retourner vers ces régions de la Bactriane, de la Sogdiane, du Turfan et au-delà des oasis de la steppe jusqu'à la frontière chinoise sur la période de 300 à 850.
L'auteur nous livre une réflexion qu'il dit lui même comme tissée sans fil rouge bien distinct et nous invite à voyager dans son ouvrage tels les nomades qu'il nous décrit. Il y a quand même de grandes têtes de chapitres autour de phases clés de cette vaste aire géographique, mais l'invitation au voyage tient ses promesses.
Il analyse d'abord le milieu et nous livre une réflexion sur le nomadisme faite de la connaissance des espace, des herbages et des climats qui nous transmet l'image de peuples nomades qui loin d'errer au hasard sont des techniciens de la transhumance pour le bien être de leurs troupeau et donc de leur richesse.
On voit au travers de ces analyses la structuration sociale propre à ces sociétés et leurs interactions autour du grand commerce avec le rôle majeur de Sogdiens dans ces mouvements de richesses à dos de caravanes.
Alors que les peuples de la steppe se succèdent (Rouran, Xiongnus, Huns, Alains, Turcs, Ouighours...) dans une plus ou moins grande continuité culturelle ; ces derniers se confrontent à leurs voisins perses, chinois, tibétains, puis musulmans, tous intégrés dans des structures étatiques fortes et les inspirations sont fortes entre ces sphères culturelles.
Les échangent ne se font pas que sur la base des marchandises. Ce sont aussi les idées, les techniques et les religions (manichéisme, bouddhisme, islam...) qui suivent les mêmes routes et s'y mêlent parfois dans un syncrétisme propre à la région. Là encore, passés les noms de régions et de peuples qui pourront paraître très exotiques pour certains, le récit et l'analyse demeurent passionnants.
On mesure derrière cette histoire de l'Asie centrale le travail ardu de l'historien qui a dû faire avec des sources extérieures souvent lacunaires pour nous transmettre un portait de la région et des interactions qui s'y sont jouées .
Connaissez-vous l'histoire de la première globalisation ? Bien loin de la Révolution Industrielle ou de l'ère du numérique, on est en l'an 300, mille ans avant l'expansion européenne. Tout se passe en Asie centrale où se trouve le coeur des échanges eurasiatiques médiévaux et que nous avons désigné, a posteriori, « la route de la soie ». de Samarcande à Dunhuang, en passant par Bactres, ces routes sont les chemins les plus fréquentés à cette période. Que ce soit pour des raisons marchandes, religieuses ou conquérantes, des milliers de personnes font le trajet pour relier la Chine à Byzance ou l'Iran à la steppe.
Étienne de la Vaissière revient sur l'histoire de l'Asie centrale de l'an 300 à 850, en prenant en compte les multiples thématiques qui la forgent. Il étudie ainsi l'histoire du climat, de la démographie, en passant par les migrations nomades, l'art bouddhique jusqu'à la première islamisation. Aucune thématique n'est laissée de côté pour arriver à comprendre, de manière globale, l'histoire et la géographie de ce vaste territoire et de ses dynamiques politiques, économiques et sociales.
S'appuyant sur une grande diversité de textes arabes, chinois, iraniens et turcs, sur les travaux les plus récents ainsi que sur les dernières fouilles archéologiques, Étienne de la Vaissière nous livre, dans cet ouvrage, le résultat de vingt années de recherche.
Le travail d'Étienne de la Vaissière est admirable. En étant complet et didactique, il nous donne une véritable somme de l'Asie centrale, à l'essor de la première route de la soie. Je vous invite donc à découvrir cet ouvrage riche et l'histoire de celle qui fait encore beaucoup parler d'elle.
Étienne de la Vaissière revient sur l'histoire de l'Asie centrale de l'an 300 à 850, en prenant en compte les multiples thématiques qui la forgent. Il étudie ainsi l'histoire du climat, de la démographie, en passant par les migrations nomades, l'art bouddhique jusqu'à la première islamisation. Aucune thématique n'est laissée de côté pour arriver à comprendre, de manière globale, l'histoire et la géographie de ce vaste territoire et de ses dynamiques politiques, économiques et sociales.
S'appuyant sur une grande diversité de textes arabes, chinois, iraniens et turcs, sur les travaux les plus récents ainsi que sur les dernières fouilles archéologiques, Étienne de la Vaissière nous livre, dans cet ouvrage, le résultat de vingt années de recherche.
Le travail d'Étienne de la Vaissière est admirable. En étant complet et didactique, il nous donne une véritable somme de l'Asie centrale, à l'essor de la première route de la soie. Je vous invite donc à découvrir cet ouvrage riche et l'histoire de celle qui fait encore beaucoup parler d'elle.
Dans cette somme de 600 pages, Etienne de la Vaissière, historien spécialiste de l'Asie centrale, explore la période de 300 à 850 dans cette région largement absente de nos cours d'histoire (toutes époques confondues). Si bien que je suis entrée dans l'ouvrage enthousiaste et curieuse mais en terrain totalement inconnu. Ce que l'auteur sait très bien, et il nous prévient, avec une bienveillance bienvenue :
"Tu vas entrer en eaux profondes et rien ne sera familier,rien ne sera connu, de peuples étranges en toponymes abscons. Plonge ! Accepte d'être dépassé, parfois perdu, lassé, saute des pages et des passages, feuillète, reviens en arrière, va de carte en carte, d'image en image. Tu découvriras un monde immense et formidable, le grand déploiement d'un tissu historié."
Cela a le mérite de décomplexer complètement notre approche. Avec cette idée en arrière-plan, on peut ensuite aborder les chapitres en surface ou au contraire, comme j'ai commencé à le faire (sans terminer car c'est une tâche de longue haleine), d'essayer de saisir tout ce que l'auteur nous décrit.
Sauf si on s'est intéressé de nous-même à la période et à la région, tout n'est que découverte. Et quand on se passionne pour l'histoire, qu'on est avide de connaître les autres peuples, les autres cultures, cet ouvrage est une mine d'or.
Car oui, c'est un monde immense et formidable. C'est passionnant de découvrir tous ces peuples, ces villes, ces géographies. de comprendre comment les voies terrestres se sont dessinées entre les différents reliefs. de visualiser ce qui unit les populations ou les divise. de les inscrire dans la frise chronologique que nos connaissances antérieures ont élaboré.
Il faut absolument souligner la qualité du travail éditorial. On trouvera au fil des pages, de belles cartes, des photos d'oeuvres artistiques, de documents, de paysages. le soin apporté à la mise en page rend la lecture encore plus captivante.
"Asie Centrale 300-850 Des routes et des royaumes" est plus qu'une porte d'entrée pour connaître l'histoire de l'Asie centrale. C'est une plongée totale dans ce pan d'histoire mis à la portée des néophytes, car on sent bien là que l'intention d'Etienne de la Vaissière n'était pas de s'adresser à un public acquis mais de partager ses connaissances avec tous les amoureux d'histoire.
Un superbe ouvrage documentaire, dense et passionnant, qui conquerra sans nul doute quiconque l'ouvrira.
Lien : https://lejardindenatiora.wo..
"Tu vas entrer en eaux profondes et rien ne sera familier,rien ne sera connu, de peuples étranges en toponymes abscons. Plonge ! Accepte d'être dépassé, parfois perdu, lassé, saute des pages et des passages, feuillète, reviens en arrière, va de carte en carte, d'image en image. Tu découvriras un monde immense et formidable, le grand déploiement d'un tissu historié."
Cela a le mérite de décomplexer complètement notre approche. Avec cette idée en arrière-plan, on peut ensuite aborder les chapitres en surface ou au contraire, comme j'ai commencé à le faire (sans terminer car c'est une tâche de longue haleine), d'essayer de saisir tout ce que l'auteur nous décrit.
Sauf si on s'est intéressé de nous-même à la période et à la région, tout n'est que découverte. Et quand on se passionne pour l'histoire, qu'on est avide de connaître les autres peuples, les autres cultures, cet ouvrage est une mine d'or.
Car oui, c'est un monde immense et formidable. C'est passionnant de découvrir tous ces peuples, ces villes, ces géographies. de comprendre comment les voies terrestres se sont dessinées entre les différents reliefs. de visualiser ce qui unit les populations ou les divise. de les inscrire dans la frise chronologique que nos connaissances antérieures ont élaboré.
Il faut absolument souligner la qualité du travail éditorial. On trouvera au fil des pages, de belles cartes, des photos d'oeuvres artistiques, de documents, de paysages. le soin apporté à la mise en page rend la lecture encore plus captivante.
"Asie Centrale 300-850 Des routes et des royaumes" est plus qu'une porte d'entrée pour connaître l'histoire de l'Asie centrale. C'est une plongée totale dans ce pan d'histoire mis à la portée des néophytes, car on sent bien là que l'intention d'Etienne de la Vaissière n'était pas de s'adresser à un public acquis mais de partager ses connaissances avec tous les amoureux d'histoire.
Un superbe ouvrage documentaire, dense et passionnant, qui conquerra sans nul doute quiconque l'ouvrira.
Lien : https://lejardindenatiora.wo..
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
[Diffusion du bouddhisme, de l'Asie centrale à la Chine et vice-versa.]
C'est par l'Asie centrale que la Chine est touchée. Ce sont en effet des moines et des ambassadeurs, protecteurs nobles du bouddhisme, venus des marges du monde indien, qui, les premiers, introduisent quelques textes gândhârî en Chine au I° s de n.è. On a noté que, durant les trois premiers siècles de notre ère, les centre-asiatiques - Bactriens, Sogdiens de familles marchandes émigrées en Inde, Indo-Parthes, Khotanais, Koutchéens - forment les deux tiers des traducteurs des textes indiens en Chine. Au milieu du II°s de notre ère, le premier grand protecteur du bouddhisme en Chine est un ambassadeur parthe, An Shigao, et une génération plus tard, Lokakshema, l'introducteur du mahâyâna, est un Bactrien. En Chine du sud, au III°s, les deux grands noms sont ceux de Zhi Qian et Kang Senghui, de familles bactrienne et sogdienne d'Asie centrale ayant émigré en territoire chinois. En Chine du Nord, les deux grands traducteurs sont, à la fin du III°s, Dharmaraksha, d'une famille bactrienne de Dunhuang, puis, un siècle plus tard, Kumârajîva, prince koutchéen. Ces moines viennent souvent de familles de marchands, et étaient sans doute par leur milieu social plus habitués à parcourir les routes.
Mais ensuite, le bouddhisme se rediffuse vers l'ouest depuis la Chine. Dunhuang, dans le prolongement du Gansu, et Gaochang, à partir de sa conquête au milieu du V°s par la dynastie sinisée des Qu du Gansu - et même si le bouddhisme y est antérieur -, appartiennent en Asie centrale à ce bouddhisme chinois. La conquête chinoise d'une large part de l'Asie centrale au milieu du VII°s vient renforcer ce bouddhisme notamment par la création de monastères d'Etat, déjà évoqués au chapitre VII. L'intégration de l'Asie centrale à l'empire des Tang a des conséquences qui ne se limitent pas à ces monastères coloniaux : on constate le basculement d'une partie des réseaux marchands sogdiens vers un bouddhisme dominé par les modèles chinois. Alors que la Sogdiane était voisine de la Bactriane, le bouddhisme ne s'y était diffusé que faiblement. La plupart des textes sogdiens bouddhiques sont traduits du chinois à partir du milieu du VII°s dans les communautés sogdiennes expatriées à l'est, et non directement des langues indiennes ou du bactrien et en Sogdiane.
p. 362
C'est par l'Asie centrale que la Chine est touchée. Ce sont en effet des moines et des ambassadeurs, protecteurs nobles du bouddhisme, venus des marges du monde indien, qui, les premiers, introduisent quelques textes gândhârî en Chine au I° s de n.è. On a noté que, durant les trois premiers siècles de notre ère, les centre-asiatiques - Bactriens, Sogdiens de familles marchandes émigrées en Inde, Indo-Parthes, Khotanais, Koutchéens - forment les deux tiers des traducteurs des textes indiens en Chine. Au milieu du II°s de notre ère, le premier grand protecteur du bouddhisme en Chine est un ambassadeur parthe, An Shigao, et une génération plus tard, Lokakshema, l'introducteur du mahâyâna, est un Bactrien. En Chine du sud, au III°s, les deux grands noms sont ceux de Zhi Qian et Kang Senghui, de familles bactrienne et sogdienne d'Asie centrale ayant émigré en territoire chinois. En Chine du Nord, les deux grands traducteurs sont, à la fin du III°s, Dharmaraksha, d'une famille bactrienne de Dunhuang, puis, un siècle plus tard, Kumârajîva, prince koutchéen. Ces moines viennent souvent de familles de marchands, et étaient sans doute par leur milieu social plus habitués à parcourir les routes.
Mais ensuite, le bouddhisme se rediffuse vers l'ouest depuis la Chine. Dunhuang, dans le prolongement du Gansu, et Gaochang, à partir de sa conquête au milieu du V°s par la dynastie sinisée des Qu du Gansu - et même si le bouddhisme y est antérieur -, appartiennent en Asie centrale à ce bouddhisme chinois. La conquête chinoise d'une large part de l'Asie centrale au milieu du VII°s vient renforcer ce bouddhisme notamment par la création de monastères d'Etat, déjà évoqués au chapitre VII. L'intégration de l'Asie centrale à l'empire des Tang a des conséquences qui ne se limitent pas à ces monastères coloniaux : on constate le basculement d'une partie des réseaux marchands sogdiens vers un bouddhisme dominé par les modèles chinois. Alors que la Sogdiane était voisine de la Bactriane, le bouddhisme ne s'y était diffusé que faiblement. La plupart des textes sogdiens bouddhiques sont traduits du chinois à partir du milieu du VII°s dans les communautés sogdiennes expatriées à l'est, et non directement des langues indiennes ou du bactrien et en Sogdiane.
p. 362
Enfin, avant d'aller plus loin, au terme de cette avalanche de noms de peuples, de villes, d'oasis et de langues, il faut souligner un dernier point : tout ce qu'on va lire ne concerne en termes d'espace que des zones géographiques marginales de l'Asie centrale. On ne dira jamais trop que les déserts, Taklamakan et Gobi, Dzoungarie, Qyzylqum et Qaraqum, les steppes arides et les montagnes, parmi les plus redoutables de la planète, forment l'essentiel de ces quelque six millions de kilomètres carrés. Ce qui est rare en Asie centrale, c'est la terre cultivée ou la bonne pâture, ce sont les zones habitées, tandis que les déserts et les montagnes se trouvent au centre aussi bien de la région que de chacune de ses composantes.
Il faut prendre conscience à l'orée de cet ouvrage de cette immensité désertique, cet espace à la fois distendu et compartimenté qu'est alors et toujours l'Asie centrale. Les régions agricoles de quelque ampleur y sont aussi rares que les hommes. (...) Cette prégnance des espaces vides et le compartimentage qui en découle, conduisent à questionner la notion même d'Asie centrale : il n'est nullement évident que l'Asie centrale existe, puisse être l'objet d'une enquête historique en tant que telle, tant y cohabitent de multiples groupes dans la plus grande des dispersions. Elle pourrait n'être qu'un espace interstitiel entre ces grands blocs de civilisation que forment l'Inde et la Chine, l'Iran et le monde des steppes. (...)
L'un des enjeux est bien de justifier l'idée même d'Asie centrale durant cette période, de montrer comment quelque chose se noue puis se dénoue entre le milieu du IV°s et le milieu du IX°s, et la manière, par-delà les interstices, dont de multiples réseaux organisent cet espace.
pp. 22-23
Il faut prendre conscience à l'orée de cet ouvrage de cette immensité désertique, cet espace à la fois distendu et compartimenté qu'est alors et toujours l'Asie centrale. Les régions agricoles de quelque ampleur y sont aussi rares que les hommes. (...) Cette prégnance des espaces vides et le compartimentage qui en découle, conduisent à questionner la notion même d'Asie centrale : il n'est nullement évident que l'Asie centrale existe, puisse être l'objet d'une enquête historique en tant que telle, tant y cohabitent de multiples groupes dans la plus grande des dispersions. Elle pourrait n'être qu'un espace interstitiel entre ces grands blocs de civilisation que forment l'Inde et la Chine, l'Iran et le monde des steppes. (...)
L'un des enjeux est bien de justifier l'idée même d'Asie centrale durant cette période, de montrer comment quelque chose se noue puis se dénoue entre le milieu du IV°s et le milieu du IX°s, et la manière, par-delà les interstices, dont de multiples réseaux organisent cet espace.
pp. 22-23
La première islamisation (de l'Asie Centrale) : six raisons de se convertir.
La violence militaire est, on l'a dit p. 249, probablement limitée aux premiers temps de la conquête, à une stratégie de destruction des résistances, de bris des volontés. Si cette conversion par le sabre a longtemps résumé le tableau que l'historiographie faisait du processus de conversion, il semble qu'il ne faille ni la nier pour la phase initiale, ni la projeter indûment sur la longue durée : passé la phase de conquête, on ne possède aucun témoignage sur une violence d'Etat massive et généralisée, bien impossible à maintenir durablement. (...)
Il en va sans doute autrement d'une violence sociale diffuse et protégée par le pouvoir, ou tolérée, au fur et à mesure que la part des musulmans croît dans la population. On ne la saisit que très mal, à travers de petits épisodes ou détails archéologiques. A Boukhara une foule vient piller les maisons de riches marchands qui ne venaient pas à la prière. Les battants peints de divinités de leurs portes sont utilisés comme trophées et portes de la grande mosquée, après avoir effacé le visage des anciens dieux. L'archéologie de toute l'Asie centrale montre la réalité de la pratique, visant particulièrement les yeux des images des représentations préislamiques afin de les priver de leur efficace : tous les personnages de la peinture d'Afrasiab ont eu les yeux crevés à l'époque islamique - les rouges cinabre n'ont pas eu le temps de virer au noir. De même à Pendjikent de grands "Non !" en arabe s'étalent au travers des peintures sogdiennes.
p. 453
La violence militaire est, on l'a dit p. 249, probablement limitée aux premiers temps de la conquête, à une stratégie de destruction des résistances, de bris des volontés. Si cette conversion par le sabre a longtemps résumé le tableau que l'historiographie faisait du processus de conversion, il semble qu'il ne faille ni la nier pour la phase initiale, ni la projeter indûment sur la longue durée : passé la phase de conquête, on ne possède aucun témoignage sur une violence d'Etat massive et généralisée, bien impossible à maintenir durablement. (...)
Il en va sans doute autrement d'une violence sociale diffuse et protégée par le pouvoir, ou tolérée, au fur et à mesure que la part des musulmans croît dans la population. On ne la saisit que très mal, à travers de petits épisodes ou détails archéologiques. A Boukhara une foule vient piller les maisons de riches marchands qui ne venaient pas à la prière. Les battants peints de divinités de leurs portes sont utilisés comme trophées et portes de la grande mosquée, après avoir effacé le visage des anciens dieux. L'archéologie de toute l'Asie centrale montre la réalité de la pratique, visant particulièrement les yeux des images des représentations préislamiques afin de les priver de leur efficace : tous les personnages de la peinture d'Afrasiab ont eu les yeux crevés à l'époque islamique - les rouges cinabre n'ont pas eu le temps de virer au noir. De même à Pendjikent de grands "Non !" en arabe s'étalent au travers des peintures sogdiennes.
p. 453
Contrairement à l'image classique élaborée à partir des textes gréco-latins, la "route de la Soie" n'est pas principalement un commerce entre l'Europe et la Chine. Certes, les caravaniers centre-asiatiques touchent aux rives byzantines en mer Noire, mais ce n'est là peut-être que la plus exotique de leurs destinations, et probablement pas la plus importante, comparé à la Mongolie, à l'Inde du Nord, à l'Iran et surtout aux grandes villes de Chine. De plus, l'Asie centrale ne se réduit pas au transit, elle n'est pas seulement un point de passage nécessaire de la route de la Soie, projection d'une image de l'Ancien monde où seules compteraient les grandes puissances. En termes économiques, ces routes sont segmentées entre des points nodaux, comme Samarcande ou Gaochang, où confluent puis sont réexportées des cargaisons qui comprennent aussi bien des productions locales que de la soie chinoise, des épices indiennes, de la zibeline sibérienne ou de l'argenterie byzantine et iranienne.
p. 317
p. 317
autres livres classés : asie centraleVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Étienne de La Vaissière (3)
Voir plus
Quiz
Voir plus
l'histoire médiévale française niveau facile à moyen
Entre quelles période situe-t-on le Moyen-Age?
Période moderne et Révolution Française
Préhistoire et Antiquité
Antiquité et période moderne
Révolution française et période contemporaine
23 questions
275 lecteurs ont répondu
Thèmes :
médiéval
, moyen-âge
, histoire de franceCréer un quiz sur ce livre275 lecteurs ont répondu