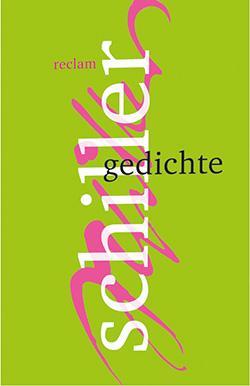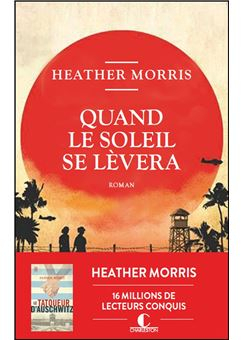Friedrich von Schiller
EAN : 9783150077146
Reclam, Stuttgart (01/01/1900)
/5
1 notes
Reclam, Stuttgart (01/01/1900)
Résumé :
Pionnier avec Goethe du romantisme allemand, Schiller est à la fois l'un des grands penseurs et l'un des grands poètes de la fin du XVIIIe siècle. Son œuvre a suscité l'admiration de Dostoïevski, de Beethoven ou encore de Thomas Mann.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après PoésiesVoir plus
Citations et extraits (60)
Voir plus
Ajouter une citation
LA PROMENADE.
Salut à toi, montagne aux sommités empourprées ! salut à toi, soleil qui colores si bien ces cimes, et à toi, campagne animée, et à vous, tilleuls dont j’aime à entendre le murmure, et au chœur joyeux qui se balance sur ces rameaux ! Je te salue aussi, azur paisible qui entoures, dans un immense espace, la colline aux teintes sombres, la forêt verte qui s’étend sur moi, lorsque je quitte mon étroite retraite pour m’entretenir avec moi-même et pour te voir. Un air balsamique me pénètre et me rafraîchit, une lumière brillante satisfait mon regard altéré. Des couleurs vives et mobiles brillent dans la prairie, puis se fondent dans un doux ensemble. La plaine me reçoit sur ses larges tapis, le sentier rustique serpente à travers sa verdure, l’abeille diligente voltige et bourdonne autour de moi, le papillon se repose sur les feuilles de trèfle, les rayons du soleil tombent sur ma tête, les vents se taisent et l’on n’entend que le chant de l’alouette qui s’élance vers le ciel. J’écoute le murmure de la forêt voisine, la couronne des aunes se penche et la brise légère balance les pointes de gazon argenté. Là se trouvent l’ombre et les parfums, et le hêtre m’offre sous ses larges rameaux un toit pompeux, une fraîcheur attrayante. Dans les détours de la forêt le paysage disparaît à mes yeux, et je monte plus loin par le chemin qui serpente. À travers le réseau de feuillage pénètrent quelques rares rayons, et l’azur du ciel qui me sourit. Mais tout à coup ce voile se déchire, la forêt s’ouvre et je retrouve l’éblouissante clarté du jour. L’espace immense s’étend sous mes yeux, et une montagne bleuâtre entourée de vapeurs s’élève à l’horizon. Au pied de la cime élevée et escarpée je vois se dérouler comme une glace les vagues du fleuve, au-dessous de moi et sur ma tête est l’immensité. De quelque côté que mes regards se tournent, j’éprouve un sentiment de terreur ou une idée de vertige. Mais entre ces sommités inébranlables et ces profondeurs terribles un chemin assuré s’ouvre au voyageur. Devant moi sont des rives fécondes, devant moi une vallée superbe cultivée avec zèle. Ces lignes qui séparent les domaines du laboureur, c’est Démétrius qui les a tracées sur les tapis de verdure. Heureuse puissance de la loi du Dieu qui gouverne les hommes depuis que l’amour s’est enfui du monde. Mais dans les champs irréguliers qui tournent et serpentent, qui tantôt touchent à la forêt, qui tantôt s’élèvent sur la colline, on distingue une trace brillante : c’est la route qui réunit plusieurs pays. Sur le fleuve paisible flottent les radeaux ; la clochette des troupeaux retentit dans la vallée et l’écho solitaire répète les chants du berger. Le gai village orne les bords du fleuve, d’autres se cachent entre les arbres, d’autres sont suspendus aux flancs des coteaux. L’homme habite au milieu de ces champs, ses sillons entourent sa maison rustique, la vigne couronne ses fenêtres, l’arbre jette sur son toit un de ses rameaux. Heureux habitant des champs que le cri de la liberté n’a pas encore éveillé ! Tu suis gaiement les lois modestes qui te sont prescrites. Au retour régulier des moissons s’arrêtent tes vœux, et ta vie se déroule comme l’œuvre de ta journée ; mais qui vient tout à coup m’arracher à ces doux aspects ? un esprit étranger se jette sur ces campagnes, ce que l’affection unissait se divise et l’on ne cherche plus que son égal. Je vois des castes qui se forment, les hauts peupliers s’alignent avec une pompe régulière et majestueuse, tout est soumis à la règle, tout doit avoir une signification, et une escorte d’esclaves m’annonce le maître. De loin aussi il s’annonce éclairé par les coupoles brillantes, par les villes bâties avec le roc et couvertes de tours. Les faunes sont repoussés au fond des forêts sauvages ; mais la piété donne une plus haute destinée à la prière. L’homme s’est rapproché de l’homme ; son cercle, en se rétrécissant, s’anime ; il sent le monde entier se mouvoir en lui, les forces ardentes luttent dans les combats, leur lutte produit de grandes choses, leur alliance en produit de plus grandes encore. Un même esprit anime des milliers de bras, un même cœur, brûlant d’une pensée ardente, palpite dans des milliers de poitrines, il palpite pour la patrie et s’enflamme pour la loi des aïeux ; sur ce sol chéri reposent leurs cendres vénérées. Les Dieux descendent du ciel et établissent leurs demeures dans une enceinte consacrée. Ils viennent apportant des dons précieux : Cérès, la première, avec les présents de la charrue ; Hermès avec l’ancre du commerce, Bacchus avec la vigne, Minerve avec les rameaux verts de l’olivier et Poséidon avec le cheval de guerre ; Cybèle arrive avec son char attelé de lions et reçoit le droit de cité. Pierres saintes, c’est de vous que sont sortis les tuteurs de l’humanité, de vous les mœurs, les arts répandus dans les îles lointaines ; près de ces portes paisibles les sages ont prononcé leurs sentences, les héros se sont précipités dans les combats pour défendre leurs pénates. Sur les murs on voyait les mères avec leurs enfants suivant l’armée de leurs regards jusqu’à ce qu’elle disparût dans le lointain ; elles tombaient à genoux devant les autels des Dieux, elles imploraient le succès et la gloire, elles imploraient le retour de ceux qu’elles aimaient ; et vous obteniez, ô braves guerriers, le succès et l’honneur, mais vous ne reveniez pas ; la pierre raconte vos exploits : « Voyageur, si tu vas à Sparte, dis que tu nous as vus ici morts comme la loi l’ordonnait. » Reposez en paix, héros aimés, l’olivier, arrosé par votre sang, reverdit, et la semence précieuse germe dans le sol ; la libre industrie se met ardemment à l’œuvre, le Dieu des ondes l’appelle dans son lit de roseaux, la hache entre en sifflant dans la tige de l’arbre, la dryade soupire, et l’arbre tombe avec fracas du haut de la montagne. On coupe le roc, on enlève la pierre avec le levier, l’homme de la montagne descend dans les ravins, le marteau retentit sur l’enclume, les étincelles de l’acier jaillissent sous une main nerveuse, le lin doré entoure le léger fuseau, le navire se meut à l’aide des cordes de chanvre, le pilote pousse son cri sur la rade, on attend les flottes qui vont porter sur la terre étrangère le produit du travail, d’autres reviennent avec les richesses des côtes lointaines, la guirlande de fête s’élève au haut des mâts superbes, les places publiques, les marchés sont pleins de mouvement et l’oreille écoute avec surprise un singulier mélange de langues diverses, le marchand étale sur la place les moissons de la terre, celles qui mûrissent sous le soleil brûlant d’Afrique, celles de l’Arabie, celles de Thulé, et la corne d’Amalthée est remplie de dons précieux. Alors la fortune fait naître les œuvres de l’imagination, l’art se développe soutenu par la liberté, le sculpteur réjouit les regards par ses imitations de la vie réelle, et le ciseau donne à la pierre le sentiment et l’éloquence. Sur les élégantes colonnes ioniennes repose un ciel artistique et l’Olympe entier est renfermé dans le Panthéon. Sur les torrents écumeux le pont s’élève, léger comme l’arc-en-ciel d’Iris et comme la flèche ; dans une retraite paisible le savant trace des cercles importants et fait des expériences fécondes : il examine la force de la matière, l’attraction de l’aimant, suit le son dans les airs, la lumière dans l’espace, cherche la loi des phénomènes et le mouvement du pôle. L’écriture donne un corps et une voix à la pensée muette, une feuille éloquente la conserve à travers le cours des siècles, les nuages de l’erreur se dissipent, les fantômes de la nuit s’évanouissent à la lumière ; l’homme brise ses chaînes, heureux se, en brisant les chaînes de la crainte, il ne rompait pas aussi les liens de la sagesse ! Liberté ! crie la raison : liberté ! les désirs aveugles se séparent de la sainte nature, l’homme brise dans la tempête les ancres qui le retenaient prudemment au rivage, le torrent écumeux le saisit et l’emporte dans l’espace, le rivage disparaît, la nacelle privée de ses mâts se balance sur les vagues orageuses, les étoiles se cachent sous les nuages ; rien ne reste, tout est terreur et confusion, la vérité n’est plus dans le langage, la foi et la fidélité ne sont plus dans la vie, le serment est trompeur, le sycophante pénètre dans les liens les plus fermes du cœur, dans les secrets de l’amour et sépare l’ami de son ami, la trahison regarde d’un œil perfide l’innocence, la dent du calomniateur fait de mortelles blessures, l’âme profanée ne garde que de lâches pensées et l’amour rejette la divine noblesse de ses sentiments ; le mensonge a pris tes traits, ô vérité ! il profane les voix les plus précieuses de la nature que le cœur altéré recherche dans l’élan de la joie ; à peine y a-t-il dans le silence un émotion vraie, à la tribune on parle pompeusement d’équité, dans la cabane on parle d’union, et le fantôme de la loi est debout près du trône des rois. Cette momie, cette image trompeuse de la vie peut subsister pendant des siècles entiers jusqu’à ce que la nature se réveille et, d’une main lourde, d’une main de fer, poussée par le temps et par la nécessité, brise l’édifice imposteur ; jusqu’à ce que, pareille à une tigresse qui, dans le souvenir des forêts de Numidie, rompt ses grilles de fer, l’humanité se lève avec la rage du crime et de la misère, et cherche à retrouver la nature dans les cendres d’une ville. Ouvrez-vous, ô murailles, laissez le prisonnier retourner aux campagnes qu’il a quittées. Mais où suis-je ? Le sentier disparaît, les abîmes profonds arrêtent ma marche, derrière moi sont les haies riantes, les jardins fleuris, toutes les traces des œuvres de l’homme, je ne vois plus que la matière d’où la vie doit sortir, le basalte brut attend la main qui le doit façonner, le torrent se précipite à travers les fentes du roc et se fraie un chemin sous les racines de l’arbre. Tout est ici sombre et terrible dans l’atmosphère déserte, l’aigle solitaire plane entre les nuage
Salut à toi, montagne aux sommités empourprées ! salut à toi, soleil qui colores si bien ces cimes, et à toi, campagne animée, et à vous, tilleuls dont j’aime à entendre le murmure, et au chœur joyeux qui se balance sur ces rameaux ! Je te salue aussi, azur paisible qui entoures, dans un immense espace, la colline aux teintes sombres, la forêt verte qui s’étend sur moi, lorsque je quitte mon étroite retraite pour m’entretenir avec moi-même et pour te voir. Un air balsamique me pénètre et me rafraîchit, une lumière brillante satisfait mon regard altéré. Des couleurs vives et mobiles brillent dans la prairie, puis se fondent dans un doux ensemble. La plaine me reçoit sur ses larges tapis, le sentier rustique serpente à travers sa verdure, l’abeille diligente voltige et bourdonne autour de moi, le papillon se repose sur les feuilles de trèfle, les rayons du soleil tombent sur ma tête, les vents se taisent et l’on n’entend que le chant de l’alouette qui s’élance vers le ciel. J’écoute le murmure de la forêt voisine, la couronne des aunes se penche et la brise légère balance les pointes de gazon argenté. Là se trouvent l’ombre et les parfums, et le hêtre m’offre sous ses larges rameaux un toit pompeux, une fraîcheur attrayante. Dans les détours de la forêt le paysage disparaît à mes yeux, et je monte plus loin par le chemin qui serpente. À travers le réseau de feuillage pénètrent quelques rares rayons, et l’azur du ciel qui me sourit. Mais tout à coup ce voile se déchire, la forêt s’ouvre et je retrouve l’éblouissante clarté du jour. L’espace immense s’étend sous mes yeux, et une montagne bleuâtre entourée de vapeurs s’élève à l’horizon. Au pied de la cime élevée et escarpée je vois se dérouler comme une glace les vagues du fleuve, au-dessous de moi et sur ma tête est l’immensité. De quelque côté que mes regards se tournent, j’éprouve un sentiment de terreur ou une idée de vertige. Mais entre ces sommités inébranlables et ces profondeurs terribles un chemin assuré s’ouvre au voyageur. Devant moi sont des rives fécondes, devant moi une vallée superbe cultivée avec zèle. Ces lignes qui séparent les domaines du laboureur, c’est Démétrius qui les a tracées sur les tapis de verdure. Heureuse puissance de la loi du Dieu qui gouverne les hommes depuis que l’amour s’est enfui du monde. Mais dans les champs irréguliers qui tournent et serpentent, qui tantôt touchent à la forêt, qui tantôt s’élèvent sur la colline, on distingue une trace brillante : c’est la route qui réunit plusieurs pays. Sur le fleuve paisible flottent les radeaux ; la clochette des troupeaux retentit dans la vallée et l’écho solitaire répète les chants du berger. Le gai village orne les bords du fleuve, d’autres se cachent entre les arbres, d’autres sont suspendus aux flancs des coteaux. L’homme habite au milieu de ces champs, ses sillons entourent sa maison rustique, la vigne couronne ses fenêtres, l’arbre jette sur son toit un de ses rameaux. Heureux habitant des champs que le cri de la liberté n’a pas encore éveillé ! Tu suis gaiement les lois modestes qui te sont prescrites. Au retour régulier des moissons s’arrêtent tes vœux, et ta vie se déroule comme l’œuvre de ta journée ; mais qui vient tout à coup m’arracher à ces doux aspects ? un esprit étranger se jette sur ces campagnes, ce que l’affection unissait se divise et l’on ne cherche plus que son égal. Je vois des castes qui se forment, les hauts peupliers s’alignent avec une pompe régulière et majestueuse, tout est soumis à la règle, tout doit avoir une signification, et une escorte d’esclaves m’annonce le maître. De loin aussi il s’annonce éclairé par les coupoles brillantes, par les villes bâties avec le roc et couvertes de tours. Les faunes sont repoussés au fond des forêts sauvages ; mais la piété donne une plus haute destinée à la prière. L’homme s’est rapproché de l’homme ; son cercle, en se rétrécissant, s’anime ; il sent le monde entier se mouvoir en lui, les forces ardentes luttent dans les combats, leur lutte produit de grandes choses, leur alliance en produit de plus grandes encore. Un même esprit anime des milliers de bras, un même cœur, brûlant d’une pensée ardente, palpite dans des milliers de poitrines, il palpite pour la patrie et s’enflamme pour la loi des aïeux ; sur ce sol chéri reposent leurs cendres vénérées. Les Dieux descendent du ciel et établissent leurs demeures dans une enceinte consacrée. Ils viennent apportant des dons précieux : Cérès, la première, avec les présents de la charrue ; Hermès avec l’ancre du commerce, Bacchus avec la vigne, Minerve avec les rameaux verts de l’olivier et Poséidon avec le cheval de guerre ; Cybèle arrive avec son char attelé de lions et reçoit le droit de cité. Pierres saintes, c’est de vous que sont sortis les tuteurs de l’humanité, de vous les mœurs, les arts répandus dans les îles lointaines ; près de ces portes paisibles les sages ont prononcé leurs sentences, les héros se sont précipités dans les combats pour défendre leurs pénates. Sur les murs on voyait les mères avec leurs enfants suivant l’armée de leurs regards jusqu’à ce qu’elle disparût dans le lointain ; elles tombaient à genoux devant les autels des Dieux, elles imploraient le succès et la gloire, elles imploraient le retour de ceux qu’elles aimaient ; et vous obteniez, ô braves guerriers, le succès et l’honneur, mais vous ne reveniez pas ; la pierre raconte vos exploits : « Voyageur, si tu vas à Sparte, dis que tu nous as vus ici morts comme la loi l’ordonnait. » Reposez en paix, héros aimés, l’olivier, arrosé par votre sang, reverdit, et la semence précieuse germe dans le sol ; la libre industrie se met ardemment à l’œuvre, le Dieu des ondes l’appelle dans son lit de roseaux, la hache entre en sifflant dans la tige de l’arbre, la dryade soupire, et l’arbre tombe avec fracas du haut de la montagne. On coupe le roc, on enlève la pierre avec le levier, l’homme de la montagne descend dans les ravins, le marteau retentit sur l’enclume, les étincelles de l’acier jaillissent sous une main nerveuse, le lin doré entoure le léger fuseau, le navire se meut à l’aide des cordes de chanvre, le pilote pousse son cri sur la rade, on attend les flottes qui vont porter sur la terre étrangère le produit du travail, d’autres reviennent avec les richesses des côtes lointaines, la guirlande de fête s’élève au haut des mâts superbes, les places publiques, les marchés sont pleins de mouvement et l’oreille écoute avec surprise un singulier mélange de langues diverses, le marchand étale sur la place les moissons de la terre, celles qui mûrissent sous le soleil brûlant d’Afrique, celles de l’Arabie, celles de Thulé, et la corne d’Amalthée est remplie de dons précieux. Alors la fortune fait naître les œuvres de l’imagination, l’art se développe soutenu par la liberté, le sculpteur réjouit les regards par ses imitations de la vie réelle, et le ciseau donne à la pierre le sentiment et l’éloquence. Sur les élégantes colonnes ioniennes repose un ciel artistique et l’Olympe entier est renfermé dans le Panthéon. Sur les torrents écumeux le pont s’élève, léger comme l’arc-en-ciel d’Iris et comme la flèche ; dans une retraite paisible le savant trace des cercles importants et fait des expériences fécondes : il examine la force de la matière, l’attraction de l’aimant, suit le son dans les airs, la lumière dans l’espace, cherche la loi des phénomènes et le mouvement du pôle. L’écriture donne un corps et une voix à la pensée muette, une feuille éloquente la conserve à travers le cours des siècles, les nuages de l’erreur se dissipent, les fantômes de la nuit s’évanouissent à la lumière ; l’homme brise ses chaînes, heureux se, en brisant les chaînes de la crainte, il ne rompait pas aussi les liens de la sagesse ! Liberté ! crie la raison : liberté ! les désirs aveugles se séparent de la sainte nature, l’homme brise dans la tempête les ancres qui le retenaient prudemment au rivage, le torrent écumeux le saisit et l’emporte dans l’espace, le rivage disparaît, la nacelle privée de ses mâts se balance sur les vagues orageuses, les étoiles se cachent sous les nuages ; rien ne reste, tout est terreur et confusion, la vérité n’est plus dans le langage, la foi et la fidélité ne sont plus dans la vie, le serment est trompeur, le sycophante pénètre dans les liens les plus fermes du cœur, dans les secrets de l’amour et sépare l’ami de son ami, la trahison regarde d’un œil perfide l’innocence, la dent du calomniateur fait de mortelles blessures, l’âme profanée ne garde que de lâches pensées et l’amour rejette la divine noblesse de ses sentiments ; le mensonge a pris tes traits, ô vérité ! il profane les voix les plus précieuses de la nature que le cœur altéré recherche dans l’élan de la joie ; à peine y a-t-il dans le silence un émotion vraie, à la tribune on parle pompeusement d’équité, dans la cabane on parle d’union, et le fantôme de la loi est debout près du trône des rois. Cette momie, cette image trompeuse de la vie peut subsister pendant des siècles entiers jusqu’à ce que la nature se réveille et, d’une main lourde, d’une main de fer, poussée par le temps et par la nécessité, brise l’édifice imposteur ; jusqu’à ce que, pareille à une tigresse qui, dans le souvenir des forêts de Numidie, rompt ses grilles de fer, l’humanité se lève avec la rage du crime et de la misère, et cherche à retrouver la nature dans les cendres d’une ville. Ouvrez-vous, ô murailles, laissez le prisonnier retourner aux campagnes qu’il a quittées. Mais où suis-je ? Le sentier disparaît, les abîmes profonds arrêtent ma marche, derrière moi sont les haies riantes, les jardins fleuris, toutes les traces des œuvres de l’homme, je ne vois plus que la matière d’où la vie doit sortir, le basalte brut attend la main qui le doit façonner, le torrent se précipite à travers les fentes du roc et se fraie un chemin sous les racines de l’arbre. Tout est ici sombre et terrible dans l’atmosphère déserte, l’aigle solitaire plane entre les nuage
FRIDOLIN.
Fridolin était un pieux serviteur, craignant Dieu et dévoué à sa maîtresse, la comtesse de Saverne. C’était une douce et généreuse femme ; mais quelles que fussent ses volontés, Fridolin avait appris à s’y soumettre gaiement et pour l’amour de Dieu.
Depuis le point du jour jusqu’au soir, il n’était occupé que de la servir, jamais il ne croyait faire assez, et lorsque sa maîtresse lui disait : « Ne te donne pas tant de peine, » il sentait les larmes lui venir dans les yeux et craignait, en se montrant moins zélé, de manquer à son devoir.
La comtesse le distinguait entre tous les gens de sa maison ; sans cesse elle le louait ; elle ne le traitait pas comme un valet, mais plutôt comme un enfant, et arrêtait volontiers ses regards sur sa jeune et agréable figure.
Cette préférence irrita la méchante âme de Robert, le chasseur, qui depuis longtemps nourrissait de mauvais desseins. Pressé par le génie du mal, un jour qu’il s’en revenait de la chasse avec le comte, il lui jeta dans le cœur les germes du soupçon.
« Que vous êtes heureux, noble comte ! lui dit-il traîtreusement : le doute rongeur ne trouble pas votre paisible sommeil ; car vous possédez une vertueuse femme dont la pudeur augmente les charmes. Nul séducteur ne parviendrait à ébranler une telle vertu.
— Que me dis-tu là ? répondit le comte avec un regard sombre. Puis-je me fier à la vertu de la femme mobile comme l’onde ? Elle attire facilement les paroles flatteuses. Ma confiance repose sur une base plus ferme, et le séducteur, je l’espère, n’oserait s’approcher de la femme du comte de Saverne.
— Vous avez raison, reprend Robert, et il ne faut que rire de l’insensé valet qui ose élever ses vœux téméraires jusqu’à la noble dame à laquelle il doit obéir. — Quoi ! s’écria le comte, parles-tu de celui qui est là ?
— Oui sans doute. Mon maître ignore ce dont chacun parle, et puisque vous ne savez rien, je voudrais me taire. — Tu es mort, si tu n’achèves, dit le comte d’une voix terrible. Qui oserait lever les yeux sur Cunégonde ? — Je veux parler du petit blond.
« Il n’est pas laid de figure, — continue Robert avec méchanceté, tandis qu’à chaque mot la sueur inonde le visage du comte. — Est-il possible, monseigneur, que vous n’ayez jamais remarqué qu’il n’a des yeux que pour elle ? À table il reste languissant derrière sa chaise, et ne s’occupe pas même de vous.
« Voyez ces vers qu’il a écrits et où il avoue son amour. — Il avoue ! — Et l’audacieux la conjure de l’aimer aussi. La noble comtesse, qui est si douce et si bonne, ne vous en a rien dit par pitié pour lui. Je me repens d’avoir laissé échapper ces paroles : car qu’allez-vous faire ? » —
Le comte, dans sa colère, pénètre au milieu d’un bois voisin, où l’on fond le fer dans une de ses forges. Là, matin et soir, les ouvriers entretiennent le feu d’une main active. L’étincelle jaillit, les soufflets sont en mouvement, comme s’il fallait vitrifier les rocs.
Là on voit réunie la puissance de l’eau et du feu. La roue, poussée par les flots, tourne sans cesse ; les rouages résonnent jour et nuit, le marteau tombe lourdement sur l’enclume, et le fer cède à ses coups répétés.
Il fait signe à deux forgerons et leur dit :
« Le premier messager qui viendra ici vous demander si vous avez accompli les ordres de son maître, vous le prendrez et vous le jetterez dans la fournaise. Qu’il y soit réduit en cendres et que mes yeux ne le revoient plus. »
Ces paroles donnent aux forgerons une joie de bourreau ; car leur cœur était dur comme le fer. Ils raniment avec le soufflet le feu de la fournaise et attendent avec un cruel désir leur victime.
Robert s’en va trouver Fridolin, et lui dit d’une voix hypocrite : « Allons ! hâte-toi, le maître veut te parler. » Et le comte dit à Fridolin : « Il faut que tu ailles à l’instant même à la forge, et que tu demandes aux ouvriers s’ils ont accompli mes ordres.
— Cela sera fait, répond Fridolin, » et il se prépare à partir. Cependant il réfléchit tout à coup que sa maîtresse peut avoir quelque ordre à lui donner. Il s’en va près d’elle et lui dit : « On m’envoie à la forge, dites-moi ce que je dois faire, car c’est à vous que j’appartiens. »
La dame de Saverne lui répond avec douceur : « Je voudrais bien entendre la messe, mais mon fils est malade. Va prier à ma place, et en te repentant de tes péchés, obtiens-moi la grâce de Dieu. »
Et, joyeux de recevoir cet ordre, il se met en marche. À peine arrivé au bout du village, il entend le son de la clochette qui invite solennellement tous les pécheurs à s’approcher du saint sacrement.
« Ne t’éloigne pas, se dit-il, du bon Dieu, si tu le trouves sur ta route, » et alors il entre dans l’église. Elle est déserte, car c’est le temps de la moisson. Les laboureurs sont dans les champs, il n’y a pas même un enfant de chœur pour servir la messe.
Fridolin a bientôt pris sa résolution. Il remplace le sacristain. « Peu importe, se dit-il, le délai, c’est le ciel qui le veut. » Il donne au prêtre l’étole et la chasuble, prépare à la hâte les vases nécessaires pour le saint office. Puis, après avoir accompli cette tâche, il marche devant le prêtre, s’agenouille à droite, s’agenouille à gauche, obéit à chaque signe, et au Sanctus fait sonner trois fois la clochette.
Lorsque le prêtre s’incline pieusement, et, tourné du côté de l’autel, tient entre ses mains le Dieu descendu dans l’hostie, le sacristain agite sa clochette, et tous les assistants s’agenouillent, se frappent la poitrine et font le signe de la croix devant le Christ.
Fridolin accomplit ainsi habilement son devoir religieux. Il connaît les coutumes de l’Église et les suit de point en point, jusqu’à ce que le prêtre prononce le Dominus vobiscum et termine l’office en bénissant la communauté.
Alors Fridolin remet tout en ordre sur l’autel et dans le sanctuaire, puis il s’éloigne la conscience tranquille et s’en va vers la forge, en murmurant tout bas douze Pater noster.
Arrivé près de la fournaise, il demande aux ouvriers s’ils ont exécuté les ordres du comte. Ils ouvrent la bouche en grimaçant, lui montrent la gueule de la fournaise et lui disent : « La chose est faite, le maître sera content de ses serviteurs. »
Il retourne à la hâte porter cette réponse au comte. Celui-ci, en le voyant venir de loin, ne pouvait en croire ses yeux. « Malheureux ! s’écrie-t-il, d’où viens-tu ? — De la forge. — C’est impossible. Tu t’es donc arrêté en chemin ? — Pas plus qu’il ne le fallait pour faire ma prière.
« Car lorsque je vous quittai ce matin, je m’en allai, pardonnez-moi, demander des ordres à celle à qui je dois d’abord obéir. Elle m’ordonna d’entendre la messe, ce que je fis avec joie, et je dis le rosaire pour votre salut et pour le sien. »
Le comte épouvanté lui demande ce qu’on lui a répondu à la forge : « Maître, les paroles de ouvriers étaient obscures : on m’a montré la fournaise, et l’on m’a dit : « Son affaire est faite, le maître sera content de ses serviteurs. »
— Et Robert, dit le comte avec un frisson glacial, ne l’as-tu pas rencontré ? Je l’ai envoyé dans la forêt.
— Seigneur, je n’ai vu aucune trace de lui dans les champs ni dans la forêt. — Eh bien ! s’écrie le comte stupéfait, le Dieu du ciel lui-même a jugé. »
Et, prenant avec une bonté inaccoutumée son serviteur par la main, il le mène tout ému auprès de la comtesse, qui ne comprenait rien à cette action.
« Je recommande cet enfant à votre grâce. Pas un ange n’est plus pur que lui. Nous avons été mal conseillé ; mais Dieu et ses chérubins étaient avec lui. »
Fridolin était un pieux serviteur, craignant Dieu et dévoué à sa maîtresse, la comtesse de Saverne. C’était une douce et généreuse femme ; mais quelles que fussent ses volontés, Fridolin avait appris à s’y soumettre gaiement et pour l’amour de Dieu.
Depuis le point du jour jusqu’au soir, il n’était occupé que de la servir, jamais il ne croyait faire assez, et lorsque sa maîtresse lui disait : « Ne te donne pas tant de peine, » il sentait les larmes lui venir dans les yeux et craignait, en se montrant moins zélé, de manquer à son devoir.
La comtesse le distinguait entre tous les gens de sa maison ; sans cesse elle le louait ; elle ne le traitait pas comme un valet, mais plutôt comme un enfant, et arrêtait volontiers ses regards sur sa jeune et agréable figure.
Cette préférence irrita la méchante âme de Robert, le chasseur, qui depuis longtemps nourrissait de mauvais desseins. Pressé par le génie du mal, un jour qu’il s’en revenait de la chasse avec le comte, il lui jeta dans le cœur les germes du soupçon.
« Que vous êtes heureux, noble comte ! lui dit-il traîtreusement : le doute rongeur ne trouble pas votre paisible sommeil ; car vous possédez une vertueuse femme dont la pudeur augmente les charmes. Nul séducteur ne parviendrait à ébranler une telle vertu.
— Que me dis-tu là ? répondit le comte avec un regard sombre. Puis-je me fier à la vertu de la femme mobile comme l’onde ? Elle attire facilement les paroles flatteuses. Ma confiance repose sur une base plus ferme, et le séducteur, je l’espère, n’oserait s’approcher de la femme du comte de Saverne.
— Vous avez raison, reprend Robert, et il ne faut que rire de l’insensé valet qui ose élever ses vœux téméraires jusqu’à la noble dame à laquelle il doit obéir. — Quoi ! s’écria le comte, parles-tu de celui qui est là ?
— Oui sans doute. Mon maître ignore ce dont chacun parle, et puisque vous ne savez rien, je voudrais me taire. — Tu es mort, si tu n’achèves, dit le comte d’une voix terrible. Qui oserait lever les yeux sur Cunégonde ? — Je veux parler du petit blond.
« Il n’est pas laid de figure, — continue Robert avec méchanceté, tandis qu’à chaque mot la sueur inonde le visage du comte. — Est-il possible, monseigneur, que vous n’ayez jamais remarqué qu’il n’a des yeux que pour elle ? À table il reste languissant derrière sa chaise, et ne s’occupe pas même de vous.
« Voyez ces vers qu’il a écrits et où il avoue son amour. — Il avoue ! — Et l’audacieux la conjure de l’aimer aussi. La noble comtesse, qui est si douce et si bonne, ne vous en a rien dit par pitié pour lui. Je me repens d’avoir laissé échapper ces paroles : car qu’allez-vous faire ? » —
Le comte, dans sa colère, pénètre au milieu d’un bois voisin, où l’on fond le fer dans une de ses forges. Là, matin et soir, les ouvriers entretiennent le feu d’une main active. L’étincelle jaillit, les soufflets sont en mouvement, comme s’il fallait vitrifier les rocs.
Là on voit réunie la puissance de l’eau et du feu. La roue, poussée par les flots, tourne sans cesse ; les rouages résonnent jour et nuit, le marteau tombe lourdement sur l’enclume, et le fer cède à ses coups répétés.
Il fait signe à deux forgerons et leur dit :
« Le premier messager qui viendra ici vous demander si vous avez accompli les ordres de son maître, vous le prendrez et vous le jetterez dans la fournaise. Qu’il y soit réduit en cendres et que mes yeux ne le revoient plus. »
Ces paroles donnent aux forgerons une joie de bourreau ; car leur cœur était dur comme le fer. Ils raniment avec le soufflet le feu de la fournaise et attendent avec un cruel désir leur victime.
Robert s’en va trouver Fridolin, et lui dit d’une voix hypocrite : « Allons ! hâte-toi, le maître veut te parler. » Et le comte dit à Fridolin : « Il faut que tu ailles à l’instant même à la forge, et que tu demandes aux ouvriers s’ils ont accompli mes ordres.
— Cela sera fait, répond Fridolin, » et il se prépare à partir. Cependant il réfléchit tout à coup que sa maîtresse peut avoir quelque ordre à lui donner. Il s’en va près d’elle et lui dit : « On m’envoie à la forge, dites-moi ce que je dois faire, car c’est à vous que j’appartiens. »
La dame de Saverne lui répond avec douceur : « Je voudrais bien entendre la messe, mais mon fils est malade. Va prier à ma place, et en te repentant de tes péchés, obtiens-moi la grâce de Dieu. »
Et, joyeux de recevoir cet ordre, il se met en marche. À peine arrivé au bout du village, il entend le son de la clochette qui invite solennellement tous les pécheurs à s’approcher du saint sacrement.
« Ne t’éloigne pas, se dit-il, du bon Dieu, si tu le trouves sur ta route, » et alors il entre dans l’église. Elle est déserte, car c’est le temps de la moisson. Les laboureurs sont dans les champs, il n’y a pas même un enfant de chœur pour servir la messe.
Fridolin a bientôt pris sa résolution. Il remplace le sacristain. « Peu importe, se dit-il, le délai, c’est le ciel qui le veut. » Il donne au prêtre l’étole et la chasuble, prépare à la hâte les vases nécessaires pour le saint office. Puis, après avoir accompli cette tâche, il marche devant le prêtre, s’agenouille à droite, s’agenouille à gauche, obéit à chaque signe, et au Sanctus fait sonner trois fois la clochette.
Lorsque le prêtre s’incline pieusement, et, tourné du côté de l’autel, tient entre ses mains le Dieu descendu dans l’hostie, le sacristain agite sa clochette, et tous les assistants s’agenouillent, se frappent la poitrine et font le signe de la croix devant le Christ.
Fridolin accomplit ainsi habilement son devoir religieux. Il connaît les coutumes de l’Église et les suit de point en point, jusqu’à ce que le prêtre prononce le Dominus vobiscum et termine l’office en bénissant la communauté.
Alors Fridolin remet tout en ordre sur l’autel et dans le sanctuaire, puis il s’éloigne la conscience tranquille et s’en va vers la forge, en murmurant tout bas douze Pater noster.
Arrivé près de la fournaise, il demande aux ouvriers s’ils ont exécuté les ordres du comte. Ils ouvrent la bouche en grimaçant, lui montrent la gueule de la fournaise et lui disent : « La chose est faite, le maître sera content de ses serviteurs. »
Il retourne à la hâte porter cette réponse au comte. Celui-ci, en le voyant venir de loin, ne pouvait en croire ses yeux. « Malheureux ! s’écrie-t-il, d’où viens-tu ? — De la forge. — C’est impossible. Tu t’es donc arrêté en chemin ? — Pas plus qu’il ne le fallait pour faire ma prière.
« Car lorsque je vous quittai ce matin, je m’en allai, pardonnez-moi, demander des ordres à celle à qui je dois d’abord obéir. Elle m’ordonna d’entendre la messe, ce que je fis avec joie, et je dis le rosaire pour votre salut et pour le sien. »
Le comte épouvanté lui demande ce qu’on lui a répondu à la forge : « Maître, les paroles de ouvriers étaient obscures : on m’a montré la fournaise, et l’on m’a dit : « Son affaire est faite, le maître sera content de ses serviteurs. »
— Et Robert, dit le comte avec un frisson glacial, ne l’as-tu pas rencontré ? Je l’ai envoyé dans la forêt.
— Seigneur, je n’ai vu aucune trace de lui dans les champs ni dans la forêt. — Eh bien ! s’écrie le comte stupéfait, le Dieu du ciel lui-même a jugé. »
Et, prenant avec une bonté inaccoutumée son serviteur par la main, il le mène tout ému auprès de la comtesse, qui ne comprenait rien à cette action.
« Je recommande cet enfant à votre grâce. Pas un ange n’est plus pur que lui. Nous avons été mal conseillé ; mais Dieu et ses chérubins étaient avec lui. »
LE COMBAT AVEC LE DRAGON.
Où court tout ce peuple ? Pourquoi cette rumeur et ce tumulte dans les longues rues ? Rhodes est-il en proie aux flammes dévorantes ? Tout est en mouvement : au milieu de la foule j’aperçois un homme à cheval, et derrière lui, quel spectacle ! on traîne un monstre qui a la forme d’un dragon, une large gueule de crocodile, et chacun regarde tour à tour avec surprise le cavalier et le dragon.
Des milliers de voix s’écrient : « Venez et voyez ! Voilà le dragon qui dévorait les troupeaux et les bergers ! et voilà le héros qui l’a vaincu ! Beaucoup d’autres avaient tenté avant lui ce combat terrible ; mais nul n’en était revenu : rendons hommage au fier cavalier ! » et l’on s’en va vers le cloître où les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean sont réunis en conseil.
Le jeune homme s’avance d’un air modeste devant le noble maître de l’Ordre, tandis que la foule impétueuse se précipite dans la salle ; il prend la parole et dit : « J’ai accompli mon devoir de chevalier, le dragon qui dévastait le pays est mort sous ma main. Maintenant, le voyageur peut poursuivre sa route, le berger conduire son troupeau sur la montagne, et le pèlerin s’en aller par le sentier rocailleux vers l’image qu’il invoque. »
Mais le prince le regarde avec sévérité et lui répond : « Tu as agi comme un héros ; c’est le courage qui honore le chevalier, tu as fait preuve de courage. Mais dis-moi, quel est le premier devoir de celui qui combat pour le Christ et qui porte pour ornement le signe de la croix ? » Tous les assistants pâlissent, et le chevalier dit en s’inclinant et le visage rouge : « L’obéissance est le premier devoir de celui qui veut se rendre digne de porter le signe de la croix.
— Et ce devoir, mon fils, reprend le maître, tu l’as outrageusement violé : tu as entrepris avec audace le combat que la loi t’interdisait. — Maître, répond le jeune chevalier avec soumission, tu jugeras quand tu sauras tout. J’ai cru remplir fidèlement le sens et la volonté de la loi. Je n’ai pas été combattre imprudemment le monstre, j’ai essayé de le vaincre par la ruse et l’habileté.
« Cinq chevaliers de notre Ordre, honneur de la religion, étaient devenus victimes de leur courage ; alors tu nous interdis tout nouveau combat. Cependant, j’éprouvais dans mon cœur une ardente impatience : la nuit même, dans mes rêves, je me voyais luttant avec ardeur, et, quand venait le matin, j’étais saisi d’une inquiétude sauvage et je résolus de tenter le combat.
« Je me dis : Quelle est la gloire du jeune homme et de l’homme mûr ? Quelle fut celle de ces héros dont nous parlent les poëtes, et que l’aveugle paganisme entoura de la splendeur des dieux ? Dans leurs entreprises hardies ils purgèrent la terre de ses monstres, ils attaquèrent le lion et luttèrent avec le minotaure pour délivrer de pauvres victimes, et empêcher le sang de couler.
« Le Sarrasin mérite-t-il seul qu’on le combatte avec l’épée du chrétien ? Ne devons-nous attaquer que les faux dieux ? Le chrétien n’a-t-il pas la mission de secourir le monde entier, d’offrir l’appui de son bras à chaque souffrance, à chaque sollicitude ? Mais la sagesse doit guider son courage, la ruse doit lutter avec la force. Voilà ce que je me disais souvent à l’écart, et je m’en allais m’informant de la manière de combattre les bêtes féroces, lorsque soudain il me vint une inspiration et je m’écriai avec joie : Je l’ai trouvée !
« Je m’approchai de toi et je te dis : Il importe que je retourne dans ma patrie. Tu accédas à mes vœux, et je traversai la mer. À peine arrivé sur le sol natal, je fis façonner par un artiste une image de dragon semblable à celle que j’avais bien remarquée. Je plaçai cette lourde image sur des pieds raccourcis et je la couvris d’une cuirasse écaillée et scintillante.
« Le cou s’étendait en avant ; la gueule, terrible et pareille à une porte d’enfer, s’ouvrait comme pour dévorer sa proie ; au milieu d’une rangée de dents aiguës et sous un noir palais on voyait une langue pareille à la pointe d’une épée ; les yeux lançaient des éclairs ; le dos se terminait par une queue de serpent qui se repliait sur elle-même comme pour enlacer homme et cheval.
« Je fis façonner ainsi cette image exacte et je la revêtis d’une couleur sombre et sinistre. Je vis alors le monstre à moitié dragon, à moitié vipère, enfanté dans un marais empoisonné. Lorsque l’image fut achevée, je choisis un couple de dogues forts, alertes, habitués à s’élancer sur les animaux féroces ; je les exerçai à se jeter sur le dragon en excitant leur colère, en les guidant de la voix, et à le saisir avec leurs dents acérées.
« Je leur appris à faire entrer les dents au milieu du ventre, à l’endroit même où le monstre n’est protégé que par une molle toison. Et moi, couvert de mes armes, je monte sur mon cheval arabe, j’excite son ardeur, je le guide vers le dragon en l’aiguillonnant avec l’éperon, et je brandis mon glaive comme si je voulais pourfendre l’image.
« Mon cheval se cabre, écume, résiste à la bride ; mes chiens s’effrayent, se retirent ; mais je ne cesse de les ramener vers l’image du monstre. Pendant trois mois je les exerce ainsi dans la solitude, et lorsque je les crois habitués à l’image effrayante, je les embarque avec moi sur un navire. Il y a trois jours que je suis arrivé, à peine ai-je pu me décider à prendre quelque repos avant d’avoir conduit à bonne fin mon entreprise.
« Car les plaintes continues de ce pays me troublaient le cœur. On venait tout récemment de trouver en lambeaux les corps de bergers qui s’étaient égarés près des marais. Je veux accomplir à la hâte mon projet et je ne prends conseil que de moi-même. Je donne à la hâte mes instructions à mes gens. Je monte sur mon coursier, et, suivi de mes nobles chiens, je m’en vais au-devant de l’ennemi par des sentiers secrets où je ne devais avoir nul témoin de mon combat.
« Tu connais, maître, la petite chapelle, œuvre d’un esprit hardi, qui s’élève sur la pointe d’un roc et qui domine au loin l’île, elle paraît bien humble et bien pauvre, cependant elle renferme un miracle. La sainte Vierge est là avec l’enfant Jésus auquel les trois rois ont porté leurs présents. Par trois fois trente degrés le pèlerin monte à cette chapelle, et lorsqu’il arrive, à demi chancelant, à son but, il se sent reposé ; car il est près de son Sauveur.
« Dans le roc où cette chapelle est bâtie, il y a une grotte humide et sombre où jamais ne pénètre la lumière du ciel. C’est là qu’était le dragon, épiant sa proie nuit et jour. Il était là comme un être infernal au pied de la maison de Dieu, et lorsqu’un pèlerin passait sur ce sentier funeste, le monstre s’élançait de sa retraite et l’emportait pour le dévorer.
« Je gravis la montagne avant d’entreprendre mon difficile combat, je m’agenouillai devant l’image du Christ, je purifiai mon cœur de ses péchés, puis je m’armai dans le sanctuaire de mon épée et de ma cuirasse, et, ma lance à la main, je redescendis vers mes écuyers. Je m’élançai sur mon cheval et je recommandai mon âme à Dieu.
« À peine étais-je près des marais que mes dogues se précipitent en avant, tandis que mon cheval, effrayé, écume et se cabre. Car mon ennemi terrible était étendu au soleil sur la terre ardente. Mes chiens alertes se précipitent sur lui, puis se retournent rapides comme l’éclair, lorsqu’il ouvre sa large gueule et gémit comme un chacal, et répand autour de lui un air empesté.
« Mais bientôt je ranime leur courage : ils se jettent sur le monstre avec fureur, pendant que, d’une main ferme, je dirige ma lance sur ses flancs, et cette lance impuissante se brise comme une baguette sur sa cuirasse d’écailles. Avant que je puisse recommencer mon attaque, mon cheval, effrayé par ces regards de basilic, par ce souffle empesté, recule avec épouvante, et alors c’en était fait de moi.
« Je mets pied à terre, je tire mon épée du fourreau, mais je frappe en vain, nul coup ne pénètre dans cette armure de pierre ; et de sa queue vigoureuse il me jette sur le sol. Déjà je vois sa gueule s’ouvrir ; il s’approche de moi avec ses dents effroyables, lorsque mes chiens, enflammés de rage, se jettent sur son ventre, le couvrent de morsures et, déchiré par la douleur, il pousse d’affreux gémissements.
« Tandis qu’il essaye de s’arracher à ses deux adversaires, je me lève à la hâte, j’observe l’endroit vulnérable et j’y plonge mon épée jusqu’à la garde. Un sang noir coule à grands flots de sa blessure. Le monstre gigantesque tombe et m’entraîne sous lui dans sa chute. Je m’évanouis, et lorsque je revins à moi je me trouvai entouré de mes écuyers, et le dragon était baigné dans son sang. »
Tous les auditeurs applaudissent avec joie au récit du chevalier. Dix fois leurs voix s’élèvent, retentissent sous la voûte et se répètent au loin. Les chevaliers de l’Ordre demandent qu’on couronne le front du héros, le peuple veut le conduire en triomphe ; mais une ride sévère s’imprime sur le front du maître et il commande le silence. « Tu as tué, dit-il, d’une main courageuse le dragon qui ravageait cette contrée. Tu es devenu un dieu pour ce peuple et tu es devenu un ennemi pour notre Ordre. Ton cœur a enfanté un monstre pire que ce dragon. Il a enfanté la vipère qui empoisonne l’âme, qui produit la discorde et la perdition. Il a enfanté l’esprit de révolte qui se soulève audacieusement contre la discipline, qui brise les liens sacrés de la loi et qui détruit le monde.
« Le mamelouk montre aussi du courage : mais l’obéissance est la parure du Christ. Car, aux lieux où Notre-Seigneur apparut dans sa nudité sur ce sol sacré, nos pères fondèrent cet Ordre pour accomplir le plus difficile des devoirs, celui de dompter sa propre volonté. Une vaine gloire t’a ému, retire-toi de moi. Car celui qui ne porte pas le joug du Christ, ne doit pas être paré de sa croix. »
Où court tout ce peuple ? Pourquoi cette rumeur et ce tumulte dans les longues rues ? Rhodes est-il en proie aux flammes dévorantes ? Tout est en mouvement : au milieu de la foule j’aperçois un homme à cheval, et derrière lui, quel spectacle ! on traîne un monstre qui a la forme d’un dragon, une large gueule de crocodile, et chacun regarde tour à tour avec surprise le cavalier et le dragon.
Des milliers de voix s’écrient : « Venez et voyez ! Voilà le dragon qui dévorait les troupeaux et les bergers ! et voilà le héros qui l’a vaincu ! Beaucoup d’autres avaient tenté avant lui ce combat terrible ; mais nul n’en était revenu : rendons hommage au fier cavalier ! » et l’on s’en va vers le cloître où les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean sont réunis en conseil.
Le jeune homme s’avance d’un air modeste devant le noble maître de l’Ordre, tandis que la foule impétueuse se précipite dans la salle ; il prend la parole et dit : « J’ai accompli mon devoir de chevalier, le dragon qui dévastait le pays est mort sous ma main. Maintenant, le voyageur peut poursuivre sa route, le berger conduire son troupeau sur la montagne, et le pèlerin s’en aller par le sentier rocailleux vers l’image qu’il invoque. »
Mais le prince le regarde avec sévérité et lui répond : « Tu as agi comme un héros ; c’est le courage qui honore le chevalier, tu as fait preuve de courage. Mais dis-moi, quel est le premier devoir de celui qui combat pour le Christ et qui porte pour ornement le signe de la croix ? » Tous les assistants pâlissent, et le chevalier dit en s’inclinant et le visage rouge : « L’obéissance est le premier devoir de celui qui veut se rendre digne de porter le signe de la croix.
— Et ce devoir, mon fils, reprend le maître, tu l’as outrageusement violé : tu as entrepris avec audace le combat que la loi t’interdisait. — Maître, répond le jeune chevalier avec soumission, tu jugeras quand tu sauras tout. J’ai cru remplir fidèlement le sens et la volonté de la loi. Je n’ai pas été combattre imprudemment le monstre, j’ai essayé de le vaincre par la ruse et l’habileté.
« Cinq chevaliers de notre Ordre, honneur de la religion, étaient devenus victimes de leur courage ; alors tu nous interdis tout nouveau combat. Cependant, j’éprouvais dans mon cœur une ardente impatience : la nuit même, dans mes rêves, je me voyais luttant avec ardeur, et, quand venait le matin, j’étais saisi d’une inquiétude sauvage et je résolus de tenter le combat.
« Je me dis : Quelle est la gloire du jeune homme et de l’homme mûr ? Quelle fut celle de ces héros dont nous parlent les poëtes, et que l’aveugle paganisme entoura de la splendeur des dieux ? Dans leurs entreprises hardies ils purgèrent la terre de ses monstres, ils attaquèrent le lion et luttèrent avec le minotaure pour délivrer de pauvres victimes, et empêcher le sang de couler.
« Le Sarrasin mérite-t-il seul qu’on le combatte avec l’épée du chrétien ? Ne devons-nous attaquer que les faux dieux ? Le chrétien n’a-t-il pas la mission de secourir le monde entier, d’offrir l’appui de son bras à chaque souffrance, à chaque sollicitude ? Mais la sagesse doit guider son courage, la ruse doit lutter avec la force. Voilà ce que je me disais souvent à l’écart, et je m’en allais m’informant de la manière de combattre les bêtes féroces, lorsque soudain il me vint une inspiration et je m’écriai avec joie : Je l’ai trouvée !
« Je m’approchai de toi et je te dis : Il importe que je retourne dans ma patrie. Tu accédas à mes vœux, et je traversai la mer. À peine arrivé sur le sol natal, je fis façonner par un artiste une image de dragon semblable à celle que j’avais bien remarquée. Je plaçai cette lourde image sur des pieds raccourcis et je la couvris d’une cuirasse écaillée et scintillante.
« Le cou s’étendait en avant ; la gueule, terrible et pareille à une porte d’enfer, s’ouvrait comme pour dévorer sa proie ; au milieu d’une rangée de dents aiguës et sous un noir palais on voyait une langue pareille à la pointe d’une épée ; les yeux lançaient des éclairs ; le dos se terminait par une queue de serpent qui se repliait sur elle-même comme pour enlacer homme et cheval.
« Je fis façonner ainsi cette image exacte et je la revêtis d’une couleur sombre et sinistre. Je vis alors le monstre à moitié dragon, à moitié vipère, enfanté dans un marais empoisonné. Lorsque l’image fut achevée, je choisis un couple de dogues forts, alertes, habitués à s’élancer sur les animaux féroces ; je les exerçai à se jeter sur le dragon en excitant leur colère, en les guidant de la voix, et à le saisir avec leurs dents acérées.
« Je leur appris à faire entrer les dents au milieu du ventre, à l’endroit même où le monstre n’est protégé que par une molle toison. Et moi, couvert de mes armes, je monte sur mon cheval arabe, j’excite son ardeur, je le guide vers le dragon en l’aiguillonnant avec l’éperon, et je brandis mon glaive comme si je voulais pourfendre l’image.
« Mon cheval se cabre, écume, résiste à la bride ; mes chiens s’effrayent, se retirent ; mais je ne cesse de les ramener vers l’image du monstre. Pendant trois mois je les exerce ainsi dans la solitude, et lorsque je les crois habitués à l’image effrayante, je les embarque avec moi sur un navire. Il y a trois jours que je suis arrivé, à peine ai-je pu me décider à prendre quelque repos avant d’avoir conduit à bonne fin mon entreprise.
« Car les plaintes continues de ce pays me troublaient le cœur. On venait tout récemment de trouver en lambeaux les corps de bergers qui s’étaient égarés près des marais. Je veux accomplir à la hâte mon projet et je ne prends conseil que de moi-même. Je donne à la hâte mes instructions à mes gens. Je monte sur mon coursier, et, suivi de mes nobles chiens, je m’en vais au-devant de l’ennemi par des sentiers secrets où je ne devais avoir nul témoin de mon combat.
« Tu connais, maître, la petite chapelle, œuvre d’un esprit hardi, qui s’élève sur la pointe d’un roc et qui domine au loin l’île, elle paraît bien humble et bien pauvre, cependant elle renferme un miracle. La sainte Vierge est là avec l’enfant Jésus auquel les trois rois ont porté leurs présents. Par trois fois trente degrés le pèlerin monte à cette chapelle, et lorsqu’il arrive, à demi chancelant, à son but, il se sent reposé ; car il est près de son Sauveur.
« Dans le roc où cette chapelle est bâtie, il y a une grotte humide et sombre où jamais ne pénètre la lumière du ciel. C’est là qu’était le dragon, épiant sa proie nuit et jour. Il était là comme un être infernal au pied de la maison de Dieu, et lorsqu’un pèlerin passait sur ce sentier funeste, le monstre s’élançait de sa retraite et l’emportait pour le dévorer.
« Je gravis la montagne avant d’entreprendre mon difficile combat, je m’agenouillai devant l’image du Christ, je purifiai mon cœur de ses péchés, puis je m’armai dans le sanctuaire de mon épée et de ma cuirasse, et, ma lance à la main, je redescendis vers mes écuyers. Je m’élançai sur mon cheval et je recommandai mon âme à Dieu.
« À peine étais-je près des marais que mes dogues se précipitent en avant, tandis que mon cheval, effrayé, écume et se cabre. Car mon ennemi terrible était étendu au soleil sur la terre ardente. Mes chiens alertes se précipitent sur lui, puis se retournent rapides comme l’éclair, lorsqu’il ouvre sa large gueule et gémit comme un chacal, et répand autour de lui un air empesté.
« Mais bientôt je ranime leur courage : ils se jettent sur le monstre avec fureur, pendant que, d’une main ferme, je dirige ma lance sur ses flancs, et cette lance impuissante se brise comme une baguette sur sa cuirasse d’écailles. Avant que je puisse recommencer mon attaque, mon cheval, effrayé par ces regards de basilic, par ce souffle empesté, recule avec épouvante, et alors c’en était fait de moi.
« Je mets pied à terre, je tire mon épée du fourreau, mais je frappe en vain, nul coup ne pénètre dans cette armure de pierre ; et de sa queue vigoureuse il me jette sur le sol. Déjà je vois sa gueule s’ouvrir ; il s’approche de moi avec ses dents effroyables, lorsque mes chiens, enflammés de rage, se jettent sur son ventre, le couvrent de morsures et, déchiré par la douleur, il pousse d’affreux gémissements.
« Tandis qu’il essaye de s’arracher à ses deux adversaires, je me lève à la hâte, j’observe l’endroit vulnérable et j’y plonge mon épée jusqu’à la garde. Un sang noir coule à grands flots de sa blessure. Le monstre gigantesque tombe et m’entraîne sous lui dans sa chute. Je m’évanouis, et lorsque je revins à moi je me trouvai entouré de mes écuyers, et le dragon était baigné dans son sang. »
Tous les auditeurs applaudissent avec joie au récit du chevalier. Dix fois leurs voix s’élèvent, retentissent sous la voûte et se répètent au loin. Les chevaliers de l’Ordre demandent qu’on couronne le front du héros, le peuple veut le conduire en triomphe ; mais une ride sévère s’imprime sur le front du maître et il commande le silence. « Tu as tué, dit-il, d’une main courageuse le dragon qui ravageait cette contrée. Tu es devenu un dieu pour ce peuple et tu es devenu un ennemi pour notre Ordre. Ton cœur a enfanté un monstre pire que ce dragon. Il a enfanté la vipère qui empoisonne l’âme, qui produit la discorde et la perdition. Il a enfanté l’esprit de révolte qui se soulève audacieusement contre la discipline, qui brise les liens sacrés de la loi et qui détruit le monde.
« Le mamelouk montre aussi du courage : mais l’obéissance est la parure du Christ. Car, aux lieux où Notre-Seigneur apparut dans sa nudité sur ce sol sacré, nos pères fondèrent cet Ordre pour accomplir le plus difficile des devoirs, celui de dompter sa propre volonté. Une vaine gloire t’a ému, retire-toi de moi. Car celui qui ne porte pas le joug du Christ, ne doit pas être paré de sa croix. »
HÉRO ET LÉANDRE.
Voyez ce vieux château que les rayons du soleil éclairent sur les rives où les vagues de l’Hellespont se précipitent en gémissant contre les rocs des Dardanelles. Entendez-vous le bruit de ces vagues qui se brisent sur le rivage ? Elles séparent l’Asie de l’Europe, mais elles n’épouvantent pas l’amour.
Le Dieu de l’amour a lancé un de ses traits puissants dans le cœur de Héro et de Léandre. Héro est belle et fraîche comme Hébé ; lui parcourt les montagnes, entraîné par le plaisir de la chasse. L’inimitié de leurs parents sépare cet heureux couple, et leur amour est en péril. Mais sur la tour de Sestos que les flots de l’Hellespont frappent sans cesse avec impétuosité, la jeune fille est assise dans la solitude, et regarde les rives d’Abydos, où demeure son bien-aimé. Hélas ! nul pont ne réunit ces rivages éloignés, nul bateau ne va de l’un à l’autre ; mais l’Amour a su trouver son chemin, il a su pénétrer dans les détours du labyrinthe ; il donne l’habileté à celui qui est timide, il asservit à son joug les animaux féroces, il attelle à son char les taureaux fougueux. Le Styx même, avec ses neuf contours, n’arrête pas le Dieu hardi : il enlève une amante aux sombres demeures de Pluton.
Il excite le courage de Léandre et le pousse sur les flots avec un ardent désir. Quand le rayon du jour pâlit, l’audacieux nageur se jette dans les ondes du Pont, les fend d’un bras nerveux et arrive sur la terre chérie où la lumière d’un flambeau lui sert de guide.
Dans les bras de celle qu’il aime, l’heureux jeune homme se repose de sa lutte terrible ; il reçoit la récompense divine que l’amour lui réserve, jusqu’à ce que l’aurore éveille les deux amants dans leur rêve de volupté, et que le jeune homme se rejette dans les ondes froides de la mer.
Trente jours se passent ainsi ; trente jours donnent à ces tendres amants les joies, les douceurs d’une nuit nuptiale, les transports ravissants que les Dieux eux-mêmes envient. Celui-là n’a pas connu le bonheur, qui n’a pas su dérober les fruits du ciel au bord effroyable du fleuve des enfers.
Le soir et le matin se succèdent à l’horizon. Les amants ne voient pas la chute des feuilles, ils ne remarquent pas le vent du nord qui annonce l’approche de l’hiver ; ils se réjouissent de voir les jours décroître, et remercient Jupiter qui prolonge les nuits.
Déjà la durée des nuits était égale à celle des jours. La jeune fille, assise dans son château, regardait les chevaux du Soleil courir à l’horizon ; la mer, silencieuse et calme, ressemblait à un pur miroir, nul souffle ne ridait sa surface de cristal ; des troupes de dauphins jouent dans l’élément limpide, et l’escorte de Téthys s’élève en longue ligne noire du sein de la mer. Ces êtres marins connaissaient seuls le secret de Léandre, mais Hécate les empêche à tout jamais de parler. La jeune fille contemple avec bonheur cette belle mer et lui dit d’une voix caressante : « Doux élément, pourrais-tu tromper ? Non, je traiterais d’imposteur celui qui t’appellerait fausse et infidèle. Fausse est la race des hommes, cruel est le cœur de mon père ; mais toi, tu es douce et bienveillante, tu t’émeus au chagrin de l’amour. J’étais condamnée à passer une vie triste et solitaire dans ces murs isolés et à languir dans un éternel ennui ; mais tu portes sur ton sein, sans nacelle et sans pont, celui que j’aime, et tu le conduis dans mes bras. Effrayante est ta profondeur, terribles sont tes vagues ! mais l’amour t’attendrit, le courage te subjugue.
« Le puissant Dieu de l’amour t’a subjuguée aussi, lorsque la jeune et belle Hellé s’en revenait avec son frère emportant la toison d’or : ravie de ses charmes, tu la saisis sur les vagues, tu l’entraînas au fond de la mer.
« Dans les grottes de cristal, douée de l’immortalité, Déesse, elle est unie à un Dieu, elle s’intéresse à l’amour persécuté, elle adoucit les mouvements impétueux et conduit les navigateurs dans le port. Belle Hellé, douce Déesse, c’est toi que j’implore, ramène-moi celui que j’aime, par sa route accoutumée. »
Déjà la nuit enveloppe le ciel, la jeune fille allume le flambeau qui doit servir de fanal, sur les vagues désertes, à celui qu’elle attend. Mais voilà que le vent s’élève et mugit, la mer écume, la lueur des étoiles disparaît et l’orage approche.
Les ténèbres s’étendent à la surface lointaine du Pont, et des torrents de pluie tombent du sein des nuages ; l’éclair brille, les vents sont déchaînés, les vagues profondes s’entr’ouvrent, et la mer apparaît terrible et béante comme la gueule de l’enfer.
« Malheur ! malheur à moi ! s’écrie la pauvre fille : Jupiter, prends pitié de mon sort. Hélas ! qu’ai-je osé demander ? Si les dieux m’écoutaient, si mon amant allait se livrer aux orages de cette mer infidèle !… Tous les oiseaux s’enfuient à la hâte, tous les navires qui connaissent la tempête se réfugient dans les baies. Hélas ! sans doute, l’audacieux entreprendra ce qu’il a déjà souvent entrepris, car il est poussé par un Dieu puissant ; et il me l’a juré, en me quittant, au nom de son amour, la mort seule l’affranchira de ses serments. Hélas ! à cette heure même il lutte contre la violence de la tempête, et les vagues courroucées l’entraînent dans l’abîme.
« Vagues trompeuses, votre silence cachait votre trahison. Vous étiez unies comme une glace, calmes et sans trouble, et vous allez l’entraîner dans vos profondeurs perfides. C’est lorsqu’il est déjà au milieu de son trajet, lorsque tout retour est impossible, que vous déchaînez contre lui votre fureur. »
La tempête s’augmente : les vagues s’élèvent comme des montagnes et se brisent en mugissant contre les rochers, le navire aux flancs de chêne n’échappe pas à leur fureur ; le vent éteint le flambeau qui devait guider le nageur, le péril est sur les eaux et le péril sur le rivage.
La jeune fille invoque Aphrodite ; elle la prie d’apaiser l’orage, et promet d’offrir de riches sacrifices, d’immoler un taureau avec des cornes dorées ; elle conjure toutes les Déesses de l’abîme et tous les Dieux du ciel de calmer la mer emportée.
« Écoute ma voix, sors de ta verte retraite, bienveillante Leucothée, toi qui souvent, à l’heure du péril, sur les vagues tumultueuses, es apparue aux navigateurs pour les sauver ! donne à celui que j’aime, ton voile sacré, ton voile d’un tissu mystérieux, qui l’emportera sain et sauf hors du précipice des flots. »
Les vents furieux s’apaisent, les chevaux d’Éos montent à l’horizon, la mer reprend sa sérénité, l’air est doux, l’onde est riante : elle tombe mollement sur les rocs du rivage et y apporte, comme en se jouant, un cadavre.
Oui, c’est lui qui est mort et qui n’a pas manqué à son serment. La jeune fille le reconnaît : elle n’exhale pas une plainte, elle ne verse pas une larme ; elle reste froide et immobile dans son désespoir, puis élève les yeux vers le ciel, et une noble rougeur colore son pâle visage.
« Ah ! c’est vous, terribles Divinités : vous exercez cruellement vos droits, vous êtes inflexibles, le cours de ma vie est achevé bien promptement. Mais j’ai connu le bonheur et mon destin fut doux ; je me suis consacrée à ton temple comme une de tes prêtresses, je t’offre gaiement, par ma mort, un nouveau sacrifice, Vénus, grande reine. »
Et, du haut de la tour, elle se précipite dans les flots. Le Dieu des mers s’empare du corps de la jeune fille, et, content de sa proie, il continue joyeusement à répandre les ondes de son urne inépuisable.
Voyez ce vieux château que les rayons du soleil éclairent sur les rives où les vagues de l’Hellespont se précipitent en gémissant contre les rocs des Dardanelles. Entendez-vous le bruit de ces vagues qui se brisent sur le rivage ? Elles séparent l’Asie de l’Europe, mais elles n’épouvantent pas l’amour.
Le Dieu de l’amour a lancé un de ses traits puissants dans le cœur de Héro et de Léandre. Héro est belle et fraîche comme Hébé ; lui parcourt les montagnes, entraîné par le plaisir de la chasse. L’inimitié de leurs parents sépare cet heureux couple, et leur amour est en péril. Mais sur la tour de Sestos que les flots de l’Hellespont frappent sans cesse avec impétuosité, la jeune fille est assise dans la solitude, et regarde les rives d’Abydos, où demeure son bien-aimé. Hélas ! nul pont ne réunit ces rivages éloignés, nul bateau ne va de l’un à l’autre ; mais l’Amour a su trouver son chemin, il a su pénétrer dans les détours du labyrinthe ; il donne l’habileté à celui qui est timide, il asservit à son joug les animaux féroces, il attelle à son char les taureaux fougueux. Le Styx même, avec ses neuf contours, n’arrête pas le Dieu hardi : il enlève une amante aux sombres demeures de Pluton.
Il excite le courage de Léandre et le pousse sur les flots avec un ardent désir. Quand le rayon du jour pâlit, l’audacieux nageur se jette dans les ondes du Pont, les fend d’un bras nerveux et arrive sur la terre chérie où la lumière d’un flambeau lui sert de guide.
Dans les bras de celle qu’il aime, l’heureux jeune homme se repose de sa lutte terrible ; il reçoit la récompense divine que l’amour lui réserve, jusqu’à ce que l’aurore éveille les deux amants dans leur rêve de volupté, et que le jeune homme se rejette dans les ondes froides de la mer.
Trente jours se passent ainsi ; trente jours donnent à ces tendres amants les joies, les douceurs d’une nuit nuptiale, les transports ravissants que les Dieux eux-mêmes envient. Celui-là n’a pas connu le bonheur, qui n’a pas su dérober les fruits du ciel au bord effroyable du fleuve des enfers.
Le soir et le matin se succèdent à l’horizon. Les amants ne voient pas la chute des feuilles, ils ne remarquent pas le vent du nord qui annonce l’approche de l’hiver ; ils se réjouissent de voir les jours décroître, et remercient Jupiter qui prolonge les nuits.
Déjà la durée des nuits était égale à celle des jours. La jeune fille, assise dans son château, regardait les chevaux du Soleil courir à l’horizon ; la mer, silencieuse et calme, ressemblait à un pur miroir, nul souffle ne ridait sa surface de cristal ; des troupes de dauphins jouent dans l’élément limpide, et l’escorte de Téthys s’élève en longue ligne noire du sein de la mer. Ces êtres marins connaissaient seuls le secret de Léandre, mais Hécate les empêche à tout jamais de parler. La jeune fille contemple avec bonheur cette belle mer et lui dit d’une voix caressante : « Doux élément, pourrais-tu tromper ? Non, je traiterais d’imposteur celui qui t’appellerait fausse et infidèle. Fausse est la race des hommes, cruel est le cœur de mon père ; mais toi, tu es douce et bienveillante, tu t’émeus au chagrin de l’amour. J’étais condamnée à passer une vie triste et solitaire dans ces murs isolés et à languir dans un éternel ennui ; mais tu portes sur ton sein, sans nacelle et sans pont, celui que j’aime, et tu le conduis dans mes bras. Effrayante est ta profondeur, terribles sont tes vagues ! mais l’amour t’attendrit, le courage te subjugue.
« Le puissant Dieu de l’amour t’a subjuguée aussi, lorsque la jeune et belle Hellé s’en revenait avec son frère emportant la toison d’or : ravie de ses charmes, tu la saisis sur les vagues, tu l’entraînas au fond de la mer.
« Dans les grottes de cristal, douée de l’immortalité, Déesse, elle est unie à un Dieu, elle s’intéresse à l’amour persécuté, elle adoucit les mouvements impétueux et conduit les navigateurs dans le port. Belle Hellé, douce Déesse, c’est toi que j’implore, ramène-moi celui que j’aime, par sa route accoutumée. »
Déjà la nuit enveloppe le ciel, la jeune fille allume le flambeau qui doit servir de fanal, sur les vagues désertes, à celui qu’elle attend. Mais voilà que le vent s’élève et mugit, la mer écume, la lueur des étoiles disparaît et l’orage approche.
Les ténèbres s’étendent à la surface lointaine du Pont, et des torrents de pluie tombent du sein des nuages ; l’éclair brille, les vents sont déchaînés, les vagues profondes s’entr’ouvrent, et la mer apparaît terrible et béante comme la gueule de l’enfer.
« Malheur ! malheur à moi ! s’écrie la pauvre fille : Jupiter, prends pitié de mon sort. Hélas ! qu’ai-je osé demander ? Si les dieux m’écoutaient, si mon amant allait se livrer aux orages de cette mer infidèle !… Tous les oiseaux s’enfuient à la hâte, tous les navires qui connaissent la tempête se réfugient dans les baies. Hélas ! sans doute, l’audacieux entreprendra ce qu’il a déjà souvent entrepris, car il est poussé par un Dieu puissant ; et il me l’a juré, en me quittant, au nom de son amour, la mort seule l’affranchira de ses serments. Hélas ! à cette heure même il lutte contre la violence de la tempête, et les vagues courroucées l’entraînent dans l’abîme.
« Vagues trompeuses, votre silence cachait votre trahison. Vous étiez unies comme une glace, calmes et sans trouble, et vous allez l’entraîner dans vos profondeurs perfides. C’est lorsqu’il est déjà au milieu de son trajet, lorsque tout retour est impossible, que vous déchaînez contre lui votre fureur. »
La tempête s’augmente : les vagues s’élèvent comme des montagnes et se brisent en mugissant contre les rochers, le navire aux flancs de chêne n’échappe pas à leur fureur ; le vent éteint le flambeau qui devait guider le nageur, le péril est sur les eaux et le péril sur le rivage.
La jeune fille invoque Aphrodite ; elle la prie d’apaiser l’orage, et promet d’offrir de riches sacrifices, d’immoler un taureau avec des cornes dorées ; elle conjure toutes les Déesses de l’abîme et tous les Dieux du ciel de calmer la mer emportée.
« Écoute ma voix, sors de ta verte retraite, bienveillante Leucothée, toi qui souvent, à l’heure du péril, sur les vagues tumultueuses, es apparue aux navigateurs pour les sauver ! donne à celui que j’aime, ton voile sacré, ton voile d’un tissu mystérieux, qui l’emportera sain et sauf hors du précipice des flots. »
Les vents furieux s’apaisent, les chevaux d’Éos montent à l’horizon, la mer reprend sa sérénité, l’air est doux, l’onde est riante : elle tombe mollement sur les rocs du rivage et y apporte, comme en se jouant, un cadavre.
Oui, c’est lui qui est mort et qui n’a pas manqué à son serment. La jeune fille le reconnaît : elle n’exhale pas une plainte, elle ne verse pas une larme ; elle reste froide et immobile dans son désespoir, puis élève les yeux vers le ciel, et une noble rougeur colore son pâle visage.
« Ah ! c’est vous, terribles Divinités : vous exercez cruellement vos droits, vous êtes inflexibles, le cours de ma vie est achevé bien promptement. Mais j’ai connu le bonheur et mon destin fut doux ; je me suis consacrée à ton temple comme une de tes prêtresses, je t’offre gaiement, par ma mort, un nouveau sacrifice, Vénus, grande reine. »
Et, du haut de la tour, elle se précipite dans les flots. Le Dieu des mers s’empare du corps de la jeune fille, et, content de sa proie, il continue joyeusement à répandre les ondes de son urne inépuisable.
LES CIGOGNES D’IBICUS.
Les peuples de la Grèce vont se réunir sur la terre de Corinthe pour le combat des chars et le combat du chant. Ibicus, l’ami des Dieux, vient de se mettre en route. Apollon lui a donné le génie poétique et l’harmonie des vers ; il part de Rhégium avec un bâton de voyage, sentant déjà vibrer dans son cœur la voix qui l’inspire.
Déjà ses regards contemplent l’Acrocorinthe sur la montagne, et il s’avance avec joie à travers les mystérieuses forêts de Poseidon. Nul être humain n’apparaît ; il ne voit que des cigognes qui s’en vont chercher la chaleur des contrées méridionales et l’accompagnent sur son chemin.
« Salut à vous, dit-il, oiseaux chéris, qui avez traversé la mer en même temps que moi. Ma destinée ressemble à la vôtre : nous venons de loin, et nous allons chercher une retraite hospitalière. Soyons fidèles à l’hôte qui préserve de l’injure l’étranger. »
Puis il continue sa marche. Il arrive au milieu de la forêt ; tout à coup des meurtriers s’avancent et l’arrêtent. Il veut combattre ; mais bientôt sa main retombe fatiguée, car elle est plus habituée à tendre les cordes légères de la lyre que celles de l’arc vigoureux.
Il appelle à son secours les hommes et les Dieux : ses cris sont inutiles. Aussi loin que sa voix peut s’étendre, il n’existe pas un être humain. « Hélas ! s’écrie-t-il, il faut donc que je meure ici de la main de deux misérables, sur ce sol étranger où personne ne me pleurera, où personne ne viendra me venger. »
À ces mots il tombe couvert de blessures. Au même moment les cigognes passent ; il entend leurs cris aigus et ne peut plus les voir ; mais il leur dit : « Si nulle autre voix ne s’élève pour venger ma mort, la vôtre du moins accusera mes meurtriers. » Il dit et meurt.
On retrouva un cadavre dans la forêt ; et quoiqu’il fût défiguré, celui qui devait recevoir Ibicus à Corinthe reconnut ses traits chéris. « Est-ce donc ainsi, dit-il, que je devais te retrouver, moi qui espérais te voir porter glorieusement la couronne de laurier ? »
Tous les étrangers réunis à la fête de Poseidon déplorent la perte d’Ibicus ; toute la Grèce en est émue. Chaque cœur le regrette, et le peuple se rassemble au Prytanée et demande avec colère à venger la mort du poëte, à satisfaire ses mânes par le sang de ses meurtriers.
Mais comment reconnaître les traces du crime, au milieu de cette foule attirée par l’éclat de la fête ? Ibicus a-t-il été frappé par des voleurs ? est-il victime d’un lâche ennemi ? Hélios seul peut le dire, Hélios qui connaît le secret des choses.
Peut-être, tandis que la vengeance le cherche, peut-être le meurtrier s’en va-t-il d’un pas hardi à travers l’assemblée des Grecs, jouissant des fruits de son crime ; peut-être insulte-t-il aux Dieux jusque sur le seuil de leur temple ; peut-être se mêle-t-il à la foule qui se dirige maintenant vers le théâtre.
Les bancs sont serrés l’un contre l’autre ; les colonnes de l’édifice chancellent presque sous ce lourd fardeau. Les peuples de la Grèce accourent, et la vague rumeur de cette foule ressemble au mugissement de la mer. Tout le monde se presse dans le vaste circuit de l’édifice et sur les gradins de l’amphithéâtre qui s’élève audacieusement dans les airs.
Qui pourrait compter tous ces peuples ? qui pourrait dire les noms de tous ceux qui ont trouvé ici l’hospitalité ? Il en est venu de la ville de Thèbes, des bords de l’Aulide, de la Phocée, de Sparte, des côtes éloignées de l’Asie et de toutes les îles. Et tous ces spectateurs écoutent la mélodie lugubre du chœur, qui, selon l’antique usage, sort du fond du théâtre avec une contenance grave et sévère, s’avance à pas mesurés et fait le tour de la scène. Aucune femme de ce monde ne ressemble à celles de ce chœur ; jamais la maison d’un mortel ne montra une figure pareille ; leur taille est comme celle des géants.
Un manteau noir tombe sur leurs flancs, et dans leurs mains décharnées elles portent des flambeaux qui jettent une lueur sombre ; au lieu de cheveux, on voit se balancer sur leurs têtes des serpents et des couleuvres enflées par le venin.
Ce chœur épouvantable s’avance et entonne l’hymne fatal qui pénètre dans l’âme et enlace dans ses propres liens la pensée du coupable. Les paroles de ce chant lamentable retentissent et agitent ceux qui les écoutent, et nulle lyre ne les accompagne.
« Heureux, disent-elles, heureux celui qui n’a point senti le crime détruire la naïve innocence de son âme ! Celui-là, nous ne le poursuivrons pas ; il peut poursuivre librement sa route. Mais malheur, malheur à celui qui a volé ou commis un meurtre ! Nous nous attacherons à ses pas, nous filles terribles de la Nuit !
« Qu’il ne croie pas nous échapper ! Nous avons des ailes ; nous lui jetterons un lien au pied, et il tombera par terre. Aucun repentir ne nous fléchit ; nous poursuivrons sans relâche le coupable, nous le poursuivrons jusque dans l’empire des ombres, et là nous ne l’abandonnerons pas encore. »
En chantant ainsi, les Euménides dansent leur ronde funèbre. Un silence de mort pèse sur toute l’assemblée comme si la Divinité était là présente ; et le chœur, poursuivant sa marche, s’en retourne à pas lents et mesurés dans le fond du théâtre.
L’âme de chaque spectateur semble flotter entre la vérité et le mensonge, et chacun rend hommage à cette puissance invisible et inexplicable qui veille dans l’ombre, mêle les fils de la destinée humaine, se révèle parfois au cœur inquiet, s’enfuit avant le jour.
Tout à coup on entend sur un des gradins les plus élevés une voix qui s’écrie : « Regarde, regarde, Timothée : les cigognes d’Ibicus ! » Au même instant on vit comme un nuage passer sur l’azur du ciel et une troupe de cigognes poursuivre son vol.
Ibicus ! ce nom ravive les regrets de tous les spectateurs, et ces paroles volent de bouche en bouche : « Ibicus, que la main d’un meurtrier égorgea et que nous avons pleuré ? Qui parle de lui ? Quel rapport y a-t-il entre lui et ces cigognes ? »
Et les questions redoublent ; un triste pressentiment passe rapide dans tous les esprits. « Faites attention, s’écrie la foule, à la puissance des Euménides. Le poëte religieux sera vengé ; l’assassin vient de se trahir lui-même. Saisissez celui qui a parlé d’Ibicus, et qu’il soit jugé. »
Celui qui avait prononcé ces paroles imprudentes aurait voulu les retenir ; mais il était trop tard ; ses lèvres pâles, son visage effrayé révèlent son crime. On l’arrache de son siège, on le traîne devant le juge. La scène est transformée en tribunal, et l’éclair de la vengeance frappe le meurtrier.
Les peuples de la Grèce vont se réunir sur la terre de Corinthe pour le combat des chars et le combat du chant. Ibicus, l’ami des Dieux, vient de se mettre en route. Apollon lui a donné le génie poétique et l’harmonie des vers ; il part de Rhégium avec un bâton de voyage, sentant déjà vibrer dans son cœur la voix qui l’inspire.
Déjà ses regards contemplent l’Acrocorinthe sur la montagne, et il s’avance avec joie à travers les mystérieuses forêts de Poseidon. Nul être humain n’apparaît ; il ne voit que des cigognes qui s’en vont chercher la chaleur des contrées méridionales et l’accompagnent sur son chemin.
« Salut à vous, dit-il, oiseaux chéris, qui avez traversé la mer en même temps que moi. Ma destinée ressemble à la vôtre : nous venons de loin, et nous allons chercher une retraite hospitalière. Soyons fidèles à l’hôte qui préserve de l’injure l’étranger. »
Puis il continue sa marche. Il arrive au milieu de la forêt ; tout à coup des meurtriers s’avancent et l’arrêtent. Il veut combattre ; mais bientôt sa main retombe fatiguée, car elle est plus habituée à tendre les cordes légères de la lyre que celles de l’arc vigoureux.
Il appelle à son secours les hommes et les Dieux : ses cris sont inutiles. Aussi loin que sa voix peut s’étendre, il n’existe pas un être humain. « Hélas ! s’écrie-t-il, il faut donc que je meure ici de la main de deux misérables, sur ce sol étranger où personne ne me pleurera, où personne ne viendra me venger. »
À ces mots il tombe couvert de blessures. Au même moment les cigognes passent ; il entend leurs cris aigus et ne peut plus les voir ; mais il leur dit : « Si nulle autre voix ne s’élève pour venger ma mort, la vôtre du moins accusera mes meurtriers. » Il dit et meurt.
On retrouva un cadavre dans la forêt ; et quoiqu’il fût défiguré, celui qui devait recevoir Ibicus à Corinthe reconnut ses traits chéris. « Est-ce donc ainsi, dit-il, que je devais te retrouver, moi qui espérais te voir porter glorieusement la couronne de laurier ? »
Tous les étrangers réunis à la fête de Poseidon déplorent la perte d’Ibicus ; toute la Grèce en est émue. Chaque cœur le regrette, et le peuple se rassemble au Prytanée et demande avec colère à venger la mort du poëte, à satisfaire ses mânes par le sang de ses meurtriers.
Mais comment reconnaître les traces du crime, au milieu de cette foule attirée par l’éclat de la fête ? Ibicus a-t-il été frappé par des voleurs ? est-il victime d’un lâche ennemi ? Hélios seul peut le dire, Hélios qui connaît le secret des choses.
Peut-être, tandis que la vengeance le cherche, peut-être le meurtrier s’en va-t-il d’un pas hardi à travers l’assemblée des Grecs, jouissant des fruits de son crime ; peut-être insulte-t-il aux Dieux jusque sur le seuil de leur temple ; peut-être se mêle-t-il à la foule qui se dirige maintenant vers le théâtre.
Les bancs sont serrés l’un contre l’autre ; les colonnes de l’édifice chancellent presque sous ce lourd fardeau. Les peuples de la Grèce accourent, et la vague rumeur de cette foule ressemble au mugissement de la mer. Tout le monde se presse dans le vaste circuit de l’édifice et sur les gradins de l’amphithéâtre qui s’élève audacieusement dans les airs.
Qui pourrait compter tous ces peuples ? qui pourrait dire les noms de tous ceux qui ont trouvé ici l’hospitalité ? Il en est venu de la ville de Thèbes, des bords de l’Aulide, de la Phocée, de Sparte, des côtes éloignées de l’Asie et de toutes les îles. Et tous ces spectateurs écoutent la mélodie lugubre du chœur, qui, selon l’antique usage, sort du fond du théâtre avec une contenance grave et sévère, s’avance à pas mesurés et fait le tour de la scène. Aucune femme de ce monde ne ressemble à celles de ce chœur ; jamais la maison d’un mortel ne montra une figure pareille ; leur taille est comme celle des géants.
Un manteau noir tombe sur leurs flancs, et dans leurs mains décharnées elles portent des flambeaux qui jettent une lueur sombre ; au lieu de cheveux, on voit se balancer sur leurs têtes des serpents et des couleuvres enflées par le venin.
Ce chœur épouvantable s’avance et entonne l’hymne fatal qui pénètre dans l’âme et enlace dans ses propres liens la pensée du coupable. Les paroles de ce chant lamentable retentissent et agitent ceux qui les écoutent, et nulle lyre ne les accompagne.
« Heureux, disent-elles, heureux celui qui n’a point senti le crime détruire la naïve innocence de son âme ! Celui-là, nous ne le poursuivrons pas ; il peut poursuivre librement sa route. Mais malheur, malheur à celui qui a volé ou commis un meurtre ! Nous nous attacherons à ses pas, nous filles terribles de la Nuit !
« Qu’il ne croie pas nous échapper ! Nous avons des ailes ; nous lui jetterons un lien au pied, et il tombera par terre. Aucun repentir ne nous fléchit ; nous poursuivrons sans relâche le coupable, nous le poursuivrons jusque dans l’empire des ombres, et là nous ne l’abandonnerons pas encore. »
En chantant ainsi, les Euménides dansent leur ronde funèbre. Un silence de mort pèse sur toute l’assemblée comme si la Divinité était là présente ; et le chœur, poursuivant sa marche, s’en retourne à pas lents et mesurés dans le fond du théâtre.
L’âme de chaque spectateur semble flotter entre la vérité et le mensonge, et chacun rend hommage à cette puissance invisible et inexplicable qui veille dans l’ombre, mêle les fils de la destinée humaine, se révèle parfois au cœur inquiet, s’enfuit avant le jour.
Tout à coup on entend sur un des gradins les plus élevés une voix qui s’écrie : « Regarde, regarde, Timothée : les cigognes d’Ibicus ! » Au même instant on vit comme un nuage passer sur l’azur du ciel et une troupe de cigognes poursuivre son vol.
Ibicus ! ce nom ravive les regrets de tous les spectateurs, et ces paroles volent de bouche en bouche : « Ibicus, que la main d’un meurtrier égorgea et que nous avons pleuré ? Qui parle de lui ? Quel rapport y a-t-il entre lui et ces cigognes ? »
Et les questions redoublent ; un triste pressentiment passe rapide dans tous les esprits. « Faites attention, s’écrie la foule, à la puissance des Euménides. Le poëte religieux sera vengé ; l’assassin vient de se trahir lui-même. Saisissez celui qui a parlé d’Ibicus, et qu’il soit jugé. »
Celui qui avait prononcé ces paroles imprudentes aurait voulu les retenir ; mais il était trop tard ; ses lèvres pâles, son visage effrayé révèlent son crime. On l’arrache de son siège, on le traîne devant le juge. La scène est transformée en tribunal, et l’éclair de la vengeance frappe le meurtrier.
Lire un extrait
Video de Friedrich von Schiller (1)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature allemandeVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Friedrich von Schiller (47)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz: l'Allemagne et la Littérature
Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?
Hoffmann
Gordon
Grimm
Marx
10 questions
416 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature allemande
, guerre mondiale
, allemagneCréer un quiz sur ce livre416 lecteurs ont répondu