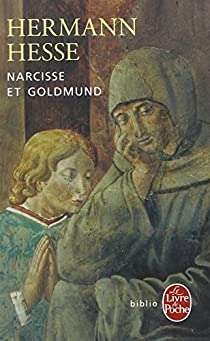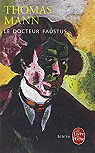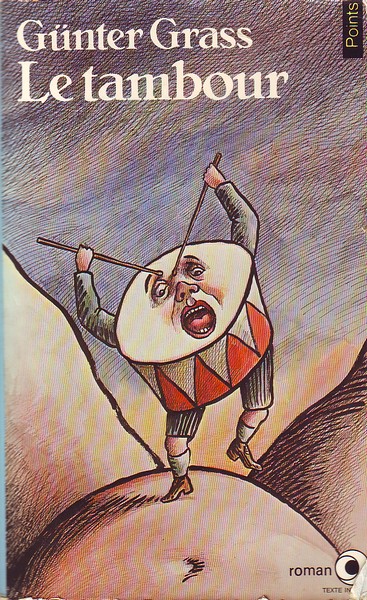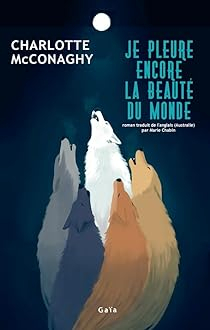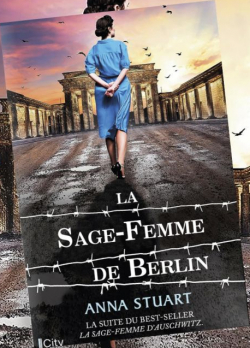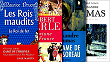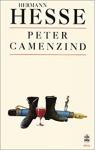Hermann Hesse
Fernand Delmas (Autre)/5 1333 notes
Rien ne peut arrêter l'errance de Goldmund, aucune femme, pas même la misère, la peste ou la mort qu'il côtoie en chemin.
Assoiffé de plaisir, avide de beauté féminine, inlassablement, il reprend cette route où chaque rencontre est l'épreuve du plus beau et du plus noir de l'humanité. Dans cet esprit candide et généreux perce une révolte née de l'injustice, de la cruauté des hommes, où seuls l'art et la création allègent le poids de cette hum... >Voir plus
Fernand Delmas (Autre)/5 1333 notes
Résumé :
Rien ne peut arrêter l'errance de Goldmund, aucune femme, pas même la misère, la peste ou la mort qu'il côtoie en chemin.
Assoiffé de plaisir, avide de beauté féminine, inlassablement, il reprend cette route où chaque rencontre est l'épreuve du plus beau et du plus noir de l'humanité. Dans cet esprit candide et généreux perce une révolte née de l'injustice, de la cruauté des hommes, où seuls l'art et la création allègent le poids de cette hum... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Narcisse et GoldmundVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (77)
Voir plus
Ajouter une critique
Il y a lire des livres, et il y a lire de la littérature.
Très (trop) souvent je lis, je lis des livres, des livres et des livres encore… Et je m'endors avec, la main déjà dans le « fort molle », la farce sur l'oreiller, l'oeil à peu près mi-clos, luttant, peinant, cravachant dur pour cavaler, si possible, jusqu'au bout de ma page — ah, maudite page ! — avant d'être tout à fait croquée par le sommeil, une fois encore.
Un soir, deux soirs, parfois trois soirs de suite ça dure, cette affaire-là. Je me cogne et je me recogne et je me rerecogne la même putain de page sans nom, captivante au moins comme les reliefs de Frise et du Bangladesh réunis, d'un caractère si décisif, oui… si des Sisyphe pouvaient venir m'aider un peu sur ce coup-là, car vraiment, les deux précédents soirs, cent coups fait rire, enfin sans erreur possible je veux dire, ce sont décidément mes saletés de paupières qui ont encore gagné… aïïïïïïïïïïïïïe !
Vous avez connu ça, vous aussi, n'est-ce pas ? Et puis un jour — un soir, pour être exacte — au moment où vous ne l'espériez plus, vous tombez nez-à-nez avec la littérature, et là, là, c'est la page qui gagne, que dis-je ? qui VOUS gagne. Vous la relisez, pourtant — ça devient une habitude, à force — sauf que là, ça se passe tout de suite, dans la foulée, et juste après, rebelote, vous la relisez encore, mais seulement parce que vous la trouvez belle, cette fois, oui, belle, tout simplement belle…
Mazette, les gars ! Sabrez le champagne et sablez, les gars, sablez ! Non, pas pour moi, merci, je me contenterai de regarder monter les bulles de ces pages… du fond des vers mélancoliques… mêlant colique avec quoi d'ailleurs ? Ça, je ne sais pas… Mais enfin, voilà, tout de même, ça y est, je la tiens ma belle page… ma belle page, belle comme… Ah ! la vache ! me v'là coincée !… À l'aide !… Bon, laisse tomber, ma vieille, tout le monde roupille, faut que tu t'y colles !
Bon, alors, belle comme… une citadelle, peut-être, ou une cicindèle, je ne sais plus trop, je les confonds ces deux-là ; belle comme une épine de prose plantée dans l'épié, t'as vu, Freddy, fallait la caser celle-là, pas commode ; belle comme un filet d'Ariane mijoté au Grand Thésée, c'est ça ? Ou du Cointreau, peut-être bien, j'affirmerais pas. Bon, okay Freddy, t'as raison, tout le monde s'ennuie, j'accélère !
Belle comme une formule féroce qui fait fleurir les phrases même quand ce n'est plus du tout la saison ; belle comme ces objets usés qui vous rappellent des êtres chers ; belle comme le mot sublime que vous n'avez jamais pu sortir, souvenez-vous, coincé dans la gorge, dès la première minute du premier soir de votre premier amour ; belle comme cette employée courageuse — mais fatiguée —, celle dont tout le monde oublie le nom, et qui accepte pourtant de se farcir tout le sale boulot, sans chichi, sans trémolo, parce qu'il faut que ce soit fait, parce qu'il le faut, un point, c'est tout, et la voilà déjà partie ; belle comme un adverbe et une préposition qui s'étonneraient de plonger tout seuls, le soir, un crépuscule d'été, dans les immensités sans fond, quand les nébuleuses frétillent et que les vers luisants font des machins pas clairs avec leur lumière dans le train pour attirer les autres…
Aaah ! Ouais… Freddy ! C'est ça, peut-être bien, que ça nous fait, la littérature ! Ça nous allume des choses louches à des endroits bizarres, même en pensée… Tu me diras, ça va, tu es dans ton lit, tranquille, il fait nuit, personne te regarde, y a pas d'outrage…
Mais si pourtant, il y a outrage, cré vingt dieux ! parce qu'on nous fait croire, à nous, que ce qu'on tenait dans les mains et qu'on a laissé tomber au pied de notre pieu trois soirs de suite, ce qu'on tenait dans la musette, quand on se baladait froidement dans les pics et les ravins de la Zélande, qui atteignent tous facilement vingt centimètres, on nous fait croire, vous dis-je, que c'était ça, la littérature et que ça pouvait allumer des choses en nous ! Et ça n'allume rien, jamais, vous le savez bien, sauf peut-être bien sûr, un barbecue, quand on n'a plus d'allume-feu, et encore, il faut voir, même pour ça c'est pas garanti…
Alors que la littérature, en vrai, quand on en croise, on la reconnaît à ses lumières, pas vrai ? Pas besoin d'écrire en gros dessus LITTÉRATURE ou PRIX MACHIN, c'est comme si moi je m'amusais, comme ça, rien que pour faire joli, à écrire CYANURE ou LION VIVANT sur un paquet de lentilles ou des toilettes publiques.
Y en a qui trouveraient à redire, j'en suis certaine, alors pourquoi qu'ils le font avec la littérature qu'allume rien, les autres, hein ? Pourquoi ? Je me le demande. Faudra-t-il un jour qu'on écrive ZÈBRE en-dessous de chaque zèbre qu'on verra ? Des fois qu'on confondrait avec une girafe ou un oryctérope ? Elle est peut-être là, L'ÂNE AU MALI ?
Ouais, bon bref, j'en appelle à tous ceux qui en ont sérieusement marre de se manger de l'oryctérope étiqueté zèbre à longueur de pages. Ce que vous allez lire, là, Narcisse et Goldmund, ça ne vous plaira peut-être pas, c'est vrai — qui le peut à chaque fois et pour tous ? — mais c'est de la littérature. En soi, c'est déjà devenu tellement rare que ça mérite au moins un coup de chapeau pour commencer.
Et si je devais en parler à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, je commencerais sans doute par lui rappeler qu'on a coutume de dire que le personnage principal d'une oeuvre de fiction est celui qui évolue le plus au cours de la narration. À ce titre, il est certainement possible d'affirmer que le personnage qui évolue le plus dans « Narcisse et Goldmund » est Goldmund. Indubitablement, c'est lui le personnage principal : dans une bonne moitié du livre, on ne parle que de lui.
Alors ? Alors pourquoi ce titre si énigmatique ? Pourquoi mettre sur un pied de quasi égalité deux entités apparemment si dissemblables, si disproportionnées et qui aucunement ne pèsent de la même façon sur les deux plateaux de la balance ?
Demandons-nous alors que symbolisent, apparemment, ces deux personnages fictifs : Narcisse, ascétique, pondéré, calme, froid, méditatif, versé de sciences, de théologie, véritable rat de bibliothèque, intéressé seulement de théories et de choses de l'esprit. Soit. Qu'en est-il de Goldmund à présent : sensible, sensuel, impulsif, jouisseur, bouillant, sans cesse remuant, avide d'expériences chaque fois nouvelles, désireux de tester avant tout, presque sans réfléchir, quitte à se brûler les doigts.
Les choses apparaissent peut-être plus clairement désormais : Narcisse, c'est l'esprit, c'est la réflexion et Goldmund, c'est le corps, c'est la sensation. Ce que Hermann Hesse semble vouloir illustrer, d'après moi, dans ce roman, ce sont les deux sources de la connaissance auxquelles tout un chacun peut puiser : l'inférence et l'expérience. L'une est théorique, l'autre est pratique mais les deux procurent un savoir sur la vie, la nôtre et celle qui nous entoure.
En ce cas, pourquoi Goldmund est-il le personnage principal de ce roman, si les deux approches sont d'égale importance ? Eh bien, je crois (cette interprétation est mienne et réclame vraiment beaucoup de prudence, j'y exprime seulement mon propre ressenti, aucunement une vérité avérée), je crois, donc, que ce dont nous parle Hermann Hesse, c'est du cas particulier de l'art et, plus encore peut-être, du dilemme propre aux artistes.
Car l'art, en soi, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui parle aux sens, qui crée des émotions, tout en s'adressant à l'intellect — et c'est là la spécificité de l'art comparativement à tout autre activité humaine, peut-être — c'est de parler aux sens EN MÊME TEMPS qu'à l'esprit. L'artiste doit donc être À LA FOIS sensible et théoriser sur cette sensibilité pour mieux pouvoir l'exprimer, la livrer aux autres. (Fernando Pessoa a des phrases fameuses là-dessus dans son Livre de l'Intranquillité.)
Bref, l'oeuvre d'art, c'est ce qui procure des émotions tout en stimulant notre réflexion ; l'oeuvre d'art est ce qui fait la synthèse entre la réalisation technique de l'oeuvre et la somme d'expériences vécues et théorisées par l'artiste pour y donner naissance. Et voilà pourquoi, d'après moi, Goldmund se retire après avoir produit ses deux seules oeuvres véritables : la statue de Saint Jean et la chaire.
Si l'artiste fait autre chose que cela, il dévoie l'art. Certes, cela peut lui procurer beaucoup d'argent, de la reconnaissance éventuellement, mais d'art, point. C'est cela aussi, d'après mon interprétation, que cherche à nous dire Hermann Hesse dans cette oeuvre : l'artiste qui aligne les oeuvres les unes à la suite des autres, malgré toute sa maestria technique, malgré tout l'esthétisme qu'il sera capable de déployer, ne sera rien d'autre qu'un vendeur de babioles pour béotiens ébahis.
(Combien d'oeuvres soi-disant « littéraires » sont du même acabit et répondent à la même logique marchande ? Un écrivain, même très grand, au cours de son unique vie, des oeuvres d'art véritable, combien en produira-t-il ? Certainement pas des tas, d'où l'ineptie, d'où le non-sens artistique des bandeaux colorés sur des livres pondus à heure fixe et à bonne date, du genre : “ le dernier Joncour “, “ le dernier Nothomb “, “ le dernier Dubois “, etc.)
Si je veux illustrer ce propos au moyen d'oeuvres ou d'artistes connus, je ne vois pas meilleur exemple que Pablo Picasso. Si j'ai bien compris ce que Hesse cherche à nous dire, notamment par l'entremise du personnage de maître Niklaus, c'est qu'un Picasso aura pu produire des centaines et des centaines d'objets esthétiques ayant beaucoup de prix sur le marché de l'art, lui rapportant à la fois aisance financière et renommée internationale, mais les zéros, même à la fin d'un prix, restent des zéros. D'oeuvres d'art véritables, au sens qui parlent autant au corps qu'à l'esprit, qui laissent durablement leur empreinte sur le spectateur et sur le monde, il n'y en aura eu que deux : Les Demoiselles d'Avignon et Guernica, respectivement produites à 26 et 56 ans, soit les bornes naturelles et biologiques de ce qu'on appelle ordinairement « la force de l'âge ».
Picasso lui-même semblait parfaitement conscient de cet état de fait. On rapporte que l'artiste, au cours d'un dîner dans un restaurant, aurait fait un dessin sur une serviette ou une nappe en papier et qu'il l'aurait donné à l'un (ou l'une, je ne sais plus) des convives. Ce dernier (ou cette dernière) lui aurait alors demandé de signer son dessin, ce que l'Espagnol aurait refusé en déclarant : « le dessin ne vaut rien mais la signature vaut des millions. »
Pourtant, dans Narcisse et Goldmund, il y a encore bien plus que cela. L'auteur reprend, aménage, réexprime ce qu'il avait déjà admirablement explicité dans le Loup des Steppes, à savoir que toute personne, du simple fait de sa conception par deux parents nécessairement singuliers et distincts, est toujours plus ou moins tiraillée entre différents aspects de sa personnalité. Certains lui ayant été transmis par le père, d'autres par la mère.
C'est cela que vit Goldmund. S'il est fasciné, au départ, par le personnage de Narcisse, c'est peut-être et avant tout parce que celui-ci fait appel en lui aux éléments typiquement paternels de sa personnalité. Cependant, le sage et perspicace Narcisse aura tôt fait d'exhumer de la personnalité duelle de son jeune admirateur les éléments purement maternels et qu'il refusait de prendre en considération jusque-là. Alors commence le déchirement de Goldmund, le désespoir de n'être pas celui que son esprit voudrait être, la déception d'être un corps avant même un cerveau.
Mais l'on n'échappe pas à sa nature. Si jouisseur tu es, Freddy, par atavisme, jouisseur tu seras, quelles qu'en puissent être les répugnances de l'esprit. le choc est terrible pour Goldmund, il aurait tant voulu être autre chose, mais en fait non, il est bien cela. Museler son moi profond au prix d'un effort ou d'une coercition de tous les instants ou accepter ce que l'on est, au plus profond de soi ?
Nul doute que Hermann Hesse a injecté beaucoup de lui-même dans Narcisse et dans Goldmund, il a dissocié l'être bicéphale qu'il était pour tâcher d'en faire deux abstractions à peu près pures. Nul doute qu'il y a beaucoup du véritable monastère de Maulbronn — qu'il a fréquenté — dans le monastère fictif de Mariabronn qu'il nous dépeint. Nul doute qu'il y a beaucoup de ses propres rébellions, de ses propres errances, de ses propres quêtes et de ses propres incohérences dans les rébellions, les errances, les quêtes et les incohérences de Goldmund.
Nul doute également que Narcisse et Goldmund, comme toute oeuvre d'art véritable, aura marqué les esprits de ses lecteurs et, probablement, aura fait des petits en littérature. Je vois, par exemple, dans le couple que forment Guillaume de Baskerville et Adso dans le Nom de la Rose d'Umberto Eco un vif clin d'oeil à Narcisse et Goldmund. de même, l'errance pleine de mort et de choléra d'Angelo dans le Hussard sur le Toit de Jean Giono n'est pas sans présenter de nombreux parallèles avec l'errance pleine de mort et de peste du susnommé Goldmund.
Enfin, en guise de conclusion, pour en terminer avec mon parallèle entre Goldmund et Picasso, quelles sont les deux seules oeuvres de Goldmund ? L'une, celle qui clôt sa jeunesse, n'est autre que le portrait de Narcisse en Saint Jean, c'est-à-dire, dit simplement, le portrait de la sagesse offert au monde des jouisseurs. L'autre, la chaire décorée de Mariabronn, n'est rien d'autre que l'inverse, c'est-à-dire celle qui clôt la force de l'âge de Goldmund et qui est une somme de la beauté et des jouissances du monde extérieur offerte au monde cloîtré de la sagesse et de l'esprit, à l'endroit même où se délivre la parole supposée transcendantale.
Quoi qu'il en soit, comme toujours et plus que jamais, l'essentiel est et sera toujours de lire par soi-même cette oeuvre puissante, complexe, non univoque, non commerciale et qui continue longtemps d'infuser dans l'esprit de ceux qui l'on lue et appréciée, passées les émotions premières, marque probable sinon indubitable des véritables oeuvres d'art. Dormez bien, ce soir, et quand vous songerez à vous racheter un vélo hollandais, souvenez-vous que ce n'est là que mon avis, rien qu'un coup de sonnette dans tout le trafic, c'est-à-dire, pas grand chose.
Très (trop) souvent je lis, je lis des livres, des livres et des livres encore… Et je m'endors avec, la main déjà dans le « fort molle », la farce sur l'oreiller, l'oeil à peu près mi-clos, luttant, peinant, cravachant dur pour cavaler, si possible, jusqu'au bout de ma page — ah, maudite page ! — avant d'être tout à fait croquée par le sommeil, une fois encore.
Un soir, deux soirs, parfois trois soirs de suite ça dure, cette affaire-là. Je me cogne et je me recogne et je me rerecogne la même putain de page sans nom, captivante au moins comme les reliefs de Frise et du Bangladesh réunis, d'un caractère si décisif, oui… si des Sisyphe pouvaient venir m'aider un peu sur ce coup-là, car vraiment, les deux précédents soirs, cent coups fait rire, enfin sans erreur possible je veux dire, ce sont décidément mes saletés de paupières qui ont encore gagné… aïïïïïïïïïïïïïe !
Vous avez connu ça, vous aussi, n'est-ce pas ? Et puis un jour — un soir, pour être exacte — au moment où vous ne l'espériez plus, vous tombez nez-à-nez avec la littérature, et là, là, c'est la page qui gagne, que dis-je ? qui VOUS gagne. Vous la relisez, pourtant — ça devient une habitude, à force — sauf que là, ça se passe tout de suite, dans la foulée, et juste après, rebelote, vous la relisez encore, mais seulement parce que vous la trouvez belle, cette fois, oui, belle, tout simplement belle…
Mazette, les gars ! Sabrez le champagne et sablez, les gars, sablez ! Non, pas pour moi, merci, je me contenterai de regarder monter les bulles de ces pages… du fond des vers mélancoliques… mêlant colique avec quoi d'ailleurs ? Ça, je ne sais pas… Mais enfin, voilà, tout de même, ça y est, je la tiens ma belle page… ma belle page, belle comme… Ah ! la vache ! me v'là coincée !… À l'aide !… Bon, laisse tomber, ma vieille, tout le monde roupille, faut que tu t'y colles !
Bon, alors, belle comme… une citadelle, peut-être, ou une cicindèle, je ne sais plus trop, je les confonds ces deux-là ; belle comme une épine de prose plantée dans l'épié, t'as vu, Freddy, fallait la caser celle-là, pas commode ; belle comme un filet d'Ariane mijoté au Grand Thésée, c'est ça ? Ou du Cointreau, peut-être bien, j'affirmerais pas. Bon, okay Freddy, t'as raison, tout le monde s'ennuie, j'accélère !
Belle comme une formule féroce qui fait fleurir les phrases même quand ce n'est plus du tout la saison ; belle comme ces objets usés qui vous rappellent des êtres chers ; belle comme le mot sublime que vous n'avez jamais pu sortir, souvenez-vous, coincé dans la gorge, dès la première minute du premier soir de votre premier amour ; belle comme cette employée courageuse — mais fatiguée —, celle dont tout le monde oublie le nom, et qui accepte pourtant de se farcir tout le sale boulot, sans chichi, sans trémolo, parce qu'il faut que ce soit fait, parce qu'il le faut, un point, c'est tout, et la voilà déjà partie ; belle comme un adverbe et une préposition qui s'étonneraient de plonger tout seuls, le soir, un crépuscule d'été, dans les immensités sans fond, quand les nébuleuses frétillent et que les vers luisants font des machins pas clairs avec leur lumière dans le train pour attirer les autres…
Aaah ! Ouais… Freddy ! C'est ça, peut-être bien, que ça nous fait, la littérature ! Ça nous allume des choses louches à des endroits bizarres, même en pensée… Tu me diras, ça va, tu es dans ton lit, tranquille, il fait nuit, personne te regarde, y a pas d'outrage…
Mais si pourtant, il y a outrage, cré vingt dieux ! parce qu'on nous fait croire, à nous, que ce qu'on tenait dans les mains et qu'on a laissé tomber au pied de notre pieu trois soirs de suite, ce qu'on tenait dans la musette, quand on se baladait froidement dans les pics et les ravins de la Zélande, qui atteignent tous facilement vingt centimètres, on nous fait croire, vous dis-je, que c'était ça, la littérature et que ça pouvait allumer des choses en nous ! Et ça n'allume rien, jamais, vous le savez bien, sauf peut-être bien sûr, un barbecue, quand on n'a plus d'allume-feu, et encore, il faut voir, même pour ça c'est pas garanti…
Alors que la littérature, en vrai, quand on en croise, on la reconnaît à ses lumières, pas vrai ? Pas besoin d'écrire en gros dessus LITTÉRATURE ou PRIX MACHIN, c'est comme si moi je m'amusais, comme ça, rien que pour faire joli, à écrire CYANURE ou LION VIVANT sur un paquet de lentilles ou des toilettes publiques.
Y en a qui trouveraient à redire, j'en suis certaine, alors pourquoi qu'ils le font avec la littérature qu'allume rien, les autres, hein ? Pourquoi ? Je me le demande. Faudra-t-il un jour qu'on écrive ZÈBRE en-dessous de chaque zèbre qu'on verra ? Des fois qu'on confondrait avec une girafe ou un oryctérope ? Elle est peut-être là, L'ÂNE AU MALI ?
Ouais, bon bref, j'en appelle à tous ceux qui en ont sérieusement marre de se manger de l'oryctérope étiqueté zèbre à longueur de pages. Ce que vous allez lire, là, Narcisse et Goldmund, ça ne vous plaira peut-être pas, c'est vrai — qui le peut à chaque fois et pour tous ? — mais c'est de la littérature. En soi, c'est déjà devenu tellement rare que ça mérite au moins un coup de chapeau pour commencer.
Et si je devais en parler à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, je commencerais sans doute par lui rappeler qu'on a coutume de dire que le personnage principal d'une oeuvre de fiction est celui qui évolue le plus au cours de la narration. À ce titre, il est certainement possible d'affirmer que le personnage qui évolue le plus dans « Narcisse et Goldmund » est Goldmund. Indubitablement, c'est lui le personnage principal : dans une bonne moitié du livre, on ne parle que de lui.
Alors ? Alors pourquoi ce titre si énigmatique ? Pourquoi mettre sur un pied de quasi égalité deux entités apparemment si dissemblables, si disproportionnées et qui aucunement ne pèsent de la même façon sur les deux plateaux de la balance ?
Demandons-nous alors que symbolisent, apparemment, ces deux personnages fictifs : Narcisse, ascétique, pondéré, calme, froid, méditatif, versé de sciences, de théologie, véritable rat de bibliothèque, intéressé seulement de théories et de choses de l'esprit. Soit. Qu'en est-il de Goldmund à présent : sensible, sensuel, impulsif, jouisseur, bouillant, sans cesse remuant, avide d'expériences chaque fois nouvelles, désireux de tester avant tout, presque sans réfléchir, quitte à se brûler les doigts.
Les choses apparaissent peut-être plus clairement désormais : Narcisse, c'est l'esprit, c'est la réflexion et Goldmund, c'est le corps, c'est la sensation. Ce que Hermann Hesse semble vouloir illustrer, d'après moi, dans ce roman, ce sont les deux sources de la connaissance auxquelles tout un chacun peut puiser : l'inférence et l'expérience. L'une est théorique, l'autre est pratique mais les deux procurent un savoir sur la vie, la nôtre et celle qui nous entoure.
En ce cas, pourquoi Goldmund est-il le personnage principal de ce roman, si les deux approches sont d'égale importance ? Eh bien, je crois (cette interprétation est mienne et réclame vraiment beaucoup de prudence, j'y exprime seulement mon propre ressenti, aucunement une vérité avérée), je crois, donc, que ce dont nous parle Hermann Hesse, c'est du cas particulier de l'art et, plus encore peut-être, du dilemme propre aux artistes.
Car l'art, en soi, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui parle aux sens, qui crée des émotions, tout en s'adressant à l'intellect — et c'est là la spécificité de l'art comparativement à tout autre activité humaine, peut-être — c'est de parler aux sens EN MÊME TEMPS qu'à l'esprit. L'artiste doit donc être À LA FOIS sensible et théoriser sur cette sensibilité pour mieux pouvoir l'exprimer, la livrer aux autres. (Fernando Pessoa a des phrases fameuses là-dessus dans son Livre de l'Intranquillité.)
Bref, l'oeuvre d'art, c'est ce qui procure des émotions tout en stimulant notre réflexion ; l'oeuvre d'art est ce qui fait la synthèse entre la réalisation technique de l'oeuvre et la somme d'expériences vécues et théorisées par l'artiste pour y donner naissance. Et voilà pourquoi, d'après moi, Goldmund se retire après avoir produit ses deux seules oeuvres véritables : la statue de Saint Jean et la chaire.
Si l'artiste fait autre chose que cela, il dévoie l'art. Certes, cela peut lui procurer beaucoup d'argent, de la reconnaissance éventuellement, mais d'art, point. C'est cela aussi, d'après mon interprétation, que cherche à nous dire Hermann Hesse dans cette oeuvre : l'artiste qui aligne les oeuvres les unes à la suite des autres, malgré toute sa maestria technique, malgré tout l'esthétisme qu'il sera capable de déployer, ne sera rien d'autre qu'un vendeur de babioles pour béotiens ébahis.
(Combien d'oeuvres soi-disant « littéraires » sont du même acabit et répondent à la même logique marchande ? Un écrivain, même très grand, au cours de son unique vie, des oeuvres d'art véritable, combien en produira-t-il ? Certainement pas des tas, d'où l'ineptie, d'où le non-sens artistique des bandeaux colorés sur des livres pondus à heure fixe et à bonne date, du genre : “ le dernier Joncour “, “ le dernier Nothomb “, “ le dernier Dubois “, etc.)
Si je veux illustrer ce propos au moyen d'oeuvres ou d'artistes connus, je ne vois pas meilleur exemple que Pablo Picasso. Si j'ai bien compris ce que Hesse cherche à nous dire, notamment par l'entremise du personnage de maître Niklaus, c'est qu'un Picasso aura pu produire des centaines et des centaines d'objets esthétiques ayant beaucoup de prix sur le marché de l'art, lui rapportant à la fois aisance financière et renommée internationale, mais les zéros, même à la fin d'un prix, restent des zéros. D'oeuvres d'art véritables, au sens qui parlent autant au corps qu'à l'esprit, qui laissent durablement leur empreinte sur le spectateur et sur le monde, il n'y en aura eu que deux : Les Demoiselles d'Avignon et Guernica, respectivement produites à 26 et 56 ans, soit les bornes naturelles et biologiques de ce qu'on appelle ordinairement « la force de l'âge ».
Picasso lui-même semblait parfaitement conscient de cet état de fait. On rapporte que l'artiste, au cours d'un dîner dans un restaurant, aurait fait un dessin sur une serviette ou une nappe en papier et qu'il l'aurait donné à l'un (ou l'une, je ne sais plus) des convives. Ce dernier (ou cette dernière) lui aurait alors demandé de signer son dessin, ce que l'Espagnol aurait refusé en déclarant : « le dessin ne vaut rien mais la signature vaut des millions. »
Pourtant, dans Narcisse et Goldmund, il y a encore bien plus que cela. L'auteur reprend, aménage, réexprime ce qu'il avait déjà admirablement explicité dans le Loup des Steppes, à savoir que toute personne, du simple fait de sa conception par deux parents nécessairement singuliers et distincts, est toujours plus ou moins tiraillée entre différents aspects de sa personnalité. Certains lui ayant été transmis par le père, d'autres par la mère.
C'est cela que vit Goldmund. S'il est fasciné, au départ, par le personnage de Narcisse, c'est peut-être et avant tout parce que celui-ci fait appel en lui aux éléments typiquement paternels de sa personnalité. Cependant, le sage et perspicace Narcisse aura tôt fait d'exhumer de la personnalité duelle de son jeune admirateur les éléments purement maternels et qu'il refusait de prendre en considération jusque-là. Alors commence le déchirement de Goldmund, le désespoir de n'être pas celui que son esprit voudrait être, la déception d'être un corps avant même un cerveau.
Mais l'on n'échappe pas à sa nature. Si jouisseur tu es, Freddy, par atavisme, jouisseur tu seras, quelles qu'en puissent être les répugnances de l'esprit. le choc est terrible pour Goldmund, il aurait tant voulu être autre chose, mais en fait non, il est bien cela. Museler son moi profond au prix d'un effort ou d'une coercition de tous les instants ou accepter ce que l'on est, au plus profond de soi ?
Nul doute que Hermann Hesse a injecté beaucoup de lui-même dans Narcisse et dans Goldmund, il a dissocié l'être bicéphale qu'il était pour tâcher d'en faire deux abstractions à peu près pures. Nul doute qu'il y a beaucoup du véritable monastère de Maulbronn — qu'il a fréquenté — dans le monastère fictif de Mariabronn qu'il nous dépeint. Nul doute qu'il y a beaucoup de ses propres rébellions, de ses propres errances, de ses propres quêtes et de ses propres incohérences dans les rébellions, les errances, les quêtes et les incohérences de Goldmund.
Nul doute également que Narcisse et Goldmund, comme toute oeuvre d'art véritable, aura marqué les esprits de ses lecteurs et, probablement, aura fait des petits en littérature. Je vois, par exemple, dans le couple que forment Guillaume de Baskerville et Adso dans le Nom de la Rose d'Umberto Eco un vif clin d'oeil à Narcisse et Goldmund. de même, l'errance pleine de mort et de choléra d'Angelo dans le Hussard sur le Toit de Jean Giono n'est pas sans présenter de nombreux parallèles avec l'errance pleine de mort et de peste du susnommé Goldmund.
Enfin, en guise de conclusion, pour en terminer avec mon parallèle entre Goldmund et Picasso, quelles sont les deux seules oeuvres de Goldmund ? L'une, celle qui clôt sa jeunesse, n'est autre que le portrait de Narcisse en Saint Jean, c'est-à-dire, dit simplement, le portrait de la sagesse offert au monde des jouisseurs. L'autre, la chaire décorée de Mariabronn, n'est rien d'autre que l'inverse, c'est-à-dire celle qui clôt la force de l'âge de Goldmund et qui est une somme de la beauté et des jouissances du monde extérieur offerte au monde cloîtré de la sagesse et de l'esprit, à l'endroit même où se délivre la parole supposée transcendantale.
Quoi qu'il en soit, comme toujours et plus que jamais, l'essentiel est et sera toujours de lire par soi-même cette oeuvre puissante, complexe, non univoque, non commerciale et qui continue longtemps d'infuser dans l'esprit de ceux qui l'on lue et appréciée, passées les émotions premières, marque probable sinon indubitable des véritables oeuvres d'art. Dormez bien, ce soir, et quand vous songerez à vous racheter un vélo hollandais, souvenez-vous que ce n'est là que mon avis, rien qu'un coup de sonnette dans tout le trafic, c'est-à-dire, pas grand chose.
A l'époque moyenâgeuse du Saint-Empire romain germanique, le péché mignon des pensionnaires du monastère de Mariabronn se limite à un peu de vin chaud bien sucré, parfumé à la cannelle et à l'oeillet.
Parmi les membres de cette communauté religieuse, haut-lieu de la connaissance et de la prière, deux jeunes gens s'apprécient et se recherchent : Narcisse et Goldmund sont sous l'influence d'une force d'attraction hors des pulsions inverties.
Professeur de grec, encore novice, Narcisse est un être d'élite respecté de tous. Jeune homme de grande écoute, il prend sous son aile Goldmund un élève studieux âgé de quinze ans, rêveur à ses heures.
En recherche de spiritualité, ils sont l'un comme l'autre au stade du serment non exprimé. Chacun se sent engagé au fond de lui-même par cette promesse de voeux non écrite mais sacrée.
En fin psychologue, Narcisse découvre chez son ami un traumatisme enfoui depuis l'enfance, une blessure cachée liée au souvenir ténu d'une mère qui a fui le domicile familial alors qu'il était en bas âge. Il ne pense pas que la vie ascétique corresponde à la personnalité de Goldmund mais qu'une recherche de soi orientée vers l'art siérait mieux à son tempérament passionné.
Alors que Narcisse se prépare à recevoir l'ordination, Goldmund abandonne au bout de trois ans la vie austère de Mariabronn au profit de celle aventureuse du monde extérieur.
Ces quelques lignes introductives survolent seulement les tout premiers chapitres, la majeure partie de « Narcisse et Goldmund » se déroule au grand air, en dehors de l'enceinte confinée du monastère.
Les paysages rhénans, la faune, la flore sont décrits dans un style imagé et poétique.
Alternent avec bonheur les scènes contemplatives et mouvementées, la condition de vagant n'est pas de tout repos.
Les regards complices, les paroles douces, les ébats amoureux entre le séduisant Goldmund aux boucles blondes et les femmes rencontrées ici et là, agrémentent de surcroît le récit.
Les prédispositions artistiques qui au fil des années s'affirment chez Goldmund sont également évoquées avec intelligence.
Mais l'attrait principal de cette oeuvre romanesque, écrite par Hermann Hesse en 1930, réside dans l'amitié indéfectible entre Narcisse le spirituel et Goldmund le sensuel, deux êtres fondamentalement différents mais pourtant en symbiose.
En cette période de Noël censée être de concorde et de paix, « Narcisse et Goldmund » est un formidable message de tolérance, de réconfort.
Le lecteur, aux anges, gardera longtemps à l'esprit les prénoms indissociables du penseur et de l'artiste !
Parmi les membres de cette communauté religieuse, haut-lieu de la connaissance et de la prière, deux jeunes gens s'apprécient et se recherchent : Narcisse et Goldmund sont sous l'influence d'une force d'attraction hors des pulsions inverties.
Professeur de grec, encore novice, Narcisse est un être d'élite respecté de tous. Jeune homme de grande écoute, il prend sous son aile Goldmund un élève studieux âgé de quinze ans, rêveur à ses heures.
En recherche de spiritualité, ils sont l'un comme l'autre au stade du serment non exprimé. Chacun se sent engagé au fond de lui-même par cette promesse de voeux non écrite mais sacrée.
En fin psychologue, Narcisse découvre chez son ami un traumatisme enfoui depuis l'enfance, une blessure cachée liée au souvenir ténu d'une mère qui a fui le domicile familial alors qu'il était en bas âge. Il ne pense pas que la vie ascétique corresponde à la personnalité de Goldmund mais qu'une recherche de soi orientée vers l'art siérait mieux à son tempérament passionné.
Alors que Narcisse se prépare à recevoir l'ordination, Goldmund abandonne au bout de trois ans la vie austère de Mariabronn au profit de celle aventureuse du monde extérieur.
Ces quelques lignes introductives survolent seulement les tout premiers chapitres, la majeure partie de « Narcisse et Goldmund » se déroule au grand air, en dehors de l'enceinte confinée du monastère.
Les paysages rhénans, la faune, la flore sont décrits dans un style imagé et poétique.
Alternent avec bonheur les scènes contemplatives et mouvementées, la condition de vagant n'est pas de tout repos.
Les regards complices, les paroles douces, les ébats amoureux entre le séduisant Goldmund aux boucles blondes et les femmes rencontrées ici et là, agrémentent de surcroît le récit.
Les prédispositions artistiques qui au fil des années s'affirment chez Goldmund sont également évoquées avec intelligence.
Mais l'attrait principal de cette oeuvre romanesque, écrite par Hermann Hesse en 1930, réside dans l'amitié indéfectible entre Narcisse le spirituel et Goldmund le sensuel, deux êtres fondamentalement différents mais pourtant en symbiose.
En cette période de Noël censée être de concorde et de paix, « Narcisse et Goldmund » est un formidable message de tolérance, de réconfort.
Le lecteur, aux anges, gardera longtemps à l'esprit les prénoms indissociables du penseur et de l'artiste !
D'un côté : le religieux: science , vie monastique rigoureusement réglée, vertu, aspiration à l'intellect, méditation et ordre, prière et quête spirituelle absolue: Voici Narcisse.
De l'autre : sensualité , appel des sens, amour des femmes , besoin d'indépendance, vagabondage , passions violentes ,jouissance de la vie et de la chair alliée à la puérilité de la vie des vagants , révolte contre la loi et la raison, nature d'artiste et de créateur, usage des mains pour la sculpture, difficultés des débuts et habileté qui allait toute seule: Voici Goldmund.
C'est dans l'Allemagne du Moyen Âge qu'Hermann Hesse situe son histoire .
Ou les deux FACES d' amis aussi différents que possible : en réalité les deux visages de l'homme celui de la pensée et celui de l'action, à la fois complémentaires, et dissociées.
Un ouvrage bouleversant , riche d'émotions à la profondeur psychologique sans pareille , bien au delà de sa portée spirituelle et universelle.
C'est un hymne philosophique vibrant entre quête de l'absolu et juste manière de trouver sa voie!
Un équilibre bien fragile.
De la difficulté à nous, HUMAINS à vivre des aspirations contraires, rattachées à notre nature profonde.
Une oeuvre magistrale , majeure , unique , lumineuse , une sorte d'épopée initiatique qui dormait depuis longtemps dans ma bibliothèque , alliant découverte des sens, amitié et spiritualité , ainsi que cheminement ardu dans la vraie vie !
La quête éperdue , vitale, de SENS à la recherche du « Beau » .
Une écriture élégante imprégnée par l'ardent désir de conciliation entre spiritualité et animalité .
Quel talent !
On en ressort très ému !
Narcisse le penseur , Goldmund l'artiste jouisseur !
Deux pôles opposés pourtant !
Différences effacées et conciliation des contraires .
Ne faire « qu'un coeur de deux coeurs » ?
Périlleux , âpre et sublime.
Je dois avouer que très longtemps, la 1ère de couverture , austère , n'attirait pas mon oeil , puéril, non?
De l'autre : sensualité , appel des sens, amour des femmes , besoin d'indépendance, vagabondage , passions violentes ,jouissance de la vie et de la chair alliée à la puérilité de la vie des vagants , révolte contre la loi et la raison, nature d'artiste et de créateur, usage des mains pour la sculpture, difficultés des débuts et habileté qui allait toute seule: Voici Goldmund.
C'est dans l'Allemagne du Moyen Âge qu'Hermann Hesse situe son histoire .
Ou les deux FACES d' amis aussi différents que possible : en réalité les deux visages de l'homme celui de la pensée et celui de l'action, à la fois complémentaires, et dissociées.
Un ouvrage bouleversant , riche d'émotions à la profondeur psychologique sans pareille , bien au delà de sa portée spirituelle et universelle.
C'est un hymne philosophique vibrant entre quête de l'absolu et juste manière de trouver sa voie!
Un équilibre bien fragile.
De la difficulté à nous, HUMAINS à vivre des aspirations contraires, rattachées à notre nature profonde.
Une oeuvre magistrale , majeure , unique , lumineuse , une sorte d'épopée initiatique qui dormait depuis longtemps dans ma bibliothèque , alliant découverte des sens, amitié et spiritualité , ainsi que cheminement ardu dans la vraie vie !
La quête éperdue , vitale, de SENS à la recherche du « Beau » .
Une écriture élégante imprégnée par l'ardent désir de conciliation entre spiritualité et animalité .
Quel talent !
On en ressort très ému !
Narcisse le penseur , Goldmund l'artiste jouisseur !
Deux pôles opposés pourtant !
Différences effacées et conciliation des contraires .
Ne faire « qu'un coeur de deux coeurs » ?
Périlleux , âpre et sublime.
Je dois avouer que très longtemps, la 1ère de couverture , austère , n'attirait pas mon oeil , puéril, non?
C'est une pépite. Un objet littéraire comme on en rencontre peu, accessible et profond.
Ce roman de 1930, sous estimé avec seulement 63 critiques à ce jour, recouvre le thème de l'amitié dans un Moyen Âge germanique où la mort est omniprésente, mais si ce n'était que cela...
Les opposés s'attirent. Ce fait est mis en pratique quand Goldmund et Narcisse se rencontrent dans le pensionnat du monastère de Mariabronn, l'un est un élève rêveur, l'autre est un jeune professeur qui tire son statut, et beaucoup d'orgueil, de ses connaissances sur Aristote et Saint thomas d'Aquin. Mais, dans le silence de la prière et de la spiritualité souffle dans les interstices des murs du cloître un air de liberté.
Le roman, faisant la part belle à l'aventure, se concentrera sur l'imprévisible Goldmund.
Aventure et recherche de soi sont les moteurs du récit.
Il oppose l'errance et la propriété mais aussi la recherche de l'autre et la peur de l'autre. En effet, le bon Herman Hesse constate que le propriétaire redoute le vagabond car il lui rappelle son implacable inclinaison vers la déchéance et la mort.
Indépendance, instinct et instabilité se révèlent dans le monde primitif du vagabond soumis à la providence qui lui octroie soleil, pluie, neige, froid ou chaleur.
Pour le jeune homme sûr de sa force et de sa beauté, la recherche de nourriture et de rencontres féminines sont des besoins du corps qui, assouvis, ne lui permettent pourtant pas de se révéler pleinement.
Voilà la quête: quel sens à donner à sa vie?
Des réponses seront peut-être trouvées sur les routes de l'aventure qui se lie au vice , de la sagesse liée à la monotonie ou bien de l'art qui pourrait transcender cette obscure peur ancrée en certains d'entre nous.
Herman Hesse m'a paru beaucoup plus lisible que dans "Le loup des steppes", ses réflexions sur l'être humain souhaitant, même inconsciemment, que quelque chose lui survive, sont bouleversantes.
Une splendide découverte soufflée par Babelio et ses généreux contributeurs.
Ce roman de 1930, sous estimé avec seulement 63 critiques à ce jour, recouvre le thème de l'amitié dans un Moyen Âge germanique où la mort est omniprésente, mais si ce n'était que cela...
Les opposés s'attirent. Ce fait est mis en pratique quand Goldmund et Narcisse se rencontrent dans le pensionnat du monastère de Mariabronn, l'un est un élève rêveur, l'autre est un jeune professeur qui tire son statut, et beaucoup d'orgueil, de ses connaissances sur Aristote et Saint thomas d'Aquin. Mais, dans le silence de la prière et de la spiritualité souffle dans les interstices des murs du cloître un air de liberté.
Le roman, faisant la part belle à l'aventure, se concentrera sur l'imprévisible Goldmund.
Aventure et recherche de soi sont les moteurs du récit.
Il oppose l'errance et la propriété mais aussi la recherche de l'autre et la peur de l'autre. En effet, le bon Herman Hesse constate que le propriétaire redoute le vagabond car il lui rappelle son implacable inclinaison vers la déchéance et la mort.
Indépendance, instinct et instabilité se révèlent dans le monde primitif du vagabond soumis à la providence qui lui octroie soleil, pluie, neige, froid ou chaleur.
Pour le jeune homme sûr de sa force et de sa beauté, la recherche de nourriture et de rencontres féminines sont des besoins du corps qui, assouvis, ne lui permettent pourtant pas de se révéler pleinement.
Voilà la quête: quel sens à donner à sa vie?
Des réponses seront peut-être trouvées sur les routes de l'aventure qui se lie au vice , de la sagesse liée à la monotonie ou bien de l'art qui pourrait transcender cette obscure peur ancrée en certains d'entre nous.
Herman Hesse m'a paru beaucoup plus lisible que dans "Le loup des steppes", ses réflexions sur l'être humain souhaitant, même inconsciemment, que quelque chose lui survive, sont bouleversantes.
Une splendide découverte soufflée par Babelio et ses généreux contributeurs.
Il y a des livres qui vous parlent, celui-ci dialogue avec moi. Il y a des livres qui vous "remuent", celui-ci me bouleverse. Hermann Hesse évoque avec poésie, élégance, réalisme, la difficulté d'être humain, de vivre les aspirations contraires qui sont rattachées à notre essence.
L'auteur a choisi de dissocier dans ce roman les deux inclinaisons majeures de l'homme, d'un côté l'aspiration vers l'intellect et le religieux, l'ordre et le scientifique, la méditation et la prière, et de l'autre, la jouissance de la vie dans toute son animalité, en un hymne à la mort et à la vie, à l'amour et à la tristesse, à la beauté et à l'ignominie, en les personnifiant en deux personnalités antithétiques mais complémentaires. Goldmund transcendera sa nature sensuelle en l'investissant dans l'art, qu'il revêt alors d'un caractère sacré.
Mais « Narcisse et Goldmund » est aussi une fable sur la dualité de l'être humain, dans laquelle les deux personnages représentent les forces contraires d'une même psyché. Tiraillé entre ses appétits, ses aspirations, ses nécessités, les exigences du monde extérieur, l'être humain est amené à faire des choix, et ce faisant, de renoncer, de s'amputer d'une partie de ce qu'il est. Mais Hesse nous apporte une solution à ce dilemme sans fin : on ne peut, au mieux, que devenir que ce que l'on est, et c'est en transcendant l'expérience des sens qu'on accède à la spiritualité. En ce sens, il rejoint la conceptualisation du sacré de Carl Gustav Jung, dont Hesse fut l'ami et le patient (d'ailleurs « Narcisse et Goldmund » présente tout au long de l'ouvrage la plus magnifique évocation de l'Anima qu'il m'ait été donné de lire).
A mon sens, « Narcisse et Goldmund » est un chef d'oeuvre, plus abouti que par exemple « Siddharta » (qui m'a paru plus convenu, moins surprenant, dans son traitement), ou le « Jeu des perles de verre » dont le Maitre me parait trop intellectuel, pas assez humain… Il y a dans ce livre une idée de réconciliation, et de paix, que je n'ai jamais trouvé par ailleurs chez cet auteur.
C'est pour moi une oeuvre à la fois majeure et magistrale, que je place sans hésitation tout en haut du panthéon des livres qui m'ont le plus marquée.
L'auteur a choisi de dissocier dans ce roman les deux inclinaisons majeures de l'homme, d'un côté l'aspiration vers l'intellect et le religieux, l'ordre et le scientifique, la méditation et la prière, et de l'autre, la jouissance de la vie dans toute son animalité, en un hymne à la mort et à la vie, à l'amour et à la tristesse, à la beauté et à l'ignominie, en les personnifiant en deux personnalités antithétiques mais complémentaires. Goldmund transcendera sa nature sensuelle en l'investissant dans l'art, qu'il revêt alors d'un caractère sacré.
Mais « Narcisse et Goldmund » est aussi une fable sur la dualité de l'être humain, dans laquelle les deux personnages représentent les forces contraires d'une même psyché. Tiraillé entre ses appétits, ses aspirations, ses nécessités, les exigences du monde extérieur, l'être humain est amené à faire des choix, et ce faisant, de renoncer, de s'amputer d'une partie de ce qu'il est. Mais Hesse nous apporte une solution à ce dilemme sans fin : on ne peut, au mieux, que devenir que ce que l'on est, et c'est en transcendant l'expérience des sens qu'on accède à la spiritualité. En ce sens, il rejoint la conceptualisation du sacré de Carl Gustav Jung, dont Hesse fut l'ami et le patient (d'ailleurs « Narcisse et Goldmund » présente tout au long de l'ouvrage la plus magnifique évocation de l'Anima qu'il m'ait été donné de lire).
A mon sens, « Narcisse et Goldmund » est un chef d'oeuvre, plus abouti que par exemple « Siddharta » (qui m'a paru plus convenu, moins surprenant, dans son traitement), ou le « Jeu des perles de verre » dont le Maitre me parait trop intellectuel, pas assez humain… Il y a dans ce livre une idée de réconciliation, et de paix, que je n'ai jamais trouvé par ailleurs chez cet auteur.
C'est pour moi une oeuvre à la fois majeure et magistrale, que je place sans hésitation tout en haut du panthéon des livres qui m'ont le plus marquée.
Citations et extraits (188)
Voir plus
Ajouter une citation
Et pourtant, ce qui l'attendait maintenant était encore pire qu'il n'eût pu l'imaginer. Cela commença aux premières fermes, aux premiers villages, et plus il avançait, plus cela persistait en s'aggravant. Toute la région, tout le vaste pays était sous un nuage de mort, sous un voile d'horreur, d'angoisse qui assombrissait les âmes, et le pire, ce n'étaient pas les maisons désertes, les chiens qui pourrissaient morts de faim à la chaine, les morts restés sans sépulture, les enfants qui mendiaient, les fosses communes devant les villes. Le pire, c'étaient les vivants qui, sous le fardeau de l'effroi et de l'angoisse mortelle, semblaient avoir perdu leurs yeux et leurs âmes. .. Des parents avaient abandonné leurs enfants et des époux leurs femmes quand ils étaient tombés malades. Les valets de la peste et les aides des hôpitaux régnaient en bourreaux, pillant les maisons vidées par la mort, tantôt, selon leur bon plaisir, laissant les morts sans sépulture, tantôt traînant les vivants, avant qu'ils aient cessé de respirer, hors de leurs lits sur les chars à cadavres... Chacun prétendait connaître le coupable, cause de l'épidémie, ou ses auteurs criminels ... Celui sur qui pesait un tel soupçon, à moins qu'il ne fût averti et pût fuir, était perdu, il était mis à mort par la justice ou par la populace. Les riches incriminaient les pauvres et réciproquement ; ou bien ce devaient être les juifs, ou les welches, ou les médecins. Dans une ville, Goldmund vit, le coeur soulevé de fureur, toute la rue des juifs en flammes, maison par maison, le peuple se tenait autour, hurlant sa liesse, et repoussant dans le brasier, par la force des armes, les fugitifs qui hurlaient. Dans cette angoisse et cette folle exaspération, partout on tuait, on brûlait, on martyrisait des innocents...
Les poissons, la bouche douloureusement ouverte, leurs yeux d'or anxieux et fixes, s'abandonnaient avec résignation à la mort ou se débattaient contre elle avec fureur et désespoir. Comme il était arrivé maintes fois déjà il fut pris de pitié pour ces animaux et de dégoût à l'égard des hommes ; pourquoi étaient-ils si insensibles et brutaux, si immensément bêtes et stupides ; pourquoi ne voyaient-ils rien, […] pourquoi ne voyaient-ils pas ces bouches, ces yeux dans l'angoisse de la mort, ces queues frappant furieusement autour d'elles, cette affreuse et inutile lutte désespérée, cette transformation intolérable des animaux mystérieux, merveilleusement beaux, le dernier léger frisson de la mort passant sur leur peau agonisante avant qu'ils soient là, allongés, morts et éteints, lamentables morceaux de viande destinés à la table des mangeurs réjouis ? Ils ne voyaient rien, ces hommes, ils ne savaient rien et ne s'apercevaient de rien, rien ne leur parlait. Peu importait qu'une pauvre et noble bête crevât sous leurs yeux […] ; ils ne voyaient rien, rien ne les touchait. Tous ils étaient joyeux, ou occupés, se donnaient des airs d'importance, ils étaient pressés, criaient, riaient, ou rotaient les uns devant les autres, chahutaient, blaguaient, se chamaillaient pour deux liards, et tous trouvaient que tout allait bien, que tout était dans l'ordre, et tous se sentaient contents d'eux et du monde. C'étaient des cochons, ah ! bien pires, bien plus dégoûtants que des cochons.
Chapitre XII.
Chapitre XII.
C'était vraiment honteux d'être ainsi berné par la vie ; c'était à en rire et à en pleurer ! Ou bien on vivait en s'abandonnant au jeu de ses sens, […] on connaissait alors mainte noble joie, mais on restait sans protection contre l'instabilité des choses humaines ; on était alors comme un champignon dans la forêt, tout resplendissant de ses riches couleurs, mais qui, demain, pourrira. Ou bien on se mettait en défense, on s'enfermait dans un atelier, on cherchait à dresser un monument à la vie fugitive : alors il fallait renoncer à la vie, on n'était plus qu'un instrument, on se mettait bien au service de l'éternel, mais on s'y desséchait et on y perdait sa liberté, sa plénitude, sa joie de vivre […].
Et pourtant toute notre vie n'avait un sens que si on parvenait à mener à la fois ces deux existences, que si elle n'était pas brisée par ce dilemme : créer sans payer cette création du prix de sa vie ! Vivre sans pour cela renoncer au noble destin du créateur ! Était-ce donc impossible ?
Peut-être existait-il des hommes qui en étaient capables. Peut-être existait-il des époux et des pères de famille à qui la fidélité ne faisait pas perdre le sens de la volupté. Peut-être y avait-il des sédentaires dont le cœur ne se desséchait pas faute de liberté et de danger. Il se pouvait. Il n'en avait encore vu aucun.
Tout être reposait, semblait-il, sur une dualité, sur des oppositions. On était homme ou femme, chemineau ou bourgeois, intellectuel ou sentimental ; nulle part on ne trouvait ce rythme de l'inspiration et de l'expiration, on ne pouvait être à la fois homme et femme, jouir de la liberté et de l'ordre, vivre en même temps la vie de l'instinct et de l'intelligence. Toujours il fallait payer l'un de la perte de l'autre et toujours l'un était aussi précieux et désirable que l'autre.
Chapitre XVI.
Et pourtant toute notre vie n'avait un sens que si on parvenait à mener à la fois ces deux existences, que si elle n'était pas brisée par ce dilemme : créer sans payer cette création du prix de sa vie ! Vivre sans pour cela renoncer au noble destin du créateur ! Était-ce donc impossible ?
Peut-être existait-il des hommes qui en étaient capables. Peut-être existait-il des époux et des pères de famille à qui la fidélité ne faisait pas perdre le sens de la volupté. Peut-être y avait-il des sédentaires dont le cœur ne se desséchait pas faute de liberté et de danger. Il se pouvait. Il n'en avait encore vu aucun.
Tout être reposait, semblait-il, sur une dualité, sur des oppositions. On était homme ou femme, chemineau ou bourgeois, intellectuel ou sentimental ; nulle part on ne trouvait ce rythme de l'inspiration et de l'expiration, on ne pouvait être à la fois homme et femme, jouir de la liberté et de l'ordre, vivre en même temps la vie de l'instinct et de l'intelligence. Toujours il fallait payer l'un de la perte de l'autre et toujours l'un était aussi précieux et désirable que l'autre.
Chapitre XVI.
En réalité Narcisse n'ignorait nullement ce que lui offrait son ami ; il ne fermait pas les yeux à sa beauté en fleurs, à sa vitalité orientée dans le sens de la nature, à l' opulence de ses dons en plein épanouissement... Au contraire, son affection pour le blondin était trop ardente et c'était là pour lui le danger, car aimer n'était pas pour lui une fonction naturelle, mais un miracle. Il ne lui était pas permis de s'éprendre de Goldmund, de se borner à contempler avec délices ces jolis yeux, le rayonnement épanoui de ces cheveux blonds. Il ne pouvait permettre à son amour, même pour un instant, de s'attarder dans la sensualité. Car Narcisse, qui se sentait destiné pour son existence entière à la vie ascétique du moine, à l'effort vers la sainteté, était vraiment promis à une telle existence. Une seule forme d'amour lui était permise : la plus haute. Mais Narcisse ne croyait pas que Goldmund fût appelé à la vie ascétique. Il s'entendait mieux que tout autre à lire dans la conscience des hommes et ici où il aimait, les choses lui apparaissaient dans une clarté plus vive. Il discernait la véritable nature de Goldmund et la comprenait à fond, car elle était une moitié perdue de sa propre nature. Il la pénétrait, toute bardée qu'elle fût d'une solide enveloppe de chimères, fruit d'une éducation à contresens et de préceptes paternels. Il soupçonnait depuis longtemps le secret tout simple de cette jeune existence. Son devoir lui apparaissait clair ; dévoiler ce secret à celui qui en était porteur, le débarrasser de sa gangue, restituer à son ami sa nature vraie. Ce serait pénible et le plus dur était qu'il y pourrait peut-être perdre son amitié.
Il se disait que lui-même, comme tous les hommes, s'écoulait, se transformait sans cesse pour se dissoudre enfin, tandis que son image créée par l'artiste resterait immuablement la même et pour toujours.
Peut-être, pensait-il, la source de tout art et sans doute aussi de toute pensée est-elle la crainte de la mort. Nous la craignons, nous frissonnons en présence de l'instabilité des choses, nous voyons avec tristesse les fleurs se faner, les feuilles tomber chaque année, et nous sentons manifestement dans notre propre cœur que nous sommes, nous aussi, éphémères et que nous fanerons bientôt. Lorsque, comme artistes, nous créons des formes ou bien, comme penseurs, cherchons des lois ou formulons des idées, nous le faisons pour arriver tout de même à sauver quelque chose de la grande danse macabre, pour fixer quelque chose qui ait plus de durée que nous-mêmes. La femme d'après laquelle le maître a sculpté sa madone est peut-être déjà fanée ou morte et bientôt il sera mort lui-même, d'autres habiteront sa maison, mangeront à sa table, mais son œuvre restera, dans la silencieuse église du cloître elle brillera encore au bout de cent ans et bien au-delà et demeurera toujours belle, souriant toujours du même sourire triste dans son éternelle jeunesse.
Chapitre X.
Peut-être, pensait-il, la source de tout art et sans doute aussi de toute pensée est-elle la crainte de la mort. Nous la craignons, nous frissonnons en présence de l'instabilité des choses, nous voyons avec tristesse les fleurs se faner, les feuilles tomber chaque année, et nous sentons manifestement dans notre propre cœur que nous sommes, nous aussi, éphémères et que nous fanerons bientôt. Lorsque, comme artistes, nous créons des formes ou bien, comme penseurs, cherchons des lois ou formulons des idées, nous le faisons pour arriver tout de même à sauver quelque chose de la grande danse macabre, pour fixer quelque chose qui ait plus de durée que nous-mêmes. La femme d'après laquelle le maître a sculpté sa madone est peut-être déjà fanée ou morte et bientôt il sera mort lui-même, d'autres habiteront sa maison, mangeront à sa table, mais son œuvre restera, dans la silencieuse église du cloître elle brillera encore au bout de cent ans et bien au-delà et demeurera toujours belle, souriant toujours du même sourire triste dans son éternelle jeunesse.
Chapitre X.
Videos de Hermann Hesse (8)
Voir plusAjouter une vidéo
Après "Bienvenue au club", le CNL en partenariat avec Public Sénat, met en avant les conseils des lecteurs en leur donnant la parole dans l'émission #LivresetVous. Une nouvelle chronique à ne pas manquer tous les vendredi à 17h30.
Que peut nous apprendre la philosophie au quotidien?Pour répondre à cette question Guillaume Erner est accompagné de Géraldine Mosna-Savoye et d'Emmanuel Kessler. Cette semaine, David, étudiant et membre du club de lecture de l'université d'Orléans, répond au thème de l'émission en convoquant « Siddharta » de Hermann Hesse, et «l'insoutenable légèrté de l'être » de Milan Kundera.
Une émission présentée par Guillaume Erner, en partenariat avec France Culture.
#livresetvous #bienvenueauclub #publicsenat #franceculture #universitéorléans
Suivez le CNL sur son site et les réseaux sociaux :
Site officiel : www.centrenationaldulivre.fr Facebook : Centre national du livre Twitter : @LeCNL Instagram : le_cnl Linkedin : Centre national du livre
Que peut nous apprendre la philosophie au quotidien?Pour répondre à cette question Guillaume Erner est accompagné de Géraldine Mosna-Savoye et d'Emmanuel Kessler. Cette semaine, David, étudiant et membre du club de lecture de l'université d'Orléans, répond au thème de l'émission en convoquant « Siddharta » de Hermann Hesse, et «l'insoutenable légèrté de l'être » de Milan Kundera.
Une émission présentée par Guillaume Erner, en partenariat avec France Culture.
#livresetvous #bienvenueauclub #publicsenat #franceculture #universitéorléans
Suivez le CNL sur son site et les réseaux sociaux :
Site officiel : www.centrenationaldulivre.fr Facebook : Centre national du livre Twitter : @LeCNL Instagram : le_cnl Linkedin : Centre national du livre
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Romans, contes, nouvellesVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature des langues germaniques. Allemand>Romans, contes, nouvelles (879)
autres livres classés : littérature allemandeVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Hermann Hesse (71)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Hermann Hesse
Choisissez les bonnes dates ..
3 juillet 1977 - 8 août 1962
2 juillet 1877 - 9 août 1962
2 juillet 1876 - 9 août 1967
10 questions
75 lecteurs ont répondu
Thème :
Hermann HesseCréer un quiz sur ce livre75 lecteurs ont répondu