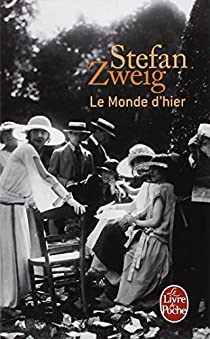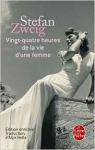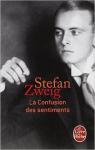Témoignage édifiant. Permet de voir la montée du nazisme avec des yeux de citoyen lambda. Il nous dit aussi que avant 1914 les passeports et l'impôt n'existait pour ainsi dire pas
Le monde d'apres est plus que jamais un sujet du moment.
Et comme l'histoire nous l'a appris, parler de demain commence par parler d'hier.
Le "monde d'hier" de Stefan Zweig apporte un point de vue complet sur la belle époque des années 1900, puis les 2 guerres mondiales qui en ont découlé.
Période d'une génération se voyant belle et forte et finissant minable par s'entretuer.
Les années 1900 ont été sans doute la période la plus prolifique de l'ère moderne dans les grands progrès scientifiques (electricité, automobile, aviation, radio, medecine, etc).
Et cette génération faisait également briller naturellement les arts (poésie, theatre, sculpture, peinture, etc) présentés comme rassembleurs d'horyzons différents (ce que les sports sont devenus de nos jours).
Ce qui ne l'a pas empêché de tomber dans le chaos.
Comment est-on allé aussi haut ? Pour tomber autant dans le chaos ?
On se rend compte au fur et à mesure du livre que la genération a créé sa propre décadence.
Elle est responsable des conditions ayant généré les problèmes, sans avoir eu les solutions pour y faire face. Plus précisement, sans se rendre compte que ses progrès scientifiques et ses arts ne sont pas des solutions suffisantes.
Ces conditions ne sont pas évidentes, ce qui explique la "naivité" de l'époque telle qu'elle est racontée. Tout comme la très probable naiveté dont on fait preuve actuellement et qui nous jouera de mauvais tours.
Parmi ces conditions, on peut noter :
- La confiance dans le progrès scientifique pour faire de l'homme un homme meilleur
Le progrès scientifique est devenu une religion.
Chaque nouvelle prouesse créé une foi aveugle dans un homme repoussant sans cesse les limites. On dirait même que c'est une foi obligeant l'homme à le faire.
- L'homme en veut toujours plus, au risque de ne plus se protéger
Si l'homme sait repousser sans cesse les limites, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'en vouloir plus ?
Cela est vrai autant dans la croissance économique ou dans la politique avec la recherche d'un pouvoir plus grand et un désir d'expansion territoriale.
Si l'homme se croit obligé de dépasser toutes les limites, il ne se protège plus. Cela en amène certains à vouloir créer le chaos et penser pouvoir le maitriser et en tirer profit.
- La liberté peut aveugler une majorité face à une minorité folle
L'appartenance au groupe est exacerbée par certains, souvent autour du thème de l'identité nationale et de la patrie .
La majorité reste indifférente à ce groupe minoritaire. Meme si ils ne sont pas d'accord avec les valeurs et comportements de ce groupe, ils se considèrent comme plus forts.
La majorité se veut superieurement sage : la sagesse de respecter la liberté des autres, de les laisser-faire tant que cela respecte leur vision relativement egoiste de la liberté : ce n'est pas un probleme si cela ne touche pas à ma liberté. Je n'attaque pas les libertés des autres, mais je ne les défend pas non plus (c'est aux autres de le faire).
Le groupe minoritaire profite de ces conditions et s'affirme alors avec de plus de fermeté et d'agressivité, franchissant alors les limites du chaos : Si l'effort de la majorité est de respecter au maximum les libertés, alors ils ne savent plus s'opposer à la liberté de certains de détruire la liberté des autres. le faire serait renier leur sagesse.
Le jour où le chaos se met en place et que le piège se referme, la majorité ne peut plus s'opposer, ils adherent par une sage abnegation (qui n'est pas d'accord, n'est pas pour la paix ou n'est pas patriotique pour sortir du chaos), la minorité est devenu majorité (souvent aidée par des etrangers pensant profiter du chaos).
Le plus navrant est que la majorité a senti le danger arriver, mais elle ne l'a pas pris assez au sérieux. Stefan Zweig dit : "il y avait du serieux dans le jeu et du jeu dans le serieux".
Ces conditions pourraient être résumées par l'oppositions des hommes à l'Homme.
Le paradoxe de l'homme n'est il pas d'etre etranger à lui-meme ? de se sentir lui-même qu'en appartenant à un groupe ?
Ou d'être étranger à lui-même en étant avec d'autres hommes qui lui sont similaires ?
L'Homme est à la fois tout et rien.
Comme les soldats de la guerre : célébrés comme héros partants à la guerre. Puis rejetés comme de simples mendiants faisant honte au pays en revenant à la fin de la guerre perdue.
L'homme opposé aux hommes,
c'est la liberté de penser différemment opposé à la necessité d'avoir une pensée commune avec les autres.
C'est la bienveillance envers les autres opposée à la flatterie.
C'est grimper la montagne au lieu d'attendre sa destruction pour la traverser,
C'est l'éternelle remise en cause opposée à l'immobilisme réconfortant.
Le livre parcourt ces thèmes au travers de la vie de son auteur.
Son enfance à bonne école à Vienne, capitale de la culture, dans un monde strict et trop hypocrite à son gout.
Ses études et sa soif de culture qui le poussent à voyager en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre et bien ailleurs.
Ses rencontres faciles et diverses qui lui font prendre confiance dans sa passion et dans la liberté.
Ses réussites inattendues comme artiste qu'il ne celebre qu'à demi-mots.
L'annonce de la premiere guerre mondiale.
Sa surprise de voir sa patrie autrichienne être heureuse de partir en guerre.
Son impuissance à faire entendre une voix pour ramener les hommes à la raison et se mefier de la guerre.
Sa vie d'après-guerre, épuisante, incertaine et traumatisante.
La montée en puissance du fascisme et du nazisme. Lentement mais surement les libertés sont cassés et le chaos s'installe.
Le dangereux jeu des autres nations pour laisser en place ces régimes à l'etranger tout en s'y opposant chez soi.
Les fausses joies des negociations de paix avec Hitler.
Son exil en Angleterre où il ne veut pas froisser un peuple immature et naif face à la guerre approchante.
Son exil encore plus lointain qui n'empeche pas la guerre d'arriver a le perturber aussi fortement.
J'ai particulierement aimé ses descriptions de la vie d'apres-guerre.
Le chaos d'après-guerre prend de multiples formes :
- chaos social : l'abandon des soldats par la patrie qui ne leur laisse pas d'autres choix que de devenir mendiants. Certains ne pouvant pas rentrer chez eux.
- chaos financier avec l'explosion des dettes de la guerre qu'il faut rembourser : l'etat fait tourner la planche à billet. Ce qui genère une inflation qui fait doubler les prix du matin au soir ! La monnaie nationale perd toute sa valeur, le troc est préféré. Les puissances etrangeres en profitent pour acheter les richesses du pays.
- chaos economique avec de multiples penuries. Que ce soit de la nourriture (on ne mange plus à sa faim), des vetements (le cuir est arraché des fauteuils pour en faire des chaussures), du chauffage (le bois et le charbon sont devenus un grand luxe pour se chauffer), le delabrement des logements (la pluie rentrait a l interieur des batiments, faute de pouvoir reparer convenablement)
Stefan Zweig parle de 3 années traumatisantes avant de voir son pays commencer à se relever (pouvoir remanger à sa faim et dormir dans un lit chaud).
La monnaie a retrouvé de la stabilité inspirant la confiance pour les marchés, l'economie s'est reconsolidé.
Mais les hommes ne sont plus aussi confiants qu'avant.
Ce traumatisme aura comme conséquence une attirance vers la nouveauté et la jeunesse. Cela débouchera sur la tentation de la jeunesse pour les nouvelles modes communistes, fascistes et nazis.
Ces regimes en prenant de l'ampleur pourront alors mettre en place leur politique de destruction de libertés pour piéger la majorité : en commenceant par exemple par la mise en place des passeports qui n'existaient pas avant la 1ere guerre mondiale. Puis, cela derivera vers l'interdiction aux juifs de s'asseoir sur un banc public et finira par la construction de camps de concentration.
Lire le livre, c est sortir de l insouciance. C est se preparer mentalement.
Ecouter les hommes sans arriver a comprendre l'homme completement.
Les hommes sont un eternel recommencement, est-ce que l'homme en est un ?
Réminiscence
Et comme l'histoire nous l'a appris, parler de demain commence par parler d'hier.
Le "monde d'hier" de Stefan Zweig apporte un point de vue complet sur la belle époque des années 1900, puis les 2 guerres mondiales qui en ont découlé.
Période d'une génération se voyant belle et forte et finissant minable par s'entretuer.
Les années 1900 ont été sans doute la période la plus prolifique de l'ère moderne dans les grands progrès scientifiques (electricité, automobile, aviation, radio, medecine, etc).
Et cette génération faisait également briller naturellement les arts (poésie, theatre, sculpture, peinture, etc) présentés comme rassembleurs d'horyzons différents (ce que les sports sont devenus de nos jours).
Ce qui ne l'a pas empêché de tomber dans le chaos.
Comment est-on allé aussi haut ? Pour tomber autant dans le chaos ?
On se rend compte au fur et à mesure du livre que la genération a créé sa propre décadence.
Elle est responsable des conditions ayant généré les problèmes, sans avoir eu les solutions pour y faire face. Plus précisement, sans se rendre compte que ses progrès scientifiques et ses arts ne sont pas des solutions suffisantes.
Ces conditions ne sont pas évidentes, ce qui explique la "naivité" de l'époque telle qu'elle est racontée. Tout comme la très probable naiveté dont on fait preuve actuellement et qui nous jouera de mauvais tours.
Parmi ces conditions, on peut noter :
- La confiance dans le progrès scientifique pour faire de l'homme un homme meilleur
Le progrès scientifique est devenu une religion.
Chaque nouvelle prouesse créé une foi aveugle dans un homme repoussant sans cesse les limites. On dirait même que c'est une foi obligeant l'homme à le faire.
- L'homme en veut toujours plus, au risque de ne plus se protéger
Si l'homme sait repousser sans cesse les limites, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'en vouloir plus ?
Cela est vrai autant dans la croissance économique ou dans la politique avec la recherche d'un pouvoir plus grand et un désir d'expansion territoriale.
Si l'homme se croit obligé de dépasser toutes les limites, il ne se protège plus. Cela en amène certains à vouloir créer le chaos et penser pouvoir le maitriser et en tirer profit.
- La liberté peut aveugler une majorité face à une minorité folle
L'appartenance au groupe est exacerbée par certains, souvent autour du thème de l'identité nationale et de la patrie .
La majorité reste indifférente à ce groupe minoritaire. Meme si ils ne sont pas d'accord avec les valeurs et comportements de ce groupe, ils se considèrent comme plus forts.
La majorité se veut superieurement sage : la sagesse de respecter la liberté des autres, de les laisser-faire tant que cela respecte leur vision relativement egoiste de la liberté : ce n'est pas un probleme si cela ne touche pas à ma liberté. Je n'attaque pas les libertés des autres, mais je ne les défend pas non plus (c'est aux autres de le faire).
Le groupe minoritaire profite de ces conditions et s'affirme alors avec de plus de fermeté et d'agressivité, franchissant alors les limites du chaos : Si l'effort de la majorité est de respecter au maximum les libertés, alors ils ne savent plus s'opposer à la liberté de certains de détruire la liberté des autres. le faire serait renier leur sagesse.
Le jour où le chaos se met en place et que le piège se referme, la majorité ne peut plus s'opposer, ils adherent par une sage abnegation (qui n'est pas d'accord, n'est pas pour la paix ou n'est pas patriotique pour sortir du chaos), la minorité est devenu majorité (souvent aidée par des etrangers pensant profiter du chaos).
Le plus navrant est que la majorité a senti le danger arriver, mais elle ne l'a pas pris assez au sérieux. Stefan Zweig dit : "il y avait du serieux dans le jeu et du jeu dans le serieux".
Ces conditions pourraient être résumées par l'oppositions des hommes à l'Homme.
Le paradoxe de l'homme n'est il pas d'etre etranger à lui-meme ? de se sentir lui-même qu'en appartenant à un groupe ?
Ou d'être étranger à lui-même en étant avec d'autres hommes qui lui sont similaires ?
L'Homme est à la fois tout et rien.
Comme les soldats de la guerre : célébrés comme héros partants à la guerre. Puis rejetés comme de simples mendiants faisant honte au pays en revenant à la fin de la guerre perdue.
L'homme opposé aux hommes,
c'est la liberté de penser différemment opposé à la necessité d'avoir une pensée commune avec les autres.
C'est la bienveillance envers les autres opposée à la flatterie.
C'est grimper la montagne au lieu d'attendre sa destruction pour la traverser,
C'est l'éternelle remise en cause opposée à l'immobilisme réconfortant.
Le livre parcourt ces thèmes au travers de la vie de son auteur.
Son enfance à bonne école à Vienne, capitale de la culture, dans un monde strict et trop hypocrite à son gout.
Ses études et sa soif de culture qui le poussent à voyager en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre et bien ailleurs.
Ses rencontres faciles et diverses qui lui font prendre confiance dans sa passion et dans la liberté.
Ses réussites inattendues comme artiste qu'il ne celebre qu'à demi-mots.
L'annonce de la premiere guerre mondiale.
Sa surprise de voir sa patrie autrichienne être heureuse de partir en guerre.
Son impuissance à faire entendre une voix pour ramener les hommes à la raison et se mefier de la guerre.
Sa vie d'après-guerre, épuisante, incertaine et traumatisante.
La montée en puissance du fascisme et du nazisme. Lentement mais surement les libertés sont cassés et le chaos s'installe.
Le dangereux jeu des autres nations pour laisser en place ces régimes à l'etranger tout en s'y opposant chez soi.
Les fausses joies des negociations de paix avec Hitler.
Son exil en Angleterre où il ne veut pas froisser un peuple immature et naif face à la guerre approchante.
Son exil encore plus lointain qui n'empeche pas la guerre d'arriver a le perturber aussi fortement.
J'ai particulierement aimé ses descriptions de la vie d'apres-guerre.
Le chaos d'après-guerre prend de multiples formes :
- chaos social : l'abandon des soldats par la patrie qui ne leur laisse pas d'autres choix que de devenir mendiants. Certains ne pouvant pas rentrer chez eux.
- chaos financier avec l'explosion des dettes de la guerre qu'il faut rembourser : l'etat fait tourner la planche à billet. Ce qui genère une inflation qui fait doubler les prix du matin au soir ! La monnaie nationale perd toute sa valeur, le troc est préféré. Les puissances etrangeres en profitent pour acheter les richesses du pays.
- chaos economique avec de multiples penuries. Que ce soit de la nourriture (on ne mange plus à sa faim), des vetements (le cuir est arraché des fauteuils pour en faire des chaussures), du chauffage (le bois et le charbon sont devenus un grand luxe pour se chauffer), le delabrement des logements (la pluie rentrait a l interieur des batiments, faute de pouvoir reparer convenablement)
Stefan Zweig parle de 3 années traumatisantes avant de voir son pays commencer à se relever (pouvoir remanger à sa faim et dormir dans un lit chaud).
La monnaie a retrouvé de la stabilité inspirant la confiance pour les marchés, l'economie s'est reconsolidé.
Mais les hommes ne sont plus aussi confiants qu'avant.
Ce traumatisme aura comme conséquence une attirance vers la nouveauté et la jeunesse. Cela débouchera sur la tentation de la jeunesse pour les nouvelles modes communistes, fascistes et nazis.
Ces regimes en prenant de l'ampleur pourront alors mettre en place leur politique de destruction de libertés pour piéger la majorité : en commenceant par exemple par la mise en place des passeports qui n'existaient pas avant la 1ere guerre mondiale. Puis, cela derivera vers l'interdiction aux juifs de s'asseoir sur un banc public et finira par la construction de camps de concentration.
Lire le livre, c est sortir de l insouciance. C est se preparer mentalement.
Ecouter les hommes sans arriver a comprendre l'homme completement.
Les hommes sont un eternel recommencement, est-ce que l'homme en est un ?
Réminiscence
Sous-titré « Souvenir d'un Européen« , le monde d'hier est un texte dense et émouvant. Cri d'alarme poussé au milieu des ténèbres de la guerre, il retrace la vie de Zweig et, suivant son histoire personnelle, montre comment l'Europe a basculé inéluctablement dans une logique destructrice.
« Il n'y avait guère de ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne. »
Zweig nous parle d'abord d'une Autriche, prospère, cultivée, insouciante, héritière d'une histoire brillante qu'on ne connait absolument pas en France, l'Empire des Habsbourg. On pourrait croire qu'il idéalise le temps de sa jeunesse.
Cependant la nostalgie du bon vieux temps n'occulte pas les défauts de cette société rigide ; Zweig ne tombe pas dans un écueil aussi facile. Ce qu'il l'intéresse est plutôt de dévoiler la fracture qui sépare deux époques d'une façon radicale et violente et fait basculer sa génération dans la barbarie.
« Entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts sont rompus. »
Au terme du XIXème siècle, l'humanité glisse sur une pente raide. L'accélération du temps conduit à des ruptures brutales et incontrôlables dans une ampleur jamais connue à l'échelle d'une seule génération. Quel contraste avec le rythme paisible de ses parents ou grands parents ! Un paradoxe ne manque pas de surprendre entre un progrès technologique inédit tandis que dans le même temps le monde sombre dans une déchéance morale brutale.
Exilé à cause de la guerre, moralement épuisé par « les chevaux livides de l'Apocalypse (qui) se sont rués à travers (son) existence« , Stefan Zweig nous donne ce texte comme un testament en 1941 avant de mettre fin à ses jours.
Il ne s'agit pas d'un livre de plus dans la grande production de Zweig, mais bien d'un cri du coeur et, plus encore, d'un devoir : « Si, par notre témoignage, nous transmettons à la génération qui vient ne serait-ce qu'une parcelle de vérité, vestige de cet édifice effondré, nous n'aurons pas oeuvré tout à fait en vain.«
Si on s'intéresse plus à la biographie de Zweig, le lecteur risque d'avoir le tournis devant la liste des éminents personnages qu'il fréquente : des compositeurs comme Johannes Brahms, Richard Strauss, beaucoup d'écrivains et de poètes comme Paul Valéry, Jules Romain, Gide, Rainer Maria Rilke, Yeats, Claudel, Gorki, Arthur Schnitzler, Anatole France, Pirandello, Bernard Shaw, H.G. Wells, des hommes politiques tels Walter Rathenau, Théodore Herzl, et bien d'autres artistes ou intellectuels comme Freud ou Rodin.
Loin d'un simple « name droping », Zweig montre le lien quasi affectif qui le liait à chacun d'entre eux. D'une anecdote à l'autre, se dessine la carte d'amitiés solides qui traversent les disciplines et les pays.
« Vous êtes un homme libre, mettez à profit cette liberté ! »
Alors qu'il parcourait l'Europe avec cette facilité que nous n'avons plus connu qu'après les accords de Shengen, sur l'invitation de Rathenau, Zweig se lance à la découverte du monde. Puis survient 1914, l'enfermement commence. Les frontières font leur apparition et ne s'effaceront plus pour des générations. La montée du nazisme poursuivant le triste travail de la première guerre mondiale définit les contours dramatiques d'une bascule de l'homme moderne dans la barbarie.
Sans se limiter à cette peinture de son époque, Zweig nous donne aussi un accès à ses propres questionnements, aborde discrètement sa vie familiale et parle de ses succès littéraires. Au passage, alors qu'il évoque ses propres ouvrages, apparait la clé de sa méthode d'écriture, combinaison de travail documentaire pointilleux et de condensation littéraire (qu'il nomme « l'art du renoncement« ).
Texte brillant et passionnant sur lequel il y aurait tant à dire, j'ai cherché la raison pour laquelle, le monde d'hier reste d'actualité et nous parle encore.
Zweig livre ici de façon pressante un témoignage historique et une dénonciation des sectarismes politiques. Une urgence qui ne détonne plus dans notre Europe malmenée et rappelle le texte brillant de Guglielmo Ferrero, La Ruine de la civilisation antique.
Le monde d'hier est définitivement un ouvrage essentiel qui mériterait être inscrit au programme de nos lycées. C'est là que se trouve la « génération qui vient » citée plus haut, et qu'il convient de ne pas laisser dans l'ignorance.
T. Sandorf
Lien : https://thomassandorf.wordpr..
« Il n'y avait guère de ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne. »
Zweig nous parle d'abord d'une Autriche, prospère, cultivée, insouciante, héritière d'une histoire brillante qu'on ne connait absolument pas en France, l'Empire des Habsbourg. On pourrait croire qu'il idéalise le temps de sa jeunesse.
Cependant la nostalgie du bon vieux temps n'occulte pas les défauts de cette société rigide ; Zweig ne tombe pas dans un écueil aussi facile. Ce qu'il l'intéresse est plutôt de dévoiler la fracture qui sépare deux époques d'une façon radicale et violente et fait basculer sa génération dans la barbarie.
« Entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts sont rompus. »
Au terme du XIXème siècle, l'humanité glisse sur une pente raide. L'accélération du temps conduit à des ruptures brutales et incontrôlables dans une ampleur jamais connue à l'échelle d'une seule génération. Quel contraste avec le rythme paisible de ses parents ou grands parents ! Un paradoxe ne manque pas de surprendre entre un progrès technologique inédit tandis que dans le même temps le monde sombre dans une déchéance morale brutale.
Exilé à cause de la guerre, moralement épuisé par « les chevaux livides de l'Apocalypse (qui) se sont rués à travers (son) existence« , Stefan Zweig nous donne ce texte comme un testament en 1941 avant de mettre fin à ses jours.
Il ne s'agit pas d'un livre de plus dans la grande production de Zweig, mais bien d'un cri du coeur et, plus encore, d'un devoir : « Si, par notre témoignage, nous transmettons à la génération qui vient ne serait-ce qu'une parcelle de vérité, vestige de cet édifice effondré, nous n'aurons pas oeuvré tout à fait en vain.«
Si on s'intéresse plus à la biographie de Zweig, le lecteur risque d'avoir le tournis devant la liste des éminents personnages qu'il fréquente : des compositeurs comme Johannes Brahms, Richard Strauss, beaucoup d'écrivains et de poètes comme Paul Valéry, Jules Romain, Gide, Rainer Maria Rilke, Yeats, Claudel, Gorki, Arthur Schnitzler, Anatole France, Pirandello, Bernard Shaw, H.G. Wells, des hommes politiques tels Walter Rathenau, Théodore Herzl, et bien d'autres artistes ou intellectuels comme Freud ou Rodin.
Loin d'un simple « name droping », Zweig montre le lien quasi affectif qui le liait à chacun d'entre eux. D'une anecdote à l'autre, se dessine la carte d'amitiés solides qui traversent les disciplines et les pays.
« Vous êtes un homme libre, mettez à profit cette liberté ! »
Alors qu'il parcourait l'Europe avec cette facilité que nous n'avons plus connu qu'après les accords de Shengen, sur l'invitation de Rathenau, Zweig se lance à la découverte du monde. Puis survient 1914, l'enfermement commence. Les frontières font leur apparition et ne s'effaceront plus pour des générations. La montée du nazisme poursuivant le triste travail de la première guerre mondiale définit les contours dramatiques d'une bascule de l'homme moderne dans la barbarie.
Sans se limiter à cette peinture de son époque, Zweig nous donne aussi un accès à ses propres questionnements, aborde discrètement sa vie familiale et parle de ses succès littéraires. Au passage, alors qu'il évoque ses propres ouvrages, apparait la clé de sa méthode d'écriture, combinaison de travail documentaire pointilleux et de condensation littéraire (qu'il nomme « l'art du renoncement« ).
Texte brillant et passionnant sur lequel il y aurait tant à dire, j'ai cherché la raison pour laquelle, le monde d'hier reste d'actualité et nous parle encore.
Zweig livre ici de façon pressante un témoignage historique et une dénonciation des sectarismes politiques. Une urgence qui ne détonne plus dans notre Europe malmenée et rappelle le texte brillant de Guglielmo Ferrero, La Ruine de la civilisation antique.
Le monde d'hier est définitivement un ouvrage essentiel qui mériterait être inscrit au programme de nos lycées. C'est là que se trouve la « génération qui vient » citée plus haut, et qu'il convient de ne pas laisser dans l'ignorance.
T. Sandorf
Lien : https://thomassandorf.wordpr..
Ce livre est un compte-rendu de la vie de Zweig voire un testament Il nous présente une vue partielle de l'Europe du début du siècle dernier avec une « Autriche » rayonnante au centre de l'Europe
Pour résumer : Zweig aborde sa scolarité insatisfaisante sur le plan personnel et intellectuel, la sexualité niée des homme et femmes, la liberté de l'individu et l' humanisme des arts, le chaos qui a suivi la première guerre mondiale, le délitement de l'Europe et son Suicide.
C'est le regard crédule et désenchanté (à l'approche de la seconde guerre mondiale) d'un grand rêveur qui n'a qu'une connaissance, semble-t-il, très limitée de la vie: celle de son entourage immédiat c'est-à-dire un monde bourgeois riche, cultivé, humaniste très déconnecté du réel
« L'âge d'or de la sécurité » un point de vue de bourgeois confortement installé dans la vie qui ne souffre ni de problèmes d'argent ni de fin de mois difficiles , qui voyage d'un pays à l'autre, étudiant, consommant les belles choses, fréquentant l'élite aisée européenne de l'Europe
Une vision naïve de la vie et des hommes ( il en est conscient d'ailleurs et le dit) qui privilégie des centres d'intérêts comme les arts surtout et la politique .
il lui semble que le monde de la fin du XIX est en bonne voie car des intellectuels travaillent à la création d'un monde humain mais prend bien tardivement conscience que ce monde périclite. Encore a-t-il du mal à l'admettre pourtant il a quand même été plus clairvoyant que nombre de ses contemporains ce qui prouve sa clairvoyance
Dans cet ouvrage il fait preuve d'une méconnaissance assez surprenante de ses contemporains (du moins ceux qui n'appartiennent pas à son monde et ils sont nombreux ) ainsi que de l'état du monde. Une cécité qu'il est difficile d'expliquer car Zweig est un fin psychologue, un fin observateur de la nature humaine et très bon narrateur ( ses nouvelles le prouvent) donc s'il méconnait et fait l'impasse sur un sujet c'est qu'il le fait pertinemment
Il a infiniment plus de plaisir à écrire dans sa chronique de belles choses, sublimées, sur les grands de ce monde Rodin, Romain Rolland, Verhaeren, Gorki, Freud, du beau linge ainsi que sur les belles villes visitées que de s'appesantir sur des sujets moins séduisants notamment le social au sens large et la misère.
En excluant socialement des pans entiers de l'humanité dans sa chronique, en occultant des descriptions de la pauvreté il oublie sa fonction de chroniqueur, de témoin .En ne présentant qu'une petite facette de la société , facette minime d'une société privilégiée, il falsifie la réalité et abuse le lecteur.
C'est un témoignage qu'il veut transmettre et rien d'autre et celui-ci ne peut être choisi et fragmentaire.
C'est dit-il « le destin de toute une génération » il ajoute « …Mais si par notre témoignage nous transmettons à la génération qui vient ne serait- ce qu'une parcelle de vérité vestige de cet édifice effondré nous n'aurons pas oeuvrés en vain »… parcelle de vérité certes mais laquelle ? Est-ce du cynisme de la part de Zweig de nous donner qu'une vérité partielle celle qui l'intéresse et qui ne constitue pas un témoignage probant de l'état du monde ?
Il faut préférer Zweig narrateur de nouvelles (elles sont excellentes) à celui de chroniqueur. Toutefois son talent pour l'écriture ne l' excuse malheureusement pas de nous avoir livré une histoire dénaturée… bien au contraire ...surtout sachant qu'il allait mettre fin à ses jours.
Le livre de trop !
Pour résumer : Zweig aborde sa scolarité insatisfaisante sur le plan personnel et intellectuel, la sexualité niée des homme et femmes, la liberté de l'individu et l' humanisme des arts, le chaos qui a suivi la première guerre mondiale, le délitement de l'Europe et son Suicide.
C'est le regard crédule et désenchanté (à l'approche de la seconde guerre mondiale) d'un grand rêveur qui n'a qu'une connaissance, semble-t-il, très limitée de la vie: celle de son entourage immédiat c'est-à-dire un monde bourgeois riche, cultivé, humaniste très déconnecté du réel
« L'âge d'or de la sécurité » un point de vue de bourgeois confortement installé dans la vie qui ne souffre ni de problèmes d'argent ni de fin de mois difficiles , qui voyage d'un pays à l'autre, étudiant, consommant les belles choses, fréquentant l'élite aisée européenne de l'Europe
Une vision naïve de la vie et des hommes ( il en est conscient d'ailleurs et le dit) qui privilégie des centres d'intérêts comme les arts surtout et la politique .
il lui semble que le monde de la fin du XIX est en bonne voie car des intellectuels travaillent à la création d'un monde humain mais prend bien tardivement conscience que ce monde périclite. Encore a-t-il du mal à l'admettre pourtant il a quand même été plus clairvoyant que nombre de ses contemporains ce qui prouve sa clairvoyance
Dans cet ouvrage il fait preuve d'une méconnaissance assez surprenante de ses contemporains (du moins ceux qui n'appartiennent pas à son monde et ils sont nombreux ) ainsi que de l'état du monde. Une cécité qu'il est difficile d'expliquer car Zweig est un fin psychologue, un fin observateur de la nature humaine et très bon narrateur ( ses nouvelles le prouvent) donc s'il méconnait et fait l'impasse sur un sujet c'est qu'il le fait pertinemment
Il a infiniment plus de plaisir à écrire dans sa chronique de belles choses, sublimées, sur les grands de ce monde Rodin, Romain Rolland, Verhaeren, Gorki, Freud, du beau linge ainsi que sur les belles villes visitées que de s'appesantir sur des sujets moins séduisants notamment le social au sens large et la misère.
En excluant socialement des pans entiers de l'humanité dans sa chronique, en occultant des descriptions de la pauvreté il oublie sa fonction de chroniqueur, de témoin .En ne présentant qu'une petite facette de la société , facette minime d'une société privilégiée, il falsifie la réalité et abuse le lecteur.
C'est un témoignage qu'il veut transmettre et rien d'autre et celui-ci ne peut être choisi et fragmentaire.
C'est dit-il « le destin de toute une génération » il ajoute « …Mais si par notre témoignage nous transmettons à la génération qui vient ne serait- ce qu'une parcelle de vérité vestige de cet édifice effondré nous n'aurons pas oeuvrés en vain »… parcelle de vérité certes mais laquelle ? Est-ce du cynisme de la part de Zweig de nous donner qu'une vérité partielle celle qui l'intéresse et qui ne constitue pas un témoignage probant de l'état du monde ?
Il faut préférer Zweig narrateur de nouvelles (elles sont excellentes) à celui de chroniqueur. Toutefois son talent pour l'écriture ne l' excuse malheureusement pas de nous avoir livré une histoire dénaturée… bien au contraire ...surtout sachant qu'il allait mettre fin à ses jours.
Le livre de trop !
Un récit autobiographique et historique où l'auteur retrace tant sa vie, ses succès, ses rencontres, ses joies, ses échecs, ses peines, etc. que les affres de cette époque. Depuis son enfance dans un monde aisé et sécurisé, dans l'empire séculaire autrichien, jusqu'à l'exil à l'aube de la Seconde Guerre. Il connait en effet les deux guerres, en souffre atrocement, à la fois en temps qu'Européen convaincu et pacifiste de la première heure et à la fois en tant que juif. Ce récit, ce retour sur soi et sur ces sombres pages de l'histoire est poignant, intéressant et d'autant plus marquant quand on sait que cet ouvrage précède son suicide.
Le monde d'hier est un livre fascinant qui parle d'un monde disparu, celui de Zweig né sous l'empire Austro-hongrois tout comme son ami Josef Roth.
Ce livre cultive peut-être une nostalgie d'un monde serein.C est pourquoi sans doute Zweig ne lui résistera pas.
Face aux dechainements et atrocites que L Histoire va connaître.
A voir aussi adapté au théâtre avec Jérôme Kirsch, à travers lui, on entend Stefan Zweig nous parler
Ce livre cultive peut-être une nostalgie d'un monde serein.C est pourquoi sans doute Zweig ne lui résistera pas.
Face aux dechainements et atrocites que L Histoire va connaître.
A voir aussi adapté au théâtre avec Jérôme Kirsch, à travers lui, on entend Stefan Zweig nous parler
Le monde d'hier est à la fois un témoignage, une autobiographie de Stefan Zweig, ainsi qu'un essai sur son temps. La lecture est agréable, on sent l'amitié d'un auteur humaniste et raffiné. Ce livre est une fenêtre originale sur la période de la fin du 19e jusqu'à 1941 : on peut connaître une période à partir des faits, mais aussi par le souvenir de ceux qui l'ont vécue. Par cet ouvrage, on est donc immergé dans cette période avec ses réjouissances et ses avancées, mais surtout, et c'est le thème du livre, avec ses décadences et ses retours en arrière. le livre n'est pas si pessimiste que cela car il montre les réelles richesses de cette époque : les amitiés, les artistes, les quelques progrès politiques. Mais il est certain que le point de fuite reste la victoire du nazisme, d'autant plus anxiogène quand on sait que l'auteur se suicidera quelques mois après la fin de la rédaction de l'ouvrage.
Escrito en 1941, El mundo de ayer nos cuenta en clave autobiográfica cómo cambió el mundo del vienés Stefan Zweig (1881-1942) desde su infancia hasta casi su final. Lo más interesante del libro es que nos ayuda a relativizar nuestro mundo y a comprender nuestro pasado. Todos pensamos que vivimos en un mundo que ha sufrido cambios impensables que solo la ciencia ficción había previsto. Sin embargo, cuando lees este libro, te das cuenta que los cambios que vivió el autor son mucho mayores que los nuestros: el nacimiento del automóvil, del cine, del teléfono, del avión en relación a la técnica; las armas nuevas y destructivas desconocidas hasta entonces respecto a la guerra; el paso de una sociedad jerárquica y autoritaria a las primeras democracias; el derrumbamiento del imperio austrohúngaro y el surgimiento de los pequeños estados nación; y por último, el triunfo del nacionalsocialismo y la destrucción de la civilización occidental. Zweig creía que este iba a ser el final y por eso decidió suicidarse. Por fortuna se equivocó. Gracias a su libro podemos ser más conscientes hoy de la riqueza que el mundo contiene y de los peligros que lo acechan. Una lectura muy recomendable en un mundo que también ahora parece tambalearse.
Dans cet ouvrage Zweig se souvient et souligne pour son lecteur combien, alors qu'un spectateur ordinaire pourrait croire l'histoire du monde linéaire, qu'une vie comme la sienne est d'abord une traversée des mondes qui se succèdent bien plus simplement que des événements quotidiens.
Dans ces temps troublés que connaît notre vieille Europe, lire « le monde d' hier » est un bonheur.
Zweig, avec talent, pondération et sincérité, évoque ses jeunes années enchantées, l' horreur de la première guerre, l' espoir de la paix retrouvée et la montée du nazisme.
Un testament intellectuel superbement écrit par un de nos plus grands écrivains.
Un chef-d'oeuvre, à ne pas oublier, à l' aube d' un bouleversement mondial.
Zweig, avec talent, pondération et sincérité, évoque ses jeunes années enchantées, l' horreur de la première guerre, l' espoir de la paix retrouvée et la montée du nazisme.
Un testament intellectuel superbement écrit par un de nos plus grands écrivains.
Un chef-d'oeuvre, à ne pas oublier, à l' aube d' un bouleversement mondial.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Stefan Zweig (177)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le joueur d'échec de Zweig
Quel est le nom du champion du monde d'échecs ?
Santovik
Czentovick
Czentovic
Zenovic
9 questions
1898 lecteurs ont répondu
Thème : Le Joueur d'échecs de
Stefan ZweigCréer un quiz sur ce livre1898 lecteurs ont répondu