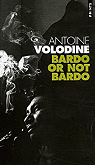Critiques de Antoine Volodine (236)
Alors que l'époque pousse toujours plus au bilan, confortant l'hypothèse auto-destructive d'une Fin de la Littérature, polarisant un spectre national réduit à sa plus petite expression, partagé entre un aride libidineux aux frustrations toujours plus réactionnaires, et une pétroleuse racialiste jalousant sa boite d'allumettes, demandant à chacun d'y choisir son camp, le non-alignement apparait comme la seule voie raisonnable…
…
Volodine devrait s'y substituer et incarner ce chemin.
Laissons de côté l'affect et la subjectivité.
Voici une Oeuvre, initiée il y a presque quarante années, se bâtissant sous nos yeux inattentifs et fatigués, édifice aux composants bien équilibrés, dont l'élément en question y figure comme première arche — point de passage soutenant tout ce qui suivra — premier livre aux intimidantes Editions de Minuit, venant après quatre romans chez Denoël simplement étiquetés « science-fiction ».
…
La cohérence de cet ensemble patiemment construit est telle que l'on ne sait pas bien quoi en faire.
On lui donne parfois un prix : ici le Médicis, là le Wepler ; on écrit quelques articles ; on l'affuble de chaman ; on le regarde un peu de biais ; puis on l'oublie à nouveau.
Ce ne sera sans doute pas le dernier à être quelque peu boudé de son vivant.
Sans doute, fait-il un peu peur.
…
Alors que les genres littéraires ne correspondent plus qu'à des cibles visées, catégories spectrales d'une civilisation individuelle et publicitaire, Volodine se propose d'en agréger un nouveau.
Ce roman en fournit les premiers jalons.
Paradoxe, encore : ce ne sont pas des inventions, mais bien la révélation de formes anciennes auxquelles le créateur redonne vie en les réorganisant.
…
Un roman dont l'apparente complexité s'expliquera bien plus tard ; où certaines formes seront ré-employées, clarifiées, quand d'autres resteront à quai, parenthèse lusophile nous rappelant les talents de traducteur du bonhomme : tels « Soufre » de José Luís Peixoto, « Dribble » de Sergio Rodrigues, etc.
Un roman qui se lirait comme le premier, alors qu'on en a déjà tant parcouru, rempli des fantômes de Rosa Luxemburg et de la Bande à Baader, bien que ta mère reste sauve.
…
Mais réjouissons-nous : vous disposez d'encore tant de temps pour venir visiter cette cité… à défaut de l'entreprendre… encore moins de la « faire »…
À bientôt.
…
Volodine devrait s'y substituer et incarner ce chemin.
Laissons de côté l'affect et la subjectivité.
Voici une Oeuvre, initiée il y a presque quarante années, se bâtissant sous nos yeux inattentifs et fatigués, édifice aux composants bien équilibrés, dont l'élément en question y figure comme première arche — point de passage soutenant tout ce qui suivra — premier livre aux intimidantes Editions de Minuit, venant après quatre romans chez Denoël simplement étiquetés « science-fiction ».
…
La cohérence de cet ensemble patiemment construit est telle que l'on ne sait pas bien quoi en faire.
On lui donne parfois un prix : ici le Médicis, là le Wepler ; on écrit quelques articles ; on l'affuble de chaman ; on le regarde un peu de biais ; puis on l'oublie à nouveau.
Ce ne sera sans doute pas le dernier à être quelque peu boudé de son vivant.
Sans doute, fait-il un peu peur.
…
Alors que les genres littéraires ne correspondent plus qu'à des cibles visées, catégories spectrales d'une civilisation individuelle et publicitaire, Volodine se propose d'en agréger un nouveau.
Ce roman en fournit les premiers jalons.
Paradoxe, encore : ce ne sont pas des inventions, mais bien la révélation de formes anciennes auxquelles le créateur redonne vie en les réorganisant.
…
Un roman dont l'apparente complexité s'expliquera bien plus tard ; où certaines formes seront ré-employées, clarifiées, quand d'autres resteront à quai, parenthèse lusophile nous rappelant les talents de traducteur du bonhomme : tels « Soufre » de José Luís Peixoto, « Dribble » de Sergio Rodrigues, etc.
Un roman qui se lirait comme le premier, alors qu'on en a déjà tant parcouru, rempli des fantômes de Rosa Luxemburg et de la Bande à Baader, bien que ta mère reste sauve.
…
Mais réjouissons-nous : vous disposez d'encore tant de temps pour venir visiter cette cité… à défaut de l'entreprendre… encore moins de la « faire »…
À bientôt.
« Après tout, pour cet ultime pétillement d'agonie, plutôt que visionner le film de ma vie, cette suite apocalyptique que je connais par cœur et qui ne m'apportera aucun plaisir de découverte, autant composer un roman. Un petit roman hurlé en accéléré, à toute vitesse. A la va-vite. (...) Voyager une dernière fois. Dire tout, inventer tout, ne pas s'affoler en face de l'indicible. C'est dans mes cordes. Et vu comme ça, au jugé, je dispose d'une seconde. J'ai donc tout mon temps. »
Le prologue pose clairement le cadre. Le narrateur, un soldat nommé Sam, va mourir brûlé dans les flammes du napalm. Aucune échappatoire possible, aucune fuite possible. Et dans la seconde qui lui reste à vivre, il va inventer un monde autre, marqué par le feu qui s'apprête à le tuer, et se donner ainsi une autre vie pleine d'autres souvenirs ; la vitesse de l'action se décalant totalement avec la vitesse de la narration qui elle se dilate. Comme Shéhérazade racontant des histoires pour échapper à la mort, Sam étire le temps de son récit dans un déploiement narratif qui brouille tous les repères classiques.
Les chapitres portent le nom d'un membre de sa foutraque famille imaginaire, quasiment que des femmes puissantes, toutes sorcières et magiciennes dont les apparitions semblent venues du fonds des temps pour lui donner des leçons de feu afin de l'aider à s'accoutumer à son destin : entrer dans le feu tout en continuant à y exister, « faire l'éternité entre deux flammes », le Graal.
Chaque tante, grand-mère, oncle ou cousine est associé à une scène à l'action fugace comme la flamme d'une allumette que l'on vient de gratter, mais qui laisse une empreinte forte et visuelle dans la tête du lecteur : un féroce oiseau de feu, une collection d'homoncules qui se collent contre le verre de leur boîte-prison, un étrange voyage initiatique sur une voie ferrée au cœur d'une montagne accessible après une longue chevauchée dans les steppes.
C'est ma première incursion dans l'œuvre post-exotique de Volodine. Je n'ai pas cherché à comprendre ce qui m'était raconté ou à y chercher une lecture psychanalytique ou métaphorique. Je me suis laissée porter par la superbe écriture chamanique de l'auteur, je me suis mise « en mode onirique » comme certains personnages dans le livre. J'entendais la voix du narrateur comme s'il narrait à haute voix un très vieux conte plein de sagesse, de malice, de cauchemar et de poésie.
Et j'ai aimé cette expérience à la fois inclassable et stimulante. J'ai aimé cet ailleurs littéraire qui convoque un imaginaire très excitant, m'évoquant l'univers d'Enki Bilal avec en bande-son lancinante et mystique le This is the end des Doors, susurré et hurlé par Jim Morrison.
La fin m'a totalement décontenancée car je ne l'ai pas vue arriver, j'avais l'impression qu'il me restait encore plein de pages à lire. C'était brutal, et j'étais déçue qu'elle ne revienne pas factuellement sur le prologue en le complétant ou apportant une réponse. J'attendais bêtement un bouquet final classique. En relisant les dernières pages, je les ai finalement trouvées certes frustrantes, mais cohérentes, en écho à la dernière seconde qu'il reste à vivre à Sam. Des dernières gouttes de vie à suspendre pour l'éternité.
Le prologue pose clairement le cadre. Le narrateur, un soldat nommé Sam, va mourir brûlé dans les flammes du napalm. Aucune échappatoire possible, aucune fuite possible. Et dans la seconde qui lui reste à vivre, il va inventer un monde autre, marqué par le feu qui s'apprête à le tuer, et se donner ainsi une autre vie pleine d'autres souvenirs ; la vitesse de l'action se décalant totalement avec la vitesse de la narration qui elle se dilate. Comme Shéhérazade racontant des histoires pour échapper à la mort, Sam étire le temps de son récit dans un déploiement narratif qui brouille tous les repères classiques.
Les chapitres portent le nom d'un membre de sa foutraque famille imaginaire, quasiment que des femmes puissantes, toutes sorcières et magiciennes dont les apparitions semblent venues du fonds des temps pour lui donner des leçons de feu afin de l'aider à s'accoutumer à son destin : entrer dans le feu tout en continuant à y exister, « faire l'éternité entre deux flammes », le Graal.
Chaque tante, grand-mère, oncle ou cousine est associé à une scène à l'action fugace comme la flamme d'une allumette que l'on vient de gratter, mais qui laisse une empreinte forte et visuelle dans la tête du lecteur : un féroce oiseau de feu, une collection d'homoncules qui se collent contre le verre de leur boîte-prison, un étrange voyage initiatique sur une voie ferrée au cœur d'une montagne accessible après une longue chevauchée dans les steppes.
C'est ma première incursion dans l'œuvre post-exotique de Volodine. Je n'ai pas cherché à comprendre ce qui m'était raconté ou à y chercher une lecture psychanalytique ou métaphorique. Je me suis laissée porter par la superbe écriture chamanique de l'auteur, je me suis mise « en mode onirique » comme certains personnages dans le livre. J'entendais la voix du narrateur comme s'il narrait à haute voix un très vieux conte plein de sagesse, de malice, de cauchemar et de poésie.
Et j'ai aimé cette expérience à la fois inclassable et stimulante. J'ai aimé cet ailleurs littéraire qui convoque un imaginaire très excitant, m'évoquant l'univers d'Enki Bilal avec en bande-son lancinante et mystique le This is the end des Doors, susurré et hurlé par Jim Morrison.
La fin m'a totalement décontenancée car je ne l'ai pas vue arriver, j'avais l'impression qu'il me restait encore plein de pages à lire. C'était brutal, et j'étais déçue qu'elle ne revienne pas factuellement sur le prologue en le complétant ou apportant une réponse. J'attendais bêtement un bouquet final classique. En relisant les dernières pages, je les ai finalement trouvées certes frustrantes, mais cohérentes, en écho à la dernière seconde qu'il reste à vivre à Sam. Des dernières gouttes de vie à suspendre pour l'éternité.
Volodine est un auteur du siècle passé, écrivant pour les siècles à venir.
On se méprend souvent sur son compte ; on le croirait ici ou là, alors qu’il est de l’autre côté.
Il ne ricane pas pour autant ; il continue son oeuvre, post-exotique, concentré de folklore et de débris, de statues oubliées et d’insectes habités, racontant la beauté dans la laideur chez le genre humain.
Il est commissaire des paradoxes oxymoriques.
Son écriture respire la simplicité, acquise à la suite de très longues séances d’isolation, dans la plus complète obscurité sensorielle.
Dans chacun de ses livres, il réussi à renouveler un genre personnel qui pourrait s’affadir plus rapidement qu’il n’est possible de l’oublier.
…
Ici, point de narrats, romånce, ou entrevoutes, mais bien d’un roman, d’une taille appréciable, à la structure bien charpentée, suivant un processus narratif auto-destructeur, non-fiable mais assurément vrai, d’une tessiture de rêve qui ne se déclarerait plus comme cauchemar.
Il faut bien tout cela pour nous entretenir de génocides et de viols.
Quand la vengeance revêt une importance plus grande que l’acte dont elle se nourri. Processus millénaire à en devenir naturel.
Le langage comme mémoire servant à raconter, soigner et se souvenir, mais peut-être pas à guérir.
La beauté de ces lignes restant une forme d’essai à s’en approcher, une sombre scansion sans dieux pour l’entendre, recouvertes sous les ruines permanentes de la Révolution Mondiale.
…
Un roman, où Volodine se plonge plus que d’usuel dans de profondes mises en abîme, brodées de lentins tigrés et de chiffres magiques, éclipsant le chamane de son écriture, s’achevant à l’envie d’un trivial : « Volomar m’a tuer ».
…
Assurant lui-même la quatrième, Volodine confirme tout ce que nous ignorions, diluant les genres, ethnies et histoires dans un sombre chaudron nommé humanité.
On se méprend souvent sur son compte ; on le croirait ici ou là, alors qu’il est de l’autre côté.
Il ne ricane pas pour autant ; il continue son oeuvre, post-exotique, concentré de folklore et de débris, de statues oubliées et d’insectes habités, racontant la beauté dans la laideur chez le genre humain.
Il est commissaire des paradoxes oxymoriques.
Son écriture respire la simplicité, acquise à la suite de très longues séances d’isolation, dans la plus complète obscurité sensorielle.
Dans chacun de ses livres, il réussi à renouveler un genre personnel qui pourrait s’affadir plus rapidement qu’il n’est possible de l’oublier.
…
Ici, point de narrats, romånce, ou entrevoutes, mais bien d’un roman, d’une taille appréciable, à la structure bien charpentée, suivant un processus narratif auto-destructeur, non-fiable mais assurément vrai, d’une tessiture de rêve qui ne se déclarerait plus comme cauchemar.
Il faut bien tout cela pour nous entretenir de génocides et de viols.
Quand la vengeance revêt une importance plus grande que l’acte dont elle se nourri. Processus millénaire à en devenir naturel.
Le langage comme mémoire servant à raconter, soigner et se souvenir, mais peut-être pas à guérir.
La beauté de ces lignes restant une forme d’essai à s’en approcher, une sombre scansion sans dieux pour l’entendre, recouvertes sous les ruines permanentes de la Révolution Mondiale.
…
Un roman, où Volodine se plonge plus que d’usuel dans de profondes mises en abîme, brodées de lentins tigrés et de chiffres magiques, éclipsant le chamane de son écriture, s’achevant à l’envie d’un trivial : « Volomar m’a tuer ».
…
Assurant lui-même la quatrième, Volodine confirme tout ce que nous ignorions, diluant les genres, ethnies et histoires dans un sombre chaudron nommé humanité.
"En te promenant dans ton propre pays, voyant tes voisins et même ton cadavre, tu penseras douloureusement :
"me voilà donc mort" !"
(Bardo Thödol, le Livre Tibétain des Morts)
C'est la fin du monde tel qu'on ne le connait même pas.
La fin de la Deuxième Union Soviétique dont la capitale Orbise s'est effondrée. La nature a repris ses droits sur le monde dévasté par la guerre et les radiations, mais ce n'est plus la même nature. Les gens errent dans cet étrange décor, entre la sauvagerie du néant et les camps militaires dont on ne connaît pas l'emplacement exact, mais ce ne sont plus les mêmes gens.
Rien n'est comme avant. Même pas les corbeaux... surtout les corbeaux !
Dans les herbes hautes de la steppe - la valdelame-à-bouclettes, la clé-de-chine, la talmazine, l'octroie - se cachent trois déserteurs. Deux ex-vaillants ex-soldats Iliouchenko et Kronauer, et Vassilissa Marachvili. Irradiés jusqu'aux os. Vassia est mourante. Impossible de se ravitailler au kolkhoze abandonné qui est tout près, car un bizarre train militaire vient de s'arrêter devant son portail.
Kronauer va alors braver les dangers de la taïga pour chercher de l'aide. La taïga dont les mousses luisent dans l'obscurité et dont les arbres hurlent à l'intérieur de votre tête...
... et il trouve Terminus Radieux.
Un kolkhoze dont le temps de gloire est passé, suspendu entre "avant" et "maintenant"; entre "être" et "non-être". L'immortelle mémé Oudgoul y parle à la pile nucléaire en lui offrant des vestiges des temps passés, et en tournant les boutons de sa vieille radio dans l'espoir de capter encore quelques slogans de l'ancienne propagande. Il y a aussi le président Solovieï, moujik sorcier, grand marionnettiste des choses prétendument vivantes. Et ses trois étranges filles.
Kronauer va devenir une sorte d'élu qui va jouer un rôle dans le destin de Terminus Radieux, mais y a t-il encore un Destin ? Quand on se pique avec l'aiguille d'un phonographe dont les rouleaux contiennent les mélopées chamaniques du thaumaturge Solovieï, que devient la réalité ?
Sommes nous vraiment vivants, ou errons-nous dans le bardo, cet état entre deux états, entre la vie et la mort, dans une rêverie sans fin, sans durée... le corbeau vous le dira. Peut-être.
"Terminus Radieux" est une trouvaille inattendue. Je n'ai encore jamais lu un livre similaire (même le terme "réalisme magique" paraît bien fade), et ce n'est pas étonnant. C'est un roman "post-exotique", un courant créé par Volodine lui même et entretenu sous ses différents pseudos. Volodine ? Kronauer ? Tout est subtilement entremêlé entre la réalité et la fiction, le présent physique et le rêve. 49 livres de 49 chapitres (autant que les jours d'errance dans le bardo tibétain) qui vous feront entrer dans des vases communicants entre ici et là-bas. Au corbeau de vous guider, mais attention ! Il peut s'immiscer dans votre tête pour vous raconter des mensonges...
Cela peut paraître incroyable, mais si vous décidez de jouer le jeu, le livre se lit sans effort. Volodine a réussi à créer un monde très poétique non seulement dans ses évocations d'images, mais aussi dans cette mixture de l'aventure post-apocalyptique classique avec des mondes oniriques où les corps et les esprits errent pour se recroiser dans d'autres lieux, d'autres temps et d'autres contextes, pour évoquer leurs souvenirs d'autrefois. La nature, culture et littérature inventées de toutes pièces font pendant à la culture ancienne, les bylines et contes de fée russes. Palais illusoires, oiseaux magiques, trois filles, l'eau vive et les morts qui se lèvent... on a déjà vu tout ça. Même Solovieï, on l'a déjà rencontré dans le personnage légendaire de Kochtcheï l'Immortel, ou bien le Rossignol-Brigand. Il y a peut-être dix ans, peut-être mille. Qui s'en souvient ?
Cinq étoiles. Je vais me faire une tisane à la vierge-tatare, pour revenir dans le monde normal.
Adieu, corbeau... à un de ces quarante-neuf !
"me voilà donc mort" !"
(Bardo Thödol, le Livre Tibétain des Morts)
C'est la fin du monde tel qu'on ne le connait même pas.
La fin de la Deuxième Union Soviétique dont la capitale Orbise s'est effondrée. La nature a repris ses droits sur le monde dévasté par la guerre et les radiations, mais ce n'est plus la même nature. Les gens errent dans cet étrange décor, entre la sauvagerie du néant et les camps militaires dont on ne connaît pas l'emplacement exact, mais ce ne sont plus les mêmes gens.
Rien n'est comme avant. Même pas les corbeaux... surtout les corbeaux !
Dans les herbes hautes de la steppe - la valdelame-à-bouclettes, la clé-de-chine, la talmazine, l'octroie - se cachent trois déserteurs. Deux ex-vaillants ex-soldats Iliouchenko et Kronauer, et Vassilissa Marachvili. Irradiés jusqu'aux os. Vassia est mourante. Impossible de se ravitailler au kolkhoze abandonné qui est tout près, car un bizarre train militaire vient de s'arrêter devant son portail.
Kronauer va alors braver les dangers de la taïga pour chercher de l'aide. La taïga dont les mousses luisent dans l'obscurité et dont les arbres hurlent à l'intérieur de votre tête...
... et il trouve Terminus Radieux.
Un kolkhoze dont le temps de gloire est passé, suspendu entre "avant" et "maintenant"; entre "être" et "non-être". L'immortelle mémé Oudgoul y parle à la pile nucléaire en lui offrant des vestiges des temps passés, et en tournant les boutons de sa vieille radio dans l'espoir de capter encore quelques slogans de l'ancienne propagande. Il y a aussi le président Solovieï, moujik sorcier, grand marionnettiste des choses prétendument vivantes. Et ses trois étranges filles.
Kronauer va devenir une sorte d'élu qui va jouer un rôle dans le destin de Terminus Radieux, mais y a t-il encore un Destin ? Quand on se pique avec l'aiguille d'un phonographe dont les rouleaux contiennent les mélopées chamaniques du thaumaturge Solovieï, que devient la réalité ?
Sommes nous vraiment vivants, ou errons-nous dans le bardo, cet état entre deux états, entre la vie et la mort, dans une rêverie sans fin, sans durée... le corbeau vous le dira. Peut-être.
"Terminus Radieux" est une trouvaille inattendue. Je n'ai encore jamais lu un livre similaire (même le terme "réalisme magique" paraît bien fade), et ce n'est pas étonnant. C'est un roman "post-exotique", un courant créé par Volodine lui même et entretenu sous ses différents pseudos. Volodine ? Kronauer ? Tout est subtilement entremêlé entre la réalité et la fiction, le présent physique et le rêve. 49 livres de 49 chapitres (autant que les jours d'errance dans le bardo tibétain) qui vous feront entrer dans des vases communicants entre ici et là-bas. Au corbeau de vous guider, mais attention ! Il peut s'immiscer dans votre tête pour vous raconter des mensonges...
Cela peut paraître incroyable, mais si vous décidez de jouer le jeu, le livre se lit sans effort. Volodine a réussi à créer un monde très poétique non seulement dans ses évocations d'images, mais aussi dans cette mixture de l'aventure post-apocalyptique classique avec des mondes oniriques où les corps et les esprits errent pour se recroiser dans d'autres lieux, d'autres temps et d'autres contextes, pour évoquer leurs souvenirs d'autrefois. La nature, culture et littérature inventées de toutes pièces font pendant à la culture ancienne, les bylines et contes de fée russes. Palais illusoires, oiseaux magiques, trois filles, l'eau vive et les morts qui se lèvent... on a déjà vu tout ça. Même Solovieï, on l'a déjà rencontré dans le personnage légendaire de Kochtcheï l'Immortel, ou bien le Rossignol-Brigand. Il y a peut-être dix ans, peut-être mille. Qui s'en souvient ?
Cinq étoiles. Je vais me faire une tisane à la vierge-tatare, pour revenir dans le monde normal.
Adieu, corbeau... à un de ces quarante-neuf !
« L'étrange est la forme que prend le beau quand le beau est sans espérance ».
Le temps de m'adapter, à la margelle des mots, le temps d'une vacillation, et j'ai plongé, conquise…Plongée dans le Volodinistan grâce à Pierre, Paul, Suz, je leur serai gré de ne pas faire attention à mes maladresses, à mes incompréhensions éventuelles pour parler de ce monde étrange et inquiétant. Mais j'ai décidé de ne pas faire de recherche sur le post-exotisme imaginé par Antoine Volodine pour précisément, suite à cette toute première incursion, laisser remonter seules les sensations, vierge de toute connaissance préalable, si ce n'est des critiques des apôtres cités qui m'ont convaincue de cette découverte. Bien m'en a pris. Une expérience de lecture dont je ressors changée. Volodinisée je suis. Je n'avais pas été prévenue…
« Dans le ciel, les nuages s'effilochaient en prenant l'aspect de livides lanières, de robes déchirées, de longues écharpes, et, derrière, la couche de vapeur était plus unie et gris plomb ».
Du post post-apo…Vous voyez ? Suite à une catastrophe nucléaire, à l'univers concentrationnaire, lorsque l'homme est devenu sauvage, pire qu'une bête, quand il n'y a plus d'espoir. Que la terre n'est plus habitable mais qu'il reste cependant une poignée de pauvres hères. Une humanité mourante, au dernier stade de la dispersion et de l'inexistence, proche de l'extinction. Des hommes devenues simples formes, simulacre d'apparence humaine grâce aux loques portées, en errance dans la chaleur, la poussière, la fange. Dans les odeurs pestilentielles, les ruines, les charniers. La sauvagerie qui se manifeste par du cannibalisme, de la torture. A moins que ces actes ne soient que fantasmés. Les hommes et les femmes, devenus rares, devenus de pauvres « Anges Mineurs » qui n'ont plus que leur déchéance à faire valoir. «Ne voyant plus la différence entre réel et imaginaire, confondant les maux dus aux séquelles de l'antique système capitaliste et les dérives causées par le non-fonctionnement du système non capitaliste ».
49 narrats structurent ce récit. 49 récits. Non des narrats, c'est le bien terme exact proposé par l'auteur et que j'utilise donc. Voilà ce qu'Antoine Volodine nous explique en préambule du livre :
« J'appelle narrats des textes post-exotiques à cent pour cent, j'appelle narrats des instantanés romanesques qui fixent une situation, des émotions, un conflit vibrant entre mémoire et réalité, entre imaginaire et souvenir. C'est une séquence poétique à partir de quoi toute rêverie est possible, pour les interprètes de l'action comme pour les lecteurs. On trouvera ici quarante-neuf de ces moments de prose ».
Des narrats de quelques pages qui s'enchainent et où nous voyons apparaitre peu à peu une figure centrale, un certain Will Scheidmann, enfanté dans un hospice pour vieillards, dans la peur et le chaos, à partir de chiffons et de pratiques chamaniques de très vieilles femmes devenues immortelles. Il incarnait l'espoir de l'humanité, il a failli en ramenant, une nouvelle fois, le capitalisme, perdition même de l'homme, rétablissant la propriété privée et l'exploitation de l'homme par l'homme, « et autres abominations mafiogènes ». La position idéologique d'Antoine Volodine est claire et sans ambiguïté possible. Position scandée par ces vieilles femmes :
«…nous avons devant nous leurs valeurs démocratiques conçues pour leur propre renouvellement éternel et pour notre éternelle torpeur, nous avons devant nous les machines démocratiques qui leur obéissent au doigt et à l'oeil et interdisent aux pauvres toute victoire significative,… »
Chaque narrat invite à la découverte d'un personnage dans une scène de « vie » réelle ou imaginaire, parfois glaçante, mais curieusement teintée de beauté et de poésie aussi. Ils me font penser à des fleurs vénéneuses. Elles nous offrent leur beauté, parfois leur côté fantastique et magique, nous attirent avant de nous avaler avec horreur. de nous mordre. de nous injecter leur poison et de nous laisser comme hébétés…
Deux extraits de l'un de ces narrat, le plus marquant pour moi, celui intitulée Babaïa Schtern :
« La porte a été sciée à mi-hauteur, comme autrefois dans les box d'écurie, au temps où il y avait des chevaux, et, sur le rebord de la partie supérieure, une femme s'appuie, elle appuie ses bras énormes. C'est Babaïa Schtern. Elle est là nuit et jour, en chemise, luisante de sueur, large et ventrue et adipeusement lisse comme autrefois les hippopotames, au temps où il y avait l'Afrique »
Cette femme dont les enfants s'occupe, que le narrateur croise parfois, obèse, à attendre le passant qui n'est plus, à sa porte ainsi sciée, l'air perdu, pour apprendre en fin de narrat :
« On voit bien qu'ils engraissent leur mère pour de simples raisons cannibales. Dans peu de semaines, ils la saigneront et ils la cuisineront. C'est vrai que l'existence est fondamentalement sale, mais, tout de même, ils pourraient aller faire cela ailleurs ».
La fleur nous a avalés. Tout cru. Vous avez senti ? C'est à la fois féérique et extrêmement sinistre, c'est repoussant me direz vous et pourtant elles sont belles aussi ces fleurs, je vous assure, de belles fleurs cruelles. Certains narrats contiennent en effet une beauté absolue, la beauté de la fin ultime des temps :
« Elle se tenait en face du paysage qu'elle ne regardait pas, en face du soleil magnifique, en face des ruines inhabitées, en face des immenses façades qui noircissaient dans le silence du matin, en face des champs de débris qui ressemblaient à une mégapole après la fin de la civilisation et même après la fin de la barbarie, en face du souvenir d'Enzo Mardirossian, en face de ce souvenir qui l'éblouissait, lui aussi. Des taches rouge brique dérivèrent sous ses paupières ».
Nous comprenons peu à peu que toutes ces fleurs dangereuses et toxiques ont des liens, des racines communes, un réseau entrelacé de connaissances plus ou moins enfouies dans le temps. Tout est lié, tout se tient. Ces narrats proviennent en effet tous de l'imagination foisonnante de ce Will Scheidmann comme nous le comprenons au 22ème narrat.
Où est Volodine là-dedans ?… Il se cache et écrit sous différents pseudos, nous le pressentons, derrière Will, derrière les femmes immortelles, derrière tous les personnages même je pense. Les narrats sont les incantations hallucinées d'un homme, le dernier des hommes…Sa nostalgie d'un paradis noir d'une société égalitaire remue et parle dans l'espace de ses narrats. Sa plume est, de plus, sublime. Elle nous tient fermement malgré la noirceur, noirceur qu'il éclaircit parfois lorsqu'il nous montre le formidable pouvoir de l'imagination pour survivre dans cette indescriptible solitude, imagination qui efface même le réel, qui le tord effaçant par la même le passé. Cette façon de se glisser dans de multiples personnages, d'effacer les frontières entre imaginaire et réel, de faire fi des lois du temps n'est pas sans rappeler l'univers de Philippe K.Dick.
Tandis que Will Scheidmann raconte, les vieillardes, de trois siècles, de plus en plus séniles et perdant la mémoire, détachent des lambeaux de ce héros à bout de souffle pour tenter de retenir un morceau de leur mémoire et de leur humanité elle aussi en bout de course. Finalement ce livre est une formidable métaphore, celle de la narration, celle du conte lorsque nous avons besoin de nous rappeler notre humanité. Les drogues de translation de Philippe K.Dick dans « le dieu venu du centaure », D-Liss et K-Diss, sont ici les narrats.
Je ne sais pas si j'ai tout compris. Je n'ai certainement pas certaines clés en main n'ayant pas lu d'autres livres de cet auteur. Que les amateurs de Volodine ne m'en tiennent pas rigueur. Ce fut pour moi une magnifique porte d'entrée dans son univers. Ces narrats ont été écrits pour créer « des images destinées à s'incruster dans leur inconscient et à resurgir bien plus tard dans leurs méditations ou dans leurs rêves ». Je crois que c'est réussi…une inoubliable lecture qui a hanté mes nuits devenues blanches...
Le temps de m'adapter, à la margelle des mots, le temps d'une vacillation, et j'ai plongé, conquise…Plongée dans le Volodinistan grâce à Pierre, Paul, Suz, je leur serai gré de ne pas faire attention à mes maladresses, à mes incompréhensions éventuelles pour parler de ce monde étrange et inquiétant. Mais j'ai décidé de ne pas faire de recherche sur le post-exotisme imaginé par Antoine Volodine pour précisément, suite à cette toute première incursion, laisser remonter seules les sensations, vierge de toute connaissance préalable, si ce n'est des critiques des apôtres cités qui m'ont convaincue de cette découverte. Bien m'en a pris. Une expérience de lecture dont je ressors changée. Volodinisée je suis. Je n'avais pas été prévenue…
« Dans le ciel, les nuages s'effilochaient en prenant l'aspect de livides lanières, de robes déchirées, de longues écharpes, et, derrière, la couche de vapeur était plus unie et gris plomb ».
Du post post-apo…Vous voyez ? Suite à une catastrophe nucléaire, à l'univers concentrationnaire, lorsque l'homme est devenu sauvage, pire qu'une bête, quand il n'y a plus d'espoir. Que la terre n'est plus habitable mais qu'il reste cependant une poignée de pauvres hères. Une humanité mourante, au dernier stade de la dispersion et de l'inexistence, proche de l'extinction. Des hommes devenues simples formes, simulacre d'apparence humaine grâce aux loques portées, en errance dans la chaleur, la poussière, la fange. Dans les odeurs pestilentielles, les ruines, les charniers. La sauvagerie qui se manifeste par du cannibalisme, de la torture. A moins que ces actes ne soient que fantasmés. Les hommes et les femmes, devenus rares, devenus de pauvres « Anges Mineurs » qui n'ont plus que leur déchéance à faire valoir. «Ne voyant plus la différence entre réel et imaginaire, confondant les maux dus aux séquelles de l'antique système capitaliste et les dérives causées par le non-fonctionnement du système non capitaliste ».
49 narrats structurent ce récit. 49 récits. Non des narrats, c'est le bien terme exact proposé par l'auteur et que j'utilise donc. Voilà ce qu'Antoine Volodine nous explique en préambule du livre :
« J'appelle narrats des textes post-exotiques à cent pour cent, j'appelle narrats des instantanés romanesques qui fixent une situation, des émotions, un conflit vibrant entre mémoire et réalité, entre imaginaire et souvenir. C'est une séquence poétique à partir de quoi toute rêverie est possible, pour les interprètes de l'action comme pour les lecteurs. On trouvera ici quarante-neuf de ces moments de prose ».
Des narrats de quelques pages qui s'enchainent et où nous voyons apparaitre peu à peu une figure centrale, un certain Will Scheidmann, enfanté dans un hospice pour vieillards, dans la peur et le chaos, à partir de chiffons et de pratiques chamaniques de très vieilles femmes devenues immortelles. Il incarnait l'espoir de l'humanité, il a failli en ramenant, une nouvelle fois, le capitalisme, perdition même de l'homme, rétablissant la propriété privée et l'exploitation de l'homme par l'homme, « et autres abominations mafiogènes ». La position idéologique d'Antoine Volodine est claire et sans ambiguïté possible. Position scandée par ces vieilles femmes :
«…nous avons devant nous leurs valeurs démocratiques conçues pour leur propre renouvellement éternel et pour notre éternelle torpeur, nous avons devant nous les machines démocratiques qui leur obéissent au doigt et à l'oeil et interdisent aux pauvres toute victoire significative,… »
Chaque narrat invite à la découverte d'un personnage dans une scène de « vie » réelle ou imaginaire, parfois glaçante, mais curieusement teintée de beauté et de poésie aussi. Ils me font penser à des fleurs vénéneuses. Elles nous offrent leur beauté, parfois leur côté fantastique et magique, nous attirent avant de nous avaler avec horreur. de nous mordre. de nous injecter leur poison et de nous laisser comme hébétés…
Deux extraits de l'un de ces narrat, le plus marquant pour moi, celui intitulée Babaïa Schtern :
« La porte a été sciée à mi-hauteur, comme autrefois dans les box d'écurie, au temps où il y avait des chevaux, et, sur le rebord de la partie supérieure, une femme s'appuie, elle appuie ses bras énormes. C'est Babaïa Schtern. Elle est là nuit et jour, en chemise, luisante de sueur, large et ventrue et adipeusement lisse comme autrefois les hippopotames, au temps où il y avait l'Afrique »
Cette femme dont les enfants s'occupe, que le narrateur croise parfois, obèse, à attendre le passant qui n'est plus, à sa porte ainsi sciée, l'air perdu, pour apprendre en fin de narrat :
« On voit bien qu'ils engraissent leur mère pour de simples raisons cannibales. Dans peu de semaines, ils la saigneront et ils la cuisineront. C'est vrai que l'existence est fondamentalement sale, mais, tout de même, ils pourraient aller faire cela ailleurs ».
La fleur nous a avalés. Tout cru. Vous avez senti ? C'est à la fois féérique et extrêmement sinistre, c'est repoussant me direz vous et pourtant elles sont belles aussi ces fleurs, je vous assure, de belles fleurs cruelles. Certains narrats contiennent en effet une beauté absolue, la beauté de la fin ultime des temps :
« Elle se tenait en face du paysage qu'elle ne regardait pas, en face du soleil magnifique, en face des ruines inhabitées, en face des immenses façades qui noircissaient dans le silence du matin, en face des champs de débris qui ressemblaient à une mégapole après la fin de la civilisation et même après la fin de la barbarie, en face du souvenir d'Enzo Mardirossian, en face de ce souvenir qui l'éblouissait, lui aussi. Des taches rouge brique dérivèrent sous ses paupières ».
Nous comprenons peu à peu que toutes ces fleurs dangereuses et toxiques ont des liens, des racines communes, un réseau entrelacé de connaissances plus ou moins enfouies dans le temps. Tout est lié, tout se tient. Ces narrats proviennent en effet tous de l'imagination foisonnante de ce Will Scheidmann comme nous le comprenons au 22ème narrat.
Où est Volodine là-dedans ?… Il se cache et écrit sous différents pseudos, nous le pressentons, derrière Will, derrière les femmes immortelles, derrière tous les personnages même je pense. Les narrats sont les incantations hallucinées d'un homme, le dernier des hommes…Sa nostalgie d'un paradis noir d'une société égalitaire remue et parle dans l'espace de ses narrats. Sa plume est, de plus, sublime. Elle nous tient fermement malgré la noirceur, noirceur qu'il éclaircit parfois lorsqu'il nous montre le formidable pouvoir de l'imagination pour survivre dans cette indescriptible solitude, imagination qui efface même le réel, qui le tord effaçant par la même le passé. Cette façon de se glisser dans de multiples personnages, d'effacer les frontières entre imaginaire et réel, de faire fi des lois du temps n'est pas sans rappeler l'univers de Philippe K.Dick.
Tandis que Will Scheidmann raconte, les vieillardes, de trois siècles, de plus en plus séniles et perdant la mémoire, détachent des lambeaux de ce héros à bout de souffle pour tenter de retenir un morceau de leur mémoire et de leur humanité elle aussi en bout de course. Finalement ce livre est une formidable métaphore, celle de la narration, celle du conte lorsque nous avons besoin de nous rappeler notre humanité. Les drogues de translation de Philippe K.Dick dans « le dieu venu du centaure », D-Liss et K-Diss, sont ici les narrats.
Je ne sais pas si j'ai tout compris. Je n'ai certainement pas certaines clés en main n'ayant pas lu d'autres livres de cet auteur. Que les amateurs de Volodine ne m'en tiennent pas rigueur. Ce fut pour moi une magnifique porte d'entrée dans son univers. Ces narrats ont été écrits pour créer « des images destinées à s'incruster dans leur inconscient et à resurgir bien plus tard dans leurs méditations ou dans leurs rêves ». Je crois que c'est réussi…une inoubliable lecture qui a hanté mes nuits devenues blanches...
Les quatre romans parus aux éditions de Minuit d’Antoine Volodine forment un passionnant témoignage d’une oeuvre en voie d’établissement.
Chacun défriche à sa manière des pistes en voie d’exploration, dont la cartographie future s’assemblera à leur impossible histoire commune.
…
Débutant par la voix de l’oralité, offrant au possible d’être racontée, son histoire glace de son vécu trop familier, cyclique cirque communo-fasciste, spectacle donné car bien trop véritable.
…
L’idéal totalitaire y entre en piste sans crier gare, la rumeur de sa venue précédant l’érection de son chapiteau, les affiches la vantant largement placardées sur ces murs, passifs témoins ne sachant l’arrêter.
…
Arméniens, Juifs, Cathares ou Doryphores, éternels sons du glas joués alors que la foule s’assemble autour d’idées bien trop simples.
Mais au moins, la musique reste.
Chacun défriche à sa manière des pistes en voie d’exploration, dont la cartographie future s’assemblera à leur impossible histoire commune.
…
Débutant par la voix de l’oralité, offrant au possible d’être racontée, son histoire glace de son vécu trop familier, cyclique cirque communo-fasciste, spectacle donné car bien trop véritable.
…
L’idéal totalitaire y entre en piste sans crier gare, la rumeur de sa venue précédant l’érection de son chapiteau, les affiches la vantant largement placardées sur ces murs, passifs témoins ne sachant l’arrêter.
…
Arméniens, Juifs, Cathares ou Doryphores, éternels sons du glas joués alors que la foule s’assemble autour d’idées bien trop simples.
Mais au moins, la musique reste.
« Je flambe dans le brasier à l’ardeur adorable ».
Cette citation d’Apollinaire sied à merveille au dernier opus d’Antoine Volodine. Goutte essentielle d’huile volodinienne, « Vivre dans le feu » concentre avec tendresse et facétie en effet tous les éléments de l’univers chamanique de ce singulier auteur qui a su développer, au fil des livres, un monde à nul autre pareil.
Ce roman est situé, comme tous les autres romans de l’auteur et également les romans de ses nombreux pseudonymes, dans le courant post-exotique qu’on pourrait qualifier, pour imager grossièrement, de post-post apo, la catastrophe étant désormais plus qu’un vague souvenir et la société entièrement détruite, quelques âmes errent et seul le clan a valeur de refuge. Le post-exotisme c’est la dystopie ultime qui l’éloigne ainsi de la science-fiction pour former un courant singulier et marginal où les repères spatio-temporels ont explosé, où les codes sont autres, où rêve et réalité se confondent.
Nous faisons la connaissance du soldat Sam destiné à finir dans le feu. En effet, alors que lui et ses hommes, en terrain découvert, font face à l’arrivée inéluctable d’un nuage orangé de napalm déversé par avion, ne pouvant plus ni fuir ni se cacher, puisqu’il est certain de mourir, qui plus est dans d’atroces souffrances, il décide de faire un pied de nez à l’inéluctable et, les quelques secondes restantes, de composer un roman, un petit « roman hurlé, en accéléré ». Quelques microsecondes suffisantes, le temps d’un craquement d’allumettes, le temps d’un clignement de paupières, ou encore d’un ultime pétillement d’agonie, pour fuir dans l’imaginaire à défaut de fuir physiquement, avec dignité, face à la douleur sans doute inouïe qui déferle.
« Et vu comme ça, au jugé, je dispose d’une seconde. J’ai donc tout mon temps ».
Dans cette grandiose mais brève aventure imaginaire, Sam invente une histoire fantastique et fantasque, il s’imagine membre d’un clan composé de tantes et de grands-mères, d’une petite poignée d’oncles aussi. Les tantes de Sam cherchent à lui apprendre à « vivre dans le feu ». Des femmes belles et fortes, chamaniques, des femmes ancestrales, sans âge, qui ne sont menacées que par ce qui reste de la société, tueurs en tout genre, hommes et femmes davantage mus par la violence et les instincts primaires que par la volonté de refaire société. Cette dernière, en tant que telle, est détruite depuis bien longtemps.
Manuel pour débutants expliquant comment être dans les flammes, mentionnant la déformation de l’espace-temps à l’intérieur des flammes, travaux pratiques, expériences, anecdotes, voilà ce que lui transmettent ces tantes et grands-mères, certains hommes de la famille ayant pour destinée de vivre dans le feu. Pourquoi pas Sam ? Ainsi décident-elles de lui transmettre le flambeau si on peut dire, de lui donner de solides leçons de feu pour savoir exister dans le feu et arrêter d’être étranger au feu. Faire l’éternité entre deux flammes.
« L’habituation au feu n’est pas chose facile. J’en parlerai plus tard si les événements ne se précipitent pas ».
Si le feu nucléaire de Terminus radieux laisse place ici aux flammes du napalm, les paysages sont très proches de ceux traversés dans les autres livres de l’auteur, un paysage redevenu sauvage composé d’immenses steppes aux herbes hautes et sèches, ondulantes, vertes et argentées, aux fleurs et graminées comme les aime l’inventif Volodine, « touffes d’avoine sauvage, mirmine-bréhaigne, fière-mirmine, shizane –violette », immensités entrecoupées par endroit par des étendues désolées, anciennes mines, vestiges éparpillées d’anciens déserts industriels, ou casses immenses. La poésie émane de ces lieux désolés et hypnotise, un peu à l’image des photographies de lieux abandonnés, l’urbex.
« Jeep hors d’usage, berlines cabossées, écrasées, autocars désossées, démantelés, incendiés, caravanes éventrées, citernes vides, déchirées, camionnettes, camions, machines agricoles aux fonctions indiscernables, engins de chantier, matériel de l’armée. Coulures d’huile de vidange, odeurs jamais disparues de pneumatiques, de peinture en désagrégation, de carburants divers, de matières plastiques déjà en miettes. Un monde silencieux, puant, dangereux et désert. Un immense labyrinthe, trois dimensions qui s’étendait sur des kilomètres ».
Cette marche dans le Bardo nous plonge en mode onirique au sein d’une zone ténébreuse. L’aventure des morts ou des quasi-morts qui vont dans l’espace noir en direction d’une hypothétique renaissance ou simple survie, est une nouvelle fois mise en valeur, ici de façon très réaliste.
Roman tribal par ailleurs, cette famille dysfonctionnelle semble davantage régie par les lois claniques d’une tribu dans laquelle le noyau familial classique, père/mère/enfant, n’existe pas. La parenté concerne les oncles, les tantes et les grands-mères. Le clan est la structure centrale dans l’éducation de Sam et la transmission familiale porte sur des valeurs étranges, des dons non-humains. Un clan qui casse les codes avec nos propres structures familiales et notre acception de la transmission. Les codes sont différentes, j’en veux pour preuve l’inceste qui n’est ici pas un tabou.
Alors que le sujet est atroce, mourir dans du napalm n’est pas sans rappeler de sombres moments historiques depuis l’holocauste en passant par l’image insoutenable de cette petite fille au corps ravagé, j’ai trouvé que l’humour noir était très présent et d’ailleurs dès l’incipit. Humour noir et humour fantastique lorsque l’on pense aux homoncules de Tante Yoanna qui a, en modèle réduit et à sa merci, dans une sorte de terrarium, des hommes qui dans la vie l’importune…De quoi leur faire faire ce qu’elle veut. C’est croquignolet à souhait…
Toujours aussi sombre, étrange, radicale, mais peut-être un peu moins sensorielle et poétique que mon préféré de Volodine, Des anges mineurs, mais paradoxalement plus facétieux, voire drôle, la dernière pierre de l’édifice post-exotique de Volodine n’est certainement pas la plus importante de l’édifice mais c’est sans doute la plus accessible du fait de la malice évoquée. Ce livre est d’autant plus important qu’il s’agirait du dernier livre signé Volodine dans l’épopée post-exotique, terminus incandescent qui en rend la lecture d’autant plus touchante.
Cette citation d’Apollinaire sied à merveille au dernier opus d’Antoine Volodine. Goutte essentielle d’huile volodinienne, « Vivre dans le feu » concentre avec tendresse et facétie en effet tous les éléments de l’univers chamanique de ce singulier auteur qui a su développer, au fil des livres, un monde à nul autre pareil.
Ce roman est situé, comme tous les autres romans de l’auteur et également les romans de ses nombreux pseudonymes, dans le courant post-exotique qu’on pourrait qualifier, pour imager grossièrement, de post-post apo, la catastrophe étant désormais plus qu’un vague souvenir et la société entièrement détruite, quelques âmes errent et seul le clan a valeur de refuge. Le post-exotisme c’est la dystopie ultime qui l’éloigne ainsi de la science-fiction pour former un courant singulier et marginal où les repères spatio-temporels ont explosé, où les codes sont autres, où rêve et réalité se confondent.
Nous faisons la connaissance du soldat Sam destiné à finir dans le feu. En effet, alors que lui et ses hommes, en terrain découvert, font face à l’arrivée inéluctable d’un nuage orangé de napalm déversé par avion, ne pouvant plus ni fuir ni se cacher, puisqu’il est certain de mourir, qui plus est dans d’atroces souffrances, il décide de faire un pied de nez à l’inéluctable et, les quelques secondes restantes, de composer un roman, un petit « roman hurlé, en accéléré ». Quelques microsecondes suffisantes, le temps d’un craquement d’allumettes, le temps d’un clignement de paupières, ou encore d’un ultime pétillement d’agonie, pour fuir dans l’imaginaire à défaut de fuir physiquement, avec dignité, face à la douleur sans doute inouïe qui déferle.
« Et vu comme ça, au jugé, je dispose d’une seconde. J’ai donc tout mon temps ».
Dans cette grandiose mais brève aventure imaginaire, Sam invente une histoire fantastique et fantasque, il s’imagine membre d’un clan composé de tantes et de grands-mères, d’une petite poignée d’oncles aussi. Les tantes de Sam cherchent à lui apprendre à « vivre dans le feu ». Des femmes belles et fortes, chamaniques, des femmes ancestrales, sans âge, qui ne sont menacées que par ce qui reste de la société, tueurs en tout genre, hommes et femmes davantage mus par la violence et les instincts primaires que par la volonté de refaire société. Cette dernière, en tant que telle, est détruite depuis bien longtemps.
Manuel pour débutants expliquant comment être dans les flammes, mentionnant la déformation de l’espace-temps à l’intérieur des flammes, travaux pratiques, expériences, anecdotes, voilà ce que lui transmettent ces tantes et grands-mères, certains hommes de la famille ayant pour destinée de vivre dans le feu. Pourquoi pas Sam ? Ainsi décident-elles de lui transmettre le flambeau si on peut dire, de lui donner de solides leçons de feu pour savoir exister dans le feu et arrêter d’être étranger au feu. Faire l’éternité entre deux flammes.
« L’habituation au feu n’est pas chose facile. J’en parlerai plus tard si les événements ne se précipitent pas ».
Si le feu nucléaire de Terminus radieux laisse place ici aux flammes du napalm, les paysages sont très proches de ceux traversés dans les autres livres de l’auteur, un paysage redevenu sauvage composé d’immenses steppes aux herbes hautes et sèches, ondulantes, vertes et argentées, aux fleurs et graminées comme les aime l’inventif Volodine, « touffes d’avoine sauvage, mirmine-bréhaigne, fière-mirmine, shizane –violette », immensités entrecoupées par endroit par des étendues désolées, anciennes mines, vestiges éparpillées d’anciens déserts industriels, ou casses immenses. La poésie émane de ces lieux désolés et hypnotise, un peu à l’image des photographies de lieux abandonnés, l’urbex.
« Jeep hors d’usage, berlines cabossées, écrasées, autocars désossées, démantelés, incendiés, caravanes éventrées, citernes vides, déchirées, camionnettes, camions, machines agricoles aux fonctions indiscernables, engins de chantier, matériel de l’armée. Coulures d’huile de vidange, odeurs jamais disparues de pneumatiques, de peinture en désagrégation, de carburants divers, de matières plastiques déjà en miettes. Un monde silencieux, puant, dangereux et désert. Un immense labyrinthe, trois dimensions qui s’étendait sur des kilomètres ».
Cette marche dans le Bardo nous plonge en mode onirique au sein d’une zone ténébreuse. L’aventure des morts ou des quasi-morts qui vont dans l’espace noir en direction d’une hypothétique renaissance ou simple survie, est une nouvelle fois mise en valeur, ici de façon très réaliste.
Roman tribal par ailleurs, cette famille dysfonctionnelle semble davantage régie par les lois claniques d’une tribu dans laquelle le noyau familial classique, père/mère/enfant, n’existe pas. La parenté concerne les oncles, les tantes et les grands-mères. Le clan est la structure centrale dans l’éducation de Sam et la transmission familiale porte sur des valeurs étranges, des dons non-humains. Un clan qui casse les codes avec nos propres structures familiales et notre acception de la transmission. Les codes sont différentes, j’en veux pour preuve l’inceste qui n’est ici pas un tabou.
Alors que le sujet est atroce, mourir dans du napalm n’est pas sans rappeler de sombres moments historiques depuis l’holocauste en passant par l’image insoutenable de cette petite fille au corps ravagé, j’ai trouvé que l’humour noir était très présent et d’ailleurs dès l’incipit. Humour noir et humour fantastique lorsque l’on pense aux homoncules de Tante Yoanna qui a, en modèle réduit et à sa merci, dans une sorte de terrarium, des hommes qui dans la vie l’importune…De quoi leur faire faire ce qu’elle veut. C’est croquignolet à souhait…
Toujours aussi sombre, étrange, radicale, mais peut-être un peu moins sensorielle et poétique que mon préféré de Volodine, Des anges mineurs, mais paradoxalement plus facétieux, voire drôle, la dernière pierre de l’édifice post-exotique de Volodine n’est certainement pas la plus importante de l’édifice mais c’est sans doute la plus accessible du fait de la malice évoquée. Ce livre est d’autant plus important qu’il s’agirait du dernier livre signé Volodine dans l’épopée post-exotique, terminus incandescent qui en rend la lecture d’autant plus touchante.
Terminus, tout le monde descend. Destination éblouissante, radioactive, ionisante, oui radieuse façon irradiante…Limbes herbeuses et ventées, entre rêve et réalité, mariage de la défaite de l'internationalisme communiste, des camps et du chamanisme, limbes desquelles vous ne reviendrez pas car c'est un voyage vers la fin de tout, sans retour possible, à un rythme hypnotisant.
Sentez-vous votre identité devenir poreuse, sentez-vous les senteurs d'absinthes, voyez-vous ces routes à l'abandon, ces voies de chemin de fer envahies par les herbes, percevez-vous les vibrations de l'air et cette lumière aveuglante mais froide, sentez-vous le regard de ce corbeau, là en face, qui vous regarde de ses yeux étrangement mordorés et qui semble vouloir vous guider ? Entendez-vous le silence ? Voilà, vous êtes bien arrivés et n'êtes pas prêts de repartir. Une fois que l'on goute aux terres volodiniennes, on ne peut s'empêcher d'y revenir, 49 narrats fois 49 kilomètres, soit 2401 kilomètres de lecture ensorcelante et absolument unique…
« le panorama avait quelque chose d'éternel. L'immensité du ciel dominait l'immensité de la prairie. Ils se trouvaient sur une petite éminence et ils voyaient loin. Une voie ferrée coupait en deux l'image. La terre avait été autrefois couverte de blé, mais au fil du temps elle était retournée à la sauvagerie des céréales préhistoriques et des graminées mutantes ».
Mais que vais-je raconter sur ce livre inracontable sans passer pour une allumée qui aurait avalé quantités de trucs hallucinogènes ? Car ce livre ne se raconte pas, il se vit. Et pour le vivre il faut abandonner toute rationalité. Oui, laissez-la par terre, votre rationalité, au milieu des valdelame-à-bouclettes et des Jeannes-des-communistes et laissez-vous irradier avec volupté…
C'est une expérience de littérature comme il en existe peu et d'ailleurs, je cherche, ai-je déjà lu quelque chose de ressemblant ? Je ne crois pas, le réalisme magique me semble bien faible pour le qualifier, la SF post-apocalyptique aussi. le post-exotisme de Volodine est à part, sans comparaison possible. C'est l'assurance de plonger dans un monde à nul autre pareil, et ce dès les premières pages, sa poésie de fin du monde aux tonalités sepia vous enveloppe pour ne plus vous lâcher et s'immisce en vous, vous ensorcelle de son onirisme, de ses mille références, de son humour corrosif, de son temps élastique, de ses distances floues et fluctuantes, de la présence de l'auteur à vos côtés qui ne revêt pas forcément le personnage que vous croyez…
Alors peut-être commencer par vous dire où nous sommes et à quelle date nous sommes, oui commençons par cela, plantons le décor. Immédiatement vous voilà projeté dans un futur indéterminé qui vous cueille en pleine steppe sibérienne cernée de taïga. La Seconde Union Soviétique communiste s'est effondrée sous l'assaut des forces contre-révolutionnaires capitalistes. Effondrement politique mais aussi effondrement écologique puisque les mini-réacteurs nucléaires qui devaient fidèlement servir la décentralisation énergétique pour fournir de l'énergie propre et en quantité importante à la Seconde Union Soviétique se sont totalement détériorés inondant la terre de radiations. L'humanité et la civilisation, la faune sont en péril. Reste quelques survivants, souffrant de malaises, d'affaiblissement, de dégout de l'existence, de diarrhées, de perte de cheveux et de poils, dans ce monde qui s'éteint et qui retourne au végétal comme le montre les herbes et les fleurs omniprésentes dans le livre, néologisme végétal de toute beauté.
« Ciel. Silence. Herbes qui ondulent. Bruit des herbes. Bruit de froissement des herbes. Murmure de la mauvegarde, de la chougda, de la marche-sept-lieues, de l'épernielle, de la vieille-captive, de la saquebrille, de la lucemingotte, de la vite-saignée, de la sainte-valiyane, de la valiyane-bec-de-lièvre, de la sottefraise, de l'iglitsa. Crissements de l'odilie-des-foins, de la grande-odilie, de la chauvegrille ou calvegrillette. Sifflement monotone de la caracolaire-des-ruines. Les herbes avaient des couleurs diverses et même chacune avait sa manière à elle de balancer sous le vent ou de se tordre. Certaines résistaient. D'autres s'avachissaient souplement et attendaient un bon moment, après le souffle, avant de retrouver leur position initiale. Bruit des herbes, de leurs mouvements passifs, de leur résistance. »
Le roman met en scène Elli Kronauer, qui, ayant tout tenté pour défendre l'Orbise – capitale de la Deuxième Union Soviétique qui vient de s'effondrer sous les coups des « barbares », à savoir les capitalistes –, s'enfonce avec deux camarades dans les territoires irradiés, décrétés no man's land après une catastrophe qui a vu le dérèglement des piles nucléaires de tous les villages de la zone. Alors que les trois compères sont dans un état proche de la mort, sans nourriture et sans eau, Kronauer décide de se diriger vers un lieu, dans la Taïga, d'où s'élève une mince volute de fumée et donc probablement des maisons, afin de demander de l'aide.
Dans ce contexte absolument tragique, deux lieux vont venir alternativement dans le récit.
Un train tout d'abord, à l'arrêt au début du récit, proche des trois personnages qui doivent ainsi s'en cacher parmi les herbes hautes, qui se mettra ensuite en route pour un hypothétique camp de prisonniers où les pauvres hères qui sont à l'intérieur s'imaginent y vivre enfin heureux car contrôlés, régulés sévèrement et ce, dans une stricte égalité rappelant le communisme défunt. le camp comme réalisation parfaite du rêve totalitaire d'ingénierie sociale marxiste-léniniste. Ces chapitres hallucinants consacrés au train sont d'un tragique absurde qui glace le sang…
« Rien n'est plus souhaitable, surtout pour quelqu'un né dans le camp, que la vie dans le camp. Ce n'est pas une question de décor, ni de qualité de l'air, ni même de qualité des aventures qu'on risque d'y connaître avant la mort. C'est surtout une question de contrat respecté entre le destin et soi. Il y a là un avantage supérieur qu'aucune des précédentes tentatives de société idéale n'avait réussi à mettre au point. A partir du moment où tous peuvent prétendre à entrer dans le camp et où jamais nul n'y est refusé ou n'en ressort, le camp devient l'unique endroit du monde où le destin ne déçoit personne, tant il est concrètement conforme à ce qu'on est en droit d'attendre de lui ».
Un kolkhoze ensuite, jusqu'où va arriver Kronauer. Ce kolkhoze, « Terminus radieux », est gouverné par Solovieï, sorte d'ogre terrifiant, une force de la nature, à l'image d'un Tarass Bulba, chaman omnipotent qui s'introduit dans les rêves, les façonne, prend à des degrés divers le contrôle des êtres qui l'entourent, vous maintient en vie alors que vous êtes mort par exemple, au point de faire de tous les êtres qui l'entourent des pantins dont il tire toutes les ficelles. Il règne sur son monde, les humains vivants, ou morts, ou presque morts, ou régulièrement ressuscités, qui ne savent pas ensuite dans quelle catégorie ils sont, incertains quant à leur statut de vivants, de morts ou de chiens…Seule leur reste une errance sans fin dans la taïga. Éternellement. Je me suis demandé si Volodine n'était pas Solovieï car finalement n'est-ce pas là la puissance absolue de tout écrivain de tirer les ficelles et de manipuler et ses personnages et ses lecteurs ?
Vivent à ses côtés la mémé Oudgoul, héroïque liquidatrice rendue immortelle par les radiations et les trois filles de Soloveï, victimes de ses viols psychiques. L'arrivée de Kronauer va déséquilibrer cette mainmise et l'équilibre de ce milieu étrange. Là encore j'ai senti en ce personnage de Kronauer la présence de l'auteur, ce farceur qui m'a fait douter. Il faut dire que Antoine Volodine signe également des fictions sous le nom d'Elli Kronauer…Soloveï et Kronoauer seraient-elles les deux faces miroir de Volodine en tant qu'auteur ?
« On est tous ni morts, ni vivants à "Terminus radieux". On est tous des morceaux de rêve de Solovieï. On est tous des espèces de bouts de rêves ou de poèmes dans son crâne. Ce qu'on lui fait, ça compte pas pour lui.(...) Ça compte pour du beurre. C'est rien. Ça va s'effacer ».
Fascinant livre sertie d'une poésie noire qui donne son ton au roman, coincée entre auto-dérision (le courant post-exotique est mainte fois cité et critiqué) et magie, entre dénonciation de la catastrophe écologique et antagonismes des systèmes de pensée, poésie qui infuse et apporte beaucoup au côté hypnotisant du récit. Un livre dont chaque relecture apporterait un éclairage autre, je le pressens. Oui, ce livre m'a fait l'effet d'une bombe entremêlant plusieurs plans de conscience en moi, comme avant l'endormissement, lorsqu'un sursaut vous fait sauter en l'air dans votre lit pensant tomber dans un puits de 2km au fond duquel se terre une pile radioactive…
Sentez-vous votre identité devenir poreuse, sentez-vous les senteurs d'absinthes, voyez-vous ces routes à l'abandon, ces voies de chemin de fer envahies par les herbes, percevez-vous les vibrations de l'air et cette lumière aveuglante mais froide, sentez-vous le regard de ce corbeau, là en face, qui vous regarde de ses yeux étrangement mordorés et qui semble vouloir vous guider ? Entendez-vous le silence ? Voilà, vous êtes bien arrivés et n'êtes pas prêts de repartir. Une fois que l'on goute aux terres volodiniennes, on ne peut s'empêcher d'y revenir, 49 narrats fois 49 kilomètres, soit 2401 kilomètres de lecture ensorcelante et absolument unique…
« le panorama avait quelque chose d'éternel. L'immensité du ciel dominait l'immensité de la prairie. Ils se trouvaient sur une petite éminence et ils voyaient loin. Une voie ferrée coupait en deux l'image. La terre avait été autrefois couverte de blé, mais au fil du temps elle était retournée à la sauvagerie des céréales préhistoriques et des graminées mutantes ».
Mais que vais-je raconter sur ce livre inracontable sans passer pour une allumée qui aurait avalé quantités de trucs hallucinogènes ? Car ce livre ne se raconte pas, il se vit. Et pour le vivre il faut abandonner toute rationalité. Oui, laissez-la par terre, votre rationalité, au milieu des valdelame-à-bouclettes et des Jeannes-des-communistes et laissez-vous irradier avec volupté…
C'est une expérience de littérature comme il en existe peu et d'ailleurs, je cherche, ai-je déjà lu quelque chose de ressemblant ? Je ne crois pas, le réalisme magique me semble bien faible pour le qualifier, la SF post-apocalyptique aussi. le post-exotisme de Volodine est à part, sans comparaison possible. C'est l'assurance de plonger dans un monde à nul autre pareil, et ce dès les premières pages, sa poésie de fin du monde aux tonalités sepia vous enveloppe pour ne plus vous lâcher et s'immisce en vous, vous ensorcelle de son onirisme, de ses mille références, de son humour corrosif, de son temps élastique, de ses distances floues et fluctuantes, de la présence de l'auteur à vos côtés qui ne revêt pas forcément le personnage que vous croyez…
Alors peut-être commencer par vous dire où nous sommes et à quelle date nous sommes, oui commençons par cela, plantons le décor. Immédiatement vous voilà projeté dans un futur indéterminé qui vous cueille en pleine steppe sibérienne cernée de taïga. La Seconde Union Soviétique communiste s'est effondrée sous l'assaut des forces contre-révolutionnaires capitalistes. Effondrement politique mais aussi effondrement écologique puisque les mini-réacteurs nucléaires qui devaient fidèlement servir la décentralisation énergétique pour fournir de l'énergie propre et en quantité importante à la Seconde Union Soviétique se sont totalement détériorés inondant la terre de radiations. L'humanité et la civilisation, la faune sont en péril. Reste quelques survivants, souffrant de malaises, d'affaiblissement, de dégout de l'existence, de diarrhées, de perte de cheveux et de poils, dans ce monde qui s'éteint et qui retourne au végétal comme le montre les herbes et les fleurs omniprésentes dans le livre, néologisme végétal de toute beauté.
« Ciel. Silence. Herbes qui ondulent. Bruit des herbes. Bruit de froissement des herbes. Murmure de la mauvegarde, de la chougda, de la marche-sept-lieues, de l'épernielle, de la vieille-captive, de la saquebrille, de la lucemingotte, de la vite-saignée, de la sainte-valiyane, de la valiyane-bec-de-lièvre, de la sottefraise, de l'iglitsa. Crissements de l'odilie-des-foins, de la grande-odilie, de la chauvegrille ou calvegrillette. Sifflement monotone de la caracolaire-des-ruines. Les herbes avaient des couleurs diverses et même chacune avait sa manière à elle de balancer sous le vent ou de se tordre. Certaines résistaient. D'autres s'avachissaient souplement et attendaient un bon moment, après le souffle, avant de retrouver leur position initiale. Bruit des herbes, de leurs mouvements passifs, de leur résistance. »
Le roman met en scène Elli Kronauer, qui, ayant tout tenté pour défendre l'Orbise – capitale de la Deuxième Union Soviétique qui vient de s'effondrer sous les coups des « barbares », à savoir les capitalistes –, s'enfonce avec deux camarades dans les territoires irradiés, décrétés no man's land après une catastrophe qui a vu le dérèglement des piles nucléaires de tous les villages de la zone. Alors que les trois compères sont dans un état proche de la mort, sans nourriture et sans eau, Kronauer décide de se diriger vers un lieu, dans la Taïga, d'où s'élève une mince volute de fumée et donc probablement des maisons, afin de demander de l'aide.
Dans ce contexte absolument tragique, deux lieux vont venir alternativement dans le récit.
Un train tout d'abord, à l'arrêt au début du récit, proche des trois personnages qui doivent ainsi s'en cacher parmi les herbes hautes, qui se mettra ensuite en route pour un hypothétique camp de prisonniers où les pauvres hères qui sont à l'intérieur s'imaginent y vivre enfin heureux car contrôlés, régulés sévèrement et ce, dans une stricte égalité rappelant le communisme défunt. le camp comme réalisation parfaite du rêve totalitaire d'ingénierie sociale marxiste-léniniste. Ces chapitres hallucinants consacrés au train sont d'un tragique absurde qui glace le sang…
« Rien n'est plus souhaitable, surtout pour quelqu'un né dans le camp, que la vie dans le camp. Ce n'est pas une question de décor, ni de qualité de l'air, ni même de qualité des aventures qu'on risque d'y connaître avant la mort. C'est surtout une question de contrat respecté entre le destin et soi. Il y a là un avantage supérieur qu'aucune des précédentes tentatives de société idéale n'avait réussi à mettre au point. A partir du moment où tous peuvent prétendre à entrer dans le camp et où jamais nul n'y est refusé ou n'en ressort, le camp devient l'unique endroit du monde où le destin ne déçoit personne, tant il est concrètement conforme à ce qu'on est en droit d'attendre de lui ».
Un kolkhoze ensuite, jusqu'où va arriver Kronauer. Ce kolkhoze, « Terminus radieux », est gouverné par Solovieï, sorte d'ogre terrifiant, une force de la nature, à l'image d'un Tarass Bulba, chaman omnipotent qui s'introduit dans les rêves, les façonne, prend à des degrés divers le contrôle des êtres qui l'entourent, vous maintient en vie alors que vous êtes mort par exemple, au point de faire de tous les êtres qui l'entourent des pantins dont il tire toutes les ficelles. Il règne sur son monde, les humains vivants, ou morts, ou presque morts, ou régulièrement ressuscités, qui ne savent pas ensuite dans quelle catégorie ils sont, incertains quant à leur statut de vivants, de morts ou de chiens…Seule leur reste une errance sans fin dans la taïga. Éternellement. Je me suis demandé si Volodine n'était pas Solovieï car finalement n'est-ce pas là la puissance absolue de tout écrivain de tirer les ficelles et de manipuler et ses personnages et ses lecteurs ?
Vivent à ses côtés la mémé Oudgoul, héroïque liquidatrice rendue immortelle par les radiations et les trois filles de Soloveï, victimes de ses viols psychiques. L'arrivée de Kronauer va déséquilibrer cette mainmise et l'équilibre de ce milieu étrange. Là encore j'ai senti en ce personnage de Kronauer la présence de l'auteur, ce farceur qui m'a fait douter. Il faut dire que Antoine Volodine signe également des fictions sous le nom d'Elli Kronauer…Soloveï et Kronoauer seraient-elles les deux faces miroir de Volodine en tant qu'auteur ?
« On est tous ni morts, ni vivants à "Terminus radieux". On est tous des morceaux de rêve de Solovieï. On est tous des espèces de bouts de rêves ou de poèmes dans son crâne. Ce qu'on lui fait, ça compte pas pour lui.(...) Ça compte pour du beurre. C'est rien. Ça va s'effacer ».
Fascinant livre sertie d'une poésie noire qui donne son ton au roman, coincée entre auto-dérision (le courant post-exotique est mainte fois cité et critiqué) et magie, entre dénonciation de la catastrophe écologique et antagonismes des systèmes de pensée, poésie qui infuse et apporte beaucoup au côté hypnotisant du récit. Un livre dont chaque relecture apporterait un éclairage autre, je le pressens. Oui, ce livre m'a fait l'effet d'une bombe entremêlant plusieurs plans de conscience en moi, comme avant l'endormissement, lorsqu'un sursaut vous fait sauter en l'air dans votre lit pensant tomber dans un puits de 2km au fond duquel se terre une pile radioactive…
Qu’il est bon de retrouver les terres volodiniennes, les fulgurances volodinesques, l’univers unique du Volodine’s land ! C’est un voyage à nul autre pareil, une expérience littéraire ahurissante, envoutante et hypnotisante.
Et pourtant…Pourtant nous plongeons dans un monde noir, totalement noir, d’une noirceur si absolue qu’il en devient lyrique. D’une telle monstruosité qu’il en devient poétique. La cité dans laquelle nous convie Antoine Volodine est obscure, putride, poussiéreuse, quelques survivants dont les cafards et les gueux se partagent quelques vieux blocs de béton fissurés et de ginguois. Dans une chaleur épouvantable, l’air est saturé d’odeurs nauséabondes, ail frit, entrailles de poisson, chien mouillé, câbles surchauffés, gaz, ferraille rouillée, humidité crasseuse, « il sentait les taudis où survivent gueux et Untermenschen, il sentait la pisse de rat, la décomposition, la vieillesse infâme de presque toute chose ». Les débris et les déchets jonchent chaque centimètre carré de sorte que se succèdent sous la pulpe des doigts seulement nids de poussières humides, aspérités friables, pointes. Aucune surface propre, aucune surface lisse. Aucune douceur, pas de répit. Les cafards se chevauchent les uns sur les autres, l’eau goutte de toutes les habitations, les bruits sont grinçants et métalliques. Dense, inextricable, insalubre, tel est le décor de « Dondog ». Bienvenue en terres volodiniennes vous dis-je ! Bienvenue dans cette chambre numéro 4A d’un immeuble de la Cité :
« Trop d’années s’étaient égrenées sans que quiconque entrât pour nettoyer ou aérer. C’est pourquoi des champignons noirs avaient proliféré dans la chaleur humide de l’été et dans le froid humide de la saison froide, et une couche duveteuse avait pris possession de toutes les surfaces. Les meubles sombraient sous leur lèpre, le sofa paraissait transformé en piège gluant, le linoléum du sol avait été comme aspergé d’une colle brunâtre. Au plafond et sur les murs s’épanouissaient d’immense tâches velues, à dominante charbonneuse mais avec des nuances : aile de corbeau, aile de chauve-souris, ou bistre, anthracite, poussière d’anthracite. L’oxygène avait disparu. Une intense puanteur de moisi l’avait remplacé (…) Il nagea à travers la semi-pénombre suffocante, avec l’intention d’ouvrir ou de fracasser la porte-fenêtre du balcon. Un rideau pendait devant la vitre. Il s’en empara. L’étoffe aussitôt se déchira, libérant environ sept cent soixante-deux papillons miniatures, d’un gris terne qui n’incitait pas à l’indulgence envers les lépidoptères. Les bestioles se mirent à voleter massivement en tous sens. Elles tournoyaient dans un total silence. Des mites, commenta Marconi ».
Qu’il est bon curieusement de sonder ce puits sans fond, de s’y laisser tomber. Et pourtant…Pourtant nous avançons hébétés dans une contrée située « entre la steppe mongole, la taïga sibérienne et le béton soviétique », dans laquelle la mafia règne en maître, les ethnies se mélangent, les frontières entre rêve et réalité sont poreuses, les stigmates de combats béent sans aucune pudeur. Elle a la tessiture granuleuse, ou plutôt grumeleuse, du cauchemar cette sorte de post-post-post apocalyptique dans laquelle l’humanité est à bout de souffle, donc dans un futur très lointain on peut le penser de prime abord, mais en réalité une tragédie d’hier et d’aujourd’hui. Atemporelle et sans géographie précise. La tragédie des minorités, celle des camps d’extermination, celle des femmes et des hommes réduits à l’état de blatte. La tragédie des révolutions vaines, celle des massacrés. La tragédie des peuples en guerre. Une humanité à bout de souffle de demain et d’aujourd’hui, fantasmée ou vécue. Tels sont les livres d’Antoine Volodine qui, ne désirant pas être rattaché à la SF et à toutes ses nuances associées (dont le fameux post-apocalyptique justement), a proposé le terme de post-exotisme. Je ne crois pas avoir lu un jour un écrit qui s’en rapproche. Et des deux seuls livres que j’ai lu de lui, ma première rencontre avec l’auteur ayant eu lieu avec « Des anges mineurs », je retrouve la même ambiance, les mêmes références, les mêmes obsessions. Je le pressens, entre les livres d’Antoine Volodine, des liens sont tissés, et sa bibliographie forme très probablement une toile d’une incroyable inventivité, sans doute partagent-ils des personnages communs comme j’ai cru le comprendre dans certaines critiques, notamment celles de Suz (Bobby-the-Rasta-Lama) et Paul (Bobfutur) pour ne pas les nommer, voire des réponses croisées à des questions laissées en suspens.
Dondog. Dondog Balbaïan. Les personnages d’Antoine Volodine ont toujours des noms incroyables à l’exotisme slave souvent, latino par moment. Après avoir passé trente années dans un camp d’extermination des Ybürs, Dondog Balbaïan sent qu’il n’en a plus pour très longtemps et désire, avant de mourir, tuer les responsables de son malheur et du malheur des siens. Souffrant d’amnésie, il ne se souvient que vaguement de son passé, et trois noms de bourreaux hantent son esprit : Gulmuz Korsakov, Tonny Bronx et sans doute, mais il n’en est pas certain, Éliane Hotchkiss. Les personnages s’entrecroisent, les identités se multiplient, les anecdotes inoubliables éclosent, les allers retours entre présent et passé expliquant les raisons de la vengeance ponctuent le récit. Cependant, nous comprenons peu à peu que, avec sa mémoire déclinante, il ne sait plus trop quoi leur reprocher à ces bonshommes-là, alors pour donner un sens à sa vengeance, il s’invente une biographie tragique. Les anecdotes inoubliables sont les fruits de son imagination, de ce passé réinventé lui donnant des raisons de haïr. Mais Dondog n’est pas mû par une énergie vive, son combat est juste pour la forme, l’humanité étant quasiment réduite à l’état d’insecte, à moins que ce ne soit les insectes qui peu à peu se rabaissent au même niveau que nous…
« Un cafard partiellement écrasé se débattait alors sous un talon de Dondog, le droit il me semble. Il se débattait pour la forme. Nul ne l’avait remarqué et, au fond, il était comme nous, il commençait à se désintéresser de son avenir ».
La traque est-elle utile lorsque les bourreaux sont déjà morts ? N’est-elle pas symbolique, conceptuelle, et cette traque n’est-elle pas celle qui a lieu à l’intérieur de nos têtes, là où se nichent véritablement ceux que nous poursuivons ? Qu’est-ce que la vengeance, si ce n’est un reste désespéré d’humanité, lorsque nous réalisons que la personne détestée sera un jour moins qu’une pourriture, a-t-elle un sens ? Sur ce dernier point, le chapitre intitulé « la maitresse » est, selon moi, un morceau d’anthologie, un passage d’une beauté gothique que je ne suis pas prête d’oublier, où comment relativiser lorsque l’injustice nous pousse au désespoir.
« Maintenant la maîtresse de Dondog repose sous une pierre tombale, maintenant elle gît, maintenant la maîtresse repose et se décompose, on pourrait imaginer sa sépulture par exemple dans un petit cimetière de campagne, à la lisière d’une forêt de sapins, près des champs en friche et près d’une grange délabrée, les os de la maîtresse bientôt auront perdu toute la viscosité de la vie, son corps de maîtresse deviendra humus puis descendra plus bas encore dans l’échelle de la non-vie et perdra la viscosité, l’élasticité, le droit à la fermentation ralentie ou grouillante de la vie, maintenant la maîtresse de Dondog va cesser de fermenter et elle va entamer sa descente et devenir un ensemble filamenteux et friable que nul ne pourra nommer ni écouter ni voir. Voilà à quoi bientôt elle sera réduite, dit Dondog. Tout son être se sera décharné jusqu’à la poussière et se sera effacé. Tout aura rejoint les magmas non vivants de la terre. Et quand je dis tout, je pense en priorité aux mains qui, dans les marges des cahiers de Dondog, si souvent inscrivaient des annotations malveillantes, et aux yeux qui ont relu le texte de la dénonciation accusant injustement Dondog, ou encore à la langue de la maîtresse qui a léché le bord de l’enveloppe pour la cacheter ; tout cela se dispersera au milieu de la terre non vivante ».
Dondog alors si éloigné des chamanes, comme Gabriella Bruna, son ancêtre, pour qui la mort n’est qu’un passage, l’existence se poursuivant après le décès. Lui réinvente le passé tandis qu’elle voyait le futur. La vision crépusculaire offerte dans le livre est-elle la réalité ou juste la vision d’un Dondog à l’agonie, aux gestes ralentis, à l’intelligence décroissante, à la mémoire confuse ? Provient-elle uniquement de son imagination et de la biographie réinventée ? C’est à mon sens un cauchemar s’appuyant sur le chant des opprimés, lorsque l’homme n’est plus qu’un loup pour l’homme. Lorsque l’humanité est réduite à une poignée de survivants. Lorsqu’il ne reste que les ruines de la Révolution mondiale.
Une mise en scène, une narration mélancolique ce récit dans lequel Volodine lui-même se met en scène dans une mise en abîme vertigineuse, par la voix de Dondog lui-même, pour nous parler du post-exostisme comme autant de petits cailloux offerts aux lecteurs, petits Poucets en quête de sens, de liens, de communion. Et nous en redemandons, fous que nous sommes à aimer nous engluer en ces terres poisseuses, à tenter de décoller ces cailloux aux arrêtes coupantes, signes éphémères de compréhension de ce récit halluciné.
Mille et une interrogations, mille et une mises en abîme, milles et une belles étrangetés, comme autant de fleurs noires lancées au vent, des fleurs de bunker, des coquelicots sanglants sortis sauvagement des fissures du béton. Une poésie du désespoir. Cette poésie finalement unique et seule preuve d’humanité. Je n’ai certainement pas tout compris, il me reste tant à lire de cet auteur, à créer mes liens, à définir mieux le post-exotisme, mais j’ai compris une chose au moins : j’aime passionnément les écrits d’Antoine Volodine.
Et pourtant…Pourtant nous plongeons dans un monde noir, totalement noir, d’une noirceur si absolue qu’il en devient lyrique. D’une telle monstruosité qu’il en devient poétique. La cité dans laquelle nous convie Antoine Volodine est obscure, putride, poussiéreuse, quelques survivants dont les cafards et les gueux se partagent quelques vieux blocs de béton fissurés et de ginguois. Dans une chaleur épouvantable, l’air est saturé d’odeurs nauséabondes, ail frit, entrailles de poisson, chien mouillé, câbles surchauffés, gaz, ferraille rouillée, humidité crasseuse, « il sentait les taudis où survivent gueux et Untermenschen, il sentait la pisse de rat, la décomposition, la vieillesse infâme de presque toute chose ». Les débris et les déchets jonchent chaque centimètre carré de sorte que se succèdent sous la pulpe des doigts seulement nids de poussières humides, aspérités friables, pointes. Aucune surface propre, aucune surface lisse. Aucune douceur, pas de répit. Les cafards se chevauchent les uns sur les autres, l’eau goutte de toutes les habitations, les bruits sont grinçants et métalliques. Dense, inextricable, insalubre, tel est le décor de « Dondog ». Bienvenue en terres volodiniennes vous dis-je ! Bienvenue dans cette chambre numéro 4A d’un immeuble de la Cité :
« Trop d’années s’étaient égrenées sans que quiconque entrât pour nettoyer ou aérer. C’est pourquoi des champignons noirs avaient proliféré dans la chaleur humide de l’été et dans le froid humide de la saison froide, et une couche duveteuse avait pris possession de toutes les surfaces. Les meubles sombraient sous leur lèpre, le sofa paraissait transformé en piège gluant, le linoléum du sol avait été comme aspergé d’une colle brunâtre. Au plafond et sur les murs s’épanouissaient d’immense tâches velues, à dominante charbonneuse mais avec des nuances : aile de corbeau, aile de chauve-souris, ou bistre, anthracite, poussière d’anthracite. L’oxygène avait disparu. Une intense puanteur de moisi l’avait remplacé (…) Il nagea à travers la semi-pénombre suffocante, avec l’intention d’ouvrir ou de fracasser la porte-fenêtre du balcon. Un rideau pendait devant la vitre. Il s’en empara. L’étoffe aussitôt se déchira, libérant environ sept cent soixante-deux papillons miniatures, d’un gris terne qui n’incitait pas à l’indulgence envers les lépidoptères. Les bestioles se mirent à voleter massivement en tous sens. Elles tournoyaient dans un total silence. Des mites, commenta Marconi ».
Qu’il est bon curieusement de sonder ce puits sans fond, de s’y laisser tomber. Et pourtant…Pourtant nous avançons hébétés dans une contrée située « entre la steppe mongole, la taïga sibérienne et le béton soviétique », dans laquelle la mafia règne en maître, les ethnies se mélangent, les frontières entre rêve et réalité sont poreuses, les stigmates de combats béent sans aucune pudeur. Elle a la tessiture granuleuse, ou plutôt grumeleuse, du cauchemar cette sorte de post-post-post apocalyptique dans laquelle l’humanité est à bout de souffle, donc dans un futur très lointain on peut le penser de prime abord, mais en réalité une tragédie d’hier et d’aujourd’hui. Atemporelle et sans géographie précise. La tragédie des minorités, celle des camps d’extermination, celle des femmes et des hommes réduits à l’état de blatte. La tragédie des révolutions vaines, celle des massacrés. La tragédie des peuples en guerre. Une humanité à bout de souffle de demain et d’aujourd’hui, fantasmée ou vécue. Tels sont les livres d’Antoine Volodine qui, ne désirant pas être rattaché à la SF et à toutes ses nuances associées (dont le fameux post-apocalyptique justement), a proposé le terme de post-exotisme. Je ne crois pas avoir lu un jour un écrit qui s’en rapproche. Et des deux seuls livres que j’ai lu de lui, ma première rencontre avec l’auteur ayant eu lieu avec « Des anges mineurs », je retrouve la même ambiance, les mêmes références, les mêmes obsessions. Je le pressens, entre les livres d’Antoine Volodine, des liens sont tissés, et sa bibliographie forme très probablement une toile d’une incroyable inventivité, sans doute partagent-ils des personnages communs comme j’ai cru le comprendre dans certaines critiques, notamment celles de Suz (Bobby-the-Rasta-Lama) et Paul (Bobfutur) pour ne pas les nommer, voire des réponses croisées à des questions laissées en suspens.
Dondog. Dondog Balbaïan. Les personnages d’Antoine Volodine ont toujours des noms incroyables à l’exotisme slave souvent, latino par moment. Après avoir passé trente années dans un camp d’extermination des Ybürs, Dondog Balbaïan sent qu’il n’en a plus pour très longtemps et désire, avant de mourir, tuer les responsables de son malheur et du malheur des siens. Souffrant d’amnésie, il ne se souvient que vaguement de son passé, et trois noms de bourreaux hantent son esprit : Gulmuz Korsakov, Tonny Bronx et sans doute, mais il n’en est pas certain, Éliane Hotchkiss. Les personnages s’entrecroisent, les identités se multiplient, les anecdotes inoubliables éclosent, les allers retours entre présent et passé expliquant les raisons de la vengeance ponctuent le récit. Cependant, nous comprenons peu à peu que, avec sa mémoire déclinante, il ne sait plus trop quoi leur reprocher à ces bonshommes-là, alors pour donner un sens à sa vengeance, il s’invente une biographie tragique. Les anecdotes inoubliables sont les fruits de son imagination, de ce passé réinventé lui donnant des raisons de haïr. Mais Dondog n’est pas mû par une énergie vive, son combat est juste pour la forme, l’humanité étant quasiment réduite à l’état d’insecte, à moins que ce ne soit les insectes qui peu à peu se rabaissent au même niveau que nous…
« Un cafard partiellement écrasé se débattait alors sous un talon de Dondog, le droit il me semble. Il se débattait pour la forme. Nul ne l’avait remarqué et, au fond, il était comme nous, il commençait à se désintéresser de son avenir ».
La traque est-elle utile lorsque les bourreaux sont déjà morts ? N’est-elle pas symbolique, conceptuelle, et cette traque n’est-elle pas celle qui a lieu à l’intérieur de nos têtes, là où se nichent véritablement ceux que nous poursuivons ? Qu’est-ce que la vengeance, si ce n’est un reste désespéré d’humanité, lorsque nous réalisons que la personne détestée sera un jour moins qu’une pourriture, a-t-elle un sens ? Sur ce dernier point, le chapitre intitulé « la maitresse » est, selon moi, un morceau d’anthologie, un passage d’une beauté gothique que je ne suis pas prête d’oublier, où comment relativiser lorsque l’injustice nous pousse au désespoir.
« Maintenant la maîtresse de Dondog repose sous une pierre tombale, maintenant elle gît, maintenant la maîtresse repose et se décompose, on pourrait imaginer sa sépulture par exemple dans un petit cimetière de campagne, à la lisière d’une forêt de sapins, près des champs en friche et près d’une grange délabrée, les os de la maîtresse bientôt auront perdu toute la viscosité de la vie, son corps de maîtresse deviendra humus puis descendra plus bas encore dans l’échelle de la non-vie et perdra la viscosité, l’élasticité, le droit à la fermentation ralentie ou grouillante de la vie, maintenant la maîtresse de Dondog va cesser de fermenter et elle va entamer sa descente et devenir un ensemble filamenteux et friable que nul ne pourra nommer ni écouter ni voir. Voilà à quoi bientôt elle sera réduite, dit Dondog. Tout son être se sera décharné jusqu’à la poussière et se sera effacé. Tout aura rejoint les magmas non vivants de la terre. Et quand je dis tout, je pense en priorité aux mains qui, dans les marges des cahiers de Dondog, si souvent inscrivaient des annotations malveillantes, et aux yeux qui ont relu le texte de la dénonciation accusant injustement Dondog, ou encore à la langue de la maîtresse qui a léché le bord de l’enveloppe pour la cacheter ; tout cela se dispersera au milieu de la terre non vivante ».
Dondog alors si éloigné des chamanes, comme Gabriella Bruna, son ancêtre, pour qui la mort n’est qu’un passage, l’existence se poursuivant après le décès. Lui réinvente le passé tandis qu’elle voyait le futur. La vision crépusculaire offerte dans le livre est-elle la réalité ou juste la vision d’un Dondog à l’agonie, aux gestes ralentis, à l’intelligence décroissante, à la mémoire confuse ? Provient-elle uniquement de son imagination et de la biographie réinventée ? C’est à mon sens un cauchemar s’appuyant sur le chant des opprimés, lorsque l’homme n’est plus qu’un loup pour l’homme. Lorsque l’humanité est réduite à une poignée de survivants. Lorsqu’il ne reste que les ruines de la Révolution mondiale.
Une mise en scène, une narration mélancolique ce récit dans lequel Volodine lui-même se met en scène dans une mise en abîme vertigineuse, par la voix de Dondog lui-même, pour nous parler du post-exostisme comme autant de petits cailloux offerts aux lecteurs, petits Poucets en quête de sens, de liens, de communion. Et nous en redemandons, fous que nous sommes à aimer nous engluer en ces terres poisseuses, à tenter de décoller ces cailloux aux arrêtes coupantes, signes éphémères de compréhension de ce récit halluciné.
Mille et une interrogations, mille et une mises en abîme, milles et une belles étrangetés, comme autant de fleurs noires lancées au vent, des fleurs de bunker, des coquelicots sanglants sortis sauvagement des fissures du béton. Une poésie du désespoir. Cette poésie finalement unique et seule preuve d’humanité. Je n’ai certainement pas tout compris, il me reste tant à lire de cet auteur, à créer mes liens, à définir mieux le post-exotisme, mais j’ai compris une chose au moins : j’aime passionnément les écrits d’Antoine Volodine.
Parmi les écrits d’Antoine Volodine & Cie, les grands romans parus au Seuil sont à distinguer.
S’il était encore nécessaire de parler en terme de construction, ils en seraient les poutres : narrations au long cours, véritables trames romanesques, structures narrées de manière sérieuse.
De solides histoires, se déroulant dans des mondes qui le sont beaucoup moins, où narrateurs, personnages et spectateurs tentent de se raccrocher à des lambeaux de vie normale au milieu d’environnements en décomposition.
…
Ces Songes sont bien une manière élégante et vaguement désespérée de nous conter la difficile expérience d’une traversée du Bardo, équivalent tibétain de notre purgatoire, 49 chapitres dans cet univers noir.
…
La réussite de ce roman tient dans sa progression physique et géo-mentale ininterrompue, étageant ses différentes strates de réalités sans nécessité d’en consulter la carte, les quelques recours à la magie semblant plus vrais que nature.
…
Des oiseaux-mutants en sont les gardiens, ou peut-être simplement les prisonniers.
Le folklore post-historique y reste discret, nous situant dans une capitale orientale de l’Eurasie, si un tel lieu pouvait exister.
…
Rien n’y est facile, et pourtant, tout s’y passe naturellement.
La noirceur absolue qui y règne ne nous fait jamais perdre de vue la malice de son créateur ; on se prend même à sourire, à rêver et à rire, alors que toute couleur a disparu.
…
Un essentiel morceau d’histoire post-exotique, pas le premier ni le dernier, pour continuer son chemin…
S’il était encore nécessaire de parler en terme de construction, ils en seraient les poutres : narrations au long cours, véritables trames romanesques, structures narrées de manière sérieuse.
De solides histoires, se déroulant dans des mondes qui le sont beaucoup moins, où narrateurs, personnages et spectateurs tentent de se raccrocher à des lambeaux de vie normale au milieu d’environnements en décomposition.
…
Ces Songes sont bien une manière élégante et vaguement désespérée de nous conter la difficile expérience d’une traversée du Bardo, équivalent tibétain de notre purgatoire, 49 chapitres dans cet univers noir.
…
La réussite de ce roman tient dans sa progression physique et géo-mentale ininterrompue, étageant ses différentes strates de réalités sans nécessité d’en consulter la carte, les quelques recours à la magie semblant plus vrais que nature.
…
Des oiseaux-mutants en sont les gardiens, ou peut-être simplement les prisonniers.
Le folklore post-historique y reste discret, nous situant dans une capitale orientale de l’Eurasie, si un tel lieu pouvait exister.
…
Rien n’y est facile, et pourtant, tout s’y passe naturellement.
La noirceur absolue qui y règne ne nous fait jamais perdre de vue la malice de son créateur ; on se prend même à sourire, à rêver et à rire, alors que toute couleur a disparu.
…
Un essentiel morceau d’histoire post-exotique, pas le premier ni le dernier, pour continuer son chemin…
Il suffirait d’écrire ceci :
« Une fois de plus, on a devant soi un exemple de l’insolence post-exotique, telle que depuis ses origines littéraires elle s’est affirmée : dire entre soi des histoires, murmurer ou gronder de violentes visions, habiter des terres parallèles, transmettre images et ambiances, provoquer l’exil et la transe, mais laisser à l’écart l'ennemi, toujours rôdant quelque part parmi les auditeurs, le laissant agacé et impuissant, le laisser ferrailler contre des cuirasses imperçables, derrière lesquelles rien d’important ne se dissimule ; construire entre soi des univers romanesques, une prose lyrique à plusieurs niveaux et chemins de lecture, dont au moins un passe par l’inconscient verrouillé des prisonniers et prisonnières qui disent, qui chuchotent, qui hurlent ou qui se taisent. L’insolence guerrière, le camouflage, la prudence et l’habileté se combinent et, pour les sympathisants, elles font l’image. »
Clair.
« Une fois de plus, on a devant soi un exemple de l’insolence post-exotique, telle que depuis ses origines littéraires elle s’est affirmée : dire entre soi des histoires, murmurer ou gronder de violentes visions, habiter des terres parallèles, transmettre images et ambiances, provoquer l’exil et la transe, mais laisser à l’écart l'ennemi, toujours rôdant quelque part parmi les auditeurs, le laissant agacé et impuissant, le laisser ferrailler contre des cuirasses imperçables, derrière lesquelles rien d’important ne se dissimule ; construire entre soi des univers romanesques, une prose lyrique à plusieurs niveaux et chemins de lecture, dont au moins un passe par l’inconscient verrouillé des prisonniers et prisonnières qui disent, qui chuchotent, qui hurlent ou qui se taisent. L’insolence guerrière, le camouflage, la prudence et l’habileté se combinent et, pour les sympathisants, elles font l’image. »
Clair.
Sept nouvelles pour nous conter les quarante-neuf jours passés dans le Bardo, monde intermédiaire entre la mort et la vie de la tradition tibétaine.
Sept fois plongé dans une quasi-obscurité, un certain humour, à la limite de l’auto-parodie, comme fil d’Ariane pour y déployer toute sa mythologie.
…
Le post-exotisme volodinien est un oracle que l’on vient parfois consulter, un pilier bien esseulé d’une certaine littérature française.
…
Avec sa plume d’une apparente simplicité, il déploie toute sa capacité narrative et visionnaire, comme dans sa première nouvelle, où il trouve le moyen de multiplier les narrateurs, nous y incluant tous.
…
Il réussi toujours à évoquer, avec malice, les grands combats sociaux, dont il se sert comme glyphe pour raconter son histoire humaine, forcément emprunte de radicalité. En quelques mots et images, il y synthétise ce qu’une bibliographie complète, à force de tourner autour, n’arriverait qu’à éparpiller.
…
Il est le genre d’écrivain dont l’oeuvre entière est une et unique. Souvent copié, ses inspirés n’ayant toujours pas daigné lui rendre hommage en se réclamant de son mouvement d’après l’exotisme. J’avais déjà cité à ce propos Joël Casséus (« Crépuscules »); son nouveau livre, feuilleté dans une librairie « militante », s’enfonce davantage dans la parenté, mais toujours en restant de son côté, défaut quasi-patenté de celles et ceux voulant à tout prix déconstruire.
…
Lorsque les quarante-neuf portes d’entrée auront été ouvertes.
Sept fois plongé dans une quasi-obscurité, un certain humour, à la limite de l’auto-parodie, comme fil d’Ariane pour y déployer toute sa mythologie.
…
Le post-exotisme volodinien est un oracle que l’on vient parfois consulter, un pilier bien esseulé d’une certaine littérature française.
…
Avec sa plume d’une apparente simplicité, il déploie toute sa capacité narrative et visionnaire, comme dans sa première nouvelle, où il trouve le moyen de multiplier les narrateurs, nous y incluant tous.
…
Il réussi toujours à évoquer, avec malice, les grands combats sociaux, dont il se sert comme glyphe pour raconter son histoire humaine, forcément emprunte de radicalité. En quelques mots et images, il y synthétise ce qu’une bibliographie complète, à force de tourner autour, n’arriverait qu’à éparpiller.
…
Il est le genre d’écrivain dont l’oeuvre entière est une et unique. Souvent copié, ses inspirés n’ayant toujours pas daigné lui rendre hommage en se réclamant de son mouvement d’après l’exotisme. J’avais déjà cité à ce propos Joël Casséus (« Crépuscules »); son nouveau livre, feuilleté dans une librairie « militante », s’enfonce davantage dans la parenté, mais toujours en restant de son côté, défaut quasi-patenté de celles et ceux voulant à tout prix déconstruire.
…
Lorsque les quarante-neuf portes d’entrée auront été ouvertes.
"Lorsque le monde lui déplaît sous tous ses angles, l'écrivain, sur le papier, métamorphose le tissu de la vérité."
(p.31)
"C'est l'histoire d'un homme. De deux hommes. En fait, ils sont trois. Aram, Matko et Will MacGrodno..."
... Mais c'est aussi l'histoire d'une altiste qui bouleverse son auditoire, d'un oiseau aux ailes coupées nommé Ragojine, d'un écrivain et d'une peintre épris de liberté, d'un clown de cirque obsédé par la mort et d'un voleur de chevaux qui a vendu son âme aux forces obscures.
Mais avant toute chose, c'est l'histoire d'un concert de musique classique qui a mal tourné.
Les noms étranges de toute beauté (pensez-en ce que vous voulez, mais j'ai toujours un frisson de plaisir quand je croise des personnages littéraires qui portent des noms comme Will MacGrodno, Baxir Kodek, Salvara Dradjia ou Hakatia Badrinourbat) ainsi que l'indéfinissable atmosphère qui nous enveloppe dès les premières lignes indiquent clairement que le monde dans lequel on se trouve n'est pas réel, malgré toutes les similitudes avec le notre. C'est le monde post-exotique de Volodine, hors de l'espace et du temps. Construit sur des ruines, incertain et plein de dangers.
Trois hommes sortent de prison, et errent dans la ville de Chamrouche gouvernée par les frondistes - parti populiste dirigé par un homme au nom évocateur de Balynt Zagoebel. L'araignée qui décore son brassard prend inexorablement la ville dans sa toile, tandis que quelque part dans "l'Hémisphère Sud" se trouve encore la "zone libre"... mais elle semble bien loin.
A Chamrouche, une étincelle de liberté pourrait potentiellement illuminer le théâtre où le concert d'un quatuor à cordes se prépare pour cette belle soirée printanière du 27 mai. Le choix du répertoire est osé, loin du goût des dirigeants politiques. Le spectacle n'est pas interdit, mais s'y rendre représente un défi : une affirmation publique de ses convictions.
Les divers protagonistes du drame final - tous des solitaires, étrangers dans leur propre pays - se croisent à peine au fil de pages, mais ils finiront tous par se retrouver le soir dans la même salle : les prisonniers politiques, les "oiseaux", les "nègues", les suspects opposants au régime, les artistes et les intellectuels qui ont tout juste le droit de se taire.
Or, désormais c'est Balynt Zagoebel qui décide à quoi doit ressembler la culture à Chamrouche, et il prépare à son tour un grand meeting-spectacle sur la place devant le théâtre. Les artistes du cirque Vanzetti (un bon nom italien pour un cirque, mais lourd de sens) seront recrutés de force afin de donner un peu de peps à cette manifestation d'abrutissement collectif : chanter, danser, hurler les slogans et rire de tout, même des saltimbanques poussés à l'extrême. Le peuple n'a pas besoin de douteuses distractions élitistes, il a besoin de s'amuser. Panem et circenses, entrez dans la ronde ! Fournissez un amusement populaire à la population, et vous serez populaire. Et quand vous serez populaire, le monde sera à vous.
Les mélomanes au théâtre ne sont pas nombreux. Ils entrent la tête haute et le coeur serré, en pensant à la foule fanatisée qui se rassemble dehors. Les frondistes ont d'ailleurs acheté la plupart des places dans la salle, et ils s'installent en souriant, tandis que le malaise et l'anxiété montent, ainsi que le pressentiment d'une "soirée affreuse, angoissée et angoissante".
"Alto Solo" est un court roman - seulement trois chapitres, dont le deuxième est raconté à la première personne par l'écrivain Iakoub Khadjabakiro - et pourtant, tant est dit !
De tout ce que j'ai pu lire de Volodine, c'est le récit le plus "réaliste", ouvertement conçu comme un multiple avertissement, et presque dépourvu de cet humour détaché typique de ce gracieux barde du bardo. Mais tout est encore une fois soigneusement brassé dans le magique chaudron post-exotique rempli comme d'habitude d'un bouillon acide de merveilleux poétisme sombre, des néologismes et de l'atmosphère unique. Volodine (accessoirement Khadjabakiro ?) fait de la ville de Chamrouche une allégorie du régime totalitaire, avec sa pensée unique et sa culture unique.
Mais il y aura toujours des drôles d'oiseaux qui n'auront pas envie de se joindre à la beuglante queue leu leu, quitte à prendre un envol risqué, et c'est à eux qu'est dédiée cette histoire.
4/5 : dans mon palmarès privé, aucun autre roman de Volodine ne peut surpasser les lueurs éclatantes de "Terminus Radieux", mais ces événements du 27 mai à Chamrouche méritent une mention spéciale.
(p.31)
"C'est l'histoire d'un homme. De deux hommes. En fait, ils sont trois. Aram, Matko et Will MacGrodno..."
... Mais c'est aussi l'histoire d'une altiste qui bouleverse son auditoire, d'un oiseau aux ailes coupées nommé Ragojine, d'un écrivain et d'une peintre épris de liberté, d'un clown de cirque obsédé par la mort et d'un voleur de chevaux qui a vendu son âme aux forces obscures.
Mais avant toute chose, c'est l'histoire d'un concert de musique classique qui a mal tourné.
Les noms étranges de toute beauté (pensez-en ce que vous voulez, mais j'ai toujours un frisson de plaisir quand je croise des personnages littéraires qui portent des noms comme Will MacGrodno, Baxir Kodek, Salvara Dradjia ou Hakatia Badrinourbat) ainsi que l'indéfinissable atmosphère qui nous enveloppe dès les premières lignes indiquent clairement que le monde dans lequel on se trouve n'est pas réel, malgré toutes les similitudes avec le notre. C'est le monde post-exotique de Volodine, hors de l'espace et du temps. Construit sur des ruines, incertain et plein de dangers.
Trois hommes sortent de prison, et errent dans la ville de Chamrouche gouvernée par les frondistes - parti populiste dirigé par un homme au nom évocateur de Balynt Zagoebel. L'araignée qui décore son brassard prend inexorablement la ville dans sa toile, tandis que quelque part dans "l'Hémisphère Sud" se trouve encore la "zone libre"... mais elle semble bien loin.
A Chamrouche, une étincelle de liberté pourrait potentiellement illuminer le théâtre où le concert d'un quatuor à cordes se prépare pour cette belle soirée printanière du 27 mai. Le choix du répertoire est osé, loin du goût des dirigeants politiques. Le spectacle n'est pas interdit, mais s'y rendre représente un défi : une affirmation publique de ses convictions.
Les divers protagonistes du drame final - tous des solitaires, étrangers dans leur propre pays - se croisent à peine au fil de pages, mais ils finiront tous par se retrouver le soir dans la même salle : les prisonniers politiques, les "oiseaux", les "nègues", les suspects opposants au régime, les artistes et les intellectuels qui ont tout juste le droit de se taire.
Or, désormais c'est Balynt Zagoebel qui décide à quoi doit ressembler la culture à Chamrouche, et il prépare à son tour un grand meeting-spectacle sur la place devant le théâtre. Les artistes du cirque Vanzetti (un bon nom italien pour un cirque, mais lourd de sens) seront recrutés de force afin de donner un peu de peps à cette manifestation d'abrutissement collectif : chanter, danser, hurler les slogans et rire de tout, même des saltimbanques poussés à l'extrême. Le peuple n'a pas besoin de douteuses distractions élitistes, il a besoin de s'amuser. Panem et circenses, entrez dans la ronde ! Fournissez un amusement populaire à la population, et vous serez populaire. Et quand vous serez populaire, le monde sera à vous.
Les mélomanes au théâtre ne sont pas nombreux. Ils entrent la tête haute et le coeur serré, en pensant à la foule fanatisée qui se rassemble dehors. Les frondistes ont d'ailleurs acheté la plupart des places dans la salle, et ils s'installent en souriant, tandis que le malaise et l'anxiété montent, ainsi que le pressentiment d'une "soirée affreuse, angoissée et angoissante".
"Alto Solo" est un court roman - seulement trois chapitres, dont le deuxième est raconté à la première personne par l'écrivain Iakoub Khadjabakiro - et pourtant, tant est dit !
De tout ce que j'ai pu lire de Volodine, c'est le récit le plus "réaliste", ouvertement conçu comme un multiple avertissement, et presque dépourvu de cet humour détaché typique de ce gracieux barde du bardo. Mais tout est encore une fois soigneusement brassé dans le magique chaudron post-exotique rempli comme d'habitude d'un bouillon acide de merveilleux poétisme sombre, des néologismes et de l'atmosphère unique. Volodine (accessoirement Khadjabakiro ?) fait de la ville de Chamrouche une allégorie du régime totalitaire, avec sa pensée unique et sa culture unique.
Mais il y aura toujours des drôles d'oiseaux qui n'auront pas envie de se joindre à la beuglante queue leu leu, quitte à prendre un envol risqué, et c'est à eux qu'est dédiée cette histoire.
4/5 : dans mon palmarès privé, aucun autre roman de Volodine ne peut surpasser les lueurs éclatantes de "Terminus Radieux", mais ces événements du 27 mai à Chamrouche méritent une mention spéciale.
Aborder l'univers d'Antoine Volodine c'est un peu comme entrer dans une cathédrale gothique, on y entre le pas hésitant face à une architecture complexe et imposante baignée par une lumière crépusculaire. Le regard ébahi devant une littérature du désastre bien singulière, un roman d'aventures et de mythes à la surface duquel scintille une poésie du délabrement.
Terminus radieux c'est l'échec de la seconde révolution soviétique, vraisemblablement sur le territoire russe même si les repères spatio-temporels sont déformés, avec des territoires en ruine, un no man's land irradié dans lequel erre une humanité à bout de souffle.
Terminus radieux c'est surtout une atmosphère étrange puis léthargique qui pénètre en vous. Il y a bien sûr cette radioactivité invisible et mortifère qui installe le récit dans un sentiment particulier. Mais l'auteur nous entraîne dans une vision hallucinée du réel qui dérape et tente de se reconfigurer de manière fuyante. On s'y perd parfois comme s'égare le personnage de Kronauer, un déserteur qui dans sa fuite se retrouve dans un kolkhoze tenu d'une main de fer par un sorcier adepte des pratiques chamaniques et incestueuses. Oui quelques énergumènes subsistent dans cet espace inhospitalier ravagé par des centrales nucléaires qui n'en font qu'à leur tête.
L'auteur introduit tant d'incertitude et de dissonance que l'on se retrouve au cours de cette lecture un peu hébété.On tente alors de s'accrocher à des indices, des éléments significatifs avant de se rendre compte que finalement ce n'est qu'illusion, souvenir, obsession. On progresse dans la lecture avec la sensation d'être en plein sommeil paradoxal, cette phase où, la conscience brumeuse, les rêves sont surréalistes avec des images floues et inachevées. Peut-être parce que la réalité est tellement brutale qu'il vaut mieux inscrire le récit dans un univers intermédiaire et voir les personnages se réfugier dans une dimension onirique et absurde. Seule voie possible lorsque subsiste la nostalgie d'un idéal égalitaire alors que l'avenir semble être une vaine perspective, une lente décrépitude physique et mentale, un voyage vers la mort interminable...
Véritable curiosité, comme celles que l'on exposait dans les cabinets au 18e siècle, Terminus radieux est fascinant par la poésie de la noirceur qu'il dégage. Elle investit le roman d'un ton unique qui fait qu'on est rapidement absorbé par la lecture malgré la sensation d'apathie qui infuse à travers le récit.
Cette première incursion dans le post-exotisme sans savoir si Terminus radieux est particulièrement représentatif de ce courant, ponctué de quelques traits d'humour, fut un excellent moment de lecture.
Terminus radieux c'est l'échec de la seconde révolution soviétique, vraisemblablement sur le territoire russe même si les repères spatio-temporels sont déformés, avec des territoires en ruine, un no man's land irradié dans lequel erre une humanité à bout de souffle.
Terminus radieux c'est surtout une atmosphère étrange puis léthargique qui pénètre en vous. Il y a bien sûr cette radioactivité invisible et mortifère qui installe le récit dans un sentiment particulier. Mais l'auteur nous entraîne dans une vision hallucinée du réel qui dérape et tente de se reconfigurer de manière fuyante. On s'y perd parfois comme s'égare le personnage de Kronauer, un déserteur qui dans sa fuite se retrouve dans un kolkhoze tenu d'une main de fer par un sorcier adepte des pratiques chamaniques et incestueuses. Oui quelques énergumènes subsistent dans cet espace inhospitalier ravagé par des centrales nucléaires qui n'en font qu'à leur tête.
L'auteur introduit tant d'incertitude et de dissonance que l'on se retrouve au cours de cette lecture un peu hébété.On tente alors de s'accrocher à des indices, des éléments significatifs avant de se rendre compte que finalement ce n'est qu'illusion, souvenir, obsession. On progresse dans la lecture avec la sensation d'être en plein sommeil paradoxal, cette phase où, la conscience brumeuse, les rêves sont surréalistes avec des images floues et inachevées. Peut-être parce que la réalité est tellement brutale qu'il vaut mieux inscrire le récit dans un univers intermédiaire et voir les personnages se réfugier dans une dimension onirique et absurde. Seule voie possible lorsque subsiste la nostalgie d'un idéal égalitaire alors que l'avenir semble être une vaine perspective, une lente décrépitude physique et mentale, un voyage vers la mort interminable...
Véritable curiosité, comme celles que l'on exposait dans les cabinets au 18e siècle, Terminus radieux est fascinant par la poésie de la noirceur qu'il dégage. Elle investit le roman d'un ton unique qui fait qu'on est rapidement absorbé par la lecture malgré la sensation d'apathie qui infuse à travers le récit.
Cette première incursion dans le post-exotisme sans savoir si Terminus radieux est particulièrement représentatif de ce courant, ponctué de quelques traits d'humour, fut un excellent moment de lecture.
Bienvenue dans ce Volodinistan que mon amie HordeDuContrevent aime tant, bienvenue dans cette extraordinaire perle du « postexotéisme » inventée par Antoine Volodine, bienvenue dans ces quarante-neuf narrats ou moments de prose qui composent l'ossature Des anges mineurs. On entre dans cette littérature comme on entre en religion, avec toutes ses croyances et tous ses doutes. On se noie dans les mots de cet auteur comme on peut se noyer dans le torrent impétueux et sauvage d'une montagne. L'univers raconté ici, est post apocalyptique. C'est un monde où tout se meurt, où tout est en voie de disparition. Où les hommes et les femmes sont devenus aussi rares que les anges et les dieux.
Nous nous attachons au cours de cette histoire à quelques survivants. Des hommes tout d'abord comme Enzo Mardirossian, le régleur de larmes ou Fred Zenfl, le dernier écrivain de cette terre; des femmes aussi comme les deux belles Djaliyla Solaris et Bella Mardirossian ou la forte Babaïa Schtern, prisonnière du neuvième étage d'un immeuble en ruine où ses fils l'engraissent dans le but inavouable de la manger, sans oublier la Rita Arsenal ou le Robby Milioutine. Antoine Volodine va tenter tout au long de son livre, de nous dresser le portrait d'une dizaine de personnages. Mais comme il nous l'affirme haut et fort au début de son oeuvre, cette description ressemble plus à « une photographie truquée, qui rend difficile la perception des traces laissées par ces êtres».
Le personnage principal de ce quasi-conte moderne se nomme Will Scheidmann. On découvre au fur et à mesure de la lecture que c'est lui le véritable narrateur. Et quand je dis on, c'est pour dire lui…C'est dans ces déserts urbains aux immeubles vides, sur cette terre de brique rouge où la vie est en voie d'extinction, qu'un groupe de vieillardes immortelles et amnésiques cherchent à lui donner vie. Ces vieilles sorcières mongoles vont à partir de morceaux de chiffon et d'incantations chamaniques, animer un poupon de chiffons, plutôt une sorte de golem en chiffons. Et ce golem incarné par Will scheidmann n'aura de cesse comme dans le mythe de se retourner contre elles pour les détruire.
La prose d'Antoine Volodine est aussi limpide que magnifique. Elle nous aide à parcourir ce monde dévasté et chose incroyable, à apprendre aussi à l'aimer. Il sait trouver dans la noirceur de ce chaos, des touches de lumière et de couleurs. Le rouge brique côtoie le gris béton en se mêlant au vert steppe. Son style est proche du Boris Vian de l'écume des jours. Une poésie qui sert l'histoire, une imagination qui la transcende. Les quarante-neuf chapitres ou narrats se complètent, s'emmêlent et se confondent pour ne faire plus qu'une seule et unique histoire. L'histoire d'un aboutissement, d'un achèvement du monde plus que de sa fin.
Merci à Antoine Volodine pour m'avoir à la fois bousculé, déboussolé, secoué mais aussi fasciné, impressionné et surtout enchanté. Cest son livre qui donne envie de découvrir son oeuvre comme c'est souvent une seule perle trouvée qui donne envie de fabriquer un collier. Entre être Arroseur d'étoiles ou Planteur de rêves, le choix est assez difficile quand on pose la question directement à ses amis. La réponse est souvent mitigée tant les deux métiers semblent exotiques. Pour Antoine Volodines la question ne se pose même pas, car comme pour son personnage Enzo Mardirossian, il a choisi d'être pour sa part Régleur de larmes et son recueil Des Anges Mineurs est bien là pour nous l'affirmer voire pour nous le confirmer…
« Je sais ce qu'aurait pu me dire le régleur [de larmes] : que tout en moi était détraqué, pas seulement les larmes, et que je pleurais n'importe comment et en désordre, et souvent à contretemps, ou sans cause, ou que je restais impassible sans raison ».
Nous nous attachons au cours de cette histoire à quelques survivants. Des hommes tout d'abord comme Enzo Mardirossian, le régleur de larmes ou Fred Zenfl, le dernier écrivain de cette terre; des femmes aussi comme les deux belles Djaliyla Solaris et Bella Mardirossian ou la forte Babaïa Schtern, prisonnière du neuvième étage d'un immeuble en ruine où ses fils l'engraissent dans le but inavouable de la manger, sans oublier la Rita Arsenal ou le Robby Milioutine. Antoine Volodine va tenter tout au long de son livre, de nous dresser le portrait d'une dizaine de personnages. Mais comme il nous l'affirme haut et fort au début de son oeuvre, cette description ressemble plus à « une photographie truquée, qui rend difficile la perception des traces laissées par ces êtres».
Le personnage principal de ce quasi-conte moderne se nomme Will Scheidmann. On découvre au fur et à mesure de la lecture que c'est lui le véritable narrateur. Et quand je dis on, c'est pour dire lui…C'est dans ces déserts urbains aux immeubles vides, sur cette terre de brique rouge où la vie est en voie d'extinction, qu'un groupe de vieillardes immortelles et amnésiques cherchent à lui donner vie. Ces vieilles sorcières mongoles vont à partir de morceaux de chiffon et d'incantations chamaniques, animer un poupon de chiffons, plutôt une sorte de golem en chiffons. Et ce golem incarné par Will scheidmann n'aura de cesse comme dans le mythe de se retourner contre elles pour les détruire.
La prose d'Antoine Volodine est aussi limpide que magnifique. Elle nous aide à parcourir ce monde dévasté et chose incroyable, à apprendre aussi à l'aimer. Il sait trouver dans la noirceur de ce chaos, des touches de lumière et de couleurs. Le rouge brique côtoie le gris béton en se mêlant au vert steppe. Son style est proche du Boris Vian de l'écume des jours. Une poésie qui sert l'histoire, une imagination qui la transcende. Les quarante-neuf chapitres ou narrats se complètent, s'emmêlent et se confondent pour ne faire plus qu'une seule et unique histoire. L'histoire d'un aboutissement, d'un achèvement du monde plus que de sa fin.
Merci à Antoine Volodine pour m'avoir à la fois bousculé, déboussolé, secoué mais aussi fasciné, impressionné et surtout enchanté. Cest son livre qui donne envie de découvrir son oeuvre comme c'est souvent une seule perle trouvée qui donne envie de fabriquer un collier. Entre être Arroseur d'étoiles ou Planteur de rêves, le choix est assez difficile quand on pose la question directement à ses amis. La réponse est souvent mitigée tant les deux métiers semblent exotiques. Pour Antoine Volodines la question ne se pose même pas, car comme pour son personnage Enzo Mardirossian, il a choisi d'être pour sa part Régleur de larmes et son recueil Des Anges Mineurs est bien là pour nous l'affirmer voire pour nous le confirmer…
« Je sais ce qu'aurait pu me dire le régleur [de larmes] : que tout en moi était détraqué, pas seulement les larmes, et que je pleurais n'importe comment et en désordre, et souvent à contretemps, ou sans cause, ou que je restais impassible sans raison ».
"Surprise ! You're dead !
Guess what ?
It never ends
Never ever ends."
(Faith no More)
Tout a commencé comme une sorte de blague. Quand on a demandé à Antoine Volodine dans quelle catégorie il faut ranger ses écrits, il a tiré un peu négligemment de sa manche le terme "post-exotisme", pour éviter la confusion avec la SF, le post-apo, les dystopies ou les anti-utopies.
Mais au fur et à mesure que le corpus post-exotique grandit, s'étoffe avec de nouvelles plumes tenues par la même main, et se dirige fatalement vers sa fin (l'ultime 49ème ouvrage, correspondant au 49 jours d'errance entre la vie et la mort, selon le "Bardo Thödol" tibétain), ce qui était au départ une boutade destinée aux journalistes est devenu un terme sérieux.
Un novice sera probablement déstabilisé en ouvrant son premier roman post-exotique, mais en devenant un habitué, il trouvera toujours ce qu'il est venu chercher :
Un monde qui ne ressemble à aucun autre, à la fois déprimant et lyrique, qui possède sa propre géographie glissante, quelque part entre la steppe mongole, la taïga sibérienne et le béton soviétique. L'atmosphère qui évoque "ici et n'importe où ; hier, demain, et tout le temps".
Les personnages-voix aux noms improbables et aux nationalités indéfinissables, qui se promènent à leur guise d'un récit à l'autre, un peu comme chez Marquez ou chez Balzac... l'ensemble volodinesque est aussi, en quelque sorte, une "comédie humaine", teintée d'étrange "réalisme magique".
Le style unique de Volodine, qui, selon ses propres mots, "écrit en français une littérature étrangère", et qui le fait fort bien.
Ses néologismes. Son humour noir.
Il y a largement de quoi séduire, et sans grande surprise, "Dondog" a comblé toutes mes attentes.
Quand on sort d'un camp de travail et on n'en a plus pour longtemps, on a bien envie de "régler des comptes avec deux ou trois personnes". Celles qu'on a connu autrefois...
La confession de Dondog Balbaïan nous met directement au coeur de l'intrigue orchestrée par Volodine. C'est un roman qui parle de chemin-même vers la mort.
Pour le miséreux protagoniste il s'agit de la recherche de son passé, et de ceux qui l'ont autrefois rabaissé ; ceux qui l'ont transformé en "chien", ce qui signifie, dans le langage des camps, littéralement "rebut" ou "moins que rien". Don Dog : le chien suprême. (Le nom se prête tout seul aux interprétations, mais, gamine, je possédais un livre d'aventures écrit pas un auteur mongol Dondogin Cevegmid qui mentionne aussi les chamans si chers à Volodine... hm, sans doute rien à voir, mais cela prouve que le champ des connotations liées au Volodinestan peut être très large.)
Dondog a survécu à la purge ethnique visant l'extermination des Ybürs, mais il a été déporté et il a passé trente ans au camp de travaux forcés. Libéré au début du roman, il découvre lentement comment le monde a changé après toutes ces années. Il arrive dans une triste ville pleine d'immeubles miteux qui tiennent à peine debout ; l'endroit qui a survécu aux pogroms et aux répressions, et qui s'est transformé en bizarre chaos architectonique. Dans un dangereux dédale de couloirs obscurs les murs humides s'écaillent, le sol grouille de vermine, partout règne une puanteur indescriptible.
Et Dondog rêve de vengeance.
Dans sa tête s'immiscent des noms comme Tonny Bronx, Eliane Hotchkiss, Gulmuz Korsakov... mais il ne sait par vraiment pourquoi ce sont précisément eux qui doivent payer. le régime a parfaitement gommé la mémoire de Dondog, et il est maintenant obligé de solliciter à grand peine ses souvenirs, afin de se trouver une bonne raison pour régler ces vieilles dettes. C'est la seule façon de retrouver sa liberté, sa seule façon de mourir en paix.
En réalité (tout comme Kronauer dans "Terminus Radieux"), il n'est même pas clair si Dondog est encore vivant, ou s'il est déjà mort. Au début, je ne me posais jamais la question, mais plus on pénètre dans l'univers post-exotique, et plus la présence du "Bardo Thödol" (signifiant littéralement "la libération par l'écoute dans les états intermédiaires" ; merci, Wikipédia* !) se fait sentir. Comme si tout cela se passait derrière une vitre sale qui déforme la vision du monde qui se trouve derrière, malgré quelques éléments rassurants : l'électricité y fonctionne encore (parfois) et on paye en dollars.
Je me méfie un peu du terme "postmoderne" mis à toutes les sauces, mais ici il prend vraiment tout son sens. Dondog se souvient de son enfance, de sa formidable grand-mère, mais aussi de l'époque où il écrivait des romans et des pièces post-exotiques. Dans son monologue, il passe facilement de "je" à "il", et l'un de ses noms d'autrefois - Schlumm - nous dirige vers un autre roman de Volodine... roman qui s'intitule comme par hasard "Bardo or not Bardo"... de ce fait, je me dis que toute tentative de trancher définitivement sur le sujet des (non)existences volodinesques n'est que pure vanité.
Comme tous les autres personnages, Dondog affronte ses terreurs par l'invention de son propre passé. Les seules armes qui lui restent sont l'ironie, et l'obsession des jeux avec les mots. L'incompréhensible ville est à l'image de ces terreurs : la mafia règne, les ethnies et les langues se mélangent, les frontières entre le réel et l'irréel s'effacent.
La forme de "Dondog" est astucieuse, mais elle est moins expérimentale que certains autres écrits de Volodine. L'histoire se déroule de façon classique, et elle est facile à suivre ; j'avoue que parfois c'est un soulagement, même si j'étais tout aussi séduite par les fragmentaires "Moines-Soldats".
L'ensemble est totalement envoûtant comme d'habitude, et en y ajoutant la taille honnête (l'auteur dépasse exceptionnellement 350 pages !), il mérite amplement ses 5 étoiles, 5 marteaux, et 5 faucilles.
*P.S. Pour revenir une dernière fois vers le "Livre des morts tibétain" (je cite) : "la récitation du principal chapitre par un LAMA lors de l'agonie ou après la mort est censée aider à la libération du cycle des réincarnations, ou du moins à obtenir une meilleure réincarnation".
J'espère donc que ma critique a atteint son but... repose en paix, Dondog Balbaïan ! Je t'aimais bien, et j'espère te retrouver bientôt dans une meilleure réincarnation.
Guess what ?
It never ends
Never ever ends."
(Faith no More)
Tout a commencé comme une sorte de blague. Quand on a demandé à Antoine Volodine dans quelle catégorie il faut ranger ses écrits, il a tiré un peu négligemment de sa manche le terme "post-exotisme", pour éviter la confusion avec la SF, le post-apo, les dystopies ou les anti-utopies.
Mais au fur et à mesure que le corpus post-exotique grandit, s'étoffe avec de nouvelles plumes tenues par la même main, et se dirige fatalement vers sa fin (l'ultime 49ème ouvrage, correspondant au 49 jours d'errance entre la vie et la mort, selon le "Bardo Thödol" tibétain), ce qui était au départ une boutade destinée aux journalistes est devenu un terme sérieux.
Un novice sera probablement déstabilisé en ouvrant son premier roman post-exotique, mais en devenant un habitué, il trouvera toujours ce qu'il est venu chercher :
Un monde qui ne ressemble à aucun autre, à la fois déprimant et lyrique, qui possède sa propre géographie glissante, quelque part entre la steppe mongole, la taïga sibérienne et le béton soviétique. L'atmosphère qui évoque "ici et n'importe où ; hier, demain, et tout le temps".
Les personnages-voix aux noms improbables et aux nationalités indéfinissables, qui se promènent à leur guise d'un récit à l'autre, un peu comme chez Marquez ou chez Balzac... l'ensemble volodinesque est aussi, en quelque sorte, une "comédie humaine", teintée d'étrange "réalisme magique".
Le style unique de Volodine, qui, selon ses propres mots, "écrit en français une littérature étrangère", et qui le fait fort bien.
Ses néologismes. Son humour noir.
Il y a largement de quoi séduire, et sans grande surprise, "Dondog" a comblé toutes mes attentes.
Quand on sort d'un camp de travail et on n'en a plus pour longtemps, on a bien envie de "régler des comptes avec deux ou trois personnes". Celles qu'on a connu autrefois...
La confession de Dondog Balbaïan nous met directement au coeur de l'intrigue orchestrée par Volodine. C'est un roman qui parle de chemin-même vers la mort.
Pour le miséreux protagoniste il s'agit de la recherche de son passé, et de ceux qui l'ont autrefois rabaissé ; ceux qui l'ont transformé en "chien", ce qui signifie, dans le langage des camps, littéralement "rebut" ou "moins que rien". Don Dog : le chien suprême. (Le nom se prête tout seul aux interprétations, mais, gamine, je possédais un livre d'aventures écrit pas un auteur mongol Dondogin Cevegmid qui mentionne aussi les chamans si chers à Volodine... hm, sans doute rien à voir, mais cela prouve que le champ des connotations liées au Volodinestan peut être très large.)
Dondog a survécu à la purge ethnique visant l'extermination des Ybürs, mais il a été déporté et il a passé trente ans au camp de travaux forcés. Libéré au début du roman, il découvre lentement comment le monde a changé après toutes ces années. Il arrive dans une triste ville pleine d'immeubles miteux qui tiennent à peine debout ; l'endroit qui a survécu aux pogroms et aux répressions, et qui s'est transformé en bizarre chaos architectonique. Dans un dangereux dédale de couloirs obscurs les murs humides s'écaillent, le sol grouille de vermine, partout règne une puanteur indescriptible.
Et Dondog rêve de vengeance.
Dans sa tête s'immiscent des noms comme Tonny Bronx, Eliane Hotchkiss, Gulmuz Korsakov... mais il ne sait par vraiment pourquoi ce sont précisément eux qui doivent payer. le régime a parfaitement gommé la mémoire de Dondog, et il est maintenant obligé de solliciter à grand peine ses souvenirs, afin de se trouver une bonne raison pour régler ces vieilles dettes. C'est la seule façon de retrouver sa liberté, sa seule façon de mourir en paix.
En réalité (tout comme Kronauer dans "Terminus Radieux"), il n'est même pas clair si Dondog est encore vivant, ou s'il est déjà mort. Au début, je ne me posais jamais la question, mais plus on pénètre dans l'univers post-exotique, et plus la présence du "Bardo Thödol" (signifiant littéralement "la libération par l'écoute dans les états intermédiaires" ; merci, Wikipédia* !) se fait sentir. Comme si tout cela se passait derrière une vitre sale qui déforme la vision du monde qui se trouve derrière, malgré quelques éléments rassurants : l'électricité y fonctionne encore (parfois) et on paye en dollars.
Je me méfie un peu du terme "postmoderne" mis à toutes les sauces, mais ici il prend vraiment tout son sens. Dondog se souvient de son enfance, de sa formidable grand-mère, mais aussi de l'époque où il écrivait des romans et des pièces post-exotiques. Dans son monologue, il passe facilement de "je" à "il", et l'un de ses noms d'autrefois - Schlumm - nous dirige vers un autre roman de Volodine... roman qui s'intitule comme par hasard "Bardo or not Bardo"... de ce fait, je me dis que toute tentative de trancher définitivement sur le sujet des (non)existences volodinesques n'est que pure vanité.
Comme tous les autres personnages, Dondog affronte ses terreurs par l'invention de son propre passé. Les seules armes qui lui restent sont l'ironie, et l'obsession des jeux avec les mots. L'incompréhensible ville est à l'image de ces terreurs : la mafia règne, les ethnies et les langues se mélangent, les frontières entre le réel et l'irréel s'effacent.
La forme de "Dondog" est astucieuse, mais elle est moins expérimentale que certains autres écrits de Volodine. L'histoire se déroule de façon classique, et elle est facile à suivre ; j'avoue que parfois c'est un soulagement, même si j'étais tout aussi séduite par les fragmentaires "Moines-Soldats".
L'ensemble est totalement envoûtant comme d'habitude, et en y ajoutant la taille honnête (l'auteur dépasse exceptionnellement 350 pages !), il mérite amplement ses 5 étoiles, 5 marteaux, et 5 faucilles.
*P.S. Pour revenir une dernière fois vers le "Livre des morts tibétain" (je cite) : "la récitation du principal chapitre par un LAMA lors de l'agonie ou après la mort est censée aider à la libération du cycle des réincarnations, ou du moins à obtenir une meilleure réincarnation".
J'espère donc que ma critique a atteint son but... repose en paix, Dondog Balbaïan ! Je t'aimais bien, et j'espère te retrouver bientôt dans une meilleure réincarnation.
"Noble fils, maintenant que ta respiration a presque cessé, voici pour toi le moment de chercher une voie, car la lumière fondamentale qui apparaît lors du premier état intermédiaire va poindre..."
(Bardo Thödol, le Livre Tibétain des Morts)
Sépulcrale lumière matinale d'octobre, paisible lamaserie deux-sévrienne...
Gong.
Noble lecteur, te voilà prêt à entamer une errance de 49 jours, à travers les sept chapitres du Bardo (or not Bardo ? toute la question est là !) volodinien. Prêt à être surpris et étonné par ce qui t'arrive, à te sentir perdu en passant d'un état intermédiaire à l'autre, et à t'approcher peut-être de la Claire Lumière. Dans le meilleur des cas tu entreras au Nirvana littéraire que peuvent apporter les romans post-exotiques... dans le pire (ce que je ne te souhaite pas), tu te réincarneras sans peine en lecteur de romans ordinaires, qui n'aura plus jamais envie de franchir la porte phosphorescente et délabrée du Volodinestan.
Gong.
"Bardo or not Bardo" est la création la plus drôle, la plus "théâtrale" et la plus tragiquement burlesque de tous les romans de Volodine que j'ai pu lire jusqu'au présent. Mais pour en profiter pleinement, il n'est peut-être pas inutile d'être déjà familier de l'univers du barde post-exotique, qui peut paraître aussi obscur et fantasque que le système de médailles babéliotes. Tous ses romans sont plus ou moins bardés de Bardo de façon sous-jacente, mais celui-ci nous fait entrer directement dans l'Espace Noir, et explorer ses affres en même temps que les personnages.
Selon la tradition bouddhiste, le défunt doit être accompagné pendant les sept semaines de son séjour au Bardo - dans un état entre la vie et la mort - par le lama, lui récitant les textes de "Bardo Thödol". Il sera ainsi guidé vers un reposant néant ultime, qui signifie la fin des souffrances. Si le travail est mal fait, il dévie de son trajet en prenant le chemin de la prochaine réincarnation, dans une matrice souvent peu enviable. Qui d'entre nous voudrait devenir pingouin ?
Et vous pressentez déjà que ça va barder... depuis l'ouverture par "Baroud d'honneur avant le Bardo", jusqu'à la rencontre finale au "Bar du Bardo".
Gong.
Dans une interview, Volodine disait ne pas supporter l'idée de la mort : c'est pour cela qu'elle est si souvent déclinée dans ses récits, de façon détournée et grotesque, qui permet d'exorciser ces craintes. Est-ce de l'humour noir ? Bien évidemment, mais c'est un humour noir qui n'appartient qu'à cet univers post-exotique brillamment conçu. Si la vie s'apparente à l'univers carcéral, qu'en est-il de la mort ? Une libération ? L'idée du néant, d'un Rien définitif et inaltérable, est presque aussi effrayante que l'idée même de mourir, et il n'est pas étonnant que les trépassés de Volodine se sentent quelque peu paumés et hésitants sur leur chemin vers la Claire Lumière. D'autant plus que leur mémoire est encore pleine des souvenirs terrestres. Ils sont tous dûment accompagnés, et leurs guides du passage dans l'au-delà sont pleins de bonne volonté, mais... voyez-vous, même dans la vraie vie il y a souvent une grande différence entre les choses telles qu'on les imagine, et telles qu'elles le sont vraiment. le Livre Tibétain des Morts devrait fonctionner, mais à quel point doit-on se fier à tous ces textes qui font office de loi ?
Gong.
Les sept scénarios sont tous minimalistes : un défunt et son guide à travers le Bardo, qui communiquent, ou du moins essaient d'entrer en contact dans l'Espace Noir. Mais cela suffit amplement à Volodine pour imaginer des situations aussi comiques que désespérantes. Comme d'habitude, tout foire.
Abram Schlumm alias Kominform se fait descendre dans le poulailler d'une lamaserie par une faction ennemie. le bon lama Drumbog se démène entre ses tourments gastriques, les reporters qui envahissent le poulailler et son assistant, incapable d'apporter le livre demandé. Les errances de Kominform seront donc accompagnées par un livre de cuisine : "l'Art d'accommoder les animaux morts", et par "Cadavres exquis, une anthologie surréaliste".
Glouchenko du chapitre suivant a une certaine chance, mais (un clin d'oeil à son nom) il reste sourd à la voix du lama, et continue à chercher obstinément une pile électrique.
Schmollowski, l'ancien terroriste, va sympathiser avec le banquier Dadokian, et malins comme ils sont, ils décident d'ignorer le délai des 49 jours. Après tout, c'est sympa, le Bardo, et rien n'empêche d'y rester pour l'éternité. Ah, vraiment ?! Et quand la voix du lama fait défaut, peut-être que le vieux juke-box pourri au fond d'une caverne pourrait délivrer un message fiable, le tout c'est de bien l'interpréter.
En passant par le "Micmac à la Morgue" (comment résister ?), "Le Bardo de la Méduse" interprété aux lapins et aux arbres par l'unique membre restant de l'ancienne corporation The Baba and Nyonya Theater (comment résister, bis), et autres "histoires dans l'histoire", on se dirige sans faute vers le bar du Bardo et l'affligé clown du cirque Schmühl, qui ferait tout pour que son défunt ami et collègue Grümscher trouve la voie de la Claire Lumière. A la fois triste et hilarant, comme toutes les histoires de Volodine.
Gong.
Toujours le même monde post-exotique, plein de grands idéaux et de petits moyens. On sait à peu près ce qu'on va trouver en franchissant sa porte, mais à chaque fois il nous réserve de nouvelles surprises, et nous fait retrouver des vieilles connaissances sous une autre identité... n'est ce pas, Dondog ? C'est pour cela qu'on y retourne encore et encore, avec plaisir. Excellent livre, rempli de "Cadavres exquis" cités plus haut, dont la qualité augmente encore à mes yeux par sa mise en valeur des lamas et des lamaseries. Une étoile pour chaque coup de gong.
(Bardo Thödol, le Livre Tibétain des Morts)
Sépulcrale lumière matinale d'octobre, paisible lamaserie deux-sévrienne...
Gong.
Noble lecteur, te voilà prêt à entamer une errance de 49 jours, à travers les sept chapitres du Bardo (or not Bardo ? toute la question est là !) volodinien. Prêt à être surpris et étonné par ce qui t'arrive, à te sentir perdu en passant d'un état intermédiaire à l'autre, et à t'approcher peut-être de la Claire Lumière. Dans le meilleur des cas tu entreras au Nirvana littéraire que peuvent apporter les romans post-exotiques... dans le pire (ce que je ne te souhaite pas), tu te réincarneras sans peine en lecteur de romans ordinaires, qui n'aura plus jamais envie de franchir la porte phosphorescente et délabrée du Volodinestan.
Gong.
"Bardo or not Bardo" est la création la plus drôle, la plus "théâtrale" et la plus tragiquement burlesque de tous les romans de Volodine que j'ai pu lire jusqu'au présent. Mais pour en profiter pleinement, il n'est peut-être pas inutile d'être déjà familier de l'univers du barde post-exotique, qui peut paraître aussi obscur et fantasque que le système de médailles babéliotes. Tous ses romans sont plus ou moins bardés de Bardo de façon sous-jacente, mais celui-ci nous fait entrer directement dans l'Espace Noir, et explorer ses affres en même temps que les personnages.
Selon la tradition bouddhiste, le défunt doit être accompagné pendant les sept semaines de son séjour au Bardo - dans un état entre la vie et la mort - par le lama, lui récitant les textes de "Bardo Thödol". Il sera ainsi guidé vers un reposant néant ultime, qui signifie la fin des souffrances. Si le travail est mal fait, il dévie de son trajet en prenant le chemin de la prochaine réincarnation, dans une matrice souvent peu enviable. Qui d'entre nous voudrait devenir pingouin ?
Et vous pressentez déjà que ça va barder... depuis l'ouverture par "Baroud d'honneur avant le Bardo", jusqu'à la rencontre finale au "Bar du Bardo".
Gong.
Dans une interview, Volodine disait ne pas supporter l'idée de la mort : c'est pour cela qu'elle est si souvent déclinée dans ses récits, de façon détournée et grotesque, qui permet d'exorciser ces craintes. Est-ce de l'humour noir ? Bien évidemment, mais c'est un humour noir qui n'appartient qu'à cet univers post-exotique brillamment conçu. Si la vie s'apparente à l'univers carcéral, qu'en est-il de la mort ? Une libération ? L'idée du néant, d'un Rien définitif et inaltérable, est presque aussi effrayante que l'idée même de mourir, et il n'est pas étonnant que les trépassés de Volodine se sentent quelque peu paumés et hésitants sur leur chemin vers la Claire Lumière. D'autant plus que leur mémoire est encore pleine des souvenirs terrestres. Ils sont tous dûment accompagnés, et leurs guides du passage dans l'au-delà sont pleins de bonne volonté, mais... voyez-vous, même dans la vraie vie il y a souvent une grande différence entre les choses telles qu'on les imagine, et telles qu'elles le sont vraiment. le Livre Tibétain des Morts devrait fonctionner, mais à quel point doit-on se fier à tous ces textes qui font office de loi ?
Gong.
Les sept scénarios sont tous minimalistes : un défunt et son guide à travers le Bardo, qui communiquent, ou du moins essaient d'entrer en contact dans l'Espace Noir. Mais cela suffit amplement à Volodine pour imaginer des situations aussi comiques que désespérantes. Comme d'habitude, tout foire.
Abram Schlumm alias Kominform se fait descendre dans le poulailler d'une lamaserie par une faction ennemie. le bon lama Drumbog se démène entre ses tourments gastriques, les reporters qui envahissent le poulailler et son assistant, incapable d'apporter le livre demandé. Les errances de Kominform seront donc accompagnées par un livre de cuisine : "l'Art d'accommoder les animaux morts", et par "Cadavres exquis, une anthologie surréaliste".
Glouchenko du chapitre suivant a une certaine chance, mais (un clin d'oeil à son nom) il reste sourd à la voix du lama, et continue à chercher obstinément une pile électrique.
Schmollowski, l'ancien terroriste, va sympathiser avec le banquier Dadokian, et malins comme ils sont, ils décident d'ignorer le délai des 49 jours. Après tout, c'est sympa, le Bardo, et rien n'empêche d'y rester pour l'éternité. Ah, vraiment ?! Et quand la voix du lama fait défaut, peut-être que le vieux juke-box pourri au fond d'une caverne pourrait délivrer un message fiable, le tout c'est de bien l'interpréter.
En passant par le "Micmac à la Morgue" (comment résister ?), "Le Bardo de la Méduse" interprété aux lapins et aux arbres par l'unique membre restant de l'ancienne corporation The Baba and Nyonya Theater (comment résister, bis), et autres "histoires dans l'histoire", on se dirige sans faute vers le bar du Bardo et l'affligé clown du cirque Schmühl, qui ferait tout pour que son défunt ami et collègue Grümscher trouve la voie de la Claire Lumière. A la fois triste et hilarant, comme toutes les histoires de Volodine.
Gong.
Toujours le même monde post-exotique, plein de grands idéaux et de petits moyens. On sait à peu près ce qu'on va trouver en franchissant sa porte, mais à chaque fois il nous réserve de nouvelles surprises, et nous fait retrouver des vieilles connaissances sous une autre identité... n'est ce pas, Dondog ? C'est pour cela qu'on y retourne encore et encore, avec plaisir. Excellent livre, rempli de "Cadavres exquis" cités plus haut, dont la qualité augmente encore à mes yeux par sa mise en valeur des lamas et des lamaseries. Une étoile pour chaque coup de gong.
Petites soeurs de la onzième nuit, ne pleurez pas, sortez des eaux, frappez !
(Maria Soudaïeva, "Slogans", n. 296)
Pleurer n'est pas leur genre. Prêtes à frapper, elles sortent en cachette des ténèbres. Elles passent par la fenêtre d'un immeuble délabré de la rue qu'on ne trouve plus sur aucune carte. L'une après l'autre... elles s'écrasent en bas, se relèvent, et partent en mission. Elles sont belles, entraînées pour la lutte finale, et elles parlent toutes comme des charretières.
Les filles de Monroe.
Mais quelle "lutte finale" ?
Cette dernière excursion au Volodinestan post-exotique était peut-être la plus "noire" de toutes celles que j'ai pu faire. Non seulement à cause de l'obscurité omniprésente, dissipée tout au plus par la faible lueur des ampoules à basse consommation, qui plongent le récit dans la pénombre où on distingue à peine le vrai du faux, les choses mortes des choses vivantes. Ni à cause du déluge permanent qui s'abat sur les pavillons d'un vaste camp abandonné, sur la végétation mutante et les rails effondrés où aucun tramway n'est passé depuis la chute de la "Deuxième Union Soviétique", il y a quelques trois cents ans. C'est surtout à cause d'un sentiment de vanité absolue, généré par le récit ; cette éternelle question "à quoi bon ?".
A quoi bon s'engager pour une cause, ou même tenter de survivre dans un monde qui n'existe pour ainsi dire plus, où on doit fouiller les caves et les poches des cadavres si on veut encore trouver la dernière allumette pour allumer la dernière clope ? Où la communication avec les vivants est aussi pénible qu'avec les morts, et où on ne sait même pas dans quelle catégorie ranger notre interlocuteur, surtout si son manteau dégage une indescriptible odeur de terre et de mygale ? Où tout ce qui reste peut facilement se départager entre l'énorme hôpital psychiatrique, "La maison des cosmonautes" désaffectée, les bâtiments du Parti, et quelques immeubles obscurs habités par les dissidents et les morts ?
Et pourtant, on tente.
Le narrateur schizophrène, Breton, vivote dans une chambre de l'hôpital. Difficile à dire s'il est seul ou s'ils sont deux, en tout cas, ce dédoublement est pratique pour jouer aux échecs, quand il n'est pas en train de surveiller ladite fenêtre de l'inexistante rue Dellwo, et guetter l'apparition des filles de Monroe. Elles sont envoyées depuis "l'espace noir" par un ancien dissident exécuté par le régime, afin de "rétablir la logique du Parti". Parmi elles, Rebecca Rausch, dont Breton était autrefois "follement amoureux" ; il n'est donc pas étonnant qu'il va jouer un double jeu, une fois forcé par le Parti (ou ce qui en reste encore) de localiser les intruses grâce à sa capacité de "voir les songes des morts".
Mais quel "Parti", je vous prie ?
Ce monde ne semble abriter plus rien, à part les morts-vivants, les malades mentaux et quelques hauts fonctionnaires avec leurs sbires qui jouent aux petits soldats en se berçant encore d'illusions sur l'avenir radieux, ce qui donne au récit - malgré sa noirceur - une inimitable dimension burlesque.
Les personnages (qui semblent parfois interchangeables) pataugent sans cesse sous la flotte tiède, dans un accoutrement comique, entre la rue Zinkorine, le secteur Baltimore, la place Dadirboukian et la rue Tolgosane dans le dessein de rétablir l'odre dans le chaos, et on ne peut que sourire des vaines tentatives de séduction de l'énorme Dame Patmos, ou de la démarche de Kaytel pour renouer avec les pratiques chamaniques. Les armes semblent aussi inefficaces que les amulettes de plumes, comme le dirait le couple mort peu causant qui commente le remue-ménage sur l'escalier de l'immeuble pisseux de la rue Tolgosane avec un détachement cynique propre à son état.
Ce sentiment de vanité est encore exacerbé par l'issue de la mission des filles de Monroe, et par l'apparition finale de Monroe en personne, et tout est mené au paroxysme par la liste des "343 fractions du Parti au temps de sa gloire", tellement hétéroclite qu'on se pose la question légitime quant à la véritable utilité du Parti en tant que "parti".
Comme il se doit, le récit est évidemment divisé en 7 chapitres organisés en 49 parties, et si on se demande s'il sert vraiment à quelque chose dans le corpus post-exotique, la réponse est probablement "oui".
Je n'ai pas la moindre idée si l'intention de Volodine était de doter son roman d'une quelconque "morale". Mais dans n'importe quelle autre histoire post-apocalyptique, les efforts des survivants ont encore un certain sens. le monde d'avant n'est plus, mais il reste peut-être encore une parcelle d'espoir. "Les filles de Monroe" sont une rare excursion littéraire dans ce qu'on pourrait appeler le "post-post-apo", où le "vanitas vanitatum, et omnia vanitas" prend vraiment tout son sens. Pensons-y, à l'occasion. 4/5, pour le mélange très réussi du burlesque, du sérieux et du sinistre, et pour les qualités visuelles et olfactives du roman.
(Maria Soudaïeva, "Slogans", n. 296)
Pleurer n'est pas leur genre. Prêtes à frapper, elles sortent en cachette des ténèbres. Elles passent par la fenêtre d'un immeuble délabré de la rue qu'on ne trouve plus sur aucune carte. L'une après l'autre... elles s'écrasent en bas, se relèvent, et partent en mission. Elles sont belles, entraînées pour la lutte finale, et elles parlent toutes comme des charretières.
Les filles de Monroe.
Mais quelle "lutte finale" ?
Cette dernière excursion au Volodinestan post-exotique était peut-être la plus "noire" de toutes celles que j'ai pu faire. Non seulement à cause de l'obscurité omniprésente, dissipée tout au plus par la faible lueur des ampoules à basse consommation, qui plongent le récit dans la pénombre où on distingue à peine le vrai du faux, les choses mortes des choses vivantes. Ni à cause du déluge permanent qui s'abat sur les pavillons d'un vaste camp abandonné, sur la végétation mutante et les rails effondrés où aucun tramway n'est passé depuis la chute de la "Deuxième Union Soviétique", il y a quelques trois cents ans. C'est surtout à cause d'un sentiment de vanité absolue, généré par le récit ; cette éternelle question "à quoi bon ?".
A quoi bon s'engager pour une cause, ou même tenter de survivre dans un monde qui n'existe pour ainsi dire plus, où on doit fouiller les caves et les poches des cadavres si on veut encore trouver la dernière allumette pour allumer la dernière clope ? Où la communication avec les vivants est aussi pénible qu'avec les morts, et où on ne sait même pas dans quelle catégorie ranger notre interlocuteur, surtout si son manteau dégage une indescriptible odeur de terre et de mygale ? Où tout ce qui reste peut facilement se départager entre l'énorme hôpital psychiatrique, "La maison des cosmonautes" désaffectée, les bâtiments du Parti, et quelques immeubles obscurs habités par les dissidents et les morts ?
Et pourtant, on tente.
Le narrateur schizophrène, Breton, vivote dans une chambre de l'hôpital. Difficile à dire s'il est seul ou s'ils sont deux, en tout cas, ce dédoublement est pratique pour jouer aux échecs, quand il n'est pas en train de surveiller ladite fenêtre de l'inexistante rue Dellwo, et guetter l'apparition des filles de Monroe. Elles sont envoyées depuis "l'espace noir" par un ancien dissident exécuté par le régime, afin de "rétablir la logique du Parti". Parmi elles, Rebecca Rausch, dont Breton était autrefois "follement amoureux" ; il n'est donc pas étonnant qu'il va jouer un double jeu, une fois forcé par le Parti (ou ce qui en reste encore) de localiser les intruses grâce à sa capacité de "voir les songes des morts".
Mais quel "Parti", je vous prie ?
Ce monde ne semble abriter plus rien, à part les morts-vivants, les malades mentaux et quelques hauts fonctionnaires avec leurs sbires qui jouent aux petits soldats en se berçant encore d'illusions sur l'avenir radieux, ce qui donne au récit - malgré sa noirceur - une inimitable dimension burlesque.
Les personnages (qui semblent parfois interchangeables) pataugent sans cesse sous la flotte tiède, dans un accoutrement comique, entre la rue Zinkorine, le secteur Baltimore, la place Dadirboukian et la rue Tolgosane dans le dessein de rétablir l'odre dans le chaos, et on ne peut que sourire des vaines tentatives de séduction de l'énorme Dame Patmos, ou de la démarche de Kaytel pour renouer avec les pratiques chamaniques. Les armes semblent aussi inefficaces que les amulettes de plumes, comme le dirait le couple mort peu causant qui commente le remue-ménage sur l'escalier de l'immeuble pisseux de la rue Tolgosane avec un détachement cynique propre à son état.
Ce sentiment de vanité est encore exacerbé par l'issue de la mission des filles de Monroe, et par l'apparition finale de Monroe en personne, et tout est mené au paroxysme par la liste des "343 fractions du Parti au temps de sa gloire", tellement hétéroclite qu'on se pose la question légitime quant à la véritable utilité du Parti en tant que "parti".
Comme il se doit, le récit est évidemment divisé en 7 chapitres organisés en 49 parties, et si on se demande s'il sert vraiment à quelque chose dans le corpus post-exotique, la réponse est probablement "oui".
Je n'ai pas la moindre idée si l'intention de Volodine était de doter son roman d'une quelconque "morale". Mais dans n'importe quelle autre histoire post-apocalyptique, les efforts des survivants ont encore un certain sens. le monde d'avant n'est plus, mais il reste peut-être encore une parcelle d'espoir. "Les filles de Monroe" sont une rare excursion littéraire dans ce qu'on pourrait appeler le "post-post-apo", où le "vanitas vanitatum, et omnia vanitas" prend vraiment tout son sens. Pensons-y, à l'occasion. 4/5, pour le mélange très réussi du burlesque, du sérieux et du sinistre, et pour les qualités visuelles et olfactives du roman.
Une littérature taillée pour la Fin des Temps, extraite de l'huile noire afin de survivre à la fin de l'histoire, partout et jusqu'au bout.
Rencontrer l'oeuvre d'Antoire Volodine et de ses avatars post-exotiques a fini par m'arriver, comme elle finira, je l'espère, par vous arriver aussi, nombreux parmi nous n'ayant encore gravi la margelle sombre et indistincte marquant l'entrée de ce véritable monde post-historique, assez ambitieux pour être nommé à la manière d'un mouvement littéraire, regroupant quatre variations d'un même écrivain, sans véritable démarche égocentrique apparente. Un « nous » qui se veut rassembleur et transindividuel.
J'engage le lecteur intéressé à écouter sa conférence de 2019 aux Rencontres Internationales de Genève intitulée « Désarroi » https://youtu.be/x5oPEqyamTA , et la lecture de ce « Terminus Radieux », excellentes portes d'entrée dans cet édifice littéraire érigé pour les siècles à venir.
Je viens de suivre ce chemin.
Le livre en soi bénéficie de suffisamment de bonnes descriptions, ici et ailleurs, pour n'y rajouter, en ce qui me concerne, que des noms, des évocations littéraires allant des « Guérillères » de Monique Wittig à la Kolyma de Chalamov, aux effondrements soviétiques de Zinoviev…
Volodine ne crée rien de nouveau, il agrège l'histoire et le langage jusqu'à leur disparition et leur rémanence éternelle.
Volodine crée des noms d'herbes déjà mortes plus vivantes que son lecteur.
Volodine est peut-être en fin de compte un dieu à qui toute dévotion serait inutile.
A bientôt, Volodine.
Rencontrer l'oeuvre d'Antoire Volodine et de ses avatars post-exotiques a fini par m'arriver, comme elle finira, je l'espère, par vous arriver aussi, nombreux parmi nous n'ayant encore gravi la margelle sombre et indistincte marquant l'entrée de ce véritable monde post-historique, assez ambitieux pour être nommé à la manière d'un mouvement littéraire, regroupant quatre variations d'un même écrivain, sans véritable démarche égocentrique apparente. Un « nous » qui se veut rassembleur et transindividuel.
J'engage le lecteur intéressé à écouter sa conférence de 2019 aux Rencontres Internationales de Genève intitulée « Désarroi » https://youtu.be/x5oPEqyamTA , et la lecture de ce « Terminus Radieux », excellentes portes d'entrée dans cet édifice littéraire érigé pour les siècles à venir.
Je viens de suivre ce chemin.
Le livre en soi bénéficie de suffisamment de bonnes descriptions, ici et ailleurs, pour n'y rajouter, en ce qui me concerne, que des noms, des évocations littéraires allant des « Guérillères » de Monique Wittig à la Kolyma de Chalamov, aux effondrements soviétiques de Zinoviev…
Volodine ne crée rien de nouveau, il agrège l'histoire et le langage jusqu'à leur disparition et leur rémanence éternelle.
Volodine crée des noms d'herbes déjà mortes plus vivantes que son lecteur.
Volodine est peut-être en fin de compte un dieu à qui toute dévotion serait inutile.
A bientôt, Volodine.
Me revoilà dans l'univers post-exotique où le projet utopique et fraternel d'un monde meilleur a basculé dans le cauchemar. Me revoilà dans une lumière pisseuse, derrière des murs sans fenêtre d'une consternante grisaille de blockhaus. C'est là que Maria Samarkande est enfermée, là qu'elle subit un sinistre interrogatoire.
Ce qui, d'une certaine façon, rend les choses moins plombantes, c'est que Maria est déjà morte, elle le dit clairement: « Je m'appelle Maria Samarkande et je suis morte. » C'est une caractéristique de l'univers post-exotique que j'aime assez, les frontières entre la vie et la mort y sont beaucoup moins nettes que dans notre monde.
Maria raconte d'ailleurs sa mort dans un livre intitulé, comme celui de Volodine, «Vue sur l'ossuaire», qui fait suite au récit de son interrogatoire. Sa mort et celle de Jean Vlassenko, l'homme avec qui elle a «passionnément vécu et passionnément fabriqué de petits mondes littéraires intimes, qui ont reflété notre désarroi, nos peurs, notre constante espérance». le livre d'Antoine Volodine est construit en miroir - comme pour exprimer leur complicité inextricable mais peut-être aussi la séparation, chacun d'un côté du miroir, voire l'angoisse d'une impensable trahison, «coeur goudronneux de notre mauvais rêve»-, il présente dans sa seconde partie le récit de l'interrogatoire de Jean Vlassenko, suivi d'un troisième «Vue sur l'ossuaire», qui lui est attribué.
Les 7x2 «narrats» de Maria et Jean se font écho, demandent à être rapprochés, mettant en scène les mêmes personnages, les mêmes lieux, se complétant, se prolongeant, protestant contre une séparation arbitraire qui les mutile.
On y rencontre des personnages soupçonnés d'être des dissidents, leur réel est terrible, et leurs rêves qui parfois y plaquent des images se confondant avec celles du jour ne valent pas toujours mieux.
On y apprend que « La nuit nous habite: on a des pulsions de prédateurs. On met longtemps avant de respecter ce qui tressaute; on obéit à des ordres laids, venus du fond des âges… La nuit et la stupidité nous habitent. »
Mais on croit aussi y voir, dans le « gâchis sans remède » de 1914, un dirigeable, «une merveilleuse invention argentée, grise, tout à fait indépendante du massacre en cours: une porte enfin ouverte sur les rêves les plus purs, une promesse de beauté pour les décennies à venir.», on se met donc à rêver: « Ce n'est plus la peine de mourir… le siècle a eu un hoquet de sang, mais à partir d'aujourd'hui il sera lumineux jusqu'à sa fin… Plus personne ne sera victime des riches… L'intelligence commandera… » Et même s'il est évident que le règne de l'intelligence n'est pas advenu, ils continuent à aimer le rêve du dirigeable, à parler de grandes insurrections qui malheureusement « déferleraient trop tard, si jamais elles déferlaient, pour sauver les yacks sauvages, les lémuriens et les fourmiliers», et à construire des passerelles poétiques entre la réalité de leurs rêves et la réalité du monde des illusions.
Évidemment, les « narrats » et « récitats lunaires », c'est trouble, c'est bizarre, ce n'est pas clair, et ça énerve les Comités de vigilance qui espéraient bien par leurs interrogatoires amener Vlassenko à décrypter « ces messages soi-disant post-exotiques ».
Mais les « champs oniriques » que Jean laisse en friche au fond de sa mémoire demeurent inaccessibles à ses tourmenteurs, et ils ne peuvent saisir que l'écriture commune des narrats est un acte de tendresse et de volupté, de survie, quelque chose qui ne peut que leur échapper. Et c'est la force de cet amour, indestructible malgré la mort et la barbarie, de ce partage dans la créativité littéraire, qui introduit dans l'obscurité post-exotique une lueur certes vacillante, certes fragile, certes incertaine, mais pleine de grâce.
C'est difficile à noter, une oeuvre post-exotique, bien sûr chacune a son indépendance, mais le plaisir de lecture tient aussi à la sensation de s'enfoncer un peu plus dans cet univers fascinant, cet édifice qui se construit livre après livre, et où chacun d'eux puise une profondeur dans cet au-delà du texte où se tient toute une communauté fraternelle d'écrivains incarcérés, avec leur idéologie, leur imaginaire, leur histoire collective… Alors même si Vue sur l'ossuaire a pu être qualifié de livre mineur dans l'oeuvre de Volodine, j'ai beaucoup apprécié cette lecture.
Groupe post-exotisme
Lien : https://www.babelio.com/grou..
Ce qui, d'une certaine façon, rend les choses moins plombantes, c'est que Maria est déjà morte, elle le dit clairement: « Je m'appelle Maria Samarkande et je suis morte. » C'est une caractéristique de l'univers post-exotique que j'aime assez, les frontières entre la vie et la mort y sont beaucoup moins nettes que dans notre monde.
Maria raconte d'ailleurs sa mort dans un livre intitulé, comme celui de Volodine, «Vue sur l'ossuaire», qui fait suite au récit de son interrogatoire. Sa mort et celle de Jean Vlassenko, l'homme avec qui elle a «passionnément vécu et passionnément fabriqué de petits mondes littéraires intimes, qui ont reflété notre désarroi, nos peurs, notre constante espérance». le livre d'Antoine Volodine est construit en miroir - comme pour exprimer leur complicité inextricable mais peut-être aussi la séparation, chacun d'un côté du miroir, voire l'angoisse d'une impensable trahison, «coeur goudronneux de notre mauvais rêve»-, il présente dans sa seconde partie le récit de l'interrogatoire de Jean Vlassenko, suivi d'un troisième «Vue sur l'ossuaire», qui lui est attribué.
Les 7x2 «narrats» de Maria et Jean se font écho, demandent à être rapprochés, mettant en scène les mêmes personnages, les mêmes lieux, se complétant, se prolongeant, protestant contre une séparation arbitraire qui les mutile.
On y rencontre des personnages soupçonnés d'être des dissidents, leur réel est terrible, et leurs rêves qui parfois y plaquent des images se confondant avec celles du jour ne valent pas toujours mieux.
On y apprend que « La nuit nous habite: on a des pulsions de prédateurs. On met longtemps avant de respecter ce qui tressaute; on obéit à des ordres laids, venus du fond des âges… La nuit et la stupidité nous habitent. »
Mais on croit aussi y voir, dans le « gâchis sans remède » de 1914, un dirigeable, «une merveilleuse invention argentée, grise, tout à fait indépendante du massacre en cours: une porte enfin ouverte sur les rêves les plus purs, une promesse de beauté pour les décennies à venir.», on se met donc à rêver: « Ce n'est plus la peine de mourir… le siècle a eu un hoquet de sang, mais à partir d'aujourd'hui il sera lumineux jusqu'à sa fin… Plus personne ne sera victime des riches… L'intelligence commandera… » Et même s'il est évident que le règne de l'intelligence n'est pas advenu, ils continuent à aimer le rêve du dirigeable, à parler de grandes insurrections qui malheureusement « déferleraient trop tard, si jamais elles déferlaient, pour sauver les yacks sauvages, les lémuriens et les fourmiliers», et à construire des passerelles poétiques entre la réalité de leurs rêves et la réalité du monde des illusions.
Évidemment, les « narrats » et « récitats lunaires », c'est trouble, c'est bizarre, ce n'est pas clair, et ça énerve les Comités de vigilance qui espéraient bien par leurs interrogatoires amener Vlassenko à décrypter « ces messages soi-disant post-exotiques ».
Mais les « champs oniriques » que Jean laisse en friche au fond de sa mémoire demeurent inaccessibles à ses tourmenteurs, et ils ne peuvent saisir que l'écriture commune des narrats est un acte de tendresse et de volupté, de survie, quelque chose qui ne peut que leur échapper. Et c'est la force de cet amour, indestructible malgré la mort et la barbarie, de ce partage dans la créativité littéraire, qui introduit dans l'obscurité post-exotique une lueur certes vacillante, certes fragile, certes incertaine, mais pleine de grâce.
C'est difficile à noter, une oeuvre post-exotique, bien sûr chacune a son indépendance, mais le plaisir de lecture tient aussi à la sensation de s'enfoncer un peu plus dans cet univers fascinant, cet édifice qui se construit livre après livre, et où chacun d'eux puise une profondeur dans cet au-delà du texte où se tient toute une communauté fraternelle d'écrivains incarcérés, avec leur idéologie, leur imaginaire, leur histoire collective… Alors même si Vue sur l'ossuaire a pu être qualifié de livre mineur dans l'oeuvre de Volodine, j'ai beaucoup apprécié cette lecture.
Groupe post-exotisme
Lien : https://www.babelio.com/grou..
Groupes sur Antoine Volodine
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Antoine Volodine
Lecteurs de Antoine Volodine (870)Voir plus
Quiz
Voir plus
Les femmes et la littérature
Quel est le nom du roman de Marie NDiaye qui lui a valu le prix Goncourt en 2009 ?
Alabama song
Trois femmes puissantes
Les Heures souterraines
Trois jours chez ma mère
10 questions
5178 lecteurs ont répondu
Thèmes :
Femmes écrivains
, femmes
, HéroïnesCréer un quiz sur cet auteur5178 lecteurs ont répondu