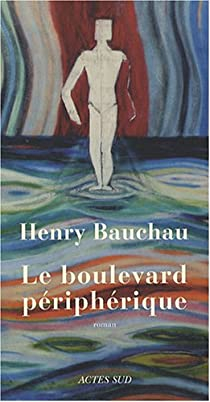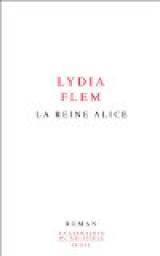Henry Bauchau/5
308 notes
Résumé :
Paris, 1980. Alors qu'il "accompagne" sa belle-fille dans sa lutte contre un cancer, le narrateur se souvient de Stéphane, son ami de jeunesse. Au début de la guerre, cet homme l'a initié à l'escalade et au dépassement de la peur, avant d'entrer dans la Résistance puis, capturé par un officier nazi - le colonel Shadow -, de mourir dans des circonstances jamais vraiment élucidées.
Mais Shadow, à la fin de la guerre, s'est fait connaître du narrateur. S... >Voir plus
Mais Shadow, à la fin de la guerre, s'est fait connaître du narrateur. S... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le boulevard périphériqueVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (60)
Voir plus
Ajouter une critique
Le narrateur visite quotidiennement sa belle-fille, Paule, atteinte d'un cancer qui semble impossible à vaincre. Il emprunte chaque jour le boulevard périphérique en voiture ou enchaîne les correspondances de RER, de métro et de bus. « Je vois une longue suite de jours où j'emprunterai le boulevard périphérique ou le métro et toutes les stations qui vont jusqu'au Fort d'Aubervilliers. » (p. 68) Ce voyage sans cesse recommencé constitue une boucle infernale dont le narrateur ne peut et ne veut s'extraire. Et peu à peu, c'est sa mémoire qui devient un boulevard périphérique, une longue boucle interminable dont il manque toutes les sorties, sans cesse repris par le flot de ses souvenirs. Ces derniers s'imposent au présent et la mort abolit le temps.
La mort imminente de Paule rappelle au vieux narrateur la disparition de son ami Stéphane, exécuté en 1944 par un officier nazi, le cruel colonel Shadow. « Je n'en peux plus de penser à Paule, de vivre à travers elle la mort de Stéphane. » (p. 15) Stéphane était jeune et plein de force, excellent grimpeur et premier de cordée. le corps du bel alpiniste a été retrouvé, mais les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Vers la fin de la guerre, le narrateur a été contacté par le colonel Shadow. Au cours de longs et d'intenses entretiens, l'officier nazi a révélé son admiration pour le résistant terroriste.
Près de 40 ans après la mort de son ami, le narrateur vit au quotidien avec son souvenir, avec l'ombre lourde de Shadow et le regret d'une jeunesse qui a été brisée en plein élan. « Je dis des petits bouts de prière pour qui ? Pour Paule, pour Stéphane ? Ou peut-être pour Shadow parce que c'est lui qui meurt peut-être le plus obstinément en moi. » (p. 144 & 145) À présent vieux et bien impuissant devant le mal qui ronge sa belle-fille, le narrateur ne sait comment parler à son fils Mykha ou comment atteindre son petit-fils Win. « Il y a que je suis l'homme sans argent, fragilisé par l'âge, mais dont les mains réchauffent encore. » (p. 173) le narrateur porte durablement ses morts en lui-même et sa vie est couverte de l'ombre de la disparition prochaine. Mais face à l'inéluctable, il reste toujours un espoir et une possible suite.
J'ai aimé suivre le narrateur et Stéphane sur leurs de voies de varappe. L'ascension et la légèreté par rapport à la pierre contrastent fabuleusement avec la pesanteur de la guerre et du colonel Shadow. Autant Stéphane est un être aérien, autant Shadow est ancré dans le sol, voire dans le tréfonds, au plus près de la boue et de la salissure. Et l'unique faiblesse de Stéphane, dérisoire talon d'Achille, sera son ultime force et sa dernière liberté.
Le roman d'Henry Bauchau est de ceux qu'il faut aborder avec l'esprit reposé, voire apaisé. Il brasse trop de douleurs et de sourdes violences pour être lu dans l'effervescence ou l'agitation. Il y a de nombreux récits parallèles et de voix qui s'élèvent. le tout est parfois difficile à suivre. Pour suivre le titre, je dirais qu'il ne faut pas manquer les sorties. Si j'ai d'abord eu des difficultés à m'intéresser à Paule, d'autant que les deux premiers tiers du roman sont plutôt consacrés à Stéphane, j'ai fini par m'attacher à cette famille marquée par la maladie et meurtrie par la routine quotidienne et nécessaire des déplacements à l'hôpital. Ce texte est d'un abord complexe : la langue est dense, le sujet est grave et l'issue très incertaine. Parvenue au bout de ma lecture, je me suis sentie comme le narrateur, la première fois qu'il a franchi un surplomb difficile, encouragé par Stéphane. C'est donc une très belle lecture, mais véritablement exigeante.
La mort imminente de Paule rappelle au vieux narrateur la disparition de son ami Stéphane, exécuté en 1944 par un officier nazi, le cruel colonel Shadow. « Je n'en peux plus de penser à Paule, de vivre à travers elle la mort de Stéphane. » (p. 15) Stéphane était jeune et plein de force, excellent grimpeur et premier de cordée. le corps du bel alpiniste a été retrouvé, mais les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Vers la fin de la guerre, le narrateur a été contacté par le colonel Shadow. Au cours de longs et d'intenses entretiens, l'officier nazi a révélé son admiration pour le résistant terroriste.
Près de 40 ans après la mort de son ami, le narrateur vit au quotidien avec son souvenir, avec l'ombre lourde de Shadow et le regret d'une jeunesse qui a été brisée en plein élan. « Je dis des petits bouts de prière pour qui ? Pour Paule, pour Stéphane ? Ou peut-être pour Shadow parce que c'est lui qui meurt peut-être le plus obstinément en moi. » (p. 144 & 145) À présent vieux et bien impuissant devant le mal qui ronge sa belle-fille, le narrateur ne sait comment parler à son fils Mykha ou comment atteindre son petit-fils Win. « Il y a que je suis l'homme sans argent, fragilisé par l'âge, mais dont les mains réchauffent encore. » (p. 173) le narrateur porte durablement ses morts en lui-même et sa vie est couverte de l'ombre de la disparition prochaine. Mais face à l'inéluctable, il reste toujours un espoir et une possible suite.
J'ai aimé suivre le narrateur et Stéphane sur leurs de voies de varappe. L'ascension et la légèreté par rapport à la pierre contrastent fabuleusement avec la pesanteur de la guerre et du colonel Shadow. Autant Stéphane est un être aérien, autant Shadow est ancré dans le sol, voire dans le tréfonds, au plus près de la boue et de la salissure. Et l'unique faiblesse de Stéphane, dérisoire talon d'Achille, sera son ultime force et sa dernière liberté.
Le roman d'Henry Bauchau est de ceux qu'il faut aborder avec l'esprit reposé, voire apaisé. Il brasse trop de douleurs et de sourdes violences pour être lu dans l'effervescence ou l'agitation. Il y a de nombreux récits parallèles et de voix qui s'élèvent. le tout est parfois difficile à suivre. Pour suivre le titre, je dirais qu'il ne faut pas manquer les sorties. Si j'ai d'abord eu des difficultés à m'intéresser à Paule, d'autant que les deux premiers tiers du roman sont plutôt consacrés à Stéphane, j'ai fini par m'attacher à cette famille marquée par la maladie et meurtrie par la routine quotidienne et nécessaire des déplacements à l'hôpital. Ce texte est d'un abord complexe : la langue est dense, le sujet est grave et l'issue très incertaine. Parvenue au bout de ma lecture, je me suis sentie comme le narrateur, la première fois qu'il a franchi un surplomb difficile, encouragé par Stéphane. C'est donc une très belle lecture, mais véritablement exigeante.
Quel livre exceptionnel !
Un homme va quotidiennement voir sa belle-fille atteinte d'un cancer.
Pour se rendre à l'hôpital, au fil des jours, il emprunte le boulevard périphérique et égrène ses souvenirs comme s'égrène le chapelet des portes de Paris.
Dès les premières pages, les personnes qui ont marqué sa vie, les évènements passés se succèdent, se mêlent au présent.
Avec un grand art, Henry Bauchau nous fait passer d'une époque, d'un personnage à l'autre, sans que jamais on ne sente de rupture dans la lecture.
On suit avec délice les méandres de ses pensées et de ses souvenirs, l'une ou l'un entraînant l'autre.
Quelle sensibilité dans l'écriture, quelle fine analyse psychologique de l'Homme et des relations humaines !
De l'ouvrier immigré qui creuse le regard dans le vide à l'ami de jeunesse, au bourreau nazi, maîtrise personnifiée, tous les portraits, et ils sont nombreux, sont sublimes et criants de vérité.
Quel art pour dire si légèrement des choses si profondes !
La mort, omniprésente côtoie l'espérance et l'amour avec une infinie délicatesse.
J'ai lu ce livre lentement, très lentement, mais trop vite encore pour m'imprégner de toutes les richesses qu'il contient.
Un homme va quotidiennement voir sa belle-fille atteinte d'un cancer.
Pour se rendre à l'hôpital, au fil des jours, il emprunte le boulevard périphérique et égrène ses souvenirs comme s'égrène le chapelet des portes de Paris.
Dès les premières pages, les personnes qui ont marqué sa vie, les évènements passés se succèdent, se mêlent au présent.
Avec un grand art, Henry Bauchau nous fait passer d'une époque, d'un personnage à l'autre, sans que jamais on ne sente de rupture dans la lecture.
On suit avec délice les méandres de ses pensées et de ses souvenirs, l'une ou l'un entraînant l'autre.
Quelle sensibilité dans l'écriture, quelle fine analyse psychologique de l'Homme et des relations humaines !
De l'ouvrier immigré qui creuse le regard dans le vide à l'ami de jeunesse, au bourreau nazi, maîtrise personnifiée, tous les portraits, et ils sont nombreux, sont sublimes et criants de vérité.
Quel art pour dire si légèrement des choses si profondes !
La mort, omniprésente côtoie l'espérance et l'amour avec une infinie délicatesse.
J'ai lu ce livre lentement, très lentement, mais trop vite encore pour m'imprégner de toutes les richesses qu'il contient.
Pas facile de circuler dans une grande ville. Me faisant cette conclusion, j'ai décidé, il y a trois semaines de cela, de ne plus sortir de chez moi, sauf exceptions contrôlées, maîtrisées, encadrées et mesurées.
Imaginons que je veuille aller à Porte des Alpes – ce qui serait assez saugrenu, mais pourquoi pas. Il faut compter une dizaine de minutes en voiture mais si je veux prendre les transports en commun, je dois d'abord aller chercher le C26 dont la station la plus proche se situe à 6 minutes de chez moi et qui passe toutes les 8 minutes en période de pointe, puis je dois descendre au terminus de Grange-Blanche après quinze minutes pour prendre le tram qui passe toutes les sept minutes en semaine. Je descends ensuite à l'arrêt Porte des Alpes après une dizaine de minutes à respirer l'odeur de merde des gens entassés autour de moi. Cet arrêt se situe à l'autre bout de l'entrée du centre commercial, ce qui représente environ 800 mètres de parking à traverser.
L'autre jour, j'avais un entretien pour un boulot à la con vers Garibaldi. Je regarde l'adresse sur le gps avant d'accepter. Niquel, c'est à côté de l'arrêt Abondance desservi par le C11 que je peux choper à deux minutes de chez moi. Je consulte les horaires en avance pour pas me faire chier à l'arrêt pour rien : 14h41. A 14h37, je suis là-bas avec un bouquin quelconque dans la main, choisi non pas pour l'intérêt qu'il pourrait représenter mais pour son format, car tout livre de transport en commun se doit de rentrer dans un sac ou dans une poche, ou d'être tenu à la main comme une vulgaire lettre pour les impôts. Inutile de se trimbaler des valises avec soi quand il s'agit seulement d'aller parler à un gogol qui recrute des gens pour un bar à salades (ce n'est pas parce qu'on met le mot « bar » dans un titre que ça devient plus fun).
14h45, toujours pas de bus. le bouquin m'énerve de plus en plus, à mesure que le bus ne vient pas. 14h50 : je sais que je ne serai pas à l'heure au rendez-vous. 14h55 : le bus arrive enfin ! Je monte à l'intérieur et je remarque que je suis la seule blanche parmi les passagers. Enfin ! j'ai l'impression d'être unique ! Dire que je cherchais un moyen de me distinguer depuis des années, il suffit que je monte dans ce bus un jour de semaine en plein après-midi pour devenir cet individu hors-normes que j'avais toujours rêvé d'être. Bref, des travaux sur la route, des arrêts tous les 500 mètres. Pour parcourir 4 ou 5 kilomètres, ce putain de bus met 20 minutes. Je descends enfin à l'arrêt Abondance. le livre est presque fini. Il est donc 15h15. Ma ponctualité, affirmée dans ma lettre de motivation, vient de trouver son infirmation. L'entretien dure une dizaine de minutes, le mec m'explique que je ne vais pas beaucoup cuisiner mais surtout faire du ménage et servir des cafés. Il demande aussi si je peux faire une semaine d'essai la semaine prochaine. Je crois pas non. Il me demande si j'ai des questions. Je me triture vaguement la tête et avec un sourire de faux-cul, je lui réponds non, vous avez tout bien expliqué, et je me dépêche de quitter son boui-boui pour choper le C11 en sens retour, que j'aperçois de loin.
Si ce que vous venez de lire vous a emmerdé, faites gaffe au Boulevard périphérique dont l'organisation urbaine de route et de poteaux indicateurs risque de vous écraser comme piéton shooté par voiture folle. Pour ma part, sensible au charme du goudron, des clignotants et des ronronnements de moteur -obligatoirement sensible à cela puisqu'on aime toujours ce qui nous berce dès l'enfance-, j'ai aimé l'énumération des stations de métro et des arrêts de bus -parisiens- à laquelle s'oblige Henry pour encadrer son récit de visites à l'hôpital, de retours à la maison, de travail. Une vie de merde, en somme, comme toutes nos vies. Parfois émergent des souvenirs anciens. de l'escalade avec Stéphane, de la résistance de guerre avec Shadow. On n'y comprend pas grand-chose au début. Les moments où l'auteur retrouve Paule dans sa chambre d'hôpital nous semblent plus calmes, plus plaisants, et pourtant, ici comme là-bas, la mort fait son chemin.
Drôle de bouquin pour drôle d'époque.
Imaginons que je veuille aller à Porte des Alpes – ce qui serait assez saugrenu, mais pourquoi pas. Il faut compter une dizaine de minutes en voiture mais si je veux prendre les transports en commun, je dois d'abord aller chercher le C26 dont la station la plus proche se situe à 6 minutes de chez moi et qui passe toutes les 8 minutes en période de pointe, puis je dois descendre au terminus de Grange-Blanche après quinze minutes pour prendre le tram qui passe toutes les sept minutes en semaine. Je descends ensuite à l'arrêt Porte des Alpes après une dizaine de minutes à respirer l'odeur de merde des gens entassés autour de moi. Cet arrêt se situe à l'autre bout de l'entrée du centre commercial, ce qui représente environ 800 mètres de parking à traverser.
L'autre jour, j'avais un entretien pour un boulot à la con vers Garibaldi. Je regarde l'adresse sur le gps avant d'accepter. Niquel, c'est à côté de l'arrêt Abondance desservi par le C11 que je peux choper à deux minutes de chez moi. Je consulte les horaires en avance pour pas me faire chier à l'arrêt pour rien : 14h41. A 14h37, je suis là-bas avec un bouquin quelconque dans la main, choisi non pas pour l'intérêt qu'il pourrait représenter mais pour son format, car tout livre de transport en commun se doit de rentrer dans un sac ou dans une poche, ou d'être tenu à la main comme une vulgaire lettre pour les impôts. Inutile de se trimbaler des valises avec soi quand il s'agit seulement d'aller parler à un gogol qui recrute des gens pour un bar à salades (ce n'est pas parce qu'on met le mot « bar » dans un titre que ça devient plus fun).
14h45, toujours pas de bus. le bouquin m'énerve de plus en plus, à mesure que le bus ne vient pas. 14h50 : je sais que je ne serai pas à l'heure au rendez-vous. 14h55 : le bus arrive enfin ! Je monte à l'intérieur et je remarque que je suis la seule blanche parmi les passagers. Enfin ! j'ai l'impression d'être unique ! Dire que je cherchais un moyen de me distinguer depuis des années, il suffit que je monte dans ce bus un jour de semaine en plein après-midi pour devenir cet individu hors-normes que j'avais toujours rêvé d'être. Bref, des travaux sur la route, des arrêts tous les 500 mètres. Pour parcourir 4 ou 5 kilomètres, ce putain de bus met 20 minutes. Je descends enfin à l'arrêt Abondance. le livre est presque fini. Il est donc 15h15. Ma ponctualité, affirmée dans ma lettre de motivation, vient de trouver son infirmation. L'entretien dure une dizaine de minutes, le mec m'explique que je ne vais pas beaucoup cuisiner mais surtout faire du ménage et servir des cafés. Il demande aussi si je peux faire une semaine d'essai la semaine prochaine. Je crois pas non. Il me demande si j'ai des questions. Je me triture vaguement la tête et avec un sourire de faux-cul, je lui réponds non, vous avez tout bien expliqué, et je me dépêche de quitter son boui-boui pour choper le C11 en sens retour, que j'aperçois de loin.
Si ce que vous venez de lire vous a emmerdé, faites gaffe au Boulevard périphérique dont l'organisation urbaine de route et de poteaux indicateurs risque de vous écraser comme piéton shooté par voiture folle. Pour ma part, sensible au charme du goudron, des clignotants et des ronronnements de moteur -obligatoirement sensible à cela puisqu'on aime toujours ce qui nous berce dès l'enfance-, j'ai aimé l'énumération des stations de métro et des arrêts de bus -parisiens- à laquelle s'oblige Henry pour encadrer son récit de visites à l'hôpital, de retours à la maison, de travail. Une vie de merde, en somme, comme toutes nos vies. Parfois émergent des souvenirs anciens. de l'escalade avec Stéphane, de la résistance de guerre avec Shadow. On n'y comprend pas grand-chose au début. Les moments où l'auteur retrouve Paule dans sa chambre d'hôpital nous semblent plus calmes, plus plaisants, et pourtant, ici comme là-bas, la mort fait son chemin.
Drôle de bouquin pour drôle d'époque.
Très beau roman écrit par un poète de 95 ans! le narrateur traverse chaque jour le boulevard périphérique pour aller rendre visite à sa belle fille atteinte d'un cancer. Cette mort redoutée va le ramener quarante ans plus tôt et faire ressurgir la disparition terrible et mystérieuse de son ami Stéphane grimpeur magnifique , engagé dans la résistance.
Entre légèreté et pesanteur, beauté et noirceur, amour et haine, Henry Bauchau trouve dans leur puissance, un point de convergence des extrêmes. Dans un style épuré, ce psychanalyste nous entraine dans les profondeurs de l'âme. Tout en finesse et délicatesse, il décortique les racines du mal dans sa terrible intelligence, il interroge les questions fondamentales de la vie et de la mort.
« je suis dans le petit bureau où je reçois mes patients. J'écoute, j'écoute des souffrances, des actes manqués, de faux espoirs . J'écoute des rêves, des piétinements, des élans ( ). J'écoute le mieux que je peux et comme il y a en moi une forte présence de mort j'entends leur parole de mort, de condamnation d'eux-mêmes qui s'élève sur un fond d'amour et d'espoir en mineur. Je pense c'est bien d'être heureux, c'est bien de jouir. Mais il n'y a pas de devoir de jouir pas de devoir d'être heureux. »
Un texte fort, qui porte vers la vie malgré les apparences, à savourer avec lenteur, à lire et à relire pour en saisir toute la profondeur.
Entre légèreté et pesanteur, beauté et noirceur, amour et haine, Henry Bauchau trouve dans leur puissance, un point de convergence des extrêmes. Dans un style épuré, ce psychanalyste nous entraine dans les profondeurs de l'âme. Tout en finesse et délicatesse, il décortique les racines du mal dans sa terrible intelligence, il interroge les questions fondamentales de la vie et de la mort.
« je suis dans le petit bureau où je reçois mes patients. J'écoute, j'écoute des souffrances, des actes manqués, de faux espoirs . J'écoute des rêves, des piétinements, des élans ( ). J'écoute le mieux que je peux et comme il y a en moi une forte présence de mort j'entends leur parole de mort, de condamnation d'eux-mêmes qui s'élève sur un fond d'amour et d'espoir en mineur. Je pense c'est bien d'être heureux, c'est bien de jouir. Mais il n'y a pas de devoir de jouir pas de devoir d'être heureux. »
Un texte fort, qui porte vers la vie malgré les apparences, à savourer avec lenteur, à lire et à relire pour en saisir toute la profondeur.
Henri Bauchau raconte deux histoires dans ce livre , le combat de sa belle -fille de 30 ans , contre le cancer et un souvenir de jeunesse qui l'a beaucoup marqué ; la mort d'un ami dont il était très proche , mort , torturé par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale , cet ami était résistant et avait essayé d'assassiner un officier allemand de façon presque suicidaire .
Avec le recul des années , il semble de plus en plus à l'auteur que ce geste est effectivement suicidaire et est peut-être lié à l'amour non partagé que lui portait son ami .
Tous les jours , l'auteur prend ' le périphérique ' d'où le nom du roman pour se rendre au chevet de sa belle -fille , comme si à travers elle , il essayait d'accomplir une réparation du passé .
L'auteur est psychanaliste et cela se sent , lorsqu'il nous raconte l'acte manqué , le jour de la mort de sa belle -fille , en effet , ce matin -là , il se rend compte qu'il a oublié les clés sur sa voiture et que la batterie est déchargée , ce passage est très bien décrit ,.
L'auteur apprivoise la mort , doucement , la mort qui balaie tout car aussitôt que la chambre d'hôpital de sa belle -fille est libérée , une autre patiente prend sa place .
J'avoue que ce roman qui démarrait bien m'a un peu déçue , car je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions et cela m'attriste car je viens de découvrir l'auteur qui a 99 ans cette année et qui a l'air si sympathique .
Avec le recul des années , il semble de plus en plus à l'auteur que ce geste est effectivement suicidaire et est peut-être lié à l'amour non partagé que lui portait son ami .
Tous les jours , l'auteur prend ' le périphérique ' d'où le nom du roman pour se rendre au chevet de sa belle -fille , comme si à travers elle , il essayait d'accomplir une réparation du passé .
L'auteur est psychanaliste et cela se sent , lorsqu'il nous raconte l'acte manqué , le jour de la mort de sa belle -fille , en effet , ce matin -là , il se rend compte qu'il a oublié les clés sur sa voiture et que la batterie est déchargée , ce passage est très bien décrit ,.
L'auteur apprivoise la mort , doucement , la mort qui balaie tout car aussitôt que la chambre d'hôpital de sa belle -fille est libérée , une autre patiente prend sa place .
J'avoue que ce roman qui démarrait bien m'a un peu déçue , car je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions et cela m'attriste car je viens de découvrir l'auteur qui a 99 ans cette année et qui a l'air si sympathique .
Citations et extraits (71)
Voir plus
Ajouter une citation
Ce que j'ai fait de mon enfance, je n'en sais rien, je l'ai perdue en partie, mais il en reste des traces effilochées à tous les buissons, à toutes les ronces de ma vie. Peut-être que quelque chose renaîtra, ce n'est pas mon affaire maintenant. Ce que je vois dans le regard, dans la souffrance de Shadow, c'est peut-être que Stéphane avait gardé sa légèreté d'enfance, n'ayant rien eu d'autre. Ayant sans doute accepté de n'avoir rien d'autre. Alors que Shadow est mort à son enfance, qu'il est tout entier adulte, dans la terrible pesanteur de cet état. Ce qui se croise dans nos regards, c'est notre double pesanteur braquée sur le passage aérien et ferme de Stéphane. Je perçois en même temps la pesanteur effrayante de Shadow. Une pesanteur satanique où tout est puissance, métaux, lourdes matières de l'esprit. Si je pèse peu c'est par rapport à la formidable concentration d'énergie et d'esprit et d'intelligence métallique de Shadow. Moi aussi, je pèse lourd avec ma cargaison d'espoirs, de désirs, d'amours en regard de la petite barque et de la grande voile blanche de Stéphane. Tous deux sont allés bien plus loin que moi dans la réalité, Shadow dans la pesanteur, dans la dure complexité du monde, Stéphane dans l'allègement, dans une allégresse blessée par la vie, dans un soulèvement de plante qui sort de la terre sans savoir encore s'il y a un soleil.
[Incipit.]
Tandis que le métro m'emporte vers la station du fort d'Aubervilliers où je prendrai le bus pour Bobigny, je pense à ma famille telle qu'elle était dans mon enfance. La famille, les années lointaines que j'ai encore connues, c'est cela surtout qui intéresse Paule lorsque nous parlons ensemble à l'hôpital. Les racines, les liens entremêlés, les façons de vivre de ce clan auquel son mari et son petit garçon, souvent à leur insu, appartiennent si fort et avec qui elle a conclu alliance.
Le traitement contre le cancer a fait perdre ses cheveux à Paule. Je pense souvent, en la voyant si préoccupée de garder sa perruque bien en place, combien elle a dû souffrir en se découvrant chauve. Stéphane, s'il avait vécu, s'il n'avait pas été assassiné en 1944 par les nazis, serait-il devenu chauve ? Je le verrai toujours tel qu'il était à vingt-sept ans, et dans ma mémoire il n'aura jamais été touché par le temps. Il me semble qu'il entre avec moi dans la chambre de Paule, avec ses yeux très bleus, ses cheveux blonds, sa taille haute, son sourire bref. Non pas timide mais réservé. Un homme de l'acte.
C'est en juillet 1940 que je l'ai connu, dans un chantier de déblaiement des ruines de la guerre. De son métier il était sondeur de mines, mais il connaissait bien les travaux de chantier. Très vite c'est lui qui a dirigé le nôtre. Quand nos chantiers se sont regroupés il a pris la tête d'un camp de formation de chefs de chantier en 1941 dans la région mosane.
Chaque fois qu'il était libre il partait grimper dans les rochers qui par endroits bordent le fleuve, puisque depuis la guerre les Alpes ou les autres montagnes ne lui étaient plus accessibles. J'ai appris qu'il était un excellent alpiniste et que montagnes, rochers, glaciers étaient la passion de sa vie.
Un jour il m'a proposé d'aller grimper avec lui. Un petit train nous mène à proximité d'un groupe de rochers où il y a plusieurs voies à faire. Il sort de son sac une corde tressée en anneaux et la met autour de son cou. Nous marchons jusqu'au pied des rochers et avec son collier de cordes il paraît à la fois modeste et glorieux. Pour grimper il faut une pratique, un apprentissage et tout de suite j'aime le faire avec lui. Je me rappelle cette voie, la première qu'il m'a fait faire. Je suis impressionné car j'ai toujours eu le vertige. Il ne m'explique pas grand-chose sinon le maniement de la corde et comment il faut la faire coulisser dans les mousquetons qu'il attache à quelques pitons. Pour le reste, il me dit : "Fais comme moi." Je le regarde m'étonnant du peu de surface qui lui est nécessaire pour une prise de pied ou une prise de main. Cela me semble irréalisable pour moi, je vais lâcher, glisser, pourtant j'arrive à peu près à tenir où il a tenu, à me soulever là où il a pris de la hauteur. A un passage un peu délicat il faut contourner le rocher en ne se tenant en équilibre que sur un pied tandis que l'autre, à tâtons, cherche une vire sur laquelle s'élever. On est forcé de poser le regard vers le bas. Nous ne sommes pas très haut, assez pourtant pour que la sensation du vide me trouble. Tout se met à tournoyer légèrement et mon pied tremble sur la prise qu'il faut quitter sans que j'arrive à trouver l'autre.
Tandis que le métro m'emporte vers la station du fort d'Aubervilliers où je prendrai le bus pour Bobigny, je pense à ma famille telle qu'elle était dans mon enfance. La famille, les années lointaines que j'ai encore connues, c'est cela surtout qui intéresse Paule lorsque nous parlons ensemble à l'hôpital. Les racines, les liens entremêlés, les façons de vivre de ce clan auquel son mari et son petit garçon, souvent à leur insu, appartiennent si fort et avec qui elle a conclu alliance.
Le traitement contre le cancer a fait perdre ses cheveux à Paule. Je pense souvent, en la voyant si préoccupée de garder sa perruque bien en place, combien elle a dû souffrir en se découvrant chauve. Stéphane, s'il avait vécu, s'il n'avait pas été assassiné en 1944 par les nazis, serait-il devenu chauve ? Je le verrai toujours tel qu'il était à vingt-sept ans, et dans ma mémoire il n'aura jamais été touché par le temps. Il me semble qu'il entre avec moi dans la chambre de Paule, avec ses yeux très bleus, ses cheveux blonds, sa taille haute, son sourire bref. Non pas timide mais réservé. Un homme de l'acte.
C'est en juillet 1940 que je l'ai connu, dans un chantier de déblaiement des ruines de la guerre. De son métier il était sondeur de mines, mais il connaissait bien les travaux de chantier. Très vite c'est lui qui a dirigé le nôtre. Quand nos chantiers se sont regroupés il a pris la tête d'un camp de formation de chefs de chantier en 1941 dans la région mosane.
Chaque fois qu'il était libre il partait grimper dans les rochers qui par endroits bordent le fleuve, puisque depuis la guerre les Alpes ou les autres montagnes ne lui étaient plus accessibles. J'ai appris qu'il était un excellent alpiniste et que montagnes, rochers, glaciers étaient la passion de sa vie.
Un jour il m'a proposé d'aller grimper avec lui. Un petit train nous mène à proximité d'un groupe de rochers où il y a plusieurs voies à faire. Il sort de son sac une corde tressée en anneaux et la met autour de son cou. Nous marchons jusqu'au pied des rochers et avec son collier de cordes il paraît à la fois modeste et glorieux. Pour grimper il faut une pratique, un apprentissage et tout de suite j'aime le faire avec lui. Je me rappelle cette voie, la première qu'il m'a fait faire. Je suis impressionné car j'ai toujours eu le vertige. Il ne m'explique pas grand-chose sinon le maniement de la corde et comment il faut la faire coulisser dans les mousquetons qu'il attache à quelques pitons. Pour le reste, il me dit : "Fais comme moi." Je le regarde m'étonnant du peu de surface qui lui est nécessaire pour une prise de pied ou une prise de main. Cela me semble irréalisable pour moi, je vais lâcher, glisser, pourtant j'arrive à peu près à tenir où il a tenu, à me soulever là où il a pris de la hauteur. A un passage un peu délicat il faut contourner le rocher en ne se tenant en équilibre que sur un pied tandis que l'autre, à tâtons, cherche une vire sur laquelle s'élever. On est forcé de poser le regard vers le bas. Nous ne sommes pas très haut, assez pourtant pour que la sensation du vide me trouble. Tout se met à tournoyer légèrement et mon pied tremble sur la prise qu'il faut quitter sans que j'arrive à trouver l'autre.
sur la route de Paris la banalité du décor trop connu m'écrase. Ce n'est pas vraiment la laideur, la plupart des bâtiments sont assez neufs. Ce qui me frappe c'est le manque. Quelque chose fait défaut qui devrait être là, qui y était encore il y a peu d'années. Je m'efforce de me dégager, de ces regrets, de ces soupirs. Seul compte ce qui est, cela seul est vrai. Tout est lié, le passé, la nature déjà restreinte, déjà blessée, celle qu'ont vue Claude Monet et ses camarades, et ce présent d'immeubles et de station service. Tout est là et dans ce rapport universel je suis pour le moment un point mobile qui va vers un autre momentanément immobilisé et couché avant la guérison ou l'intégration dans des formes nouvelles. Me voilà à la Porte Maillot, je tourne autour du square au milieu de la place et je m'engage sur le périphérique. Pas trop de monde ce dimanche après-midi, ça roule; Il me semble faire à l'ouest et au nord de Paris une sorte de chemin de croix comme on en faisait à l'église dans mon enfance. Mais les stations, cette fois-ci sont des portes. Des portes qui s'ouvrent vers Paris, vers l'encombrement, les bouchons et de l'autre côté vers la gigantesque banlieue, les autoroutes, les routes, et la campagne ruisselante de pluie. J'égrène en roulant les noms des portes comme les grains d'un chapelet. La ville est coupée en deux par ce boulevard, tout ce qui l'environne est marqué d'une sorte de saleté grise comme les gares de mon enfance l'étaient par la suie. Tout est à la fois mesquin et gigantesque, c'est Babylone, mais le regard ne peut se fixer nulle part. Je suis poussé en avant par tous ceux qui m'entourent et qui me suivent. Les choses ne sont pas faites pour être regardées, elles ne sont d'aucune façon accordées à un regard même à quatre-vingt kilomètres à l'heure. Je suis poussé en avant, vers où ? je suis poussé ver l'hôpital et la maladie. C'est là que l'on aboutit en ce lieu et en ce temps, je le ressens avec force.
Pourquoi nous avons fait deux voies ce matin, pourquoi en refaire une ou deux tout à l'heure? La varappe ce n'est qu'un prêtexte que nous nous donnons. Le vrai, le motif, c'est ce moment-ci où je le regarde, où il me regarde. C'était ce matin, ce regard sur sa façon d'aborder le rocher, sur sa manière de rassembler la corde en anneaux sur ses épaules. Et lui aussi voulait me voir à certains moments comme maintenant, emporter en lui une image de moi, que je ne peux absolument pas imaginer, qui est la sienne. En somme, ce mouvement à travers le temps et l'espace que nous avons fait, ce long retour qui nous attend, ça ressemble à quoi? A un dialogue de regards, un dialogue sans paroles entre nous, parce que nous ne nous sommes presque rien dit et c'est autre chose que des paroles que nous échangeons. Ce qui se passe ici et maintenant, ce qui nous a poussés à venir ici l'un et l'autre à travers tant de difficultés, il est clair que si nous étions un homme et une femme, on penserait que c'est l'amour. Et c'est cela sans doute, je suis prêt, lui aussi peut-être, à le reconnaître mais je suis arrêté parce qu'il n'y a entre nous ni désir, ni possession. Il n'entrera pas dans mon avoir, ni moi dans le sien. Il est hors mots d'amour, hors mots sexuels. Tout se passe dans l'échange de regards dont bientôt nous allons être privés. Il n'y a d'autre raison à notre présence ici, à notre heureuse conversation de regards; Et bientôt, dans trois heures et quelques minutes, nous serons séparés, sans savoir pour combien de temps, par la nécessité, par la distance, et par la guerre.
Je n'avais jamais vraiment pensé à la vieillesse et voilà qu'elle approchait. La mort, utile aux autres, ne me faisait pas peur, du moins je le croyais, mais le vrai courage, la vraie lutte, celle contre l'affaiblissement, la diminution physique, la perte de mémoire, les maladies de l'âge, cela je ne l'avais pas envisagé et voici que c'était là à ma porte.
Videos de Henry Bauchau (12)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Henry Bauchau (44)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La littérature belge
Quel roman Nicolas Ancion n'a-t-il pas écrit?
Les ours n'ont pas de problèmes de parking
Nous sommes tous des playmobiles
Les Ménapiens dévalent la pente
Quatrième étage
15 questions
63 lecteurs ont répondu
Thèmes :
roman
, littérature belgeCréer un quiz sur ce livre63 lecteurs ont répondu