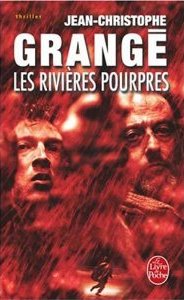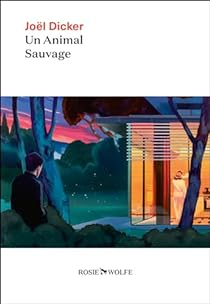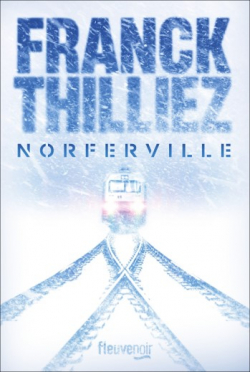Joël Dicker/5
6621 notes
Résumé :
Quand les masques tombent… Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'énigme de la chambre 622Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (830)
Voir plus
Ajouter une critique
Genève. Un hôtel huppé où l'auteur himself y séjourne pour quelques vacances. Entre deux plaintes au sujet de son éditeur décédé l'année précédente, il y fait la rencontre de Scarlett, riche héritière en fuite d'un mari violent. Elle l'accoste, le reconnaît, il est l'Écrivain, et voilà que la donzelle souhaite comprendre les mécanismes de l'écriture. Il tente de lui apprendre, s'essaie à la difficile explication de la création d'un roman. Ça pourrait être intéressant, mais bien vite cette idée s'efface au profit d'une enquête qui tombe mystérieusement sous leurs paluches : pourquoi n'y a-t-il pas de chambre 622 ?
Le roman présente deux temporalités : celle de l'Écrivain qui enquête sur le mystère d'une absence de numéro. Et la seconde, qui nous replace des années auparavant, avec Macaire, un jeune banquier à qui la présidence de la banque familiale pourrait lui être compromise. Deux temporalités sont aisées à saisir, mais l'auteur en rajoute, tartine des événements “16 ans plus tôt”, “vingt ans plus tôt”, “la veille du meurtre”, “cinq mois plus tôt”... et cette accumulation de date devient complexe à retenir, quasi impossible à broder sur une ligne du temps. On valse d'une date à l'autre sans aisance.
On se perd. On abandonne tout intérêt pour l'affaire qui, sur la fin, s'emmêle dans plusieurs deus-ex machina, épuisant toute possibilité d'être surpris, engendrant dépit. Un livre qui aurait pu être tranché d'une bonne centaine de pages. Un roman qui n'a pas su me plaire et dont, malheureusement, je ne parviens pas à en extirper le moindre grain de positif.
On accumule les clichés, ainsi qu'un tissage d'intrigue trop emmêlé pour qu'il y ait un soupçon de crédibilité.
Le roman présente deux temporalités : celle de l'Écrivain qui enquête sur le mystère d'une absence de numéro. Et la seconde, qui nous replace des années auparavant, avec Macaire, un jeune banquier à qui la présidence de la banque familiale pourrait lui être compromise. Deux temporalités sont aisées à saisir, mais l'auteur en rajoute, tartine des événements “16 ans plus tôt”, “vingt ans plus tôt”, “la veille du meurtre”, “cinq mois plus tôt”... et cette accumulation de date devient complexe à retenir, quasi impossible à broder sur une ligne du temps. On valse d'une date à l'autre sans aisance.
On se perd. On abandonne tout intérêt pour l'affaire qui, sur la fin, s'emmêle dans plusieurs deus-ex machina, épuisant toute possibilité d'être surpris, engendrant dépit. Un livre qui aurait pu être tranché d'une bonne centaine de pages. Un roman qui n'a pas su me plaire et dont, malheureusement, je ne parviens pas à en extirper le moindre grain de positif.
On accumule les clichés, ainsi qu'un tissage d'intrigue trop emmêlé pour qu'il y ait un soupçon de crédibilité.
Le succès du quelconque.
Pour moi, l'énigme ne se situe pas dans la chambre 622 mais dans l'incroyable succès des romans de Joel Dicker.
En rapatriant l'intrigue de son nouveau roman dans sa Suisse natale, le Roger Federer des lettres helvètes, le style en moins, a aussi embarqué son habituel excédent de bagages : 550 pages avec des trous dans la raquette.
Un écrivain à succès qui s'appelle bizarrement Joël (mais où va t'il chercher tout cela ?), va soigner, le pauvre chéri, un gros chagrin dans un Palace des Alpes Suisses. La vie est vraiment trop dure pour ce gendre idéal. C'est du Zola avec une Rolex au poignet. Il découvre avec sa voisine de chambre un peu collante qu'un meurtre non résolu s'est produit quelques années plus tôt dans ce zoo à millionnaires. L'hôtel a rebaptisé la chambre 622 en 621 bis dans un élan de créativité qui rendrait jaloux n'importe quel lauréat du concours Lepine, pour effacer cet évènement de la mémoire collective. le fameux Joel et l'inspirante Scarlett, vont mener l'enquête qui, Suisse oblige, Cold case d'attaché case, aura pour décorum une histoire de succession à la tête d'une grande banque d'affaires. On n'est pas dans le braquage d'un carnet de timbres à la Poste du village.
Pour quelques lignes, je vais essayer d'être moins taquin et reconnaître de réelles qualités à ce roman. La construction est celle d'un architecte fan de légos et les sauts dans le temps soulignent une mécanique narrative sans accroc. Avouons aussi que s'il n'est pas révolutionnaire d'ignorer le pédigrée d'un tueur avant le dénouement de l'intrigue, il est plus rare de devoir deviner aussi l'identité de la victime. L'auteur connait bien son affaire, le lecteur est manipulé par un osthéo du suspense qui malaxe son récit de faux semblants et il y a tant de rebondissements dans l'histoire que nous ne sommes pas loin d'une compétition de trempoline. J'ai trouvé ce côté feuilletonesque plutôt divertissant. le rythme s'accélère au fil des chapitres de façon opportune pour capter l'attention et la fin du récit, imprévisible, ressemble au dénouement d'un vieil épisode de la série Arsène Lupin avec Georges Descrières où les masques tombent au propre comme au figuré. le cahier des charges d'un bon petit polar est donc rempli selon moi. Mais sans plus... et avec des moins.
Les noms des personnages sont aussi bizarres que romanesques (Sinior Tarnogol, Macaire Ebezner , Lev Levovitch…) mais en terme de profils psychologiques, c'est du 0 sur l'échelle de Sigmund. Encéphalogramme trumpien. C'est ce manque de profondeur d'esprit qui m'incline à ranger hélas les romans de Joel Dicker dans le tout venant de ma bibliothèque.
Cet auteur excelle selon moi dans la construction du récit mais ses carences en second degré, une cure s'impose, ruinent ses tentatives introspectives. Ses personnages devraient se limiter à agir et avoir l'interdiction de s'asseoir et de réfléchir.
C'est dommage car les hommages glissés dans le roman à son défunt éditeur et pygmalion à travers le récit de souvenirs communs sont touchants et empreints d'une vraie sincérité mais cette plume d'éternel adolescent et cette incapacité à plonger sous la surface des choses frustrent le lecteur que je suis.
Je reste donc sur ma faim alors que le roman est plutôt calorique.
Pour moi, l'énigme ne se situe pas dans la chambre 622 mais dans l'incroyable succès des romans de Joel Dicker.
En rapatriant l'intrigue de son nouveau roman dans sa Suisse natale, le Roger Federer des lettres helvètes, le style en moins, a aussi embarqué son habituel excédent de bagages : 550 pages avec des trous dans la raquette.
Un écrivain à succès qui s'appelle bizarrement Joël (mais où va t'il chercher tout cela ?), va soigner, le pauvre chéri, un gros chagrin dans un Palace des Alpes Suisses. La vie est vraiment trop dure pour ce gendre idéal. C'est du Zola avec une Rolex au poignet. Il découvre avec sa voisine de chambre un peu collante qu'un meurtre non résolu s'est produit quelques années plus tôt dans ce zoo à millionnaires. L'hôtel a rebaptisé la chambre 622 en 621 bis dans un élan de créativité qui rendrait jaloux n'importe quel lauréat du concours Lepine, pour effacer cet évènement de la mémoire collective. le fameux Joel et l'inspirante Scarlett, vont mener l'enquête qui, Suisse oblige, Cold case d'attaché case, aura pour décorum une histoire de succession à la tête d'une grande banque d'affaires. On n'est pas dans le braquage d'un carnet de timbres à la Poste du village.
Pour quelques lignes, je vais essayer d'être moins taquin et reconnaître de réelles qualités à ce roman. La construction est celle d'un architecte fan de légos et les sauts dans le temps soulignent une mécanique narrative sans accroc. Avouons aussi que s'il n'est pas révolutionnaire d'ignorer le pédigrée d'un tueur avant le dénouement de l'intrigue, il est plus rare de devoir deviner aussi l'identité de la victime. L'auteur connait bien son affaire, le lecteur est manipulé par un osthéo du suspense qui malaxe son récit de faux semblants et il y a tant de rebondissements dans l'histoire que nous ne sommes pas loin d'une compétition de trempoline. J'ai trouvé ce côté feuilletonesque plutôt divertissant. le rythme s'accélère au fil des chapitres de façon opportune pour capter l'attention et la fin du récit, imprévisible, ressemble au dénouement d'un vieil épisode de la série Arsène Lupin avec Georges Descrières où les masques tombent au propre comme au figuré. le cahier des charges d'un bon petit polar est donc rempli selon moi. Mais sans plus... et avec des moins.
Les noms des personnages sont aussi bizarres que romanesques (Sinior Tarnogol, Macaire Ebezner , Lev Levovitch…) mais en terme de profils psychologiques, c'est du 0 sur l'échelle de Sigmund. Encéphalogramme trumpien. C'est ce manque de profondeur d'esprit qui m'incline à ranger hélas les romans de Joel Dicker dans le tout venant de ma bibliothèque.
Cet auteur excelle selon moi dans la construction du récit mais ses carences en second degré, une cure s'impose, ruinent ses tentatives introspectives. Ses personnages devraient se limiter à agir et avoir l'interdiction de s'asseoir et de réfléchir.
C'est dommage car les hommages glissés dans le roman à son défunt éditeur et pygmalion à travers le récit de souvenirs communs sont touchants et empreints d'une vraie sincérité mais cette plume d'éternel adolescent et cette incapacité à plonger sous la surface des choses frustrent le lecteur que je suis.
Je reste donc sur ma faim alors que le roman est plutôt calorique.
Impossible d'aller jusqu'au bout de ce livre navrant à tout point de vue. Dicker est une énigme pour moi. Ces deux premiers romans m'avaient emballée comme nombre de lecteurs. Mais depuis, ce n'est que déception et celui-ci n'échapper pas à la règle; écriture plate, intrigue prévisible, personnages caricaturaux.
Bon, c'est mon deuxième Dicker. En fermant le premier, qui était presque aussi le sien (en terme de célébrité) et qui bénéficiait de critiques dithyrambiques, je m'étais dit : « mon gars, t'es pas dans le trip mainstream exigé en la circonstance, c'est quand-même pas, ce bouquin, le chef d'oeuvre qui fait tomber la bonne société en pâmoison ? »
Alors après avoir souri en voyant passer les suivants, je me suis donné une deuxième chance.
Et j'ai bien fait car, j'ai trouvé cet opus bien meilleur que le gars Harry. Et surtout j'ai bien mieux compris pourquoi je n'aime pas cette littérature.
C'est donc très bien construit, un petit bijou de complexité. Certains pourront s'extasier devant une telle prouesse narrative, mais personnellement, je crois que le mieux est parfois l'ennemi du bien. C'est tellement emberlificoté que je suis incapable de savoir si tous les indices, tous les faits sont réellement cohérents. Mais sans doute l'est-ce car c'est comme l'horlogerie Suisse, précis.
Et je ne doute pas qu'il y ait un vrai travail de découpage derrière cette énigme policière. Je me suis perdu dans les temps, l'auteur ayant pris un malin plaisir à aligner cinq ou six temporalités différentes. Un vrai labyrinthe.
Précis donc mais précieux aussi, comme leurs coffres cette fois. Ah quelle belle société nous est narrée ici. On ne bouffe pas sur le pouce des sandwichs dans ces romans Genevois, on déjeune, on soupe, on déguste des mets toujours très raffinés. On devine que l'auteur n'est pas en manque de connaissance sur ces pratiques culinaires sociétales. Au pire, la cuisine rapide pour nos personnages principaux : des tagliatelles au homard, mais juste parce-que le majordome n'a pas eu le temps d'acheter des truffes au marché bio de Verbier.
Car bien sûr tous ces héros qui émeuvent les critiques littéraires de Paris, de Lausanne et de Luxembourg (surtout de ce petit paradis mais est-ce surprenant ?) ne savent rien faire sans l'aide d'une armée de domestiques qui les transportent, les nourrissent, les habillent, leur font les courses, les aiment même comme de bons laquais.
Bien sûr ils ont des compétences tout de même, il faut être juste. En placements financiers juteux (Suisse oblige), en « rôle playing » aussi. Pas pour passer une soirée à jouer à « advanced dungeons and dragons » ou « call of chtulhu », mais pour espionner les employés d'hôtel et dénoncer éventuellement des comportements inappropriés de ces serviteurs plébéiens envers les riches clients qui fréquentent ces palaces Suisses. Grande tradition comique Suisse sans doute (Thomas Wiesel doit se retourner dans sa tombe).
Pareil, on n'est pas dans des lieux anodins. Suites quinze étoiles, villa à Corfou, limousines et voitures de sport…
Pour finir ce tableau, c'est le thème de la filiation qui est mis en exergue : fils de banquier tu es et tu seras . . .fils d'acteur tu nais et resteras . . . domestique tu es...etc...
Vous l'aurez compris, ce n'est pas tant la nature de l'intrigue qui m'ennuie, c'est le cadre.
Il ne m'intéresse pas.
Je n'ai ressenti aucune empathie pour aucun des personnages.
Leurs pseudo souffrances existentielles, leur volonté de dominer, de contrôler, de tromper, n'a même pas l'excuse de la nécessité, du concours de circonstances.
C'est l'anti polar noir : c'est le polar blanc
Blanc comme les neiges qui tombent là-bas, blanc comme l'argent qui est passé par leurs coffres, blanc comme les oies qui pépient à la recherche du bon parti pour avoir à éviter d'apprendre à faire la cuisine et se trouver un travail intéressant.
Pour couronner (et oui décidément) le tout, il nous fait un panégyrique de son éditeur décédé deux fois : en 2018 en vrai et une seconde (j'espère) dans ce livre. Oh que c'est touchant? Non, c'est nombriliste comme le reste.
C'est donc un exercice de style, mâtiné d'un hommage à son éditeur que livre Dicker, avec une histoire secondaire à l'eau de rose entre l'écrivain qui enquête sur tout ce que je viens de décrire et la riche (encore ?) héritière prénommée Scarlett et/ou sa voisine de palier... Peut-être faut-il aller voir les magazines people pour savoir à qui s'adressent ses clins d'oeil. Personnellement, cela ne m'intéresse pas.
Il serait temps que ce fils de politicien-écrivain revienne parmi les citoyens de base. Au vingt-et-unième siècle, cette histoire de « fils de » n'a plus de sens dans l'imaginaire collectif, n'en déplaise à nos maîtres.
C'est brillant et sans profondeur. La dernière phrase du livre est à replacer dans le contexte de ce que je viens de décrire pour en apprécier toute la saveur.
Finalement, zéro étoile pour le fond, cinq pour la forme parfaite. Moyenne : 2 arrondi à 0,5 (Je compte moins bien que ses personnages, moins habitué qu'eux aux bilans annuels des banques).
Alors après avoir souri en voyant passer les suivants, je me suis donné une deuxième chance.
Et j'ai bien fait car, j'ai trouvé cet opus bien meilleur que le gars Harry. Et surtout j'ai bien mieux compris pourquoi je n'aime pas cette littérature.
C'est donc très bien construit, un petit bijou de complexité. Certains pourront s'extasier devant une telle prouesse narrative, mais personnellement, je crois que le mieux est parfois l'ennemi du bien. C'est tellement emberlificoté que je suis incapable de savoir si tous les indices, tous les faits sont réellement cohérents. Mais sans doute l'est-ce car c'est comme l'horlogerie Suisse, précis.
Et je ne doute pas qu'il y ait un vrai travail de découpage derrière cette énigme policière. Je me suis perdu dans les temps, l'auteur ayant pris un malin plaisir à aligner cinq ou six temporalités différentes. Un vrai labyrinthe.
Précis donc mais précieux aussi, comme leurs coffres cette fois. Ah quelle belle société nous est narrée ici. On ne bouffe pas sur le pouce des sandwichs dans ces romans Genevois, on déjeune, on soupe, on déguste des mets toujours très raffinés. On devine que l'auteur n'est pas en manque de connaissance sur ces pratiques culinaires sociétales. Au pire, la cuisine rapide pour nos personnages principaux : des tagliatelles au homard, mais juste parce-que le majordome n'a pas eu le temps d'acheter des truffes au marché bio de Verbier.
Car bien sûr tous ces héros qui émeuvent les critiques littéraires de Paris, de Lausanne et de Luxembourg (surtout de ce petit paradis mais est-ce surprenant ?) ne savent rien faire sans l'aide d'une armée de domestiques qui les transportent, les nourrissent, les habillent, leur font les courses, les aiment même comme de bons laquais.
Bien sûr ils ont des compétences tout de même, il faut être juste. En placements financiers juteux (Suisse oblige), en « rôle playing » aussi. Pas pour passer une soirée à jouer à « advanced dungeons and dragons » ou « call of chtulhu », mais pour espionner les employés d'hôtel et dénoncer éventuellement des comportements inappropriés de ces serviteurs plébéiens envers les riches clients qui fréquentent ces palaces Suisses. Grande tradition comique Suisse sans doute (Thomas Wiesel doit se retourner dans sa tombe).
Pareil, on n'est pas dans des lieux anodins. Suites quinze étoiles, villa à Corfou, limousines et voitures de sport…
Pour finir ce tableau, c'est le thème de la filiation qui est mis en exergue : fils de banquier tu es et tu seras . . .fils d'acteur tu nais et resteras . . . domestique tu es...etc...
Vous l'aurez compris, ce n'est pas tant la nature de l'intrigue qui m'ennuie, c'est le cadre.
Il ne m'intéresse pas.
Je n'ai ressenti aucune empathie pour aucun des personnages.
Leurs pseudo souffrances existentielles, leur volonté de dominer, de contrôler, de tromper, n'a même pas l'excuse de la nécessité, du concours de circonstances.
C'est l'anti polar noir : c'est le polar blanc
Blanc comme les neiges qui tombent là-bas, blanc comme l'argent qui est passé par leurs coffres, blanc comme les oies qui pépient à la recherche du bon parti pour avoir à éviter d'apprendre à faire la cuisine et se trouver un travail intéressant.
Pour couronner (et oui décidément) le tout, il nous fait un panégyrique de son éditeur décédé deux fois : en 2018 en vrai et une seconde (j'espère) dans ce livre. Oh que c'est touchant? Non, c'est nombriliste comme le reste.
C'est donc un exercice de style, mâtiné d'un hommage à son éditeur que livre Dicker, avec une histoire secondaire à l'eau de rose entre l'écrivain qui enquête sur tout ce que je viens de décrire et la riche (encore ?) héritière prénommée Scarlett et/ou sa voisine de palier... Peut-être faut-il aller voir les magazines people pour savoir à qui s'adressent ses clins d'oeil. Personnellement, cela ne m'intéresse pas.
Il serait temps que ce fils de politicien-écrivain revienne parmi les citoyens de base. Au vingt-et-unième siècle, cette histoire de « fils de » n'a plus de sens dans l'imaginaire collectif, n'en déplaise à nos maîtres.
C'est brillant et sans profondeur. La dernière phrase du livre est à replacer dans le contexte de ce que je viens de décrire pour en apprécier toute la saveur.
Finalement, zéro étoile pour le fond, cinq pour la forme parfaite. Moyenne : 2 arrondi à 0,5 (Je compte moins bien que ses personnages, moins habitué qu'eux aux bilans annuels des banques).
Je suis éberlué ! En dépit de la controverse que le livre suscita, il y a huit ans, avant que je n'écrive mes premières critiques, je garde un bon souvenir de la vérité sur l'affaire Harry Quebert, premier best-seller de Joël Dicker. Dans le Livre des Baltimore, paru en 2015, je m'étais efforcé de faire preuve d'humour pour démonter les artifices de « littérature-marketing » mis en place pour plaire au plus grand nombre. Cela ne m'avait pas empêché de trouver le livre plutôt agréable.
Mais dès les premières pages de L'énigme de la chambre 622, je me suis demandé si c'était moi qui avais changé ou si l'auteur, dont les qualités de conteur sont indéniables, avait renoncé à toute crédibilité littéraire au profit d'un positionnement ultra-populaire, en assumant la diffusion en librairie d'une sorte de produit hybride de chick-lit et de polar de gare.
Je ne juge personne, il vaut mieux lire des histoires niaises que ne pas lire du tout. Mais une fois rendu hommage aux vertus civilisatrices de Joël Dicker, je m'arroge le droit, après m'être cogné les six cents pages du livre, de laisser libre cours à mon ressenti personnel.
L'auteur se met en scène dans l'écriture d'un livre, dont le sujet est une enquête policière où l'entraîne une jolie femme. La narration révèle une intrigue aux multiples rebonds, superposant trois époques : celle de l'enquête et de l'écriture du livre, celle d'un meurtre non élucidé dans un hôtel de luxe de la station de ski valaisanne de Verbiers, et « quinze ans plus tôt ». Les nombreuses péripéties se tiennent, mais leur cohérence ne vaut que par le recours à des ficelles enfantines ou abracadabrantes, à la limite du réalisme.
L'intrigue inclut un scénario de romance qui s'étale en « je t'aime moi non plus » sur les six cents pages. Joël Dicker a probablement relu récemment Belle du Seigneur, car on y trouve quelques « trucs » – je n'ose parler de références ! – puisés dans l'idylle mythique d'Ariane et de Solal : l'élégance provocante de Lev, les bains moussants de la très belle Anastasia, l'ennui mortel de l'amour parfait, avec en clin d'oeil, une étape à Corfou, l'île natale du grand Albert Cohen.
Les dialogues sont d'une insignifiance à pleurer – ou à pouffer de rire – pour des personnages présentés comme des banquiers de grande envergure. Ridicule ! Et j'allais oublier, dans le même esprit, les artifices de théâtre de boulevard, avec des personnages qui sortent par la porte de droite, juste au moment où d'autres entrent par celle de gauche.
Six cents pages ! C'est insupportablement long, même si les chapitres se terminent par des mises en suspens. Des artifices éculés qui m'ont rappelé mon abonnement d'enfance à Tintin, dont les aventures hebdomadaires se terminaient régulièrement par une image illustrée de grands points d'exclamation et d'interrogation, pour m'inciter à me précipiter sur la suite, la semaine suivante. C'était presque plus subtil.
J'ai toutefois apprécié quelques pages. Elles n'ont rien à voir avec l'intrigue ; l'auteur y rend hommage à une personne décédée l'année dernière, Hubert de Fallois, un grand éditeur, auquel La vérité sur l'affaire Harry Quebert doit son succès planétaire et un jeune plumitif inconnu sa destinée de star. Je me demande si ce grand spécialiste de la littérature et de l'édition n'a pas manqué au parachèvement de L'énigme de la chambre 622. J'ai noté des irrégularités dans le traitement des soixante quatorze chapitres : la syntaxe est généralement correcte, mais certains passages donnent vraiment l'impression d'être restés au stade du premier jet, sans être retravaillés, comme s'il avait fallu se presser pour que le livre soit disponible en librairie au début de l'été. Il est vrai qu'il aurait été vain de paraître en septembre, en vue des prix littéraires. A chacun de choisir les exigences à privilégier.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Mais dès les premières pages de L'énigme de la chambre 622, je me suis demandé si c'était moi qui avais changé ou si l'auteur, dont les qualités de conteur sont indéniables, avait renoncé à toute crédibilité littéraire au profit d'un positionnement ultra-populaire, en assumant la diffusion en librairie d'une sorte de produit hybride de chick-lit et de polar de gare.
Je ne juge personne, il vaut mieux lire des histoires niaises que ne pas lire du tout. Mais une fois rendu hommage aux vertus civilisatrices de Joël Dicker, je m'arroge le droit, après m'être cogné les six cents pages du livre, de laisser libre cours à mon ressenti personnel.
L'auteur se met en scène dans l'écriture d'un livre, dont le sujet est une enquête policière où l'entraîne une jolie femme. La narration révèle une intrigue aux multiples rebonds, superposant trois époques : celle de l'enquête et de l'écriture du livre, celle d'un meurtre non élucidé dans un hôtel de luxe de la station de ski valaisanne de Verbiers, et « quinze ans plus tôt ». Les nombreuses péripéties se tiennent, mais leur cohérence ne vaut que par le recours à des ficelles enfantines ou abracadabrantes, à la limite du réalisme.
L'intrigue inclut un scénario de romance qui s'étale en « je t'aime moi non plus » sur les six cents pages. Joël Dicker a probablement relu récemment Belle du Seigneur, car on y trouve quelques « trucs » – je n'ose parler de références ! – puisés dans l'idylle mythique d'Ariane et de Solal : l'élégance provocante de Lev, les bains moussants de la très belle Anastasia, l'ennui mortel de l'amour parfait, avec en clin d'oeil, une étape à Corfou, l'île natale du grand Albert Cohen.
Les dialogues sont d'une insignifiance à pleurer – ou à pouffer de rire – pour des personnages présentés comme des banquiers de grande envergure. Ridicule ! Et j'allais oublier, dans le même esprit, les artifices de théâtre de boulevard, avec des personnages qui sortent par la porte de droite, juste au moment où d'autres entrent par celle de gauche.
Six cents pages ! C'est insupportablement long, même si les chapitres se terminent par des mises en suspens. Des artifices éculés qui m'ont rappelé mon abonnement d'enfance à Tintin, dont les aventures hebdomadaires se terminaient régulièrement par une image illustrée de grands points d'exclamation et d'interrogation, pour m'inciter à me précipiter sur la suite, la semaine suivante. C'était presque plus subtil.
J'ai toutefois apprécié quelques pages. Elles n'ont rien à voir avec l'intrigue ; l'auteur y rend hommage à une personne décédée l'année dernière, Hubert de Fallois, un grand éditeur, auquel La vérité sur l'affaire Harry Quebert doit son succès planétaire et un jeune plumitif inconnu sa destinée de star. Je me demande si ce grand spécialiste de la littérature et de l'édition n'a pas manqué au parachèvement de L'énigme de la chambre 622. J'ai noté des irrégularités dans le traitement des soixante quatorze chapitres : la syntaxe est généralement correcte, mais certains passages donnent vraiment l'impression d'être restés au stade du premier jet, sans être retravaillés, comme s'il avait fallu se presser pour que le livre soit disponible en librairie au début de l'été. Il est vrai qu'il aurait été vain de paraître en septembre, en vue des prix littéraires. A chacun de choisir les exigences à privilégier.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
critiques presse (2)
L’écrivain suisse plante le décor de son nouveau roman dans son pays d’origine. Pour le reste, les ingrédients (un meurtre, une enquête, des suspects à tous les étages) n’ont pas bougé.
Lire la critique sur le site : LeSoir
Une fois ouvert le pavé de presque 600 pages, on plonge dedans comme dans une série. Les chapitres défilent aussi prestement que des épisodes d’un soap opera, rythmés par des dialogues nerveux, des scènes visuelles et nébuleuses. Liaisons secrètes, rendez-vous ratés, coups de théâtre, jeux de dupes et vies parallèles… Les mensonges éclatent comme du pop-corn.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Citations et extraits (295)
Voir plus
Ajouter une citation
Cher Joël,
Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Le 19 septembre 2012, Harry Quebert faisait son entrée dans toutes les librairies de France, de Belgique et de Suisse.
Je ne suis pas fou des anniversaires, mais celui-ci est amusant, parce qu'il montre bien à quel point dans la vie tout se tient, se relie, et prend une signification plus importante.
Ce jour-là, 19 septembre, je me souviens avoir été jusqu'à la librairie Fontaine, pour voir si le livre était en vitrine. Il y était. Certes, il ne devait pas être partout en vitrine, car nous avions bousculé toutes les règles et toutes les habitudes pour préparer cette mise en vente, mais dans cette librairie, ce sont des amis, prévenus par nous, il s’y trouvait.
En le regardant avec plaisir, il m’est revenu à l'esprit ce beau passage de Proust lorsqu'il raconte la mort de Bergotte :
« On l’enterra. Mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées, et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de la resurrection. »
Quelle leçon tirer de tout cela ? Que vous n'avez publié encore que deux livres et que pour pouvoir un jour les regarder, disposés trois par trois, aux vitrines d'un libraire, il faut que vous en écriviez encore beaucoup plus.
J espère que nous les regarderons ensemble et que nous nous souviendrons du très juste avertissement de Proust.
Mon cher Joël, je suis sûr que vous pensez comme moi qu'il ne faut jamais se rassurer trop vite ni s'endormir sur d'éphémères succès, mais tout de même, en pensant à I’année qui vient de s’écouler, il me semble que tout cela n’est pas mal.
Bernard
Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Le 19 septembre 2012, Harry Quebert faisait son entrée dans toutes les librairies de France, de Belgique et de Suisse.
Je ne suis pas fou des anniversaires, mais celui-ci est amusant, parce qu'il montre bien à quel point dans la vie tout se tient, se relie, et prend une signification plus importante.
Ce jour-là, 19 septembre, je me souviens avoir été jusqu'à la librairie Fontaine, pour voir si le livre était en vitrine. Il y était. Certes, il ne devait pas être partout en vitrine, car nous avions bousculé toutes les règles et toutes les habitudes pour préparer cette mise en vente, mais dans cette librairie, ce sont des amis, prévenus par nous, il s’y trouvait.
En le regardant avec plaisir, il m’est revenu à l'esprit ce beau passage de Proust lorsqu'il raconte la mort de Bergotte :
« On l’enterra. Mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées, et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de la resurrection. »
Quelle leçon tirer de tout cela ? Que vous n'avez publié encore que deux livres et que pour pouvoir un jour les regarder, disposés trois par trois, aux vitrines d'un libraire, il faut que vous en écriviez encore beaucoup plus.
J espère que nous les regarderons ensemble et que nous nous souviendrons du très juste avertissement de Proust.
Mon cher Joël, je suis sûr que vous pensez comme moi qu'il ne faut jamais se rassurer trop vite ni s'endormir sur d'éphémères succès, mais tout de même, en pensant à I’année qui vient de s’écouler, il me semble que tout cela n’est pas mal.
Bernard
Paris, au mois de mai. Huit mois après l’immense succès de mon second roman.
Un journaliste était venu interviewer Bernard au siège des Éditions de Fallois, 22 rue La Boétie. Bernard n'aimait pas tellement les interviews, mais il acceptait parfois de se prêter au jeu quand je le lui demandais. J'étais présent dans la pièce également.
Après quelques questions d'une affligeante banalité, le Journaliste prit un air narquois et demanda à Bernard, sous-entendant que j'allais évidemment céder aux sirènes des grands noms de Saint-Germain-des-Prés :
— Pensez-vous que vous éditerez le prochain roman de Joël ?
Je devins pourpre de rage et dus me retenir de ne pas chasser le journaliste à coups de pied dans le derrière. Bernard, lui, sourit d'un regard malicieux et répondit:
— Si le prochain roman de Joël n'est pas bon, je ne le publierai pas.
Je n'oublierai jamais cette phrase, qui résume à elle seule la relation que j'ai entretenue avec Bernard pendant toutes ces années.
Bernard me faisait un contrat par livre, sans que cela me lie à lui pour le suivant.
Un livre à la fois, m'expliquait-il. Si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, je ne veux pas vous y forcer.
Ce à quoi je lui répondais :
— Et moi, je ne vous demande aucune avance. Vous me paierez pour ce que je vends. Si le livre a du succès, tant mieux pour nous tous, s'il n'a pas de succès, nous nous serons au moins bien amusés.
— Le succès, c'est le plaisir de travailler ensemble ! me rappelait alors Bernard, d'un ton enthousiaste.
Nos contrats étaient d'ailleurs signés à la dernière minute, souvent alors que le nouveau roman était déjà à l'impression, tant ceci n'était pas notre préoccupation.
Un journaliste était venu interviewer Bernard au siège des Éditions de Fallois, 22 rue La Boétie. Bernard n'aimait pas tellement les interviews, mais il acceptait parfois de se prêter au jeu quand je le lui demandais. J'étais présent dans la pièce également.
Après quelques questions d'une affligeante banalité, le Journaliste prit un air narquois et demanda à Bernard, sous-entendant que j'allais évidemment céder aux sirènes des grands noms de Saint-Germain-des-Prés :
— Pensez-vous que vous éditerez le prochain roman de Joël ?
Je devins pourpre de rage et dus me retenir de ne pas chasser le journaliste à coups de pied dans le derrière. Bernard, lui, sourit d'un regard malicieux et répondit:
— Si le prochain roman de Joël n'est pas bon, je ne le publierai pas.
Je n'oublierai jamais cette phrase, qui résume à elle seule la relation que j'ai entretenue avec Bernard pendant toutes ces années.
Bernard me faisait un contrat par livre, sans que cela me lie à lui pour le suivant.
Un livre à la fois, m'expliquait-il. Si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, je ne veux pas vous y forcer.
Ce à quoi je lui répondais :
— Et moi, je ne vous demande aucune avance. Vous me paierez pour ce que je vends. Si le livre a du succès, tant mieux pour nous tous, s'il n'a pas de succès, nous nous serons au moins bien amusés.
— Le succès, c'est le plaisir de travailler ensemble ! me rappelait alors Bernard, d'un ton enthousiaste.
Nos contrats étaient d'ailleurs signés à la dernière minute, souvent alors que le nouveau roman était déjà à l'impression, tant ceci n'était pas notre préoccupation.
INCIPIT
Le jour du meurtre
(Dimanche 16 décembre)
Il était 6 heures 30 du matin. Le Palace de Verbier était plongé dans l’obscurité. Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment.
Au sixième étage, les portes de l’ascenseur de service s’ouvrirent. Un employé de l’hôtel apparut avec un plateau de petit-déjeuner et se dirigea vers la chambre 622.
En y arrivant, il se rendit compte que la porte était entrouverte. De la lumière filtrait par l’interstice. Il s’annonça, mais n’obtint aucune réponse. Il prit finalement la liberté d’entrer, supposant que la porte avait été ouverte à son intention. Ce qu’il découvrit lui arracha un hurlement. Il s’enfuit pour aller alerter ses collègues et appeler les secours.
À mesure que la nouvelle se propagea à travers le Palace, les lumières s’allumèrent à tous les étages.
Un cadavre gisait sur la moquette de la chambre 622.
Chapitre 1.
Coup de foudre
Au début de l’été 2018, lorsque je me rendis au Palace de Verbier, un hôtel prestigieux des Alpes suisses, j’étais loin d’imaginer que j’allais consacrer mes vacances à élucider un crime commis dans l’établissement bien des années auparavant.
Ce séjour était censé m’offrir une pause bienvenue après deux petits cataclysmes personnels survenus dans ma vie. Mais avant de vous raconter ce qui se passa cet été-là, il me faut d’abord revenir sur ce qui fut à l’origine de toute cette histoire: la mort de mon éditeur, Bernard de Fallois.
Bernard de Fallois était l’homme à qui je devais tout.
Mon succès et ma notoriété, c’était grâce à lui.
On m’appelait l’écrivain, grâce à lui.
On me lisait, grâce à lui.
Lorsque je l’avais rencontré, j’étais un auteur même pas publié: il avait fait de moi un écrivain lu dans le monde entier. Bernard, sous ses airs d’élégant patriarche, avait été l’une des personnalités majeures de l’édition française. Pour moi, il avait été un maître et surtout, malgré les soixante ans qui nous séparaient, un grand ami.
Bernard était décédé au mois de janvier 2018, dans sa quatre-vingt-douzième année, et j’avais réagi à sa mort comme l’aurait fait n’importe quel écrivain : en me mettant à écrire un livre sur lui. Je m’y étais lancé corps et âme, enfermé dans le bureau de mon appartement du 13 avenue Alfred-Bertrand, dans le quartier de Champel, à Genève.
Comme toujours en période d’écriture, la seule présence humaine que je tolérais était celle de Denise, mon assistante. Denise était la bonne fée qui veillait sur moi. Éternellement de bonne humeur, elle organisait mon agenda, triait et classait le courrier des lecteurs, relisait et corrigeait ce que j’avais écrit. Accessoirement, elle remplissait mon frigidaire et m’approvisionnait en café. Enfin, elle s’attribuait des fonctions de médecin de bord, débarquant dans mon bureau, comme si elle montait sur un navire après une interminable traversée, et me prodiguait des conseils de santé.
— Sortez d’ici ! ordonnait-elle gentiment. Allez faire un tour dans le parc pour vous aérer l’esprit. Ça fait des heures que vous êtes enfermé !
— Je suis déjà allé courir tôt ce matin, lui rappelais-je.
— Vous devez vous oxygéner le cerveau à intervalles réguliers ! insistait-elle.
C’était presque un rituel quotidien : j’obtempérais et je sortais sur le balcon du bureau. Je m’emplissais les poumons de quelques bouffées de l’air frais de février, puis, la défiant d’un regard amusé, j’allumais une cigarette. Elle protestait et me disait, d’un ton consterné :
— Vous savez, Joël, je ne viderai pas votre cendrier. Comme ça, vous vous rendrez compte de ce que vous fumez.
Tous les jours, je m’astreignais à la routine monacale qui était la mienne en phase d’écriture et qui se décomposait en trois étapes indispensables : me lever à l’aube, faire un jogging et écrire jusqu’au soir. C’est donc indirectement grâce à ce livre que je fis la connaissance de Sloane. Sloane était ma nouvelle voisine de palier. Depuis son récent emménagement, tous les habitants de l’immeuble parlaient d’elle. Pour ma part je n’avais jamais eu l’occasion de la rencontrer. Jusqu’à ce matin où, de retour de ma séance de sport quotidienne, je la croisai pour la première fois. Elle revenait elle aussi d’un jogging et nous pénétrâmes ensemble dans l’immeuble. Je compris aussitôt pourquoi Sloane faisait l’unanimité parmi les voisins : c’était une jeune femme au charme désarmant. Nous nous contentâmes d’un salut poli avant de disparaître chacun dans notre appartement. Derrière ma porte, je restai béat. Cette brève rencontre avait suffi à me faire tomber un peu amoureux.
Je n’eus bientôt plus qu’une idée en tête : faire la connaissance de Sloane.
Je tentai une première approche par l’entremise de la course à pied. Sloane courait presque tous les jours, mais sans horaires réguliers. Je passais des heures à errer dans le parc Bertrand, désespérant de la croiser. Puis soudain, je la voyais qui filait le long d’une allée. En général, j’étais bien incapable de la rattraper et j’allais l’attendre à l’entrée de notre immeuble. Je trépignais devant les boîtes aux lettres, faisant semblant de relever le courrier chaque fois que des voisins allaient et venaient, jusqu’à ce qu’elle arrive enfin. Elle passait devant moi, me souriait, ce qui me faisait fondre et me décontenançait : le temps de trouver quelque chose d’intelligent à lui dire, elle était déjà rentrée chez elle.
C’est la concierge de l’immeuble, madame Armanda, qui me renseigna sur Sloane : elle était pédiatre, anglaise par sa mère, père avocat, elle avait été mariée deux ans mais ça n’avait pas marché. Elle travaillait aux Hôpitaux Universitaires de Genève et alternait des horaires de jour ou de nuit, ce qui expliquait ma difficulté à comprendre sa routine.
Après l’échec de la course à pied, je décidai de changer de méthode : je confiai à Denise la mission de surveiller le couloir à travers le judas et de m’avertir lorsqu’elle la voyait apparaître. Aux cris de Denise (« Elle sort de chez elle ! ») je déboulais de mon bureau, pomponné et parfumé, et j’apparaissais à mon tour sur le palier, comme s’il s’agissait d’une coïncidence. Mais nos échanges étaient limités à une salutation. En général, elle descendait à pied, ce qui coupait court à toute conversation. Je lui emboîtais le pas, mais à quoi bon ? Arrivée dans la rue, elle disparaissait. Les rares fois où elle prenait l’ascenseur, je restais muet et un silence gêné s’installait dans la cabine. Dans les deux cas, je remontais ensuite chez moi, bredouille.
— Alors ? demandait Denise.
— Alors rien, maugréais-je.
— Oh, mais vous êtes nul, Joël ! Enfin, faites un petit effort !
— C’est que je suis un peu timide, expliquais-je.
— Oh, arrêtez vos histoires, voulez-vous ! Vous n’avez pas l’air timide du tout sur les plateaux de télévision !
— Parce que c’est l’Écrivain que vous voyez à la télévision. Joël, lui, est très différent.
— Allons, Joël, ce n’est vraiment pas compliqué : vous sonnez à sa porte, vous lui offrez des fleurs et vous l’invitez à dîner. Vous avez la flemme d’aller chez le fleuriste, c’est ça ? Vous voulez que je m’en charge ?
Puis il y eut ce soir d’avril, à l’opéra de Genève, où je me rendis seul à une représentation du Lac des Cygnes. Voilà que pendant l’entracte, sortant fumer une cigarette, je tombai sur elle. Nous échangeâmes quelques mots puis, comme on sonnait déjà le rappel des spectateurs, elle me proposa d’aller boire un verre après le ballet. Nous nous retrouvâmes au Remor, un café à quelques pas de là. C’est ainsi que Sloane entra dans ma vie.
Sloane était belle, drôle et intelligente. Certainement l’une des personnes les plus fascinantes que j’aie rencontrées. Après notre soirée au Remor, je l’invitai à sortir plusieurs fois. Nous allâmes au concert, au cinéma. Je la traînais au vernissage d’une improbable exposition d’art contemporain qui nous valut un sérieux fou rire et d’où nous nous enfuîmes pour aller dîner dans un restaurant vietnamien qu’elle adorait. Nous passâmes plusieurs soirées chez elle ou chez moi, à écouter de l’opéra, à discuter et refaire le monde. Je ne pouvais m’empêcher de la dévorer du regard : j’étais en adoration devant elle. Sa façon de cligner les yeux, de replacer ses mèches de cheveux, de sourire doucement lorsqu’elle était gênée, de jouer avec ses doigts vernis avant de me poser une question. Tout chez elle me plaisait.
Je ne pensai bientôt plus qu’à elle. Au point de délaisser momentanément l’écriture de mon livre.
— Vous avez l’air complètement ailleurs, mon pauvre Joël, me disait Denise en constatant que je n’écrivais plus une ligne.
— C’est à cause de Sloane, expliquais-je derrière mon ordinateur éteint.
Je n’attendais que le moment de la retrouver et de poursuivre nos interminables conversations. Je ne me lassais pas de l’écouter me raconter sa vie, ses passions, ses envies et ses ambitions. Elle aimait les films d’Elia Kazan et l’opéra.
Une nuit, après un dîner arrosé dans une brasserie du quartier des Pâquis, nous atterrîmes dans mon salon. Sloane contempla, amusée, les bibelots et les livres dans les bibliothèques murales. Elle s’arrêta longuement sur un tableau de Saint-Pétersbourg que je tenais de mon grand-oncle. Puis, elle s’attarda sur les alcools forts de mon bar. Elle aima l’esturgeon en relief qui ornait la bouteille de vodka Beluga, je nous en servis deux verres sur glaçons. J’allumai la radio sur le programme de musique classique que j’écoutais souvent le soir. Elle me mit au défi d’identifier le compositeur qui était en train d’être diffusé. Facile, c’était du Wagner. C’est donc sur La Walkyrie qu’elle m’embrassa et m’attira contre elle, en me murmurant à l’oreille qu’elle avait envie de moi.
Notre liaison allait durer deux mois. Deux mois merveilleux. Mais au fil desquels, peu à peu, mon livre sur Bernard reprit le dessus. D’abord je profitai des nuits où Sloane était de garde à l’hôpital pour avancer. Mais plus j’avançais, plus j’étais emporté par mon roman. Un soir, elle me proposa de sortir : pour
Le jour du meurtre
(Dimanche 16 décembre)
Il était 6 heures 30 du matin. Le Palace de Verbier était plongé dans l’obscurité. Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment.
Au sixième étage, les portes de l’ascenseur de service s’ouvrirent. Un employé de l’hôtel apparut avec un plateau de petit-déjeuner et se dirigea vers la chambre 622.
En y arrivant, il se rendit compte que la porte était entrouverte. De la lumière filtrait par l’interstice. Il s’annonça, mais n’obtint aucune réponse. Il prit finalement la liberté d’entrer, supposant que la porte avait été ouverte à son intention. Ce qu’il découvrit lui arracha un hurlement. Il s’enfuit pour aller alerter ses collègues et appeler les secours.
À mesure que la nouvelle se propagea à travers le Palace, les lumières s’allumèrent à tous les étages.
Un cadavre gisait sur la moquette de la chambre 622.
Chapitre 1.
Coup de foudre
Au début de l’été 2018, lorsque je me rendis au Palace de Verbier, un hôtel prestigieux des Alpes suisses, j’étais loin d’imaginer que j’allais consacrer mes vacances à élucider un crime commis dans l’établissement bien des années auparavant.
Ce séjour était censé m’offrir une pause bienvenue après deux petits cataclysmes personnels survenus dans ma vie. Mais avant de vous raconter ce qui se passa cet été-là, il me faut d’abord revenir sur ce qui fut à l’origine de toute cette histoire: la mort de mon éditeur, Bernard de Fallois.
Bernard de Fallois était l’homme à qui je devais tout.
Mon succès et ma notoriété, c’était grâce à lui.
On m’appelait l’écrivain, grâce à lui.
On me lisait, grâce à lui.
Lorsque je l’avais rencontré, j’étais un auteur même pas publié: il avait fait de moi un écrivain lu dans le monde entier. Bernard, sous ses airs d’élégant patriarche, avait été l’une des personnalités majeures de l’édition française. Pour moi, il avait été un maître et surtout, malgré les soixante ans qui nous séparaient, un grand ami.
Bernard était décédé au mois de janvier 2018, dans sa quatre-vingt-douzième année, et j’avais réagi à sa mort comme l’aurait fait n’importe quel écrivain : en me mettant à écrire un livre sur lui. Je m’y étais lancé corps et âme, enfermé dans le bureau de mon appartement du 13 avenue Alfred-Bertrand, dans le quartier de Champel, à Genève.
Comme toujours en période d’écriture, la seule présence humaine que je tolérais était celle de Denise, mon assistante. Denise était la bonne fée qui veillait sur moi. Éternellement de bonne humeur, elle organisait mon agenda, triait et classait le courrier des lecteurs, relisait et corrigeait ce que j’avais écrit. Accessoirement, elle remplissait mon frigidaire et m’approvisionnait en café. Enfin, elle s’attribuait des fonctions de médecin de bord, débarquant dans mon bureau, comme si elle montait sur un navire après une interminable traversée, et me prodiguait des conseils de santé.
— Sortez d’ici ! ordonnait-elle gentiment. Allez faire un tour dans le parc pour vous aérer l’esprit. Ça fait des heures que vous êtes enfermé !
— Je suis déjà allé courir tôt ce matin, lui rappelais-je.
— Vous devez vous oxygéner le cerveau à intervalles réguliers ! insistait-elle.
C’était presque un rituel quotidien : j’obtempérais et je sortais sur le balcon du bureau. Je m’emplissais les poumons de quelques bouffées de l’air frais de février, puis, la défiant d’un regard amusé, j’allumais une cigarette. Elle protestait et me disait, d’un ton consterné :
— Vous savez, Joël, je ne viderai pas votre cendrier. Comme ça, vous vous rendrez compte de ce que vous fumez.
Tous les jours, je m’astreignais à la routine monacale qui était la mienne en phase d’écriture et qui se décomposait en trois étapes indispensables : me lever à l’aube, faire un jogging et écrire jusqu’au soir. C’est donc indirectement grâce à ce livre que je fis la connaissance de Sloane. Sloane était ma nouvelle voisine de palier. Depuis son récent emménagement, tous les habitants de l’immeuble parlaient d’elle. Pour ma part je n’avais jamais eu l’occasion de la rencontrer. Jusqu’à ce matin où, de retour de ma séance de sport quotidienne, je la croisai pour la première fois. Elle revenait elle aussi d’un jogging et nous pénétrâmes ensemble dans l’immeuble. Je compris aussitôt pourquoi Sloane faisait l’unanimité parmi les voisins : c’était une jeune femme au charme désarmant. Nous nous contentâmes d’un salut poli avant de disparaître chacun dans notre appartement. Derrière ma porte, je restai béat. Cette brève rencontre avait suffi à me faire tomber un peu amoureux.
Je n’eus bientôt plus qu’une idée en tête : faire la connaissance de Sloane.
Je tentai une première approche par l’entremise de la course à pied. Sloane courait presque tous les jours, mais sans horaires réguliers. Je passais des heures à errer dans le parc Bertrand, désespérant de la croiser. Puis soudain, je la voyais qui filait le long d’une allée. En général, j’étais bien incapable de la rattraper et j’allais l’attendre à l’entrée de notre immeuble. Je trépignais devant les boîtes aux lettres, faisant semblant de relever le courrier chaque fois que des voisins allaient et venaient, jusqu’à ce qu’elle arrive enfin. Elle passait devant moi, me souriait, ce qui me faisait fondre et me décontenançait : le temps de trouver quelque chose d’intelligent à lui dire, elle était déjà rentrée chez elle.
C’est la concierge de l’immeuble, madame Armanda, qui me renseigna sur Sloane : elle était pédiatre, anglaise par sa mère, père avocat, elle avait été mariée deux ans mais ça n’avait pas marché. Elle travaillait aux Hôpitaux Universitaires de Genève et alternait des horaires de jour ou de nuit, ce qui expliquait ma difficulté à comprendre sa routine.
Après l’échec de la course à pied, je décidai de changer de méthode : je confiai à Denise la mission de surveiller le couloir à travers le judas et de m’avertir lorsqu’elle la voyait apparaître. Aux cris de Denise (« Elle sort de chez elle ! ») je déboulais de mon bureau, pomponné et parfumé, et j’apparaissais à mon tour sur le palier, comme s’il s’agissait d’une coïncidence. Mais nos échanges étaient limités à une salutation. En général, elle descendait à pied, ce qui coupait court à toute conversation. Je lui emboîtais le pas, mais à quoi bon ? Arrivée dans la rue, elle disparaissait. Les rares fois où elle prenait l’ascenseur, je restais muet et un silence gêné s’installait dans la cabine. Dans les deux cas, je remontais ensuite chez moi, bredouille.
— Alors ? demandait Denise.
— Alors rien, maugréais-je.
— Oh, mais vous êtes nul, Joël ! Enfin, faites un petit effort !
— C’est que je suis un peu timide, expliquais-je.
— Oh, arrêtez vos histoires, voulez-vous ! Vous n’avez pas l’air timide du tout sur les plateaux de télévision !
— Parce que c’est l’Écrivain que vous voyez à la télévision. Joël, lui, est très différent.
— Allons, Joël, ce n’est vraiment pas compliqué : vous sonnez à sa porte, vous lui offrez des fleurs et vous l’invitez à dîner. Vous avez la flemme d’aller chez le fleuriste, c’est ça ? Vous voulez que je m’en charge ?
Puis il y eut ce soir d’avril, à l’opéra de Genève, où je me rendis seul à une représentation du Lac des Cygnes. Voilà que pendant l’entracte, sortant fumer une cigarette, je tombai sur elle. Nous échangeâmes quelques mots puis, comme on sonnait déjà le rappel des spectateurs, elle me proposa d’aller boire un verre après le ballet. Nous nous retrouvâmes au Remor, un café à quelques pas de là. C’est ainsi que Sloane entra dans ma vie.
Sloane était belle, drôle et intelligente. Certainement l’une des personnes les plus fascinantes que j’aie rencontrées. Après notre soirée au Remor, je l’invitai à sortir plusieurs fois. Nous allâmes au concert, au cinéma. Je la traînais au vernissage d’une improbable exposition d’art contemporain qui nous valut un sérieux fou rire et d’où nous nous enfuîmes pour aller dîner dans un restaurant vietnamien qu’elle adorait. Nous passâmes plusieurs soirées chez elle ou chez moi, à écouter de l’opéra, à discuter et refaire le monde. Je ne pouvais m’empêcher de la dévorer du regard : j’étais en adoration devant elle. Sa façon de cligner les yeux, de replacer ses mèches de cheveux, de sourire doucement lorsqu’elle était gênée, de jouer avec ses doigts vernis avant de me poser une question. Tout chez elle me plaisait.
Je ne pensai bientôt plus qu’à elle. Au point de délaisser momentanément l’écriture de mon livre.
— Vous avez l’air complètement ailleurs, mon pauvre Joël, me disait Denise en constatant que je n’écrivais plus une ligne.
— C’est à cause de Sloane, expliquais-je derrière mon ordinateur éteint.
Je n’attendais que le moment de la retrouver et de poursuivre nos interminables conversations. Je ne me lassais pas de l’écouter me raconter sa vie, ses passions, ses envies et ses ambitions. Elle aimait les films d’Elia Kazan et l’opéra.
Une nuit, après un dîner arrosé dans une brasserie du quartier des Pâquis, nous atterrîmes dans mon salon. Sloane contempla, amusée, les bibelots et les livres dans les bibliothèques murales. Elle s’arrêta longuement sur un tableau de Saint-Pétersbourg que je tenais de mon grand-oncle. Puis, elle s’attarda sur les alcools forts de mon bar. Elle aima l’esturgeon en relief qui ornait la bouteille de vodka Beluga, je nous en servis deux verres sur glaçons. J’allumai la radio sur le programme de musique classique que j’écoutais souvent le soir. Elle me mit au défi d’identifier le compositeur qui était en train d’être diffusé. Facile, c’était du Wagner. C’est donc sur La Walkyrie qu’elle m’embrassa et m’attira contre elle, en me murmurant à l’oreille qu’elle avait envie de moi.
Notre liaison allait durer deux mois. Deux mois merveilleux. Mais au fil desquels, peu à peu, mon livre sur Bernard reprit le dessus. D’abord je profitai des nuits où Sloane était de garde à l’hôpital pour avancer. Mais plus j’avançais, plus j’étais emporté par mon roman. Un soir, elle me proposa de sortir : pour
Bernard était un grand éditeur, dis-je. Mais il était aussi beaucoup plus que ça. Il était un grand homme, doté de toutes les supériorités, qui avait eu, au cours de sa carrière dans l’édition, plusieurs vies. À la fois homme de lettres et grand érudit, il était également un redoutable homme d’affaires, doté d’un charisme et d’un talent de conviction hors du commun : il eût été avocat, tout le barreau parisien était au chômage. Il y avait eu une époque pendant laquelle Bernard avait été le patron, craint et respecté, des plus importants groupes d’édition français, tout en étant proche de grands philosophes et d’intellectuels du moment, ainsi que d’hommes politiques au pouvoir. Dans la dernière partie de sa vie, après avoir régné sur Paris, Bernard s’était mis en retrait sans perdre une once de son aura : il avait créé une petite maison d’édition, à son image : modeste, discrète, prestigieuse. C’était le Bernard que j’avais connu, moi, lorsqu’il m’avait pris sous son aile. Génial, curieux, joyeux et solaire : il était le maître dont j’avais toujours rêvé. Sa conversation était scintillante, spirituelle, allègre et profonde. Son rire était une leçon permanente de sagesse. Il connaissait tous les ressorts de la comédie humaine. Il était une inspiration pour la vie, une étoile dans la Nuit. p. 26-27
— Je ne suis pas certain de vous suivre, docteur.
— Eh bien, si vous étiez élu sans devoir batailler, vous finiriez peut-être par vous dire que vous n’avez pas de mérite. Or désormais il vous faut convaincre Tarnogol. Et je sais que vous allez le convaincre. Je sais que vous en êtes capable. Vous allez vous prouver à vous-même ce que vous avez dans le ventre, et vous serez élu président de la Banque Ebezner. Et après cette élection, vous serez un nouvel homme, enfin émancipé de votre père, car votre place de président vous ne la devrez qu’à vous-même. Vous avez, au fil de nos séances, mis au jour votre véritable identité : celle d’un battant, celle d’un gagnant. Il est temps de la montrer à tout le monde, à commencer par Tarnogol.
— Vous avez absolument raison, docteur ! s’écria Macaire, soudain galvanisé. Mais vous ne m’avez pas dit comment convaincre Tarnogol. En tant que psychanalyste, vous êtes certainement un as de la manipulation mentale, non ?
— En principe, je ne suis pas censé donner d’idées, vous devez les trouver vous-même, rappela le docteur Kazan. C’est tout le principe de la psychanalyse.
— Oh docteur, supplia Macaire, un petit coup de main, s’il vous plaît… Je sens que vous avez une idée.
Le bon docteur Kazan, face à la détresse de son patient, lui suggéra alors : — Arrangez-vous pour que Tarnogol vous doive une énorme faveur. Il sera alors obligé de vous porter à la présidence de la banque. Il est l’heure de clore cette séance. À jeudi
— Eh bien, si vous étiez élu sans devoir batailler, vous finiriez peut-être par vous dire que vous n’avez pas de mérite. Or désormais il vous faut convaincre Tarnogol. Et je sais que vous allez le convaincre. Je sais que vous en êtes capable. Vous allez vous prouver à vous-même ce que vous avez dans le ventre, et vous serez élu président de la Banque Ebezner. Et après cette élection, vous serez un nouvel homme, enfin émancipé de votre père, car votre place de président vous ne la devrez qu’à vous-même. Vous avez, au fil de nos séances, mis au jour votre véritable identité : celle d’un battant, celle d’un gagnant. Il est temps de la montrer à tout le monde, à commencer par Tarnogol.
— Vous avez absolument raison, docteur ! s’écria Macaire, soudain galvanisé. Mais vous ne m’avez pas dit comment convaincre Tarnogol. En tant que psychanalyste, vous êtes certainement un as de la manipulation mentale, non ?
— En principe, je ne suis pas censé donner d’idées, vous devez les trouver vous-même, rappela le docteur Kazan. C’est tout le principe de la psychanalyse.
— Oh docteur, supplia Macaire, un petit coup de main, s’il vous plaît… Je sens que vous avez une idée.
Le bon docteur Kazan, face à la détresse de son patient, lui suggéra alors : — Arrangez-vous pour que Tarnogol vous doive une énorme faveur. Il sera alors obligé de vous porter à la présidence de la banque. Il est l’heure de clore cette séance. À jeudi
Videos de Joël Dicker (101)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Polar et thriller
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Joël Dicker (14)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Savez-vous la vérité sur l'affaire Harry Quebert ?
Que sont Harry et Marcus ?
père et fils
frères
amis
collègues de travail
24 questions
2484 lecteurs ont répondu
Thème : La Vérité sur l'affaire Harry Quebert de
Joël DickerCréer un quiz sur ce livre2484 lecteurs ont répondu