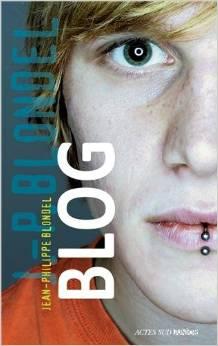Antonin Sabot/5
44 notes
Résumé :
Un soir, Martin voit son père mort venir s’attabler avec lui. Ce père qui lui a appris à entendre les arbres et à humer le vent, à suivre les pistes des bêtes dans la forêt, à connaître les paysans des alentours…
Les mystères que cette apparition révèle, le jeune homme va les affronter. Qu’y a-t-il au-delà de sa ferme isolée en pleine montagne ? Une mère, d’autres lieux, d’autres gens, une autre manière de vivre… Martin va apprendre à les connaître et partir ... >Voir plus
Les mystères que cette apparition révèle, le jeune homme va les affronter. Qu’y a-t-il au-delà de sa ferme isolée en pleine montagne ? Une mère, d’autres lieux, d’autres gens, une autre manière de vivre… Martin va apprendre à les connaître et partir ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Nous sommes les chardonsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (12)
Voir plus
Ajouter une critique
Mon père, ma montagne, mon jardin
Avec Nous sommes les chardonsAntonin Sabot a remporté le Prix Jean Anglade 2020. Ayant eu la chance de faire partie du jury, je vous entraîne dans les coulisses des délibérations avant de vous présenter ce beau roman initiatique.
Cette chronique sera un peu particulière, car j'ai eu la chance de faire partie du jury du Prix Jean Anglade. Je peux par conséquent vous expliquer comment nous avons choisi le roman d'Antonin Sabot comme lauréat 2020 et vous dévoiler les coulisses de la sélection. Une belle expérience qui a aussi été l'occasion de quelques belles rencontres même si – confinement oblige – elles ont été virtuelles.
Mais commençons par le commencement. Initié par le Cercle Jean Anglade et les Presses de la Cité, ce Prix est décerné chaque année à un premier roman qui met en avant les valeurs que le romancier auvergnat a défendu tout au long de sa longue vie (Jean Anglade est décédé le 22 Novembre 2017 à 102 ans). À l'issue d'un concours d'écriture, les Presses de la Cité ont procédé à la sélection des cinq meilleurs manuscrits et les ont soumis sous leur forme brute au jury d'une quinzaine de membres présidé cette année par Agnès Ledig. Parmi les autres membres, on trouvait notamment Jean-Paul Pourade, Président fondateur du Cercle Jean Anglade, Hélène Anglade, la fille de Jean Anglade, Véronique Pierron, Lauréate 2019 avec Les miracles de l'Ourcq, des critiques littéraires et professionnels du livre ainsi que des blogueurs, dont votre serviteur. Sans oublier Clarisse Enaudeau, Directrice littéraire Presses de la Cité.
Notre mission consistait à lire les manuscrits et à les évaluer, chacun avec sa sensibilité, puis de les classer chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. En mars dernier la pandémie a empêché le jury de se réunir sur les terres de Jean Anglade, mais nous avons pu échanger nos points de vue par vidéoconférence et très vite constaté que deux titres se détachaient. Au terme de débats aussi intéressants qu'animés, Antonin Sabot a été choisi, notamment pour sa plume «efficace et généreuse» pour reprendre les termes d'Agnès Ledig.
C'est alors que Clarisse Enaudeau a pris le relais pour retravailler le manuscrit, le débarrasser de ses coquilles, choisir la couverture et préparer le lancement de l'ouvrage en librairie. C'est en fait maintenant que commence l'aventure de Nous sommes les chardons!
Il est donc temps de vous présenter ce roman à la thématique à la fois universelle et très actuelle. Martin vit dans la montagne avec son père dans un quasi dénuement. Mais la nature environnante et leur «mur de livres» suffisent à satisfaire leurs modestes besoins. Sauf qu'un soir le père ne revient pas. La nouvelle vie de Martin est alors rythmée par ses jours sans le père.
«On dirait que le père s'est volatilisé, et je sais que je ne le rattraperai pas, il connaît la forêt comme sa poche et, s'il a décidé de rester seul, il peut se débrouiller pour ne pas être retrouvé.» À l'incrédibilité du premier jour succède le choc avec le réel. Il faut répondre aux questions des gendarmes, puis il faut s'installer dans la nouvelle réalité: «si je veux manger ce soir et les suivants et pouvoir affronter l'hiver seul, il va falloir travailler double et ne compter que sur moi. C'est ce soir que cette pensée me frappe avec le plus d'acuité, en me rendant vraiment compte que le père n'est plus là».
Avec beaucoup d'acuité, mais aussi un joli sens de la formule, le romancier va alors s'attacher à démontrer combien le lien entre le père et le fils est fort, juste dans les gestes du quotidien. Comme quand il coupe du bois: «En reproduisant les gestes de ceux d'avant, on les respecte, on montre qu'on n'a pas tout oublié. Et puis, ce qu'il y a de bien avec le bois que l'on fend, c'est que l'on se chauffe deux fois. On se réchauffe en le brûlant, mais aussi en le coupant.» La puissance du lien est alors telle qu'avec une touche de fantastique le fils continue de parler à son père, à lui dire ses difficultés tout en essayant de conjurer sa solitude. Ses rencontres avec Marie-Louise, qui a bien connu son père et qu'il croise lors de ses balades en montagne lui mettent un peu de baume au coeur.
La surprise va venir avec les obsèques, lorsqu'il fait le connaissance d'une invitée-surprise, sa mère. Cette dernière va lui proposer de l'accompagner à Paris, proposition qu'il va accepter, non sans appréhension.
La seconde partie de ce passionnant roman s'inspire de la véritable histoire d'Olivier Pinalie, créateur du Jardin Solidaire, qui a relaté son expérience dans Chronique d'un Jardin solidaire. On y voit Martin essayer d'amener un peu de nature et de solidarité dans la grande ville. Une démarche qui va finir par susciter l'intérêt de sa demi-soeur…
Après Nature humaine de Serge Joncour, le grand vertige de Pierre Ducrozet, La Dislocation de Louise Browaeys ou encore 2030 de Philippe Djian, on retrouve ici le thème du lien de l'homme avec la nature, de plus en plus distendu et de plus en plus indispensable. Souhaitons donc plein succès à ce beau roman initiatique !
Lien : https://collectiondelivres.w..
Avec Nous sommes les chardonsAntonin Sabot a remporté le Prix Jean Anglade 2020. Ayant eu la chance de faire partie du jury, je vous entraîne dans les coulisses des délibérations avant de vous présenter ce beau roman initiatique.
Cette chronique sera un peu particulière, car j'ai eu la chance de faire partie du jury du Prix Jean Anglade. Je peux par conséquent vous expliquer comment nous avons choisi le roman d'Antonin Sabot comme lauréat 2020 et vous dévoiler les coulisses de la sélection. Une belle expérience qui a aussi été l'occasion de quelques belles rencontres même si – confinement oblige – elles ont été virtuelles.
Mais commençons par le commencement. Initié par le Cercle Jean Anglade et les Presses de la Cité, ce Prix est décerné chaque année à un premier roman qui met en avant les valeurs que le romancier auvergnat a défendu tout au long de sa longue vie (Jean Anglade est décédé le 22 Novembre 2017 à 102 ans). À l'issue d'un concours d'écriture, les Presses de la Cité ont procédé à la sélection des cinq meilleurs manuscrits et les ont soumis sous leur forme brute au jury d'une quinzaine de membres présidé cette année par Agnès Ledig. Parmi les autres membres, on trouvait notamment Jean-Paul Pourade, Président fondateur du Cercle Jean Anglade, Hélène Anglade, la fille de Jean Anglade, Véronique Pierron, Lauréate 2019 avec Les miracles de l'Ourcq, des critiques littéraires et professionnels du livre ainsi que des blogueurs, dont votre serviteur. Sans oublier Clarisse Enaudeau, Directrice littéraire Presses de la Cité.
Notre mission consistait à lire les manuscrits et à les évaluer, chacun avec sa sensibilité, puis de les classer chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. En mars dernier la pandémie a empêché le jury de se réunir sur les terres de Jean Anglade, mais nous avons pu échanger nos points de vue par vidéoconférence et très vite constaté que deux titres se détachaient. Au terme de débats aussi intéressants qu'animés, Antonin Sabot a été choisi, notamment pour sa plume «efficace et généreuse» pour reprendre les termes d'Agnès Ledig.
C'est alors que Clarisse Enaudeau a pris le relais pour retravailler le manuscrit, le débarrasser de ses coquilles, choisir la couverture et préparer le lancement de l'ouvrage en librairie. C'est en fait maintenant que commence l'aventure de Nous sommes les chardons!
Il est donc temps de vous présenter ce roman à la thématique à la fois universelle et très actuelle. Martin vit dans la montagne avec son père dans un quasi dénuement. Mais la nature environnante et leur «mur de livres» suffisent à satisfaire leurs modestes besoins. Sauf qu'un soir le père ne revient pas. La nouvelle vie de Martin est alors rythmée par ses jours sans le père.
«On dirait que le père s'est volatilisé, et je sais que je ne le rattraperai pas, il connaît la forêt comme sa poche et, s'il a décidé de rester seul, il peut se débrouiller pour ne pas être retrouvé.» À l'incrédibilité du premier jour succède le choc avec le réel. Il faut répondre aux questions des gendarmes, puis il faut s'installer dans la nouvelle réalité: «si je veux manger ce soir et les suivants et pouvoir affronter l'hiver seul, il va falloir travailler double et ne compter que sur moi. C'est ce soir que cette pensée me frappe avec le plus d'acuité, en me rendant vraiment compte que le père n'est plus là».
Avec beaucoup d'acuité, mais aussi un joli sens de la formule, le romancier va alors s'attacher à démontrer combien le lien entre le père et le fils est fort, juste dans les gestes du quotidien. Comme quand il coupe du bois: «En reproduisant les gestes de ceux d'avant, on les respecte, on montre qu'on n'a pas tout oublié. Et puis, ce qu'il y a de bien avec le bois que l'on fend, c'est que l'on se chauffe deux fois. On se réchauffe en le brûlant, mais aussi en le coupant.» La puissance du lien est alors telle qu'avec une touche de fantastique le fils continue de parler à son père, à lui dire ses difficultés tout en essayant de conjurer sa solitude. Ses rencontres avec Marie-Louise, qui a bien connu son père et qu'il croise lors de ses balades en montagne lui mettent un peu de baume au coeur.
La surprise va venir avec les obsèques, lorsqu'il fait le connaissance d'une invitée-surprise, sa mère. Cette dernière va lui proposer de l'accompagner à Paris, proposition qu'il va accepter, non sans appréhension.
La seconde partie de ce passionnant roman s'inspire de la véritable histoire d'Olivier Pinalie, créateur du Jardin Solidaire, qui a relaté son expérience dans Chronique d'un Jardin solidaire. On y voit Martin essayer d'amener un peu de nature et de solidarité dans la grande ville. Une démarche qui va finir par susciter l'intérêt de sa demi-soeur…
Après Nature humaine de Serge Joncour, le grand vertige de Pierre Ducrozet, La Dislocation de Louise Browaeys ou encore 2030 de Philippe Djian, on retrouve ici le thème du lien de l'homme avec la nature, de plus en plus distendu et de plus en plus indispensable. Souhaitons donc plein succès à ce beau roman initiatique !
Lien : https://collectiondelivres.w..
« “L'homme est fait pour écouter les oiseaux et pour leur donner des noms, disait le père, aujourd'hui, le bruit des machines est arrivé aux oreilles des gens et ils ne comprennent pas qu'ils en ont la migraine. Pourtant, c'est normal, nos oreilles sont faites pour entendre le vent dans les arbres et pas plus d'une ou deux voix à la fois. Mais les habitants des villes n'entendent plus rien, car ils sont assourdis par le bruit de la planète entière.“ C'est de ça que le père avait voulu se préserver en venant habiter la montagne, en montant plus haut que les voitures, là où nul n'ose plus se rendre aujourd'hui. Il m'avait emmené là pour que j'apprenne à écouter autre chose que tout ce bruit, m'avait-il expliqué un jour où je lui demandais pourquoi on n'allait pas vivre ailleurs. »
Martin a grandi avec son père, « une sorte de résistant face à un système qui vient nous dicter nos faits et gestes jusque dans notre mort », dans une cabane en montagne, isolée par les livres, des piles de livres jusqu'au plafond, « dans ce nid d'homme calfeutré contre le monde ». C'est lui qui lui faisait l'école, lui apprenait des savoirs sur la nature, de l'histoire, de la philosophie, de la politique. « L'histoire s'inscrit dans les paysages, mais celui que nous avions sous les yeux ne racontait pas la politique, les guerres de religion, l'esclavage, la financiarisation de l'économie. Notre paysage, et c'est sûrement pour ça que mon père l'avait choisi, disait la nature enfouie en l'homme, le marronnage, la vie d'un autre siècle, mais pas les grands mouvements de l'histoire contemporaine que mon père m'expliquait le soir, quand nous résumions les livres qu'il me demandait d'étudier. » Il a toujours vécu là-haut, là où les « lois dictées aux hommes et aux bêtes » n'arrivent pas, ni les idées qui racontent « qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour être heureux et réussir sa vie, ou acheter plein d'objets pour se sentir bien ». Il y a développé un certain rapport au monde. S'occuper des plantes et des bêtes entretient un lien particulier, privilégié avec la nature. « Cela apprend à attendre et à accepter que tout ce qu'on entreprend ne réussisse pas. » La mort violente du père vient brusquement tout bouleverser.
Ce roman ravira tout autant ceux qui en feront une lecture très… terre à terre, comme ceux qui sauront saisir les filigranes d'une critique sociale, entendre la pressante invitation à « allumer un feu » ici et maintenant, puis « commencer à reconstruire le monde ».
Interview de l'auteur à retrouver sur le blog :
Lien : https://bibliothequefahrenhe..
Martin a grandi avec son père, « une sorte de résistant face à un système qui vient nous dicter nos faits et gestes jusque dans notre mort », dans une cabane en montagne, isolée par les livres, des piles de livres jusqu'au plafond, « dans ce nid d'homme calfeutré contre le monde ». C'est lui qui lui faisait l'école, lui apprenait des savoirs sur la nature, de l'histoire, de la philosophie, de la politique. « L'histoire s'inscrit dans les paysages, mais celui que nous avions sous les yeux ne racontait pas la politique, les guerres de religion, l'esclavage, la financiarisation de l'économie. Notre paysage, et c'est sûrement pour ça que mon père l'avait choisi, disait la nature enfouie en l'homme, le marronnage, la vie d'un autre siècle, mais pas les grands mouvements de l'histoire contemporaine que mon père m'expliquait le soir, quand nous résumions les livres qu'il me demandait d'étudier. » Il a toujours vécu là-haut, là où les « lois dictées aux hommes et aux bêtes » n'arrivent pas, ni les idées qui racontent « qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour être heureux et réussir sa vie, ou acheter plein d'objets pour se sentir bien ». Il y a développé un certain rapport au monde. S'occuper des plantes et des bêtes entretient un lien particulier, privilégié avec la nature. « Cela apprend à attendre et à accepter que tout ce qu'on entreprend ne réussisse pas. » La mort violente du père vient brusquement tout bouleverser.
Ce roman ravira tout autant ceux qui en feront une lecture très… terre à terre, comme ceux qui sauront saisir les filigranes d'une critique sociale, entendre la pressante invitation à « allumer un feu » ici et maintenant, puis « commencer à reconstruire le monde ».
Interview de l'auteur à retrouver sur le blog :
Lien : https://bibliothequefahrenhe..
C'est le titre et le nom de l'auteur qui m'avaient fait acheter ce livre. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble.
Mais il disparut assez vite dans la PAL, et il fallut un coup de vent entraînant des courants d'air pour qu'il refasse son apparition parmi l'étalage devenu horizontal.
Ce qui fit envoler les graines de chardon, qui ont vite prospéré au point de faire nicher dans le jardin un couple de chardonneret.
Le titre a fonctionné et j'ai trouvé « ça beau, Antonin », le choix était judicieux, les passereaux multicolores ont rechanté pendant que je lisais ce récit dépaysant.
Des paysans, oui, il en est question dans cette histoire, mais pas que.
C'est la confrontation entre deux façons de vivre, les citadins et les ruraux, qui est la trame de cette quête de l'identité.
Un tendre roman d'initiation écrit juste avant le confinement, une méditation prémonitoire sur le besoin de retrouver ses racines par un retour à la nature, qui seul permet l'introspection et la compréhension du monde bouleversé actuel.
C'est Martin qui nous l'explique, un « je » permanent, qui alterne avec des descriptions de la nature et des interrogations sur les relations humaines.
Peu de dialogues, mais qui arrivent à chaque fois au bon moment, pour faire avancer l'histoire qui, sans eux, piétinerait sur les sentiers de la contemplation.
Le jeune homme a toujours vécu dans « sa » montagne, sans la mère, restée à la capitale, et qu'il n'a pas connue, avant la disparition du père, qui l'a élevé seul.
Le lecteur peut deviner à partir de ce canevas ce qui va se passer, mais c'est tout l'art du nouvel écrivain, c'est son premier roman, de nous distiller les éléments à son rythme, celui du paysan montagnard, en suivant la marche des saisons.
Ayant lu récemment un Bouysse et un Giono, j'y retrouve les mêmes émotions prodiguées par la plume de ce jeune conteur du temps présent.
« Antonin », c'est un prénom de personnage de roman, et même si l'auteur ne nous raconte pas sa propre vie, il y a une telle fusion entre Martin et lui qu'en lisant ses phrases écrites à la première personne on a l'impression que c'est lui qui nous parle.
Chapeau l'artiste, vous avez mis beaucoup de vous-même dans votre écriture et c'est ce qui fait sa force et son charme. On est happé par vos mots, envoûtants et apaisants, même lorsque le propos se révèle dur et redoutable, à l'image de la vie dans la montagne.
La bienveillance et l'empathie sont toujours présentes, alors que la mort, provoquée par un crime, nous entraîne à la recherche de l'assassin, et en même temps, à la recherche de la vérité non dite sur l'absence de la mère.
Le dosage entre passé et présent, entre ville et campagne, entre père et mère, entre solitude et promiscuité, est tout simplement parfait.
Aucune agressivité entre les deux modes de vie liés à leur environnement. Paris et la Haute-Loire, cela suppose pas mal d'incompréhension dans la façon de vivre de l'autre. Mais c'est rendu par petites touches faites de silences et d'observations, le père décédé qui réapparaît en temps que « revenant », et la mère disparue qui, elle, réapparaît en temps que vivante.
Le jardin solidaire de la capitale, qui disparaît lui aussi à cause de l'appétit démesuré des promoteurs, va réapparaître sous la forme d'un accueil paysan à la montagne. Solitaire et solidaire vont s'associer pour fuir la folie de la ville et impulser de la vie nouvelle dans cette montagne qui en avait bien besoin.
C'est tout le changement de notre société pour vivre avec la nature et non contre elle qui est évoqué. Une meilleure répartition des lieux et des taches, faite de partage et d'un autre « vivre ensemble », pour que les chardons ne prennent pas toute la place dans une friche inextricable.
Cultivons notre jardin, afin que l'humain ait toujours sa place parmi la nature qui pourrait très bien survivre sans nous.
L'auteur a créé une librairie autogérée dans son pays d'enfance. C'est une bien belle aventure qu'il nous « livre » ainsi.
Ce premier roman n'aura pas été un écrit vain. On ne peut que souhaiter une belle continuation à cet écrivain authentique.
Mais il disparut assez vite dans la PAL, et il fallut un coup de vent entraînant des courants d'air pour qu'il refasse son apparition parmi l'étalage devenu horizontal.
Ce qui fit envoler les graines de chardon, qui ont vite prospéré au point de faire nicher dans le jardin un couple de chardonneret.
Le titre a fonctionné et j'ai trouvé « ça beau, Antonin », le choix était judicieux, les passereaux multicolores ont rechanté pendant que je lisais ce récit dépaysant.
Des paysans, oui, il en est question dans cette histoire, mais pas que.
C'est la confrontation entre deux façons de vivre, les citadins et les ruraux, qui est la trame de cette quête de l'identité.
Un tendre roman d'initiation écrit juste avant le confinement, une méditation prémonitoire sur le besoin de retrouver ses racines par un retour à la nature, qui seul permet l'introspection et la compréhension du monde bouleversé actuel.
C'est Martin qui nous l'explique, un « je » permanent, qui alterne avec des descriptions de la nature et des interrogations sur les relations humaines.
Peu de dialogues, mais qui arrivent à chaque fois au bon moment, pour faire avancer l'histoire qui, sans eux, piétinerait sur les sentiers de la contemplation.
Le jeune homme a toujours vécu dans « sa » montagne, sans la mère, restée à la capitale, et qu'il n'a pas connue, avant la disparition du père, qui l'a élevé seul.
Le lecteur peut deviner à partir de ce canevas ce qui va se passer, mais c'est tout l'art du nouvel écrivain, c'est son premier roman, de nous distiller les éléments à son rythme, celui du paysan montagnard, en suivant la marche des saisons.
Ayant lu récemment un Bouysse et un Giono, j'y retrouve les mêmes émotions prodiguées par la plume de ce jeune conteur du temps présent.
« Antonin », c'est un prénom de personnage de roman, et même si l'auteur ne nous raconte pas sa propre vie, il y a une telle fusion entre Martin et lui qu'en lisant ses phrases écrites à la première personne on a l'impression que c'est lui qui nous parle.
Chapeau l'artiste, vous avez mis beaucoup de vous-même dans votre écriture et c'est ce qui fait sa force et son charme. On est happé par vos mots, envoûtants et apaisants, même lorsque le propos se révèle dur et redoutable, à l'image de la vie dans la montagne.
La bienveillance et l'empathie sont toujours présentes, alors que la mort, provoquée par un crime, nous entraîne à la recherche de l'assassin, et en même temps, à la recherche de la vérité non dite sur l'absence de la mère.
Le dosage entre passé et présent, entre ville et campagne, entre père et mère, entre solitude et promiscuité, est tout simplement parfait.
Aucune agressivité entre les deux modes de vie liés à leur environnement. Paris et la Haute-Loire, cela suppose pas mal d'incompréhension dans la façon de vivre de l'autre. Mais c'est rendu par petites touches faites de silences et d'observations, le père décédé qui réapparaît en temps que « revenant », et la mère disparue qui, elle, réapparaît en temps que vivante.
Le jardin solidaire de la capitale, qui disparaît lui aussi à cause de l'appétit démesuré des promoteurs, va réapparaître sous la forme d'un accueil paysan à la montagne. Solitaire et solidaire vont s'associer pour fuir la folie de la ville et impulser de la vie nouvelle dans cette montagne qui en avait bien besoin.
C'est tout le changement de notre société pour vivre avec la nature et non contre elle qui est évoqué. Une meilleure répartition des lieux et des taches, faite de partage et d'un autre « vivre ensemble », pour que les chardons ne prennent pas toute la place dans une friche inextricable.
Cultivons notre jardin, afin que l'humain ait toujours sa place parmi la nature qui pourrait très bien survivre sans nous.
L'auteur a créé une librairie autogérée dans son pays d'enfance. C'est une bien belle aventure qu'il nous « livre » ainsi.
Ce premier roman n'aura pas été un écrit vain. On ne peut que souhaiter une belle continuation à cet écrivain authentique.
Nous sommes les chardons est le lauréat du Prix Jean Anglade qui récompense un premier roman qui prône des valeurs qui me sont chères, telles la bienveillance, l'humanisme et l'universalité. J'ai eu la chance de faire partie du jury. Nous avons lu cinq beaux manuscrits et avons échangé, lors d'une vidéo-conférence. Avant d'écrire ma chronique, j'ai relu cette histoire, dans son format édité.
Martin a toujours vécu, seul avec son père, dans la montagne. Ils n'avaient que l'essentiel : des animaux, leur force physique et un mur de livres. le garçon n'est jamais allé en classe. « Mon père m'a instruit à l'école de la montagne et des animaux. » (p. 89) Au décès de celui qui était si important dans sa vie, Martin doit apprendre à exister sans lui et il se souvient de ce que son père lui a transmis.
Lorsque le roman commence, Martin ressent que son père est mort. Il le voit, mais il n'est plus là : « mort ou vivant, peu m'importe, il est présent à mes yeux. » (p. 36) Dans la première partie, il part à la recherche de son corps et il se remémore ce que son paternel lui a enseigné. Il ne fait qu'un avec la nature et avec la montagne. Il sait que l'on peut avoir des yeux et ne pas voir et que l'on peut écouter et ne pas entendre. Mais lui, il honore les éléments et entend leurs messages. Il se rend, également, au village. Tous les habitants respectent sa douleur : « On peut mesurer la sincérité des gens à l'épaisseur de leur silence. » (p. 98)
Grâce à une réapparition du passé, Martin va à Paris, sur les traces de celui qui lui a tant appris. Découvrir ce que celui-ci a vécu, avant d'être père, permet à son fils, de lui dire un dernier adieu. le jeune homme est dans une quête initiatique et d'identité. le contraste entre la capitale et son village, lui fait prendre conscience de ce qui compte pour lui. A un autre déraciné comme lui, Banghi, il décrit la forêt, près de laquelle il vit, il raconte les animaux, il parle de la montagne… Son nouvel ami dépeint les arbres de son pays, en Centrafrique, ceux que les hommes détruisent. J'ai été touchée par les messages transmis et la beauté des images. Ces pages sont magnifiques. C'est à ce moment-là que le titre prend tout son sens et l'explication est émouvante.
Nous sommes les chardons porte des valeurs fortes d'humanisme et d'universalité. le narrateur, Martin, a un rapport très fort à la terre et à la montagne. Il fait corps avec elles. Elles sont son essence. En s'éloignant d'elles, lors d'un voyage initiatique, il ressent qu'elles lui sont indispensables. le lien qui l'unissait à son père était fort, mais son père lui avait transmis l'essentiel. Martin sait, maintenant, qui il est et c'est un jeune homme avec de très belles valeurs et beaucoup de sensibilité.
Je remercie sincèrement Clarisse des Éditions Presses de la cité, de m'avoir permis de vivre cette formidable expérience. Je félicite Antonin Sabot de cette nomination et lui souhaite un très beau parcours littéraire.
Lien : https://valmyvoyoulit.com/20..
Martin a toujours vécu, seul avec son père, dans la montagne. Ils n'avaient que l'essentiel : des animaux, leur force physique et un mur de livres. le garçon n'est jamais allé en classe. « Mon père m'a instruit à l'école de la montagne et des animaux. » (p. 89) Au décès de celui qui était si important dans sa vie, Martin doit apprendre à exister sans lui et il se souvient de ce que son père lui a transmis.
Lorsque le roman commence, Martin ressent que son père est mort. Il le voit, mais il n'est plus là : « mort ou vivant, peu m'importe, il est présent à mes yeux. » (p. 36) Dans la première partie, il part à la recherche de son corps et il se remémore ce que son paternel lui a enseigné. Il ne fait qu'un avec la nature et avec la montagne. Il sait que l'on peut avoir des yeux et ne pas voir et que l'on peut écouter et ne pas entendre. Mais lui, il honore les éléments et entend leurs messages. Il se rend, également, au village. Tous les habitants respectent sa douleur : « On peut mesurer la sincérité des gens à l'épaisseur de leur silence. » (p. 98)
Grâce à une réapparition du passé, Martin va à Paris, sur les traces de celui qui lui a tant appris. Découvrir ce que celui-ci a vécu, avant d'être père, permet à son fils, de lui dire un dernier adieu. le jeune homme est dans une quête initiatique et d'identité. le contraste entre la capitale et son village, lui fait prendre conscience de ce qui compte pour lui. A un autre déraciné comme lui, Banghi, il décrit la forêt, près de laquelle il vit, il raconte les animaux, il parle de la montagne… Son nouvel ami dépeint les arbres de son pays, en Centrafrique, ceux que les hommes détruisent. J'ai été touchée par les messages transmis et la beauté des images. Ces pages sont magnifiques. C'est à ce moment-là que le titre prend tout son sens et l'explication est émouvante.
Nous sommes les chardons porte des valeurs fortes d'humanisme et d'universalité. le narrateur, Martin, a un rapport très fort à la terre et à la montagne. Il fait corps avec elles. Elles sont son essence. En s'éloignant d'elles, lors d'un voyage initiatique, il ressent qu'elles lui sont indispensables. le lien qui l'unissait à son père était fort, mais son père lui avait transmis l'essentiel. Martin sait, maintenant, qui il est et c'est un jeune homme avec de très belles valeurs et beaucoup de sensibilité.
Je remercie sincèrement Clarisse des Éditions Presses de la cité, de m'avoir permis de vivre cette formidable expérience. Je félicite Antonin Sabot de cette nomination et lui souhaite un très beau parcours littéraire.
Lien : https://valmyvoyoulit.com/20..
Le père est mort, Martin le sait, alors pourquoi vient-il le voir régulièrement ? Pour lui montrer que sa mort a été violente, que son corps croupit quelque part dans leurs montagnes...
Martin ne va avoir de cesse de résoudre cette disparition, quête qui va le mettre sur le chemin de sa mère, qui l'a laissé très jeune, vivre en autarcie ou presque à la ferme avec le père...
Un roman du terroir, sauvage, âpre, mais aussi d'une drôle de douceur, plein d'acuité et de sensibilité.
Une nette préférence pour la première partie, j'ai moins aimé la "sociabilisation" de Martin, partie un peu trop pleine de clichés.
Mais un joli style !
Martin ne va avoir de cesse de résoudre cette disparition, quête qui va le mettre sur le chemin de sa mère, qui l'a laissé très jeune, vivre en autarcie ou presque à la ferme avec le père...
Un roman du terroir, sauvage, âpre, mais aussi d'une drôle de douceur, plein d'acuité et de sensibilité.
Une nette préférence pour la première partie, j'ai moins aimé la "sociabilisation" de Martin, partie un peu trop pleine de clichés.
Mais un joli style !
critiques presse (1)
Inspiré par son cadre de vie en Haute-Loire, Antonin Sabot nous livre sa première oeuvre, "Nous sommes les chardons". Un roman initiatique qui a reçu le prix Jean Anglade pour son humanisme.
Lire la critique sur le site : Culturebox
Citations et extraits (23)
Voir plus
Ajouter une citation
INCIPIT
Premier jour sans le père
Je viens seulement de me rendre compte que le père est mort. Là, à la veillée. Il est assis à table devant la soupe grasse que je lui ai servie, mais il ne la touche pas et a un regard absent que je ne lui ai jamais vu. Un regard dur, ça ne m’alerterait pas. Ça, je lui connais. Avec une flamme sombre qui semble lui remonter des entrailles et qu’il est prêt à jeter sur vous sans un mot, qu’elle vous consume tout entier. Il aurait pu me lancer ce type de reproche muet si ce que j’avais cuisiné n’était pas à son goût ou qu’on n’avait pas assez rentré de foin pour les bêtes ou de bois en prévision de l’hiver. Il a tout un tas de raisons à lui pour adresser des reproches. Mais ce regard vide, ça ne lui ressemble pas.
«Oh, le père! Y a quelque chose qui va pas?»
Il ne répond pas. Pas même un grognement, comme il fait parfois. Ses larges épaules sont basses. Plus basses encore que la fois où il avait dû ramener, en la portant presque, une vache qui s’était abîmé une patte au pâturage et qui ne pouvait pas rentrer seule. Il avait fallu l’abattre un peu plus tard, car elle ne pouvait plus sortir de l’étable. Ce soir-là aussi, ses épaules étaient basses, au père, et il n’avait pas eu besoin de beaucoup de mots pour dire son dépit. De toute façon, ce n’est pas un bavard. Une force de la nature ça oui, mais pas un bavard à jacasser en permanence et à se vanter, comme certains voisins qui passent rendre visite une fois de temps en temps et qu’il accueille comme il se doit, mais sans trop d’hospitalité non plus, histoire de ne pas leur donner envie de revenir trop souvent. Il dit « C’est bien, la compagnie », quand ils sont assis à boire sa gnôle, « Mais ça doit être un plaisir qu’on savoure à petite dose », ajoute-t-il, une fois qu’ils sont partis.
Ainsi donc, il est là ce soir, à ne rien dire et à ne rien manger, à ne rien regarder vraiment non plus. Son regard ne s’attache à rien. Et lorsque je passe derrière lui, pour aller ranger le fromage dans la petite pièce qui nous sert de garde-manger, je vois son pull et sa chemise déchirés, collés à sa peau par un suint noir et brillant. Et en dessous, un grand trou, bien entre les omoplates, et qui descend jusqu’à la moitié du dos. La chair en dedans est déjà brune et sèche. Comment ai-je pu louper ça ? Vu la couleur de la plaie, ça fait bien deux ou trois jours qu’elle lui barre le dos. Je me revois m’interroger, il y a trois jours justement, à propos de sa veste déchirée. Sauf que ça ne suintait pas comme ça à ce moment-là. Et puis je m’étais dit que ça lui ressemblait bien, au père, de garder des vêtements tout abîmés et de se moquer de l’air que ça lui donne. Ensuite, il devait aller voir son amie Marie-Louise, alors je n’y ai plus pensé. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’on s’est revus.
Je reste un instant interdit, les yeux fixés sur le trou horrible et sale. Je cours dans la remise chercher une bouteille de gnôle pour désinfecter ça, peut-être même qu’il reste une vraie bouteille d’alcool de pharmacie, encore plus fort et vraiment fait pour, parce que j’ai beau ne pas m’y connaître en médecine, je sais tout même qu’une blessure, il faut la désinfecter pour ne pas que la fièvre s’y mette.
Quand je reviens dans la pièce, le père n’y est plus. Il ne reste que la chaise tirée devant le bol de soupe tiède et un morceau de pain auquel nul n’a touché. Sur la chaise, il y a une fine couche de poussière comme si personne ne s’était assis dessus. Je ne sais pas comment je note tout ça. Sûrement que mon cerveau va plus vite que d’habitude et je remarque plein d’infimes détails pendant que je cours vers la porte, voir s’il n’est pas sorti et n’a pas besoin d’aide, que je le rentre et le couche, comme lui pour la vache blessée. Non pas exactement pareil, parce qu’ensuite il avait fallu la tuer et on ne fait pas comme ça pour les gens, surtout pas pour son propre père. Je pousse la porte et regarde au-dehors. La seule présence est celle des étoiles qui scintillent. « Plus fort que partout ailleurs », dit parfois le père, même que je ne comprends pas comment les étoiles peuvent briller moins fort à des endroits et plus à d’autres. Mais cette nuit, elles brillent très fort, car il n’y a pas encore de lune.
Il me faut un moment pour habituer mon regard et observer alentour si je ne le vois pas, si en plus de sa blessure, il n’y aurait pas la folie qui l’aurait pris et il serait parti marcher dans la forêt avec dans le dos un trou grand comme la main. Il vaudrait mieux qu’il se repose, plutôt que battre la campagne. En regardant tout autour, je crois apercevoir une ombre à la lisière des bois, au bout de la clairière dans laquelle est plantée notre maison, là où nous menons parfois paître nos vaches, mais pas trop souvent, car le sol n’est pas bon, plein de pierres qui font de sournoises buttes sur lesquelles elles pourraient se blesser et l’herbe n’y pousse pas bien. Il n’y a que des genêts et des prunelliers avec de longs piquants contre lesquels on se bat lorsqu’on en a la force, mais qui finissent toujours par gagner et par revenir. Je pars en courant vers l’ombre en appelant, « Oh, le père ! », du plus fort que je peux, et manque de m’étaler en heurtant une pierre. Arrivé à l’orée du bois, je n’aperçois plus la moindre ombre. On dirait que le père s’est volatilisé, et je sais que je ne le rattraperai pas, il connaît la forêt comme sa poche et, s’il a décidé de rester seul, il peut se débrouiller pour ne pas être retrouvé.
En rentrant dans le noir, je me souviens de ce que racontait la vieille Mado les jours où on allait lui porter un fromage, une fois par mois, et aussi un peu de gnôle quelquefois. Elle habite dans la vallée d’à côté, un hameau de cinq maisons où tout le monde est soit mort, soit parti à la ville. Les derniers à s’en aller avaient voulu l’aider à déménager, l’emmener chez quelque cousin qui vivait moins loin de la civilisation. Ils affirmaient que ça serait mieux pour elle en cas de problème, alors que les plus proches voisins, nous, habitions à trois heures de marche, autant dire inatteignables en cas d’urgence, et, même si elle arrivait jusque chez nous, il faudrait deux heures de plus pour rejoindre le bourg. Ils avaient insisté pour qu’au moins elle demande l’installation d’une ligne de téléphone, même s’ils se doutaient bien que jamais l’administration n’irait équiper un hameau aussi reculé et voué à la disparition. De toute manière, elle n’avait rien voulu entendre. Maintenant que son mari était mort, répondait-elle, que pouvait-il bien lui arriver de pire que de partir le rejoindre ?
Sauf que ce n’est pas elle qui l’a rejoint, mais lui qui lui rendait visite, racontait-elle en riant. Elle nous disait que, parfois, il venait dans la minuscule pièce aux murs tout en bois clair qui lui servait à la fois de cuisine et de chambre, avec dans un coin son fourneau, dans lequel elle mettait une bûche après l’autre pour chauffer sa soupe, et à côté un réduit, une niche, sous l’escalier, qu’on aurait pu prendre pour un petit garde-manger si ce n’était la couverture rouge-violet, teintée au jus de cassis, qui montrait que c’était son lit, avec au-dessus, accrochées, une vieille publicité jaunie pour une cocotte-minute et une carte postale de Lourdes envoyée par sa nièce il y a bien longtemps. Ainsi donc, son mari venait lui rendre visite, à l’heure du dîner, à l’heure où avant qu’il soit mort il rentrait des champs. Il se tenait assis à table comme s’il attendait de manger la seule soupe que faisait toujours la Mado, avec une pomme de terre, des orties, et de larges feuilles duveteuses de consoude qui donnent un goût de poisson ; mais il ne parlait pas, il ne mangeait pas.
La première fois, ça faisait bien déjà cinq ans qu’il était mort. Il était revenu juste après le départ des derniers voisins. Elle avait eu peur, bien sûr. Mais elle avait vite vu que le fantôme ne lui voulait aucun mal, qu’il restait simplement là, à la regarder affectueusement, par-dessous son béret sale, celui qu’il avait toujours porté et qui, à la longue, l’avait rendu chauve sur le dessus du crâne, mais ça n’était pas bien grave, il ne l’enlevait presque jamais, ce béret, seulement lorsqu’il allait à la messe, ce qui n’arrivait qu’à Noël et pour le 15 août. Tant pis pour les cheveux. Il souriait silencieusement derrière sa moustache toute fine, ça lui faisait une mine espiègle. D’ailleurs, croyait la Mado, il n’avait pas l’âge de quand il était mort, lorsqu’une vache devenue folle lui avait marché dessus et brisé une côte qui lui était rentrée dans le poumon et qu’il s’était étouffé là, tout près, à l’étable. Il était plus jeune, comme lorsqu’ils s’étaient rencontrés à un bal, là-bas dans la vallée, et qu’elle avait vite déménagé de chez ses parents pour le rejoindre puisqu’à l’époque on ne pouvait pas faire autrement si un enfant s’annonçait. Même si ensuite elle l’avait perdu, mais ça, c’était une autre histoire et elle n’aimait pas trop en parler.
En tout cas, elle avait vite compris que son mari était revenu pour une bonne raison. Elle était seule au village désormais et il lui fallait quelqu’un pour veiller un peu sur elle. Elle aimait ça, disait-elle, revoir son époux par moments. Souvent, il venait des soirs où le cafard lui montait à la gorge de n’avoir vu personne depuis longtemps. Ça lui rappelait sa jeunesse de l’avoir à table qui la regardait tendrement. Elle aurait préféré pouvoir lui prendre la main et lui parler un peu, mais ça lui faisait déjà du bien de savoir qu’il pensait toujours à elle.
Est-ce que c’est pour la même raison que le père n’a pas disparu tout de suite quand il est mort ? Pour que je ne me retrouve pas tout seul ? Est-ce qu’il se dit que j’ai encore besoin de quelqu’un pour me guider à la ferme ? Pourtant, depuis un moment déjà, il n’a plus grand-chose à m’apprendre quand je mène les vaches à l’alpage, qu’on prépare le fromage ou qu’on s’occupe du potager. Dans les bois, je me débrouille presque aussi bien que lui pour dist
Premier jour sans le père
Je viens seulement de me rendre compte que le père est mort. Là, à la veillée. Il est assis à table devant la soupe grasse que je lui ai servie, mais il ne la touche pas et a un regard absent que je ne lui ai jamais vu. Un regard dur, ça ne m’alerterait pas. Ça, je lui connais. Avec une flamme sombre qui semble lui remonter des entrailles et qu’il est prêt à jeter sur vous sans un mot, qu’elle vous consume tout entier. Il aurait pu me lancer ce type de reproche muet si ce que j’avais cuisiné n’était pas à son goût ou qu’on n’avait pas assez rentré de foin pour les bêtes ou de bois en prévision de l’hiver. Il a tout un tas de raisons à lui pour adresser des reproches. Mais ce regard vide, ça ne lui ressemble pas.
«Oh, le père! Y a quelque chose qui va pas?»
Il ne répond pas. Pas même un grognement, comme il fait parfois. Ses larges épaules sont basses. Plus basses encore que la fois où il avait dû ramener, en la portant presque, une vache qui s’était abîmé une patte au pâturage et qui ne pouvait pas rentrer seule. Il avait fallu l’abattre un peu plus tard, car elle ne pouvait plus sortir de l’étable. Ce soir-là aussi, ses épaules étaient basses, au père, et il n’avait pas eu besoin de beaucoup de mots pour dire son dépit. De toute façon, ce n’est pas un bavard. Une force de la nature ça oui, mais pas un bavard à jacasser en permanence et à se vanter, comme certains voisins qui passent rendre visite une fois de temps en temps et qu’il accueille comme il se doit, mais sans trop d’hospitalité non plus, histoire de ne pas leur donner envie de revenir trop souvent. Il dit « C’est bien, la compagnie », quand ils sont assis à boire sa gnôle, « Mais ça doit être un plaisir qu’on savoure à petite dose », ajoute-t-il, une fois qu’ils sont partis.
Ainsi donc, il est là ce soir, à ne rien dire et à ne rien manger, à ne rien regarder vraiment non plus. Son regard ne s’attache à rien. Et lorsque je passe derrière lui, pour aller ranger le fromage dans la petite pièce qui nous sert de garde-manger, je vois son pull et sa chemise déchirés, collés à sa peau par un suint noir et brillant. Et en dessous, un grand trou, bien entre les omoplates, et qui descend jusqu’à la moitié du dos. La chair en dedans est déjà brune et sèche. Comment ai-je pu louper ça ? Vu la couleur de la plaie, ça fait bien deux ou trois jours qu’elle lui barre le dos. Je me revois m’interroger, il y a trois jours justement, à propos de sa veste déchirée. Sauf que ça ne suintait pas comme ça à ce moment-là. Et puis je m’étais dit que ça lui ressemblait bien, au père, de garder des vêtements tout abîmés et de se moquer de l’air que ça lui donne. Ensuite, il devait aller voir son amie Marie-Louise, alors je n’y ai plus pensé. Ce n’est qu’aujourd’hui qu’on s’est revus.
Je reste un instant interdit, les yeux fixés sur le trou horrible et sale. Je cours dans la remise chercher une bouteille de gnôle pour désinfecter ça, peut-être même qu’il reste une vraie bouteille d’alcool de pharmacie, encore plus fort et vraiment fait pour, parce que j’ai beau ne pas m’y connaître en médecine, je sais tout même qu’une blessure, il faut la désinfecter pour ne pas que la fièvre s’y mette.
Quand je reviens dans la pièce, le père n’y est plus. Il ne reste que la chaise tirée devant le bol de soupe tiède et un morceau de pain auquel nul n’a touché. Sur la chaise, il y a une fine couche de poussière comme si personne ne s’était assis dessus. Je ne sais pas comment je note tout ça. Sûrement que mon cerveau va plus vite que d’habitude et je remarque plein d’infimes détails pendant que je cours vers la porte, voir s’il n’est pas sorti et n’a pas besoin d’aide, que je le rentre et le couche, comme lui pour la vache blessée. Non pas exactement pareil, parce qu’ensuite il avait fallu la tuer et on ne fait pas comme ça pour les gens, surtout pas pour son propre père. Je pousse la porte et regarde au-dehors. La seule présence est celle des étoiles qui scintillent. « Plus fort que partout ailleurs », dit parfois le père, même que je ne comprends pas comment les étoiles peuvent briller moins fort à des endroits et plus à d’autres. Mais cette nuit, elles brillent très fort, car il n’y a pas encore de lune.
Il me faut un moment pour habituer mon regard et observer alentour si je ne le vois pas, si en plus de sa blessure, il n’y aurait pas la folie qui l’aurait pris et il serait parti marcher dans la forêt avec dans le dos un trou grand comme la main. Il vaudrait mieux qu’il se repose, plutôt que battre la campagne. En regardant tout autour, je crois apercevoir une ombre à la lisière des bois, au bout de la clairière dans laquelle est plantée notre maison, là où nous menons parfois paître nos vaches, mais pas trop souvent, car le sol n’est pas bon, plein de pierres qui font de sournoises buttes sur lesquelles elles pourraient se blesser et l’herbe n’y pousse pas bien. Il n’y a que des genêts et des prunelliers avec de longs piquants contre lesquels on se bat lorsqu’on en a la force, mais qui finissent toujours par gagner et par revenir. Je pars en courant vers l’ombre en appelant, « Oh, le père ! », du plus fort que je peux, et manque de m’étaler en heurtant une pierre. Arrivé à l’orée du bois, je n’aperçois plus la moindre ombre. On dirait que le père s’est volatilisé, et je sais que je ne le rattraperai pas, il connaît la forêt comme sa poche et, s’il a décidé de rester seul, il peut se débrouiller pour ne pas être retrouvé.
En rentrant dans le noir, je me souviens de ce que racontait la vieille Mado les jours où on allait lui porter un fromage, une fois par mois, et aussi un peu de gnôle quelquefois. Elle habite dans la vallée d’à côté, un hameau de cinq maisons où tout le monde est soit mort, soit parti à la ville. Les derniers à s’en aller avaient voulu l’aider à déménager, l’emmener chez quelque cousin qui vivait moins loin de la civilisation. Ils affirmaient que ça serait mieux pour elle en cas de problème, alors que les plus proches voisins, nous, habitions à trois heures de marche, autant dire inatteignables en cas d’urgence, et, même si elle arrivait jusque chez nous, il faudrait deux heures de plus pour rejoindre le bourg. Ils avaient insisté pour qu’au moins elle demande l’installation d’une ligne de téléphone, même s’ils se doutaient bien que jamais l’administration n’irait équiper un hameau aussi reculé et voué à la disparition. De toute manière, elle n’avait rien voulu entendre. Maintenant que son mari était mort, répondait-elle, que pouvait-il bien lui arriver de pire que de partir le rejoindre ?
Sauf que ce n’est pas elle qui l’a rejoint, mais lui qui lui rendait visite, racontait-elle en riant. Elle nous disait que, parfois, il venait dans la minuscule pièce aux murs tout en bois clair qui lui servait à la fois de cuisine et de chambre, avec dans un coin son fourneau, dans lequel elle mettait une bûche après l’autre pour chauffer sa soupe, et à côté un réduit, une niche, sous l’escalier, qu’on aurait pu prendre pour un petit garde-manger si ce n’était la couverture rouge-violet, teintée au jus de cassis, qui montrait que c’était son lit, avec au-dessus, accrochées, une vieille publicité jaunie pour une cocotte-minute et une carte postale de Lourdes envoyée par sa nièce il y a bien longtemps. Ainsi donc, son mari venait lui rendre visite, à l’heure du dîner, à l’heure où avant qu’il soit mort il rentrait des champs. Il se tenait assis à table comme s’il attendait de manger la seule soupe que faisait toujours la Mado, avec une pomme de terre, des orties, et de larges feuilles duveteuses de consoude qui donnent un goût de poisson ; mais il ne parlait pas, il ne mangeait pas.
La première fois, ça faisait bien déjà cinq ans qu’il était mort. Il était revenu juste après le départ des derniers voisins. Elle avait eu peur, bien sûr. Mais elle avait vite vu que le fantôme ne lui voulait aucun mal, qu’il restait simplement là, à la regarder affectueusement, par-dessous son béret sale, celui qu’il avait toujours porté et qui, à la longue, l’avait rendu chauve sur le dessus du crâne, mais ça n’était pas bien grave, il ne l’enlevait presque jamais, ce béret, seulement lorsqu’il allait à la messe, ce qui n’arrivait qu’à Noël et pour le 15 août. Tant pis pour les cheveux. Il souriait silencieusement derrière sa moustache toute fine, ça lui faisait une mine espiègle. D’ailleurs, croyait la Mado, il n’avait pas l’âge de quand il était mort, lorsqu’une vache devenue folle lui avait marché dessus et brisé une côte qui lui était rentrée dans le poumon et qu’il s’était étouffé là, tout près, à l’étable. Il était plus jeune, comme lorsqu’ils s’étaient rencontrés à un bal, là-bas dans la vallée, et qu’elle avait vite déménagé de chez ses parents pour le rejoindre puisqu’à l’époque on ne pouvait pas faire autrement si un enfant s’annonçait. Même si ensuite elle l’avait perdu, mais ça, c’était une autre histoire et elle n’aimait pas trop en parler.
En tout cas, elle avait vite compris que son mari était revenu pour une bonne raison. Elle était seule au village désormais et il lui fallait quelqu’un pour veiller un peu sur elle. Elle aimait ça, disait-elle, revoir son époux par moments. Souvent, il venait des soirs où le cafard lui montait à la gorge de n’avoir vu personne depuis longtemps. Ça lui rappelait sa jeunesse de l’avoir à table qui la regardait tendrement. Elle aurait préféré pouvoir lui prendre la main et lui parler un peu, mais ça lui faisait déjà du bien de savoir qu’il pensait toujours à elle.
Est-ce que c’est pour la même raison que le père n’a pas disparu tout de suite quand il est mort ? Pour que je ne me retrouve pas tout seul ? Est-ce qu’il se dit que j’ai encore besoin de quelqu’un pour me guider à la ferme ? Pourtant, depuis un moment déjà, il n’a plus grand-chose à m’apprendre quand je mène les vaches à l’alpage, qu’on prépare le fromage ou qu’on s’occupe du potager. Dans les bois, je me débrouille presque aussi bien que lui pour dist
Couper du bois, ça n’a l’air de rien, mais c’est un geste essentiel. Lorsque je brandis le merlin avec sa tête brute et triangulaire, je me sens relié à des tas de générations précédentes. Bien sûr, en ville aujourd’hui, il y a l’électricité ou le gaz, mais nous, on n’a que ça pour se chauffer l’hiver ou pour cuire la nourriture. En reproduisant les gestes de ceux d’avant, on les respecte, on montre qu’on n’a pas tout oublié. Et puis, ce qu’il y a de bien avec le bois que l’on fend, c’est que l’on se chauffe deux fois. On se réchauffe en le brûlant, mais aussi en le coupant.
Mon père explique qu'on a le droit [d'abattre un arbre] si c'est pour allumer le poêle et lire au coin du feu.
Peut-être que ce n'est pas un hasard si le papier des livres et le feu sont de la même matière, et qu'ils vous revivifient l'un comme l'autre. Une bûche que l'on fend, c'est une promesse de lecture.
Peut-être que ce n'est pas un hasard si le papier des livres et le feu sont de la même matière, et qu'ils vous revivifient l'un comme l'autre. Une bûche que l'on fend, c'est une promesse de lecture.
L’homme est fait pour écouter les oiseaux et pour leur donner des noms, disait le père, aujourd’hui, le bruit des machines est arrivé aux oreilles des gens et ils ne comprennent pas qu’ils en ont la migraine. Pourtant, c’est normal, nos oreilles sont faites pour entendre le vent dans les arbres et pas plus d’une ou deux voix à la fois. Mais les habitants des villes n’entendent plus rien, car ils sont assourdis par le bruit de la planète entière.» C’est de ça que le père avait voulu se préserver en venant habiter la montagne, en montant plus haut que les voitures, là où nul n’ose plus se rendre aujourd’hui. Il m’avait emmené là pour que j’apprenne à écouter autre chose que tout ce bruit, m’avait-il expliqué un jour où je lui demandais pourquoi on n’allait pas vivre ailleurs. Il avait pris cette question très au sérieux, même si moi, ces histoires de bruit, d’entendre et d’écouter ce qui arrivait au bout de la planète, ça me passait un peu au-dessus de la tête.
Il fait déjà sombre à l'heure où je regarde par la fenêtre passer les voitures des habitants qui reviennent de leur travail à la ville voisine. Il ne faut pas loin de trois quarts d'heure pour s'y rendre les jours où la route est bonne, mais ils prétendent tous qu'ils y gagnent en qualité de vie. Ils ont ajouté de grands garages en moellons aux vieux corps de ferme en pierre et fermé le tout par des haies de thuyas qui ne sont pas du tout des arbres d'ici mais ont l'avantage de pousser bien vite. Ils s'entourent aussi d'objets, s'en construisent un grand mur qui les dépasse et qui leur bouche l'horizon. Ils ont beau dire que le matin ils voient la montagne, c'est à ça que se résument leurs quinze minutes de verdure quotidienne, un coup d'oeil par la fenêtre au réveil. Et puis ils se dépêchent de partir en ville pour travailler, pour acheter des téléphones, des ordinateurs ou des robots ménagers, de nouvelles briques à ajouter à leur mur d'objets.
autres livres classés : relation père-filsVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antonin Sabot (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Marseille, son soleil, sa mer, ses écrivains connus
Né à Corfou, cet écrivain évoque son enfance marseillaise dans Le Livre de ma mère. Son nom ?
Elie Cohen
Albert Cohen
Leonard Cohen
10 questions
307 lecteurs ont répondu
Thèmes :
provence
, littérature régionale
, marseilleCréer un quiz sur ce livre307 lecteurs ont répondu