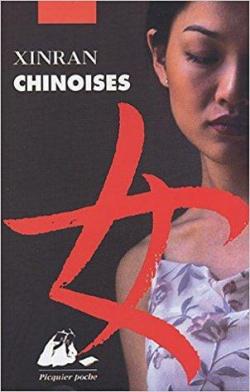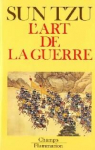Xinran
Marie-Odile Probst-Gledhill (Traducteur)/5 360 notes
Marie-Odile Probst-Gledhill (Traducteur)/5 360 notes
Résumé :
Un dicton chinois prétend que " dans chaque famille il y a un livre qu'il vaut mieux ne pas lire à haute voix ".
Une femme a rompu le silence. Durant huit années, de 1989 à 1997, Xinran a présenté chaque nuit à la radio chinoise une émission au cours de laquelle elle invitait les femmes à parler d'elles-mêmes, sans tabou. Elle a rencontré des centaines d'entre elles. Avec compassion elle les a écoutées se raconter et lui confier leurs secrets enfouis ... >Voir plus
Une femme a rompu le silence. Durant huit années, de 1989 à 1997, Xinran a présenté chaque nuit à la radio chinoise une émission au cours de laquelle elle invitait les femmes à parler d'elles-mêmes, sans tabou. Elle a rencontré des centaines d'entre elles. Avec compassion elle les a écoutées se raconter et lui confier leurs secrets enfouis ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après ChinoisesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (99)
Voir plus
Ajouter une critique
Je poursuis la lecture de cette auteure aussi engagée que talentueuse...
Après "L'Enfant unique", et "Funérailles célestes"...j'ai achevé en une
nuit insomniaque: "Chinoises"...Un livre faussement désordonné, avec moult témoignages des plus significatifs et éclairants !...
Je tire mon chapeau à cette femme, qui , fille d'un milieu libéral, a souffert
, dans son enfance et sa jeunesse, de la main mise du Parti communiste et
de la Révolution culturelle, ayant dû composer avec..., du mieux possible,
pour faire avancer les choses, dont le sort des femmes; ses émissions de
radio, son travail journalistique...ses engagements et la défense de ses
convictions...
Qu'un véritable espace de parole existe ... !
"Personne ne m'a félicitée d'avoir sauvé cette jeune fille, par contre, j'ai eu droit à des critiques pour « avoir mis les troupes en branle et troublé l'ordre public » et avoir gaspillé le temps et l'argent de la station de radio. Ces reproches m'ont ébranlée. Une jeune fille s'était trouvée en danger et quand on allait à son secours, on vous accusait de « dilapider les deniers
publics ». Que valait donc la vie d'une femme en Chine ?"
Un ouvrage où l'on perçoit les bouleversements gigantesques vécus par
la Chine, à travers ses régimes politiques extrêmes...et enfin, tardivement
son ouverture au monde. Mais que de tragédies et d'individus sacrifiés
pendant des décennies... où les premières victimes étaient les femmes et
les enfants !!...
Un ensemble de témoignages des plus prenants et dérangeants... où
nous pouvons lire à la fin de l'ouvrage que l'espérance de vie la plus
courte se trouve dans quatre professions : ouvriers d'usines chimiques,
Les chauffeurs routiers longue distance, les policiers, et plus SURPRENANT : Les journalistes !! ?
Tous ces journalistes qui ont vu un trop grand nombre d'événements
choquants, écrasés par les contrôles du Parti... Souvent contraints
d'écrire des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord...
Ce livre, comme les autres écrits de cette écrivaine-journaliste ont d'autant plus de mérite d'exister. Xinran avoue avoir décidé d'abandonner sa carrière de journaliste, se trouvant en permanence tiraillée, déchirée entre la vérité et le tragique des témoignages recueillis , écrasés par la censure omniprésente du pouvoir politique. Elle nous confirme que si elle a pu publier ces témoignages c'est parce qu'elle l'a fait en Angleterre...
"Je me suis souvenue de ce que le Vieux Chen m'avait dit : " Xinran, vous devriez écrire tout cela. Ecrire permet de se décharger de ce qu'on porte et cela peut aider à créer un espace pour accueillir de nouvelles façons de penser et de sentir.
Si vois n'écrivez pas ces histoires, leur trop-plein va vous briser le coeur.
" A l'époque, en Chine, écrire un livre tel que celui-ci m'aurait peut-être
valu la prison. Je ne pouvais prendre le risque d'abandonner mon fils ou
ces femmes qui comptaient sur l'aide et les encouragements que leur
apportait mon émission de radio. En Angleterre, le livre est devenu possible. Comme si une plume m'avait poussé dans mon coeur." (p. 352)
Vraiment très heureuse d'avoir enfin découvert cette auteure....Cela me donne envie de relire "Balzac et la petite tailleuse chinoise" de Dai Sijie...
Après "L'Enfant unique", et "Funérailles célestes"...j'ai achevé en une
nuit insomniaque: "Chinoises"...Un livre faussement désordonné, avec moult témoignages des plus significatifs et éclairants !...
Je tire mon chapeau à cette femme, qui , fille d'un milieu libéral, a souffert
, dans son enfance et sa jeunesse, de la main mise du Parti communiste et
de la Révolution culturelle, ayant dû composer avec..., du mieux possible,
pour faire avancer les choses, dont le sort des femmes; ses émissions de
radio, son travail journalistique...ses engagements et la défense de ses
convictions...
Qu'un véritable espace de parole existe ... !
"Personne ne m'a félicitée d'avoir sauvé cette jeune fille, par contre, j'ai eu droit à des critiques pour « avoir mis les troupes en branle et troublé l'ordre public » et avoir gaspillé le temps et l'argent de la station de radio. Ces reproches m'ont ébranlée. Une jeune fille s'était trouvée en danger et quand on allait à son secours, on vous accusait de « dilapider les deniers
publics ». Que valait donc la vie d'une femme en Chine ?"
Un ouvrage où l'on perçoit les bouleversements gigantesques vécus par
la Chine, à travers ses régimes politiques extrêmes...et enfin, tardivement
son ouverture au monde. Mais que de tragédies et d'individus sacrifiés
pendant des décennies... où les premières victimes étaient les femmes et
les enfants !!...
Un ensemble de témoignages des plus prenants et dérangeants... où
nous pouvons lire à la fin de l'ouvrage que l'espérance de vie la plus
courte se trouve dans quatre professions : ouvriers d'usines chimiques,
Les chauffeurs routiers longue distance, les policiers, et plus SURPRENANT : Les journalistes !! ?
Tous ces journalistes qui ont vu un trop grand nombre d'événements
choquants, écrasés par les contrôles du Parti... Souvent contraints
d'écrire des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord...
Ce livre, comme les autres écrits de cette écrivaine-journaliste ont d'autant plus de mérite d'exister. Xinran avoue avoir décidé d'abandonner sa carrière de journaliste, se trouvant en permanence tiraillée, déchirée entre la vérité et le tragique des témoignages recueillis , écrasés par la censure omniprésente du pouvoir politique. Elle nous confirme que si elle a pu publier ces témoignages c'est parce qu'elle l'a fait en Angleterre...
"Je me suis souvenue de ce que le Vieux Chen m'avait dit : " Xinran, vous devriez écrire tout cela. Ecrire permet de se décharger de ce qu'on porte et cela peut aider à créer un espace pour accueillir de nouvelles façons de penser et de sentir.
Si vois n'écrivez pas ces histoires, leur trop-plein va vous briser le coeur.
" A l'époque, en Chine, écrire un livre tel que celui-ci m'aurait peut-être
valu la prison. Je ne pouvais prendre le risque d'abandonner mon fils ou
ces femmes qui comptaient sur l'aide et les encouragements que leur
apportait mon émission de radio. En Angleterre, le livre est devenu possible. Comme si une plume m'avait poussé dans mon coeur." (p. 352)
Vraiment très heureuse d'avoir enfin découvert cette auteure....Cela me donne envie de relire "Balzac et la petite tailleuse chinoise" de Dai Sijie...
Magnifiquement structuré dans une apparente déstructure, Chinoises se construit au fils des différents récits qui s'imbriquent finement les uns dans les autres jusqu'à la reconstruction finale qui laisse un goût amer sur les doigts.
Xinran a animé à la radio chinoise pendant plusieurs années (de 1989 à 1997), une émission où elle invitait les femmes à parler d'elles-mêmes. Durant cette période, Xinran a eu l'occasion de lire leurs nombreuses lettres, d'entendre leurs témoignages et de s'entretenir avec elles. Ce magnifique recueil est le résultat d'un travail de longue haleine. Xinran a parcouru la Chine de long en large, pour écouter ces femmes. D'autres récits lui ont été envoyés ou ont été enregistrés de manière anonyme sur le répondeur de la radio.
Un jour, le vieux Chen dit à Xinran: «Xinran, vous devriez écrire tout cela. Écrire permet de se décharger de ce que l'on porte et cela peut aider à créer un espace pour accueillir de nouvelles façons de penser et d'écrire. Si vous n'écrivez pas ces histoires, leur trop-plein va vous briser le coeur». Arrivée en Angleterre, c'est ce qu'elle décida de faire. Il en ressort un livre bouleversant, poignant, étonnant, émouvant, magnifique, inoubliable, incroyable... qui au travers de l'histoire de ces femmes, de toute classe sociale, de tout âge et de tout horizon, nous en apprend sur la place de la femme en Chine mais aussi sur la société de cet énorme pays en pleine mutation.
Chinoises est un roman dont j'ai beaucoup de mal à parler. Je ne trouve pas les mots adéquats, forts, les mots parfaits pour exprimer tout mon ressenti. Les récits de ces femmes m'ont emporté sans ménagement. Il faut dire que la force de Chinoises réside dans sa capacité à allier une multitude d'émotions chez son lecteur, j'ai personnellement bouillonné de colère et d'indignation, ressenti le désarroi et la peine de ces femmes, et parfois éprouvé du dégoût pour la nature humaine. En quelques mots, Chinoises m'a littéralement fendu le coeur.
Xinran, en laissant la parole à ces femmes, nous a permis de découvrir la fille, la maîtresse, l'amoureuse mais aussi la mère chinoise, comme on ne la soupçonnait pas. Et ce qui est admirable chez cette « femme chinoise », c'est qu'il n'y a jamais de haine ni de soif de vengeance, juste une envie de faire connaître ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit.
Il y a des livres, trop peu nombreux, où le système de notation perd tout son sens, car le maximum d'étoiles n'est pas assez.... Trop rares sont les livres qui proposent de telles émotions, de telles histoires, trop rares sont les livres ayant une telle âme que celui-ci. Chinoises. Un hommage en l'honneur de la femme chinoise, petit certes, comparé aux drames et sacrifices qu'elles ont dû vivre, mais qui permet de ne pas les oublier et de faire perdurer leurs histoires dans nos mémoires. Merci Xinran, infiniment…
Xinran a animé à la radio chinoise pendant plusieurs années (de 1989 à 1997), une émission où elle invitait les femmes à parler d'elles-mêmes. Durant cette période, Xinran a eu l'occasion de lire leurs nombreuses lettres, d'entendre leurs témoignages et de s'entretenir avec elles. Ce magnifique recueil est le résultat d'un travail de longue haleine. Xinran a parcouru la Chine de long en large, pour écouter ces femmes. D'autres récits lui ont été envoyés ou ont été enregistrés de manière anonyme sur le répondeur de la radio.
Un jour, le vieux Chen dit à Xinran: «Xinran, vous devriez écrire tout cela. Écrire permet de se décharger de ce que l'on porte et cela peut aider à créer un espace pour accueillir de nouvelles façons de penser et d'écrire. Si vous n'écrivez pas ces histoires, leur trop-plein va vous briser le coeur». Arrivée en Angleterre, c'est ce qu'elle décida de faire. Il en ressort un livre bouleversant, poignant, étonnant, émouvant, magnifique, inoubliable, incroyable... qui au travers de l'histoire de ces femmes, de toute classe sociale, de tout âge et de tout horizon, nous en apprend sur la place de la femme en Chine mais aussi sur la société de cet énorme pays en pleine mutation.
Chinoises est un roman dont j'ai beaucoup de mal à parler. Je ne trouve pas les mots adéquats, forts, les mots parfaits pour exprimer tout mon ressenti. Les récits de ces femmes m'ont emporté sans ménagement. Il faut dire que la force de Chinoises réside dans sa capacité à allier une multitude d'émotions chez son lecteur, j'ai personnellement bouillonné de colère et d'indignation, ressenti le désarroi et la peine de ces femmes, et parfois éprouvé du dégoût pour la nature humaine. En quelques mots, Chinoises m'a littéralement fendu le coeur.
Xinran, en laissant la parole à ces femmes, nous a permis de découvrir la fille, la maîtresse, l'amoureuse mais aussi la mère chinoise, comme on ne la soupçonnait pas. Et ce qui est admirable chez cette « femme chinoise », c'est qu'il n'y a jamais de haine ni de soif de vengeance, juste une envie de faire connaître ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit.
Il y a des livres, trop peu nombreux, où le système de notation perd tout son sens, car le maximum d'étoiles n'est pas assez.... Trop rares sont les livres qui proposent de telles émotions, de telles histoires, trop rares sont les livres ayant une telle âme que celui-ci. Chinoises. Un hommage en l'honneur de la femme chinoise, petit certes, comparé aux drames et sacrifices qu'elles ont dû vivre, mais qui permet de ne pas les oublier et de faire perdurer leurs histoires dans nos mémoires. Merci Xinran, infiniment…
J'avis beaucoup aimé Funérailles Célestes, de Xinran, l'année dernière. Il relatait l'histoire d'une femme qui avait vécu plusieurs dizaines d'années au Tibet, isolée du reste du monde. Elle avait recueillie ce témoignage parmi tant d'autres pour son émission de radio sur les femmes chinoises.
Chinoises, contrairement à Funérailles Célestes qui est très beau, très descriptif, est une suite, donc, de témoignages anonymes ou non reçus entre 1989 et 1997.
Xinran est journaliste pour une radio dépendante du Parti, donc surveillée et éventuellement censurée. Malgré ça, elle parvient à recueillir et diffuser ces récits parfois insoutenables de ces femmes qui ont subi, et subissent encore, la tradition chinoise de la femme soumise et qui ont vécu l'oppression de ces années de communisme.
Certaines nées de familles cultivées, puissantes, d'autres dans la pauvreté la plus totale, mais toutes liées par cette même expérience du viol, du mariage arrangé, du mépris, de la violence verbale et physique. Certaines en sont devenues folles, d'autres ont accepté et mené leur vie dans l'ombre.
Chaque récit est différent - Xinran y dévoile elle-même la vie de sa propre mère - et pourtant tous nous parlent de ces vies écrasées, niées, au fil des siècles, que ce soit dans une campagne encore très arriérée (où les femmes "s'utilisent" parfois par plusieurs frères, où elles se vendent ou s'échangent) ou dans les villes prospères et nouvellement capitalistes, où l'argent et la beauté est un atout majeur pour un mari ambitieux.
Xinran a l'art, la patience, la douceur pour exorciser ces femmes de ces drames pour les faire témoigner. La deuxième étape, l'écriture du livre, se fera ensuite lorsqu'elle s'installe à Londres, désireuse de vivre une autre vie mais de témoigner du véritable sort des femmes chinoises au monde occidental.
Par ces témoignages, et en transition les efforts et frustrations des journalistes en butte à la censure, tout un pan de l'histoire chinoise est à nouveau dévoilé.
Il faut le dire, cette représentation de la Chine est profondément déprimante...
Chinoises, contrairement à Funérailles Célestes qui est très beau, très descriptif, est une suite, donc, de témoignages anonymes ou non reçus entre 1989 et 1997.
Xinran est journaliste pour une radio dépendante du Parti, donc surveillée et éventuellement censurée. Malgré ça, elle parvient à recueillir et diffuser ces récits parfois insoutenables de ces femmes qui ont subi, et subissent encore, la tradition chinoise de la femme soumise et qui ont vécu l'oppression de ces années de communisme.
Certaines nées de familles cultivées, puissantes, d'autres dans la pauvreté la plus totale, mais toutes liées par cette même expérience du viol, du mariage arrangé, du mépris, de la violence verbale et physique. Certaines en sont devenues folles, d'autres ont accepté et mené leur vie dans l'ombre.
Chaque récit est différent - Xinran y dévoile elle-même la vie de sa propre mère - et pourtant tous nous parlent de ces vies écrasées, niées, au fil des siècles, que ce soit dans une campagne encore très arriérée (où les femmes "s'utilisent" parfois par plusieurs frères, où elles se vendent ou s'échangent) ou dans les villes prospères et nouvellement capitalistes, où l'argent et la beauté est un atout majeur pour un mari ambitieux.
Xinran a l'art, la patience, la douceur pour exorciser ces femmes de ces drames pour les faire témoigner. La deuxième étape, l'écriture du livre, se fera ensuite lorsqu'elle s'installe à Londres, désireuse de vivre une autre vie mais de témoigner du véritable sort des femmes chinoises au monde occidental.
Par ces témoignages, et en transition les efforts et frustrations des journalistes en butte à la censure, tout un pan de l'histoire chinoise est à nouveau dévoilé.
Il faut le dire, cette représentation de la Chine est profondément déprimante...
Chinoises de Xinran fait partie de ces livres dont on se dit qu'il faut les lire, mais dont on repousse toujours la lecture parce qu'on sait que ce qu'ils racontent va nous bousculer, nous affliger une fois de plus et nous ramener à une réalité que nous n'avons pas toujours envie de ressasser.
Xinran est journaliste et a animé en Chine une émission de radio, novatrice, si j'osais je dirais "révolutionnaire" mais le terme est pour le moins galvaudé dans ce pays. Sous haute surveillance, elle donne la parole aux femmes sur l'antenne et mène en parallèle une enquête pour découvrir ce qui anime les chinoises : en quoi elles croient, qu'elles sont leurs espérances et leurs vies. Elle reçoit, au fil des émissions de plus en plus de témoignages bouleversants et de courriers qui sont pour certains, des appels au secours.
"Dans Mots sur la brise nocturne, je m'efforçais d'ouvrir une petite fenêtre, un tout petit trou, où les gens pourraient pleurer et respirer après l'atmosphère chargée de poudre de fusil des quarante années précédentes."
Alors on la suit, au fil de ses rencontres, de ses doutes et questionnements personnels sur sa propre histoire et sa propre réalité de femme dans ce pays où l'homme est roi et la femme n'est rien. Les témoignages sont bouleversants et la force, l'abnégation de ces femmes sans commune mesure. J'ai ressenti la même émotion à la lecture de "la fin de l'homme rouge" de Sveltana Alexievitch dans lequel elle nous livre également des témoignages de femmes russes.
Les choses évoluent doucement, presque imperceptiblement, et pour cause : "La Chine a une très longue histoire derrière elle, mais cela fait très peu de temps que les femmes ont pu devenir elles-mêmes et que les hommes ont commencé à les connaître vraiment."
Le poids des traditions est tellement présent, la place de la femme dans la société chinoise, comme dans beaucoup d'autres, est tellement "verrouillée", maillon dénigré, insignifiant et pourtant si essentiel que sa libération (qui n'est somme toute que la reconnaissance de ses droits et de son égalité) ne peut aller sans une déconstruction totale de la société à laquelle elle appartient. Déconstruction déjà bien amorcée par un développement économique exponentiel, que les dirigeants politiques essaient désespérément de maintenir compatible avec l'asservissement et le contrôle des populations en rêvant d'assurer l'expansion mondiale de leurs puissances (et pas seulement économique).
Est-ce la peur de cette déconstruction qui menace un équilibre millénaire où les hommes ont le "bon rôle" au sein d'une tradition qu'ils ont tout intérêt à maintenir qui expliquerait ce renforcement de l'étau, cette volonté renouvelée de l'asservissement de la femme, sous couvert de respect, dans beaucoup de pays où lui est réservée le même sort, et actuellement confrontés au bouleversement de "la mondialisation" ?
Ou n'est-ce que la conséquence logique de tout système totalitaire où les premières victimes sont toujours les femmes et les enfants (les hommes n'étant en rien épargnés non plus, même si leur sort semble toujours plus enviable) ?
Xinran est journaliste et a animé en Chine une émission de radio, novatrice, si j'osais je dirais "révolutionnaire" mais le terme est pour le moins galvaudé dans ce pays. Sous haute surveillance, elle donne la parole aux femmes sur l'antenne et mène en parallèle une enquête pour découvrir ce qui anime les chinoises : en quoi elles croient, qu'elles sont leurs espérances et leurs vies. Elle reçoit, au fil des émissions de plus en plus de témoignages bouleversants et de courriers qui sont pour certains, des appels au secours.
"Dans Mots sur la brise nocturne, je m'efforçais d'ouvrir une petite fenêtre, un tout petit trou, où les gens pourraient pleurer et respirer après l'atmosphère chargée de poudre de fusil des quarante années précédentes."
Alors on la suit, au fil de ses rencontres, de ses doutes et questionnements personnels sur sa propre histoire et sa propre réalité de femme dans ce pays où l'homme est roi et la femme n'est rien. Les témoignages sont bouleversants et la force, l'abnégation de ces femmes sans commune mesure. J'ai ressenti la même émotion à la lecture de "la fin de l'homme rouge" de Sveltana Alexievitch dans lequel elle nous livre également des témoignages de femmes russes.
Les choses évoluent doucement, presque imperceptiblement, et pour cause : "La Chine a une très longue histoire derrière elle, mais cela fait très peu de temps que les femmes ont pu devenir elles-mêmes et que les hommes ont commencé à les connaître vraiment."
Le poids des traditions est tellement présent, la place de la femme dans la société chinoise, comme dans beaucoup d'autres, est tellement "verrouillée", maillon dénigré, insignifiant et pourtant si essentiel que sa libération (qui n'est somme toute que la reconnaissance de ses droits et de son égalité) ne peut aller sans une déconstruction totale de la société à laquelle elle appartient. Déconstruction déjà bien amorcée par un développement économique exponentiel, que les dirigeants politiques essaient désespérément de maintenir compatible avec l'asservissement et le contrôle des populations en rêvant d'assurer l'expansion mondiale de leurs puissances (et pas seulement économique).
Est-ce la peur de cette déconstruction qui menace un équilibre millénaire où les hommes ont le "bon rôle" au sein d'une tradition qu'ils ont tout intérêt à maintenir qui expliquerait ce renforcement de l'étau, cette volonté renouvelée de l'asservissement de la femme, sous couvert de respect, dans beaucoup de pays où lui est réservée le même sort, et actuellement confrontés au bouleversement de "la mondialisation" ?
Ou n'est-ce que la conséquence logique de tout système totalitaire où les premières victimes sont toujours les femmes et les enfants (les hommes n'étant en rien épargnés non plus, même si leur sort semble toujours plus enviable) ?
Lu dans le cadre de mes études il y a quelques années, Chinoises m'a permis de découvrir des facettes de la Chine que je ne connaissais pas encore. Témoignages et interview recueillies par Xinran nous font partager la vie de plusieurs chinoises issues de toutes les classes sociales et de toutes les générations. Bien que j'ai pu découvrir d'autres facettes de la femme chinoise depuis (entre autres que dans un couple chinois, l'homme ne dirige que lorsqu'il y a d'autres personnes présentent, pour ne pas perdre la face, sinon c'est madame qui décide de tout) ce livre nous montre tout de même plutôt bien que la vie de la femme chinoise de nos jours est un défi quotidien.
Sans être un coup ce coeur, ce livre reste très touchant, étonnant, percutant, bref il ouvre l'esprit et les yeux à des choses que l'on ne connait peut-être pas, et en plus il se lit très bien.
Sans être un coup ce coeur, ce livre reste très touchant, étonnant, percutant, bref il ouvre l'esprit et les yeux à des choses que l'on ne connait peut-être pas, et en plus il se lit très bien.
Citations et extraits (137)
Voir plus
Ajouter une citation
Un jour, j’étais recroquevillée au fond de la classe à pleurer parce que les
enfants de « rouges » m’avaient rossée. Je croyais être seule, et j’ai été
étonnée quand l’un de mes professeurs s’est approché de moi par-derrière et
m’a tapoté légèrement l’épaule. A travers mes larmes, il m’était difficile de
lire l’expression de son visage à la faible lumière de la lampe, mais j’ai vu
qu’il me faisait signe de le suivre. J’avais confiance en lui parce que je
savais qu’il aidait des gens pauvres à l’extérieur de l’école.
Il m’a conduite jusqu’à une cabane au bord du terrain de jeux, où l’école
entassait du matériel au rebut. Il a ouvert la serrure d’un geste vif et m’a
poussée à l’intérieur. La fenêtre était obturée avec des journaux, et il faisait
très sombre. La pièce était remplie jusqu’au plafond d’un fouillis de choses
dépareillées et sentait le moisi et la pourriture. Je me suis raidie de dégoût,
mais le professeur s’est frayé un chemin dans ce labyrinthe avec une
aisance qui dénotait une longue habitude. Je l’ai suivi du mieux que j’ai pu.
Au centre de la pièce, j’ai été stupéfaite de trouver une bibliothèque
complète, en ordre. Plusieurs centaines de livres étaient rangés sur des
planches cassées. Pour la première fois, j’ai compris le sens de ce vers
célèbre : « Dans l’ombre la plus épaisse des saules, je découvris soudain les
fleurs brillantes d’un village. »
Le professeur m’a dit que cette bibliothèque était un secret qu’il gardait en
cadeau pour les générations futures. Peu importe ce qu’en pensent les
révolutionnaires, a-t-il dit, les gens ne peuvent se passer de livres. Sans
livres, nous ne pourrions pas comprendre le monde ; sans livres, nous ne
pourrions pas évoluer ; sans livres, la nature ne pourrait pas servir
l’humanité ; plus il parlait, plus son enthousiasme se communiquait à moi,
et plus j’avais peur. Je savais que c’étaient justement ces livres-là que la
Révolution culturelle s’efforçait de détruire. Le professeur m’a donné une
clef de la cabane en me disant que je pourrais m’y réfugier et y lire quand je
voulais.
La cabane se trouvait derrière les seules toilettes de l’école, aussi m’était-il
facile de m’y rendre sans me faire remarquer quand les autres enfants
participaient à des activités dont j’étais exclue.
Lors de mes premières visites à la cabane, j’ai trouvé l’odeur et l’obscurité
étouffantes, et j’ai foré un petit trou de la taille d’un pois dans les journaux
qui recouvraient la fenêtre. Je pouvais y coller un œil et regarder les enfants
jouer, en rêvant du jour où il me serait permis de me joindre à eux.
Mais la mêlée sur le terrain de jeux m’attristait tant que j’ai fini par me
mettre à lire. Il n’y avait pas beaucoup de livres faciles à lire et j’avais bien
de mal à comprendre le vocabulaire. Au début, le professeur répondait à
mes questions et m’expliquait des choses quand il venait voir si tout allait
bien ; puis il m’a apporté un dictionnaire, que je consultais
consciencieusement, même si je comprenais à peine la moitié de ce que je
lisais.
Les livres sur l’histoire de la Chine et des autres pays me fascinaient. Ils
m’ont beaucoup appris sur la vie : non seulement sur la « grande histoire »
que chacun connaît, mais aussi sur les gens simples qui tissent leur propre
histoire au jour le jour. Ces livres m’ont aussi enseigné que beaucoup de
questions restent sans réponses.
J’ai beaucoup appris de l’encyclopédie, ce qui m’a épargné bien des soucis
et des dépenses par la suite, car je suis habile de mes mains et je sais réparer
seule toutes sortes de choses, des bicyclettes jusqu’aux petites pannes
électriques. Je rêvais de devenir diplomate, avocate, journaliste ou écrivain.
Quand l’opportunité de choisir une profession s’est présentée, j’ai quitté
mon travail administratif dans l’armée, au bout de douze ans, pour devenir
journaliste. Le savoir latent que j’avais accumulé dans mon enfance est
venu une fois de plus à mon secours.
Le rêve que j’entretenais de rejoindre les autres enfants sur le terrain de
jeux ne s’est jamais réalisé, mais je me suis consolée à la lecture de récits
de batailles et d’effusions de sang dans cette bibliothèque secrète. Les
chroniques de guerre me donnaient le sentiment d’avoir de la chance de
vivre en temps de paix, et m’ont aidée à oublier les brimades qui
m’attendaient à l’extérieur de la cabane.
enfants de « rouges » m’avaient rossée. Je croyais être seule, et j’ai été
étonnée quand l’un de mes professeurs s’est approché de moi par-derrière et
m’a tapoté légèrement l’épaule. A travers mes larmes, il m’était difficile de
lire l’expression de son visage à la faible lumière de la lampe, mais j’ai vu
qu’il me faisait signe de le suivre. J’avais confiance en lui parce que je
savais qu’il aidait des gens pauvres à l’extérieur de l’école.
Il m’a conduite jusqu’à une cabane au bord du terrain de jeux, où l’école
entassait du matériel au rebut. Il a ouvert la serrure d’un geste vif et m’a
poussée à l’intérieur. La fenêtre était obturée avec des journaux, et il faisait
très sombre. La pièce était remplie jusqu’au plafond d’un fouillis de choses
dépareillées et sentait le moisi et la pourriture. Je me suis raidie de dégoût,
mais le professeur s’est frayé un chemin dans ce labyrinthe avec une
aisance qui dénotait une longue habitude. Je l’ai suivi du mieux que j’ai pu.
Au centre de la pièce, j’ai été stupéfaite de trouver une bibliothèque
complète, en ordre. Plusieurs centaines de livres étaient rangés sur des
planches cassées. Pour la première fois, j’ai compris le sens de ce vers
célèbre : « Dans l’ombre la plus épaisse des saules, je découvris soudain les
fleurs brillantes d’un village. »
Le professeur m’a dit que cette bibliothèque était un secret qu’il gardait en
cadeau pour les générations futures. Peu importe ce qu’en pensent les
révolutionnaires, a-t-il dit, les gens ne peuvent se passer de livres. Sans
livres, nous ne pourrions pas comprendre le monde ; sans livres, nous ne
pourrions pas évoluer ; sans livres, la nature ne pourrait pas servir
l’humanité ; plus il parlait, plus son enthousiasme se communiquait à moi,
et plus j’avais peur. Je savais que c’étaient justement ces livres-là que la
Révolution culturelle s’efforçait de détruire. Le professeur m’a donné une
clef de la cabane en me disant que je pourrais m’y réfugier et y lire quand je
voulais.
La cabane se trouvait derrière les seules toilettes de l’école, aussi m’était-il
facile de m’y rendre sans me faire remarquer quand les autres enfants
participaient à des activités dont j’étais exclue.
Lors de mes premières visites à la cabane, j’ai trouvé l’odeur et l’obscurité
étouffantes, et j’ai foré un petit trou de la taille d’un pois dans les journaux
qui recouvraient la fenêtre. Je pouvais y coller un œil et regarder les enfants
jouer, en rêvant du jour où il me serait permis de me joindre à eux.
Mais la mêlée sur le terrain de jeux m’attristait tant que j’ai fini par me
mettre à lire. Il n’y avait pas beaucoup de livres faciles à lire et j’avais bien
de mal à comprendre le vocabulaire. Au début, le professeur répondait à
mes questions et m’expliquait des choses quand il venait voir si tout allait
bien ; puis il m’a apporté un dictionnaire, que je consultais
consciencieusement, même si je comprenais à peine la moitié de ce que je
lisais.
Les livres sur l’histoire de la Chine et des autres pays me fascinaient. Ils
m’ont beaucoup appris sur la vie : non seulement sur la « grande histoire »
que chacun connaît, mais aussi sur les gens simples qui tissent leur propre
histoire au jour le jour. Ces livres m’ont aussi enseigné que beaucoup de
questions restent sans réponses.
J’ai beaucoup appris de l’encyclopédie, ce qui m’a épargné bien des soucis
et des dépenses par la suite, car je suis habile de mes mains et je sais réparer
seule toutes sortes de choses, des bicyclettes jusqu’aux petites pannes
électriques. Je rêvais de devenir diplomate, avocate, journaliste ou écrivain.
Quand l’opportunité de choisir une profession s’est présentée, j’ai quitté
mon travail administratif dans l’armée, au bout de douze ans, pour devenir
journaliste. Le savoir latent que j’avais accumulé dans mon enfance est
venu une fois de plus à mon secours.
Le rêve que j’entretenais de rejoindre les autres enfants sur le terrain de
jeux ne s’est jamais réalisé, mais je me suis consolée à la lecture de récits
de batailles et d’effusions de sang dans cette bibliothèque secrète. Les
chroniques de guerre me donnaient le sentiment d’avoir de la chance de
vivre en temps de paix, et m’ont aidée à oublier les brimades qui
m’attendaient à l’extérieur de la cabane.
Le ciel et la terre semblaient s’être mélangés. Le soleil n’était pas encore
levé, mais sa lumière se déversait déjà au loin sur cette toile immense,
effleurant les pierres sur les collines et faisant étinceler l’or de la terre d’un
jaune gris. Je n’avais jamais contemplé plus belle aurore. Je me suis dit que
le tourisme pourrait peut-être aider cette région à sortir de sa pauvreté. Le
splendide lever de soleil sur ce plateau de lœss devrait enchanter ceux qui
escaladaient le mont Tai ou se ruaient au bord de la mer. Quand j’ai évoqué
cette idée par la suite, un jeune garçon l’a repoussée comme procédant de
l’ignorance : Colline Hurlante n’avait pas assez d’eau pour pourvoir aux
besoins quotidiens les plus élémentaires des villageois, comment ferait-on
pour satisfaire une foule de visiteurs ?
Les vapeurs étouffantes du feu de la jeune fille m’ont tirée de ma rêverie.
La bouse de vache qu’elle utilisait comme combustible exhalait une odeur
âcre. Le feu avait été allumé entre des grandes pierres, sur lesquelles la
jeune fille avait disposé un pot et une pierre plate. Elle a confectionné un
gruau de farine dans le pot, et grillé un grossier pain plat sur la pierre. Elle
s’appelait Niu’er (fille). Elle m’a expliqué que la bouse était leur seul
moyen de chauffage pendant l’hiver. A l’occasion, lors d’un deuil ou un
mariage, ou quand de la famille ou des amis leur rendaient visite, ils
faisaient la cuisine sur des feux de bouses comme expression solennelle de
leur amitié. Le combustible habituel se composait de racines de l’herbe
cogon (une plante de sol aride qui a de grandes racines et de rares feuilles
qui restent vivaces peu de temps), avec lesquelles ils chauffaient une toute
petite quantité d’eau pour le gruau. On ne cuisait le pain plat, le mo, qu’une
fois par an, sur les pierres brûlantes de la colline, l’été. On le conservait
sous terre et il était si sec et si dur qu’il se gardait presque un an. On m’a
fait l’honneur de me servir du mo. Seuls les hommes qui travaillaient aux
champs avaient le droit d’en manger. Les femmes et les enfants se
nourrissaient de gruau de blé clair – des années de survie les avaient
accoutumés à la faim. Le plus grand honneur et festin de la vie d’une
femme consistait en un bol d’œufs mélangés à de l’eau quand elle mettait
au monde un fils. A un autre moment de mon séjour, je m’en suis souvenue
quand j’ai entendu une femme se disputant avec une autre : « Et combien de
bols d’œufs et d’eau peux-tu te vanter d’avoir mangé ? » disait-elle.
Après ce petit-déjeuner exceptionnel de gruau et de mo le premier jour,
notre groupe s’est mis au travail. J’ai expliqué aux responsables du village
que je voulais faire un reportage sur les femmes de Colline Hurlante. Ces
hommes, qui ne savaient même pas écrire leur nom mais se considéraient
comme cultivés, ont secoué la tête, stupéfaits : « Que peut-il y avoir à dire
sur les femmes ? »
Je leur ai tenu tête, et ils ont fini par céder. Pour eux, je n’étais qu’une
femme comme une autre, qui ne comprenait rien mais imitait les hommes
en essayant de les impressionner par son originalité. Leur réticence ne me
gênait pas. Mon expérience de journaliste, après toutes ces années, m’avait
enseigné que l’accès aux sources était plus important que l’opinion que les
autres pouvaient avoir de moi.
Colline Hurlante est située dans une ceinture de terre où le désert empiète
sur le plateau de lœss. Tout au long de l’année, le vent souffle
inlassablement, depuis des milliers d’années. Il est souvent difficile de voir
plus loin qu’à quelques pas dans ces tempêtes de sable, et les villageois qui
peinent sur la colline sont obligés de crier pour se parler. C’est pour cela
que les gens de Colline Hurlante sont célèbres pour leurs voix fortes et
sonores ; personne n’a pu me confirmer si c’était de là que venait le nom du
village, mais selon moi c’est une explication plausible. C’est un lieu
totalement coupé du monde moderne ; entre dix et vingt familles avec
seulement quatre patronymes vivent dans des habitations troglodytes
exiguës au plafond bas. Les femmes n’ont qu’une valeur utilitaire ; en tant
qu’instruments de reproduction, elles sont une monnaie d’échange très
précieuse pour les villageois. Les hommes n’hésitent pas à échanger deux
ou trois fillettes contre une femme d’un autre village. Donner en mariage
une femme de la famille à un autre village et acquérir une épouse en
échange est la pratique la plus courante, et en conséquence la majorité des
épouses de Colline Hurlante viennent de l’extérieur du village. Une fois
mères, elles sont forcées de céder leurs propres filles à leur tour. Les
femmes n’ont aucun droit de propriété ou d’héritage.
La pratique sociale inhabituelle qui consiste à partager une épouse entre
plusieurs hommes existe aussi. Dans la majorité des cas, des frères issus de
familles extrêmement pauvres, sans filles à échanger, achètent une épouse
commune pour assurer leur descendance. Le jour, elle prépare la nourriture
et s’occupe des travaux ménagers, et la nuit, ils jouissent de son corps tour à
tour. Si la femme a un enfant, elle ne sait pas toujours elle-même qui en est
le père. Pour l’enfant, les frères sont Grand Papa, Deuxième Papa,
Troisième, Quatrième Papa et ainsi de suite. Les villageois ne considèrent
pas cette pratique comme illégale, parce que c’est une coutume établie par
leurs ancêtres, ce qui la rend à leurs yeux plus puissante que la loi. Les
enfants qui ont plusieurs pères ne sont pas en butte aux moqueries, car ils
sont sous la protection de plusieurs hommes. Nul ne ressent de compassion
pour les épouses ainsi partagées ; pour eux, l’existence des femmes se
justifie par leur utilité.
La pratique sociale inhabituelle qui consiste à partager une épouse entre
plusieurs hommes existe aussi. Dans la majorité des cas, des frères issus de
familles extrêmement pauvres, sans filles à échanger, achètent une épouse
commune pour assurer leur descendance. Le jour, elle prépare la nourriture
et s’occupe des travaux ménagers, et la nuit, ils jouissent de son corps tour à
tour. Si la femme a un enfant, elle ne sait pas toujours elle-même qui en est
le père. Pour l’enfant, les frères sont Grand Papa, Deuxième Papa,
Troisième, Quatrième Papa et ainsi de suite. Les villageois ne considèrent
pas cette pratique comme illégale, parce que c’est une coutume établie par
leurs ancêtres, ce qui la rend à leurs yeux plus puissante que la loi. Les
enfants qui ont plusieurs pères ne sont pas en butte aux moqueries, car ils
sont sous la protection de plusieurs hommes. Nul ne ressent de compassion
pour les épouses ainsi partagées ; pour eux, l’existence des femmes se
justifie par leur utilité.
Quel que soit le village dont sont originaires les femmes, elles adoptent les
coutumes transmises de génération en génération à Colline Hurlante. Elles
mènent une vie extrêmement dure. Dans l’unique pièce de leur maison
troglodyte, dont la moitié est occupée par un kang, elles ne disposent que de
quelques dalles de pierre, de nattes de paille et de bols d’argile grossiers ;
une cruche en terre cuite est un article de luxe réservé aux familles
« riches ». Des jouets d’enfants ou des articles réservés à l’usage exclusif
des femmes sont impensables dans leur société. Comme les épouses sont
achetées avec le sang de la parenté, elles sont en butte au ressentiment des
membres de la famille qui ont perdu des filles ou des sœurs, et doivent
peiner jour et nuit pour assurer la nourriture, la boisson et les autres besoins
quotidiens de toute la maisonnée.
levé, mais sa lumière se déversait déjà au loin sur cette toile immense,
effleurant les pierres sur les collines et faisant étinceler l’or de la terre d’un
jaune gris. Je n’avais jamais contemplé plus belle aurore. Je me suis dit que
le tourisme pourrait peut-être aider cette région à sortir de sa pauvreté. Le
splendide lever de soleil sur ce plateau de lœss devrait enchanter ceux qui
escaladaient le mont Tai ou se ruaient au bord de la mer. Quand j’ai évoqué
cette idée par la suite, un jeune garçon l’a repoussée comme procédant de
l’ignorance : Colline Hurlante n’avait pas assez d’eau pour pourvoir aux
besoins quotidiens les plus élémentaires des villageois, comment ferait-on
pour satisfaire une foule de visiteurs ?
Les vapeurs étouffantes du feu de la jeune fille m’ont tirée de ma rêverie.
La bouse de vache qu’elle utilisait comme combustible exhalait une odeur
âcre. Le feu avait été allumé entre des grandes pierres, sur lesquelles la
jeune fille avait disposé un pot et une pierre plate. Elle a confectionné un
gruau de farine dans le pot, et grillé un grossier pain plat sur la pierre. Elle
s’appelait Niu’er (fille). Elle m’a expliqué que la bouse était leur seul
moyen de chauffage pendant l’hiver. A l’occasion, lors d’un deuil ou un
mariage, ou quand de la famille ou des amis leur rendaient visite, ils
faisaient la cuisine sur des feux de bouses comme expression solennelle de
leur amitié. Le combustible habituel se composait de racines de l’herbe
cogon (une plante de sol aride qui a de grandes racines et de rares feuilles
qui restent vivaces peu de temps), avec lesquelles ils chauffaient une toute
petite quantité d’eau pour le gruau. On ne cuisait le pain plat, le mo, qu’une
fois par an, sur les pierres brûlantes de la colline, l’été. On le conservait
sous terre et il était si sec et si dur qu’il se gardait presque un an. On m’a
fait l’honneur de me servir du mo. Seuls les hommes qui travaillaient aux
champs avaient le droit d’en manger. Les femmes et les enfants se
nourrissaient de gruau de blé clair – des années de survie les avaient
accoutumés à la faim. Le plus grand honneur et festin de la vie d’une
femme consistait en un bol d’œufs mélangés à de l’eau quand elle mettait
au monde un fils. A un autre moment de mon séjour, je m’en suis souvenue
quand j’ai entendu une femme se disputant avec une autre : « Et combien de
bols d’œufs et d’eau peux-tu te vanter d’avoir mangé ? » disait-elle.
Après ce petit-déjeuner exceptionnel de gruau et de mo le premier jour,
notre groupe s’est mis au travail. J’ai expliqué aux responsables du village
que je voulais faire un reportage sur les femmes de Colline Hurlante. Ces
hommes, qui ne savaient même pas écrire leur nom mais se considéraient
comme cultivés, ont secoué la tête, stupéfaits : « Que peut-il y avoir à dire
sur les femmes ? »
Je leur ai tenu tête, et ils ont fini par céder. Pour eux, je n’étais qu’une
femme comme une autre, qui ne comprenait rien mais imitait les hommes
en essayant de les impressionner par son originalité. Leur réticence ne me
gênait pas. Mon expérience de journaliste, après toutes ces années, m’avait
enseigné que l’accès aux sources était plus important que l’opinion que les
autres pouvaient avoir de moi.
Colline Hurlante est située dans une ceinture de terre où le désert empiète
sur le plateau de lœss. Tout au long de l’année, le vent souffle
inlassablement, depuis des milliers d’années. Il est souvent difficile de voir
plus loin qu’à quelques pas dans ces tempêtes de sable, et les villageois qui
peinent sur la colline sont obligés de crier pour se parler. C’est pour cela
que les gens de Colline Hurlante sont célèbres pour leurs voix fortes et
sonores ; personne n’a pu me confirmer si c’était de là que venait le nom du
village, mais selon moi c’est une explication plausible. C’est un lieu
totalement coupé du monde moderne ; entre dix et vingt familles avec
seulement quatre patronymes vivent dans des habitations troglodytes
exiguës au plafond bas. Les femmes n’ont qu’une valeur utilitaire ; en tant
qu’instruments de reproduction, elles sont une monnaie d’échange très
précieuse pour les villageois. Les hommes n’hésitent pas à échanger deux
ou trois fillettes contre une femme d’un autre village. Donner en mariage
une femme de la famille à un autre village et acquérir une épouse en
échange est la pratique la plus courante, et en conséquence la majorité des
épouses de Colline Hurlante viennent de l’extérieur du village. Une fois
mères, elles sont forcées de céder leurs propres filles à leur tour. Les
femmes n’ont aucun droit de propriété ou d’héritage.
La pratique sociale inhabituelle qui consiste à partager une épouse entre
plusieurs hommes existe aussi. Dans la majorité des cas, des frères issus de
familles extrêmement pauvres, sans filles à échanger, achètent une épouse
commune pour assurer leur descendance. Le jour, elle prépare la nourriture
et s’occupe des travaux ménagers, et la nuit, ils jouissent de son corps tour à
tour. Si la femme a un enfant, elle ne sait pas toujours elle-même qui en est
le père. Pour l’enfant, les frères sont Grand Papa, Deuxième Papa,
Troisième, Quatrième Papa et ainsi de suite. Les villageois ne considèrent
pas cette pratique comme illégale, parce que c’est une coutume établie par
leurs ancêtres, ce qui la rend à leurs yeux plus puissante que la loi. Les
enfants qui ont plusieurs pères ne sont pas en butte aux moqueries, car ils
sont sous la protection de plusieurs hommes. Nul ne ressent de compassion
pour les épouses ainsi partagées ; pour eux, l’existence des femmes se
justifie par leur utilité.
La pratique sociale inhabituelle qui consiste à partager une épouse entre
plusieurs hommes existe aussi. Dans la majorité des cas, des frères issus de
familles extrêmement pauvres, sans filles à échanger, achètent une épouse
commune pour assurer leur descendance. Le jour, elle prépare la nourriture
et s’occupe des travaux ménagers, et la nuit, ils jouissent de son corps tour à
tour. Si la femme a un enfant, elle ne sait pas toujours elle-même qui en est
le père. Pour l’enfant, les frères sont Grand Papa, Deuxième Papa,
Troisième, Quatrième Papa et ainsi de suite. Les villageois ne considèrent
pas cette pratique comme illégale, parce que c’est une coutume établie par
leurs ancêtres, ce qui la rend à leurs yeux plus puissante que la loi. Les
enfants qui ont plusieurs pères ne sont pas en butte aux moqueries, car ils
sont sous la protection de plusieurs hommes. Nul ne ressent de compassion
pour les épouses ainsi partagées ; pour eux, l’existence des femmes se
justifie par leur utilité.
Quel que soit le village dont sont originaires les femmes, elles adoptent les
coutumes transmises de génération en génération à Colline Hurlante. Elles
mènent une vie extrêmement dure. Dans l’unique pièce de leur maison
troglodyte, dont la moitié est occupée par un kang, elles ne disposent que de
quelques dalles de pierre, de nattes de paille et de bols d’argile grossiers ;
une cruche en terre cuite est un article de luxe réservé aux familles
« riches ». Des jouets d’enfants ou des articles réservés à l’usage exclusif
des femmes sont impensables dans leur société. Comme les épouses sont
achetées avec le sang de la parenté, elles sont en butte au ressentiment des
membres de la famille qui ont perdu des filles ou des sœurs, et doivent
peiner jour et nuit pour assurer la nourriture, la boisson et les autres besoins
quotidiens de toute la maisonnée.
Je suis née à Pékin en 1958, quand la Chine était si pauvre que la ration de
nourriture pour un jour consistait en une poignée de pois. Tandis que
d’autres enfants de mon âge avaient froid et faim, je mangeais des chocolats
d’importation dans la maison de ma grand-mère, dont la cour était fleurie et
remplie du chant des oiseaux. Mais la Chine s’apprêtait à abolir les
distinctions entre riches et pauvres, à sa manière unique, politique. Les
enfants qui avaient survécu à la pauvreté et aux privations allaient me traiter
avec mépris et m’insulter ; bientôt les richesses matérielles dont j’avais joui
autrefois seraient plus qu’amplement compensées par des souffrances
immatérielles. Il m’a bien fallu comprendre qu’il y avait dans la vie des
choses plus importantes que le chocolat.
Quand j’étais petite, ma grand-mère peignait et tressait mes cheveux tous
les jours en nattes bien unies et régulières avant de nouer un ruban à chaque
bout. J’étais extrêmement fière de mes nattes, et je secouais la tête avec
orgueil quand je marchais ou jouais. A l’heure du coucher, je ne laissais pas
ma grand-mère dénouer les rubans, et je plaçais mes nattes soigneusement
de chaque côté de l’oreiller avant de m’endormir. Parfois, en me levant le
matin et en trouvant mes nœuds défaits, je demandais d’un ton boudeur qui
avait détruit leur belle ordonnance.
Mes parents avaient été affectés à une base militaire près de la Grande
Muraille. A l’âge de sept ans, je les ai rejoints pour vivre avec eux, pour la
première fois depuis ma naissance. Moins d’une quinzaine de jours après
mon arrivée, les gardes rouges ont perquisitionné chez nous. Ils
soupçonnaient mon père d’être « un intellectuel réactionnaire » parce qu’il
était membre de l’Association chinoise des ingénieurs en mécanique de
haut niveau. On prétendait aussi que c’était « un laquais de l’impérialisme
anglais » parce que son père avait travaillé pour la firme britannique gec
pendant trente-cinq ans. En plus de cela, parce que notre maison contenait
des objets d’art, mon père a été accusé d’être « un représentant du
féodalisme, du capitalisme et du révisionnisme ».
Je me souviens de l’essaim de gardes rouges envahissant la maison et d’un
grand feu dans notre cour où ils jetaient les livres de mon père, les précieux
meubles traditionnels de mes grands-parents et mes jouets. Ils ont arrêté et
emmené mon père. Effrayée et triste, je suis tombée dans une sorte de
stupeur en regardant le feu, j’avais l’impression d’entendre dans les
flammes des voix crier à l’aide. Le feu a tout consumé : la maison que je
venais tout juste de m’approprier, mon enfance jusque-là heureuse, mes
espoirs et la fierté que ma famille mettait en son savoir et ses richesses. Il a
imprimé en moi des regrets dont la brûlure ne se cicatrisera pas jusqu’à ma
mort.
A la lumière du feu, une fille portant un brassard rouge s’est avancée vers
moi, une grande paire de ciseaux à la main. Elle a empoigné mes tresses et a
décrété : « C’est un style de coiffure petit-bourgeois. »
Avant que je comprenne de quoi elle parlait, elle avait coupé mes tresses et
les avait jetées dans le feu. Figée sur place, j’ai regardé, les yeux
écarquillés, mes nattes et leurs jolis nœuds se transformer en cendres.
Quand les gardes rouges sont partis, la fille qui avait coupé mes nattes m’a
dit : « Dorénavant, il t’est interdit de nouer tes cheveux avec des rubans.
C’est une coiffure impérialiste ! »
Mon père en prison, ma mère n’avait plus le temps de s’occuper de nous.
Elle rentrait toujours tard, et quand elle restait à la maison, elle était
toujours en train d’écrire ; ce qu’elle écrivait, je l’ignorais. Mon frère et moi
ne pouvions acheter de la nourriture qu’à la cantine de l’unité de travail de
notre père où ils servaient un maigre ordinaire de navets ou de choux
bouillis. L’huile de friture était une denrée rare alors.
Un jour, ma mère a rapporté à la maison un morceau de poitrine de porc et
elle a préparé un ragoût pour nous dans la nuit. Le lendemain, avant de
partir travailler, elle m’a dit : « Quand tu rentreras, attise les charbons et
réchauffe le porc pour le déjeuner. Ne m’en laissez pas. Vous avez besoin de
manger, tous les deux. »
A mon retour de l’école à midi, je suis allée chercher mon frère chez une
voisine qui le gardait. Quand je lui ai dit qu’il allait avoir quelque chose de
bon à manger, il était tout content et il s’est assis docilement à table pour
me regarder réchauffer la nourriture.
Notre poêle était un haut fourneau en brique d’un type courant dans le
nord, et pour attiser le charbon avec un tisonnier, il fallait que je grimpe sur
un tabouret. C’était la première fois que je faisais cela toute seule. Je n’ai
pas compris que le tisonnier allait prendre la chaleur du fourneau, et comme
j’avais du mal à le retirer de la main droite, je l’ai agrippé fermement de la
gauche. La peau de ma paume a gonflé et s’est détachée et j’ai hurlé de
douleur.
La voisine est accourue quand elle m’a entendue. Elle a appelé un médecin
qui habitait non loin de là, mais il lui a dit qu’il n’osait pas venir sans
certificat, il lui fallait une permission spéciale pour aller voir à domicile
ceux qui faisaient l’objet d’une enquête.
Un autre voisin, un vieux professeur, a dit qu’il fallait frotter les brûlures
avec de la sauce de soja et il en a versé toute une bouteille sur ma main ; la
douleur était si insupportable que je me suis écroulée et tortillée sur le sol
dans tous les sens avant de m’évanouir.
Quand je suis revenue à moi, j’étais couchée et ma mère, assise à mon
chevet, tenait ma main gauche bandée dans les siennes, en se reprochant de
m’avoir demandé de me servir du poêle.
Aujourd’hui encore, j’ai du mal à comprendre comment ce médecin a pu
invoquer le statut politique de notre famille pour refuser de me porter
secours.
En tant que « membre d’un foyer capitaliste », ma mère a été bientôt
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer penda
nourriture pour un jour consistait en une poignée de pois. Tandis que
d’autres enfants de mon âge avaient froid et faim, je mangeais des chocolats
d’importation dans la maison de ma grand-mère, dont la cour était fleurie et
remplie du chant des oiseaux. Mais la Chine s’apprêtait à abolir les
distinctions entre riches et pauvres, à sa manière unique, politique. Les
enfants qui avaient survécu à la pauvreté et aux privations allaient me traiter
avec mépris et m’insulter ; bientôt les richesses matérielles dont j’avais joui
autrefois seraient plus qu’amplement compensées par des souffrances
immatérielles. Il m’a bien fallu comprendre qu’il y avait dans la vie des
choses plus importantes que le chocolat.
Quand j’étais petite, ma grand-mère peignait et tressait mes cheveux tous
les jours en nattes bien unies et régulières avant de nouer un ruban à chaque
bout. J’étais extrêmement fière de mes nattes, et je secouais la tête avec
orgueil quand je marchais ou jouais. A l’heure du coucher, je ne laissais pas
ma grand-mère dénouer les rubans, et je plaçais mes nattes soigneusement
de chaque côté de l’oreiller avant de m’endormir. Parfois, en me levant le
matin et en trouvant mes nœuds défaits, je demandais d’un ton boudeur qui
avait détruit leur belle ordonnance.
Mes parents avaient été affectés à une base militaire près de la Grande
Muraille. A l’âge de sept ans, je les ai rejoints pour vivre avec eux, pour la
première fois depuis ma naissance. Moins d’une quinzaine de jours après
mon arrivée, les gardes rouges ont perquisitionné chez nous. Ils
soupçonnaient mon père d’être « un intellectuel réactionnaire » parce qu’il
était membre de l’Association chinoise des ingénieurs en mécanique de
haut niveau. On prétendait aussi que c’était « un laquais de l’impérialisme
anglais » parce que son père avait travaillé pour la firme britannique gec
pendant trente-cinq ans. En plus de cela, parce que notre maison contenait
des objets d’art, mon père a été accusé d’être « un représentant du
féodalisme, du capitalisme et du révisionnisme ».
Je me souviens de l’essaim de gardes rouges envahissant la maison et d’un
grand feu dans notre cour où ils jetaient les livres de mon père, les précieux
meubles traditionnels de mes grands-parents et mes jouets. Ils ont arrêté et
emmené mon père. Effrayée et triste, je suis tombée dans une sorte de
stupeur en regardant le feu, j’avais l’impression d’entendre dans les
flammes des voix crier à l’aide. Le feu a tout consumé : la maison que je
venais tout juste de m’approprier, mon enfance jusque-là heureuse, mes
espoirs et la fierté que ma famille mettait en son savoir et ses richesses. Il a
imprimé en moi des regrets dont la brûlure ne se cicatrisera pas jusqu’à ma
mort.
A la lumière du feu, une fille portant un brassard rouge s’est avancée vers
moi, une grande paire de ciseaux à la main. Elle a empoigné mes tresses et a
décrété : « C’est un style de coiffure petit-bourgeois. »
Avant que je comprenne de quoi elle parlait, elle avait coupé mes tresses et
les avait jetées dans le feu. Figée sur place, j’ai regardé, les yeux
écarquillés, mes nattes et leurs jolis nœuds se transformer en cendres.
Quand les gardes rouges sont partis, la fille qui avait coupé mes nattes m’a
dit : « Dorénavant, il t’est interdit de nouer tes cheveux avec des rubans.
C’est une coiffure impérialiste ! »
Mon père en prison, ma mère n’avait plus le temps de s’occuper de nous.
Elle rentrait toujours tard, et quand elle restait à la maison, elle était
toujours en train d’écrire ; ce qu’elle écrivait, je l’ignorais. Mon frère et moi
ne pouvions acheter de la nourriture qu’à la cantine de l’unité de travail de
notre père où ils servaient un maigre ordinaire de navets ou de choux
bouillis. L’huile de friture était une denrée rare alors.
Un jour, ma mère a rapporté à la maison un morceau de poitrine de porc et
elle a préparé un ragoût pour nous dans la nuit. Le lendemain, avant de
partir travailler, elle m’a dit : « Quand tu rentreras, attise les charbons et
réchauffe le porc pour le déjeuner. Ne m’en laissez pas. Vous avez besoin de
manger, tous les deux. »
A mon retour de l’école à midi, je suis allée chercher mon frère chez une
voisine qui le gardait. Quand je lui ai dit qu’il allait avoir quelque chose de
bon à manger, il était tout content et il s’est assis docilement à table pour
me regarder réchauffer la nourriture.
Notre poêle était un haut fourneau en brique d’un type courant dans le
nord, et pour attiser le charbon avec un tisonnier, il fallait que je grimpe sur
un tabouret. C’était la première fois que je faisais cela toute seule. Je n’ai
pas compris que le tisonnier allait prendre la chaleur du fourneau, et comme
j’avais du mal à le retirer de la main droite, je l’ai agrippé fermement de la
gauche. La peau de ma paume a gonflé et s’est détachée et j’ai hurlé de
douleur.
La voisine est accourue quand elle m’a entendue. Elle a appelé un médecin
qui habitait non loin de là, mais il lui a dit qu’il n’osait pas venir sans
certificat, il lui fallait une permission spéciale pour aller voir à domicile
ceux qui faisaient l’objet d’une enquête.
Un autre voisin, un vieux professeur, a dit qu’il fallait frotter les brûlures
avec de la sauce de soja et il en a versé toute une bouteille sur ma main ; la
douleur était si insupportable que je me suis écroulée et tortillée sur le sol
dans tous les sens avant de m’évanouir.
Quand je suis revenue à moi, j’étais couchée et ma mère, assise à mon
chevet, tenait ma main gauche bandée dans les siennes, en se reprochant de
m’avoir demandé de me servir du poêle.
Aujourd’hui encore, j’ai du mal à comprendre comment ce médecin a pu
invoquer le statut politique de notre famille pour refuser de me porter
secours.
En tant que « membre d’un foyer capitaliste », ma mère a été bientôt
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer penda
Une enquête menée en 1995 a révélé que, dans les zones prospères du
pays, les quatre professions qui avaient l’espérance de vie la plus courte
étaient les ouvriers d’usines chimiques, les chauffeurs routiers longue
distance, les policiers et les journalistes. Les ouvriers et les camionneurs
sont victimes d’une insuffisance de règles de sécurité adaptées à leur
condition. Le sort des policiers chinois doit être un des plus durs du monde :
avec un système judiciaire défectueux, dans une société où le pouvoir
politique règne en maître absolu, les criminels qui ont des appuis influents
se font une gloire de s’en tirer souvent indemnes, et certains se vengent par
la suite sur les fonctionnaires impliqués. Les policiers sont pris entre ce
qu’ils savent être le droit chemin et les ordres qu’ils reçoivent ; frustration,
insécurité et mauvaise conscience expliquent le nombre de morts précoces.
Mais pourquoi les journalistes, qui ont, de plus d’une façon, une vie
privilégiée, partagent-ils le même sort ?
Les journalistes en Chine ont été témoins de nombre d’événements
choquants, bouleversants. Toutefois, dans une société où les principes du
Parti gouvernaient l’information, il leur était très difficile de montrer le vrai
visage de ce dont ils avaient été témoins. Ils ont souvent été contraints de
dire et d’écrire des choses avec lesquelles ils n’étaient pas d’accord.
Quand j’ai interviewé des femmes mariées contre leur gré pour des motifs
politiques, quand j’ai vu les femmes lutter contre la pauvreté et des
conditions de vie si pénibles qu’elles n’avaient pas même un bol de soupe
ou un œuf à manger après un accouchement, ou entendu sur les répondeurs
de mon émission ces femmes qui n’osaient dire à personne que leurs maris
les battaient, j’ai souvent été dans l’impossibilité de les aider à cause du
code de la radiodiffusion. Je ne pouvais que me désoler pour elles en privé.
Quand la Chine a commencé à s’ouvrir, ce fut comme si un enfant affamé
dévorait tout ce qui lui tombait sous la main sans faire de distinction. Plus
tard, alors que le monde découvrait une Chine rose de bonheur dans ses
nouveaux atours, qui ne hurlait plus de faim, la communauté des
journalistes a assisté, muette, aux convulsions de ce corps ravagé par les
douleurs de l’indigestion. Mais c’était un corps dont le cerveau était stérile
car le cerveau de la Chine n’avait pas encore développé les cellules
nécessaires pour absorber la vérité et la liberté. Le divorce entre ce qu’ils
savaient et ce qu’il leur était permis de dire mettait à rude épreuve la santé
mentale et physique des journalistes.
C’est à cause de cette situation de divorce que j’ai décidé d’abandonner
ma carrière de journaliste.
pays, les quatre professions qui avaient l’espérance de vie la plus courte
étaient les ouvriers d’usines chimiques, les chauffeurs routiers longue
distance, les policiers et les journalistes. Les ouvriers et les camionneurs
sont victimes d’une insuffisance de règles de sécurité adaptées à leur
condition. Le sort des policiers chinois doit être un des plus durs du monde :
avec un système judiciaire défectueux, dans une société où le pouvoir
politique règne en maître absolu, les criminels qui ont des appuis influents
se font une gloire de s’en tirer souvent indemnes, et certains se vengent par
la suite sur les fonctionnaires impliqués. Les policiers sont pris entre ce
qu’ils savent être le droit chemin et les ordres qu’ils reçoivent ; frustration,
insécurité et mauvaise conscience expliquent le nombre de morts précoces.
Mais pourquoi les journalistes, qui ont, de plus d’une façon, une vie
privilégiée, partagent-ils le même sort ?
Les journalistes en Chine ont été témoins de nombre d’événements
choquants, bouleversants. Toutefois, dans une société où les principes du
Parti gouvernaient l’information, il leur était très difficile de montrer le vrai
visage de ce dont ils avaient été témoins. Ils ont souvent été contraints de
dire et d’écrire des choses avec lesquelles ils n’étaient pas d’accord.
Quand j’ai interviewé des femmes mariées contre leur gré pour des motifs
politiques, quand j’ai vu les femmes lutter contre la pauvreté et des
conditions de vie si pénibles qu’elles n’avaient pas même un bol de soupe
ou un œuf à manger après un accouchement, ou entendu sur les répondeurs
de mon émission ces femmes qui n’osaient dire à personne que leurs maris
les battaient, j’ai souvent été dans l’impossibilité de les aider à cause du
code de la radiodiffusion. Je ne pouvais que me désoler pour elles en privé.
Quand la Chine a commencé à s’ouvrir, ce fut comme si un enfant affamé
dévorait tout ce qui lui tombait sous la main sans faire de distinction. Plus
tard, alors que le monde découvrait une Chine rose de bonheur dans ses
nouveaux atours, qui ne hurlait plus de faim, la communauté des
journalistes a assisté, muette, aux convulsions de ce corps ravagé par les
douleurs de l’indigestion. Mais c’était un corps dont le cerveau était stérile
car le cerveau de la Chine n’avait pas encore développé les cellules
nécessaires pour absorber la vérité et la liberté. Le divorce entre ce qu’ils
savaient et ce qu’il leur était permis de dire mettait à rude épreuve la santé
mentale et physique des journalistes.
C’est à cause de cette situation de divorce que j’ai décidé d’abandonner
ma carrière de journaliste.
En tant que « membre d’un foyer capitaliste », ma mère a été bientôt
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer pendant presque cinq ans. Nous
avons eu plus de chance que d’autres : certains y ont passé près de dix ans.
retenue pour des interrogatoires, avec interdiction de rentrer chez elle. Mon
frère et moi avons emménagé dans des quartiers réservés aux enfants dont
les parents étaient incarcérés.
A l’école, il m’était interdit de participer aux chants et aux danses avec les
autres filles parce que je ne devais pas « polluer » l’arène de la révolution.
Alors que j’étais myope, je n’avais pas le droit de m’asseoir dans la rangée
de devant parce que les meilleures places étaient réservées aux enfants de
paysans, de travailleurs ou de soldats ; on estimait qu’ils avaient « des
racines droites et des bourgeons rouges ». De même, je n’avais pas le droit
d’occuper le premier rang pendant les cours d’éducation physique, alors que
j’étais la plus petite de la classe, parce que les places près du professeur
étaient réservées à la « prochaine génération de la révolution ».
Avec les autres douze enfants « pollués » qui avaient de deux à quatorze
ans, mon frère et moi devions assister à une classe d’éducation politique
après l’école, et nous ne pouvions prendre part aux activités extrascolaires
avec les enfants de notre âge. Il nous était interdit de regarder des films,
même les plus révolutionnaires, parce que nous devions « reconnaître
complètement » la nature réactionnaire de nos familles. A la cantine, on
nous servait après tout le monde parce que mon grand-père paternel avait
autrefois « aidé les impérialistes anglais et américains à ôter la nourriture de
la bouche des Chinois et les vêtements de leur dos ».
Nos journées étaient réglées par deux gardes rouges qui aboyaient des
ordres :
— Levez-vous !
— En classe !
— A la cantine !
— Etudiez les citations du président Mao !
— Allez vous coucher !
Sans famille pour nous protéger, nous suivions la même routine mécanique
jour après jour, sans le moindre jeu, rire ou sourire de l’enfance. Nous
accomplissions les tâches ménagères nous-mêmes, et les plus âgés aidaient
les plus jeunes à se laver le visage et les pieds tous les jours et à nettoyer
leurs vêtements ; on ne prenait qu’une douche par semaine. La nuit, filles et
garçons dormaient ensemble, serrés les uns contre les autres sur un matelas
de paille.
Notre seul maigre réconfort, c’était la cantine. On n’y entendait ni rires ni
bavardages, mais des gens généreux nous glissaient parfois à la dérobée de
petits colis de nourriture.
Un jour, j’ai posé mon frère, qui n’avait pas encore trois ans, au bout de la
queue de la cantine, qui était anormalement longue. Ce devait être un jour
de célébration nationale, car on y proposait pour la première fois du poulet
rôti, et l’odeur délicieuse embaumait l’air. Nous avions l’eau à la bouche ;
nous ne mangions rien d’autre que des restes depuis longtemps, mais nous
savions qu’il n’y aurait pas de poulet rôti pour nous.
Mon frère a soudain fondu en larmes, criant qu’il voulait du poulet rôti.
J’avais peur que le bruit n’incommode les gardes rouges, qu’ils nous
chassent et que nous n’ayons rien à manger, et j’ai fait mon possible pour
calmer mon frère. Mais il a recommencé à pleurer de plus belle ; j’étais
pétrifiée de terreur et moi-même au bord des larmes.
A ce moment-là, une femme à l’air maternel est passée près de nous. Elle a
pris un morceau de son poulet rôti, l’a donné à mon frère et s’est éloignée
sans un mot. Mon frère a cessé de gémir et il s’apprêtait à manger quand un
garde rouge est accouru, lui a arraché la cuisse de poulet de la bouche, l’a
jetée au sol et réduite en bouillie sous son talon.
— Ces chiots impérialistes, ça se croit digne de manger du poulet aussi,
hein ? a hurlé le garde rouge.
Mon frère était trop effrayé pour réagir ; il n’a rien mangé de la journée –
et n’a plus pleuré ou fait de crise pour du poulet rôti ou aucun autre luxe
longtemps après cela. Des années plus tard, je lui ai demandé s’il se
souvenait de cet incident. Je suis heureuse de dire qu’il ne s’en souvenait
pas, mais moi je n’arrive pas à l’oublier.
Mon frère et moi avons vécu dans ce foyer pendant presque cinq ans. Nous
avons eu plus de chance que d’autres : certains y ont passé près de dix ans.
Videos de Xinran (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Comme la majorité des adolescent.e.s de son âge, Xinxin est fille unique. La raison ? La politique de l'enfant unique en Chine, qui - de 1979 à 2015 - a contraint les couples chinois à n'avoir qu'un seul enfant, en sanctionnant financièrement de façon très dure les couples en ayant plusieurs. Mais voilà que - maintenant que cette politique n'a plus cours - sa meilleure amie, Xia, lui apprend qu'elle va être grande sœur. Pour Xinxin, cette révélation va avoir l'effet d'un électrochoc : elle aussi, elle le sait, elle le sent, veut être une sœur. Elle va alors découvrir qu'un lourd secret pèse sur sa famille...
Comme moi, vous avez probablement entendu parler de la politique de l'enfant unique en Chine, mais avez-vous vraiment idée des conséquences de cette politique dans ce pays, tout au long de 26 années de naissances uniques ? Non ?Je vous explique tout ça !
Comme moi, vous avez probablement entendu parler de la politique de l'enfant unique en Chine, mais avez-vous vraiment idée des conséquences de cette politique dans ce pays, tout au long de 26 années de naissances uniques ? Non ?Je vous explique tout ça !
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Role social de la femmeVoir plus
>Groupes sociaux>Femmes>Role social de la femme (109)
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Xinran (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
131 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre131 lecteurs ont répondu