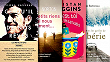Critiques de Alexandre Lacroix (145)
Le roman L’homme qui aimait trop travailler d’Alexandre Lacroix, paru en 2015, s’articule autour de Sommer, le personnage principal. Responsable efficace d’une chaîne logistique pour une grande entreprise de biscuits, ce dernier partage avec nous, au gré d’une journée de travail, les réflexions qu’il porte sur les différentes tâches qui lui incombent et sur les relations qu’il a avec ses collègues et les gens de son entourage.
À travers ces réflexions, Sommer nous fait voir l’homme cérébral (c’est le mot!), qu’il est, celui qui calcule, qui pèse le pour et le contre, qui pose un regard froid et analytique sur chaque situation, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse, qui trouve son plaisir lorsque l’esprit, hautement sollicité par le travail, se tend et se concentre aux résolutions et au maintien des équilibres.
Sous l’angle d’analyse de ce personnage, le texte de Lacroix est réussi. D’abord, en multipliant les situations où l’on voit Sommer agir en conformité avec sa raison, l’auteur nous permet de découvrir à qui nous avons à faire. Ensuite, parce que la narration se fait à la première personne du singulier, le procédé, en nous convient dans l’intimité réflexive et rationnelle de Sommer, permet encore l’accentuation du trait caractériel du personnage. Enfin, en nous préparant une finale en apothéose où, confronté aux conséquences douloureuses de sa nature Sommer continue pourtant ses réflexions, l’auteur montre que la cérébralité de son personnage, davantage qu’accessoire, se voulait peut-être, quelque part, le sujet même de son récit.
À travers ces réflexions, Sommer nous fait voir l’homme cérébral (c’est le mot!), qu’il est, celui qui calcule, qui pèse le pour et le contre, qui pose un regard froid et analytique sur chaque situation, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse, qui trouve son plaisir lorsque l’esprit, hautement sollicité par le travail, se tend et se concentre aux résolutions et au maintien des équilibres.
Sous l’angle d’analyse de ce personnage, le texte de Lacroix est réussi. D’abord, en multipliant les situations où l’on voit Sommer agir en conformité avec sa raison, l’auteur nous permet de découvrir à qui nous avons à faire. Ensuite, parce que la narration se fait à la première personne du singulier, le procédé, en nous convient dans l’intimité réflexive et rationnelle de Sommer, permet encore l’accentuation du trait caractériel du personnage. Enfin, en nous préparant une finale en apothéose où, confronté aux conséquences douloureuses de sa nature Sommer continue pourtant ses réflexions, l’auteur montre que la cérébralité de son personnage, davantage qu’accessoire, se voulait peut-être, quelque part, le sujet même de son récit.
Dans son roman, l’auteur Alexandre Lacroix met en scène Sommer, c’est-à-dire L’homme qui aimait trop travailler. Personnage principal et narrateur du récit, celui-ci dissèque froidement son quotidien et sa vie – complètement subjuguée par le travail. En tant que responsable de la chaîne logistique d’un fabricant de biscuits, Sommer se livre à des analyses intérieures à la fois impassibles et subtiles : tantôt il décrit l’exécution méticuleuse de ses tâches et vante les bienfaits du courriel aseptisé, tantôt il expose les luttes intestines pour le pouvoir et méprise les habitudes de ses collègues. Héritier avoué de L’Étranger d’Albert Camus ("L’homme qui aimait trop travailler", s.d.), Sommer est avant tout un quadragénaire au caractère profondément indifférent, prisonnier consentant du rythme « métro, boulot, dodo ».
Ainsi, tout le roman repose sur les observations de Sommer, dont la lucidité permet à Alexandre Lacroix de proposer des analyses approfondies sur le monde du travail contemporain; L’homme qui aimait trop travailler suscite de la sorte certaines réflexions à la fois provocantes et amusantes par leur vérité. Or, d’autres propos s’avèrent superficiels – ou est-ce l’effet recherché ? – en raison de l’apathie du personnage principal, privé d’intelligence émotionnelle. Par le regard de Sommer, Lacroix dépeint notamment des collègues caricaturaux tels que le supérieur malveillant ou la voluptueuse consœur de travail. Semblablement, Sommer n’éveille guère la sympathie, ce qui dessert, par moments, le livre : son manque d’introspection frôle parfois une arrogance trop exaspérante pour apprécier les intentions de l’écrivain.
Référence :
L’homme qui aimait trop travailler. (s.d.). Repéré à http://alexandrelacroix.com/livres/romans/lhomme-qui-aimait-trop-travailler/
Ainsi, tout le roman repose sur les observations de Sommer, dont la lucidité permet à Alexandre Lacroix de proposer des analyses approfondies sur le monde du travail contemporain; L’homme qui aimait trop travailler suscite de la sorte certaines réflexions à la fois provocantes et amusantes par leur vérité. Or, d’autres propos s’avèrent superficiels – ou est-ce l’effet recherché ? – en raison de l’apathie du personnage principal, privé d’intelligence émotionnelle. Par le regard de Sommer, Lacroix dépeint notamment des collègues caricaturaux tels que le supérieur malveillant ou la voluptueuse consœur de travail. Semblablement, Sommer n’éveille guère la sympathie, ce qui dessert, par moments, le livre : son manque d’introspection frôle parfois une arrogance trop exaspérante pour apprécier les intentions de l’écrivain.
Référence :
L’homme qui aimait trop travailler. (s.d.). Repéré à http://alexandrelacroix.com/livres/romans/lhomme-qui-aimait-trop-travailler/
Alexandre Lacroix est directeur de la rédaction de la revue Philosophie Magazine. Il est également auteur d’une dizaine de romans et d’essais. Son dernier roman « L’homme qui aimait trop travailler » raconte l’histoire d’un cadre de direction employé dans une industrie multinationale du biscuit, entreprise qui pourrait être un groupe mondial comme le sont Kraft, Mondelez, United Biscuits ou Kellogg’s. Investi à fond dans sa vie professionnelle, l‘homme qui aimait trop travailler finit par se faire un infarctus en pleine réunion de travail.
Le roman est pour l’auteur l’occasion de balayer un sujet bien d’actualité, à mon avis trop peu abordé dans la littérature actuelle. Le monde de l’entreprise est plutôt bien décrit. On y retrouve mille et un détails de la vie quotidienne d’un cadre actuel exerçant en entreprise : la tenue de check-lists d’actions à faire, la gestion de dizaines de mails reçus quotidiennement, le travail en mode multitâche, l’espace de travail en mode open space, les discussions informelles à la machine à café, les comportements et attitudes de chacun en réunion de direction, les rapports entre hiérarchique et salarié, les relations entre salariés, les discours à tenir lors des pots de départ, les motivations et le plaisir que chacun peut trouver dans le travail…
C’est aussi l’occasion pour l’auteur de décrire l’enchaînement qui conduit un cadre actuel à s’investir et à travailler toujours plus, avec comme répercussion le délaissement de sa vie personnelle et ses conséquences.
Le récit se lit rapidement. Il n’y a pas d’intrigue mais peu importe. En terminant le récit, c’est finalement la déception qui l’emporte. Pauvreté du style avec l’usage abusif de l’adverbe pour débuter une phrase (pages 22 et 23 : « en outre, aussi, ainsi, ensuite, exprès, par exemple, bien sûr, souvent »…) et plus surprenant des fautes de syntaxe (page 131 : « c’est d’un thé que j’aurais eu besoin »). Pauvreté également du contenu avec un récit qui reste superficiel. Directeur d’une revue traitant de philosophie, j’attendais de l’auteur une élévation de la réflexion sur le monde actuel du travail. Dommage. Le sujet méritait mieux
Le roman est pour l’auteur l’occasion de balayer un sujet bien d’actualité, à mon avis trop peu abordé dans la littérature actuelle. Le monde de l’entreprise est plutôt bien décrit. On y retrouve mille et un détails de la vie quotidienne d’un cadre actuel exerçant en entreprise : la tenue de check-lists d’actions à faire, la gestion de dizaines de mails reçus quotidiennement, le travail en mode multitâche, l’espace de travail en mode open space, les discussions informelles à la machine à café, les comportements et attitudes de chacun en réunion de direction, les rapports entre hiérarchique et salarié, les relations entre salariés, les discours à tenir lors des pots de départ, les motivations et le plaisir que chacun peut trouver dans le travail…
C’est aussi l’occasion pour l’auteur de décrire l’enchaînement qui conduit un cadre actuel à s’investir et à travailler toujours plus, avec comme répercussion le délaissement de sa vie personnelle et ses conséquences.
Le récit se lit rapidement. Il n’y a pas d’intrigue mais peu importe. En terminant le récit, c’est finalement la déception qui l’emporte. Pauvreté du style avec l’usage abusif de l’adverbe pour débuter une phrase (pages 22 et 23 : « en outre, aussi, ainsi, ensuite, exprès, par exemple, bien sûr, souvent »…) et plus surprenant des fautes de syntaxe (page 131 : « c’est d’un thé que j’aurais eu besoin »). Pauvreté également du contenu avec un récit qui reste superficiel. Directeur d’une revue traitant de philosophie, j’attendais de l’auteur une élévation de la réflexion sur le monde actuel du travail. Dommage. Le sujet méritait mieux
Sommer travaille pour une grande entreprise. Responsable de la chaîne logistique, il surveille les différentes étapes menant de la production à la vente de biscuits. Le problème c'est que son existence est entièrement absorbée par le travail. Perfectionniste, il prête une attention particulière à de menus détails comme la sonnerie des téléphones portables de ses collègues. Un personnage peut se définir dans son rapport avec les autres (Todorov, 1966) et ici on peut dire que Sommer est peu doué dans les relations sociales. Il préfère la « propreté » des courriels au téléphone ou aux poignées de main. S'il n'y avait qu'un mot à choisir pour le caractériser, ce serait le mot obsessif. Cette obsession se traduit dans ses comportements, mais également dans ses observations sur le travail ou sur la vie en général, ce qui donne une profondeur à un personnage froid, insensible et antipathique. Lacroix ne se contente pas de décrire à gros traits les défauts d'un homme superficiel en apparence. Bien qu'il ne puisse échapper à sa propre vie, une vie en quelque sorte déréglée par le travail, Sommer est conscient que quelque chose a été transformé en lui. À mes yeux, l'intérêt principal du roman de Lacroix se trouve ici. On n'apprécie pas le personnage du récit pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il nous permet de penser. C'est à travers les réflexions de Sommer que Lacroix nous fait réfléchir sur le côté aliénant du travail et sur quelques absurdités de la vie moderne.
Références :
Todorov, T. (1966). Les catégories du récit littéraire. Communications, 8I, 125-151.
Références :
Todorov, T. (1966). Les catégories du récit littéraire. Communications, 8I, 125-151.
Pourquoi ce livre?
Le roman L’homme qui aimait trop travailler d’Alexandre Lacroix a été lu tout récemment dans le cadre d’une lecture suggérée dans le cours intitulé « La lecture, le livre et l’édition » offert à l’automne 2015 dans le cadre de la maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal. Je l’ai lu principalement lors de mes déplacements entre l’université, le travail et la garderie des enfants. Il m’a servi de passe-temps et de refuge dans le désagrément propre à l’utilisation des transports collectifs aux heures de pointe. Bien que ce livre n’aurait jamais fait l’objet d’un choix spontané de ma part, et sans devenir l’un de mes préférés, il m’a apporté un certain divertissement pendant les quelques heures que je lui ai consacrées.
Un premier aspect qui m’a plu :
Ce livre présente un style fluide. Le vocabulaire y est accessible. Il se lit aisément et ne demande pas d’efforts soutenus pour être bien compris. La trame narrative est simple et logique. Ce livre est tout à fait indiqué pour une lecture dans un milieu bruyant ou pour une lecture entrecoupée puisqu’il comporte peu de personnages et de lieux. En somme, il s’agit d’un choix tout indiqué pour une lecture de train ou de salle d’attente; ce qui était tout à fait en équation avec les circonstances de mon expérience de lectrice.
Un second aspect qui m’a plu :
Le personnage principal ainsi que son univers sont en phase avec notre époque. Ce roman dresse un portrait vraisemblable de notre société. Il est facile d’y reconnaître de nombreux éléments de nos vies; de s’y projeter et de s’y reconnaître. Le personnage principal par son aliénation et son assujettissement face à son travail fait figure de symbole ou de métaphore d’un certain pan de la vie contemporaine. Ce portrait d’une partie de notre société et de nous-mêmes peut donner lieu à une belle réflexion chez certains; ce qui en fait assurément l’un des éléments intéressants de cette lecture.
Un aspect qui m’a moins plu :
Le roman « L’homme qui aimait trop travailler » d’Alexandre Lacroix fait presque figure de roman à thèse. Le propos ainsi que la réflexion qui sous-tend cet écrit constituent son principal point d’intérêt. Tel que mentionné précédemment, l’auteur dresse un portrait fidèle d’une partie de nos sociétés contemporaines, pourtant, cela ne suffit pas à faire de ce roman une œuvre captivante. Tout y est prévisible, voire convenu. En somme, bien que cette lecture ne soit pas dépourvue d’un certain intérêt, elle ennuie.
Le roman L’homme qui aimait trop travailler d’Alexandre Lacroix a été lu tout récemment dans le cadre d’une lecture suggérée dans le cours intitulé « La lecture, le livre et l’édition » offert à l’automne 2015 dans le cadre de la maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal. Je l’ai lu principalement lors de mes déplacements entre l’université, le travail et la garderie des enfants. Il m’a servi de passe-temps et de refuge dans le désagrément propre à l’utilisation des transports collectifs aux heures de pointe. Bien que ce livre n’aurait jamais fait l’objet d’un choix spontané de ma part, et sans devenir l’un de mes préférés, il m’a apporté un certain divertissement pendant les quelques heures que je lui ai consacrées.
Un premier aspect qui m’a plu :
Ce livre présente un style fluide. Le vocabulaire y est accessible. Il se lit aisément et ne demande pas d’efforts soutenus pour être bien compris. La trame narrative est simple et logique. Ce livre est tout à fait indiqué pour une lecture dans un milieu bruyant ou pour une lecture entrecoupée puisqu’il comporte peu de personnages et de lieux. En somme, il s’agit d’un choix tout indiqué pour une lecture de train ou de salle d’attente; ce qui était tout à fait en équation avec les circonstances de mon expérience de lectrice.
Un second aspect qui m’a plu :
Le personnage principal ainsi que son univers sont en phase avec notre époque. Ce roman dresse un portrait vraisemblable de notre société. Il est facile d’y reconnaître de nombreux éléments de nos vies; de s’y projeter et de s’y reconnaître. Le personnage principal par son aliénation et son assujettissement face à son travail fait figure de symbole ou de métaphore d’un certain pan de la vie contemporaine. Ce portrait d’une partie de notre société et de nous-mêmes peut donner lieu à une belle réflexion chez certains; ce qui en fait assurément l’un des éléments intéressants de cette lecture.
Un aspect qui m’a moins plu :
Le roman « L’homme qui aimait trop travailler » d’Alexandre Lacroix fait presque figure de roman à thèse. Le propos ainsi que la réflexion qui sous-tend cet écrit constituent son principal point d’intérêt. Tel que mentionné précédemment, l’auteur dresse un portrait fidèle d’une partie de nos sociétés contemporaines, pourtant, cela ne suffit pas à faire de ce roman une œuvre captivante. Tout y est prévisible, voire convenu. En somme, bien que cette lecture ne soit pas dépourvue d’un certain intérêt, elle ennuie.
• Pourquoi ce livre? 1. Tout d’abord parce que nous avions droit de lire l’une des lectures obligatoires pour ce travail. Ensuite parce que c‘est celui qui semblait le moins long (j’ai beaucoup de lecture en ce début de session…), mais aussi parce que j’avais lu que l’auteur est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Ça fait longtemps que je n’avais pas lu 175 pages en une journée (merci Google ?), alors j’ai pu me donner ce défi et le réussir.
• Un premier aspect qui m’a plu : 2. Il m’arrive rarement de lire des romans écrit à la première personne ces derniers temps, alors cette lecture avait cela de rafraichissant. Le point de vue narratif interne à cet avantage de nous faire découvrir les opinions que le protagoniste a des autres ou encore de lui-même. Ici Sommer a beaucoup d’opinion sur lui-même et pas les plus modestes !
• Un second aspect qui m’a plu : 3. Le livre contient quelques assertions philosophiques qui ne sont pas totalement dépourvues d’intérêt, mais les réflexions sur l’économie internationale sont complètement farfelues et sont aisément réfutables. D’un autre côté, le texte contient plusieurs « petits » faits plutôt intéressant, par exemple que le bouton de fermeture des portes d’un ascenseur est le plus utilisé, chose nouvelle d’après l’auteur.
• Un aspect qui m’a moins plu : 4. Il est difficile de dire si la pensée de l’auteur se reflètent dans les propos tenus par Sommer ou si ce dernier agit comme un anti-héros à la Elvis Gratton. Vu que les chapitres sont trop court pour développer correctement une idée, nous en sommes à pouvoir contredire facilement ses propos, mais il n’y a personne au bout du fil pour nous répondre… Ce qui rend la lecture frustrante pour moi.
• Un premier aspect qui m’a plu : 2. Il m’arrive rarement de lire des romans écrit à la première personne ces derniers temps, alors cette lecture avait cela de rafraichissant. Le point de vue narratif interne à cet avantage de nous faire découvrir les opinions que le protagoniste a des autres ou encore de lui-même. Ici Sommer a beaucoup d’opinion sur lui-même et pas les plus modestes !
• Un second aspect qui m’a plu : 3. Le livre contient quelques assertions philosophiques qui ne sont pas totalement dépourvues d’intérêt, mais les réflexions sur l’économie internationale sont complètement farfelues et sont aisément réfutables. D’un autre côté, le texte contient plusieurs « petits » faits plutôt intéressant, par exemple que le bouton de fermeture des portes d’un ascenseur est le plus utilisé, chose nouvelle d’après l’auteur.
• Un aspect qui m’a moins plu : 4. Il est difficile de dire si la pensée de l’auteur se reflètent dans les propos tenus par Sommer ou si ce dernier agit comme un anti-héros à la Elvis Gratton. Vu que les chapitres sont trop court pour développer correctement une idée, nous en sommes à pouvoir contredire facilement ses propos, mais il n’y a personne au bout du fil pour nous répondre… Ce qui rend la lecture frustrante pour moi.
Une journée dans la vie d'un homme qui consacre son temps et son énergie à son travail : cadre à la Défense à Paris, pour une grosse entreprise d'épicerie sucrée. La narration est la première personne du singulier. On n'a du mal à s'identifier au narrateur tant il est paradoxal. On sent pointer le nez de l'auteur dans certains propos du personnage. Le propos est intéressant, il se veut édifiant, mais en cela dessert le roman.
1. Pourquoi ce livre?
Le contexte qui m’a poussée à faire le choix du livre L’homme qui aimait trop travailler est lié à des exigences scolaires. Dans le cadre du cours SCI6344, comme il fallait minimalement lire un des deux livres proposés pour le club de lecture et qu’il était possible d’utiliser ce même titre pour réaliser ce rapport de lecture, j’ai décidé de faire d’une pierre deux coups et de sélectionner le livre d’Alexandre Lacroix. En termes de proposition de lecture, il m’interpellait davantage que Vérité et amour de Claire Legendre.
2. Un premier aspect qui m’a plu :
J’ai apprécié le fait que le roman soit écrit à la première personne du singulier. Ainsi présenté, le personnage principal m’interpelle davantage et mon adhérence à sa personnalité et à sa pensée en est décuplée. Ses réflexions sont fluides et ses interventions pertinentes et assez cinglantes. C’est un angle d’approche qui m’a plu pour aborder le sujet de notre relation avec le travail. Ainsi rendu de manière personnelle, le discours apparaît un peu plus vrai et moins généraliste. Bref, un « je » attachant malgré le fait qu’il soit lui-même détaché de toute affection.
3. Un second aspect qui m’a plu :
J’ai aimé le sujet traité, c’est-à-dire la relation que nous entretenons avec le travail et l’idée de « servitude volontaire ». C’est un sujet d’actualité et certaines conséquences des transformations qui ont présentement cours dans le milieu du travail ne sont pas toujours connues ou sinon évacuées de notre discours. Le sujet est donc riche en réflexion et permet de jeter un regard sur sa propre relation avec le travail à travers un personnage investi corps et âme dans son métier alors que ses réalisations sont assez éphémères.
4. Un aspect qui m’a moins plu :
Au départ séduite par le sujet du livre, j’ai plutôt trouvé son traitement très irritant au fil de la lecture. En effet, des longueurs sont apparues et la fin était, à mon avis, prévisible. L’impression de longueur créée par la manière de traiter le sujet, qui ressemblait presque à une proposition de thèse à certains moments, m’a finalement rebutée au point où j’ai fermé le livre avec une impression diamétralement opposée au sentiment positif que j’avais après la lecture des trois premiers chapitres.
Le contexte qui m’a poussée à faire le choix du livre L’homme qui aimait trop travailler est lié à des exigences scolaires. Dans le cadre du cours SCI6344, comme il fallait minimalement lire un des deux livres proposés pour le club de lecture et qu’il était possible d’utiliser ce même titre pour réaliser ce rapport de lecture, j’ai décidé de faire d’une pierre deux coups et de sélectionner le livre d’Alexandre Lacroix. En termes de proposition de lecture, il m’interpellait davantage que Vérité et amour de Claire Legendre.
2. Un premier aspect qui m’a plu :
J’ai apprécié le fait que le roman soit écrit à la première personne du singulier. Ainsi présenté, le personnage principal m’interpelle davantage et mon adhérence à sa personnalité et à sa pensée en est décuplée. Ses réflexions sont fluides et ses interventions pertinentes et assez cinglantes. C’est un angle d’approche qui m’a plu pour aborder le sujet de notre relation avec le travail. Ainsi rendu de manière personnelle, le discours apparaît un peu plus vrai et moins généraliste. Bref, un « je » attachant malgré le fait qu’il soit lui-même détaché de toute affection.
3. Un second aspect qui m’a plu :
J’ai aimé le sujet traité, c’est-à-dire la relation que nous entretenons avec le travail et l’idée de « servitude volontaire ». C’est un sujet d’actualité et certaines conséquences des transformations qui ont présentement cours dans le milieu du travail ne sont pas toujours connues ou sinon évacuées de notre discours. Le sujet est donc riche en réflexion et permet de jeter un regard sur sa propre relation avec le travail à travers un personnage investi corps et âme dans son métier alors que ses réalisations sont assez éphémères.
4. Un aspect qui m’a moins plu :
Au départ séduite par le sujet du livre, j’ai plutôt trouvé son traitement très irritant au fil de la lecture. En effet, des longueurs sont apparues et la fin était, à mon avis, prévisible. L’impression de longueur créée par la manière de traiter le sujet, qui ressemblait presque à une proposition de thèse à certains moments, m’a finalement rebutée au point où j’ai fermé le livre avec une impression diamétralement opposée au sentiment positif que j’avais après la lecture des trois premiers chapitres.
Un court roman que j'ai apprécié car il a une certaine résonance avec ma vie en ce moment. Par contre les pages sur les joies de l'open space ou la descrisption des maillons de la supply chain peuvent vite paraître rébarbatives pour les non-initiés. Moi ça m'a parlé et j'ai bien aimé.
Ce roman met en scène le directeur de la chaine logistique d’une compagnie de biscuits dénommé Sommer. Sa vie s’est toujours résumée à son travail et cela n’a pas changé depuis sa récente séparation. Je qualifierais ce personnage de « machinal » malgré ses nombreuses réflexions. En effet, nous remarquons rapidement la place importante de la routine et de l’organisation chez lui. En se levant chaque matin, il effectue le même geste, geste qui trahit l’omniprésence du travail dans sa vie : il consulte ses mails. Au fil des chapitres, nous avons réellement l’impression qu’il s’agit du portrait de la journée typique que Sommer vit jour après jour, tel un robot programmé pour refaire les mêmes choses. Le dénouement vient aussi appuyer notre vision de Sommer comme « homme-machine ». En effet, Sommer a essayé d’être productif et performant comme une machine — sa séance à la salle de sport démontre son besoin constant de repousser ses capacités — mais l’humain n’est pas une machine et Sommer l’apprendra drastiquement. Si j’ai apprécié ce roman, ce n’est pas en raison du personnage de Sommer, que j’ai trouvé trop stéréotypé. Même ses réflexions ne nous permettent pas changer notre vision de lui comme d’un personnage froid. Comme Sommer est l’élément principal du roman, je ne peux pas dire que j’ai apprécié complètement l’œuvre bien que l’insertion dans l’univers de l’entreprise m’ait plu. Mais aurait-on pu s’attendre à un autre personnage pour un livre s’intitulant « l’homme qui aimait trop travailler » ?
Le personnage principal de l’œuvre d’Alexandre Lacroix se nomme Sommer, un Français et un cadre responsable de la logistique de production et de vente de marques de biscuits. Très introverti, soucieux de son image physique et intelligent, il est un bourreau de travail désireux de performer dans son entreprise. Observateur pointu, il se livre à de nombreuses réflexions historiques, philosophiques et sociales comme sur ses études en anthropologie, sur ses conquêtes, sur son ancienne petite-amie et ses relations sociales (souvent tendues avec ses collègues). Il privilégie le travail et pense d’abord à lui-même au détriment de ses relations sentimentales et sociales.
Je le qualifierais d’égocentrique. Ses priorités gravitent autour de sa personne, pas des autres. C’est une des raisons de sa séparation avec son ancienne blonde. Bien que tout roule au travail, Sommer est affreusement isolé socialement et il n’est pas heureux.
J’ai bien aimé le livre puisque le lecteur peut s’imprégner et suivre graduellement l’évolution des réflexions de Sommer qui se rend compte qu’il doit briser cet égocentrisme. Celles-ci reprennent des sujets problématiques dans l’Occident comme le corps physique, l’individualisme, la performance et la sexualité. Directement concerné et frappé par ces réalités, le lecteur peut mieux comprendre le personnage et pénétrer dans son univers. C’est ce qui fait le charme de ce livre rapide à lire dans le contexte d’une critique littéraire dans le cours SCI6344.
Je le qualifierais d’égocentrique. Ses priorités gravitent autour de sa personne, pas des autres. C’est une des raisons de sa séparation avec son ancienne blonde. Bien que tout roule au travail, Sommer est affreusement isolé socialement et il n’est pas heureux.
J’ai bien aimé le livre puisque le lecteur peut s’imprégner et suivre graduellement l’évolution des réflexions de Sommer qui se rend compte qu’il doit briser cet égocentrisme. Celles-ci reprennent des sujets problématiques dans l’Occident comme le corps physique, l’individualisme, la performance et la sexualité. Directement concerné et frappé par ces réalités, le lecteur peut mieux comprendre le personnage et pénétrer dans son univers. C’est ce qui fait le charme de ce livre rapide à lire dans le contexte d’une critique littéraire dans le cours SCI6344.
Le personnage principal de ce roman, Sommer, est un véritable bourreau du travail. En tant que cadre supérieur dans une entreprise de biscuits, il travaille constamment et est obsédé par le désir de se dépasser. Difficile et exigeant envers les autres, il juge de manière profondément cynique les gens autour de lui et ne s’intéresse à eux que pour des fins pratiques. Un seul qualificatif pour résumer la caractéristique principale de ce personnage serait « orgueilleux ». En effet, par son obsession maladive du travail, Sommer finit par endommager sa relation avec son amoureuse et ses relations avec ses employés. Le roman raconte comment, à travers une journée de travail particulière, la vie de Sommer bascule soudainement et il prend conscience que le travail n’est pas ce qu’il y a de plus important. Je n’ai pas particulièrement aimé ce roman, car il m’était très difficile de m’attacher au personnage principal; sa manière froide et cynique de justifier ses actions, souvent détestables, envers les autres personnages, ainsi que par son attitude exigeante par rapport au travail, me le rendaient plutôt antipathique. Pourtant, la prise de conscience d’un personnage principal, aussi antipathique qu’il soit, demeure intéressante en ce qu’on peut voir une évolution psychologique, ce qui reflète l’expérience humaine qu’est le changement de perspective et l’apprentissage qui vient avec. Pour cette raison, ce roman constitue une lecture intéressante et pertinente à lire.
Sommer. Un personnage déshumanisé au point où il n’a plus de prénom. Un personnage que l’on pourrait décrire tout simplement par l’indifférence. L’indifférence qu’il manifeste à autrui et, ultimement à lui-même, mais aussi l’indifférence qu’il m’inspire. Un homme dans la quarantaine au mode de vie prétentieux dont l’unique amour est le travail, bien qu’il ait eu une relation où il s’est « efforcé » d’emmener sa copine à des rendez-vous dans ses quelque temps libre. Un homme qui se complaît dans sa personnalité terne en se targuant d’être un réaliste et un intellectuel et qui blâme sa personnalité aigrie sur ses choix de carrières frustrés : je pense, personnellement, qu’il aurait été tout aussi insupportable en tant que littéraire qu’en tant qu’homme d’affaires.
Cette histoire a quelque chose de froid : elle est entièrement narrée par Sommer. Nous sommes dans sa tête, ses pensées, son passé, son présent, son travail. Son détachement vis-à-vis des choses n’incite guère à s’attacher à lui ou à son récit : ce personnage n’est pas fait pour être apprécié par le lecteur. C’est d’autant plus évident que certains passages sont volontairement choquant, poussant le lecteur à s’éloigner de Sommer. Tant et si bien qu’une fois rendu à la lecture de la deuxième partie du récit, je n’éprouvais plus que pitié et frustration face à ses actions. C’est un livre que l’on laisse tomber un peu sèchement sur la table de chevet, après avoir terminé sa lecture, avec une seule pensée en tête : « Mais quel triste homme. »
Cette histoire a quelque chose de froid : elle est entièrement narrée par Sommer. Nous sommes dans sa tête, ses pensées, son passé, son présent, son travail. Son détachement vis-à-vis des choses n’incite guère à s’attacher à lui ou à son récit : ce personnage n’est pas fait pour être apprécié par le lecteur. C’est d’autant plus évident que certains passages sont volontairement choquant, poussant le lecteur à s’éloigner de Sommer. Tant et si bien qu’une fois rendu à la lecture de la deuxième partie du récit, je n’éprouvais plus que pitié et frustration face à ses actions. C’est un livre que l’on laisse tomber un peu sèchement sur la table de chevet, après avoir terminé sa lecture, avec une seule pensée en tête : « Mais quel triste homme. »
Sommer, protagoniste de ce roman d’Alexandre Lacroix, est responsable de la chaîne logistique d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de biscuits. C’est un homme qui étale son savoir, qui se livre à de nombreuses réflexions digressives et qui se préoccupe peu des autres. Il ne peut s’empêcher de performer toujours plus, à la limite du raisonnable, ce qui accentue l’isolement dans lequel il se confine.
Son ambition malsaine est le trait de caractère qui transparaît le plus tout au long du roman et qui conditionne son existence. Elle traduit sa volonté de réussir, sa vanité et son mépris tout en entraînant chez lui plusieurs dépendances et obsessions.
Si « l’image que le lecteur a d’un personnage, les sentiments que ce dernier lui inspire [...], sont très largement déterminés par la façon dont il est présenté, évalué et mis en scène par le narrateur » (Jouve, 2010, p. 94), le protagoniste-narrateur renvoie, ici, une image de lui qui n’est pas très reluisante bien qu’il ait une haute opinion de lui-même. D’abord confiant, rongé par le travail et un mode de vie respectant une méthodologie aliénante, il finit par inspirer au lecteur une certaine pitié et provoque lui-même la chute qui le mènera à sa condamnation. La psychologie de ce personnage antipathique a alimenté ma curiosité au fil de ma lecture de L’homme qui aimait trop travailler. Comme lectrice, il m’a particulièrement intéressé d’assister à son basculement pour voir de quelle façon cela modifie son comportement et sa vision du monde.
Référence :
Jouve, V. (2010). Poétique du roman. Paris, France : Armand Colin.
Son ambition malsaine est le trait de caractère qui transparaît le plus tout au long du roman et qui conditionne son existence. Elle traduit sa volonté de réussir, sa vanité et son mépris tout en entraînant chez lui plusieurs dépendances et obsessions.
Si « l’image que le lecteur a d’un personnage, les sentiments que ce dernier lui inspire [...], sont très largement déterminés par la façon dont il est présenté, évalué et mis en scène par le narrateur » (Jouve, 2010, p. 94), le protagoniste-narrateur renvoie, ici, une image de lui qui n’est pas très reluisante bien qu’il ait une haute opinion de lui-même. D’abord confiant, rongé par le travail et un mode de vie respectant une méthodologie aliénante, il finit par inspirer au lecteur une certaine pitié et provoque lui-même la chute qui le mènera à sa condamnation. La psychologie de ce personnage antipathique a alimenté ma curiosité au fil de ma lecture de L’homme qui aimait trop travailler. Comme lectrice, il m’a particulièrement intéressé d’assister à son basculement pour voir de quelle façon cela modifie son comportement et sa vision du monde.
Référence :
Jouve, V. (2010). Poétique du roman. Paris, France : Armand Colin.
Superbe découverte dans le cadre de l'opération masse critique de janvier. Merci Babelio.
En effet je n'avais encore jamais lu un ouvrage d'Alexandre Lacroix et je ne suis pas familière du milieu de la danse. Et pourtant je me suis très rapidement plongée dans les réflexions philosophiques de l'auteur sur le sujet : pourquoi ressent-on le besoin de danser ? Comment reussit-elle à concilier mouvement et immobilité ? Discipline et folie ? En quoi est-elle un art plus proche de nos origines profondes ? Quel rapport entretient-elle avec l'immortalité ?
J'ai beaucoup aimé l'écriture "vivante " de ce livre car Alexandre Lacroix ne cite pas des auteurs poussiéreux dans de longues réflexions - même si bien sûr il reprend les écrits classiques sur la question - mais alimente toujours son propos d'études récentes (par exemple de la recherche en neurobiologie) ou d'observation des pratiques de danseurs professionnels ou d'échange avec eux
(il y a même un passage très interessant sur la manière dont les danseurs procèdent pour mémoriser les différents styles de chorégraphie). C'est d'ailleurs de cette manière qu'on rencontre Ludmila Pagliero et Stephane Bullion, deux grands danseurs très différents - Ludmila la flamboyante et très professionnelle danseuse étoile et Stéphane son discret et intense partenaire dans un exigeant ballet. Decouvrir leur parcours de vie ( là je préfère vous laisser lire) a aussi été un moment fort de ma lecture.
J'ai été touchée par le récit tout en retenu de leur vie et de leur carrière, de leurs choix et de leur besoin de danser.
Ce livre m'a beaucoup plu par l'humanité avec laquelle il a été écrit et m'a inspiré beaucoup de respect pour les danseurs professionnels.
En effet je n'avais encore jamais lu un ouvrage d'Alexandre Lacroix et je ne suis pas familière du milieu de la danse. Et pourtant je me suis très rapidement plongée dans les réflexions philosophiques de l'auteur sur le sujet : pourquoi ressent-on le besoin de danser ? Comment reussit-elle à concilier mouvement et immobilité ? Discipline et folie ? En quoi est-elle un art plus proche de nos origines profondes ? Quel rapport entretient-elle avec l'immortalité ?
J'ai beaucoup aimé l'écriture "vivante " de ce livre car Alexandre Lacroix ne cite pas des auteurs poussiéreux dans de longues réflexions - même si bien sûr il reprend les écrits classiques sur la question - mais alimente toujours son propos d'études récentes (par exemple de la recherche en neurobiologie) ou d'observation des pratiques de danseurs professionnels ou d'échange avec eux
(il y a même un passage très interessant sur la manière dont les danseurs procèdent pour mémoriser les différents styles de chorégraphie). C'est d'ailleurs de cette manière qu'on rencontre Ludmila Pagliero et Stephane Bullion, deux grands danseurs très différents - Ludmila la flamboyante et très professionnelle danseuse étoile et Stéphane son discret et intense partenaire dans un exigeant ballet. Decouvrir leur parcours de vie ( là je préfère vous laisser lire) a aussi été un moment fort de ma lecture.
J'ai été touchée par le récit tout en retenu de leur vie et de leur carrière, de leurs choix et de leur besoin de danser.
Ce livre m'a beaucoup plu par l'humanité avec laquelle il a été écrit et m'a inspiré beaucoup de respect pour les danseurs professionnels.
Un texte hybride et singulier du philosophe, entre enquête au Palais Garnier et théorie d’un art.
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
Lien : https://www.lemonde.fr/livre..
D'où vient l'impulsion de danser ? Que vaut l'idée selon laquelle trop réfléchir empêcherait de bien danser ou à l'inverse celle que bien danser irait de pair avec l'inaptitude à réfléchir ? La danse est l'apanage de la bipédie dit l'auteur citant la parade nuptiale des oiseaux de paradis remarquée par Darwin comme exemples de conduites renvoyant, pour le règne animal, à cette pratique humaine unique (L'origine des espèces, 1859). Pratiquée sans doute depuis la nuit des temps préhistoriques et dans toutes les cultures, entre fêtes et rituels, la danse reste aujourd'hui un langage universel des corps.
N'est-elle qu' "un art sans ouvrage" (Aristote) ? Qu'un simple "ornement de la durée" comme l'architecture et la peinture sont "des ornements de l'espace" et ne relève-t-elle que de l' idéal "de beauté, de perfection et d'expressivité" décrit par Paul Valéry ("Degas, danse, dessin", 1938), n'est-elle qu'un leg de l'Antiquité gréco-romaine valorisant la plastique des corps ? D'où vient la danse classique et quelle est son histoire ? En quoi cette discipline se distingue-t-elle d'autres pratiques, sportive ou artistique comme le théâtre, l'écriture, la peinture ? Pourquoi fascine-t-elle toujours ?
Simples questions posées par le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix qui font entrer le néophyte et l'amateur dans la spécificité du geste et du mouvement dansé et chorégraphié au fil de déambulations à travers l'univers feutré secret de l'un de ses temples institutionnels, l'opéra Garnier. Une immersion "in situ" de l'auteur pendant un an qu'il raconte ici, témoin des entraînements, répétitions, filages ou préparations des spectacles. Les performances physiques, l'endurance des danseurs, leur discipline s'imposent d'abord à lui. Puis les défis cognitifs et mnésiques auxquels sont soumis les artistes ainsi que les paradoxes d'un art qui place ces derniers entre liberté et contrainte, fusion et dissociation du corps pour atteindre le Graal d'une interprétation partagée en public laissant apprécier et transparaitre leur originalité propre.
La danse est observée dans le registre classique (Le rouge et le noir, programmation 2021/22) ou contemporain (Pina Baush et Merce Cunningham) quand l'auteur s'attarde auprès du chorégraphe Mats Ek (Another Place, programmation 2021/22) et sur le travail de deux étoiles aux personnalités différentes dont les trajectoires sont dévoilées au fil des pages : Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion. Leurs voix mais aussi leurs silences se font entendre, leurs corps en mouvement regardés, admirés, émeuvent, interrogés par l'auteur, dans un texte dont la dimension humaine palpable est au moins équivalente à la portée conceptuelle du livre. Situations, propos et réflexions font écho à la riche mise en abîme théorique qui illustre le sujet et où s'invitent neuro-scientifiques, philosophes, penseurs du vitalisme (Bergson), psychanalystes et psychologues, écrivains et chorégraphes...
Bref, la danse apparaît ici en majesté essentiellement comme un art de la relation porté par l'engagement et le désir d'accomplissement d'artistes d'exception au sein d'un collectif qui ne l'est pas moins. La philosophie qu'on aime.
N'est-elle qu' "un art sans ouvrage" (Aristote) ? Qu'un simple "ornement de la durée" comme l'architecture et la peinture sont "des ornements de l'espace" et ne relève-t-elle que de l' idéal "de beauté, de perfection et d'expressivité" décrit par Paul Valéry ("Degas, danse, dessin", 1938), n'est-elle qu'un leg de l'Antiquité gréco-romaine valorisant la plastique des corps ? D'où vient la danse classique et quelle est son histoire ? En quoi cette discipline se distingue-t-elle d'autres pratiques, sportive ou artistique comme le théâtre, l'écriture, la peinture ? Pourquoi fascine-t-elle toujours ?
Simples questions posées par le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix qui font entrer le néophyte et l'amateur dans la spécificité du geste et du mouvement dansé et chorégraphié au fil de déambulations à travers l'univers feutré secret de l'un de ses temples institutionnels, l'opéra Garnier. Une immersion "in situ" de l'auteur pendant un an qu'il raconte ici, témoin des entraînements, répétitions, filages ou préparations des spectacles. Les performances physiques, l'endurance des danseurs, leur discipline s'imposent d'abord à lui. Puis les défis cognitifs et mnésiques auxquels sont soumis les artistes ainsi que les paradoxes d'un art qui place ces derniers entre liberté et contrainte, fusion et dissociation du corps pour atteindre le Graal d'une interprétation partagée en public laissant apprécier et transparaitre leur originalité propre.
La danse est observée dans le registre classique (Le rouge et le noir, programmation 2021/22) ou contemporain (Pina Baush et Merce Cunningham) quand l'auteur s'attarde auprès du chorégraphe Mats Ek (Another Place, programmation 2021/22) et sur le travail de deux étoiles aux personnalités différentes dont les trajectoires sont dévoilées au fil des pages : Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion. Leurs voix mais aussi leurs silences se font entendre, leurs corps en mouvement regardés, admirés, émeuvent, interrogés par l'auteur, dans un texte dont la dimension humaine palpable est au moins équivalente à la portée conceptuelle du livre. Situations, propos et réflexions font écho à la riche mise en abîme théorique qui illustre le sujet et où s'invitent neuro-scientifiques, philosophes, penseurs du vitalisme (Bergson), psychanalystes et psychologues, écrivains et chorégraphes...
Bref, la danse apparaît ici en majesté essentiellement comme un art de la relation porté par l'engagement et le désir d'accomplissement d'artistes d'exception au sein d'un collectif qui ne l'est pas moins. La philosophie qu'on aime.
J’ai adoré, j’ai envie de dire, ce roman sur la danse avec comme principaux personnages Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion et avec, comme décor, l’Opéra de Paris. J’ai tout aimé dans ce livre, de la dédicace à la dernière phrase.
Et pourtant, ce livre n’est pas un roman. C’est une enquête philosophique, un essai sur la danse. On découvre les parcours de deux danseurs étoiles. Les difficultés, les motivations, les passions de ces grands danseurs. Leurs habitudes aussi, leur façon de travailler, de mémoriser. On pénètre dans l’opéra pour y découvrir ses rouages. On y retrouve les danseurs, les chorégraphes, l’envers du décor. J’ai adoré.
Et puis, il y a toute la partie philosophique qui vient “éclairer” la lecture. Aussi fluide qu’un ballet. Avec citations, extraits, paroles et questionnements. Braquée comme un projecteur sur les pas de danse non pas pour expliquer mais pour faire réfléchir. Ce livre m’a ému. Le parcours difficile des danseurs m’a ému. Les réflexions philosophiques m’ont interpellée. Tout m’a “parlé”. Est-ce qu’on peut le dire comme ça ? J’ai été émue car même si je ne suis pas danseuse, ces réflexions s’appliquent au questionnement de la vie, à la motivation. J’ai eu envie de prendre des notes, relever des citations, des philosophes autant que des chorégraphes. J’ai beaucoup appris et pas seulement sur la danse.
Ce livre est un enchantement. J’aime la danse. Oui. Et je ne sais pas danser. J’aime ces ballets classiques, j’aime ces ballets modernes. Et je n’en vois pas assez. J’adore l’Opéra Garnier. Je suis ce genre de personne qui lorsqu’elle arrive à Paris, descend à la station Métro Opéra, et à la sortie du métro, se plante devant l’Opéra pour prendre LA photo. A chaque fois, l’émotion est là. A l’extérieur. En pensant à l’intérieur. Les statues dorées sur le toit. Les colonnes. Les inscriptions. La foule sur les marches les soirs de ballets et même en journée. Il y a un dôme magique qui entoure ce monument.
J’ai eu la chance de m’asseoir dans cet opéra magnifique et de voir Ludmila Pagliero danser Mayerling. L’effet de troupe, d’unité, dans un ballet comme celui-ci, est une évidence. Lorsqu’on assiste à un ballet on ne voit pas la perfection de chaque pas, la connexion des danseurs, mais on les ressent. C’est justement tellement parfait qu’on l’oublie et qu’on se laisse porter. En tant que spectateur, on est là pour assister à la finalité de ce qui représente pour chaque danseur un travail de titan. On vient assister au “spectacle” pour profiter de cette perfection. Est-ce que ces danseurs savent qu’on est en état de transe de les voir danser aussi bien ? Et pour Another Place avec Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion, il y a cette fluidité, cette souplesse et toujours une évidence, une connexion, une émotion.
Et pour rebondir sur le passage sur les traces et les traversées (page 220), je souhaite souligner que les traces qui restent dans la mémoire des spectateurs à l’issue d’un ballet sont indélébiles. Tous ne sont pas blasés, et je me pose plutôt du côté de la petite dame en chapeau de feutrine bleue.
Aujourd’hui, j’en sais un peu plus sur ce qui se joue dans les coulisses et dans les têtes de “nos” danseurs. Il me tarde d’aller, très vite, leur rendre visite.
Merci à Allary Editions, à Babelio et ces masses critiques qui me surprennent à chaque fois, et merci aux danseurs pour tout ce qu’ils nous apportent de plaisir et d’émerveillement.
Et pourtant, ce livre n’est pas un roman. C’est une enquête philosophique, un essai sur la danse. On découvre les parcours de deux danseurs étoiles. Les difficultés, les motivations, les passions de ces grands danseurs. Leurs habitudes aussi, leur façon de travailler, de mémoriser. On pénètre dans l’opéra pour y découvrir ses rouages. On y retrouve les danseurs, les chorégraphes, l’envers du décor. J’ai adoré.
Et puis, il y a toute la partie philosophique qui vient “éclairer” la lecture. Aussi fluide qu’un ballet. Avec citations, extraits, paroles et questionnements. Braquée comme un projecteur sur les pas de danse non pas pour expliquer mais pour faire réfléchir. Ce livre m’a ému. Le parcours difficile des danseurs m’a ému. Les réflexions philosophiques m’ont interpellée. Tout m’a “parlé”. Est-ce qu’on peut le dire comme ça ? J’ai été émue car même si je ne suis pas danseuse, ces réflexions s’appliquent au questionnement de la vie, à la motivation. J’ai eu envie de prendre des notes, relever des citations, des philosophes autant que des chorégraphes. J’ai beaucoup appris et pas seulement sur la danse.
Ce livre est un enchantement. J’aime la danse. Oui. Et je ne sais pas danser. J’aime ces ballets classiques, j’aime ces ballets modernes. Et je n’en vois pas assez. J’adore l’Opéra Garnier. Je suis ce genre de personne qui lorsqu’elle arrive à Paris, descend à la station Métro Opéra, et à la sortie du métro, se plante devant l’Opéra pour prendre LA photo. A chaque fois, l’émotion est là. A l’extérieur. En pensant à l’intérieur. Les statues dorées sur le toit. Les colonnes. Les inscriptions. La foule sur les marches les soirs de ballets et même en journée. Il y a un dôme magique qui entoure ce monument.
J’ai eu la chance de m’asseoir dans cet opéra magnifique et de voir Ludmila Pagliero danser Mayerling. L’effet de troupe, d’unité, dans un ballet comme celui-ci, est une évidence. Lorsqu’on assiste à un ballet on ne voit pas la perfection de chaque pas, la connexion des danseurs, mais on les ressent. C’est justement tellement parfait qu’on l’oublie et qu’on se laisse porter. En tant que spectateur, on est là pour assister à la finalité de ce qui représente pour chaque danseur un travail de titan. On vient assister au “spectacle” pour profiter de cette perfection. Est-ce que ces danseurs savent qu’on est en état de transe de les voir danser aussi bien ? Et pour Another Place avec Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion, il y a cette fluidité, cette souplesse et toujours une évidence, une connexion, une émotion.
Et pour rebondir sur le passage sur les traces et les traversées (page 220), je souhaite souligner que les traces qui restent dans la mémoire des spectateurs à l’issue d’un ballet sont indélébiles. Tous ne sont pas blasés, et je me pose plutôt du côté de la petite dame en chapeau de feutrine bleue.
Aujourd’hui, j’en sais un peu plus sur ce qui se joue dans les coulisses et dans les têtes de “nos” danseurs. Il me tarde d’aller, très vite, leur rendre visite.
Merci à Allary Editions, à Babelio et ces masses critiques qui me surprennent à chaque fois, et merci aux danseurs pour tout ce qu’ils nous apportent de plaisir et d’émerveillement.
Pendant un an, l’écrivain français Alexandre Lacroix a eu le privilège de suivre deux danseurs étoiles de l’Opéra de Paris, Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion, dans leur travail quotidien. Une immersion exceptionnelle qu’il raconte, à la faveur de ses questionnements et à la lumière de plusieurs penseurs, dans son essai “La danse – Philosophie du corps en mouvement”.
Lien : https://www.lalibre.be/cultu..
Lien : https://www.lalibre.be/cultu..
Une très forte nécessité intérieure. Pourquoi danser ?
D’emblée, Alexandre Lacroix adopte le point de vue rationnel du reporter : je redoute un livre savant qui présage des envolées didactiques avec les cadres historiques d’usages et les lourdeurs du genre...
Heureusement, cette posture académique est une astuce pour aborder avec des êtres de chair et d’âme toutes les questions, lui autoriser même des évocations quasi fusionnelles voire omniscientes . Osant les digressions descriptives ou les sursauts narratifs des feuilletons radiophoniques, il fusionne les intervenants en économisant les précisions diacritiques : "Ce que tu cherchais là-bas, c’est ce dépouillement, cette simplicité ? Oui ! Quand tu vis dans la nature pendant une semaine, t’es ramené à des actions élémentaires."
Ce qu’il éveille, par ces jeux d’écriture, c’est une vérité émotionnelle commune à chacun : ses larmes sont là, retenues. Elles ne coulent pas. Elles contiennent l’histoire de sa vie.
L’écriture d’Alexandre Lacroix n’est pas savante ou travaillée : elle est soignée et libre, entièrement dédiée à son objet qui est l’élan artistique : une peur et une joie d’être en union avec la vie enracinées dans la divine enfance !
D’emblée, Alexandre Lacroix adopte le point de vue rationnel du reporter : je redoute un livre savant qui présage des envolées didactiques avec les cadres historiques d’usages et les lourdeurs du genre...
Heureusement, cette posture académique est une astuce pour aborder avec des êtres de chair et d’âme toutes les questions, lui autoriser même des évocations quasi fusionnelles voire omniscientes . Osant les digressions descriptives ou les sursauts narratifs des feuilletons radiophoniques, il fusionne les intervenants en économisant les précisions diacritiques : "Ce que tu cherchais là-bas, c’est ce dépouillement, cette simplicité ? Oui ! Quand tu vis dans la nature pendant une semaine, t’es ramené à des actions élémentaires."
Ce qu’il éveille, par ces jeux d’écriture, c’est une vérité émotionnelle commune à chacun : ses larmes sont là, retenues. Elles ne coulent pas. Elles contiennent l’histoire de sa vie.
L’écriture d’Alexandre Lacroix n’est pas savante ou travaillée : elle est soignée et libre, entièrement dédiée à son objet qui est l’élan artistique : une peur et une joie d’être en union avec la vie enracinées dans la divine enfance !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Alexandre Lacroix
Lecteurs de Alexandre Lacroix (602)Voir plus
Quiz
Voir plus
1984 - Orwell
Comment s'appelle le personnage principal du roman ?
Wilson
Winston
William
Whitney
10 questions
2294 lecteurs ont répondu
Thème : 1984 de
George OrwellCréer un quiz sur cet auteur2294 lecteurs ont répondu