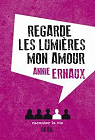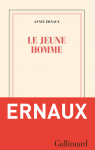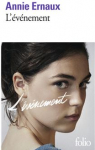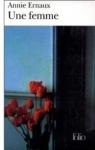Critiques de Annie Ernaux (2620)
Un livre que j'avais déjà lu car certains passages ont résonné.
Extraits de journal intime, posés là. "Parce que voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence."
L'autrice nous fait part de ses expériences de l'hypermarché en philosophant sur la vie.
C'est un livre qui est forcément marqué temporellement comme elle le note à la dernière page puisque les hypermarchés sont maintenant délaissés et n'ont plus rien de nouveau.
J'ai aimé sa réflexion sur la place de ces endroits dans la littérature.
Un seul mot inconnu dans ces 61 pages
O comme L'orthosiphon, appelé aussi « thé de Java », tire son nom du grec « orthos » qui signifie, « élancé », et de « syphon » qui signifie « tuyau », du fait de l'aspect botanique caractéristique de sa corolle. Il est utilisé traditionnellement pour soigner de nombreuses affections liées aux voies urinaires et biliaires.
Extraits de journal intime, posés là. "Parce que voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence."
L'autrice nous fait part de ses expériences de l'hypermarché en philosophant sur la vie.
C'est un livre qui est forcément marqué temporellement comme elle le note à la dernière page puisque les hypermarchés sont maintenant délaissés et n'ont plus rien de nouveau.
J'ai aimé sa réflexion sur la place de ces endroits dans la littérature.
Un seul mot inconnu dans ces 61 pages
O comme L'orthosiphon, appelé aussi « thé de Java », tire son nom du grec « orthos » qui signifie, « élancé », et de « syphon » qui signifie « tuyau », du fait de l'aspect botanique caractéristique de sa corolle. Il est utilisé traditionnellement pour soigner de nombreuses affections liées aux voies urinaires et biliaires.
Très beau texte écrit sous forme de lettre à la soeur aînée disparue... Un secret de famille pesant comme une chape de plomb, et qui ne sera jamais levé.
78 pages seulement pour ce récit très fort, criant de vérité et de douleur.
J'ai beaucoup aimé ce récit.
78 pages seulement pour ce récit très fort, criant de vérité et de douleur.
J'ai beaucoup aimé ce récit.
"Je voudrais dire à la fois le bonheur et l'aliénation." Telle est la mission que se donne Annie Ernaux en nous donnant à lire ce court et fort récit sur sa famille et tout particulièrement sur son père, d'origine paysanne, devenu ouvrier puis commerçant, tenant avec sa femme un modeste "bar-épicerie-bois-charbons" dans la petite ville normande d'Yvetot. Elle ajoute, lucide : "Impression, bien plutôt, de tanguer d'un bord à l'autre de cette contradiction." En effet, de ces deux pôles – bonheur et aliénation –, on a le sentiment que c'est largement l'aliénation qui domine et notamment dans le langage de son père, qu'elle souligne ici en italique et qui montre combien son univers est contraint, répétitif et gris : "Il gardait ses idées pour lui. Il n'en faut pas dans le commerce" ; "Ils avaient peur d'être roulés, de tout perdre pour finalement retomber ouvrier". le bonheur est ici plus difficile à percevoir, par exemple : "Dans la cour, l'hiver, il crachait et éternuait avec plaisir.".
Certains lecteurs se sont indignés devant ce qui leur semblait être du mépris pour ses parents, ou, pire encore, un mépris de classe envers les petites gens. Je m'insurge contre cette interprétation qui me semble relever d'un contresens total. En écrivant ce texte, Annie Ernaux clame haut et fort qu'elle appartient à ce milieu populaire mais elle en dénonce le caractère aliénant. Ce qui est aliénant, c'est la condition sociale de ces gens. C'est elle qui marque de son empreinte leurs faits et gestes, et leur langage. On ressent aussi par ce texte toute la force qu'il faut à une jeune fille pour s'affranchir de cette aliénation, sans pour autant renier ses origines. Car je ne vois dans ce livre aucun reniement. Juste un regard lucide, sans fausse complaisance, porté sur son père et sur la distance qui se creusait entre ce père et sa fille, en quête d'émancipation.
Le style d'Annie Ernaux a aussi été décrié en s'appuyant sur les mots même de l'auteur : "Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, {...]". A mon avis, il faut ici entendre "plat", non pas comme "insipide" ou "monotone" mais plutôt comme "dénué de tout lyrisme". Elle cherche à écrire de façon dépassionnée, factuelle. Mais l'écrivain est bien là, dans le choix des mots, le choix des angles pour ses "prises de vues", le choix de faire apparaître par petites touches l'écrivain au cours de son récit. Pour moi qui ai attendu si longtemps avant de découvrir cette auteure, ce style est absolument superbe, parfaitement adapté à son propos. C'est à peu près ce que j'avais également ressenti à la lecture du roman d'Edouard Louis "En finir avec Eddie Bellegueule", roman lui aussi controversé.
Seul regret à la lecture de "La place" : la brièveté du texte. Mais heureusement, il me reste les autres "chapitres" de la vie d'Annie Ernaux à découvrir.
Certains lecteurs se sont indignés devant ce qui leur semblait être du mépris pour ses parents, ou, pire encore, un mépris de classe envers les petites gens. Je m'insurge contre cette interprétation qui me semble relever d'un contresens total. En écrivant ce texte, Annie Ernaux clame haut et fort qu'elle appartient à ce milieu populaire mais elle en dénonce le caractère aliénant. Ce qui est aliénant, c'est la condition sociale de ces gens. C'est elle qui marque de son empreinte leurs faits et gestes, et leur langage. On ressent aussi par ce texte toute la force qu'il faut à une jeune fille pour s'affranchir de cette aliénation, sans pour autant renier ses origines. Car je ne vois dans ce livre aucun reniement. Juste un regard lucide, sans fausse complaisance, porté sur son père et sur la distance qui se creusait entre ce père et sa fille, en quête d'émancipation.
Le style d'Annie Ernaux a aussi été décrié en s'appuyant sur les mots même de l'auteur : "Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, {...]". A mon avis, il faut ici entendre "plat", non pas comme "insipide" ou "monotone" mais plutôt comme "dénué de tout lyrisme". Elle cherche à écrire de façon dépassionnée, factuelle. Mais l'écrivain est bien là, dans le choix des mots, le choix des angles pour ses "prises de vues", le choix de faire apparaître par petites touches l'écrivain au cours de son récit. Pour moi qui ai attendu si longtemps avant de découvrir cette auteure, ce style est absolument superbe, parfaitement adapté à son propos. C'est à peu près ce que j'avais également ressenti à la lecture du roman d'Edouard Louis "En finir avec Eddie Bellegueule", roman lui aussi controversé.
Seul regret à la lecture de "La place" : la brièveté du texte. Mais heureusement, il me reste les autres "chapitres" de la vie d'Annie Ernaux à découvrir.
J’ai aimé lire sous la plume d’Annie Ernaux l’histoire d’une passion. Elle décrit l’état d’absolu dépendance, de soumission affective et sexuelle qui lui fait durant quelques mois oublier son quotidien.
Elle ne vivait plus que dans l’attente d’un coup de fil de son amant, employé à l’ambassade de Russie. Sans téléphone portable, elle passait des heures chez elle, de peur de manquer l’appel, ne se permettant aucun bruit, ni aspirateur, ni sèche- cheveux qui pourrait masquer la sonnerie.
L’écriture d’Annie Ernaux, que je trouve magnifique par sa simplicité, parvient à illuminer une histoire ô combien banale.
Elle ne vivait plus que dans l’attente d’un coup de fil de son amant, employé à l’ambassade de Russie. Sans téléphone portable, elle passait des heures chez elle, de peur de manquer l’appel, ne se permettant aucun bruit, ni aspirateur, ni sèche- cheveux qui pourrait masquer la sonnerie.
L’écriture d’Annie Ernaux, que je trouve magnifique par sa simplicité, parvient à illuminer une histoire ô combien banale.
La place... Laquelle ? Celle de l'épicerie-buvette des parents d'Annie Ernaux, la place de la famille dans la vie ou encore la place dans la société ?
Dans ce livre à caractère autobiographique (ce n'est pas un roman) l'autrice nous parle de son père, de leurs relations distendues. Elle en dresse un portrait objectif, froid, sans affect et parvient malgré tout à lui rendre un bel hommage. Ce récit, confie Annie Ernaux, "est né de la douleur d'avoir perdu son père", d'un certain remord. Elle le ressent comme une juste réparation à l'éloignement survenu entre eux deux dans les dernières années.
Le père de l'autrice est né et à vécu dans la misère toute sa jeunesse. Peu instruit il a quitté l'école très tôt, à douze ans pour être placé dans une ferme, comme garçon vacher (c'était courant à l'époque), il travaille ensuite durement, physiquement, comme ouvrier d'usine ; après son mariage à force d'efforts et de privations, il achète avec sa femme un tout petit commerce d'épicerie qui leur rapporte peu et ne leur permet hélas pas de vivre décemment. Après la fin de la seconde guerre mondiale, à Yvetot sur les cendres d'une ville en ruines, le couple parvient à acquérir un modeste café-épicerie. C'est là qu'Annie Ernaux grandira et passera la plus grande partie de sa jeunesse. Un univers peuplé de "petites gens" qui vivent dans un extrême dénuement et qui "comptent" sans relâche pour boucler leurs fins de mois. Familiarité, précarité, vulgarité, langage peu évolué avec même des bribes de patois normand ; au fur et à mesure que l'autrice, "apprendra bien à l'école" et fera des études plus poussées, elle se rendra compte des différences de classe sociale et s'éloignera progressivement de ses parents, dont pourtant le souhait intime était qu'elle puisse se sortir de leur condition sociale inférieure. Effectivement, elle deviendra professeure de lettres, un "poste haut placé" et s'élèvera dans la société...
Annie Ernaux, avec son écriture "plate", simple, factuelle, signe un récit fort et émouvant. Elle arrive par ses descriptions précises et réalistes des "gens d'en bas" à toucher le lecteur. Ses paroles à la portée universelle rappellent à chacun des souvenirs lointains, des détails évoqués par les parents ou grands-parents, tout un monde fait de dur labeur, d'une extrême simplicité ,sans confort, ni hygiène, des conditions de vie qu'on a du mal à se remémorer.
Quant à son père, on décèle derrière ce portrait sobre et froid qu'en compose Annie Ernaux, beaucoup de tendresse et de regrets. La culture les avait séparés, cet hommage les a à nouveau rapprochés.
#Challenge Riquiqui 2023
Dans ce livre à caractère autobiographique (ce n'est pas un roman) l'autrice nous parle de son père, de leurs relations distendues. Elle en dresse un portrait objectif, froid, sans affect et parvient malgré tout à lui rendre un bel hommage. Ce récit, confie Annie Ernaux, "est né de la douleur d'avoir perdu son père", d'un certain remord. Elle le ressent comme une juste réparation à l'éloignement survenu entre eux deux dans les dernières années.
Le père de l'autrice est né et à vécu dans la misère toute sa jeunesse. Peu instruit il a quitté l'école très tôt, à douze ans pour être placé dans une ferme, comme garçon vacher (c'était courant à l'époque), il travaille ensuite durement, physiquement, comme ouvrier d'usine ; après son mariage à force d'efforts et de privations, il achète avec sa femme un tout petit commerce d'épicerie qui leur rapporte peu et ne leur permet hélas pas de vivre décemment. Après la fin de la seconde guerre mondiale, à Yvetot sur les cendres d'une ville en ruines, le couple parvient à acquérir un modeste café-épicerie. C'est là qu'Annie Ernaux grandira et passera la plus grande partie de sa jeunesse. Un univers peuplé de "petites gens" qui vivent dans un extrême dénuement et qui "comptent" sans relâche pour boucler leurs fins de mois. Familiarité, précarité, vulgarité, langage peu évolué avec même des bribes de patois normand ; au fur et à mesure que l'autrice, "apprendra bien à l'école" et fera des études plus poussées, elle se rendra compte des différences de classe sociale et s'éloignera progressivement de ses parents, dont pourtant le souhait intime était qu'elle puisse se sortir de leur condition sociale inférieure. Effectivement, elle deviendra professeure de lettres, un "poste haut placé" et s'élèvera dans la société...
Annie Ernaux, avec son écriture "plate", simple, factuelle, signe un récit fort et émouvant. Elle arrive par ses descriptions précises et réalistes des "gens d'en bas" à toucher le lecteur. Ses paroles à la portée universelle rappellent à chacun des souvenirs lointains, des détails évoqués par les parents ou grands-parents, tout un monde fait de dur labeur, d'une extrême simplicité ,sans confort, ni hygiène, des conditions de vie qu'on a du mal à se remémorer.
Quant à son père, on décèle derrière ce portrait sobre et froid qu'en compose Annie Ernaux, beaucoup de tendresse et de regrets. La culture les avait séparés, cet hommage les a à nouveau rapprochés.
#Challenge Riquiqui 2023
Annie Ernaux nous parle de son père.
Issu du monde paysan, ouvrier devenu commerçant, il passera sa vie à rechercher les barreaux de l’ascension sociale.
C’est par sa fille, à qui il donnera la possibilité de faire des études poussées, qu’il y parviendra, en toute discrétion et sans jamais s’en donner la responsabilité.
Car cet accès au savoir, cette ouverture à la culture les séparera, créera un gouffre d’incompréhension mutuelle.
Cependant, j’ai trouvé que l’autrice est très tendre avec son père, modulant subtilement ses qualités humaines. Elle exprime ainsi son admiration pour ce travailleur courageux et généreux.
Elle se sert aussi de ce « personnage » pour faire le portrait d’une génération qui a connu les deux guerres, qui s’est souvent perdue dans ce que l’on a appelé le progrès et la modernité. Il est assez effarant du reste de constater que la génération actuelle exprime la volonté de revenir vers ces valeurs jugées plus authentiques.
On parle beaucoup de l’écriture plate d’Annie Ernaux, la qualifiant sans style. Elle-même l’évoque dans ce texte, expliquant qu’elle évite de transmettre des sentiments, de jouer sur les émotions et qu’elle est la façon la plus adéquate pour produire la simple retranscription des faits.
Pour ma part, j’ai trouvé effectivement que cela donne une portée très symbolique au récit lui conférant un témoignage universel.
Bon. Euh. Pfffou.
Que dire. Qu’écrire. J’avais pensé à être dans un minimalisme épuré, mais j’ai eu le sentiment d’une histoire d’amour entre Teddy Slexique et Gérard Menjoui. La queen publie ainsi un court, que dis-je une péninsule de mots collés les uns aux autres sans liant. Sans assaisonnement. C’est fade et gris. Soit. Pourquoi pas une novella bien sentie ? Même pas. Mon coît littéraire fut coupé sans élan dans une horde de détails qui ne font pas corps. En 1935 ce texte aurait peut-être agité la sphère mondaine d’entre deux guerres. En 2022 être outré par un « lâche-moi la grappe » s’apparente davantage à un podcast pour la famille Bélier. Tu te rends compte !? Je lui ai dit « lâche-moi la grappe », qu’elle violence ! J’ai davantage vibré devant Les feux de l’amour saison 56, épisode 2390.
Dire que je me suis ennuyé serait faux, je n’en ai même pas eu le temps. À peine ouvert je terminais la dernière phrase, circonspect devant un je-ne-sais-quoi. Rempli de vide charnel. Je résume : Annie Ernaux a couché avec un étudiant âgé de trente ans de moins. Lui, aime Europe 2 et Nulle part ailleurs, elle le regarde manger des frites, vous avez le début, l’élément déclencheur et la fin. À ce rythme là chaque phrase peut devenir un roman à lui tout seul. Je ne suis pas aussi dur car le prénom de cet étudiant commence par un A. Je n’ai pas été éconduit par Annie Ernaux et Dieu m’en garde j’aurais été triste de voir que notre histoire se résume à ces mots sans vie et sans chair dans un si petit livre qu’il ne correspond à aucun ordre de grandeur sur l’échelle de Dexter (l’échelle de Richter pour les mauvais livres).
J’entends déjà les puristes dire qu’il faut la prendre comme un ensemble et non de manière isolée. Sur sa capacité à s’introduire en elle-même tel un fœtus littéraire ou sa brillante lucidité, son inénarrable simplicité (si je veux du simple j’appelle Orelsan. Basique. Simple. Basique) sur les bribes de son existence et qu’il faut lire le reste de ses textes. Sûrement. Mais là la chérie c’est un fashion faux-pas. Je ne peux m’empêcher de penser que Pascal, 56 ans prestidigitateur à la retraite dans le Calvados a sûrement bien plus de choses succulentes à nous raconter. Ce fut ainsi un coup pour rien où l’écriture de cette chronique a pris davantage de temps que la lecture dudit ouvrage. Au moins je peux rapidement me tourner vers une autre lecture.
Que dire. Qu’écrire. J’avais pensé à être dans un minimalisme épuré, mais j’ai eu le sentiment d’une histoire d’amour entre Teddy Slexique et Gérard Menjoui. La queen publie ainsi un court, que dis-je une péninsule de mots collés les uns aux autres sans liant. Sans assaisonnement. C’est fade et gris. Soit. Pourquoi pas une novella bien sentie ? Même pas. Mon coît littéraire fut coupé sans élan dans une horde de détails qui ne font pas corps. En 1935 ce texte aurait peut-être agité la sphère mondaine d’entre deux guerres. En 2022 être outré par un « lâche-moi la grappe » s’apparente davantage à un podcast pour la famille Bélier. Tu te rends compte !? Je lui ai dit « lâche-moi la grappe », qu’elle violence ! J’ai davantage vibré devant Les feux de l’amour saison 56, épisode 2390.
Dire que je me suis ennuyé serait faux, je n’en ai même pas eu le temps. À peine ouvert je terminais la dernière phrase, circonspect devant un je-ne-sais-quoi. Rempli de vide charnel. Je résume : Annie Ernaux a couché avec un étudiant âgé de trente ans de moins. Lui, aime Europe 2 et Nulle part ailleurs, elle le regarde manger des frites, vous avez le début, l’élément déclencheur et la fin. À ce rythme là chaque phrase peut devenir un roman à lui tout seul. Je ne suis pas aussi dur car le prénom de cet étudiant commence par un A. Je n’ai pas été éconduit par Annie Ernaux et Dieu m’en garde j’aurais été triste de voir que notre histoire se résume à ces mots sans vie et sans chair dans un si petit livre qu’il ne correspond à aucun ordre de grandeur sur l’échelle de Dexter (l’échelle de Richter pour les mauvais livres).
J’entends déjà les puristes dire qu’il faut la prendre comme un ensemble et non de manière isolée. Sur sa capacité à s’introduire en elle-même tel un fœtus littéraire ou sa brillante lucidité, son inénarrable simplicité (si je veux du simple j’appelle Orelsan. Basique. Simple. Basique) sur les bribes de son existence et qu’il faut lire le reste de ses textes. Sûrement. Mais là la chérie c’est un fashion faux-pas. Je ne peux m’empêcher de penser que Pascal, 56 ans prestidigitateur à la retraite dans le Calvados a sûrement bien plus de choses succulentes à nous raconter. Ce fut ainsi un coup pour rien où l’écriture de cette chronique a pris davantage de temps que la lecture dudit ouvrage. Au moins je peux rapidement me tourner vers une autre lecture.
Je ne rentrerai pas dans cette polémique ridicule à propos de ce livre.
Je n'ai pas compris cette agressivité chevillée au corps de certains ou certaines.
Je n'ai trouvé à aucun moment ce mépris ou bien cette honte dont parlent les uns et les autres.
Bien au contraire.
Comme quoi une même oeuvre offre des sentiments très différents.
Je l'ai trouvé touchant ce livre.
Annie Ernaux brosse un portrait de son père, certes en--dessous de sa position sociale, mais elle en parle avec une certaine distance puis avec un attachement que l'on ne peut nier.
Son père l'aime très fort, il est fier d'elle et de sa condition d'intellectuelle.
La place. Cette place offerte à ceux qui lisent, écrivent et corrigent des copies.
Cette place, elle en a souffert, elle a été lourde pour elle, elle l'a portée à bout de bras.
La place que son père a des difficultés à appréhender mais qui l'accepte sans méchanceté, sans jugement, lui qui parle encore patois de temps en temps.
Il est courageux cet homme, il travaille toujours. D'abord l'usine, puis le commerce, tout ça de ses mains. Annie Ernaux aime son père, et n'en tire aucun sentiment négatif.
Je l'ai trouvé d'ailleurs respectueuse et pleine de tendresse.
J'ai tenté de les apercevoir ces deux méchants mots, tant certains ne l'ont qu'à la bouche. Mais non, je ne les ai pas trouvés.
C'est sans doute cette écrtiture très particulière qui les a fourvoyé.
Annie Ernaux écrit la vraie vie, elle relate avec une certaine émotion ce père si lointain. Elle écrit la Vie, elle décrit un amour paternel très touchant. Mais avec une certaine distance, c'est sa marque de fabrique, son univers littéraire, son style. Après tout si l'on n'apprécie pas cette écriture distanciée, pourquoi la lire ?
C'est un livre d'une fille à son père, un hommage que, il me semble, peu ont compris, dénigrant l'auteure avec haine et mépris. Et oui, pour moi, il y a du mépris pour cette oeuvre. L'arroseur arrosé...
C'est eux qui ressentent le mépris ( à voir dans leur Histoire familiale, merci Freud), qui ressentent un malaise presque profond pour ce texte magnifique de justesse et de tendresse.
C'est le livre du Père (il l'a bien mérité) que nous offre ici Annie Ernaux.
Rien d'autre.
Ps : je viens de m'apercevoir que, pour moi, le titre évoque la place d'Annie Ernaux et non celle de son père.
Intéressant....
Je n'ai pas compris cette agressivité chevillée au corps de certains ou certaines.
Je n'ai trouvé à aucun moment ce mépris ou bien cette honte dont parlent les uns et les autres.
Bien au contraire.
Comme quoi une même oeuvre offre des sentiments très différents.
Je l'ai trouvé touchant ce livre.
Annie Ernaux brosse un portrait de son père, certes en--dessous de sa position sociale, mais elle en parle avec une certaine distance puis avec un attachement que l'on ne peut nier.
Son père l'aime très fort, il est fier d'elle et de sa condition d'intellectuelle.
La place. Cette place offerte à ceux qui lisent, écrivent et corrigent des copies.
Cette place, elle en a souffert, elle a été lourde pour elle, elle l'a portée à bout de bras.
La place que son père a des difficultés à appréhender mais qui l'accepte sans méchanceté, sans jugement, lui qui parle encore patois de temps en temps.
Il est courageux cet homme, il travaille toujours. D'abord l'usine, puis le commerce, tout ça de ses mains. Annie Ernaux aime son père, et n'en tire aucun sentiment négatif.
Je l'ai trouvé d'ailleurs respectueuse et pleine de tendresse.
J'ai tenté de les apercevoir ces deux méchants mots, tant certains ne l'ont qu'à la bouche. Mais non, je ne les ai pas trouvés.
C'est sans doute cette écrtiture très particulière qui les a fourvoyé.
Annie Ernaux écrit la vraie vie, elle relate avec une certaine émotion ce père si lointain. Elle écrit la Vie, elle décrit un amour paternel très touchant. Mais avec une certaine distance, c'est sa marque de fabrique, son univers littéraire, son style. Après tout si l'on n'apprécie pas cette écriture distanciée, pourquoi la lire ?
C'est un livre d'une fille à son père, un hommage que, il me semble, peu ont compris, dénigrant l'auteure avec haine et mépris. Et oui, pour moi, il y a du mépris pour cette oeuvre. L'arroseur arrosé...
C'est eux qui ressentent le mépris ( à voir dans leur Histoire familiale, merci Freud), qui ressentent un malaise presque profond pour ce texte magnifique de justesse et de tendresse.
C'est le livre du Père (il l'a bien mérité) que nous offre ici Annie Ernaux.
Rien d'autre.
Ps : je viens de m'apercevoir que, pour moi, le titre évoque la place d'Annie Ernaux et non celle de son père.
Intéressant....
C'est l'histoire d'une femme qui décide de sa vie.
Celle de disposer de son corps, du temps de la maternité. Il lui faudra affronter ses propres doutes mais le plus éprouvant aura été le regard suspicieux des autres, surtout au sein du corps médical.
Avorter, au sens clinique et philosophique : voilà ce que relate Annie Ernaux à travers l'évènement.
Réaliste, touchant et poignant.
Celle de disposer de son corps, du temps de la maternité. Il lui faudra affronter ses propres doutes mais le plus éprouvant aura été le regard suspicieux des autres, surtout au sein du corps médical.
Avorter, au sens clinique et philosophique : voilà ce que relate Annie Ernaux à travers l'évènement.
Réaliste, touchant et poignant.
Durant une année, de novembre 2012 à octobre 2013, l'écrivaine Annie Ernaux a tenu un journal sur ses visites à l'hypermarché Auchan de Cergy dans le Val d'Oise. Familière de ce lieu où elle se rend régulièrement pour faire ses achats, elle fait de ce temple de la consommation un sujet littéraire. Ni enquête ni reportage, c'est bel et bien un relevé libre et intime d'observations, de sensations, qui tente de retranscrire des comportements , des gestes, quelque chose de notre vie à tous.
Les premières observations de l'écrivaine, très minutieuses, la conduisent rapidement à dénoncer cet univers qui nous pousse à la consommation de manière pernicieuse, qui nous séduit par des rêves et des mensonges, et nous attache à lui par des injonctions cachées. Lieu de rentabilité, lieu de surveillance aussi où les caméras nous scrutent et où les cartes de fidélité dévoilent tout de nous. Rien n'est innocent dans les supposés « offres promotionnelles » où l'on fait croire aux gens qu'ils « gagnent » de l'argent. de l'art d'embobiner le chaland...
Pourtant, comme pour beaucoup de personnes – moi y compris – l'hypermarché est un lieu incontournable de notre vie quotidienne, un lieu où l'on retrouve certains de nos repères. le rituel des courses du samedi matin, les gens que l'on croise régulièrement sans jamais les connaître, la flânerie dans la galerie marchande… Comme nous, c'est donc avec ambivalence que l'auteure observe ce lieu paradoxal, image réduite de notre société. A travers des petits tableaux de vie, l'écrivaine retrouve dans cet espace un sexisme admis dans notre société (regardez le rayon jouets au moment des fêtes de fin d'année...) et les inégalités sociales, avec notamment le rayon discount qui propose non seulement des produits à bas prix industrialisés et insipides, mais qui les propose forcément dans des emballages les plus basiques possibles et bien reconnaissables. le passage à la caisse, quand se rassemblent tous les clients de conditions et âges différents, est ce moment où chacun dévoile sa plus grande intimité : compte en banque, habitudes alimentaires, hygiéniques, sanitaires… Pourtant, nulle gêne. En effet, l'anonymat est roi à l'hypermarché. On se frôle, on se côtoie mais on reste tous des « invisibles » les uns pour les autres. C'est la règle. Qui penserait à engager la conversation avec un inconnu dans ce lieu ?
Lieu d'injustice et lieu de communion, lieu de distraction et de flânerie, l'hypermarché est tout simplement un lieu de vie.
« Regarde les lumières mon amour » est le premier livre que je lis d'Annie Ernaux. Court et rapide à lire dans un style vivant et fin, ce petit livre confirme le talent de cette écrivaine dont on m'a souvent vanté les ouvrages.
Les premières observations de l'écrivaine, très minutieuses, la conduisent rapidement à dénoncer cet univers qui nous pousse à la consommation de manière pernicieuse, qui nous séduit par des rêves et des mensonges, et nous attache à lui par des injonctions cachées. Lieu de rentabilité, lieu de surveillance aussi où les caméras nous scrutent et où les cartes de fidélité dévoilent tout de nous. Rien n'est innocent dans les supposés « offres promotionnelles » où l'on fait croire aux gens qu'ils « gagnent » de l'argent. de l'art d'embobiner le chaland...
Pourtant, comme pour beaucoup de personnes – moi y compris – l'hypermarché est un lieu incontournable de notre vie quotidienne, un lieu où l'on retrouve certains de nos repères. le rituel des courses du samedi matin, les gens que l'on croise régulièrement sans jamais les connaître, la flânerie dans la galerie marchande… Comme nous, c'est donc avec ambivalence que l'auteure observe ce lieu paradoxal, image réduite de notre société. A travers des petits tableaux de vie, l'écrivaine retrouve dans cet espace un sexisme admis dans notre société (regardez le rayon jouets au moment des fêtes de fin d'année...) et les inégalités sociales, avec notamment le rayon discount qui propose non seulement des produits à bas prix industrialisés et insipides, mais qui les propose forcément dans des emballages les plus basiques possibles et bien reconnaissables. le passage à la caisse, quand se rassemblent tous les clients de conditions et âges différents, est ce moment où chacun dévoile sa plus grande intimité : compte en banque, habitudes alimentaires, hygiéniques, sanitaires… Pourtant, nulle gêne. En effet, l'anonymat est roi à l'hypermarché. On se frôle, on se côtoie mais on reste tous des « invisibles » les uns pour les autres. C'est la règle. Qui penserait à engager la conversation avec un inconnu dans ce lieu ?
Lieu d'injustice et lieu de communion, lieu de distraction et de flânerie, l'hypermarché est tout simplement un lieu de vie.
« Regarde les lumières mon amour » est le premier livre que je lis d'Annie Ernaux. Court et rapide à lire dans un style vivant et fin, ce petit livre confirme le talent de cette écrivaine dont on m'a souvent vanté les ouvrages.
Quand, Causette avait demandé à Annie Ernaux, quels étaient ses projets en cours, elle avait répondu :
« Je travaille sur une matière, et cette matière, c'est la femme. L'entrée dans la sexualité, la découverte de l'homme. J'ai décidé d'explorer le gouffre de ma vie. ».
Elle avait également affirmé que ce texte était « celui qui manquait », et je veux bien le comprendre, car Mémoire de fille, c'est le récit de la fragilité de certaines femmes offrant leur corps à un homme qui bientôt les laissera effacées ou vides. On y lit la force du pouvoir masculin sur la quête idéalisée d'une jeune fille mal informée et grisée par son euphorie de vivre, pour la première fois, dans un groupe de garçons (et quels garçons !).
Reconnaissons, quand même, qu'elle est plutôt pitoyable de naïveté, puisque l'homme propose et « la jeune fille de 58 » se plie trop heureuse d'avoir été choisie.
Le personnage féminin est ainsi, par l'écriture, décortiqué dans sa part sombre d'entrée dans l'âge adulte.
Les meilleurs passages, selon moi, sont ceux dans lesquels Annie Ernaux nous montre la volonté d'exister d'Annie D. dans cette nouvelle fraternité, même si elle n'est faite que de dérision et de vulgarité. C'est l'ébriété communautaire merveilleuse pour celle qui vit recluse depuis dix-sept ans dans le commerce de ses parents et l'institution religieuse qui l'enseigne.
Personne n'avait prévu les garde-fous pour la jeune femme trop heureuse « d'être déliée des yeux de sa mère ».
Quelques mots sur le choc de deux classes sociales (la sienne et celle des autres animateurs de la colo) sont appréciables, mais un peu courts pour moi.
Reconnaissons à Annie Ernaux qu'il faut beaucoup de courage pour reprendre ces faits passés, et que de « les épuiser de mots » ainsi, c'est une "décomposition" de fille (à prendre dans les deux sens du terme) qu'elle nous offre là, et c'est plutôt pathétique.
Annie D/E ne se sent pas être « ce qu'ils disent qu'elle est et ne fait pas de lien avec l'image qu'ils lui font subir. » Ces hommes (et quelques femmes) ont dépersonnalisé Annie.
Le résultat est probant : Mémoire de fille, c'est donc le récit des faits et gestes, de la « conduite » (comme on disait à l'époque pour définir et classer les filles) d'une très jeune femme (entre 18 et 20 ans) au début des années soixante.
Le désir, l'obsession, l'aliénation, la naïveté, l'espoir, l'humiliation, le fantasme, le sexe de l'autre, l'amnésie morale, l'imagination qui s'affole ... font de ce texte autant d'émotions, si universellement traversées, par lesquelles Annie Emaux (se) passe au microscope pour comprendre cette fille-là.
Je ne suis pas certaine que Mémoire de fille fasse, contrairement à d'autres de ses ouvrages, beaucoup avancer la cause de femmes.
Annie Ernaux est une auteure qui a bouleversé mes lectures, il y a de çà pas mal d'années, parce que j'admirais sa capacité à rendre compte de ce qui l'avait traversée, de dissoudre le personnel de l'intime, à parler ouvertement des ruptures entre les classes sociales.
Pour moi, c'est moins palpable là, mais peut-être avec l'âge donne-t-elle, même si elle ne l'entend pas ainsi, davantage à son écriture une forme de résilience qu'avant. C'est en tout cas de cette manière que je l'ai ressenti.
Il m'a semblé que la matière choisie pour ce livre manquait d'humus, ou bien est-ce son style qui m'a déplu, car je l'ai trouvé moins épuré qu'autrefois, et moins délicat aussi.
Lien : http://justelire.fr/memoire-..
« Je travaille sur une matière, et cette matière, c'est la femme. L'entrée dans la sexualité, la découverte de l'homme. J'ai décidé d'explorer le gouffre de ma vie. ».
Elle avait également affirmé que ce texte était « celui qui manquait », et je veux bien le comprendre, car Mémoire de fille, c'est le récit de la fragilité de certaines femmes offrant leur corps à un homme qui bientôt les laissera effacées ou vides. On y lit la force du pouvoir masculin sur la quête idéalisée d'une jeune fille mal informée et grisée par son euphorie de vivre, pour la première fois, dans un groupe de garçons (et quels garçons !).
Reconnaissons, quand même, qu'elle est plutôt pitoyable de naïveté, puisque l'homme propose et « la jeune fille de 58 » se plie trop heureuse d'avoir été choisie.
Le personnage féminin est ainsi, par l'écriture, décortiqué dans sa part sombre d'entrée dans l'âge adulte.
Les meilleurs passages, selon moi, sont ceux dans lesquels Annie Ernaux nous montre la volonté d'exister d'Annie D. dans cette nouvelle fraternité, même si elle n'est faite que de dérision et de vulgarité. C'est l'ébriété communautaire merveilleuse pour celle qui vit recluse depuis dix-sept ans dans le commerce de ses parents et l'institution religieuse qui l'enseigne.
Personne n'avait prévu les garde-fous pour la jeune femme trop heureuse « d'être déliée des yeux de sa mère ».
Quelques mots sur le choc de deux classes sociales (la sienne et celle des autres animateurs de la colo) sont appréciables, mais un peu courts pour moi.
Reconnaissons à Annie Ernaux qu'il faut beaucoup de courage pour reprendre ces faits passés, et que de « les épuiser de mots » ainsi, c'est une "décomposition" de fille (à prendre dans les deux sens du terme) qu'elle nous offre là, et c'est plutôt pathétique.
Annie D/E ne se sent pas être « ce qu'ils disent qu'elle est et ne fait pas de lien avec l'image qu'ils lui font subir. » Ces hommes (et quelques femmes) ont dépersonnalisé Annie.
Le résultat est probant : Mémoire de fille, c'est donc le récit des faits et gestes, de la « conduite » (comme on disait à l'époque pour définir et classer les filles) d'une très jeune femme (entre 18 et 20 ans) au début des années soixante.
Le désir, l'obsession, l'aliénation, la naïveté, l'espoir, l'humiliation, le fantasme, le sexe de l'autre, l'amnésie morale, l'imagination qui s'affole ... font de ce texte autant d'émotions, si universellement traversées, par lesquelles Annie Emaux (se) passe au microscope pour comprendre cette fille-là.
Je ne suis pas certaine que Mémoire de fille fasse, contrairement à d'autres de ses ouvrages, beaucoup avancer la cause de femmes.
Annie Ernaux est une auteure qui a bouleversé mes lectures, il y a de çà pas mal d'années, parce que j'admirais sa capacité à rendre compte de ce qui l'avait traversée, de dissoudre le personnel de l'intime, à parler ouvertement des ruptures entre les classes sociales.
Pour moi, c'est moins palpable là, mais peut-être avec l'âge donne-t-elle, même si elle ne l'entend pas ainsi, davantage à son écriture une forme de résilience qu'avant. C'est en tout cas de cette manière que je l'ai ressenti.
Il m'a semblé que la matière choisie pour ce livre manquait d'humus, ou bien est-ce son style qui m'a déplu, car je l'ai trouvé moins épuré qu'autrefois, et moins délicat aussi.
Lien : http://justelire.fr/memoire-..
Tenir sa place , c’est tenir son rang par rapport à son milieu social, à ses origines, ne pas dénoter.
« La Place » c’est le titre du récit d’Annie Ernaux qui relate son enfance, son adolescence dans cette famille modeste, la sienne, mais surtout celle occupée par ses parents dans une société en pleine mutation économique et sociologique (période des trente glorieuses) , place de son père, fils d’un pauvre ouvrier agricole, lui qui dut quitter l’école à 12 ans pour apporter sa cote -part financière.
Un homme qui souhaita s’élever dans la hiérarchie sociale en devenant ouvrier puis petit commerçant, une ambition restée modeste et limitée.
Annie nait en 1940, les parents devront, pendant ces années, surmonter les difficultés matérielles aggravées par ce conflit.
A la fin de la guerre , ils pourront acquérir une nouvelle épicerie-café à la périphérie d’une petite ville.
L’affaire n’est pas bien rentable, le commerce vivote, concurrencé par les premiers supermarchés et les bars plus accueillants pour une clientèle avide de modernité. La famille vit correctement, mais le superflu n’a pas droit de cité chez eux.
Annie évolue dans ce contexte où la culture se limite essentiellement à écouter la radio.
Heureusement l’école va lui permettre de découvrir un autre monde, d’autres centres d’intérêt…
Ce livre est un témoignage des années passées auprès de ce père aimant, mais fruste, il a honte de ses carences, honte de son statut mais il reste fier des valeurs qu’il porte : se contenter de ce qu’on a, « ne pas péter plus haute qu’on l’a » . Sa fille est consciente de cette honte, elle aussi est honteuse des conditions modestes dans lesquelles elle évolue, et sera honteuse de ressentir ce malaise envers ses parents, plus particulièrement envers son père.
Pour apporter plus de réalisme à son récit, elle use d’une écriture simple, d’un langage familier et argotique, une écriture sans fioriture, qui rappelle les conversations banales, plates de son quotidien, retranscrivant les erreurs de syntaxe et de vocabulaire du père, reprenant les expressions locales mâtinées de bon sens.
Poursuivre une scolarité couronnée de succès, accéder à l’université, passer le Capes (plus tard l’agrégation) , voilà un cursus qui révèle la pugnacité de vouloir réussir dans un environnement familial culturellement et financièrement défavorisé, c’est aussi un moyen de mettre en exergue que cela fut possible grâce aux sacrifices consentis par ses parents. C’est une façon de leur rendre hommage, de redonner, à son père une place privilégiée.
Ce livre n’est pas sans me rappeler les tourments que Camus connut quand il était jeune , il fallait, avec fierté, cacher la misère de sa famille. Quelle honte il éprouva quand Jean Grenier vint lui rendre visite pendant sa maladie ! Mais plus tard, il afficha pleinement et fièrement ses origines et n’oublia jamais le milieu social d’où il était issu, l’inculture de sa mère à qui il dédia « Le Premier Homme » - A toi qui ne pourra jamais lire ce livre –
« La Place » c’est le titre du récit d’Annie Ernaux qui relate son enfance, son adolescence dans cette famille modeste, la sienne, mais surtout celle occupée par ses parents dans une société en pleine mutation économique et sociologique (période des trente glorieuses) , place de son père, fils d’un pauvre ouvrier agricole, lui qui dut quitter l’école à 12 ans pour apporter sa cote -part financière.
Un homme qui souhaita s’élever dans la hiérarchie sociale en devenant ouvrier puis petit commerçant, une ambition restée modeste et limitée.
Annie nait en 1940, les parents devront, pendant ces années, surmonter les difficultés matérielles aggravées par ce conflit.
A la fin de la guerre , ils pourront acquérir une nouvelle épicerie-café à la périphérie d’une petite ville.
L’affaire n’est pas bien rentable, le commerce vivote, concurrencé par les premiers supermarchés et les bars plus accueillants pour une clientèle avide de modernité. La famille vit correctement, mais le superflu n’a pas droit de cité chez eux.
Annie évolue dans ce contexte où la culture se limite essentiellement à écouter la radio.
Heureusement l’école va lui permettre de découvrir un autre monde, d’autres centres d’intérêt…
Ce livre est un témoignage des années passées auprès de ce père aimant, mais fruste, il a honte de ses carences, honte de son statut mais il reste fier des valeurs qu’il porte : se contenter de ce qu’on a, « ne pas péter plus haute qu’on l’a » . Sa fille est consciente de cette honte, elle aussi est honteuse des conditions modestes dans lesquelles elle évolue, et sera honteuse de ressentir ce malaise envers ses parents, plus particulièrement envers son père.
Pour apporter plus de réalisme à son récit, elle use d’une écriture simple, d’un langage familier et argotique, une écriture sans fioriture, qui rappelle les conversations banales, plates de son quotidien, retranscrivant les erreurs de syntaxe et de vocabulaire du père, reprenant les expressions locales mâtinées de bon sens.
Poursuivre une scolarité couronnée de succès, accéder à l’université, passer le Capes (plus tard l’agrégation) , voilà un cursus qui révèle la pugnacité de vouloir réussir dans un environnement familial culturellement et financièrement défavorisé, c’est aussi un moyen de mettre en exergue que cela fut possible grâce aux sacrifices consentis par ses parents. C’est une façon de leur rendre hommage, de redonner, à son père une place privilégiée.
Ce livre n’est pas sans me rappeler les tourments que Camus connut quand il était jeune , il fallait, avec fierté, cacher la misère de sa famille. Quelle honte il éprouva quand Jean Grenier vint lui rendre visite pendant sa maladie ! Mais plus tard, il afficha pleinement et fièrement ses origines et n’oublia jamais le milieu social d’où il était issu, l’inculture de sa mère à qui il dédia « Le Premier Homme » - A toi qui ne pourra jamais lire ce livre –
J’ai lu « Passion simple » d’Annie Ernaux il y a quelques années et même si cette lecture ne m’avait pas semblé désagréable, je n’avais pas « accroché », trouvant l’attente que vit et décrit la narratrice presque insupportable. Je ne pensais donc pas relire cette auteure (je féminise) un jour, jusqu’à ce que je tombe sur « La place » dans ma librairie. J’ai lu les premières lignes de ce court roman : « J’ai passé les épreuves pratiques du Capes dans un lycée de Lyon, à la Croix-Rousse », etc. Je me suis laissé tenter et je l’ai acheté. Pas déçue cette fois ! J’ai beaucoup aimé l’écriture « épurée » et « plate » d’Annie Ernaux, qui n’hésite pas à multiplier les phrases nominales pour écrire sur son père, un ouvrier devenu petit commerçant, un homme simple dont la femme disait : « C’est un homme de la campagne, que voulez-vous ». L’auteure explique ainsi qu’au fil des ans, un fossé s’est creusé entre elle qui lisait « de la vraie littérature » et son père qui n’avait pas besoin de livres, de musique pour vivre, lui qui était « entré dans la catégorie des gens simples ou modestes ou braves gens ». C’est d’ailleurs probablement pour cette raison (mais aussi pour ne pas oublier) qu’elle a écrit « La place » : « J’écris peut-être parce qu’on n’avait plus rien à se dire », raconte-t-elle. Sentiment de mélancolie à la lecture de ce roman, mais joie immense d’avoir redécouvert cette auteure et grand bonheur de savoir qu’il me reste plusieurs romans d’elle à lire !
J'ai découvert #Lafemmegelée de Annie Ernaux lu par Elsa Lepoivre grâce à #NetGalleyFrance et aux Éditions Gallimard Audio, que je remercie.
Annie Ernaux nous raconte l'histoire d'une jeune fille se muant lentement en femme, qui deviendra peut-être "mariée" puis "mère", comme si c'était une obligation pour le deuxième sexe... Son héroïne se raconte à la première personne, tentant de dépasser sa condition de "sexe faible" grâce aux mots, aux livres, aux études, à la philosophie... Est-ce l'histoire de l'autrice ?
C'est indéniablement bien écrit, travaillé sans trop l'être, accessible et littéraire à la fois. Malheureusement, je n'ai pas réussi à m'attacher aux confidences de l'héroïne, que j'ai trouvé trop lisse, fade malgré ses rêves d'originalité et d'émancipation. Peut-être est-ce une époque, un style, une ambiance qui ne touche pas ma sensibilité... Pourtant, les thèmes abordés m'intéressent : la féminité, l'émancipation des femmes, le statut de mère et le soi-disant "instinct" maternel, le patriarcat se dressant contre les rebellions féminines, etc etc etc... Je suis restée à distance... Sans savoir si c'est à cause du style de narration (monotone), ou de la narratrice (tout aussi monotone) : je me suis terriblement ennuyée, j'ai décroché plusieurs fois, du revenir en arrière pour ne pas perdre le fil...
J'ai découvert ce roman en version audio et j'ai beaucoup aimé la voix d'Elsa Lepoivre. L'intention, l'intonation et la diction sont juste parfaites, mais restent monotone, en totale harmonie avec ce que j'ai ressenti tout au long de cette écoute...
#Lafemmegelée #NetGalleyFrance
Annie Ernaux nous raconte l'histoire d'une jeune fille se muant lentement en femme, qui deviendra peut-être "mariée" puis "mère", comme si c'était une obligation pour le deuxième sexe... Son héroïne se raconte à la première personne, tentant de dépasser sa condition de "sexe faible" grâce aux mots, aux livres, aux études, à la philosophie... Est-ce l'histoire de l'autrice ?
C'est indéniablement bien écrit, travaillé sans trop l'être, accessible et littéraire à la fois. Malheureusement, je n'ai pas réussi à m'attacher aux confidences de l'héroïne, que j'ai trouvé trop lisse, fade malgré ses rêves d'originalité et d'émancipation. Peut-être est-ce une époque, un style, une ambiance qui ne touche pas ma sensibilité... Pourtant, les thèmes abordés m'intéressent : la féminité, l'émancipation des femmes, le statut de mère et le soi-disant "instinct" maternel, le patriarcat se dressant contre les rebellions féminines, etc etc etc... Je suis restée à distance... Sans savoir si c'est à cause du style de narration (monotone), ou de la narratrice (tout aussi monotone) : je me suis terriblement ennuyée, j'ai décroché plusieurs fois, du revenir en arrière pour ne pas perdre le fil...
J'ai découvert ce roman en version audio et j'ai beaucoup aimé la voix d'Elsa Lepoivre. L'intention, l'intonation et la diction sont juste parfaites, mais restent monotone, en totale harmonie avec ce que j'ai ressenti tout au long de cette écoute...
#Lafemmegelée #NetGalleyFrance
Son Nobel ayant braqué les projecteurs sur cette auteure, il me tardait d'explorer son oeuvre. Suite au décès de sa mère, elle en trace un portrait assez parlant, en y glissant ici et là des fragments de leur relation. Au début, la forme m'a un peu étonné, comme s'il ressortait une impression de froideur de cette écriture très dépouillée. L'évocation est pourtant précise, agrémenté de nombreuses expressions qu'utilisait cette femme, ce qui rend le portrait plus vivant. Puis, peu à peu, des émotions font surface, la distanciation entre la narratrice et son sujet s'atténue et, contrairement au début, on sent bien que c'est une fille qui parle de sa mére et non pas d'une quelconque voisine. J'ai trouvé le dernier tiers très émouvant. L'implacable et lente dégénérescence de cette mère si fière et l'impuissance de sa fille qui y assiste sont rendus avec pudeur et brio. Les deux derniers paragraphes sont à mon avis des pièces d'anthologie. Une écrivaine que je revisiterai certainement.
Le tournant
Dans les premières pages de La Femme gelée, Annie Ernaux semble continuer la poursuite de son récit autobiographique, revenant sur une enfance et une adolescence déjà partiellement décrites avant de prolonger vers le début de sa vie d’épouse et de mère.
Et puis très vite, on comprend que là n’est pas l’essentiel et que le livre n’a pour unique objet que de décrypter par la chronologie et les souvenirs, le cheminement qui l’amena à remettre en cause, l’insidieux déterminisme de la condition des femmes de l’époque.
Il est d’abord question d’atavisme familial et rural abandonnant progressivement la famille nombreuse au profit de l’enfant unique : « Première et dernière, c’est sûr. J’étais persuadée d’avoir beaucoup de chance. »
Puis du rôle de la mère, femme au verbe haut, gestionnaire du commerce familial plus que du foyer, figure crainte et enviée : « Ma mère (…) elle est la force et la tempête, mais aussi la beauté, la curiosité des choses, figure de proue qui m’ouvre l’avenir et m’affirme qu’il ne faut jamais avoir peur de rien ni de personne. »
Une éducation par l’exemple qui gomme les différences patriarcales et ouvre grand les rêves d’avenir d’Annie : « L’Inde et l’Argentine dans ma tête mais aussi ce corps glorieux de demain auquel tout sera permis. Voyager et faire l’amour, je crois que rien ne me paraissait plus beau à dix ans. »
Une impatience qui se développe alors pour passer rapidement les étapes, scolaires et amoureuses, qui la porteront vers cet avenir attendu. Et parallèlement, peu à peu, le doute qui s’installe, distillé par les amies, sur la reproduction inconsciente d’un schéma patriarcal dont elle veut se rapprocher et s’affranchir à la fois.
Malgré la révélation de la lecture du Deuxième sexe, plus elle souhaite s’éloigner du modèle, et plus elle le reproduit inconsciemment. Flirts, sexe, mariage, maternité. Même les études qui doivent élever et émanciper deviennent renoncement face aux nécessités du foyer.
« Croire aussi obscurément que c’est obligé de vivre tout de la féminité pour être “complète“ donc heureuse. »
Repartant de sa propre expérience, Annie Ernaux nous livre une réflexion à voix haute sur la condition féminine de l’époque, sur la « normalité » des modèles, leur reproduction inconsciente ou la honte paradoxale que peuvent générer les chemins qui s’en écartent. Sur ce tournant de sa vie qui en conditionna la suite.
« Pas facile de traquer la part de la liberté et celle du conditionnement, je la croyais droite ma ligne de fille, ça part dans tous les sens. »
S’y ajoutent au passage des balades mémorielles dans les rues et cafés de Rouen, auxquelles je ne peux forcément pas rester insensible…
Dans les premières pages de La Femme gelée, Annie Ernaux semble continuer la poursuite de son récit autobiographique, revenant sur une enfance et une adolescence déjà partiellement décrites avant de prolonger vers le début de sa vie d’épouse et de mère.
Et puis très vite, on comprend que là n’est pas l’essentiel et que le livre n’a pour unique objet que de décrypter par la chronologie et les souvenirs, le cheminement qui l’amena à remettre en cause, l’insidieux déterminisme de la condition des femmes de l’époque.
Il est d’abord question d’atavisme familial et rural abandonnant progressivement la famille nombreuse au profit de l’enfant unique : « Première et dernière, c’est sûr. J’étais persuadée d’avoir beaucoup de chance. »
Puis du rôle de la mère, femme au verbe haut, gestionnaire du commerce familial plus que du foyer, figure crainte et enviée : « Ma mère (…) elle est la force et la tempête, mais aussi la beauté, la curiosité des choses, figure de proue qui m’ouvre l’avenir et m’affirme qu’il ne faut jamais avoir peur de rien ni de personne. »
Une éducation par l’exemple qui gomme les différences patriarcales et ouvre grand les rêves d’avenir d’Annie : « L’Inde et l’Argentine dans ma tête mais aussi ce corps glorieux de demain auquel tout sera permis. Voyager et faire l’amour, je crois que rien ne me paraissait plus beau à dix ans. »
Une impatience qui se développe alors pour passer rapidement les étapes, scolaires et amoureuses, qui la porteront vers cet avenir attendu. Et parallèlement, peu à peu, le doute qui s’installe, distillé par les amies, sur la reproduction inconsciente d’un schéma patriarcal dont elle veut se rapprocher et s’affranchir à la fois.
Malgré la révélation de la lecture du Deuxième sexe, plus elle souhaite s’éloigner du modèle, et plus elle le reproduit inconsciemment. Flirts, sexe, mariage, maternité. Même les études qui doivent élever et émanciper deviennent renoncement face aux nécessités du foyer.
« Croire aussi obscurément que c’est obligé de vivre tout de la féminité pour être “complète“ donc heureuse. »
Repartant de sa propre expérience, Annie Ernaux nous livre une réflexion à voix haute sur la condition féminine de l’époque, sur la « normalité » des modèles, leur reproduction inconsciente ou la honte paradoxale que peuvent générer les chemins qui s’en écartent. Sur ce tournant de sa vie qui en conditionna la suite.
« Pas facile de traquer la part de la liberté et celle du conditionnement, je la croyais droite ma ligne de fille, ça part dans tous les sens. »
S’y ajoutent au passage des balades mémorielles dans les rues et cafés de Rouen, auxquelles je ne peux forcément pas rester insensible…
L’été du BEPC…
Il y a des étés qui marquent plus que d’autres. Pour Anne, quinze ans, celui du brevet sera celui de la rupture.
D’un mois de juillet qui n’en finit pas, occupée à bronzer inutilement dans son jardin cauchois sous l’œil de ses parents, à un mois d’août émancipé et libéré avec son amie Gabrielle et la bande de monos de la colo voisine, Anne va passer d’un monde à un autre.
Du collège au lycée, bien sûr. Mais aussi de l’attente à la découverte du sexe ; de l’insouciance au commencement d’une prise de conscience politique ; de la relation en décalage avec ses parents à la prise de distance assumée ; de la certitude qu’il lui faut aller de l’avant.
« Mais ils ont beau parler ce qu’ils veulent sur l’avenir, les parents, c’est toujours l’enfance et l’arrière qu’ils représentent. »
Dans ce deuxième livre chronologique, Annie Ernaux clôt le chapitre de son enfance - elle y reviendra ensuite dans Retour à Yvetot - et des conditions du déterminisme social qui ne demandait qu’à l’enfermer à son tour.
Après les questionnements des Armoires vides, l’heure est à la conscientisation du libre arbitre et des choix à faire, quel que soit le prix à payer ou le risque à endurer : franchir des étapes libératrices, lever les obstacles qui n’en sont souvent pas et découvrir avec volontarisme ce que l’on ne fait que discerner.
Sous l’influence de Camus, Annie Ernaux se questionne sur le sens à donner à son existence, comprenant peu à peu que pour « changer la vie », il lui faut avancer, seule. Et pour cela, un été suffit parfois…
Poursuite gourmande et intéressée de mon intégrale Ernaux et plaisir toujours intact !
Il y a des étés qui marquent plus que d’autres. Pour Anne, quinze ans, celui du brevet sera celui de la rupture.
D’un mois de juillet qui n’en finit pas, occupée à bronzer inutilement dans son jardin cauchois sous l’œil de ses parents, à un mois d’août émancipé et libéré avec son amie Gabrielle et la bande de monos de la colo voisine, Anne va passer d’un monde à un autre.
Du collège au lycée, bien sûr. Mais aussi de l’attente à la découverte du sexe ; de l’insouciance au commencement d’une prise de conscience politique ; de la relation en décalage avec ses parents à la prise de distance assumée ; de la certitude qu’il lui faut aller de l’avant.
« Mais ils ont beau parler ce qu’ils veulent sur l’avenir, les parents, c’est toujours l’enfance et l’arrière qu’ils représentent. »
Dans ce deuxième livre chronologique, Annie Ernaux clôt le chapitre de son enfance - elle y reviendra ensuite dans Retour à Yvetot - et des conditions du déterminisme social qui ne demandait qu’à l’enfermer à son tour.
Après les questionnements des Armoires vides, l’heure est à la conscientisation du libre arbitre et des choix à faire, quel que soit le prix à payer ou le risque à endurer : franchir des étapes libératrices, lever les obstacles qui n’en sont souvent pas et découvrir avec volontarisme ce que l’on ne fait que discerner.
Sous l’influence de Camus, Annie Ernaux se questionne sur le sens à donner à son existence, comprenant peu à peu que pour « changer la vie », il lui faut avancer, seule. Et pour cela, un été suffit parfois…
Poursuite gourmande et intéressée de mon intégrale Ernaux et plaisir toujours intact !
Annie Ernaux décrit dans ce livre la période de vie qui va de l’été 1958 à l’été 1962. Quatre année capitales de sa vie. Elle a dix-huit ans au début du livre, pas encore la majorité à l’époque. Mais elle peut s’échapper, quitter le cocon familial, le temps d’un été d’abord, pour être monitrice dans une colonie. Elle va y vivre une histoire avec le moniteur-chef, une histoire qu’elle investit, mais qui ne constitue qu’un vague épisode peu intéressant pour son partenaire. Elle sera mise au ban du groupe, moquée, humiliée, et très vite abandonnée. Elle va pourtant vouloir revenir l’été suivant, mais sera refusée, jugée non conforme. Au retour de la colonie, elle quittera encore une fois le cadre familiale pour partir en internat, dans un lycée prestigieux, et va là aussi connaître des déconvenues. De la meilleure élève, elle passera à juste une bonne élève, parmi d’autres, et surtout sera confrontée à des filles issues de milieux bien plus favorisés que le sien. Cela la mènera à revoir à la baisse ses projets, et intégrer l’école normale pour devenir institutrice. Mais ce sera l’échec : elle se découvrira peu apte à enseigner aux enfants. Le livre va se clore sur une note plus positive : la narratrice va s’autoriser à suivre son envie, et d’aller faire des études de lettres à l’université.
C’est une sorte de récit initiatique, la narratrice qui tente de s’émanciper de son milieu familiale, est confrontée au monde. Elle se découvre à la fois fille et de milieu populaire, les deux engendrant la dévalorisation et la honte. Annie Ernaux décrit sans rien édulcorer une initiation sexuelle que l’on qualifierait aujourd’hui tout au moins d’abus sexuel. Mais elle décrit aussi l’acceptation qui lui paraît toute naturelle de sa part de ce qui lui arrive. L’absence de questionnement de la violence qui lui est faite, et qui semble légitime à son partenaire, mais aussi à la société dans son ensemble, et qui par conséquent lui semble aussi légitime. De même que lui paraît dans l’ordre des choses son positionnement sur l’échelle social, et le champ des possibles réduit que ce positionnement implique. Tout est intériorisé, rien ne peut être questionné.
Le livre tente, de manière factuelle, à partir de photos, lettres etc de reconstruire, de retrouver, de la manière la plus précise les événements, sensations, le vécu. Sans juger en apparence, en fournissant au lecteur une sorte de matière brute. Et surtout sans pathos et victimisation : c’est au lecteur de juger. Comme toujours avec Annie Ernaux, sa démarche est aussi sociologique : ses souvenirs sont ceux d’une génération, son expérience singulière s’inscrit dans un contexte historique et sociologique. D’autres filles de sa génération ont peut-être été confronté à des événements proches, elles ont en tous les cas été immergées dans un environnement similaire, qui a forcément provoqué le même type de réactions, de ressentis, de souffrances. La jeune Annie Ernaux a été anorexique, le corps traduisait le traumatisme jamais exprimé, et il ne pouvait l’être que sous une forme culpabilisante dans le contexte dans lequel elle vivait. En tant que fille, elle était forcément coupable de ce qui lui arrivait, comme en tant que transfuge de classe. C’est le monde dans lequel ce genre de jugements étaient des vérités incontestables qu’elle met à nu. Son analyse est d’autant plus forte et incontestable qu’elle reste objective, factuelle, sans affect, sans auto-apitoiement. Cette approche lui permet de transcender des souvenirs personnels, d’en faire des généralités, de prendre parole non pas pour elle, mais pour toute une génération. Ne pas ressasser des souvenirs anecdotiques mais d’arriver à l’essence des choses.
Magistral.
C’est une sorte de récit initiatique, la narratrice qui tente de s’émanciper de son milieu familiale, est confrontée au monde. Elle se découvre à la fois fille et de milieu populaire, les deux engendrant la dévalorisation et la honte. Annie Ernaux décrit sans rien édulcorer une initiation sexuelle que l’on qualifierait aujourd’hui tout au moins d’abus sexuel. Mais elle décrit aussi l’acceptation qui lui paraît toute naturelle de sa part de ce qui lui arrive. L’absence de questionnement de la violence qui lui est faite, et qui semble légitime à son partenaire, mais aussi à la société dans son ensemble, et qui par conséquent lui semble aussi légitime. De même que lui paraît dans l’ordre des choses son positionnement sur l’échelle social, et le champ des possibles réduit que ce positionnement implique. Tout est intériorisé, rien ne peut être questionné.
Le livre tente, de manière factuelle, à partir de photos, lettres etc de reconstruire, de retrouver, de la manière la plus précise les événements, sensations, le vécu. Sans juger en apparence, en fournissant au lecteur une sorte de matière brute. Et surtout sans pathos et victimisation : c’est au lecteur de juger. Comme toujours avec Annie Ernaux, sa démarche est aussi sociologique : ses souvenirs sont ceux d’une génération, son expérience singulière s’inscrit dans un contexte historique et sociologique. D’autres filles de sa génération ont peut-être été confronté à des événements proches, elles ont en tous les cas été immergées dans un environnement similaire, qui a forcément provoqué le même type de réactions, de ressentis, de souffrances. La jeune Annie Ernaux a été anorexique, le corps traduisait le traumatisme jamais exprimé, et il ne pouvait l’être que sous une forme culpabilisante dans le contexte dans lequel elle vivait. En tant que fille, elle était forcément coupable de ce qui lui arrivait, comme en tant que transfuge de classe. C’est le monde dans lequel ce genre de jugements étaient des vérités incontestables qu’elle met à nu. Son analyse est d’autant plus forte et incontestable qu’elle reste objective, factuelle, sans affect, sans auto-apitoiement. Cette approche lui permet de transcender des souvenirs personnels, d’en faire des généralités, de prendre parole non pas pour elle, mais pour toute une génération. Ne pas ressasser des souvenirs anecdotiques mais d’arriver à l’essence des choses.
Magistral.
Choses vues dans ce monde à priori déshumanisé d’une ville nouvelle Cergy, ville sans passé, sans racines, et dans les transports, train, RER, entre cette ville nouvelle et Paris.
Mais la relation de ces choses vues par Annie Ernaux n’est ni neutre, ni simple. Derrière l’observation, il y a, si l’on sait lire entre les lignes, l’engagement d’une « sacrée bonne femme », et de multiples réflexions sur notre société.
Entre 1985 et 1992, Annie Ernaux va écrire quelques fragments de cette vie des gens « du dehors », sous forme d’instantanés où se mêlent observation sans concession des mœurs et des gens, empathie pour les délaissés: sans domicile fixe, femmes perdues, chiens rabroués, et un regard à la fois féministe et attentif aux classes sociales, aux dominants et dominés.
Ce n’est pas à proprement parler, un journal. A part l’année qui est citée, l’auteure ne nous dit précisément, ni le jour, ni la saison, même si parfois, on s’y retrouve..
Ce n’est pas non plus un journal intime, Annie Ernaux n’évoque que rarement sa vie personnelle, ses états d’âme, et si elle le fait, c’est qu’en tant que représentation de traits communs à la condition féminine ou sociale.
Non, on pourrait qualifier ce texte d’hybride entre portraits des gens et des lieux, et essai sociologique.
Mais, une fois de plus, pour moi qui il y a quelques mois, ne connaissais que peu de choses de cette auteure nobelisée, c’est un texte d’une formidable originalité, marqué d’un regard acéré sur la vie des gens, d’une formidable compréhension de ce qui anime les humains, et d’une véritable compassion pour les faibles et les déclassés.
Car Annie Ernaux restitue la vie de ce monde que beaucoup de dénommés « intellectuels » méprisent, et dont les politiques sont déconnectés (cf.son commentaire sur les propos d’un François Mitterand, pourtant socialiste, sur les « petites gens »). C’est celui des caissières, des vendeuses et des client.e.s des hypermarchés ou celui des petits commerces (des observations parfois bien cruelles témoignant de l'inégalité sociale), des employées des salons de coiffure ou de « beauté », ou encore celui des gens de toutes sortes rencontrés dans les transports en commun, les couloirs de métro.
Et, comme en palimpseste, ce récit apparemment simple, nous raconte, sans grands discours, sans développements philosophiques, le statut dévalué des femmes, la violence inhérente aux inégalités sociales, aux couleurs de peau, etc….et c’est malheureusement toujours d’actualité.
Mais aussi, car ce n’est pas un tableau misérabiliste que l’auteure nous fait, le récit nous montre des instantanés quasi-photographiques montrant avec beaucoup de tendresse, l’affection ou l’amour entre les gens.
Un livre passionnant et instructif.
N.B. Annie Ernaux a poursuivi cette « chronique » pour les années 1993 à 1999, par La vie extérieure, que je n’ai pas lu, puis par une chronique de ses passages dans l’hypermarché de Cergy entre 2012 et 2014 dans Regarde les lumières mon amour, dont j’ai fait un commentaire sur ce site.
Mais la relation de ces choses vues par Annie Ernaux n’est ni neutre, ni simple. Derrière l’observation, il y a, si l’on sait lire entre les lignes, l’engagement d’une « sacrée bonne femme », et de multiples réflexions sur notre société.
Entre 1985 et 1992, Annie Ernaux va écrire quelques fragments de cette vie des gens « du dehors », sous forme d’instantanés où se mêlent observation sans concession des mœurs et des gens, empathie pour les délaissés: sans domicile fixe, femmes perdues, chiens rabroués, et un regard à la fois féministe et attentif aux classes sociales, aux dominants et dominés.
Ce n’est pas à proprement parler, un journal. A part l’année qui est citée, l’auteure ne nous dit précisément, ni le jour, ni la saison, même si parfois, on s’y retrouve..
Ce n’est pas non plus un journal intime, Annie Ernaux n’évoque que rarement sa vie personnelle, ses états d’âme, et si elle le fait, c’est qu’en tant que représentation de traits communs à la condition féminine ou sociale.
Non, on pourrait qualifier ce texte d’hybride entre portraits des gens et des lieux, et essai sociologique.
Mais, une fois de plus, pour moi qui il y a quelques mois, ne connaissais que peu de choses de cette auteure nobelisée, c’est un texte d’une formidable originalité, marqué d’un regard acéré sur la vie des gens, d’une formidable compréhension de ce qui anime les humains, et d’une véritable compassion pour les faibles et les déclassés.
Car Annie Ernaux restitue la vie de ce monde que beaucoup de dénommés « intellectuels » méprisent, et dont les politiques sont déconnectés (cf.son commentaire sur les propos d’un François Mitterand, pourtant socialiste, sur les « petites gens »). C’est celui des caissières, des vendeuses et des client.e.s des hypermarchés ou celui des petits commerces (des observations parfois bien cruelles témoignant de l'inégalité sociale), des employées des salons de coiffure ou de « beauté », ou encore celui des gens de toutes sortes rencontrés dans les transports en commun, les couloirs de métro.
Et, comme en palimpseste, ce récit apparemment simple, nous raconte, sans grands discours, sans développements philosophiques, le statut dévalué des femmes, la violence inhérente aux inégalités sociales, aux couleurs de peau, etc….et c’est malheureusement toujours d’actualité.
Mais aussi, car ce n’est pas un tableau misérabiliste que l’auteure nous fait, le récit nous montre des instantanés quasi-photographiques montrant avec beaucoup de tendresse, l’affection ou l’amour entre les gens.
Un livre passionnant et instructif.
N.B. Annie Ernaux a poursuivi cette « chronique » pour les années 1993 à 1999, par La vie extérieure, que je n’ai pas lu, puis par une chronique de ses passages dans l’hypermarché de Cergy entre 2012 et 2014 dans Regarde les lumières mon amour, dont j’ai fait un commentaire sur ce site.
Annie Ernaux | Prix Nobel Littérature 2022 | "Les Années" | 256 pages | Gallimard | 4.09/5 (1439 notes!)| 2008
Annie Ernaux a gagnée ce prestigieux prix (pour un autre livre). Je me suis dis, Charlyy, il est temps de surfer un peu sur la vague...
Alors : je qualifierais ce roman d'évasif, imagé, poétique.
Il y a ce genre de livres et d'autres : action, dialogues, solidité...
Vous l'aurez deviné, je préfère la deuxième catégorie.
Je conçois que ça parle à beaucoup de gens, et même à de très bons lecteurs (surtout; en fait! ... d'où son prix)!! Mais quand le fil est décousu et nous parle de par son style uniquement... Non, j'aime l'action, je suis pas du genre à m'extasier pour une belle tournure de phrase... J'aime le contenu en génral!
Voilà... Je ne regrette pas d'avoir testé Annie Ernaux et j'aimerais savoir votre avis dans les commentaires... J'aurais dû commencer par son dernier mais celui-ci était moins cher...
Belle journée...
Lien : https://vella.blog/
Annie Ernaux a gagnée ce prestigieux prix (pour un autre livre). Je me suis dis, Charlyy, il est temps de surfer un peu sur la vague...
Alors : je qualifierais ce roman d'évasif, imagé, poétique.
Il y a ce genre de livres et d'autres : action, dialogues, solidité...
Vous l'aurez deviné, je préfère la deuxième catégorie.
Je conçois que ça parle à beaucoup de gens, et même à de très bons lecteurs (surtout; en fait! ... d'où son prix)!! Mais quand le fil est décousu et nous parle de par son style uniquement... Non, j'aime l'action, je suis pas du genre à m'extasier pour une belle tournure de phrase... J'aime le contenu en génral!
Voilà... Je ne regrette pas d'avoir testé Annie Ernaux et j'aimerais savoir votre avis dans les commentaires... J'aurais dû commencer par son dernier mais celui-ci était moins cher...
Belle journée...
Lien : https://vella.blog/
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Petits mais costauds
Gwen21
75 livres

Prix Nobel de Littérature
NiGrivo
120 livres
Auteurs proches de Annie Ernaux
Lecteurs de Annie Ernaux Voir plus
Quiz
Voir plus
Connaissez-vous vraiment Annie Ernaux ?
Où Annie Ernaux passe-t-elle son enfance ?
Lillebonne
Yvetot
Bolbec
Fécamp
10 questions
294 lecteurs ont répondu
Thème :
Annie ErnauxCréer un quiz sur cet auteur294 lecteurs ont répondu