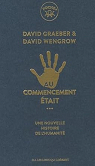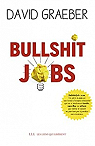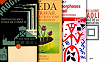Citations de David Graeber (399)
Si on la définit simplement comme une modalité de la prise de décision à l'issue d'une discussion publique, la démocratie constitue un phénomène très courant. Des exemples peuvent en être trouvés à l'intérieur même des États ou des empires, le plus souvent dans des lieux ou des domaines d'activité auxquels les dirigeants n'accordaient que peu d'intérêt. Les historiens grecs qui écrivaient sur l'Inde, par exemple, reconnaissaient que nombre de communautés pouvaient légitimement être qualifiées de démocratiques. Entre 1911 et 1918, de nombreux historiens indiens [...] découvrirent ainsi des dizaines de cas comparables à l'Athènes du Ve siècle sur le sol de l'Asie du Sud : des villes et des confédérations politiques dans lesquelles tous les hommes, formellement qualifiés de guerriers — soit le plus souvent une très large proportion de la population masculine adulte —, disposaient du pouvoir de prendre d'importantes décisions collectivement, à travers une délibération publique au sein d'assemblées communautaires. Les sources littéraires de cette époque témoignaient le plus souvent à leur égard d'une hostilité tout aussi forte que celle des sources grecques. Néanmoins, jusque dans les années 400, de telles communautés existèrent effectivement, et les mécanismes délibératifs auxquels elles recouraient étaient encore en vigueur à ce moment-là, qu'il s'agisse du gouvernement des monastères bouddhistes ou de celui des communautés de métier. Ces auteurs étaient donc en mesure d'affirmer que la tradition indienne, ou même hindoue, avait toujours été intrinsèquement démocratique. Et c'était là un argument puissant pour tous ceux qui luttaient pour l'indépendance.
Chapitre 7 : Les traditions comme actes de refondation permanente.
Chapitre 7 : Les traditions comme actes de refondation permanente.
La démocratie majoritaire ne peut donc émerger que lorsque deux facteurs sont conjointement à l'œuvre : 1) le sentiment que les gens doivent avoir un pouvoir égal dans la prise de décision au sein du groupe, et 2) un appareil de coercition capable d'assurer l'application de ces décisions.
Dans la plus grande partie de l'histoire humaine, ces deux conditions n'ont été qu'exceptionnellement réunies au même moment. Là où existent des sociétés égalitaires, imposer une coercition systématique est jugé habituellement de façon négative. Parallèlement, là où un appareil de coercition existait pour de bon, il ne venait guère à l'esprit de ses agents qu'ils mettaient en œuvre une quelconque volonté populaire.
Chapitre 3 : La démocratie n'a pas été inventée à Athènes.
Dans la plus grande partie de l'histoire humaine, ces deux conditions n'ont été qu'exceptionnellement réunies au même moment. Là où existent des sociétés égalitaires, imposer une coercition systématique est jugé habituellement de façon négative. Parallèlement, là où un appareil de coercition existait pour de bon, il ne venait guère à l'esprit de ses agents qu'ils mettaient en œuvre une quelconque volonté populaire.
Chapitre 3 : La démocratie n'a pas été inventée à Athènes.
Comme nous allons bientôt le découvrir, rien ne permet de penser que les petites communautés sont particulièrement enclines à l’égalitarisme, ni, inversement, que les plus grandes doivent fatalement avoir des rois, des présidents ou même des bureaucratie. De telles déclarations ne sont que des a priori déguisés en faits, voire en lois historiques.
La thèse de Huntington selon laquelle la civilisation occidentale aurait elle seule porté l'héritage du libéralisme, du constitutionnalisme, des droits de l'homme, de l'égalité, de la liberté, du respect du droit, de la démocratie, du libre marché et d'autres idéaux séduisants — tous ces nobles idéaux dont on dit qu'ils n'ont imprégné que de façon superficielle les autres civilisations — sonne faux aux oreilles de tous les familiers de l'histoire de l'Orient à l'âge des États-nations. Dans cette longue liste d'idéaux, il est difficile d'en trouver un seul qui n'ait pas été renié en tout ou partie par les autorités dirigeantes occidentales de l'époque dans leurs relations soit avec les peuples qu'elles soumettaient à la domination coloniale, soit avec les gouvernements sur lesquels elles tentaient d'établir leur suzeraineté. Et à l'inverse, il est tout aussi difficile d'en trouver un seul qui n'ait pas été défendu par les mouvements de libération nationale dans leur lutte contre les autorités occidentales. En défendant ces idéaux, les peuples non occidentaux mêlaient néanmoins ceux-ci avec ceux qui provenaient de leurs propres civilisations dans des domaines où ils n'avaient que peu à apprendre de l'Occident.
Chapitre 5 : Récupérations croisées.
Chapitre 5 : Récupérations croisées.
La connexion nouvelle entre violence externe et soin interne, c'est-à-dire ce que les relations humaines ont de plus impersonnel et de plus intime, marque-t-elle le début de la confusion générale? Est-ce ainsi que des rapports jusqu'alors souples et négociables ont été gravés dans le marbre? Est-ce à partir de là que nous nous sommes retrouvés bloqués?
Voilà le récit que nous devrions raconter. Plutôt que celle des “origines de l'inégalité”, la grande question à poser à l'histoire de l'humanité devrait être: comment avons-nous pu nous laisser enfermer dans une réalité sociale monolithique qui a normalisé les rapports fondés sur la violence et la domination?
Voilà le récit que nous devrions raconter. Plutôt que celle des “origines de l'inégalité”, la grande question à poser à l'histoire de l'humanité devrait être: comment avons-nous pu nous laisser enfermer dans une réalité sociale monolithique qui a normalisé les rapports fondés sur la violence et la domination?
" Individualisme, libéralisme, constitutionnalisme, droits de l'homme, égalité, liberté, règne de la loi, démocratie, marché libre, séparation de l'Église et de l'État " (Huntington, 1993).
Quelle que soit la perspective que l'on adopte, cette liste des " concepts occidentaux " présente un aspect fascinant. [...] Mais même sur cette base, n'est-il pas également possible d'établir une tout autre liste, par exemple en affirmant que la " culture occidentale " repose sur la science, l'industrie, la rationalité bureaucratique, le nationalisme, les théories raciales et sur une tendance irrépressible à l'expansion géographique, et d'en conclure que cette culture aurait culminé avec le IIIè Reich ?
Chapitre 1 : Sur l'incohérence de la notion de " tradition occidentale ".
Quelle que soit la perspective que l'on adopte, cette liste des " concepts occidentaux " présente un aspect fascinant. [...] Mais même sur cette base, n'est-il pas également possible d'établir une tout autre liste, par exemple en affirmant que la " culture occidentale " repose sur la science, l'industrie, la rationalité bureaucratique, le nationalisme, les théories raciales et sur une tendance irrépressible à l'expansion géographique, et d'en conclure que cette culture aurait culminé avec le IIIè Reich ?
Chapitre 1 : Sur l'incohérence de la notion de " tradition occidentale ".
Le terme de " démocratie " lui-même [...] semble avoir été forgé par ses détracteurs élitistes comme une sorte d'insulte. " Démocratie " signifie littéralement la " force ", voire la " violence " du peuple. " Kratos ", et non " archos ". Les élites qui ont forgé ce terme l'ont toujours considéré comme désignant quelque chose de proche de l'émeute populaire ou du règne de la populace ; même si, naturellement, la solution qu'elles préconisaient était la conquête permanente du peuple par d'autres. Ironie du sort, lorsqu'ils tentaient — et c'était le plus souvent le cas — de supprimer pour cette raison la démocratie, il en résultait que la seule façon par laquelle la volonté générale de la populace pouvait se manifester, c'était précisément les émeutes, une pratique qui s'institutionnalisa fortement, notamment sous l'Empire romain et au XVIIIè siècle en Angleterre.
Chapitre 3 : La démocratie n'a pas été inventée à Athènes.
Chapitre 3 : La démocratie n'a pas été inventée à Athènes.
Vous ne pouvez tout simplement pas donner aux gens un pouvoir arbitraire sur les autres et vous attendre à ce qui n'en abusent pas.
Cela a bien peu à voir avec les grandes traditions littéraires et philosophiques considérées comme les piliers des grandes civilisations. De fait, à de rares exceptions près, ces traditions sont ouvertement hostiles aux procédures démocratiques et à ceux qui y ont recours. Les élites gouvernantes ont, du même coup, eu tendance à ignorer ces formes ou à essayer de les éradiquer.
Néanmoins, à un certain moment de l'histoire, tout cela a commencé à changer, et tout d'abord dans les États qui constituaient le cœur du système atlantique — principalement l'Angleterre et la France, les deux nations qui possédaient les plus importantes colonies en Amérique du Nord. La constitution de ce système a été précédées par des destructions d'une ampleur telle qu'elle a permis le développement continu d'espaces d'improvisation d'où a émergé le " prolétariat atlantique ". Les États, sous la pression des mouvements sociaux, commencèrent à mettre en œuvre des réformes, et ceux qui œuvraient au sein de la tradition littéraire propre aux élites partirent à la recherche de précédents. D'où la création de systèmes représentatifs, sur le modèle de la république romaine. Enfin, sous la pression populaire, ces systèmes représentatifs furent plus tard renommés " démocraties ", dont le modèle originel aurait été le modèle athénien.
Chapitre 7 : Les traditions comme actes de refondation permanente.
Néanmoins, à un certain moment de l'histoire, tout cela a commencé à changer, et tout d'abord dans les États qui constituaient le cœur du système atlantique — principalement l'Angleterre et la France, les deux nations qui possédaient les plus importantes colonies en Amérique du Nord. La constitution de ce système a été précédées par des destructions d'une ampleur telle qu'elle a permis le développement continu d'espaces d'improvisation d'où a émergé le " prolétariat atlantique ". Les États, sous la pression des mouvements sociaux, commencèrent à mettre en œuvre des réformes, et ceux qui œuvraient au sein de la tradition littéraire propre aux élites partirent à la recherche de précédents. D'où la création de systèmes représentatifs, sur le modèle de la république romaine. Enfin, sous la pression populaire, ces systèmes représentatifs furent plus tard renommés " démocraties ", dont le modèle originel aurait été le modèle athénien.
Chapitre 7 : Les traditions comme actes de refondation permanente.
Dans le monde anglophone de la fin du XVIIIème siècle par exemple, les personnes les plus cultivées connaissaient bien la démocratie athénienne, principalement grâce à la traduction de Thucydide par Thomas Hobbes. Elles en concluaient — et ce n'est guère surprenant — que la démocratie était un régime instable et tumultueux, favorable à l'esprit de faction et à la démagogie, et marqué par une forte tendance à sombrer dans le despotisme.
Chapitre 4 : Sur l'émergence de " l'idéal démocratique ".
Chapitre 4 : Sur l'émergence de " l'idéal démocratique ".
Renverser le capitalisme, mettre à bas le pouvoir étatique, ce sont des choses que l'on peut se représenter concrètement. "Éliminer les inégalité", en revanche, on ne voit pas très bien ce que cela veut dire.
À partir des années 1970, un grand virage a eu lieu dans l'investissement : il est passé de technologies associées à la possibilité d'avenirs différents à des technologies qui ont renforcé la discipline du travail et le contrôle social.
L'ouvrage de Bruce Johansen, Forgotten Founders (1982) [...] a donné le coup d'envoi au débat sur l " 'influence ". Cette thèse [...] était la suivante : Les Anglais et les Français installés dans les colonies ne commencèrent à se penser eux-mêmes comme " Américains " — comme un peuple d'un type nouveau, amoureux de la liberté — qu'à partir du moment où ils se perçurent eux-mêmes comme ayant quelque ressemblance avec les Indiens. De plus, ce sentiment n'aurait pas été inspiré par des récits exotiques, comme ceux de Jefferson ou d'Adam Smith, mais par une expérience de vie concrète propre à ces sociétés des frontières qui étaient par leur nature même des " amalgames ", comme les qualifiait Calloway. Les colons qui débarquaient en Amérique se trouvaient en effet dans une situation tout à fait singulière : ayant fui la hiérarchie et le conformisme européen, ils se trouvaient face à des populations indigènes bien plus attachées aux principes d'égalité et d'individualisme qu'ils n'auraient pu l'imaginer ; et tout en contribuant massivement à leur extermination, ils n'en adoptèrent pas moins bon nombre de leurs coutumes, habitudes et attitudes.
Chapitre 6 : Le débat sur la question de l'influence.
Chapitre 6 : Le débat sur la question de l'influence.
L'un des historiens contemporains de la démocratie européenne les plus marquants, John Markoff, dans un article intitulé " Où et quand la démocratie fut-elle inventée ? ", remarque en passant :
" Que le pouvoir politique puisse dériver du consentement des gouvernés plutôt que d'être octroyé par une autorité supérieure, pourrait bien avoir été une expérience des équipages de pirates à l'origine du monde atlantique moderne. Ces équipages non seulement élisaient leurs capitaines, mais étaient tout à fait familiers des mécanismes de contre-pouvoir (sous la forme des quartiers-maîtres et des conseils de navire) et des relations contractuelles entre les individus et les groupes (sous la forme d'articles consignés par écrit, spécifiant la part de butin accordée à chacun et le montant des indemnités en cas d'accident de travail). " [1999, Comparative Studies in Society and History, vol. 41, n°4, p 673, note 62]
De fait, l'organisation typique au XVIIIe siècle du bateau de pirates telle qu'elle a été reconstruite par des historiens comme Marcus Rediker semble avoir été remarquablement démocratique. Les capitaines n'étaient pas seulement élus, ils opéraient habituellement comme les chefs de guerre amérindiens : un pouvoir absolu leur était confié pendant les poursuites ou les combats, mais sinon, ils étaient traités comme de simples hommes d'équipage. Même quand, sur certains bateaux, les capitaines se voyaient accorder des pouvoirs plus importants, l'accent était mis sur le droit de l'équipage à les démettre à tout moment — pour lâcheté, cruauté ou pour toute autre raison. Dans tous les cas, le pouvoir ultime reposait sur l'assemblée générale, qui tranchait souvent même sur les questions les plus mineures, et cela toujours, semble-t-il, par un vote majoritaire à main levée.
Chapitre 6 : Le débat sur la question de l'influence.
" Que le pouvoir politique puisse dériver du consentement des gouvernés plutôt que d'être octroyé par une autorité supérieure, pourrait bien avoir été une expérience des équipages de pirates à l'origine du monde atlantique moderne. Ces équipages non seulement élisaient leurs capitaines, mais étaient tout à fait familiers des mécanismes de contre-pouvoir (sous la forme des quartiers-maîtres et des conseils de navire) et des relations contractuelles entre les individus et les groupes (sous la forme d'articles consignés par écrit, spécifiant la part de butin accordée à chacun et le montant des indemnités en cas d'accident de travail). " [1999, Comparative Studies in Society and History, vol. 41, n°4, p 673, note 62]
De fait, l'organisation typique au XVIIIe siècle du bateau de pirates telle qu'elle a été reconstruite par des historiens comme Marcus Rediker semble avoir été remarquablement démocratique. Les capitaines n'étaient pas seulement élus, ils opéraient habituellement comme les chefs de guerre amérindiens : un pouvoir absolu leur était confié pendant les poursuites ou les combats, mais sinon, ils étaient traités comme de simples hommes d'équipage. Même quand, sur certains bateaux, les capitaines se voyaient accorder des pouvoirs plus importants, l'accent était mis sur le droit de l'équipage à les démettre à tout moment — pour lâcheté, cruauté ou pour toute autre raison. Dans tous les cas, le pouvoir ultime reposait sur l'assemblée générale, qui tranchait souvent même sur les questions les plus mineures, et cela toujours, semble-t-il, par un vote majoritaire à main levée.
Chapitre 6 : Le débat sur la question de l'influence.
Voter serait le meilleur moyen de provoquer ces formes d’humiliation, de ressentiment et de haine qui conduisent au bout du compte à la destruction des communautés.
Nous avons tous un problème. Les pratiques habitudes, et sensibilités bureaucratiques nous dévorent. Notre vie finit par se structurer autour des formulaires à remplir. Mais le langage dont nous disposons pour parler de cette situation est lamentablement inadéquate, voire de nature à aggraver les choses. Il nous faut trouver le moyen de formuler ce que nous réprouvons vraiment dans ce processus ; de parler honnêtement de la violence qu'il implique ; mais en même temps de comprendre parmi les éléments qui le composent, lesquels sont porteurs d'un potentiel de rédemption dans une société vraiment libre, lesquels représentent l'inévitable prix à payer pour vivre dans une société complexe et lesquels peuvent et doivent être entièrement éliminés. Si ce livre contribue, modestement à ouvrir une conversation de ce genre, il aura vraiment apporté quelque chose à la vie politique contemporaine.
Il est important de souligner que la propriété n'est pas en premier lieu une relation entre une personne et une chose. C'est d'abord une relation entre des personnes. Robinson Crusoë (tout bourgeois individualiste qu'il fût) n'avait pas à se soucier beaucoup de ses droits de propriété sur son île tant qu'il y était seul.
Nous devons bel et bien aux autres tout ce que nous sommes. C'est la pure vérité. La langue dans laquelle nous parlons et même pensons, nos habitudes et nos opinions, les aliments que nous aimons, le savoir grâce auquel la lumière s'allume et la chasse d'eau fonctionne, et même le style de nos gestes de défi et de révolte contre les conventions sociales - tout cela, nous le tenons d'autres personnes dont la plupart sont décédées depuis longtemps. S'il nous fallait imaginer ce que nous leur devons comme une dette, elle ne pourrait être qu'infinie. Mais est-il vraiment raisonnable de penser cela comme une dette ? C'est toute la question. Après tout, une dette est, par définition, quelque chose que nous pouvons au moins imaginer rembourser. Il est assez étrange de souhaiter être quitte avec ses parents - cela signifie plutôt qu'on ne veut plus d'eux comme parents. Désirons-nous réellement être quittes avec toute l'humanité ? Quel sens cela pourrait-il même avoir ?
Nul ne saurait contester l'évidence que la Grèce antique a été l'une des sociétés les plus compétitives que l'histoire humaine ait connues. Elle avait en effet tendance à faire de toute chose un objet de rivalité publique, de l'athlétisme à la philosophie ou à l'art dramatique, etc. Il n'est donc guère surprenant que la prise de décision politique ait connu elle aussi un sort semblable. Plus crucial encore est le fait que les décisions étaient prises par le peuple en armes. Aristote, dans sa Politique, remarquait que la constitution des cités-États grecques dépendait essentiellement de l'arme principale de leur armée : si c'était la cavalerie, alors il s'agirait d'une aristocratie en raison de l'importance du coût des chevaux ; si c'était l'infanterie hoplite, puissamment armée, il s'agirait d'une oligarchie, car n'importe qui ne peut assurer le coût de l'entraînement et des armures ; si, enfin, l'arme principale était la marine ou une infanterie légère, alors on pourrait s'attendre à une démocratie, car tout le monde sait ramer ou se servir d'une fronde. En d'autres termes, si un homme est armé, on a tout intérêt à prendre en compte son opinion. L'Anabase de Xénophon constitue un excellent témoignage des aspects les plus rigides de ce système. Il raconte l'histoire d'une armée de mercenaires grecs qui se trouve subitement sans chef et se perd au milieu de la Perse. Ils élisent alors de nouveaux officiers qui organisent un vote collectif afin de décider ce qu'ils doivent faire. Dans un cas comme celui-ci, même si le vote fut à 60/40, tout le monde pouvait percevoir l'équilibre des forces et deviner ce qui se passerait si l'on en venait aux mains. Chaque vote était, au sens fort du terme, une conquête. En d'autres termes, ici aussi le processus de décision et les moyens de la mise en œuvre étaient (ou pouvaient être) confondus, mais d'une façon bien différente.
Chapitre 3 : La démocratie n'a pas été inventée à Athènes.
Chapitre 3 : La démocratie n'a pas été inventée à Athènes.
Où et quand en est-on venu à considérer que le travail inutile était préférable à l’absence de travail ?
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de David Graeber
Lecteurs de David Graeber (896)Voir plus
Quiz
Voir plus
Morts subites
Empédocle, philosophe pré-socratique du Ve siècle, serait mort ...
par la chûte d'une météorite
en tombant dans un volcan
noyé dans un raz-de-marée
emporté par une avalanche
12 questions
33 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur33 lecteurs ont répondu