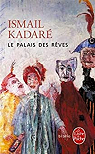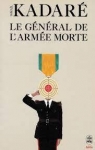Critiques de Ismaïl Kadaré (257)
Le premier roman d'Ismaïl Kadaré qu'il m'a été donné de lire. Il ressort de cette lecture un sentiment très mitigé et pas de véritable engouement pour ce livre, très étrange où la légende se mêle à la réalité. Après la chute du régime communiste le lecteur assiste à un basculement de la société albanaise dans un autre monde, là-dessus se dresse une affaire de kanun qui remonte à la fin des temps et une histoire d'amour qui trouve difficilement sa place dans cette oeuvre. Un livre qui ne m'aura pas offert de grandes émotions et qui sera vite oublié. Ce n'était pas ce que je recherchais et je suis d'autant plus déçue que le titre du roman est très poétique.
On est devant un titre un peu intrigant : Concours de beauté masculine ! et pour comble de mystère, cela se passe aux Cimes maudites. Or cet aspect étrange revient dans l'histoire elle-même par cette capacité de l'auteur à décevoir toutes les attentes du lecteur et à créer la perplexité chez lui. A chaque moment de cette lecture, on croit tenir le fil de l'histoire et surprendre l'auteur dans sa création. Mais le voilà qui se détache de notre captivité et qui crée la surprise.
Ainsi l'histoire débute avec un jeune homme qui d'après les allusions de son dialogue avec un docteur – son ami- est un homosexuel mal vu par sa société. La fin de ce premier chapitre nous laisse croire que ce bel homme participera au concours et sera tué par quelqu'un ! Or rien de cela n'arrive. Kadaré s'amuse ensuite à nous raconter le passé de ce fameux concours et les impressions que son organisation dans un petit village de montagnes a suscité chez le gouvernement et les gens. le concours n'est pas une rumeur mais une vérité et le jury est choisi. Ce dernier a donné une chance aux prisonniers des tours de claustration qui fuient les vendettas et l'un d'eux se démarque comme étant un favori (le lecteur croit que c'est lui qui tuera le jeune homme du premier chapitre). La fin de cette nouvelle-conte est plus mystérieuse encore (comme "Le Verdict" de Kafka).
Ce recueil contient aussi deux autres courtes nouvelles. Une enquête d'un journaliste médiocre qui veut vérifier la vérité sur l'existence de souterrains dans une petite ville. Et l'autre contient l'histoire d'un homme ordinaire qui veut qu'on chante son nom et qui fait tout son possible pour atteindre son but (même par le crime) !
Je qualifierai volontiers ces petits bijoux de réalisme magique car elles ressemblent à cette littérature latino-américaine avec son folklore, ses mythes, ses petites histoires tragi-comiques et son atmosphère onirique.
Ainsi l'histoire débute avec un jeune homme qui d'après les allusions de son dialogue avec un docteur – son ami- est un homosexuel mal vu par sa société. La fin de ce premier chapitre nous laisse croire que ce bel homme participera au concours et sera tué par quelqu'un ! Or rien de cela n'arrive. Kadaré s'amuse ensuite à nous raconter le passé de ce fameux concours et les impressions que son organisation dans un petit village de montagnes a suscité chez le gouvernement et les gens. le concours n'est pas une rumeur mais une vérité et le jury est choisi. Ce dernier a donné une chance aux prisonniers des tours de claustration qui fuient les vendettas et l'un d'eux se démarque comme étant un favori (le lecteur croit que c'est lui qui tuera le jeune homme du premier chapitre). La fin de cette nouvelle-conte est plus mystérieuse encore (comme "Le Verdict" de Kafka).
Ce recueil contient aussi deux autres courtes nouvelles. Une enquête d'un journaliste médiocre qui veut vérifier la vérité sur l'existence de souterrains dans une petite ville. Et l'autre contient l'histoire d'un homme ordinaire qui veut qu'on chante son nom et qui fait tout son possible pour atteindre son but (même par le crime) !
Je qualifierai volontiers ces petits bijoux de réalisme magique car elles ressemblent à cette littérature latino-américaine avec son folklore, ses mythes, ses petites histoires tragi-comiques et son atmosphère onirique.
Qui a ramené Doruntine de sa contrée lointaine ?, telle est la question centrale de ce roman d’Ismail Kadaré, un auteur albanais dont je découvre la plume, qui nous occupe tout au long du récit tout autant qu’elle préoccupe le capitaine Stres : est-ce son frère Konstantin qui en a fait la bessa à sa mère, telle qu’elle l’affirme, et si c’est le cas, comment cela peut-il être possible, vu la série de drames ayant touché la famille Vranaj ? Bien vite les villageois vont adhérer à une explication surnaturelle, au grand dam de l’Église qui charge Stres de trouver une explication plus rationnelle… Ismail Kadaré reprend une légende albanaise avec Qui a ramené Doruntine ?, Kostandini e Dhoqina, originellement écrite sous la forme d’une ballade chantée, à laquelle il joint un enquêteur qu’il charge d’élucider l’affaire. Construit autour de la notion de bessa, « la notion fondamentale du droit coutumier albanais », on nage en plein mystère, pour notre plus grand plaisir. Un auteur que je vais très certainement relire.
Perdez tout repère temporel, vous qui commencerez ce conte. Y parcourt-on des temps anciens, où l’on se déplace à cheval, ou plus modernes, puisqu’un inspecteur de police est chargé par les autorités laïques comme religieuses de mettre fin à une rumeur qui apporte avec elle une certaine perturbation ?
En effet, Doruntine, une jeune femme partie depuis trois ans se marier et vivre au loin, revient un soir dans sa famille. Elle ignore que ses frères sont morts de faits de guerre ou de maladie pendant son absence et elle affirme, provoquant un grand choc à sa mère, que c’est son frère Konstantin qui est venu la chercher, et derrière lequel elle a chevauché de longues nuits. Bien qu’elle n’ait pas distingué son visage, elle en est sûre, c’était lui. Konstantin était réticent à ce mariage en Bohême, et avait promis à sa sœur que si elle le désirait, il viendrait pour la chercher et lui permettre de revoir sa famille. Comment Konstantin a-t-il pu tenir sa promesse au-delà de la mort ?
Quantité de suppositions et de rumeurs circulent. Le capitaine Stres devient obsédé par cette affaire, d’autant qu’il est pressé par ses supérieurs et rattrapé par sa fascination passée pour Doruntine.
J’ai été attirée immédiatement à la sortie de ce roman, grâce à la conjonction du nom d’Ismaïl Kadaré (dont j’ai beaucoup aimé Avril brisé et Le palais des rêves), du titre énigmatique et de la réédition par Zulma… que des signes encourageants !
Et ma lecture a été très plaisante, avec sa langue rappelant celle des contes, mais utilisant aussi à merveille le dialogue ou les parenthèses de manière très moderne, et son thème s’inspirant d’un vieux mythe albanais : la « bessa ». La bessa est une promesse, une parole donnée, que rien, même la mort, ne saurait empêcher. On est parfois dans le domaine du surnaturel, avec ce cavalier sans visage, sans identité. Mais aussi, comme dans un roman policier, l’auteur, par les réflexions du capitaine Stres, explore des pistes, cherche des explications à ce phénomène étrange, et s’interroge, avec l’esprit critique qui le caractérise, sur la force de la promesse, sur le poids des traditions, sur le carcan religieux. Le texte rend à merveille les rudes saisons albanaises et la beauté des paysages. Les personnages sont passionnants, en particulier le policier, dans lequel l’auteur s’est projeté, entraînant à sa suite les lecteurs, ravis.
Lien : https://lettresexpres.wordpr..
En effet, Doruntine, une jeune femme partie depuis trois ans se marier et vivre au loin, revient un soir dans sa famille. Elle ignore que ses frères sont morts de faits de guerre ou de maladie pendant son absence et elle affirme, provoquant un grand choc à sa mère, que c’est son frère Konstantin qui est venu la chercher, et derrière lequel elle a chevauché de longues nuits. Bien qu’elle n’ait pas distingué son visage, elle en est sûre, c’était lui. Konstantin était réticent à ce mariage en Bohême, et avait promis à sa sœur que si elle le désirait, il viendrait pour la chercher et lui permettre de revoir sa famille. Comment Konstantin a-t-il pu tenir sa promesse au-delà de la mort ?
Quantité de suppositions et de rumeurs circulent. Le capitaine Stres devient obsédé par cette affaire, d’autant qu’il est pressé par ses supérieurs et rattrapé par sa fascination passée pour Doruntine.
J’ai été attirée immédiatement à la sortie de ce roman, grâce à la conjonction du nom d’Ismaïl Kadaré (dont j’ai beaucoup aimé Avril brisé et Le palais des rêves), du titre énigmatique et de la réédition par Zulma… que des signes encourageants !
Et ma lecture a été très plaisante, avec sa langue rappelant celle des contes, mais utilisant aussi à merveille le dialogue ou les parenthèses de manière très moderne, et son thème s’inspirant d’un vieux mythe albanais : la « bessa ». La bessa est une promesse, une parole donnée, que rien, même la mort, ne saurait empêcher. On est parfois dans le domaine du surnaturel, avec ce cavalier sans visage, sans identité. Mais aussi, comme dans un roman policier, l’auteur, par les réflexions du capitaine Stres, explore des pistes, cherche des explications à ce phénomène étrange, et s’interroge, avec l’esprit critique qui le caractérise, sur la force de la promesse, sur le poids des traditions, sur le carcan religieux. Le texte rend à merveille les rudes saisons albanaises et la beauté des paysages. Les personnages sont passionnants, en particulier le policier, dans lequel l’auteur s’est projeté, entraînant à sa suite les lecteurs, ravis.
Lien : https://lettresexpres.wordpr..
Enfin j'ai lu un roman d'Ismaïl Kadaré et plongé dans l'histoire de l'Albanie.
De l'Albanie, je connais peu de choses si ce n'est que c'est un pays des Balkans, fort peu donc. Avec ce roman, on plonge dans l'histoire de ce pays aux prises avec son énorme voisin: l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman est un ogre puissant qui croque tous les pays ou groupes alentours. Petit pays, l'Albanie est forte d'un héros légendaire Skanderberg. Il a provoqué les Ottomans et ceux ci ne comptent pas laisser passer.
Ils entament donc le siège d'une citadelle albanaise. Le roman nous raconte ce long long siège, les attaques, les ruses, les canons, les morts. Ce qui pourrait être lassant, est parfaitement réussi, on ne s'ennuie pas à lire les différents actes de cette guerre. C'est sans aucun doute dû au talent de l'auteur et aux choix narratifs faits.
Lien : http://theetlivres.eklablog...
De l'Albanie, je connais peu de choses si ce n'est que c'est un pays des Balkans, fort peu donc. Avec ce roman, on plonge dans l'histoire de ce pays aux prises avec son énorme voisin: l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman est un ogre puissant qui croque tous les pays ou groupes alentours. Petit pays, l'Albanie est forte d'un héros légendaire Skanderberg. Il a provoqué les Ottomans et ceux ci ne comptent pas laisser passer.
Ils entament donc le siège d'une citadelle albanaise. Le roman nous raconte ce long long siège, les attaques, les ruses, les canons, les morts. Ce qui pourrait être lassant, est parfaitement réussi, on ne s'ennuie pas à lire les différents actes de cette guerre. C'est sans aucun doute dû au talent de l'auteur et aux choix narratifs faits.
Lien : http://theetlivres.eklablog...
Le palais des rêves, c'est l'oniromancie totalitaire d'un empire ottoman revisité. Dans cette Anatolie semi-imaginaire, à l'orée du vingtième siècle, la loi force les citoyens à noter leurs rêves sur papier et à les envoyer à une administration omnipotente, chargée de classer, sélectionner, décrypter et utiliser ces rêves à des fins politiques, bref à les dé-rêver pourrait-on dire.
Et au coeur de ce dé-rêve, nous suivons la dérive de Mark-Alem, membre de la prestigieuse famille albanaise des Quprili. Nouvelle recrue du palais, ce drôle d'oiseau de nuit froufroute à travers une obscurité onirique et kafkaïenne. En ce lieu, on perd sa conscience. Et même la réapparition tardive de la lumière du printemps ne peut éclairer qu'un faux triomphe.
Regorgeant de rêves extorqués aux autres, ce palais oscille, vacille, souvent près de tomber dans le fantastique. le roman baigne dans une pénombre chancelante dont les moindres manifestations sont sources d'angoisse, comme l'annonce d'une imminente catabase. Les faibles touches de clarté (flocons de neige, chandelles et brasero) qui émaillent les descriptions, n'indiquent nulle issue réelle dans ce palais labyrinthique. Elles entraînent plutôt vers la perdition, à l'instar des feux follets, car elles évoquent les rêves capturés, voire les âmes victimes de ce régime fondé sur la violence. C'est ce que soulignent les comparaisons effectuées dans le chapitre central situé dans les profondeurs des archives du palais, tel un sommeil paradoxal où se révèlent les traumatismes originels unissant l'Empire Ottoman et la famille des Quprili dans une histoire funeste.
Paradoxal, ce rêve fictionnel l'est certainement, puisque j'ai du mal à imaginer une description plus concrète et réaliste du climat de peur qui règne dans les États totalitaires où chacun est suspendu à des décisions arbitraires et se retrouve réduit à l'état de fantôme dans la machine. Une machine dont chacun alimente la terrible logique grâce à des projections paranoïaques, des cauchemars qui paralysent toute velléité de révolte (chez les masses) et encouragent les actes irrationnels (chez les dirigeants). Les cauchemars sont le fondement du Palais des rêves.
Mais tout autant qu'un inconscient collectif des peuples opprimés, ce palais correspond aussi à un autoportrait ironique de l'auteur. Comment travaille un artiste, sinon à partir de ses rêves, qu'il doit un tant soit peu soumettre au filtre de la raison et sélectionner pour en faire des « maîtres-rêves » capables de secouer le monde éveillé ? Dans les lumières vacillantes de ce palais en clair-obscur, Ismaïl Kadaré confère ainsi à l'art toute sa portée poétique et politique.
Et au coeur de ce dé-rêve, nous suivons la dérive de Mark-Alem, membre de la prestigieuse famille albanaise des Quprili. Nouvelle recrue du palais, ce drôle d'oiseau de nuit froufroute à travers une obscurité onirique et kafkaïenne. En ce lieu, on perd sa conscience. Et même la réapparition tardive de la lumière du printemps ne peut éclairer qu'un faux triomphe.
Regorgeant de rêves extorqués aux autres, ce palais oscille, vacille, souvent près de tomber dans le fantastique. le roman baigne dans une pénombre chancelante dont les moindres manifestations sont sources d'angoisse, comme l'annonce d'une imminente catabase. Les faibles touches de clarté (flocons de neige, chandelles et brasero) qui émaillent les descriptions, n'indiquent nulle issue réelle dans ce palais labyrinthique. Elles entraînent plutôt vers la perdition, à l'instar des feux follets, car elles évoquent les rêves capturés, voire les âmes victimes de ce régime fondé sur la violence. C'est ce que soulignent les comparaisons effectuées dans le chapitre central situé dans les profondeurs des archives du palais, tel un sommeil paradoxal où se révèlent les traumatismes originels unissant l'Empire Ottoman et la famille des Quprili dans une histoire funeste.
Paradoxal, ce rêve fictionnel l'est certainement, puisque j'ai du mal à imaginer une description plus concrète et réaliste du climat de peur qui règne dans les États totalitaires où chacun est suspendu à des décisions arbitraires et se retrouve réduit à l'état de fantôme dans la machine. Une machine dont chacun alimente la terrible logique grâce à des projections paranoïaques, des cauchemars qui paralysent toute velléité de révolte (chez les masses) et encouragent les actes irrationnels (chez les dirigeants). Les cauchemars sont le fondement du Palais des rêves.
Mais tout autant qu'un inconscient collectif des peuples opprimés, ce palais correspond aussi à un autoportrait ironique de l'auteur. Comment travaille un artiste, sinon à partir de ses rêves, qu'il doit un tant soit peu soumettre au filtre de la raison et sélectionner pour en faire des « maîtres-rêves » capables de secouer le monde éveillé ? Dans les lumières vacillantes de ce palais en clair-obscur, Ismaïl Kadaré confère ainsi à l'art toute sa portée poétique et politique.
Il y a des noms qui vous sont familiers, comme celui de l'écrivain albanais Ismail Kadaré, quand enfin l'opportunité d'une lecture se profile. Il était temps. Son œuvre est immense, publiée en français par Fayard depuis 1993 mais c'est Zulma qui rhabille joliment ce texte qui date de 1980 (1986 en France) dans sa collection de poche et offre ainsi une très belle occasion de le découvrir. Et quel conteur ! Dans ce roman assez proche de la fable, il tisse une atmosphère pleine de mystères et de dangers qui lui permet d'explorer l'âme humaine ballotée entre les influences auxquelles elle est constamment exposée. Du grand art.
Il faut dire que le problème posé au capitaine Straes est de taille. Doruntine, la seule fille de la famille Vranaj vient de revenir en ville après une absence de trois ans due à son mariage lointain. Problème, la jeune femme affirme avoir été ramenée par son frère Konstantin ; or, ce dernier est mort depuis plusieurs années. Affabulation ? Folie ? Mensonge ? Le capitaine soupçonne une mystification, l'Eglise orthodoxe s'émeut d'autant que ses rapports avec l'Eglise catholique ne sont pas au beau fixe - une résurrection, on avait déjà celle du Christ, hors de question que -, et dans tout le pays les rumeurs vont bon train.
"Il se disait que tout un chacun, à sa façon, allait prendre position sur l'événement qui venait de se produire, et que son avis dépendrait de la place qu'il s'était faite dans la vie, de sa chance en amour ou dans le mariage, de son aspect extérieur, de la mesure de bonheur ou de malheur qui lui était échue, des faits qui avaient marqué le cours de son existence, ou de ses motivations les plus secrètes, celles que l'on se cache parfois à soi-même. Tel serait dans l'ensemble l'écho que l'événement éveillerait chez ces gens qui, croyant émettre un jugement sur le drame d'autrui, ne feraient en réalité qu'évoquer le leur."
Entre légendes, réel et surnaturel, l'enquête de Straes pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle interroge la place de la religion dans les affaires de la cité, passe la politique au prisme des débats sur l'identité, la liberté ou encore la morale. L'air de rien. Sous les allures de conte qui s'égrène dans des paysages de neige et de brumes, on reconnait les questions qui déchirent cette région des Balkans depuis la nuit des temps, et d'autres qui n'ont rien perdu de leur actualité partout dans le monde. D'une plume gracieuse et malicieuse, l'auteur sème, distille, multiplie les petits cailloux qui sont autant d'accrocs aux idées toutes faites et une salutaire invitation à réfléchir. Par les temps qui courent, c'est précieux.
Lien : http://www.motspourmots.fr/2..
Il faut dire que le problème posé au capitaine Straes est de taille. Doruntine, la seule fille de la famille Vranaj vient de revenir en ville après une absence de trois ans due à son mariage lointain. Problème, la jeune femme affirme avoir été ramenée par son frère Konstantin ; or, ce dernier est mort depuis plusieurs années. Affabulation ? Folie ? Mensonge ? Le capitaine soupçonne une mystification, l'Eglise orthodoxe s'émeut d'autant que ses rapports avec l'Eglise catholique ne sont pas au beau fixe - une résurrection, on avait déjà celle du Christ, hors de question que -, et dans tout le pays les rumeurs vont bon train.
"Il se disait que tout un chacun, à sa façon, allait prendre position sur l'événement qui venait de se produire, et que son avis dépendrait de la place qu'il s'était faite dans la vie, de sa chance en amour ou dans le mariage, de son aspect extérieur, de la mesure de bonheur ou de malheur qui lui était échue, des faits qui avaient marqué le cours de son existence, ou de ses motivations les plus secrètes, celles que l'on se cache parfois à soi-même. Tel serait dans l'ensemble l'écho que l'événement éveillerait chez ces gens qui, croyant émettre un jugement sur le drame d'autrui, ne feraient en réalité qu'évoquer le leur."
Entre légendes, réel et surnaturel, l'enquête de Straes pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Elle interroge la place de la religion dans les affaires de la cité, passe la politique au prisme des débats sur l'identité, la liberté ou encore la morale. L'air de rien. Sous les allures de conte qui s'égrène dans des paysages de neige et de brumes, on reconnait les questions qui déchirent cette région des Balkans depuis la nuit des temps, et d'autres qui n'ont rien perdu de leur actualité partout dans le monde. D'une plume gracieuse et malicieuse, l'auteur sème, distille, multiplie les petits cailloux qui sont autant d'accrocs aux idées toutes faites et une salutaire invitation à réfléchir. Par les temps qui courent, c'est précieux.
Lien : http://www.motspourmots.fr/2..
Doruntine Vranaj revient chez sa mère après trois ans passés loin de sa famille, auprès de son époux. Elle affirme être revenue avec Konstantin, son frère, mais celui-ci est mort depuis des années, ainsi que les huit autres fils de la famille Vranaj. Qui, alors, a ramené Doruntine chez les siens ? « Peut-être que ce genre de choses plaît aux jeunes mariées d'aujourd'hui. Peut-être qu'elles aiment chevaucher la nuit enlacées à une ombre, dans les ténèbres et le néant. » (p. 185) L'affaire ne manque pas d'affoler le village et le capitaine Stres qui ne peut hélas pas interroger la jeune fille et sa mère, violemment ébranlées par leurs retrouvailles empreintes de mystère macabre. « Sous nos yeux est en train de naître une légende. » (p. 64) D'une noce à des funérailles, entre une promesse et une malédiction, le retour de Doruntine n'est pas seulement une énigme, c'est surtout la puissance manifestation de l'âme albanaise.
Je découvre Ismaïl Kadaré avec ce court texte et je suis enchantée. Sous le prétexte de présenter une fable médiévale albanaise, l'auteur célèbre son pays, son identité et la force d'esprit de son peuple. En outre, l'édition dans laquelle j'ai lu cette nouvelle est destinée aux scolaires et l'appareil critique est très intéressant.
Je découvre Ismaïl Kadaré avec ce court texte et je suis enchantée. Sous le prétexte de présenter une fable médiévale albanaise, l'auteur célèbre son pays, son identité et la force d'esprit de son peuple. En outre, l'édition dans laquelle j'ai lu cette nouvelle est destinée aux scolaires et l'appareil critique est très intéressant.
Chronique douce amère qui se déroule dans l'Albanie communiste , composé de trois récits .
L'auteur encore enfant puis jeune ado ne se rend pas toujours bien compte de la gravité de vivre dans un pays communiste où la liberté est un concept irréaliste .
Un jour au lycée , il se passe une scène surréaliste , l'école est envahie de jeunes révoltés qui s'en prennent publiquement aux profs de français , de grec et de latin , ils sont mis dehors , on croit rêver , aux cris de ´ vive le russe ´ .
C'est bien plus tard que le futur auteur qui n'a pas son pareil pour dénoncer les abus du régime avec humour va se rendre compte du manque de liberté qui règne dans son pays .
Il essaye de comprendre les adultes et n'y parvient pas comme tous les enfants , il se demande bien pourquoi l'atmosphère chez lui ou chez ses grands parents n'est plus si gaie , si légère .
De quoi peut bien parler sa grand mère à ses amies pour être si grave , pourquoi son oncle préféré a - t -il voulu se suicider ?
Ah pour avoir une carte du parti communiste mais n'est - t - on dans un état communiste ?
Oui mais un état communiste c'est aussi la méfiance , les gens qui s'épient même dans les familles les plus unies , survivent difficilement dans ce cas les personnes âgées qui avaient des biens , de l'éducation , les anciens responsables de l'empire Ottoman , les généraux et autres personnes qui avaient des responsabilités , toutes ces personnes qui sortent le moins possible et qui rasent les murs quand elles sont obligées de venir en ville .
Pourtant quand le parti sera enfin le parti officiel , que de surprises , quoi cet ancien dignitaire de l'empire ottoman était un des premiers à avoir sa carte du parti , cette vielle femme qui sortait avec ses bijoux , ses fourrures , dont on se moquait méchamment à chacune de ses très rares sorties ´ tu n'es plus aussi fière maintenant ´ , avait aussi sa carte du parti.
Le plus incroyable c'est que cet employé modèle , que tout le mon respectait parce qu'il avait été un des premiers à parler russe , et bien lui n'a pas de carte de parti .
L'auteur jeune trouve que Staline a une bonne tête , comment peut il inspirer autant de peur , celui qui ressemble à un grand père bienveillant ? , et Enver Hodja , ne peut on pas avoir un président avec une tête de bandits à la place de cet homme à l'éternel sourire , surreprésenté dans les bibliothèque du pays ?
Une tête de bandits voilà qui plairait aux jeunes , les ferait rêver d'être gouvernés par un tel homme .
Même si ce livre a quelques défauts , l'auteur a un réel talent de conteur .
L'auteur encore enfant puis jeune ado ne se rend pas toujours bien compte de la gravité de vivre dans un pays communiste où la liberté est un concept irréaliste .
Un jour au lycée , il se passe une scène surréaliste , l'école est envahie de jeunes révoltés qui s'en prennent publiquement aux profs de français , de grec et de latin , ils sont mis dehors , on croit rêver , aux cris de ´ vive le russe ´ .
C'est bien plus tard que le futur auteur qui n'a pas son pareil pour dénoncer les abus du régime avec humour va se rendre compte du manque de liberté qui règne dans son pays .
Il essaye de comprendre les adultes et n'y parvient pas comme tous les enfants , il se demande bien pourquoi l'atmosphère chez lui ou chez ses grands parents n'est plus si gaie , si légère .
De quoi peut bien parler sa grand mère à ses amies pour être si grave , pourquoi son oncle préféré a - t -il voulu se suicider ?
Ah pour avoir une carte du parti communiste mais n'est - t - on dans un état communiste ?
Oui mais un état communiste c'est aussi la méfiance , les gens qui s'épient même dans les familles les plus unies , survivent difficilement dans ce cas les personnes âgées qui avaient des biens , de l'éducation , les anciens responsables de l'empire Ottoman , les généraux et autres personnes qui avaient des responsabilités , toutes ces personnes qui sortent le moins possible et qui rasent les murs quand elles sont obligées de venir en ville .
Pourtant quand le parti sera enfin le parti officiel , que de surprises , quoi cet ancien dignitaire de l'empire ottoman était un des premiers à avoir sa carte du parti , cette vielle femme qui sortait avec ses bijoux , ses fourrures , dont on se moquait méchamment à chacune de ses très rares sorties ´ tu n'es plus aussi fière maintenant ´ , avait aussi sa carte du parti.
Le plus incroyable c'est que cet employé modèle , que tout le mon respectait parce qu'il avait été un des premiers à parler russe , et bien lui n'a pas de carte de parti .
L'auteur jeune trouve que Staline a une bonne tête , comment peut il inspirer autant de peur , celui qui ressemble à un grand père bienveillant ? , et Enver Hodja , ne peut on pas avoir un président avec une tête de bandits à la place de cet homme à l'éternel sourire , surreprésenté dans les bibliothèque du pays ?
Une tête de bandits voilà qui plairait aux jeunes , les ferait rêver d'être gouvernés par un tel homme .
Même si ce livre a quelques défauts , l'auteur a un réel talent de conteur .
On se prend souvent à s'interroger à la lecture d'Avril brisé : mais dans quel espace/temps la plume talentueuse d'Ismail Kakaré nous fait-elle évoluer ?
Sommes-nous dans l'univers sombre et gothique de ces contes noirs des pays d'Europe de l'Est ? Ce que nous lisons a-t-il vraiment existé ?
Oui, le kanun et ses ancestrales règles régissant impitoyablement la vie des albanais a bien existé et existe toujours.
Avril brisé se révèle alors comme une sorte de roman ethnographique d'une étrange densité dramatique.
Car malgré des explications détaillées sur les fonctionnements de ce kanun, la trame romanesque réussit à maintenir une sourde angoisse du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. le livre ouvre une sorte de brèche fantastique parcourue sur des routes détrempées et cabossées par la calèche des protagonistes ou à pied par le jeune Gjorg en errance depuis qu'il a tué.
Avril brisé a la beauté d'une tragédie et comme toute tragédie, il se construit sur le sang et l'amour, danse éternelle et macabre d'éros et de thanatos.
Kadaré est un immense auteur que je viens ainsi seulement de découvrir.
Sommes-nous dans l'univers sombre et gothique de ces contes noirs des pays d'Europe de l'Est ? Ce que nous lisons a-t-il vraiment existé ?
Oui, le kanun et ses ancestrales règles régissant impitoyablement la vie des albanais a bien existé et existe toujours.
Avril brisé se révèle alors comme une sorte de roman ethnographique d'une étrange densité dramatique.
Car malgré des explications détaillées sur les fonctionnements de ce kanun, la trame romanesque réussit à maintenir une sourde angoisse du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. le livre ouvre une sorte de brèche fantastique parcourue sur des routes détrempées et cabossées par la calèche des protagonistes ou à pied par le jeune Gjorg en errance depuis qu'il a tué.
Avril brisé a la beauté d'une tragédie et comme toute tragédie, il se construit sur le sang et l'amour, danse éternelle et macabre d'éros et de thanatos.
Kadaré est un immense auteur que je viens ainsi seulement de découvrir.
Les nouvelles de Kadaré sont de véritables petits joyaux de profondeur et de subtilité. J'avais déjà lu un premier recueil il y a quelques années et voilà ma deuxième rencontre avec ce représentant de la littérature albanaise. Certes ce n'est pas là l'un de ses livres les plus connus, mais cela n'empêche qu’il s’agit d’un livre qu'il faut découvrir sachant qu'il condense en si peu de pages des thèmes essentiels dans l'œuvre de l'albanais.
La première partie a pour titre : "Récits d'outre-temps" et contient quatre nouvelles. Dans la première ; "Prométhée", il s'agit d'une reproduction assez libre du mythe de ce titan qui se sacrifie pour l'humanité. Mais c'est aussi une reconstitution de la trilogie d'Eschyle. Kadaré s'amuse à introduire des anachronismes pour ajouter un aspect moderne à sa nouvelle (la mention d'Amnesty International qui pourra défendre la cause de Prométhée). En plus, il s'attache à des détails insignifiants pour reconstruire sa nouvelle et la rendre plus réaliste. Ce point-là me rappelle une nouvelle de Jorge Luis Borges sur le minotaure où il bouleverse totalement la trame de ce mythe.
La deuxième nouvelle est un mélange entre le drôle et le cruel et l'on suit le parcours nocturne d'une porteuse de songes qui doit verser un tube dans l’esprit des dormeurs. Cette tâche qui s'avère simple est un acte très dangereux qui peut avoir des suites tragiques parfois. L'auteur s'amuse à évoquer moult personnalités célèbres comme Hitler, Joyce, Gengis Khan, Dante etc.
La troisième nouvelle est un jeu qui me rappelle les "Exercices de style" de Queneau mais cette fois d'une manière plutôt cinématographique où la même scène se répète interminablement mais sans perdre de son charme. Il s'agit de l'assassinat d'Agamemnon par sa femme.
La dernière nouvelle est un retour au mythe du sphinx. Or, Kadaré en fait le symbole même de la tyrannie et de la relation fondée sur la peur entre le peuple et le tyran.
La deuxième partie s'intitule "Récits de la nuit tombante" et comporte deux nouvelles. La première regroupe les notes d'un capitaine au port relatant l'arrivée de réfugiés albanais au Moyen-Age. Chose étrange, au moment de la publication de cette nouvelle au début des années 90, il y avait justement une migration des albanais vers l'Italie. Cette coïncidence est un véritable exemple du retour éternel.
La seconde nouvelle est surtout la relation d'une histoire qui illustre ce croisement entre les religions mais aussi entre l'Europe et l'Asie à travers la restauration insolite d'une église par un architecte hermaphrodite qui doit la transformer en mosquée. Ce symbole d'une Albanie qui subit l'influence de deux parties géographiques, culturelles et religieuses est l’un des sujets essentiels de l’œuvre d’Ismail Kadaré.
La première partie a pour titre : "Récits d'outre-temps" et contient quatre nouvelles. Dans la première ; "Prométhée", il s'agit d'une reproduction assez libre du mythe de ce titan qui se sacrifie pour l'humanité. Mais c'est aussi une reconstitution de la trilogie d'Eschyle. Kadaré s'amuse à introduire des anachronismes pour ajouter un aspect moderne à sa nouvelle (la mention d'Amnesty International qui pourra défendre la cause de Prométhée). En plus, il s'attache à des détails insignifiants pour reconstruire sa nouvelle et la rendre plus réaliste. Ce point-là me rappelle une nouvelle de Jorge Luis Borges sur le minotaure où il bouleverse totalement la trame de ce mythe.
La deuxième nouvelle est un mélange entre le drôle et le cruel et l'on suit le parcours nocturne d'une porteuse de songes qui doit verser un tube dans l’esprit des dormeurs. Cette tâche qui s'avère simple est un acte très dangereux qui peut avoir des suites tragiques parfois. L'auteur s'amuse à évoquer moult personnalités célèbres comme Hitler, Joyce, Gengis Khan, Dante etc.
La troisième nouvelle est un jeu qui me rappelle les "Exercices de style" de Queneau mais cette fois d'une manière plutôt cinématographique où la même scène se répète interminablement mais sans perdre de son charme. Il s'agit de l'assassinat d'Agamemnon par sa femme.
La dernière nouvelle est un retour au mythe du sphinx. Or, Kadaré en fait le symbole même de la tyrannie et de la relation fondée sur la peur entre le peuple et le tyran.
La deuxième partie s'intitule "Récits de la nuit tombante" et comporte deux nouvelles. La première regroupe les notes d'un capitaine au port relatant l'arrivée de réfugiés albanais au Moyen-Age. Chose étrange, au moment de la publication de cette nouvelle au début des années 90, il y avait justement une migration des albanais vers l'Italie. Cette coïncidence est un véritable exemple du retour éternel.
La seconde nouvelle est surtout la relation d'une histoire qui illustre ce croisement entre les religions mais aussi entre l'Europe et l'Asie à travers la restauration insolite d'une église par un architecte hermaphrodite qui doit la transformer en mosquée. Ce symbole d'une Albanie qui subit l'influence de deux parties géographiques, culturelles et religieuses est l’un des sujets essentiels de l’œuvre d’Ismail Kadaré.
Ce roman est le premier de cet écrivain albanais qui restera certainement un des grands noms de la littérature de la fin du XXème siècle et du début du XIXème siècle (actuellement âgé de 80 ans, il a été accueilli en France après avoir achevé de tomber en disgrâce dans son pays stalinien, et partage actuellement sa vie entre la France et l’Albanie).
Ses romans ne sont pas toujours faciles d’accès, il faut accepter d’y entrer, et l’on s’en trouve ensuite récompensé ! Ici, quel est l’argument de départ ? Un général de l’armée italienne est chargé par son gouvernement, vingt ans après la fin de la guerre, de ramener au pays et de rendre à leurs familles les restes des soldats morts en Albanie pendant la deuxième guerre mondiale. Que fait Kadaré de cette intrigue ?
Il en fait d’abord une réflexion sur la vanité et la sottise de la guerre. Initialement très fier de sa mission, prenant de haut les réactions des familles, la rencontre des Albanais…, le héros de son roman est enfermé dans son assurance de général chargé d’une mission qui le valorise. Mais il va peu à peu se rendre compte du caractère dérisoire, voire absurde, de sa quête. Aller déterrer ces squelettes, en faisant mine de pouvoir les identifier, en profanant en quelque sorte la terre qui les avait recueillis et dans laquelle ils dormaient tranquilles, pour les rendre à une famille dont la demande est en fait viciée par le chagrin qui l’empêche d’en voir le caractère macabre, cela n’est pas en fait une mission de gloire… Et en termes de gloire, il va plutôt découvrir l’envers de la guerre, le malheur qu’elle sème, les comportements sans panache, voire honteux, des soldats qu’il prenait pour des héros, qui sont en fait volontiers déserteurs, voire violeurs…
Son contact quotidien avec les restes exhumés crée peu à peu en lui un rapport étrange à cette armée de restes humains enfermés dans des sacs de plastique qui deviennent leur nouvel uniforme, et il se sent de plus en plus général à la tête de cette armée de morts, d’où le titre du roman. Il se trouve en quelque sorte aspiré par ce monde de morts.
Le roman, riche de tant et tant d’expressions du sentiment humain, est aussi un hymne au pays natal, à cette Albanie aux habitants si rudes et si profonds. Certains passages sont très prenants, comme par exemple les chants des villageois dans la nuit, ou la noce…
On a l’impression qu’il ne se passe pas grand-chose, que les jours se succèdent sous la pluie, mais c’est l’aventure intérieure qui fait son chemin. Ce roman est d’une grande humanité…
Ses romans ne sont pas toujours faciles d’accès, il faut accepter d’y entrer, et l’on s’en trouve ensuite récompensé ! Ici, quel est l’argument de départ ? Un général de l’armée italienne est chargé par son gouvernement, vingt ans après la fin de la guerre, de ramener au pays et de rendre à leurs familles les restes des soldats morts en Albanie pendant la deuxième guerre mondiale. Que fait Kadaré de cette intrigue ?
Il en fait d’abord une réflexion sur la vanité et la sottise de la guerre. Initialement très fier de sa mission, prenant de haut les réactions des familles, la rencontre des Albanais…, le héros de son roman est enfermé dans son assurance de général chargé d’une mission qui le valorise. Mais il va peu à peu se rendre compte du caractère dérisoire, voire absurde, de sa quête. Aller déterrer ces squelettes, en faisant mine de pouvoir les identifier, en profanant en quelque sorte la terre qui les avait recueillis et dans laquelle ils dormaient tranquilles, pour les rendre à une famille dont la demande est en fait viciée par le chagrin qui l’empêche d’en voir le caractère macabre, cela n’est pas en fait une mission de gloire… Et en termes de gloire, il va plutôt découvrir l’envers de la guerre, le malheur qu’elle sème, les comportements sans panache, voire honteux, des soldats qu’il prenait pour des héros, qui sont en fait volontiers déserteurs, voire violeurs…
Son contact quotidien avec les restes exhumés crée peu à peu en lui un rapport étrange à cette armée de restes humains enfermés dans des sacs de plastique qui deviennent leur nouvel uniforme, et il se sent de plus en plus général à la tête de cette armée de morts, d’où le titre du roman. Il se trouve en quelque sorte aspiré par ce monde de morts.
Le roman, riche de tant et tant d’expressions du sentiment humain, est aussi un hymne au pays natal, à cette Albanie aux habitants si rudes et si profonds. Certains passages sont très prenants, comme par exemple les chants des villageois dans la nuit, ou la noce…
On a l’impression qu’il ne se passe pas grand-chose, que les jours se succèdent sous la pluie, mais c’est l’aventure intérieure qui fait son chemin. Ce roman est d’une grande humanité…
Qui a ramené Doruntine, ou comment débunker les fake news au Moyen-Âge.
Vers l'an mil dans une riche et ancienne famille albanaise, Doruntine Vranaj est l'unique fille d'une fratrie de dix. Elle épouse un homme d'un pays lointain, ce qui est déjà une entorse aux traditions. Encore que ça se discute, les traditions, surtout quand on voit Palok, l'idiot - consanguin - du village.
Bref, Doruntine traverse "la moitié d'un continent" pour aller vivre en Bohême chez son mari, mais son frère Konstantin a promis qu'il irait la chercher si elle leur manquait trop. Ce n'est pas une promesse anodine : c'est la "bessa", c'est une affaire d'honneur.
Mais la guerre et la peste emportent Konstantin ainsi que les huit autres frères, et les brus quittent avec leurs enfants la maison endeuillée. La pauvre mère solitaire, devant la tombe de Konstantin, le maudit de n'avoir pas tenu sa promesse.
Qu'à cela ne tienne : Doruntine reparait chez sa mère, et assure à tous que c'est bien Konstantin qui l'a ramenée.
De cette légende albanaise, Kadaré fait... un polar.
Eh oui, c'est l'anachronique policier du village, Stres, un homme rationnel, qui mène l'enquête pour découvrir Qui a ramené Doruntine ?
Et c'est bien compliqué de démêler le vrai du faux, dans cette ambiance complotiste où "il leur fallait à tout prix apprendre quelque chose, vite même, car ils constituaient le premier cercle que les nouvelles devaient atteindre pour se propager ensuite par vagues à travers le monde entier."
(Kadaré a anticipé Twitter.)
Pour les pleureuses aux obsèques, c'est la construction d'un mythe : le frère lié par la "bessa" qui sort de sa tombe pour accomplir son devoir.
Pour les Églises, en conflit entre catholiques et orthodoxes, il n'est pas question de parler de la résurrection d'un mort, ce serait une concurrence déloyale : il va falloir trouver une explication plus politiquement correcte.
Pour l'adjoint qui enquête dans les archives de la famille Vranaj, il y a un secret croustillant mais inavouable - que je ne dévoilerai pas.
Pour le témoin... et bien il avouera volontiers tout ce qu'on veut, au vu des circonstances - que je ne dévoilerai pas non plus.
Et à la façon d'un Hercule Poirot, le policier Stres rassemblera tout le village pour la révélation... et le twist final.
Un roman remarquable, court mais dense, qui décortique tous les ressorts de la propagande et de la manipulation, avec une grande ironie et un grand talent.
Traduction impeccable de Jusuf Vrioni.
(J'aurais dû éviter l'édition Larousse, faite pour des scolaires et plombée par de multiples notes en bas de page : je déteste les notes en bas de page. Même la numérotation des lignes a perturbé ma lecture. Et "Niveau recommandé : collège" c'est vite dit, lorsqu'on explique par exemple le mot "hérésie" par "doctrine contraire au dogme officiel" : au lieu d'un mot compliqué, mettez-m'en deux !)
Challenge Globe-Trotter (Albanie)
LC thématique de juillet 2022 : "Les prénoms, saison 2"
Vers l'an mil dans une riche et ancienne famille albanaise, Doruntine Vranaj est l'unique fille d'une fratrie de dix. Elle épouse un homme d'un pays lointain, ce qui est déjà une entorse aux traditions. Encore que ça se discute, les traditions, surtout quand on voit Palok, l'idiot - consanguin - du village.
Bref, Doruntine traverse "la moitié d'un continent" pour aller vivre en Bohême chez son mari, mais son frère Konstantin a promis qu'il irait la chercher si elle leur manquait trop. Ce n'est pas une promesse anodine : c'est la "bessa", c'est une affaire d'honneur.
Mais la guerre et la peste emportent Konstantin ainsi que les huit autres frères, et les brus quittent avec leurs enfants la maison endeuillée. La pauvre mère solitaire, devant la tombe de Konstantin, le maudit de n'avoir pas tenu sa promesse.
Qu'à cela ne tienne : Doruntine reparait chez sa mère, et assure à tous que c'est bien Konstantin qui l'a ramenée.
De cette légende albanaise, Kadaré fait... un polar.
Eh oui, c'est l'anachronique policier du village, Stres, un homme rationnel, qui mène l'enquête pour découvrir Qui a ramené Doruntine ?
Et c'est bien compliqué de démêler le vrai du faux, dans cette ambiance complotiste où "il leur fallait à tout prix apprendre quelque chose, vite même, car ils constituaient le premier cercle que les nouvelles devaient atteindre pour se propager ensuite par vagues à travers le monde entier."
(Kadaré a anticipé Twitter.)
Pour les pleureuses aux obsèques, c'est la construction d'un mythe : le frère lié par la "bessa" qui sort de sa tombe pour accomplir son devoir.
Pour les Églises, en conflit entre catholiques et orthodoxes, il n'est pas question de parler de la résurrection d'un mort, ce serait une concurrence déloyale : il va falloir trouver une explication plus politiquement correcte.
Pour l'adjoint qui enquête dans les archives de la famille Vranaj, il y a un secret croustillant mais inavouable - que je ne dévoilerai pas.
Pour le témoin... et bien il avouera volontiers tout ce qu'on veut, au vu des circonstances - que je ne dévoilerai pas non plus.
Et à la façon d'un Hercule Poirot, le policier Stres rassemblera tout le village pour la révélation... et le twist final.
Un roman remarquable, court mais dense, qui décortique tous les ressorts de la propagande et de la manipulation, avec une grande ironie et un grand talent.
Traduction impeccable de Jusuf Vrioni.
(J'aurais dû éviter l'édition Larousse, faite pour des scolaires et plombée par de multiples notes en bas de page : je déteste les notes en bas de page. Même la numérotation des lignes a perturbé ma lecture. Et "Niveau recommandé : collège" c'est vite dit, lorsqu'on explique par exemple le mot "hérésie" par "doctrine contraire au dogme officiel" : au lieu d'un mot compliqué, mettez-m'en deux !)
Challenge Globe-Trotter (Albanie)
LC thématique de juillet 2022 : "Les prénoms, saison 2"
Mauvaise pioche que ce livre, pourtant le très beau titre et la quatrième de couverture m'annonçant un "chef d'œuvre" m'avaient fait bien envie. Je suis malheureusement tombé de haut, à tel point que contrairement à mon habitude j'ai failli abandonner ce livre deux ou trois fois avant de parvenir à le terminer.
L'idée de départ reste très originale: envoyer un général italien, vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale, en Albanie pour récupérer les corps des soldats tués. Malheureusement, le traitement de l'histoire reste, pour ma part, très plat. Le récit s'allonge de pages en pages d'anecdotes, de pensées, c'est long, très long sans qu'il ne se passe rien de vraiment intéressant. Au vu des notes attribuées à ce roman par les autres lecteurs de Babelio, je pense que je suis totalement passé à côté de ce livre, qu'il n'était pas fait pour moi. J'ai raté cette rencontre avec cet auteur Albanais et la poésie avec laquelle il a décrit son pays et ses habitants.
Je ne sais pas s'il y a une vérité historique dans ce récit ce qui ne serait pas étonnant.
Ne vous fiez pas à mon avis si vous avez envie de découvrir ce roman, faites vous votre propre opinion, elle sera peut-être , je l'espère, différente de la mienne.
L'idée de départ reste très originale: envoyer un général italien, vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale, en Albanie pour récupérer les corps des soldats tués. Malheureusement, le traitement de l'histoire reste, pour ma part, très plat. Le récit s'allonge de pages en pages d'anecdotes, de pensées, c'est long, très long sans qu'il ne se passe rien de vraiment intéressant. Au vu des notes attribuées à ce roman par les autres lecteurs de Babelio, je pense que je suis totalement passé à côté de ce livre, qu'il n'était pas fait pour moi. J'ai raté cette rencontre avec cet auteur Albanais et la poésie avec laquelle il a décrit son pays et ses habitants.
Je ne sais pas s'il y a une vérité historique dans ce récit ce qui ne serait pas étonnant.
Ne vous fiez pas à mon avis si vous avez envie de découvrir ce roman, faites vous votre propre opinion, elle sera peut-être , je l'espère, différente de la mienne.
" Depuis longtemps, j'avais envie de construire un enfer. Je mesurais pourtant ce qu'avait d'ambitieux et même de chimérique un pareil projet à la suite des anonymes égyptiens, de Virgile, saint Augustin, et surtout Dante... ", a dit Ismaïl Kadaré à propos de ce roman qu'on peut considérer comme son chef-d'oeuvre.
Le récit nous entraîne dans un monde surréaliste qui prend pied dans une réalité géographique et culturelle albanaise. Dans ce monde imaginaire le Sultan règne grâce à un système de renseignements puissant qui se base sur l’interprétation des rêves des citoyens.
Ces rêves, entendus comme des interprétations d’une situation sociale, ou comme des annonces d’un danger imminent, sont manipulables à volonté.
Tâche kafkaïenne que celle de passer au crible ces millions d'allégories et d'énigmes nocturnes, dans la terreur de laisser échapper celle qui permettra de connaître et conjurer les menaces à venir!
Mission dantesque que celle de drainer et centraliser l'inconscient collectif de tout un pays!
Le Palais des rêves ne dépeint pas seulement une administration aux buts absurdes, pour suggérer les travers du communisme bureaucratique.
Il va plus loin.
Dans l’Empire, celui qui tient le Palais des Rêves tient le pouvoir. La coterie familiale albanaise de Mark-Alem l’a bien compris et, dans ses mains, ce dernier n’est qu’un jouet.
Une ambiance de purge plane pourtant,sur le Palais, comme elle plane sur l’Albanie.
Les derniers chapitres, bruissants de rumeurs et de complots, expriment bien cette réalité : la guerre interne du pouvoir fait rage, sans que personne ne parvienne, et surtout pas le narrateur, à l’approcher.
Tout ce que l’on peut constater est qu’elle a lieu. Ses motifs sont aussi obscurs que ses fins. Son résultat, inattendu, demeurera une énigme, même pour son principal bénéficiaire.
L’auteur s’éloigne de la satire noire du communisme, pour creuser plus profondément dans l’insaisissable puissance politique telle qu’elle se manifeste dans une société.
Le fait onirique, tel un fait social, constitue un moyen et non une fin : un moyen de lutte politique, un moyen de compréhension du "réel", un moyen d’expansion du contrôle social.
Bien sûr, si la réalité est susceptible d’être interprétée en termes univoques (et encore), ce n’est pas le cas des manifestations oniriques
Le Palais des rêves d’Ismail Kadaré est le cousin albanais de " 1984 " de Goerges Orwell.
Le récit nous entraîne dans un monde surréaliste qui prend pied dans une réalité géographique et culturelle albanaise. Dans ce monde imaginaire le Sultan règne grâce à un système de renseignements puissant qui se base sur l’interprétation des rêves des citoyens.
Ces rêves, entendus comme des interprétations d’une situation sociale, ou comme des annonces d’un danger imminent, sont manipulables à volonté.
Tâche kafkaïenne que celle de passer au crible ces millions d'allégories et d'énigmes nocturnes, dans la terreur de laisser échapper celle qui permettra de connaître et conjurer les menaces à venir!
Mission dantesque que celle de drainer et centraliser l'inconscient collectif de tout un pays!
Le Palais des rêves ne dépeint pas seulement une administration aux buts absurdes, pour suggérer les travers du communisme bureaucratique.
Il va plus loin.
Dans l’Empire, celui qui tient le Palais des Rêves tient le pouvoir. La coterie familiale albanaise de Mark-Alem l’a bien compris et, dans ses mains, ce dernier n’est qu’un jouet.
Une ambiance de purge plane pourtant,sur le Palais, comme elle plane sur l’Albanie.
Les derniers chapitres, bruissants de rumeurs et de complots, expriment bien cette réalité : la guerre interne du pouvoir fait rage, sans que personne ne parvienne, et surtout pas le narrateur, à l’approcher.
Tout ce que l’on peut constater est qu’elle a lieu. Ses motifs sont aussi obscurs que ses fins. Son résultat, inattendu, demeurera une énigme, même pour son principal bénéficiaire.
L’auteur s’éloigne de la satire noire du communisme, pour creuser plus profondément dans l’insaisissable puissance politique telle qu’elle se manifeste dans une société.
Le fait onirique, tel un fait social, constitue un moyen et non une fin : un moyen de lutte politique, un moyen de compréhension du "réel", un moyen d’expansion du contrôle social.
Bien sûr, si la réalité est susceptible d’être interprétée en termes univoques (et encore), ce n’est pas le cas des manifestations oniriques
Le Palais des rêves d’Ismail Kadaré est le cousin albanais de " 1984 " de Goerges Orwell.
Un livre que j'aurais pu lire en version originale, mais à l'époque cela ne m'intéressait pas car je connaissais bien la légende de Doruntine, qui mettait l'accent sur l'importance de la promesse donnée. ( la bessa ) :
Constantin avait promis à sa mère qu'il allait lui ramener sa fille Doruntine, mariée dans un pays lointain, dès qu'elle aurait besoin de la voir... Mais la guerre a éclaté, provoquant la mort de Constantin et de ses huit autres frères. Trois longues années sont passées et puis un jour, Doruntine s'est présentée chez sa mère prétendant être venue avec son frère, Constantin. (Pour tenir la promesse qu'il avait donné à sa mère, le frère défunt était sorti de la tombe et avait ramené sa soeur) ...
Il s'agit ici de la légende dont on prend connaissance dès le début du livre. L'auteur a choisi d'adapter la légende et d'en faire un récit policier.
Qui a ramené Doruntine ? C'est la question qui se pose le détective dès qu'il apprend qu'elle vient d'arriver près de sa mère. On cheminera à côté de lui dans toutes ses réflexions.
Pas le temps de s'ennuyer avec ce livre. Tout les éléments sont réunis pour que le lecteur s'intéresse aux événements : une enquête passionnante, des rebondissements, une atmosphère mystérieuse, une belle écriture qui s'adapte au drame qui vit la famille Vranaj...
Et en fait : Qui a ramené Doruntine ? S'agit-t-il de Constantin comme dans la légende ? Ou de quelqu'un d'autre ?
Voulez - vous le savoir ? Lisez le livre !
Constantin avait promis à sa mère qu'il allait lui ramener sa fille Doruntine, mariée dans un pays lointain, dès qu'elle aurait besoin de la voir... Mais la guerre a éclaté, provoquant la mort de Constantin et de ses huit autres frères. Trois longues années sont passées et puis un jour, Doruntine s'est présentée chez sa mère prétendant être venue avec son frère, Constantin. (Pour tenir la promesse qu'il avait donné à sa mère, le frère défunt était sorti de la tombe et avait ramené sa soeur) ...
Il s'agit ici de la légende dont on prend connaissance dès le début du livre. L'auteur a choisi d'adapter la légende et d'en faire un récit policier.
Qui a ramené Doruntine ? C'est la question qui se pose le détective dès qu'il apprend qu'elle vient d'arriver près de sa mère. On cheminera à côté de lui dans toutes ses réflexions.
Pas le temps de s'ennuyer avec ce livre. Tout les éléments sont réunis pour que le lecteur s'intéresse aux événements : une enquête passionnante, des rebondissements, une atmosphère mystérieuse, une belle écriture qui s'adapte au drame qui vit la famille Vranaj...
Et en fait : Qui a ramené Doruntine ? S'agit-t-il de Constantin comme dans la légende ? Ou de quelqu'un d'autre ?
Voulez - vous le savoir ? Lisez le livre !
La couverture ne payait pas de mine…Un auteur totalement inconnu…
Livre trouvé chez pêle-mêle…Et au départ, il ne faisait pas partie de ma liste.
Mais bon, j'étais partante pour découvrir la littérature albanaise…Intriguée par le scénario et par ce titre : Qui a ramené Doruntine ?
Voici mon ressenti…
J'ai aimé l'univers de policier et de légende (un peu comme le cavalier sans tête mais d'un autre âge.
Publié en 86, totalement oublié des étagères mais qui ne m'a pas laissé indifférente.
Bien sûr, ce ne sera pas mon coup de coeur de l'année mais j'ai passé un bon moment…
Qui sait si je trouve encore un autre titre de Kadaré ou un autre auteur albanais…Pourquoi pas !
Il m'a donné envie de découvrir un peuple, des légendes provenant d'autres terres.
Livre trouvé chez pêle-mêle…Et au départ, il ne faisait pas partie de ma liste.
Mais bon, j'étais partante pour découvrir la littérature albanaise…Intriguée par le scénario et par ce titre : Qui a ramené Doruntine ?
Voici mon ressenti…
J'ai aimé l'univers de policier et de légende (un peu comme le cavalier sans tête mais d'un autre âge.
Publié en 86, totalement oublié des étagères mais qui ne m'a pas laissé indifférente.
Bien sûr, ce ne sera pas mon coup de coeur de l'année mais j'ai passé un bon moment…
Qui sait si je trouve encore un autre titre de Kadaré ou un autre auteur albanais…Pourquoi pas !
Il m'a donné envie de découvrir un peuple, des légendes provenant d'autres terres.
Avril brisé c'est le mois du printemps séparé en deux par la fatale loi du Kanun, loi immémoriale qui régit tous les aspect de la vie des montagnards du Rrasfh au début du siècle dernier, époque où se déroule l'histoire qui nous intéresse ici. Selon la loi implacable du Coutumier, Gjorg, l'albanais des montagne, jouit encore dans la première moitié de ce mois, de la protection de la sacro-sainte Bessa, foi, parole, ou protection jurée, selon laquelle celui qui a versé le sang est à l'abri des représailles de la famille de la victime. Mais après la date qui marquera la fin de la grande trêve d'un mois, il devra vivre comme un fugitif, abandonner les grands chemins, se déplacer nuitamment ou aller s'enfermer sine die dans une sombre tour claustrale où l'asile lui sera donné.
Le roman illustre une réalité, celle de la vendetta vécut pas trois entités bien différentes. Gjorg à vengé le sang de son frère, dont la chemise ensanglantée, sinistre bannière, flottait au deuxième étage de sa kulla, appelant vengeance. Bessian et son épouse, sont de grands bourgeois, venus passer leur voyage de noces sur le grand plateau du nord, afin d'étudier, de leur regard, moitié détaché, moitié curieux, d'esthètes et d'intellectuels, les lieux où se perpétuent encore cette fascinante loi du talion, nimbée d'une aura homérique légendaire. Enfin Mark Ukacierre est ce que l'usage à baptisé du nom terrible de l'intendant du sang, il est celui qui perçoit, dans la kulla d'Orosh, le fatal impôt du sang, que chaque vengeur se doit d'acquitter. Ainsi pour lui la vendetta, prend l'aspect d'une activité qui se mesure en terme de pertes et de profits, et il doit rendre des comptes si l'année à été mauvaise en terme de sang versé. Ce Kanun, cette conception de l'honneur est bien le fruit d'une perception des rapports humains propre au moyen âge. Le sang versé appelle vengeance, et il est un devoir de laver l'affront, qui s'il n'est pas réparé, rejaillit sur la famille, sur un village entier, voire parfois, sur une communauté de bourgades. La parole donnée est inviolable et l'hospitalité est une valeur cardinale, l'hôte est protégé et respecté, tel un monarque ou un demi dieux. Ismail Kadaré, dans un style sobre, transmet la réalité de ce Kanun, sans juger, en conteur de talent, presque comme un ethnologue.
Avril brisé est un livre pour le lecteur blasé des lectures insipides, soporifiques et répétitives. Dépaysement, ouverture sur des coutumes et des valeurs, qui nous sont étrangères sont au rendez-vous. Une belle découverte qui appelle à poursuivre la lecture des œuvres de l'écrivain albanais.
Le roman illustre une réalité, celle de la vendetta vécut pas trois entités bien différentes. Gjorg à vengé le sang de son frère, dont la chemise ensanglantée, sinistre bannière, flottait au deuxième étage de sa kulla, appelant vengeance. Bessian et son épouse, sont de grands bourgeois, venus passer leur voyage de noces sur le grand plateau du nord, afin d'étudier, de leur regard, moitié détaché, moitié curieux, d'esthètes et d'intellectuels, les lieux où se perpétuent encore cette fascinante loi du talion, nimbée d'une aura homérique légendaire. Enfin Mark Ukacierre est ce que l'usage à baptisé du nom terrible de l'intendant du sang, il est celui qui perçoit, dans la kulla d'Orosh, le fatal impôt du sang, que chaque vengeur se doit d'acquitter. Ainsi pour lui la vendetta, prend l'aspect d'une activité qui se mesure en terme de pertes et de profits, et il doit rendre des comptes si l'année à été mauvaise en terme de sang versé. Ce Kanun, cette conception de l'honneur est bien le fruit d'une perception des rapports humains propre au moyen âge. Le sang versé appelle vengeance, et il est un devoir de laver l'affront, qui s'il n'est pas réparé, rejaillit sur la famille, sur un village entier, voire parfois, sur une communauté de bourgades. La parole donnée est inviolable et l'hospitalité est une valeur cardinale, l'hôte est protégé et respecté, tel un monarque ou un demi dieux. Ismail Kadaré, dans un style sobre, transmet la réalité de ce Kanun, sans juger, en conteur de talent, presque comme un ethnologue.
Avril brisé est un livre pour le lecteur blasé des lectures insipides, soporifiques et répétitives. Dépaysement, ouverture sur des coutumes et des valeurs, qui nous sont étrangères sont au rendez-vous. Une belle découverte qui appelle à poursuivre la lecture des œuvres de l'écrivain albanais.
Gjenerali i Ushtrisë së vdekur
Traduction : Jusuf Vrioni
Introduction : Eric Faye
Sorti en 1963, ce roman est le premier d'Ismaïl Kadare (ou Kadaré), l'auteur albanais le plus lu certainement dans le monde occidental. Malgré la simplicité apparente de la trame de l'action, il s'agit d'un roman difficile à investir - je n'y suis personnellement parvenue qu'à la moitié du texte, c'est vous dire. Pourtant, les phrases sont simples, sèches même mais, curieusement, on a l'impression que cela joue contre l'écrivain. Si simples, si sèches, avec une pointe de maussaderie çà et là : comme si l'auteur s'en voulait (ou se retenait ?) d'écrire. Mais à la réflexion, on se dit que Kadare cherchait peut-être tout simplement son style.
Néanmoins, si l'on persévère, le discours du "Général de l'Armée morte" finit par toucher son lecteur. L'histoire est simple, répétons-le : une bonne vingtaine d'années après la fin de la Seconde guerre mondiale, les représentants d'une puissance européenne ayant combattu et occupé l'Albanie, un général et un aumônier ayant rang de colonel, sont expédiés dans la dictature communiste d'Enver Hoxha afin d'y rassembler les restes de leurs soldats, gradés ou non, jadis tombés et inhumés en terre albanaise. Les deux hommes sont particulièrement soucieux de ramener la dépouille d'un certain colonel Z., issu de l'une des familles les plus influentes de leur pays.
Selon toute vraisemblance et bien que l'auteur les laisse dans un anonymat absolu, le général et l'aumônier sont italiens. Au cours de leur périple dans la boue noire de l'hiver albanais, ils croisent un lieutenant général et un bourgmestre probablement d'Allemagne de l'Ouest, venus eux aussi récupérer leurs morts. Moins heureux que leurs homologues italiens, les Allemands ne disposent ni des cotes, ni des descriptions physiques qui leur permettraient de creuser et d'exhumer sans risque excessif d'erreur.
La funèbre expédition des deux Italiens, entourés d'un expert et de terrassiers albanais, les amène à s'enfoncer dans l'Albanie profonde, dans des villages où ils constatent que rien ne semble avoir été oublié. Cette rancoeur toujours en éveil de l'occupé face à l'ancien occupant culmine avec la scène du mariage durant lequel la vieille Nice, une paysanne dont le mari a été fusillé et la fille de quatorze ans violée par le colonel Z. en personne, jette aux pieds du malheureux général le sac dans lequel, vingt ans plus tôt, elle a enseveli le cadavre de Z., qu'elle avait exécuté de ses propres mains.
"Le Général de l'Armée morte" est aussi une tentative, au début assez timide, puis carrément triomphante et même exaltée, de glorification du caractère de l'Albanais : follement nationaliste, toujours prêt à régler la moindre dispute en faisant parler les armes, fier et tout d'une pièce. La critique du régime d'Enver Hoxha est ici à peine esquissée mais on sent bien, en tous cas lorsque le général et l'aumônier réintègrent la grande ville, une menace latente, celle d'un pouvoir militaire qui ne se pose pas de questions et frappe à tout-va.
Jamais peut-être, pour un "premier roman", aucun auteur ne s'est autant cherché que Kadare dans celui-ci. Si l'on passe le cap de la moitié du roman, ces tâtonnements, cette espèce d'étonnement qu'on sent chez l'auteur face à son propre pouvoir d'écriture, son irritation aussi devant son impuissance à faire vraiment ce qu'il veut des mots (ce n'est un mystère pour personne que l'écrivain a révisé nombre de ses textes, mettant et remettant vingt fois sur le métier des ouvrages qui avaient pourtant été publiés avec son aval) et l'ambiguïté qu'on lui devine envers le régime qui asservit ses compatriotes (il l'asservit certes mais il est aussi farouchement pro-albanais), finissent par inciter à se procurer au moins un autre livre de Kadare. Pour voir. Pour approfondir. Pour comprendre cette fascination que lui-même et son univers semblent avoir exercé et exercer encore sur l'Occident.
Nous en reparlerons. ;o)
Traduction : Jusuf Vrioni
Introduction : Eric Faye
Sorti en 1963, ce roman est le premier d'Ismaïl Kadare (ou Kadaré), l'auteur albanais le plus lu certainement dans le monde occidental. Malgré la simplicité apparente de la trame de l'action, il s'agit d'un roman difficile à investir - je n'y suis personnellement parvenue qu'à la moitié du texte, c'est vous dire. Pourtant, les phrases sont simples, sèches même mais, curieusement, on a l'impression que cela joue contre l'écrivain. Si simples, si sèches, avec une pointe de maussaderie çà et là : comme si l'auteur s'en voulait (ou se retenait ?) d'écrire. Mais à la réflexion, on se dit que Kadare cherchait peut-être tout simplement son style.
Néanmoins, si l'on persévère, le discours du "Général de l'Armée morte" finit par toucher son lecteur. L'histoire est simple, répétons-le : une bonne vingtaine d'années après la fin de la Seconde guerre mondiale, les représentants d'une puissance européenne ayant combattu et occupé l'Albanie, un général et un aumônier ayant rang de colonel, sont expédiés dans la dictature communiste d'Enver Hoxha afin d'y rassembler les restes de leurs soldats, gradés ou non, jadis tombés et inhumés en terre albanaise. Les deux hommes sont particulièrement soucieux de ramener la dépouille d'un certain colonel Z., issu de l'une des familles les plus influentes de leur pays.
Selon toute vraisemblance et bien que l'auteur les laisse dans un anonymat absolu, le général et l'aumônier sont italiens. Au cours de leur périple dans la boue noire de l'hiver albanais, ils croisent un lieutenant général et un bourgmestre probablement d'Allemagne de l'Ouest, venus eux aussi récupérer leurs morts. Moins heureux que leurs homologues italiens, les Allemands ne disposent ni des cotes, ni des descriptions physiques qui leur permettraient de creuser et d'exhumer sans risque excessif d'erreur.
La funèbre expédition des deux Italiens, entourés d'un expert et de terrassiers albanais, les amène à s'enfoncer dans l'Albanie profonde, dans des villages où ils constatent que rien ne semble avoir été oublié. Cette rancoeur toujours en éveil de l'occupé face à l'ancien occupant culmine avec la scène du mariage durant lequel la vieille Nice, une paysanne dont le mari a été fusillé et la fille de quatorze ans violée par le colonel Z. en personne, jette aux pieds du malheureux général le sac dans lequel, vingt ans plus tôt, elle a enseveli le cadavre de Z., qu'elle avait exécuté de ses propres mains.
"Le Général de l'Armée morte" est aussi une tentative, au début assez timide, puis carrément triomphante et même exaltée, de glorification du caractère de l'Albanais : follement nationaliste, toujours prêt à régler la moindre dispute en faisant parler les armes, fier et tout d'une pièce. La critique du régime d'Enver Hoxha est ici à peine esquissée mais on sent bien, en tous cas lorsque le général et l'aumônier réintègrent la grande ville, une menace latente, celle d'un pouvoir militaire qui ne se pose pas de questions et frappe à tout-va.
Jamais peut-être, pour un "premier roman", aucun auteur ne s'est autant cherché que Kadare dans celui-ci. Si l'on passe le cap de la moitié du roman, ces tâtonnements, cette espèce d'étonnement qu'on sent chez l'auteur face à son propre pouvoir d'écriture, son irritation aussi devant son impuissance à faire vraiment ce qu'il veut des mots (ce n'est un mystère pour personne que l'écrivain a révisé nombre de ses textes, mettant et remettant vingt fois sur le métier des ouvrages qui avaient pourtant été publiés avec son aval) et l'ambiguïté qu'on lui devine envers le régime qui asservit ses compatriotes (il l'asservit certes mais il est aussi farouchement pro-albanais), finissent par inciter à se procurer au moins un autre livre de Kadare. Pour voir. Pour approfondir. Pour comprendre cette fascination que lui-même et son univers semblent avoir exercé et exercer encore sur l'Occident.
Nous en reparlerons. ;o)
Le mystère du titre est levé dès le début. Qui est cette poupée et pourquoi ce nom ? Ce n’est pas un livre à suspens au moins c’est clair, je m’étais renseigner uniquement sur l’auteur, je m’attendais à un roman.
Pas de déception non plus, c’est un récit autobiographique et je me retrouve bloqué à écrire ma critique car il ne s’y passe rien de plus que ce qu’il y a la quatrième de couverture. Je n’ai pas de reproche à lui faire, les un peu moins de 200 pages ne m’ont pas laissé le temps de m’ennuyer.
Pas la peine de faire du remplissage, je suis resté de marbre devant ce livre.
Pas de déception non plus, c’est un récit autobiographique et je me retrouve bloqué à écrire ma critique car il ne s’y passe rien de plus que ce qu’il y a la quatrième de couverture. Je n’ai pas de reproche à lui faire, les un peu moins de 200 pages ne m’ont pas laissé le temps de m’ennuyer.
Pas la peine de faire du remplissage, je suis resté de marbre devant ce livre.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Ismaïl Kadaré
Quiz
Voir plus
LES ROMANS DE KADARE
L'arrivée de deux Irlandais new-yorkais, Max Roth et Willy Norton, dans la ville de N., au coeur de l'Albanie, fait l'effet d'une bombe dont les intéressés auraient bien étouffé l'explosion. Le sous-préfet de N. partage bien sûr l'avis de son ministre : il n'est pas exclu que les deux étrangers soient des espions...
Le grand hiver
Le général de l'armée morte
L'année noire
Le dossier H
10 questions
9 lecteurs ont répondu
Thème :
Ismaïl KadaréCréer un quiz sur cet auteur9 lecteurs ont répondu