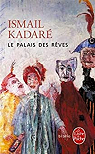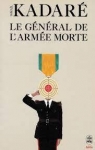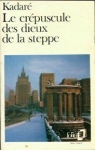Critiques de Ismaïl Kadaré (257)
Cela fait plus de vingt ans qu'on avait découvert Ismail Kadare, porte-drapeau de la littérature albanaise.
Et cela doit bien faire la quatrième fois qu'on lit et relit Les tambours de la pluie, sans doute son meilleur roman, en tout cas celui qu'on préfère.
C'est peut-être aussi la porte la plus facile d'accès sur l'Albanie de Kadare.
En l'an 1443, alors que l'Empire Ottoman est aux portes de Vienne, les albanais de Georges Kastriote faussent compagnie au Sultan ...
C'est le début d'une longue guerre entre l'immense empire turque et la petite et fière Albanie.
Les invasions s'enchaînent, les sièges s'éternisent mais les sultans se succèdent sans succès et la petite et fière Albanie résiste, du moins pendant plus de trente ans.
Il y a un peu d'Astérix ou du village gaulois (l'humour en moins) dans cette histoire. Ou de Jeanne d'Arc (les voix en moins).
Georges Kastriote, dit Skanderberg, devient le héros national.
Les tambours de la pluie racontent l'un de ces sièges, au début du conflit.
On assiste en effet à un véritable siège du temps jadis, du temps où l'on coulait encore les canons sur place.
Les albanais de la citadelle de Kruja sont assiégés par les innombrables armées turques.
Un siège qui s'éternise au fil des saisons et lorsque les turcs trouvent enfin l'aqueduc enterré et secret, on croit bien que la soif aura raison de la résistance albanaise ... jusqu'à ce qu'on entende les roulements des tambours de la pluie.
Les tambours de la pluie qui, dans la tradition militaire turque, annoncent l'arrivée des nuages : la saison des pluies sauvera donc les assiégés. Du moins pour cette fois.
Le bouquin de Kadare nous conte tout cela de manière habile : nous sommes en effet dans le camp des turcs, aux côtés du pacha et de son chroniqueur. Dans le camp des "autres" donc, et comme "eux" désemparés devant la citadelle imprenable.
Entre chaque chapitre, quelques lignes nous éclairent sur la situation des assiégés, le camp de Kadare, le camp du "nous".
Car derrière cette histoire médiévale se cache (à peine) le propos de Kadare, chantre de la fierté nationale albanaise.
Cet ancien combat a en effet, pour les albanais, un écho beaucoup plus récent : lorsqu'en 1960, l'Albanie communiste de Enver Hoxha rompt ses relations avec le grand frère soviétique devenu à ses yeux un peu trop encombrant.Ismail Kadare
Les armées turques (euh, pardon : les armées soviétiques) envahiront Budapest et Prague mais la petite et fière Albanie ne sera jamais inquiétée !
Bien sûr il faut prendre avec un peu de recul le discours de Kadare : les couleurs du nationalisme sont souvent troubles et Enver Hoxha ressemblait sans doute plus à un dictateur communiste qu'au héros Skanderberg de 1443.
Mais les écrits de Kadare ont gardé leur fraîcheur des années 70, bien avant que n'éclatent les balkans. On peut savourer sans arrière-pensée une très belle plume au service de son pays et de sa culture.
Lien : http://bmr-mam.over-blog.com..
Et cela doit bien faire la quatrième fois qu'on lit et relit Les tambours de la pluie, sans doute son meilleur roman, en tout cas celui qu'on préfère.
C'est peut-être aussi la porte la plus facile d'accès sur l'Albanie de Kadare.
En l'an 1443, alors que l'Empire Ottoman est aux portes de Vienne, les albanais de Georges Kastriote faussent compagnie au Sultan ...
C'est le début d'une longue guerre entre l'immense empire turque et la petite et fière Albanie.
Les invasions s'enchaînent, les sièges s'éternisent mais les sultans se succèdent sans succès et la petite et fière Albanie résiste, du moins pendant plus de trente ans.
Il y a un peu d'Astérix ou du village gaulois (l'humour en moins) dans cette histoire. Ou de Jeanne d'Arc (les voix en moins).
Georges Kastriote, dit Skanderberg, devient le héros national.
Les tambours de la pluie racontent l'un de ces sièges, au début du conflit.
On assiste en effet à un véritable siège du temps jadis, du temps où l'on coulait encore les canons sur place.
Les albanais de la citadelle de Kruja sont assiégés par les innombrables armées turques.
Un siège qui s'éternise au fil des saisons et lorsque les turcs trouvent enfin l'aqueduc enterré et secret, on croit bien que la soif aura raison de la résistance albanaise ... jusqu'à ce qu'on entende les roulements des tambours de la pluie.
Les tambours de la pluie qui, dans la tradition militaire turque, annoncent l'arrivée des nuages : la saison des pluies sauvera donc les assiégés. Du moins pour cette fois.
Le bouquin de Kadare nous conte tout cela de manière habile : nous sommes en effet dans le camp des turcs, aux côtés du pacha et de son chroniqueur. Dans le camp des "autres" donc, et comme "eux" désemparés devant la citadelle imprenable.
Entre chaque chapitre, quelques lignes nous éclairent sur la situation des assiégés, le camp de Kadare, le camp du "nous".
Car derrière cette histoire médiévale se cache (à peine) le propos de Kadare, chantre de la fierté nationale albanaise.
Cet ancien combat a en effet, pour les albanais, un écho beaucoup plus récent : lorsqu'en 1960, l'Albanie communiste de Enver Hoxha rompt ses relations avec le grand frère soviétique devenu à ses yeux un peu trop encombrant.Ismail Kadare
Les armées turques (euh, pardon : les armées soviétiques) envahiront Budapest et Prague mais la petite et fière Albanie ne sera jamais inquiétée !
Bien sûr il faut prendre avec un peu de recul le discours de Kadare : les couleurs du nationalisme sont souvent troubles et Enver Hoxha ressemblait sans doute plus à un dictateur communiste qu'au héros Skanderberg de 1443.
Mais les écrits de Kadare ont gardé leur fraîcheur des années 70, bien avant que n'éclatent les balkans. On peut savourer sans arrière-pensée une très belle plume au service de son pays et de sa culture.
Lien : http://bmr-mam.over-blog.com..
Plongée dans l'obscurantisme. Des coutumes héréditaires qui ne valent que parce que toute une région montagnarde les appliquent à la lettre et ne sont pas sans rappeler des immobilismes liberticides comme la charia, sont ici révélées par l'auteur. Ce que je n'ai pas aimé c'est qu'au lieu de dérouler son propos sous forme d'essai ou de ne s'attacher, sous forme romanesque, qu'à son personnage principal, Gjorg, qui vit en plein ces absurdes obligations sanguinaires, il mêle divers personnages pour traiter son sujet (un écrivain, sa femme, un intendant) alors que la force du roman réside dans le drame personnel de celui qui est "obligé" par "les brumes de l'ignorance ancestrale"( phrase reprise de Paul Bowles).
L'auteur Ismaïl Kadaré nous plonge dans les montagnes d'une Albanie sans âge et au coeur d'un village isolé où le sort s'abat sur la famille Vranaj : la seule et unique fille de la fratrie fut mariée à un lointain étranger, tandis que ses frères ont tous péris de la peste suite à leur retour de la guerre. Or, un matin, le village apprend que Doruntine est de retour, et serait à ses dires rentrée en compagnie de son défunt frère Konstantin. Stupeur dans les chaumières : le capitaine Stres doit mener l'enquête pour rétablir la vérité et désigner le coupable : Qui a donc ramené Doruntine ?
L'enquête policière se teinte alors d'une dimension fantastique, puisque la plupart des villageois semblent prêts à croire à un phénomène surnaturel ; la rationalité et les moeurs s'affrontent, tandis qu'une légende naît peu à peu...Toutes les strates de la société finissent par se mêler de la résolution de cette affaire d'État : l'église orthodoxe, en conflit avec l'église catholique, s'acharne à faire taire cette légende qu'elle considère comme un blasphème, le Prince régent s'effraie de voir ressurgir le droit coutumier (le Kanun) alors qu'il s'efforçait d'adoucir les moeurs, les habitants remettent en cause les mariages lointains et le mélange avec d'autres clans.
De son côté, Stres recoupe les différents récits qu'on lui fait des évènements et tente de tirer ses propres conclusions, tout en faisant abstraction de son attirance passée pour la belle Doruntine. S'immergeant toujours plus dans l'enquête, Stres voit les liens qui le rattachent à la raison devenir de plus en plus ténus...
Sous couvert d'une enquête policière et d'un huis-clos albanais, Ismaël Kadaré dresse le portrait d'une société repliée sur elle-même et de ses croyances et traditions. Qui a ramené Doruntine est une formidable mise en abîme qui réunit moeurs, psychologie, histoire médiévale, conflit religieux et questionnement politique, et qui permet au lecteur de s'imprégner d'un pays que l'on connaît finalement bien peu.
Mon seul regret est de n'avoir pas pu cerner la critique de la société totalitaire de l'auteur, dont l'oeuvre a été interdite de publication en Albanie. Une très belle découverte néanmoins !
L'enquête policière se teinte alors d'une dimension fantastique, puisque la plupart des villageois semblent prêts à croire à un phénomène surnaturel ; la rationalité et les moeurs s'affrontent, tandis qu'une légende naît peu à peu...Toutes les strates de la société finissent par se mêler de la résolution de cette affaire d'État : l'église orthodoxe, en conflit avec l'église catholique, s'acharne à faire taire cette légende qu'elle considère comme un blasphème, le Prince régent s'effraie de voir ressurgir le droit coutumier (le Kanun) alors qu'il s'efforçait d'adoucir les moeurs, les habitants remettent en cause les mariages lointains et le mélange avec d'autres clans.
De son côté, Stres recoupe les différents récits qu'on lui fait des évènements et tente de tirer ses propres conclusions, tout en faisant abstraction de son attirance passée pour la belle Doruntine. S'immergeant toujours plus dans l'enquête, Stres voit les liens qui le rattachent à la raison devenir de plus en plus ténus...
Sous couvert d'une enquête policière et d'un huis-clos albanais, Ismaël Kadaré dresse le portrait d'une société repliée sur elle-même et de ses croyances et traditions. Qui a ramené Doruntine est une formidable mise en abîme qui réunit moeurs, psychologie, histoire médiévale, conflit religieux et questionnement politique, et qui permet au lecteur de s'imprégner d'un pays que l'on connaît finalement bien peu.
Mon seul regret est de n'avoir pas pu cerner la critique de la société totalitaire de l'auteur, dont l'oeuvre a été interdite de publication en Albanie. Une très belle découverte néanmoins !
Chronique d'une mort annoncée... Oh, je ne dévoile rien... Tout est dit dans la première page. Dans les montagnes albanaises, sur ce que Kadare nomme le Plateau, le temps est figé. Les montagnards ne vivent pas au XXè siècle (l'auteur situe son histoire au début du siècle) mais au Moyen-Âge. Tout est figé par le Kanun... code de lois qui régit la vendetta, qui réglemente le fait de prendre le sang dû en tuant un membre d'une famille qui a offensé la sienne.
Et ainsi de suite, car la vendetta ne s'arrête jamais. Ou plutôt si, elle peut s'arrêter si on paie au lieu de tuer. Mais l'honneur se lave dans le sang, pas dans l'argent. On peut se donner toutes les justifications possibles, nous glisse à l'oreille l'auteur... comme pendre une chemise ensanglantée et mesurer le temps qui passe en regardant les taches de sang changer de couleur... en fustigeant le fils chargé de prendre le sang de la famille adverse... le sang se monnaie.
Kadare nous livre un drame en 3 actes (et 7 tableaux/chapitres). D'abord la dette de sang est effacée par Gjorg, qui devient à son tour la cible de la famille opposée. Il va entamer un voyage pour réclamer un sursis de 30 jours. Acte deux, Bessian, un écrivain de la ville, arrive avec sa femme en voyage de noces sur le Plateau. A travers ce regard exalté que pose Bessian sur les traditions et la vie sur le Plateau, on a une approche étrange de la vendetta. Si les montagnards semblent parfois vivre cela comme une fatalité, comme une malédiction, Bessian glorifie et porte aux nues cette vengeance coulée dans le Kanun... Acte 3, la femme de Bessian tombe amoureuse de Gjorg. Et vice versa. Gjorg, plutôt que d'essayer de se cacher, va tout faire pour la retrouver, pendant que celle-ci se morfond et sombre dans la mélancolie.
On dirait un drame shakespearien.
On atteint le summum de l'absurde en traversant le village où plusieurs familles sont en conflit, paralysant toute activité jusqu'à ce que le village finisse par disparaître. On en rirait presque si ce n'était pas aussi dramatique. On sombre dans le cynisme quand le préposé chargé de collecter les dettes de sang se compare à ses collègues qui prélèvent les taxes sur le foncier ou la récolte de maïs...
Gjorg et Bessian sont deux facettes de la même réalité. Et à travers la femme de Bessian, Kadare montre que si les femmes sont exclues de la vendetta (pas de sang dû pour une femme), elles en subissent les conséquences. A ces protagonistes viennent se greffer d'autres: le Plateau est une entité quasi vivante, le temps qui passe est crucial, un juge du Kanun et ses deux acolytes, le prince qui perçoit le prix du sang...
Tous ces personnages ont intérêt à perpétuer la tradition. Kadare dénonce violemment ce système où iln'y a point d'honneur, mais seulement un souci mercantile.
C'est écrit avec lenteur, et un certain sens du drame. C'est sombre et on ne peut nourrir aucun optimisme, dès la première page. On se sent atteint par le mal ambiant, par cette chappe de plomb qu'impose le Kanun sur les actes et les gens. Si le thème me parle, le style est très éloigné de mes goûts. C'est mon deuxième livre de Kadare, et il me convainc davantage que La Pyramide. La dénonciation des totalitarismes, des diktats par Kadare me semble cependant assez simpliste, et univoque. C'est finalement fort dichotomique.
Et ainsi de suite, car la vendetta ne s'arrête jamais. Ou plutôt si, elle peut s'arrêter si on paie au lieu de tuer. Mais l'honneur se lave dans le sang, pas dans l'argent. On peut se donner toutes les justifications possibles, nous glisse à l'oreille l'auteur... comme pendre une chemise ensanglantée et mesurer le temps qui passe en regardant les taches de sang changer de couleur... en fustigeant le fils chargé de prendre le sang de la famille adverse... le sang se monnaie.
Kadare nous livre un drame en 3 actes (et 7 tableaux/chapitres). D'abord la dette de sang est effacée par Gjorg, qui devient à son tour la cible de la famille opposée. Il va entamer un voyage pour réclamer un sursis de 30 jours. Acte deux, Bessian, un écrivain de la ville, arrive avec sa femme en voyage de noces sur le Plateau. A travers ce regard exalté que pose Bessian sur les traditions et la vie sur le Plateau, on a une approche étrange de la vendetta. Si les montagnards semblent parfois vivre cela comme une fatalité, comme une malédiction, Bessian glorifie et porte aux nues cette vengeance coulée dans le Kanun... Acte 3, la femme de Bessian tombe amoureuse de Gjorg. Et vice versa. Gjorg, plutôt que d'essayer de se cacher, va tout faire pour la retrouver, pendant que celle-ci se morfond et sombre dans la mélancolie.
On dirait un drame shakespearien.
On atteint le summum de l'absurde en traversant le village où plusieurs familles sont en conflit, paralysant toute activité jusqu'à ce que le village finisse par disparaître. On en rirait presque si ce n'était pas aussi dramatique. On sombre dans le cynisme quand le préposé chargé de collecter les dettes de sang se compare à ses collègues qui prélèvent les taxes sur le foncier ou la récolte de maïs...
Gjorg et Bessian sont deux facettes de la même réalité. Et à travers la femme de Bessian, Kadare montre que si les femmes sont exclues de la vendetta (pas de sang dû pour une femme), elles en subissent les conséquences. A ces protagonistes viennent se greffer d'autres: le Plateau est une entité quasi vivante, le temps qui passe est crucial, un juge du Kanun et ses deux acolytes, le prince qui perçoit le prix du sang...
Tous ces personnages ont intérêt à perpétuer la tradition. Kadare dénonce violemment ce système où iln'y a point d'honneur, mais seulement un souci mercantile.
C'est écrit avec lenteur, et un certain sens du drame. C'est sombre et on ne peut nourrir aucun optimisme, dès la première page. On se sent atteint par le mal ambiant, par cette chappe de plomb qu'impose le Kanun sur les actes et les gens. Si le thème me parle, le style est très éloigné de mes goûts. C'est mon deuxième livre de Kadare, et il me convainc davantage que La Pyramide. La dénonciation des totalitarismes, des diktats par Kadare me semble cependant assez simpliste, et univoque. C'est finalement fort dichotomique.
"Qui a ramené Doruntine" d'Ismael Kadaré ?
Voilà la question que tous se posent dans une ville albanaise. Sa mère l'a trouvée devant sa porte un soir après que quelques coups y aient été frappés. Elle a crut voir une ombre s'enfuir et a fait entrer sa fille.
Cette dernière est mariée avec un homme d'un autre pays, lointain. Quand elle est partie avec son mari, Constantin son frère a promis de la ramener sitôt qu'elle le souhaitera. Mais Constantin comme ses neuf frères est mort.
A la question mais qui donc t'as ramenée ? c'est Constantin répond Doruntine.
Et c'est parti pour les bruits les plus fous, certains iront jusqu'à évoquer la résurrection de Constantin.
Stres officier de police est sommé de tirer cette affaire au clair par les autorités politiques et religieuses. On ne peut pas laisser de telles idées se développer dans le pays !
Quelle sera la conclusion ? Je vous laisse lire le livre.
J'ai aimé cette histoire. Derrière ce qui semble une anecdote, une histoire de superstition un peu ridicule dans un pays à l'époque médiévale, se trouve l'idée de la constitution d'une nation. On comprendra que des comportements culturels peuvent caractériser une peuple, le souder, lui donner sa force.
J'ai aussi aimé l'histoire telle qu'elle est racontée. J'ai trouvé que le style et les descriptions traduisent parfaitement l'atmosphère d'une époque, la saison le pays sous la neige.
J'ai découvert Kadaré par "Le général de l'armée morte", j'ai adoré l"Le palais des rêves". Après cette lecture je continue à aimer Kadaré.
Voilà la question que tous se posent dans une ville albanaise. Sa mère l'a trouvée devant sa porte un soir après que quelques coups y aient été frappés. Elle a crut voir une ombre s'enfuir et a fait entrer sa fille.
Cette dernière est mariée avec un homme d'un autre pays, lointain. Quand elle est partie avec son mari, Constantin son frère a promis de la ramener sitôt qu'elle le souhaitera. Mais Constantin comme ses neuf frères est mort.
A la question mais qui donc t'as ramenée ? c'est Constantin répond Doruntine.
Et c'est parti pour les bruits les plus fous, certains iront jusqu'à évoquer la résurrection de Constantin.
Stres officier de police est sommé de tirer cette affaire au clair par les autorités politiques et religieuses. On ne peut pas laisser de telles idées se développer dans le pays !
Quelle sera la conclusion ? Je vous laisse lire le livre.
J'ai aimé cette histoire. Derrière ce qui semble une anecdote, une histoire de superstition un peu ridicule dans un pays à l'époque médiévale, se trouve l'idée de la constitution d'une nation. On comprendra que des comportements culturels peuvent caractériser une peuple, le souder, lui donner sa force.
J'ai aussi aimé l'histoire telle qu'elle est racontée. J'ai trouvé que le style et les descriptions traduisent parfaitement l'atmosphère d'une époque, la saison le pays sous la neige.
J'ai découvert Kadaré par "Le général de l'armée morte", j'ai adoré l"Le palais des rêves". Après cette lecture je continue à aimer Kadaré.
2 histoires se cotoient pour ne se rencontrer qu'au moment du drame final, annoncé dès le début du roman. La première est celle de Gjorg, la victime de l'histoire, humble jeune homme d'un plateau albanais. La deuxième est celle de Bessian et Diane, jeunes mariés citadins venus en voyage de noces sur le plateau. Gjorg, est en sursis jusqu'au 17 avril, car il est un maillon de la chaîne de la bessa, vendetta coutumière sur un plateau albanais. On vit la vendetta de l'intérieur, avec ses règles à la fois strictes et absurdes, que tout le monde a néanmoins à coeur d'appliquer pour éviter le déshonneur. On en vient à comprendre que les juges eux-même, qui vont de village en village pour trancher les cas litigieux de ce droit coutumier complexe et pointilleux (le Kanun), ont eux-mêmes conscience qu'il s'agit d'une comédie absurde. On comprend également que le seigneur local entretient cette coutume par intérêt matériel, de même que les humbles, premières victimes, initient ou perpétuent la vendetta, plus pour des raisons matérielles (limites entre les propriétés par exemple) que pour des raisons d'honneur. Le couple de jeunes mariés, quant à lui, va passer d'une vision intellectuelle, idéalisée et aseptisée du monde du plateau, à une vision désabusée et sordide des meutres et du cadre de vie. Kadaré, comme toujours, arrive à se situer à la frontière du réel et du mythe et arrive à rendre très présents les paysages fantasmagoriques.
Livre écrit par Ismaïl Kadaré, faisant référence au temps où l’Albanie était soumise à la dictature d’Enver Hoxha, c’est un pamphlet politique présenté sous forme de fable ou de conte moral. Prenant l’image de la construction d’une pyramide dans l’Egypte antique, l’auteur explique qu’un bon moyen pour asservir un peuple et lui ôter toute idée de révolte, c’est de l’occuper à un travail qui ne sert à rien, mais mobilise toutes les ressources du pays. C’est ce qui arriva en Albanie, où furent construits des milliers de bunkers dans tout le pays, pour se protéger d’un agresseur qui n’existait pas.
Le style est très alerte et imagé, l’allusion politique transparente. D’une manière plus générale, c’est une analyse très précise de certains mécanismes de la dictature, avec par exemple les méthodes fondées sur la délation et la peur. La leçon est toujours valable dans notre monde actuel.
Le style est très alerte et imagé, l’allusion politique transparente. D’une manière plus générale, c’est une analyse très précise de certains mécanismes de la dictature, avec par exemple les méthodes fondées sur la délation et la peur. La leçon est toujours valable dans notre monde actuel.
Nous sommes en 1443. L’immense armée ottomanes assiège la citadelle albanaise de Kruja (Krujë) qui résiste envers et contre tout dans une guerre sans merci. Les Turcs attendent la reddition des Albanais assoiffés. Les tambours de leur armée donnent le signal des attaques. Donneront-ils le signal de la pluie libératrice? Ce roman relate l’épopée de Scanderbeg, héros national albanais dont le surnom est une déformation d’Alexander Bey (Alexandre le Grand), de son vrai nom, Georges Kastriote. En Albanie, vous trouverez ses statues et plein d’objets au nom de Scanderbeg (vin, biscuits,...). Enfant, il fut enlevé par les Turcs, élevé à la cour du sultan, puis devint général dans l’armée ottomane avant de se retourner et de prendre la défense de son peuple. Le château de Skanderbeg à Krujë est maintenant un musée Le roman alterne des chapitres vus par les Turcs, mettant en scène de multiples personnages qui se chamaillent, et de plus brefs chapitres en italiques, écrits par un chroniqueur albanais où aucune individualité n’est citée et mise en avant pour montrer l’unité du peuple. Avant chaque bataille, le Pacha réunit son conseil: architecte des machines, intendant chargé de nourrir cette colossale armée, spécialiste des poisons, astrologue chargé d’annoncer les jours favorables, chef des fondeurs de canons, chroniqueur, officiers... Ils ne sont jamais d’accord et plusieurs seront rétrogradés après l’échec de ce qu’ils proposent successivement. Les assaillants des murailles reçoivent des brulots incendiaires. On creuse un souterrain, on tente de saboter l’aqueduc, d’introduire la peste,... Les Albanais, nombreux mais unis et plus ingénieux, déjouent chaque plan et les pertes sont énormes parmi les guertekindjis, dalklitchs, janissaires, serdengestlers, musélems, asapes, sandjakbeys, tchaouckes, djébelous et autres militaires ottomans.
Avant de partir, le pacha se demande s’il doit amener quelques-unes de ses 18 femmes, vu que les Albanaises sont de grande beauté. Finalement, il en prend quatre et laissera les Albanaises à ses officiers.
Les canons les plus puissants jamais fabriquées, «ces armes nouvelles, changeront la nature de la guerre, (et) rendront les citadelles inutiles».
«Calme plat. Apparemment, ils s’apprêtent à donner l’assaut. On les voit préparer des cordes, des échelles et d’autres appareils»... La première bataille (chapitre IV) est véritablement cinématographique avec l’assaut des murailles, la riposte des archers, les échelles incendiées,... Du grand art. Les Ottomans espèrent encore.
«La nuit où on prendra la citadelle. Quel sabbat ! Quelles orgies ! Leur désir assouvi, les hommes échangeons leurs captives. Ils les garderont une heure, puis les revendront pour en racheter d’autres. Elles passeront de tentes en tentes... Nous dépouillerons leurs femmes et leurs jeunes filles de leurs vêtements impudiques pour les revêtir de la noble mante noire, bénie par la religion. Nous leur ferons courber leurs têtes indociles... comme le prescrit le saint Coran... Les prix, qui n’étaient jamais fixés, variaient d’heure en heure. Ils dépendaient généralement du nombre de femmes capturées... Les blondes étaient généralement plus appréciées et parfois, leur prix montait si haut que seuls les officiers supérieurs... pouvaient s’offrir le luxe de les acquérir... Les prix, élevés au retour de l’expédition, baissaient parfois brusquement le lendemain... ils étaient prêts à s’en débarrasser à moitié prix». Des acheteurs les achetaient en grand nombre le matin, sachant que les prix remonteraient le soir».
«Le deuxième canon manqua par trois fois sa cible... La pièce doit être possédée du démon, dit le mufti... Allah nous a choisi cette mort, il nous faut l’accepter».
«Le 26 juillet, nous décidâmes de faire effondrer la galerie».
Le chapitre VIII relate les conversations des femmes. Exemple: «S’il est victorieux, il sera promu... s’achètera de nouvelles femmes, et nous aurons de nouvelles compagnes. Ah, comme ce sera amusant s’écria Edjère. S’il est vaincu, il nous vendra, et qui sait quel sera notre destin, peut-être meilleur, peut-être pire».
«Ils (creusent) là où aurait dû se trouver le canal... Notre ancien aqueduc passait autrefois là... et ils nous auraient depuis longtemps coupé l’eau si, prévoyant ce long siège, nous n’avions ouvert un nouveau canal qui suit... un chemin imprévisible... Ce qu’ils n’ont pas réussi à obtenir par les canons et la galerie, ils espèrent maintenant l’atteindre par la soif». L’aqueduc sera percé, mais il reste trois puits dans la citadelle.
Pendant ce temps, Scanderbeg se cache dans la plaine, attaque les Turcs de nuit, par surprise, et détruit les caravanes qui assurent leur ravitaillement.
L’allabey demanda à Siri Selim combien de jours il faudrait attendre, après le lancement des rats infectés par la peste pour que la première maladie se déclarât, mais les Albanais installent des pièges à rats.
«Les assauts auront lieu chaque jour, ou presque, sans tenir compte des pertes ni des obstacles» car la saison des pluies approche, et la citadelle aura de nouveau assez d’eau. Bientôt, les tambours annoncent la pluie.
«Nous avons cru leur donner la mort, alors que de nos propres mains, nous les rendions immortels».
«Et maintenant, qui nous achètera ? - dit Leïla».
L’Albanie a souvent été dominée, et longtemps par l’Empire Ottoman. Beaucoup de romans de Kadaré exaltent le courage des Albanais contre ceux qui veulent les asservir, et en filigrane, derrière celui-ci (de 1970, 10 ans après la rupture du pays avec l’URSS), comme dans d’autres, on trouve aussi une subtile dénonciation de l’asservissement au grand frère soviétique.
J’ai eu la chance de prendre le thé avec Kadaré et sa femme à Durrës, en 1987, un homme charmant parlant très bien français. Écarté de la nomenklatura communiste, il finit par être qualifié d'«ennemi» lors du Plénum des écrivains en 1882 mais, trop apprécié, ne subit aucune sanction. En disgrâce pour sa subtile critique du régime, il obtient l’asile politique en France en 1990 et est fait commandeur de la légion d’honneur. Comme Kundera et d’autres, il fut souvent cité pour le Nobel sans l’obtenir.
Avant de partir, le pacha se demande s’il doit amener quelques-unes de ses 18 femmes, vu que les Albanaises sont de grande beauté. Finalement, il en prend quatre et laissera les Albanaises à ses officiers.
Les canons les plus puissants jamais fabriquées, «ces armes nouvelles, changeront la nature de la guerre, (et) rendront les citadelles inutiles».
«Calme plat. Apparemment, ils s’apprêtent à donner l’assaut. On les voit préparer des cordes, des échelles et d’autres appareils»... La première bataille (chapitre IV) est véritablement cinématographique avec l’assaut des murailles, la riposte des archers, les échelles incendiées,... Du grand art. Les Ottomans espèrent encore.
«La nuit où on prendra la citadelle. Quel sabbat ! Quelles orgies ! Leur désir assouvi, les hommes échangeons leurs captives. Ils les garderont une heure, puis les revendront pour en racheter d’autres. Elles passeront de tentes en tentes... Nous dépouillerons leurs femmes et leurs jeunes filles de leurs vêtements impudiques pour les revêtir de la noble mante noire, bénie par la religion. Nous leur ferons courber leurs têtes indociles... comme le prescrit le saint Coran... Les prix, qui n’étaient jamais fixés, variaient d’heure en heure. Ils dépendaient généralement du nombre de femmes capturées... Les blondes étaient généralement plus appréciées et parfois, leur prix montait si haut que seuls les officiers supérieurs... pouvaient s’offrir le luxe de les acquérir... Les prix, élevés au retour de l’expédition, baissaient parfois brusquement le lendemain... ils étaient prêts à s’en débarrasser à moitié prix». Des acheteurs les achetaient en grand nombre le matin, sachant que les prix remonteraient le soir».
«Le deuxième canon manqua par trois fois sa cible... La pièce doit être possédée du démon, dit le mufti... Allah nous a choisi cette mort, il nous faut l’accepter».
«Le 26 juillet, nous décidâmes de faire effondrer la galerie».
Le chapitre VIII relate les conversations des femmes. Exemple: «S’il est victorieux, il sera promu... s’achètera de nouvelles femmes, et nous aurons de nouvelles compagnes. Ah, comme ce sera amusant s’écria Edjère. S’il est vaincu, il nous vendra, et qui sait quel sera notre destin, peut-être meilleur, peut-être pire».
«Ils (creusent) là où aurait dû se trouver le canal... Notre ancien aqueduc passait autrefois là... et ils nous auraient depuis longtemps coupé l’eau si, prévoyant ce long siège, nous n’avions ouvert un nouveau canal qui suit... un chemin imprévisible... Ce qu’ils n’ont pas réussi à obtenir par les canons et la galerie, ils espèrent maintenant l’atteindre par la soif». L’aqueduc sera percé, mais il reste trois puits dans la citadelle.
Pendant ce temps, Scanderbeg se cache dans la plaine, attaque les Turcs de nuit, par surprise, et détruit les caravanes qui assurent leur ravitaillement.
L’allabey demanda à Siri Selim combien de jours il faudrait attendre, après le lancement des rats infectés par la peste pour que la première maladie se déclarât, mais les Albanais installent des pièges à rats.
«Les assauts auront lieu chaque jour, ou presque, sans tenir compte des pertes ni des obstacles» car la saison des pluies approche, et la citadelle aura de nouveau assez d’eau. Bientôt, les tambours annoncent la pluie.
«Nous avons cru leur donner la mort, alors que de nos propres mains, nous les rendions immortels».
«Et maintenant, qui nous achètera ? - dit Leïla».
L’Albanie a souvent été dominée, et longtemps par l’Empire Ottoman. Beaucoup de romans de Kadaré exaltent le courage des Albanais contre ceux qui veulent les asservir, et en filigrane, derrière celui-ci (de 1970, 10 ans après la rupture du pays avec l’URSS), comme dans d’autres, on trouve aussi une subtile dénonciation de l’asservissement au grand frère soviétique.
J’ai eu la chance de prendre le thé avec Kadaré et sa femme à Durrës, en 1987, un homme charmant parlant très bien français. Écarté de la nomenklatura communiste, il finit par être qualifié d'«ennemi» lors du Plénum des écrivains en 1882 mais, trop apprécié, ne subit aucune sanction. En disgrâce pour sa subtile critique du régime, il obtient l’asile politique en France en 1990 et est fait commandeur de la légion d’honneur. Comme Kundera et d’autres, il fut souvent cité pour le Nobel sans l’obtenir.
Kështjella
Traduction : Jusuf Vrioni
ISBN : 9782070371426
Deux extraits de ce roman sont donnés sur Babélio
Une liste des personnages de ce livre sera bientôt disponible sur http://notabene.forumactif.com/
Qu'on apprécie ou pas l'homme qui se cache derrière les lunettes d'Ismail Kadare, on ne saurait nier à l'écrivain qui co-habite avec lui un grand, un très grand talent. Ces "Tambours de la Pluie", parus dans leur langue originelle sous le titre peut-être plus révélateur, de "La Citadelle", en constituent une preuve nouvelle et éclatante.
Notons cependant que, pour une fois, le titre français est pratiquement aussi évocateur que l'original puisque la pluie et les roulements de tambour qui, dans les camp ottoman, annoncent sa venue, tiennent ici, et de façon assez paradoxale car on ne les entend à vrai dire que deux fois, le tout premier rôle, bien avant, pourrait-on dire, les troupes en présence, celles, énormes, de la Sublime Porte opposées à celles, forcément réduites mais terriblement pugnaces, de la pugnacité du désespoir, des Albanais retranchés dans la citadelle qu'ils défendent.
De la pluie, de son absence ou de sa présence, dépend l'issue du siège. Tout le monde le sait, aussi bien les assiégés dont le porte-parole s'exprime dans de brefs chapitres en italiques que les assiégeants, auxquels reviennent les chapitres plus longs en caractères normaux. Longueur bien explicable puisque l'Empire ottoman, dans sa longue marche décidée vers l'Europe - rappelons que, deux siècles après les événements relatés par Kadare, les Turcs seront aux portes de Vienne d'où parviendra heureusement à les chasser le roi de Pologne Jean III Sobieski - n'a cessé de jeter dans la bataille un maximum de troupes. Si "Les Tambours de la Pluie" se termine par leur défaite et même par le suicide de leur chef, Tursun Pacha, qui n'a pourtant failli ni en courage, ni en talent de stratège mais préfère mourir de sa propre main plutôt que de celle des sbires d'un sultan qui envoie en fait ceux dont il veut se débarrasser combattre les redoutables et fiers Albanais, les Turcs, un jour, finiront par conquérir la fameuse citadelle et quelques autres et à soumettre, on le sait, l'Albanie tout entière.
Pas plus qu'elle ne le fera au XXème siècle en faveur de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne dépecées par Hitler, l'Europe ne viendra pas en aide à l'Albanie du XVème siècle. Qu'ils se débrouillent avec les mahométans, ces lointains Albanais qui ne sont d'ailleurs que des chrétiens orthodoxes et ne s'agenouillent pas devant Rome ! Leur pays n'est pas franchement la porte à côté et avant que les Turcs arrivent à Vienne, bien de l'eau aura coulé sous les ponts ... Si encore ils y arrivent un jour ! ...
Le Temps tourne et file mais les mentalités politiques, on peut le constater, demeurent. Comment, dans de telles conditions, s'étonner des perpétuels recommencements auxquels semble vouée l'Histoire ?
Fort heureusement, la résistance nationale fait aussi partie de ces éternels retours historiques. Le récit de Kadare rend hommage au premier héros national albanais, Gjergj (ou Georges) Kastriot, mieux connu sous le surnom que lui donnèrent ses ennemis les Turcs : Iskander Bey [= prince Alexandre, par référence à Alexandre le Grand], devenu, par allitérations successives, Skënderbeu en albanais et Skanderbeg en allemand et en français.
Skanderbeg rôde dans les pages des "Tambours de la Pluie" mais on ne le voit jamais. Ses attaques-éclair se font en général de nuit et sont la terreur des Ottomans. Ceux-ci n'ignorent pas son courage car ce prince albanais fut jadis pris comme otage à la cour du Sultan et grandit pour devenir un janissaire, en d'autres termes l'un des membres d'un véritable corps d'élite de l'armée musulmane. Il a si bien combattu pour Murad II que celui-ci l'a fait gouverneur général de certaines provinces albanaises. Mais après la mort de ses frères, empoisonnés dans des circonstances mystérieuses, le dernier des Kastriot se laisse submerger par la révolte et, rejetant l'islam qu'on lui a imposé, redevient chrétien et prend la tête de la rébellion contre la Sublime Porte. De succès en succès, invisible mais terriblement présent, Skanderbeg entre vivant dans la légende albanaise : il n'en sortira plus jamais et aujourd'hui encore, son nom continue à être vénéré dans son pays natal comme celui du premier libérateur de l'Albanie.
N'allez pas croire pour autant que Kadare nous donne ici un roman revanchard ou d'un claironnant chauvinisme. Bien au contraire : son coup de génie est de nous présenter tous les protagonistes, Turcs et Albanais, du plus humble fantassin au pacha en personne, sous leur aspect avant tout humain. Ils sont capables de fanfaronner, de pavoiser, de triompher mais aussi de souffrir, de réfléchir à la condition de l'Autre au-delà de la leur et de s'interroger enfin, pour les plus intelligents, sur la vanité de toute chose en ce monde. Les seules exceptions - ce qui n'étonnera personne - appartiennent à la race des politiques et des religieux. Kadare voue d'ailleurs à ces derniers une haine bien particulière et dépeint leur fanatisme inexorable, intemporel comme une force aveugle et infiniment malveillante, susceptible de jeter n'importe quelle troupe dans le plus sanglant et le plus sot des massacres pour la seule gloire supposée de Dieu.
Cette haine s'explique en partie par le fait que les Turcs ne se contentèrent pas de chercher à islamiser l'Albanie. Ils firent bien pire : ils cherchèrent, en l'interdisant, à éradiquer la langue du pays. Non tant par mépris de l'albanais et par vénération de leur propre dialecte mais parce que l'albanais était, avec le latin, la langue du clergé local, évidemment chrétien. Cette tentative d'assassinat linguistique est probablement la plus grave erreur commise par la Sublime Porte dans son traitement des terres et des populations albanaises.
N'oublions pas de mentionner les quelques femmes de ce livre : on ne voit pour ainsi dire pas les Albanaises assiégées, sauf lorsqu'elles viennent sur les remparts de la citadelle assister au spectacle du cheval assoiffé que les Turcs font tourner et tourner dans l'espoir qu'il parviendra à dénicher les canalisations cachées qui alimentent en au la forteresse ; les concubines que le pacha a emmenées avec lui sont au pire des objets, au mieux des ventres ; quant aux malheureuses prisonnières ramenées d'une razzia par les soldats turcs, elles ne survivront pas aux viols multiples qu'elles auront à subir. Pour toutes, le lecteur tire le triste constat d'un machisme certes omniprésent chez les Ottomans mais qui semble presque aussi naturel chez les Albanais.
En résumé - si la graphomane que je suis peut se permettre l'expression - "Les Tambours de la Pluie" est un roman ample, puissant, d'une puissance qui repose sur une technique d'une simplicité absolue. L'auteur se veut d'une impartialité totale, sauf quand il désigne du doigt les véritables responsables du siège : la classe politique et religieuse. Il n'y a pas vraiment de "méchants" et de "bons" dans ce roman, rien que des hommes, avec leurs grandeurs et leurs faiblesses, qui s'affrontent pour une certaine idée qu'ils se font de leur nation. Fatalement, cette idée diverge selon la partie prise en compte et pourtant, tous souffrent et s'interrogent, sous la chaleur éclatante de cet été qui semble ne jamais vouloir prendre fin. Et puis, c'est l'éclatement, les tambours de la pluie se mettent à résonner et l'espoir change de camp - enfin, jusqu'à l'été prochain ... ;o)
Traduction : Jusuf Vrioni
ISBN : 9782070371426
Deux extraits de ce roman sont donnés sur Babélio
Une liste des personnages de ce livre sera bientôt disponible sur http://notabene.forumactif.com/
Qu'on apprécie ou pas l'homme qui se cache derrière les lunettes d'Ismail Kadare, on ne saurait nier à l'écrivain qui co-habite avec lui un grand, un très grand talent. Ces "Tambours de la Pluie", parus dans leur langue originelle sous le titre peut-être plus révélateur, de "La Citadelle", en constituent une preuve nouvelle et éclatante.
Notons cependant que, pour une fois, le titre français est pratiquement aussi évocateur que l'original puisque la pluie et les roulements de tambour qui, dans les camp ottoman, annoncent sa venue, tiennent ici, et de façon assez paradoxale car on ne les entend à vrai dire que deux fois, le tout premier rôle, bien avant, pourrait-on dire, les troupes en présence, celles, énormes, de la Sublime Porte opposées à celles, forcément réduites mais terriblement pugnaces, de la pugnacité du désespoir, des Albanais retranchés dans la citadelle qu'ils défendent.
De la pluie, de son absence ou de sa présence, dépend l'issue du siège. Tout le monde le sait, aussi bien les assiégés dont le porte-parole s'exprime dans de brefs chapitres en italiques que les assiégeants, auxquels reviennent les chapitres plus longs en caractères normaux. Longueur bien explicable puisque l'Empire ottoman, dans sa longue marche décidée vers l'Europe - rappelons que, deux siècles après les événements relatés par Kadare, les Turcs seront aux portes de Vienne d'où parviendra heureusement à les chasser le roi de Pologne Jean III Sobieski - n'a cessé de jeter dans la bataille un maximum de troupes. Si "Les Tambours de la Pluie" se termine par leur défaite et même par le suicide de leur chef, Tursun Pacha, qui n'a pourtant failli ni en courage, ni en talent de stratège mais préfère mourir de sa propre main plutôt que de celle des sbires d'un sultan qui envoie en fait ceux dont il veut se débarrasser combattre les redoutables et fiers Albanais, les Turcs, un jour, finiront par conquérir la fameuse citadelle et quelques autres et à soumettre, on le sait, l'Albanie tout entière.
Pas plus qu'elle ne le fera au XXème siècle en faveur de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne dépecées par Hitler, l'Europe ne viendra pas en aide à l'Albanie du XVème siècle. Qu'ils se débrouillent avec les mahométans, ces lointains Albanais qui ne sont d'ailleurs que des chrétiens orthodoxes et ne s'agenouillent pas devant Rome ! Leur pays n'est pas franchement la porte à côté et avant que les Turcs arrivent à Vienne, bien de l'eau aura coulé sous les ponts ... Si encore ils y arrivent un jour ! ...
Le Temps tourne et file mais les mentalités politiques, on peut le constater, demeurent. Comment, dans de telles conditions, s'étonner des perpétuels recommencements auxquels semble vouée l'Histoire ?
Fort heureusement, la résistance nationale fait aussi partie de ces éternels retours historiques. Le récit de Kadare rend hommage au premier héros national albanais, Gjergj (ou Georges) Kastriot, mieux connu sous le surnom que lui donnèrent ses ennemis les Turcs : Iskander Bey [= prince Alexandre, par référence à Alexandre le Grand], devenu, par allitérations successives, Skënderbeu en albanais et Skanderbeg en allemand et en français.
Skanderbeg rôde dans les pages des "Tambours de la Pluie" mais on ne le voit jamais. Ses attaques-éclair se font en général de nuit et sont la terreur des Ottomans. Ceux-ci n'ignorent pas son courage car ce prince albanais fut jadis pris comme otage à la cour du Sultan et grandit pour devenir un janissaire, en d'autres termes l'un des membres d'un véritable corps d'élite de l'armée musulmane. Il a si bien combattu pour Murad II que celui-ci l'a fait gouverneur général de certaines provinces albanaises. Mais après la mort de ses frères, empoisonnés dans des circonstances mystérieuses, le dernier des Kastriot se laisse submerger par la révolte et, rejetant l'islam qu'on lui a imposé, redevient chrétien et prend la tête de la rébellion contre la Sublime Porte. De succès en succès, invisible mais terriblement présent, Skanderbeg entre vivant dans la légende albanaise : il n'en sortira plus jamais et aujourd'hui encore, son nom continue à être vénéré dans son pays natal comme celui du premier libérateur de l'Albanie.
N'allez pas croire pour autant que Kadare nous donne ici un roman revanchard ou d'un claironnant chauvinisme. Bien au contraire : son coup de génie est de nous présenter tous les protagonistes, Turcs et Albanais, du plus humble fantassin au pacha en personne, sous leur aspect avant tout humain. Ils sont capables de fanfaronner, de pavoiser, de triompher mais aussi de souffrir, de réfléchir à la condition de l'Autre au-delà de la leur et de s'interroger enfin, pour les plus intelligents, sur la vanité de toute chose en ce monde. Les seules exceptions - ce qui n'étonnera personne - appartiennent à la race des politiques et des religieux. Kadare voue d'ailleurs à ces derniers une haine bien particulière et dépeint leur fanatisme inexorable, intemporel comme une force aveugle et infiniment malveillante, susceptible de jeter n'importe quelle troupe dans le plus sanglant et le plus sot des massacres pour la seule gloire supposée de Dieu.
Cette haine s'explique en partie par le fait que les Turcs ne se contentèrent pas de chercher à islamiser l'Albanie. Ils firent bien pire : ils cherchèrent, en l'interdisant, à éradiquer la langue du pays. Non tant par mépris de l'albanais et par vénération de leur propre dialecte mais parce que l'albanais était, avec le latin, la langue du clergé local, évidemment chrétien. Cette tentative d'assassinat linguistique est probablement la plus grave erreur commise par la Sublime Porte dans son traitement des terres et des populations albanaises.
N'oublions pas de mentionner les quelques femmes de ce livre : on ne voit pour ainsi dire pas les Albanaises assiégées, sauf lorsqu'elles viennent sur les remparts de la citadelle assister au spectacle du cheval assoiffé que les Turcs font tourner et tourner dans l'espoir qu'il parviendra à dénicher les canalisations cachées qui alimentent en au la forteresse ; les concubines que le pacha a emmenées avec lui sont au pire des objets, au mieux des ventres ; quant aux malheureuses prisonnières ramenées d'une razzia par les soldats turcs, elles ne survivront pas aux viols multiples qu'elles auront à subir. Pour toutes, le lecteur tire le triste constat d'un machisme certes omniprésent chez les Ottomans mais qui semble presque aussi naturel chez les Albanais.
En résumé - si la graphomane que je suis peut se permettre l'expression - "Les Tambours de la Pluie" est un roman ample, puissant, d'une puissance qui repose sur une technique d'une simplicité absolue. L'auteur se veut d'une impartialité totale, sauf quand il désigne du doigt les véritables responsables du siège : la classe politique et religieuse. Il n'y a pas vraiment de "méchants" et de "bons" dans ce roman, rien que des hommes, avec leurs grandeurs et leurs faiblesses, qui s'affrontent pour une certaine idée qu'ils se font de leur nation. Fatalement, cette idée diverge selon la partie prise en compte et pourtant, tous souffrent et s'interrogent, sous la chaleur éclatante de cet été qui semble ne jamais vouloir prendre fin. Et puis, c'est l'éclatement, les tambours de la pluie se mettent à résonner et l'espoir change de camp - enfin, jusqu'à l'été prochain ... ;o)
L'ascension d'un jeune homme à travers les méandres bureaucratique d'un palais qui centralise et analyse les rêves de toutes la population pour essayer d'y lire les présages de l'avenir.
On est très proche de Kafka, avec une touche de poésie supplémentaire et quelque chose d'un peu plus oriental puisque l'action se situe dans une albanie ottomane.
A signaler : le gouvernement autoritaire d'Albanie a très mal reagi lors de la parution de ce livre qui dénonce la propension au contrôle des esprits du pouvoir.
On est très proche de Kafka, avec une touche de poésie supplémentaire et quelque chose d'un peu plus oriental puisque l'action se situe dans une albanie ottomane.
A signaler : le gouvernement autoritaire d'Albanie a très mal reagi lors de la parution de ce livre qui dénonce la propension au contrôle des esprits du pouvoir.
Ah ! la littérature étrangère qui relate des modes de vie et des traditions si différents des nôtres : étonnement garanti !
L’histoire commence par une scène de meurtre stupéfiante, où le plus traumatisant pour le meurtrier est le stress de savoir s’il a fait les choses dans les règles ou non, à savoir avertir l’homme qu’il va le tuer, puis une fois mort le mettre sur le dos avec son fusil près de sa tête. Quitte à demander, dans le doute, à des passants inconnus de le faire pour lui, au lieu de se cacher, de fuir. D’entrée, on croit halluciner. Et de fil en aiguille on comprend le contexte, que ce meurtre était une obligation pour celui qui l’a perpétré, une loi inscrite dans le Kanun, ce code de droit coutumier médiéval qui a cours sur les hauts plateaux montagneux du nord de l’Albanie (et des territoires limitrophes) et qui y prime sur les lois nationales. Obligation de reprendre le sang, et de le donner à son tour, c’est à dire de venger sa famille du précédent meurtre commis, et ainsi de suite à tour de rôle entre les 2 familles impliquées, sur des générations et des générations, sous peine de sanctions lourdes. Le Kanun décrit toutes les règles de vie sur le plateau (mariage, famille, travail, propriétés), mais c’est bien cette vendetta inscrite dans le code d’honneur avec ses règles strictes et son impôt qui est le cœur de ce court roman.
Nous avons d’une part Gjorg, qui vient de venger son frère en tuant son meurtrier, qui bénéficie de la bessa (trêve) de 30 jours, ses 30 derniers jours de vie libre, avant de devenir lui-même la prochaine cible de la famille d’en face. C’est bien peu, 30 jours.
Nous avons d’autre part le jeune couple Bessian et Diane Vorpsi, qui vient de la capitale Tirana ; lui est un écrivain connu, spécialiste du Kanun, qui profite de son voyage de noce pour voir « pour de vrai » cette tradition, avec une certaine fascination un peu malsaine, y traînant sa jeune et belle épouse.
Et le hasard veut qu’ils se croisent, et que le bref regard qu’échangent Gjorg et Diane va changer leur vie, précipiter leur destin.
Nous sommes à une époque indéfinie, non clairement nommée, où on roule encore en voiture à cheval, mais où passent déjà des avions dans le ciel. L’ambiance est lourde, plombée. Le même paysage à perte de vue, tout est brumeux et gris, le printemps tarde à venir. Il y a très peu de villages et de passants. Les journées de marche sont interminables. Seuls deux personnages étrangers à cette culture, un médecin et un géomètre, instruits, ex citadins, qui accompagnent partout l’exégète qui tranche les conflits du Kanum, osent émettre en aparté au jeune couple quelques critiques des règles archaïques du Kanun. Qui existait réellement (dans quelle mesure aujourd’hui ?). C’est ce qui en fait une lecture pour le moins édifiante, sidérante, assez dérangeante. Que l’on n’oublie pas.
La 1/2 étoile en moins pour les quelques redondances dans le récit, inutiles.
L’histoire commence par une scène de meurtre stupéfiante, où le plus traumatisant pour le meurtrier est le stress de savoir s’il a fait les choses dans les règles ou non, à savoir avertir l’homme qu’il va le tuer, puis une fois mort le mettre sur le dos avec son fusil près de sa tête. Quitte à demander, dans le doute, à des passants inconnus de le faire pour lui, au lieu de se cacher, de fuir. D’entrée, on croit halluciner. Et de fil en aiguille on comprend le contexte, que ce meurtre était une obligation pour celui qui l’a perpétré, une loi inscrite dans le Kanun, ce code de droit coutumier médiéval qui a cours sur les hauts plateaux montagneux du nord de l’Albanie (et des territoires limitrophes) et qui y prime sur les lois nationales. Obligation de reprendre le sang, et de le donner à son tour, c’est à dire de venger sa famille du précédent meurtre commis, et ainsi de suite à tour de rôle entre les 2 familles impliquées, sur des générations et des générations, sous peine de sanctions lourdes. Le Kanun décrit toutes les règles de vie sur le plateau (mariage, famille, travail, propriétés), mais c’est bien cette vendetta inscrite dans le code d’honneur avec ses règles strictes et son impôt qui est le cœur de ce court roman.
Nous avons d’une part Gjorg, qui vient de venger son frère en tuant son meurtrier, qui bénéficie de la bessa (trêve) de 30 jours, ses 30 derniers jours de vie libre, avant de devenir lui-même la prochaine cible de la famille d’en face. C’est bien peu, 30 jours.
Nous avons d’autre part le jeune couple Bessian et Diane Vorpsi, qui vient de la capitale Tirana ; lui est un écrivain connu, spécialiste du Kanun, qui profite de son voyage de noce pour voir « pour de vrai » cette tradition, avec une certaine fascination un peu malsaine, y traînant sa jeune et belle épouse.
Et le hasard veut qu’ils se croisent, et que le bref regard qu’échangent Gjorg et Diane va changer leur vie, précipiter leur destin.
Nous sommes à une époque indéfinie, non clairement nommée, où on roule encore en voiture à cheval, mais où passent déjà des avions dans le ciel. L’ambiance est lourde, plombée. Le même paysage à perte de vue, tout est brumeux et gris, le printemps tarde à venir. Il y a très peu de villages et de passants. Les journées de marche sont interminables. Seuls deux personnages étrangers à cette culture, un médecin et un géomètre, instruits, ex citadins, qui accompagnent partout l’exégète qui tranche les conflits du Kanum, osent émettre en aparté au jeune couple quelques critiques des règles archaïques du Kanun. Qui existait réellement (dans quelle mesure aujourd’hui ?). C’est ce qui en fait une lecture pour le moins édifiante, sidérante, assez dérangeante. Que l’on n’oublie pas.
La 1/2 étoile en moins pour les quelques redondances dans le récit, inutiles.
S'inspirant de « La balade de Constantin et Doruntine », une légende très populaire en Albanie, Kadaré nous plonge dans un Moyen-Age nocturne et fabuleux.
L'histoire est pour le moins nimbée de mystère : un matin, la mère de Doruntine ouvre sa porte et se retrouve nez à nez avec sa fille, mariée trois ans plus tôt à un étranger qui l'a emportée dans sa lointaine Bohème. C'est elle la première qui pose la fameuse question : qui a ramené Doruntine ? La jeune femme affirme que c'est son frère Konstantin qui a chevauché avec elle sous la lune pour la ramener à sa mère. Mais ce que va révéler la mère à Doruntine va les plonger toutes deux dans une fièvre de stupéfaction : Konstantin, ainsi que les huit autres frères de Doruntine, sont morts à la guerre deux ans plus tôt. Le fantôme de Konstantin est-il revenu pour honorer son serment – sa 𝘣𝘦𝘴𝘢 – de ramener un jour sa sœur à la maison ? Quel est le secret du retour de Doruntine?
J'ai adoré suivre les investigations du capitaine Stres pour dénouer ce mystère, suivre l'alternance des hypothèses, formulées par le rationalisme des uns, le conservatisme des autres ou encore les croyances populaires vivaces de toute une communauté.
Finalement, ce qui constitue la force de l'histoire de Doruntine, c'est sa portée universelle et engagée : Kadaré affirme la puissance des mots, ceux qu'on prononce comme un serment à une sœur qui se marie, qu'on profère comme une malédiction à un fils qui nous a laissée tomber, ceux qu'on se transmet comme un précieux trésor, qui résistent aux pressions politiques ou religieuses. C'est le pouvoir que Kadaré confère à la littérature, un acte de résistance contre toutes les oppressions, qui se dissimule dans les pages incroyablement magnétiques de la légende de Doruntine.
Ce court roman m'a fait entrer par la grande porte dans l’œuvre foisonnante de cet auteur albanais que j'ai déjà hâte de retrouver.
L'histoire est pour le moins nimbée de mystère : un matin, la mère de Doruntine ouvre sa porte et se retrouve nez à nez avec sa fille, mariée trois ans plus tôt à un étranger qui l'a emportée dans sa lointaine Bohème. C'est elle la première qui pose la fameuse question : qui a ramené Doruntine ? La jeune femme affirme que c'est son frère Konstantin qui a chevauché avec elle sous la lune pour la ramener à sa mère. Mais ce que va révéler la mère à Doruntine va les plonger toutes deux dans une fièvre de stupéfaction : Konstantin, ainsi que les huit autres frères de Doruntine, sont morts à la guerre deux ans plus tôt. Le fantôme de Konstantin est-il revenu pour honorer son serment – sa 𝘣𝘦𝘴𝘢 – de ramener un jour sa sœur à la maison ? Quel est le secret du retour de Doruntine?
J'ai adoré suivre les investigations du capitaine Stres pour dénouer ce mystère, suivre l'alternance des hypothèses, formulées par le rationalisme des uns, le conservatisme des autres ou encore les croyances populaires vivaces de toute une communauté.
Finalement, ce qui constitue la force de l'histoire de Doruntine, c'est sa portée universelle et engagée : Kadaré affirme la puissance des mots, ceux qu'on prononce comme un serment à une sœur qui se marie, qu'on profère comme une malédiction à un fils qui nous a laissée tomber, ceux qu'on se transmet comme un précieux trésor, qui résistent aux pressions politiques ou religieuses. C'est le pouvoir que Kadaré confère à la littérature, un acte de résistance contre toutes les oppressions, qui se dissimule dans les pages incroyablement magnétiques de la légende de Doruntine.
Ce court roman m'a fait entrer par la grande porte dans l’œuvre foisonnante de cet auteur albanais que j'ai déjà hâte de retrouver.
J’ai longtemps hésité à lire Ismail Kadaré ; la figure de l’écrivain en exil, opposant au totalitarisme, m’assommait d’avance. Finalement ce livre m’a intéressée car j’ai découvert la seconde guerre mondiale d’un point de vue très différente du nôtre, celui des Albanais. Les habitants voient leur ville de pierre occupée alternativement par les Grecs et les Italiens, comme elle l’a été par les Turcs dans le passé. Ils n’ont jamais une vision surplombante des événements, ils vivent le quotidien d’un pays en guerre dans toute son absurdité.
La narration se fait du point de vue de l’enfant qu’était Kadaré à l’époque, et ce petit garçon apporte une touche de magie à tout ce qu’il voit. La ville est personnifiée, comme l’est aussi la citerne de la maison et ses échos mystérieux. Un chou transporté à la main par un des personnages devient à ses yeux une tête coupée. Les mots écrits dans les livres ou sur les affiches se transforment, ils prennent vie indépendamment de leur sens. Tout cela fait exister le personnage, alors que les autres sont comme des figures à l’arrière-plan. Malgré tout je n’ai pas pu m’identifier au petit héros, ni être vraiment emportée par ma lecture. Je l’ai appréciée comme un document plus qu’un roman.
La narration se fait du point de vue de l’enfant qu’était Kadaré à l’époque, et ce petit garçon apporte une touche de magie à tout ce qu’il voit. La ville est personnifiée, comme l’est aussi la citerne de la maison et ses échos mystérieux. Un chou transporté à la main par un des personnages devient à ses yeux une tête coupée. Les mots écrits dans les livres ou sur les affiches se transforment, ils prennent vie indépendamment de leur sens. Tout cela fait exister le personnage, alors que les autres sont comme des figures à l’arrière-plan. Malgré tout je n’ai pas pu m’identifier au petit héros, ni être vraiment emportée par ma lecture. Je l’ai appréciée comme un document plus qu’un roman.
Ismaïl Kadaré nous emmène avec ce livre dans un monde hors du temps, sur les haut plateaux d'Albanie. On découvre les paysages du Rrafsh, séparés du monde et avec leur propre culture comme toutes ces régions de haute montagne. L'histoire nous plonge dans des querelles datant de plusieurs générations et des revanches sanguinaires codifiées par le Kanun, qui fait loi sur le plateau.
Le personnage principal, Gjorg est attachant. Il se débat contre la tradition qui fait de lui à la fois un meurtrier et un condamné, sans lui laisser aucune chance de vivre passé le 17 avril, cet avril brisé. Diana et Bessian Vorpsis quant à eux voyagent sur le plateau pour leur lune de miel, qui n'est en fait qu'une excuse pour Bessian d'aller voir le Rrafsh à propos duquel il a écrit mais qu'il n'a jamais vu. Une rencontre d'un instant, sans même un seul mot échangé, entraîne le couple dans la tragédie.
J'ai adoré cette plongée dans une culture d'un autre temps menacée par la modernité. Les descriptions m'ont donné une furieuse envie de voyager et d'aller voir les paysages par moi-même. Comme Bessian le dit, on est dans une tragédie de Shakespeare et le fantôme de Hamlet, plus torturé encore, semble hanter le plateau du Rrafsh.
Le personnage principal, Gjorg est attachant. Il se débat contre la tradition qui fait de lui à la fois un meurtrier et un condamné, sans lui laisser aucune chance de vivre passé le 17 avril, cet avril brisé. Diana et Bessian Vorpsis quant à eux voyagent sur le plateau pour leur lune de miel, qui n'est en fait qu'une excuse pour Bessian d'aller voir le Rrafsh à propos duquel il a écrit mais qu'il n'a jamais vu. Une rencontre d'un instant, sans même un seul mot échangé, entraîne le couple dans la tragédie.
J'ai adoré cette plongée dans une culture d'un autre temps menacée par la modernité. Les descriptions m'ont donné une furieuse envie de voyager et d'aller voir les paysages par moi-même. Comme Bessian le dit, on est dans une tragédie de Shakespeare et le fantôme de Hamlet, plus torturé encore, semble hanter le plateau du Rrafsh.
Novembre d'une capitale pourrait avoir pour sous-titre "géographie d'une ville en guerre".
La ville, c'est Tirana, avec son boulevard Mussolini, sa station de radio, ses maisons bourgeoises, les barricades montées de bric et de broc, les chars allemands, les murs couverts d'affiches et de graffitis. Tirana, c'est en Albanie, un pays qui eut un roi autoproclamé, fit partie de l'empire Ottoman, du royaume d'Italie... bref, l'histoire complexe des Balkans.
La guerre, c'est en 1944, avec les Allemands d'Hitler qui occupent et les partisans communistes qui libèrent, apportant la dictature du prolétariat.
Il me faudra sans doute une relecture pour apprécier complètement ce roman qui me laisse une sensation fragmentée : j'aurais voulu plonger dans l'histoire mais il me manquait des codes, des points de repères, pour que cette histoire réaliste pleine de symbolismes, à la fois précise et floue, ne me soit pas laborieuse.
La ville, c'est Tirana, avec son boulevard Mussolini, sa station de radio, ses maisons bourgeoises, les barricades montées de bric et de broc, les chars allemands, les murs couverts d'affiches et de graffitis. Tirana, c'est en Albanie, un pays qui eut un roi autoproclamé, fit partie de l'empire Ottoman, du royaume d'Italie... bref, l'histoire complexe des Balkans.
La guerre, c'est en 1944, avec les Allemands d'Hitler qui occupent et les partisans communistes qui libèrent, apportant la dictature du prolétariat.
Il me faudra sans doute une relecture pour apprécier complètement ce roman qui me laisse une sensation fragmentée : j'aurais voulu plonger dans l'histoire mais il me manquait des codes, des points de repères, pour que cette histoire réaliste pleine de symbolismes, à la fois précise et floue, ne me soit pas laborieuse.
Les tambours de la pluie restent bien silencieux durant ce siège interminable. La chaleur accable les assiégés ; elle offre une aide puissante aux assaillants. Et lorsqu’ils résonnent enfin, ils sonnent le glas de la bataille terrible ainsi que celui des destinées humaines qui se sont, des semaines durant, fracassées contre les murailles.
L’action de ce récit, entre conte et roman, se passe en Albanie, au milieu du 15ème siècle. Georges Kastriote Skanderbeg s’est révolté contre le sultan d’Istanbul, entraînant son pays dans une quête à la liberté qui trouve, en son chemin, le plus puissant empire de ce temps : l’empire ottoman. Tursun pacha, redoutable chef militaire, se trouve en charge de prendre une citadelle – c’est le nom du titre en albanais – que vient de quitter Skanderbeg.
Tout au long du récit, les armées ottomanes échouent contre les remparts. Les combats sont féroces, le sang coule à flot. La nuit, les Ottomans sont harcelés par Skanderbeg qui suscite l’effroi chez l’envahisseur. Ne reste bientôt plus qu'une obsession : quand viendra la pluie qui délivrera les assiégés et désespérera les assiégeants ?
Le récit tient du conte car il exalte la nation albanaise, qui s’est notamment forgée lors de ces guerres contre les Ottomans. La figure de Skanderbeg est un symbole sacré, celle du héros libérateur et invincible et qui concentre en lui toutes les valeurs de résistance et de liberté du peuple albanais.
Mais ce qui est intéressant, dans ce récit où se mêlent plusieurs destinées de personnages de rang divers - un historien, un janissaire, un maître fondeur de canons, le pacha, un astrologue … -, c’est que la parole est avant tout turque, et que seules quelques pages rendent compte de l’état d’esprit des assiégés. En montrant la force de l’empire – ses troupes innombrables et organisées, ses chefs valeureux, ses talents de techniciens –, Ismaïl Kadaré montre combien la détermination des Albanais est importante, eux qui n’ont même plus d’eau, quasi plus de vivres et leurs épées pour seules armes.
Kadaré opère, en ce récit, une habile transposition de ce qui se passa entre l’Albanie et l’URSS dans les années 1960 lorsqu’Enver Hoxha, mécontent de la politique de déstalinisation, rompit peu à peu avec le grand frère russe, qui était alors l’une des deux superpuissances de l’époque, pour essayer de trouver sa voie propre dans le socialisme. On peut aussi y voir une transposition dans un contexte médiéval albanais de l’Iliade d’Homère, dans laquelle les Albanais tiennent le rôle des Troyens – le cheval assoiffé qui cherche l’eau, n’est-il pas celui que les Grecs construisirent pour entrer dans Troie ? – face à une armée déterminée à passer autant de temps que nécessaire pour prendre la cité.
L’action de ce récit, entre conte et roman, se passe en Albanie, au milieu du 15ème siècle. Georges Kastriote Skanderbeg s’est révolté contre le sultan d’Istanbul, entraînant son pays dans une quête à la liberté qui trouve, en son chemin, le plus puissant empire de ce temps : l’empire ottoman. Tursun pacha, redoutable chef militaire, se trouve en charge de prendre une citadelle – c’est le nom du titre en albanais – que vient de quitter Skanderbeg.
Tout au long du récit, les armées ottomanes échouent contre les remparts. Les combats sont féroces, le sang coule à flot. La nuit, les Ottomans sont harcelés par Skanderbeg qui suscite l’effroi chez l’envahisseur. Ne reste bientôt plus qu'une obsession : quand viendra la pluie qui délivrera les assiégés et désespérera les assiégeants ?
Le récit tient du conte car il exalte la nation albanaise, qui s’est notamment forgée lors de ces guerres contre les Ottomans. La figure de Skanderbeg est un symbole sacré, celle du héros libérateur et invincible et qui concentre en lui toutes les valeurs de résistance et de liberté du peuple albanais.
Mais ce qui est intéressant, dans ce récit où se mêlent plusieurs destinées de personnages de rang divers - un historien, un janissaire, un maître fondeur de canons, le pacha, un astrologue … -, c’est que la parole est avant tout turque, et que seules quelques pages rendent compte de l’état d’esprit des assiégés. En montrant la force de l’empire – ses troupes innombrables et organisées, ses chefs valeureux, ses talents de techniciens –, Ismaïl Kadaré montre combien la détermination des Albanais est importante, eux qui n’ont même plus d’eau, quasi plus de vivres et leurs épées pour seules armes.
Kadaré opère, en ce récit, une habile transposition de ce qui se passa entre l’Albanie et l’URSS dans les années 1960 lorsqu’Enver Hoxha, mécontent de la politique de déstalinisation, rompit peu à peu avec le grand frère russe, qui était alors l’une des deux superpuissances de l’époque, pour essayer de trouver sa voie propre dans le socialisme. On peut aussi y voir une transposition dans un contexte médiéval albanais de l’Iliade d’Homère, dans laquelle les Albanais tiennent le rôle des Troyens – le cheval assoiffé qui cherche l’eau, n’est-il pas celui que les Grecs construisirent pour entrer dans Troie ? – face à une armée déterminée à passer autant de temps que nécessaire pour prendre la cité.
Kadaré est assez connu, ce roman est l'un de ses plus célèbres et j'avoue que lorsque je l'ai lu, il y a bien des années, je l'ai trouvé un peu long et ennuyeux. Cela est dû au style, fait de phrases longues et qui ralentissent le récit.
Il ne se passe aussi pas grand chose dans ce monde. On a l'impression d'être dans un téléfilm en noir et blanc, sous-titré.
Mais c'est un roman pourtant intéressant, qui permet de faire le bilan de la seconde guerre mondiale, vingt ans après, puisqu'un général part à la recherche de corps italiens enterrés en Albanie. On imagine la terre, le ciel gris et les arbres démunis. Et cette quête va être longue, un peu trop mais elle révélera un nouveau message sur le monde, la vie et la paix.
Un roman qui a peut-être un peu vieilli mais reste un classique de l'œuvre de cet auteur contemporain important.
Il ne se passe aussi pas grand chose dans ce monde. On a l'impression d'être dans un téléfilm en noir et blanc, sous-titré.
Mais c'est un roman pourtant intéressant, qui permet de faire le bilan de la seconde guerre mondiale, vingt ans après, puisqu'un général part à la recherche de corps italiens enterrés en Albanie. On imagine la terre, le ciel gris et les arbres démunis. Et cette quête va être longue, un peu trop mais elle révélera un nouveau message sur le monde, la vie et la paix.
Un roman qui a peut-être un peu vieilli mais reste un classique de l'œuvre de cet auteur contemporain important.
Avril brisé est le 4è roman d'Ismail Kadare que je lis ces derniers mois, et à chaque fois, je suis captivé par le style du très grand écrivain albanais (espérons que l'académie Nobel aura très bientôt la bonne idée de lui décerner la plus prestigieuse des récompenses littéraires). L'action se passe au tout début du XXè siècle, mais sur le plateau du Rrafsh, un code d'honneur ancestral, le Kanun, impose son implacable loi du talion. Chaque offense doit être vengée, et chaque meurtre en appelle un nouveau : le sang versé doit être "racheté" par celui du meurtrier - ou plutôt du justicier. S'il veut survivre, ce dernier n'a d'autre choix que de vivre cloitré pendant des années. Les deux familles du roman en sont à plus d'une vingtaine de morts de chaque côté, et la vendetta dure depuis tellement longtemps qu'on en oublie presque comment elle a commencé. Ce roman conjugue avec beaucoup de talent aspect documentaire, presque ethnologique, et œuvre littéraire. Kadaré nous plonge au cœur de ce monde régi par le Kanun grâce à un récit qui offre d'abord un "regard intérieur" mais objectif, celui de Gjorg, qui vient d'assassiner l'assassin de son frère, puis un "regard extérieur" mais peut-être naïf, celui d'un jeune couple de citadins en voyage dans la région, dont l'homme est un écrivain fasciné par le Kanun. Kadaré montre comment la population est obligée de se plier au Kanun, et comment ce code brise les vies - de ceux qui sont tués, mais aussi de ceux qui restent. Il montre également comment les populations sont poussées à la vendetta par ceux qui en tirent un profit économique, et comment le système a été dévoyé. Une société toute entière régie par un code moral glaçant. C'est passionnant, terrifiant, absurde. Comme souvent chez Kadare, cela ressemble à une tragédie grecque, mais au XXè siècle. Bien qu'ancré dans une société parfaitement marqué, tant géographiquement qu'historiquement, le roman brasse des thèmes qui dépassent ce cadre, et nous interroge plus largement.
Belle découverte que ce roman albanais dans lequel nous suivons le siège d'une citadelle par les Turcs au XVème siècle.
À travers le récit de l'auteur, nous découvrons le quotidien du camp des envahisseurs : les grades, les conseils, les reflexions sur les stratégies à adopter, les luttes de pouvoir également, les enjeux qui se cachent derrière la victoire ou la défaite, les difficultés à nourrir tout le monde et surtout la baisse de moral au fil du temps. Nous y apprenons aussi les débuts de l'utilisation du canon.
Les Turcs ont dû mettre toutes leurs idées en place, que ce soit de la coupure d'eau à l'envoi d'animaux infectés de maladies diverses et variés. Ces soldats turcs se sont battus avec acharnement.
J'ai trouvé la narration très intéressante, cette dernière alternant entre de longs passages centrés sur les envahisseurs et d'autres plus courts et en italique donnant la parole aux assiégés.
Ismail Kadaré nous montre ici une lutte disproportionnée puisque l'Albanie qui était faible et avec peu de moyens s'est retrouvée en proie aux griffes d'une grande puissance militaire, si ce n'est la plus grande puissance de l'époque. Combat donc complétement inégal, même si la citadelle tient, grâce aux éléments naturels finalement.
C'est ici un choc au sens propre avec d'innombrables morts, mais aussi au sens figuré : choc culturel puisqu'elles sont très différentes l'une de l'autre (par exemple langue différentes, pas les mêmes mœurs, les Turcs sont choqués de voir apparaitre les femmes albanaises aux remparts et de voir leurs yeux alors que les femmes turcs sont voilées), choc donc aussi des religions (les turcs étant musulmans et les albanais chrétiens). Cette différence est bien visible dans le roman puisqu'il y a souvent des références à Allah pour les uns et à la croix ou à Dieu pour les autres.
Une fois de plus, nous apercevons l'absurdité du genre humain, le désir assoifé de conquêtes d'autres territoires, au détriment de la vie et de la paix.
Cette histoire d'une grande puissance attaquant une plus faible (mais non démunie de ressources finalement) fait étrangement écho avec la situation actuelle...
À travers le récit de l'auteur, nous découvrons le quotidien du camp des envahisseurs : les grades, les conseils, les reflexions sur les stratégies à adopter, les luttes de pouvoir également, les enjeux qui se cachent derrière la victoire ou la défaite, les difficultés à nourrir tout le monde et surtout la baisse de moral au fil du temps. Nous y apprenons aussi les débuts de l'utilisation du canon.
Les Turcs ont dû mettre toutes leurs idées en place, que ce soit de la coupure d'eau à l'envoi d'animaux infectés de maladies diverses et variés. Ces soldats turcs se sont battus avec acharnement.
J'ai trouvé la narration très intéressante, cette dernière alternant entre de longs passages centrés sur les envahisseurs et d'autres plus courts et en italique donnant la parole aux assiégés.
Ismail Kadaré nous montre ici une lutte disproportionnée puisque l'Albanie qui était faible et avec peu de moyens s'est retrouvée en proie aux griffes d'une grande puissance militaire, si ce n'est la plus grande puissance de l'époque. Combat donc complétement inégal, même si la citadelle tient, grâce aux éléments naturels finalement.
C'est ici un choc au sens propre avec d'innombrables morts, mais aussi au sens figuré : choc culturel puisqu'elles sont très différentes l'une de l'autre (par exemple langue différentes, pas les mêmes mœurs, les Turcs sont choqués de voir apparaitre les femmes albanaises aux remparts et de voir leurs yeux alors que les femmes turcs sont voilées), choc donc aussi des religions (les turcs étant musulmans et les albanais chrétiens). Cette différence est bien visible dans le roman puisqu'il y a souvent des références à Allah pour les uns et à la croix ou à Dieu pour les autres.
Une fois de plus, nous apercevons l'absurdité du genre humain, le désir assoifé de conquêtes d'autres territoires, au détriment de la vie et de la paix.
Cette histoire d'une grande puissance attaquant une plus faible (mais non démunie de ressources finalement) fait étrangement écho avec la situation actuelle...
Récit d'un écrivain albanais en Union soviétique, qui fréquente une femme russe jusqu'au refroidissement des relations entre Albanie et Russie. La splendeur du titre désigne les dirigeants soviétiques, que l'on n'entrevoit qu'à la fin, distants et figés. le roman n'est pas exaltant, reflétant une vie morne et contrôlée, celle des écrivains communistes des pays frères à Moscou. On y perçoit d'une façon feutrée la critique du régime, sans apprendre grand chose.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Ismaïl Kadaré
Quiz
Voir plus
LES ROMANS DE KADARE
L'arrivée de deux Irlandais new-yorkais, Max Roth et Willy Norton, dans la ville de N., au coeur de l'Albanie, fait l'effet d'une bombe dont les intéressés auraient bien étouffé l'explosion. Le sous-préfet de N. partage bien sûr l'avis de son ministre : il n'est pas exclu que les deux étrangers soient des espions...
Le grand hiver
Le général de l'armée morte
L'année noire
Le dossier H
10 questions
9 lecteurs ont répondu
Thème :
Ismaïl KadaréCréer un quiz sur cet auteur9 lecteurs ont répondu