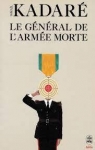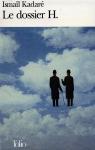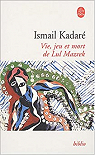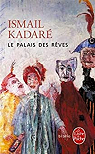Critiques de Ismaïl Kadaré (257)
Nous sommes dans l’Albanie du Moyen-Âge, Doruntine, partie suivre son mari en Bohème trois ans plus tôt, revient au pays. Ce retour fait jaser au village puisque l’unique fille Varaj, assure que c’est son frère Kostantin qui l’a ramenée.
Le problème c’est que tous ses frères sont morts à la guerre peu de temps après son départ. Qui était donc ce mystérieux cavalier couvert de boue qui lui a fait traverser les contrées ? Doruntine cache-t-elle un amant? Où est-ce la bessa ( la parole donnée) qui est responsable de la résurrection mystique de son frère?
L’inspecteur Stres ne va pas disposer de beaucoup d’éléments pour résoudre ce mystère, puisque quelques jours plus tard la mère et la fille décèdent de façon subite et inexplicable…La rumeur enfle … Une résurrection ? Il ne manquait plus ça pour l’Église orthodoxe .
Un texte que j’ai aimé, même si j’émets un bémol concernant les dernières pages, beaucoup plus politique. C’est un mélange de conte et de polar (soft). Le suspens est au rendez-vous, et on veut comprendre de quoi il retourne. Le personnage de Stres est intéressant, tout en ambiguïtés et ambivalences. J’ai aimé découvrir ce lieu sa culture et son folklore, dont je ne connais pas grand-chose !
Ismail Kadaré nous livre ici une satire de la société albanaise. Un texte qui a dérangé au moment de sa sortie puisqu’il a été interdit de parution en Albanie.
Le problème c’est que tous ses frères sont morts à la guerre peu de temps après son départ. Qui était donc ce mystérieux cavalier couvert de boue qui lui a fait traverser les contrées ? Doruntine cache-t-elle un amant? Où est-ce la bessa ( la parole donnée) qui est responsable de la résurrection mystique de son frère?
L’inspecteur Stres ne va pas disposer de beaucoup d’éléments pour résoudre ce mystère, puisque quelques jours plus tard la mère et la fille décèdent de façon subite et inexplicable…La rumeur enfle … Une résurrection ? Il ne manquait plus ça pour l’Église orthodoxe .
Un texte que j’ai aimé, même si j’émets un bémol concernant les dernières pages, beaucoup plus politique. C’est un mélange de conte et de polar (soft). Le suspens est au rendez-vous, et on veut comprendre de quoi il retourne. Le personnage de Stres est intéressant, tout en ambiguïtés et ambivalences. J’ai aimé découvrir ce lieu sa culture et son folklore, dont je ne connais pas grand-chose !
Ismail Kadaré nous livre ici une satire de la société albanaise. Un texte qui a dérangé au moment de sa sortie puisqu’il a été interdit de parution en Albanie.
Un livre des débuts de la carrière de Kadaré .Il conte la résistance des Albanais menés par Skanderberg contre l’Empire Ottoman. En1448 , une immense armée met le siège devant une citadelle qui défend le pays. Kadaré raconte ce combat de David contre Goliath alternant de longs chapitres vus du côté turc et de courts épisodes vus par les assiégés . Malgré un parti pris évident , il évite le manichéisme en créant des personnages attachants du côté assiégeants , évoquant certes les côtés barbares des ottomans ( châtiments corporels, viols, fanatisme) mais aussi leur impressionnant organisation militaire. Il met en scène l’épopée fondatrice du récit national albanais en insistant sur le rôle de défenseur de l’Occident contre l’expansion ottomane et sur la capacité de résistance de ce peuple poursuivie jusqu’à nos jours.
Tout écrivain, n'est-ce pas, même parmi les plus grands, aura publié des livres qu'on considérera « moins bons », voire parfois pas bons du tout, c'est à dire carrément ratés!
Suis-je tombé dans ce cas, en commençant la lecture de l'oeuvre d'Ismail Kadaré, salué par la critique et par de très nombreux lecteurs dans le monde entier comme l'un des plus grands écrivains européens contemporains, par ce livre qui m'aura profondément déçu?
D'une part, un récit que j'ai trouvé trop éclaté, sans vrai fil conducteur, hésitant entre différentes approches narratives, pour la plupart, à mon sens, inabouties. Puisant pêle-mêle dans des sources à la fois romanesques et existentielles, historiques, sociologiques, politiques, métaphysiques et/ou mythologiques, quasiment tout dans ce livre reste inexpliqué, ou peu développé, voire par moment introduit puis abandonné tout simplement. (Qui est Zef, par exemple, l'ami proche que Mark semble chercher, sans véritablement chercher d'ailleurs, et dont on n'aura plus aucune nouvelle dans le développement postérieur du récit ?).
D'autre part, des personnages qui ne m'auront suscité aucune empathie, aucune identification (c'est la moindre des choses, il me semble, que puisse attendre un lecteur qui s'investit !!).
À commencer par Mark Gurabardhi, l'artiste, personnage central et sorte de Mersault encore plus inconsistant que l'original, qui ne passe même pas à l'acte comme le personnage de Camus, ne s'engageant à pas grand'chose, si ce n'est peut-être à avoir peur de se prendre une balle perdue par la baie vitrée de son atelier, à s'accommoder tant soit peu à la réalité environnante d'un ville de province où il se sent étranger, et à faire l'amour avec son amie et modèle de laquelle il ne sait pas grand'chose non plus, même pas son nom de famille!
Bien-sûr, on pourra toujours invoquer l'argument que c'est exactement ce que l'auteur voulait décrire, à savoir le « flou » qui a suivi la fin de la dictature communiste en Albanie, à partir de années 1990, les premiers pas, encore incertains à l'époque, d'une nouvelle démocratie en train de se chercher et, surtout, l'insécurité face à l'avenir, associée à l'angoisse de la résurgence de vieux fantômes restés ensevelis longtemps par la répression du régime communiste, dont notamment la « kanun », code d'honneur traditionnel albanais d'origine médiévale basé sur l'honneur et la "vendetta" entre familles et clans, entraînant à nouveau dans les régions reculées du nord du pays de nombreux bains de sang en série.
Certes...
Néanmoins, de mon point de vue de lecteur, je trouve qu'on ne réussit pas forcément à décrire le "flou" par une écriture et une construction de récit qui seraient elles-même "floues", abusivement elliptiques ou laissées inabouties, comme c'est le cas de ces Froides Fleurs d'Avril, ni tout à fait allégoriques, ni vraiment réalistes.
En définitive, je reste sur ma faim sur ce plat choisi au hasard, servi trop froid à mon goût..!
Et concernant la cuisine de cet auteur, j'espère à l'avenir être conseillé préalablement par de vrais "connaisseurs", avant de m'y risquer à nouveau...
...
Suis-je tombé dans ce cas, en commençant la lecture de l'oeuvre d'Ismail Kadaré, salué par la critique et par de très nombreux lecteurs dans le monde entier comme l'un des plus grands écrivains européens contemporains, par ce livre qui m'aura profondément déçu?
D'une part, un récit que j'ai trouvé trop éclaté, sans vrai fil conducteur, hésitant entre différentes approches narratives, pour la plupart, à mon sens, inabouties. Puisant pêle-mêle dans des sources à la fois romanesques et existentielles, historiques, sociologiques, politiques, métaphysiques et/ou mythologiques, quasiment tout dans ce livre reste inexpliqué, ou peu développé, voire par moment introduit puis abandonné tout simplement. (Qui est Zef, par exemple, l'ami proche que Mark semble chercher, sans véritablement chercher d'ailleurs, et dont on n'aura plus aucune nouvelle dans le développement postérieur du récit ?).
D'autre part, des personnages qui ne m'auront suscité aucune empathie, aucune identification (c'est la moindre des choses, il me semble, que puisse attendre un lecteur qui s'investit !!).
À commencer par Mark Gurabardhi, l'artiste, personnage central et sorte de Mersault encore plus inconsistant que l'original, qui ne passe même pas à l'acte comme le personnage de Camus, ne s'engageant à pas grand'chose, si ce n'est peut-être à avoir peur de se prendre une balle perdue par la baie vitrée de son atelier, à s'accommoder tant soit peu à la réalité environnante d'un ville de province où il se sent étranger, et à faire l'amour avec son amie et modèle de laquelle il ne sait pas grand'chose non plus, même pas son nom de famille!
Bien-sûr, on pourra toujours invoquer l'argument que c'est exactement ce que l'auteur voulait décrire, à savoir le « flou » qui a suivi la fin de la dictature communiste en Albanie, à partir de années 1990, les premiers pas, encore incertains à l'époque, d'une nouvelle démocratie en train de se chercher et, surtout, l'insécurité face à l'avenir, associée à l'angoisse de la résurgence de vieux fantômes restés ensevelis longtemps par la répression du régime communiste, dont notamment la « kanun », code d'honneur traditionnel albanais d'origine médiévale basé sur l'honneur et la "vendetta" entre familles et clans, entraînant à nouveau dans les régions reculées du nord du pays de nombreux bains de sang en série.
Certes...
Néanmoins, de mon point de vue de lecteur, je trouve qu'on ne réussit pas forcément à décrire le "flou" par une écriture et une construction de récit qui seraient elles-même "floues", abusivement elliptiques ou laissées inabouties, comme c'est le cas de ces Froides Fleurs d'Avril, ni tout à fait allégoriques, ni vraiment réalistes.
En définitive, je reste sur ma faim sur ce plat choisi au hasard, servi trop froid à mon goût..!
Et concernant la cuisine de cet auteur, j'espère à l'avenir être conseillé préalablement par de vrais "connaisseurs", avant de m'y risquer à nouveau...
...
Quel étrange roman, mais pas déplaisant ! Avec son histoire plus qu'étonnante, l'auteur nous entraîne dans des réflexions sur la guerre en l'occurrence la Seconde Guerre Mondiale, ses conséquences etc..
Il nous décrit aussi cette Albanie, un pays qui lui est cher.
J'avoue que parfois j'ai trouvé la lecture un peu longue, mais l'histoire étant bien trouvée, que ce n'est pas rédhibitoire !
Il nous décrit aussi cette Albanie, un pays qui lui est cher.
J'avoue que parfois j'ai trouvé la lecture un peu longue, mais l'histoire étant bien trouvée, que ce n'est pas rédhibitoire !
Quel émouvant récit que le dossier H de Kadaré.
H comme Homère car il s agit bien ici de l'épopée contée par Homère.Deux irlandais partent en Albanie enregistrer les voix des raphsodes qui ne sont pas sans lien avec les épopées de l' Iliade et L'odyssée.
Mais au_ delà de cette recherche passionnante, toute l'Albanie nous est contée.D'abord, l'évocation politique avec ces espions qui traquent sans cesse le traître, les rapports que lit le sous_ préfet ne sont pas dénués d humour et de l'esprit caustique dint fait preuve Kadaré pour dénoncer un état totalitaire.
On s'envole aussi avec la femme du sous_ préfet qui a même changé de prénom: Daisy.Daisy nous renvoie l'image d'une Emma Bovary albanaise perissant d'ennui dans cette province où il ne se passe rien.Alors, elle s'invente sa vie avec une passion avec ces deux étrangers.La chute est dure, elle tombe enceinte de l'indicateur albanais.
Pauvre Daisy, le sort en est jeté.
Beaucoup de compassion pour ces deux chercheurs qui voient anéanti leur travail par le saccage du magnétophone.
Émouvantes paroles que nous laissent Kadaré pour finir
«En ce bas monde, le temps de l'épopée était bel et bien révolu, et ç'avait été un pur hasard s'ils avaient pu capter les derniers scintillements avant son extinction pour l'éternité.Ils les avaient captés, puis les avaient reperdus. Le voile du crépuscule était tombé pour toujours sur le terrain épique»
H comme Homère car il s agit bien ici de l'épopée contée par Homère.Deux irlandais partent en Albanie enregistrer les voix des raphsodes qui ne sont pas sans lien avec les épopées de l' Iliade et L'odyssée.
Mais au_ delà de cette recherche passionnante, toute l'Albanie nous est contée.D'abord, l'évocation politique avec ces espions qui traquent sans cesse le traître, les rapports que lit le sous_ préfet ne sont pas dénués d humour et de l'esprit caustique dint fait preuve Kadaré pour dénoncer un état totalitaire.
On s'envole aussi avec la femme du sous_ préfet qui a même changé de prénom: Daisy.Daisy nous renvoie l'image d'une Emma Bovary albanaise perissant d'ennui dans cette province où il ne se passe rien.Alors, elle s'invente sa vie avec une passion avec ces deux étrangers.La chute est dure, elle tombe enceinte de l'indicateur albanais.
Pauvre Daisy, le sort en est jeté.
Beaucoup de compassion pour ces deux chercheurs qui voient anéanti leur travail par le saccage du magnétophone.
Émouvantes paroles que nous laissent Kadaré pour finir
«En ce bas monde, le temps de l'épopée était bel et bien révolu, et ç'avait été un pur hasard s'ils avaient pu capter les derniers scintillements avant son extinction pour l'éternité.Ils les avaient captés, puis les avaient reperdus. Le voile du crépuscule était tombé pour toujours sur le terrain épique»
Des aspects autobiographiques? Kadaré a été proche du pouvoir malgré ses écrits corrosifs mais il a du s'exiler. Ici, le personnage principal ne se sent pas à sa place dans la tribune de la fête du 1er Mai: on va se demander ce qu'il a fait pour cet "honneur". Il est en désaccord avec la politique dictatoriale de son pays aussi sa fiancée met fin à leur relation pour être en harmonie avec la position élevée de son père: elle sacrifie son amour . L'auteur, pétri de culture de la Grèce antique compare le sacrifice de Suzana à celui d'Iphigénie. La raison d'état prime sur les sentiments.
Vous cherchez une oeuvre qui vous dépayse dans l’espace et dans le temps ? Lisez « Avril brisé » d’Ismaïl Kadaré. Vous partez pour l’Albanie et ses traditions d’un autre temps, celles du Moyen-Age, même si l’action se situe au début du XXème siècle. Il s’agit de vendetta, de sang qui appelle le sang pour des questions d’honneur. Il ne s’agit pas de relire « Mateo Falcone » de Mérimée, même si la nature, la famille, le père jouent aussi leurs rôles. L’écriture de Kadaré est plus développée -il s’agit d’un roman- et permet d’entrer dans une autre dimension. L’oeuvre se définit elle-même au détour de deux pages : sur son style « Tu vas t’évader de l’univers de la réalité pour gagner celui des légendes, l’univers de l’épopée proprement dite, que l’on trouve encore rarement vivante dans notre monde » et sur la qualification de l’action « C’est à la fois terrible, absurde et fatal, comme toutes les grandes choses » déclare Bessian, le personnage écrivain. Nous assistons à une véritable tragédie, rendue vivante par une écriture magistrale dans une admirable traduction de Jusuf Vrioni, qui révèle la montée des tensions, la contemplation de l’horreur, ménage ses effets, dans un rythme lent mais impossible à lâcher.
A sa manière, Ismaïl Kadaré est, lui aussi, un rhapsode. A sa manière, bien évidemment, car lui a écrit des livres tandis que les rhapsodes albanais récitaient et chantaient les vieilles épopées populaires, lesquelles avaient traversé les siècles depuis le lointain âge antique de la Grèce homérique, quitte à subir quelques transformations. Toutefois, c'est bien de mémoire collective, de mémoire populaire, de mémoire albanaise dont parle Kadaré dans ses livres. Le dossier H. est, à sa façon, une sorte de patchwork littéraire où viennent se rencontrer, liés par la langue simple et fluide de l'auteur, l'épopée, l'enquête littéraire et le conte populaire, et même la satire.
Deux Irlandais se rendent en Albanie pour y rencontrer les derniers rhapsodes. Ils veulent enregistrer leurs voix, comparer leurs récits, retrouver dans ceux-ci le matériau homérique originel en même temps que, en rencontrant ces conteurs modernes, ils espèrent identifier quel littérateur fut Homère : un rhapsode ou un compilateur, génial dans tous les cas, et dont le seul trait caractéristique connu est qu'il était aveugle. Ils s'établissent dans une auberge dans le nord du pays où, dérangé seulement par les punaises, ils compilent les récits narrés au son de la lahuta et densifient leur réflexion sur la matière rhapsodique. Toutefois, leur venue dans ce pays en butte avec ses voisins yougoslaves et grecs provoque des réactions de suspicion chez les autorités du pays. Ainsi le ministre et le sous-préfet de la ville de N. les mettent sur écoute, persuadés que les deux Irlandais sont en réalité des espions.
L'épopée est le prétexte. Fixée par Homère durant l'Antiquité grecque, elle semble survivre dans ce recoin des Balkans. Sa survie est double : par ses thèmes et par ses modalités. Les personnages homériques reviennent dans les chansons de geste albanaises sous différents noms et avec différentes destinées mais leur type littéraire est le même. De la même façon, il y a chez les rhapsodes albanais une manière de faire qui est l'héritage direct, mais lointain, des aèdes grecs. L'épopée est un genre littéraire oral qui se meurt ; en cela les deux Irlandais qui arrivent en Albanie essaient de le sauver. Il y a pourtant une dichotomie évidente qui place d'un côté l'oralité de l'épopée, son caractère fragile, instable (les rhapsodes oublient volontairement ou non des parties, font évoluer le récit selon leurs propres caractères et selon les faits qui émaillent leurs propres vies) et menacé ; de l'autre, l'enregistrement vocal et l'écrit qui stabilisent les récits, assurent leur survie dans le temps mais sur lesquels plane l'ombre de la mort. Avec l'écrit, la nécessité de l'oral disparaît et avec elle, l'essence de l'art rhapsodique. Cette dichotomie se retrouve dans la destinée de Willy Norton, l'un des protagonistes, dont la vue baisse au fur et à mesure de l'avancée du récit. Paradoxalement, c'est lorsque la cécité se fait presque complète qu'il cesse d'être un copieur de voix pour se faire le transmetteur des récits antiques.
Toutefois, loin de se circonscrire à ce genre d'enquête littéraire, Le dossier H. se veut aussi un conte moderne sur l'Albanie. La bonne société de la ville de N. y est décrite de façon satirique : on s'ennuie ferme à N. et la venue des deux Irlandais est un événement qui en appelle d'autres. Le sous-préfet fait surveiller les deux étrangers par l'un de ses indicateurs, Dul Lasoupente, lequel révèle, dans ses rapports, un véritable talent littéraire caractérisé par la précision des informations autant que par l'obséquiosité de ses remarques. L'épouse du sous-préfet rêve, elle, d'aventures érotiques et amoureuses tandis que le reste de la bonne société se complaît et se confond dans sa médiocrité. Le pays, fermé, montre, par l'attitude de son ministre, qu'il n'est pas même conscient de sa richesse intellectuelle tandis que, dans près des Cimes maudites, les montagnards croient encore en leurs traditions séculaires (cf l'histoire de l'homme qui se meurt car son ombre a été enfermée). Le dossier H. révèle donc, au fil des pages, un grand nombre de réflexions littéraires. Et, de la même façon que l'identité et le travail d'Homère demeurent une énigme, le livre de Kadaré reste ouvert à une relecture : histoire de s'assurer que, entre les circonvolutions verbales de Dul Lasoupente, quelque chose ne nous a pas échappé.
Deux Irlandais se rendent en Albanie pour y rencontrer les derniers rhapsodes. Ils veulent enregistrer leurs voix, comparer leurs récits, retrouver dans ceux-ci le matériau homérique originel en même temps que, en rencontrant ces conteurs modernes, ils espèrent identifier quel littérateur fut Homère : un rhapsode ou un compilateur, génial dans tous les cas, et dont le seul trait caractéristique connu est qu'il était aveugle. Ils s'établissent dans une auberge dans le nord du pays où, dérangé seulement par les punaises, ils compilent les récits narrés au son de la lahuta et densifient leur réflexion sur la matière rhapsodique. Toutefois, leur venue dans ce pays en butte avec ses voisins yougoslaves et grecs provoque des réactions de suspicion chez les autorités du pays. Ainsi le ministre et le sous-préfet de la ville de N. les mettent sur écoute, persuadés que les deux Irlandais sont en réalité des espions.
L'épopée est le prétexte. Fixée par Homère durant l'Antiquité grecque, elle semble survivre dans ce recoin des Balkans. Sa survie est double : par ses thèmes et par ses modalités. Les personnages homériques reviennent dans les chansons de geste albanaises sous différents noms et avec différentes destinées mais leur type littéraire est le même. De la même façon, il y a chez les rhapsodes albanais une manière de faire qui est l'héritage direct, mais lointain, des aèdes grecs. L'épopée est un genre littéraire oral qui se meurt ; en cela les deux Irlandais qui arrivent en Albanie essaient de le sauver. Il y a pourtant une dichotomie évidente qui place d'un côté l'oralité de l'épopée, son caractère fragile, instable (les rhapsodes oublient volontairement ou non des parties, font évoluer le récit selon leurs propres caractères et selon les faits qui émaillent leurs propres vies) et menacé ; de l'autre, l'enregistrement vocal et l'écrit qui stabilisent les récits, assurent leur survie dans le temps mais sur lesquels plane l'ombre de la mort. Avec l'écrit, la nécessité de l'oral disparaît et avec elle, l'essence de l'art rhapsodique. Cette dichotomie se retrouve dans la destinée de Willy Norton, l'un des protagonistes, dont la vue baisse au fur et à mesure de l'avancée du récit. Paradoxalement, c'est lorsque la cécité se fait presque complète qu'il cesse d'être un copieur de voix pour se faire le transmetteur des récits antiques.
Toutefois, loin de se circonscrire à ce genre d'enquête littéraire, Le dossier H. se veut aussi un conte moderne sur l'Albanie. La bonne société de la ville de N. y est décrite de façon satirique : on s'ennuie ferme à N. et la venue des deux Irlandais est un événement qui en appelle d'autres. Le sous-préfet fait surveiller les deux étrangers par l'un de ses indicateurs, Dul Lasoupente, lequel révèle, dans ses rapports, un véritable talent littéraire caractérisé par la précision des informations autant que par l'obséquiosité de ses remarques. L'épouse du sous-préfet rêve, elle, d'aventures érotiques et amoureuses tandis que le reste de la bonne société se complaît et se confond dans sa médiocrité. Le pays, fermé, montre, par l'attitude de son ministre, qu'il n'est pas même conscient de sa richesse intellectuelle tandis que, dans près des Cimes maudites, les montagnards croient encore en leurs traditions séculaires (cf l'histoire de l'homme qui se meurt car son ombre a été enfermée). Le dossier H. révèle donc, au fil des pages, un grand nombre de réflexions littéraires. Et, de la même façon que l'identité et le travail d'Homère demeurent une énigme, le livre de Kadaré reste ouvert à une relecture : histoire de s'assurer que, entre les circonvolutions verbales de Dul Lasoupente, quelque chose ne nous a pas échappé.
A la suite d’Avril brisé et de Chronique de la ville de pierre, je poursuis la relecture des romans de Kadaré qui dorment bien sagement sur l’étagère, avec les livres que j’ai aimés dont je ne me séparerais pas, mais que j’ai un peu oubliés.
le Général de l’Armée morte raconte l’histoire d’un général italien, dans les années soixante, chargé de rapatrier les corps des soldats morts pendant la dernière guerre afin de les rendre à leurs familles. Cette mission en temps de paix s’avère pénible, dans les montagnes escarpées d’Albanie, dans la boue de l’automne et le froid hivernal. Le Général est accompagné d’un prêtre catholique qui lui sert de traducteur, de conseiller et de confident.
Après les négociations avec les autorités nécessaires pour entreprendre ces chantiers, le Général est pénétré de la solennité de sa mission, de son étrangeté aussi :
« et puis, ces derniers temps il m’arrive quelque chose d’étrange. Dès que je vois quelqu’un, machinalement je me mets à lui enlever les cheveux, puis ses joues, ses yeux comme quelque chose d’inutile, comme quelque chose qui m’empêche même de pénétrer son essence, j’imagine sa tête rien que comme un crâne et des dents (seuls détails stables) vous me comprenez? J’ai l’impression de m’être introduit dans le royaume du calcium…. »
Ils doivent extirper de la boue des ossements, mais aussi le passé de cette invasion repoussée par les montagnards albanais qui contraignirent à la retraite. Cette campagne ne fut pas très glorieuse et le Général en a conscience. Comme il craint l’hostilité des paysans que ses fouilles peuvent causer.
« il y a vingt ans, vous écriviez les mots d’ordre du fascisme sur les poitrines de nos camarades et maintenant vous vous révoltez à propos de cette phrase écrite sans doute par un écolier.[…..]Vous évoquez souvent les Grecs et les Troyens. pourquoi ne devrait-on pas parler de ce qui se passait il y a vingt ans? »
le général voulant fêter la fin de la campagne de fouilles, s’invite à une noce où les paysans chantent et dansent, une vieille femme fait resurgir sa douleur et on frôle le drame. Tout le roman est écrit sur le fil de l’ambiguïté. Générosité de celui qui offre l’hospitalité mais aussi méfiance vis à vis de l’ancien ennemi.
J’avais d’abord fait une lecture sur le plan allégorique, mythique, tragique. Maintenant que je me suis familiarisée avec le monde de Kadaré, je replace les événements dans leur contexte historique : l’occupation italienne, Kadaré l’a raconté plus tard dans la Chronique de la ville de pierre. J’ai retrouvé au moins deux épisodes commun aux deux livres : celui de l’installation du bordel dans la ville et l’histoire du pilote anglais qui avait perdu une main. Une autre histoire, celle du prisonnier italien devenu valet du meunier a été racontée de manière analogue par Argolli dans l’Homme au canon. Dans les deux cas, l’italien, prisonnier ou déserteur avait écrit un journal intime.
L’auteur accorde une importance à la poésie des traditions, chants et musique des montagnards. A plusieurs reprise il s’attarde pour nous en faire ressentir la beauté étrange et sauvage :
» – moi je frémis à les entendre, ils m’effraient
tout leur folklore épique est ainsi, dit le prêtre.
– Le diable seul saurait dire ce que les peuples expriment par leurs chants, dit le général; On peut fouiller et s’introduire facilement dans leur sol mais quant à pénétrer leur âme, ça jamais…… »
C’est donc encore un roman tragique, prenant.
J’ai préféré dans le genre tragique Avril brisé et dans le genre historique,La chronique de la cité de pierre avec le regard naif de l’enfant.j’ai eu du mal à rentrer dans l’histoire, je ne suis laissée emporter qu’après une centaine de pages.
Lien : http://miriampanigel.blog.le..
le Général de l’Armée morte raconte l’histoire d’un général italien, dans les années soixante, chargé de rapatrier les corps des soldats morts pendant la dernière guerre afin de les rendre à leurs familles. Cette mission en temps de paix s’avère pénible, dans les montagnes escarpées d’Albanie, dans la boue de l’automne et le froid hivernal. Le Général est accompagné d’un prêtre catholique qui lui sert de traducteur, de conseiller et de confident.
Après les négociations avec les autorités nécessaires pour entreprendre ces chantiers, le Général est pénétré de la solennité de sa mission, de son étrangeté aussi :
« et puis, ces derniers temps il m’arrive quelque chose d’étrange. Dès que je vois quelqu’un, machinalement je me mets à lui enlever les cheveux, puis ses joues, ses yeux comme quelque chose d’inutile, comme quelque chose qui m’empêche même de pénétrer son essence, j’imagine sa tête rien que comme un crâne et des dents (seuls détails stables) vous me comprenez? J’ai l’impression de m’être introduit dans le royaume du calcium…. »
Ils doivent extirper de la boue des ossements, mais aussi le passé de cette invasion repoussée par les montagnards albanais qui contraignirent à la retraite. Cette campagne ne fut pas très glorieuse et le Général en a conscience. Comme il craint l’hostilité des paysans que ses fouilles peuvent causer.
« il y a vingt ans, vous écriviez les mots d’ordre du fascisme sur les poitrines de nos camarades et maintenant vous vous révoltez à propos de cette phrase écrite sans doute par un écolier.[…..]Vous évoquez souvent les Grecs et les Troyens. pourquoi ne devrait-on pas parler de ce qui se passait il y a vingt ans? »
le général voulant fêter la fin de la campagne de fouilles, s’invite à une noce où les paysans chantent et dansent, une vieille femme fait resurgir sa douleur et on frôle le drame. Tout le roman est écrit sur le fil de l’ambiguïté. Générosité de celui qui offre l’hospitalité mais aussi méfiance vis à vis de l’ancien ennemi.
J’avais d’abord fait une lecture sur le plan allégorique, mythique, tragique. Maintenant que je me suis familiarisée avec le monde de Kadaré, je replace les événements dans leur contexte historique : l’occupation italienne, Kadaré l’a raconté plus tard dans la Chronique de la ville de pierre. J’ai retrouvé au moins deux épisodes commun aux deux livres : celui de l’installation du bordel dans la ville et l’histoire du pilote anglais qui avait perdu une main. Une autre histoire, celle du prisonnier italien devenu valet du meunier a été racontée de manière analogue par Argolli dans l’Homme au canon. Dans les deux cas, l’italien, prisonnier ou déserteur avait écrit un journal intime.
L’auteur accorde une importance à la poésie des traditions, chants et musique des montagnards. A plusieurs reprise il s’attarde pour nous en faire ressentir la beauté étrange et sauvage :
» – moi je frémis à les entendre, ils m’effraient
tout leur folklore épique est ainsi, dit le prêtre.
– Le diable seul saurait dire ce que les peuples expriment par leurs chants, dit le général; On peut fouiller et s’introduire facilement dans leur sol mais quant à pénétrer leur âme, ça jamais…… »
C’est donc encore un roman tragique, prenant.
J’ai préféré dans le genre tragique Avril brisé et dans le genre historique,La chronique de la cité de pierre avec le regard naif de l’enfant.j’ai eu du mal à rentrer dans l’histoire, je ne suis laissée emporter qu’après une centaine de pages.
Lien : http://miriampanigel.blog.le..
Kadaré mérite certainement qu'on le découvre un peu plus , pour lever bien des mystères concernant son pays .
L'installation des personnages et de l'intrigue dans la première moitié du livre est motivante pour continuer la lecture mais arrivent des digressions qui en ralentissent inutilement ( à mon sens ) le rythme .
kadaré fut un continuel opposant au système dictatorial d'Enver Hoxha et dans ce livre il nous montre le vain combat d'un ministre et des chefs de la police pour enrayer les nombreuses évasions de citoyens qui discréditent la dictature aux yeux de l'opinion mondiale . Mais ce régime est tombé , kadaré vit désormais en occident et doit se rendre compte que les politiciens n'ont pas plus d'efficacité ici pour régler les problèmes .... les ministres du travail sont impuissants à diminuer le chômage , ceux de l'intérieur à circonvenir l'immigration tout comme leurs homologues albanais à enrayer la volonté d'exil . Chacun en tirera ses propres conclusions grâce à l'éclairage de l'auteur à travers ce livre .
L'installation des personnages et de l'intrigue dans la première moitié du livre est motivante pour continuer la lecture mais arrivent des digressions qui en ralentissent inutilement ( à mon sens ) le rythme .
kadaré fut un continuel opposant au système dictatorial d'Enver Hoxha et dans ce livre il nous montre le vain combat d'un ministre et des chefs de la police pour enrayer les nombreuses évasions de citoyens qui discréditent la dictature aux yeux de l'opinion mondiale . Mais ce régime est tombé , kadaré vit désormais en occident et doit se rendre compte que les politiciens n'ont pas plus d'efficacité ici pour régler les problèmes .... les ministres du travail sont impuissants à diminuer le chômage , ceux de l'intérieur à circonvenir l'immigration tout comme leurs homologues albanais à enrayer la volonté d'exil . Chacun en tirera ses propres conclusions grâce à l'éclairage de l'auteur à travers ce livre .
Ce texte est dans une veine très différente des romans d'I.Kadaré, notamment de ceux que j'ai beaucoup aimé : "Chronique de la ville de pierre", "Le pont aux trois arches", "Avril brisé", "Le Palais des rêves". C'est une autobiographie familiale, dans le sens où l'on a une série de portraits des membres de la famille proche de l'écrivain, présentés chronologiquement depuis l'enfance de Kadaré jusqu'à la mort de sa mère. La maison familiale est un personnage important car elle habite les membres de la famille davantage que l'inverse. Le livre débute et se clôt sur elle.
Le texte est une succession de petits paragraphes, ce qui nuit à la fluidité de la lecture, car les liens de l'un à l'autre ne sont pas toujours évidents. J'ai souvent décroché. J'ai régulièrement eu du mal à saisir le sens des propos. Je n'ai par exemple pas compris grand-chose au chapitre dans lequel il parle de ses relations à son père avec un arrière plan oedipien. Fatigue du lecteur ou confusion du texte ? Les passages qui relatent ses débuts d'écrivain ont été particulièrement rasoirs pour moi.
En résumé, je me suis ennuyé. Heureusement, le texte est court. A ceux qui veulent découvrir Ismail Kadaré, grand écrivain qui arrive à bien faire sentir l'étouffoir qu'a été le monde communiste, dans des romans à la frontière d'un réel sinistre et du fantastique, je conseille de commencer par les romans cités ci-dessus.
Le texte est une succession de petits paragraphes, ce qui nuit à la fluidité de la lecture, car les liens de l'un à l'autre ne sont pas toujours évidents. J'ai souvent décroché. J'ai régulièrement eu du mal à saisir le sens des propos. Je n'ai par exemple pas compris grand-chose au chapitre dans lequel il parle de ses relations à son père avec un arrière plan oedipien. Fatigue du lecteur ou confusion du texte ? Les passages qui relatent ses débuts d'écrivain ont été particulièrement rasoirs pour moi.
En résumé, je me suis ennuyé. Heureusement, le texte est court. A ceux qui veulent découvrir Ismail Kadaré, grand écrivain qui arrive à bien faire sentir l'étouffoir qu'a été le monde communiste, dans des romans à la frontière d'un réel sinistre et du fantastique, je conseille de commencer par les romans cités ci-dessus.
Le roman a été publié en 1981, et nous avons pu lire la traduction française à partir de 1998. Ce n'est donc pas un best-seller des années en cours, mais c'est un récit qui vaut vraiment la peine qu'on aille ou retourne le visiter.
D'abord il nous parle de l'Albanie. Ismaïl Kadaré nous fait remonter aux années 1930, sous le règne du roi Zog. Ce nom est celui d'un roi bien réel (et non, ce ce n'est pas une invention d'écrivain qui s'amuse !), mais il est particulièrement bienvenu pour inaugurer la description ironique et impitoyable que fait Kadaré du pouvoir en place et de son fonctionnement. Le sous-préfet est un modèle du genre ! On en retire l'idée d'un petit monde, lâche et bête, obsédé par la recherche de l'espion qu'on voit partout (je n'ai pas de connaissances sur l'époque dont parle Kadaré, mais j'ai l'impression que cette névrose de l'espionnage pourrait bien faire allusion à une Albanie plus actuelle)... Ce monde fait contraste avec une autre Albanie, celle des montagnards, hommes rudes et fiers, loyaux et courageux. Dans cette autre Albanie, le sol du pays compte encore, ce qui nous vaut de beaux moments décrivant les lieux et atmosphères de la montagne albanaise. Envoûtant voyage.
Mais avec qui faisons-nous ce voyage ? Avec deux jeunes scientifiques, Max Roth et Willy Norton, Irlandais de Washington diplômés de Harvard, qui viennent en mission scientifique. Ils découvrent l'Albanie du premier genre, pitoyable, dans la petite ville où ils atterrissent avant de partir dans la montagne. Ils vont se demander comment un peuple si fier peut se laisser diriger par des hommes politiques aussi nuls : « Peut-être que cela tient au fait que certains peuples comme les Albanais, habités de fantasmes et de désirs grandioses, la tête dans les nuages, peuvent, à cause de leur singularité, dès lors qu'il s’agit d'affaire de gouvernement intérieur, se laisser aisément prendre au dépourvu comme un homme surpris dans son sommeil… »
Mais que font ces deux-là en Albanie ? C'est là que se situe le deuxième intérêt fondamental du récit. Ils vont à la rencontre de... Homère ! D'où le titre du roman. Car il ne s'agit de rien de moins que d'étudier l'épopée d'Albanie encore vivante, récitée par ses rhapsodes, en la comparant aux poèmes homériques pour tenter de voir, en comparant le présent vivant et le passé perdu, comment l'épopée homérique a pu se construire, et pouvoir ainsi savoir enfin qui était Homère. Le sujet pourrait paraître ardu, mais par le truchement de ces deux scientifiques passionnés, Kadaré écrit des pages magnifiques sur ce que peut signifier l'épopée, et sur les rhapsodes de la montagne albanaise. Pas nécessaire d'être très cultivé sur la période homérique pour goûter à fond ce qui nous est dit. Et si vous voulez aller plus avant dans ce domaine, il est peut-être possible de lire le dénouement du roman comme une réflexion sur le mystère insondable de la création littéraire. Mais de toute façon suivez la piste du dieu magnétophone, cette invention étrange, par laquelle va venir le dénouement...
Et puis il y a la beauté de l'écriture. Je ne connais pas l'Albanais, mais je crois qu'on peut faire confiance au traducteur, Jusuf Vrioni, qui a tant contribué à faire connaître Kadaré en France. Vous allez pouvoir goûter le style incroyable des rapports de l'indicateur Dul Lasoupente, et vous distraire de l'Albanais des deux scientifiques, qui, l'ayant appris pour lire des textes anciens, le parlent comme nous l'ancien français, car c'est cette traduction-là que nous propose Vrioni..
Bonne lecture !
D'abord il nous parle de l'Albanie. Ismaïl Kadaré nous fait remonter aux années 1930, sous le règne du roi Zog. Ce nom est celui d'un roi bien réel (et non, ce ce n'est pas une invention d'écrivain qui s'amuse !), mais il est particulièrement bienvenu pour inaugurer la description ironique et impitoyable que fait Kadaré du pouvoir en place et de son fonctionnement. Le sous-préfet est un modèle du genre ! On en retire l'idée d'un petit monde, lâche et bête, obsédé par la recherche de l'espion qu'on voit partout (je n'ai pas de connaissances sur l'époque dont parle Kadaré, mais j'ai l'impression que cette névrose de l'espionnage pourrait bien faire allusion à une Albanie plus actuelle)... Ce monde fait contraste avec une autre Albanie, celle des montagnards, hommes rudes et fiers, loyaux et courageux. Dans cette autre Albanie, le sol du pays compte encore, ce qui nous vaut de beaux moments décrivant les lieux et atmosphères de la montagne albanaise. Envoûtant voyage.
Mais avec qui faisons-nous ce voyage ? Avec deux jeunes scientifiques, Max Roth et Willy Norton, Irlandais de Washington diplômés de Harvard, qui viennent en mission scientifique. Ils découvrent l'Albanie du premier genre, pitoyable, dans la petite ville où ils atterrissent avant de partir dans la montagne. Ils vont se demander comment un peuple si fier peut se laisser diriger par des hommes politiques aussi nuls : « Peut-être que cela tient au fait que certains peuples comme les Albanais, habités de fantasmes et de désirs grandioses, la tête dans les nuages, peuvent, à cause de leur singularité, dès lors qu'il s’agit d'affaire de gouvernement intérieur, se laisser aisément prendre au dépourvu comme un homme surpris dans son sommeil… »
Mais que font ces deux-là en Albanie ? C'est là que se situe le deuxième intérêt fondamental du récit. Ils vont à la rencontre de... Homère ! D'où le titre du roman. Car il ne s'agit de rien de moins que d'étudier l'épopée d'Albanie encore vivante, récitée par ses rhapsodes, en la comparant aux poèmes homériques pour tenter de voir, en comparant le présent vivant et le passé perdu, comment l'épopée homérique a pu se construire, et pouvoir ainsi savoir enfin qui était Homère. Le sujet pourrait paraître ardu, mais par le truchement de ces deux scientifiques passionnés, Kadaré écrit des pages magnifiques sur ce que peut signifier l'épopée, et sur les rhapsodes de la montagne albanaise. Pas nécessaire d'être très cultivé sur la période homérique pour goûter à fond ce qui nous est dit. Et si vous voulez aller plus avant dans ce domaine, il est peut-être possible de lire le dénouement du roman comme une réflexion sur le mystère insondable de la création littéraire. Mais de toute façon suivez la piste du dieu magnétophone, cette invention étrange, par laquelle va venir le dénouement...
Et puis il y a la beauté de l'écriture. Je ne connais pas l'Albanais, mais je crois qu'on peut faire confiance au traducteur, Jusuf Vrioni, qui a tant contribué à faire connaître Kadaré en France. Vous allez pouvoir goûter le style incroyable des rapports de l'indicateur Dul Lasoupente, et vous distraire de l'Albanais des deux scientifiques, qui, l'ayant appris pour lire des textes anciens, le parlent comme nous l'ancien français, car c'est cette traduction-là que nous propose Vrioni..
Bonne lecture !
Quel plaisir de se plonger dans ce conte d'un autre temps beaucoup plus fort qu'il n'y paraît au début. Ce petit livre, d'une écriture ciselée bien vivante est en réalité un grand roman qui s'appuie sur une légende, et aborde une notion fondamentale de l'esprit de l'Albanie ancestrale. Il fut interdit de publication dans ce pays en 1980. Le capitaine Stres (écrit Stress page 101, volontaire où coquille d'impression !) est réveillé de bon matin par son adjoint, car il se déroule un événement étrange, une vieille femme, la mère Vranaj et sa fille Doruntine sont à l'agonie. Cette fille est revenue prés de sa mère depuis la veille, elle était mariée et vivait loin de son pays, dans les forêts de Bohème. Ce qui va perturber l'enquête du Capitaine c'est que la fille prétend avoir été ramenée par son frère Konstantin, hors ce frère est décédé à la guerre, comme ses huit autres frères. L'enquête devient difficile d'autant que peu de temps après avoir été interrogées la mère et la fille décèdent. Il faut préciser que les guerres qui sévissaient dans l'Albanie médiévale étaient également porteuses de la peste. Stres et son adjoint doivent déterminer qui est réellement le mystérieux cavalier qui a ramené Doruntine. Ils recueillent des témoignages, ils étudient des archives qu'ils trouvent dans la maison de Vranaj, ils envoient des émissaires dans les auberges qui jalonnent la route que le couple a dû emprunter. Ils se rendent au cimetière vérifier que la tombe de Konstantin n'a pas été ouverte. Le mystère se propage dans la population, et arrive à l'oreille d'un archevêque, car si c'est réellement Konstantin qui a ramené sa sœur alors qu'il était mort il s'agît d'une résurrection, et sur le plan religieux la seule résurrection est celle du Christ. Qui plus est, cette énigme se produit en pleine période de conflit entre l'église chrétienne romaine et l'église orthodoxe qui ont des divergences fondamentales sur la résurrection. Toutes les hypothèses concernant le mystérieux cavalier sont étudiées. Est-ce que Doruntine s'est enfuie de chez son mari avec un amant ? Si c'est réellement son frère Konstantin, y avait-il une liaison incestueuse entre le frère et la sœur ? Après de multiples rebondissements, un colporteur est arrêté, dans un premier temps, après la torture, il avoue avoir ramené Doruntine à sa demande car elle voulait revoir sa famille, d'autant qu'elle ignorait la mort de ses frères, puis il se rétracte. C'est alors que l'affaire prend une tournure politique et religieuse, entre l'Occident et l'Orient, l'Albanie prise entre les deux. Une grande conférence est organisée, le capitaine Stres réussit à faire admettre à tout l'auditoire que c'est bien Konstantin qui a ramené Doruntine, car il avait donné sa parole à sa mère qu'il lui ramènerait sa fille lorsqu'elle lui demanderait, cette promesse se nomme en Albanie « la bessa » et s'est une notion fondamentale pour les albanais. En réalité, il persuade les participants que c'est leur croyance en « la bessa » et la parole donnée qui a fait que Konstantin bien que mort a réussi à ramener sa sœur. L'enquête, bien que d'un autre temps est passionnante et tout le long du roman, le lecteur est tenu en haleine de savoir comment elle va aboutir.
Cet ouvrage rentre dans ce qu'on pourrait appeler le sous-genre "hommage à maman".
On n'en trouve de toute sorte, chacun est unique, mais à force on parvient à trouver des similitudes dans ce genre d'ouvrage.
Oui mais là non, parce qu'on ne parle jamais de la maman mais de la Poupée, et qu'à force que l'auteur passe par mille détours pour narrer sa propre vie, on comprend de mieux en mieux ce qualificatif, d'abord presque méprisant et finalement très touchant.
La vie de cette femme qui semble dépassée par son environnement, cette vie gâchée par une société et un mari qui l'enferme dans un rôle d'épouse et de mère qui ne sort pas de son foyer, et qui de facto est chaque jour un peu plus en marge de sa société. Et pourtant la vie de cette femme qui comprend et ressent plus qu'elle ne laisse paraître.
Une très belle histoire.
On n'en trouve de toute sorte, chacun est unique, mais à force on parvient à trouver des similitudes dans ce genre d'ouvrage.
Oui mais là non, parce qu'on ne parle jamais de la maman mais de la Poupée, et qu'à force que l'auteur passe par mille détours pour narrer sa propre vie, on comprend de mieux en mieux ce qualificatif, d'abord presque méprisant et finalement très touchant.
La vie de cette femme qui semble dépassée par son environnement, cette vie gâchée par une société et un mari qui l'enferme dans un rôle d'épouse et de mère qui ne sort pas de son foyer, et qui de facto est chaque jour un peu plus en marge de sa société. Et pourtant la vie de cette femme qui comprend et ressent plus qu'elle ne laisse paraître.
Une très belle histoire.
Ismaïl Kadaré nous ramène en Albanie, à Gjirokaster, et nous conte les années 30 à travers la vision d'un jeune enfant courant de sa grande maison de pierre à celle des ses voisins, avide de racontars et de jeux d'enfants, et attentif aux superstitions des femmes et aux histoires sordides qui circulent.
Suivant le batifolage permanent du narrateur, le lecteur s'immisce dans la société albanaise, avec ses codes et ses traditions, mais aussi dans le microcosme d'une ville, d'un quartier. Mais le reste du monde n'est jamais bien loin, et les occupants italien et grec se succèdent, au grand dam pour certains, à la grande joie d'autres.
Une jolie fresque pour accompagner une petite virée dans cette très belle ville perchée sur les collines d'une montagne, même si cette lecture ne m'a pas laissé un souvenir impérissable ; j'ai préféré Qui a ramené Doruntine ? du même auteur.
Suivant le batifolage permanent du narrateur, le lecteur s'immisce dans la société albanaise, avec ses codes et ses traditions, mais aussi dans le microcosme d'une ville, d'un quartier. Mais le reste du monde n'est jamais bien loin, et les occupants italien et grec se succèdent, au grand dam pour certains, à la grande joie d'autres.
Une jolie fresque pour accompagner une petite virée dans cette très belle ville perchée sur les collines d'une montagne, même si cette lecture ne m'a pas laissé un souvenir impérissable ; j'ai préféré Qui a ramené Doruntine ? du même auteur.
Que dire? Une impression de tragique, d’absurde. Absurde et tragique, tragique parce qu’absurde. Sur ce plateau d’Albanie, les familles se déchirent et se déciment à qui mieux mieux, respectant la tradition sanglante du Kanun. On suit dans ses pérégrinations funèbres Georg, qui a respecté à la lettre les lois du kanun ( tuer et être tué), s’acquitter du prix du sang. Il croise la route d’un jeune couple en lune de miel, fasciné par ces coutumes ancestrales et barbares. Tous se croisent, se cherchent avec fièvre, se trouvent ou se manquent sur le plateau durant la trêve dont c’est bientôt la fin.
Lorsque la dernière page se tourne, tout est accompli, le drame s’est noué et dénoué, le périple est achevé. Le Plateau, « créé pour des créatures titanesques » a exercé son funeste sortilège.
Lorsque la dernière page se tourne, tout est accompli, le drame s’est noué et dénoué, le périple est achevé. Le Plateau, « créé pour des créatures titanesques » a exercé son funeste sortilège.
L'anxiété est présente tout au long de la lecture du roman.
La dictature possède un outil de contrôle effroyable sur les individus et leur pensée : interpréter les rêves. Le rêve est inconscient et échappe à votre contrôle. Il peut vous trahir s'il est jugé subversif et pouvant menacer l'ordre totalitaire. Il faut entretenir la peur au plus profond des hommes.
Le Palais des rêves est comparable au climat angoissant de George Orwell dans 1984.
Ismaïl Kadaré n'a pas réalisé l'adaptation du roman en français.
Le traduction de Jusuf Vrioni de l'albanais vers le français est remarquable… parce que l'on ne la remarque pas ! L'écriture est d'une telle fluidité que le roman semble avoir été écrit en français
Un livre effrayant sur une bureaucratie qui trouve sa comparaison aujourd'hui avec la Russie de Poutine.
Un Palais des rêves cauchemardesque.
La dictature possède un outil de contrôle effroyable sur les individus et leur pensée : interpréter les rêves. Le rêve est inconscient et échappe à votre contrôle. Il peut vous trahir s'il est jugé subversif et pouvant menacer l'ordre totalitaire. Il faut entretenir la peur au plus profond des hommes.
Le Palais des rêves est comparable au climat angoissant de George Orwell dans 1984.
Ismaïl Kadaré n'a pas réalisé l'adaptation du roman en français.
Le traduction de Jusuf Vrioni de l'albanais vers le français est remarquable… parce que l'on ne la remarque pas ! L'écriture est d'une telle fluidité que le roman semble avoir été écrit en français
Un livre effrayant sur une bureaucratie qui trouve sa comparaison aujourd'hui avec la Russie de Poutine.
Un Palais des rêves cauchemardesque.
Quand la bureaucratie totalitaire se fait onirique, et les affaires de famille des enjeux d'État, le tout au cœur d'une Albanie perdue entre l'influence de l'Empire Ottoman et de l'Europe occidentale.
Un bien étrange mélange de contrastes et d'oxymores que voilà !
Et pourtant, on n'est jamais perdus. Ou plutôt si, mais on se lance en plein dans ce labyrinthe aux côtés du personnage principal, Mark-Alem. Pistonné par sa famille, les puissants Quprili, ce jeune diplômé obtient un poste au Tabir Serail : le Palais des rêves. Il découvre peu à peu le fonctionnement et les étrangetés de ce mystérieux organisme d'état qui a pour but de récolter les rêves des sujets, les trier, les analyser, et d'en extraire des Maîtres-rêves contenant des grandes prophéties.
À mesure qu'il monte les échelons, Mark-Alem se métamorphose. Le monde réel lui semble moins vif en contraste avec le monde si coloré des rêves, et le temps s'écoule différemment. Il ne comprend toujours pas à quoi sert ce qu'il fait, mais comme les autres le respectent et le craignent, il endosse le rôle pour ne pas perdre la face. Et c'est ainsi que tient chaque maillon de cette bureaucratie totalitaire.
L'ambiance est mystérieuse et pesante, tout en étant servie par un ton caustique. Comme Mark-Alem, on s'étonne de tout, on veut absolument en apprendre plus... mais on a aussi peur d'en apprendre trop.
La bureaucratie se ressent dans chaque recoin du Palais. Ses longs couloirs gris et froids alignent des rangées régulières et symétriques de portes sans numéro. Derrière celles-ci les employés s'acharnent sur des tâches fastidieuses dont ils sont incapables de percevoir la finalité. Tout le monde agit comme « un peu à côté », étranges et l'air absent...
Grâce ce genre de petits détails amoncelés, l'univers décrit est étonnamment tangible alors que l'on frôle sans cesse le registre absurde. En effet, cette organisation redoutable mobilise une telle foule, chargée de la surveillance de ce qui a tout juste l'air de n'être que du du vent, juste des rêves ! Du non-sens auquel la bureaucratie insuffle du sens, et ce faisant à elle-même aussi.
On pourrait être tenté de croire que les rêves prédisent réellement l'avenir. On nous dit même que l'interprétation des rêves seraient aussi rigoureux que l'algèbre — soit disant, car on nous dit aussi que l'on fait ce que l'on veut tant qu'on use de créativité !
Mais prophétie ou pas, tout le palais donne surtout l'impression de n'être rien d'autre qu'une façade pour des machinations politiques. Aux intrigues du Sultan s'opposent celles de la famille Quprili, auxquelles viennent se greffer les ingérences du lobby du cuivre.
Cependant, cet aspect politique n'est pas très explicité, on a très peu de détails sur les complots qui se trament alors que j'aurais vraiment trouvé intéressant de creuser cet aspect du Palais et de son interaction avec l'extérieur.
En tout cas en interne, on se rend assez vite compte — mais déjà trop tard — que tous les coups sont permis : séquestration et coup de pression sur ceux qui ne rêvent pas comme il faut, la surveillance constante de chacun par chacun, les conséquences terribles d'une erreur ou d'un travail trop bien mené.
Enfin, c'est aussi une histoire de famille, et à travers elle, d'un pan de l'Albanie.
Les Quprili sont une famille ancienne, ayant compté maints vizirs, généraux et ministres depuis l'an 1666. Ils cultivent une culture familiale forte, avec des coutumes et la mémoire des faits historiques de leur famille. (Un passage m'a d'ailleurs beaucoup amusé, où lors d'un dîner de famille la moindre anecdote sur un lointain parent leur semble incroyablement plus intéressante que n'importe quoi d'autre.)
Cependant, ils ont dû quitté leurs terres albanaises pour s'établir à la capitale de l'Empire, siège du pouvoir. L'impérialisme apparaît alors au travers de ce territoire devenu simple province, de la langue imposée (Köprülü en orthographe ottomane), et de la mémoire interdite du passé national. Et cet impérialisme prétend pouvoir s'imposer jusqu'aux rêves.
J'ai trouvé toute cette partie sur la culture familiale des Quprili très intéressante, et plus largement toute cette question de l'identité nationale lorsqu'il n'y a pas ou plus de nation. Sans mon inculture de l'Histoire des Balkans, j'aurais sans doute repéré encore plus d'éléments intéressants, notamment des parallèles avec la réalité. Ce livre me motive à me guérir de cette inculture !
Ce fut donc une lecture agréable. Dépaysante de par son imprégnation par la culture albanaise, elle a toutefois d'un côté universel, ou en tout cas familier avec cette satire de la bureaucratie, des lobbys et des magouilles des gouvernants. J'ai beaucoup apprécié ce mélange bien dosée entre onirisme, dystopie et satire.
Je n'ai cependant pas compris en profondeur toutes les thématiques abordées. Je trouve surtout dommage qu'on ne soit jamais vraiment entré dans le cœur des complots politiques, sans quoi l'histoire aurait pu prendre une ampleur beaucoup plus importante. Mais cela n'avait pas l'air d'être la démarche voulue par l'auteur. À l'avenir, je me laisserais bien tenter par d'autres romans d'Ismaïl Kadaré, avec l'espoir d'y retrouver ce ton et ce genre d'univers si particuliers.
Un bien étrange mélange de contrastes et d'oxymores que voilà !
Et pourtant, on n'est jamais perdus. Ou plutôt si, mais on se lance en plein dans ce labyrinthe aux côtés du personnage principal, Mark-Alem. Pistonné par sa famille, les puissants Quprili, ce jeune diplômé obtient un poste au Tabir Serail : le Palais des rêves. Il découvre peu à peu le fonctionnement et les étrangetés de ce mystérieux organisme d'état qui a pour but de récolter les rêves des sujets, les trier, les analyser, et d'en extraire des Maîtres-rêves contenant des grandes prophéties.
À mesure qu'il monte les échelons, Mark-Alem se métamorphose. Le monde réel lui semble moins vif en contraste avec le monde si coloré des rêves, et le temps s'écoule différemment. Il ne comprend toujours pas à quoi sert ce qu'il fait, mais comme les autres le respectent et le craignent, il endosse le rôle pour ne pas perdre la face. Et c'est ainsi que tient chaque maillon de cette bureaucratie totalitaire.
L'ambiance est mystérieuse et pesante, tout en étant servie par un ton caustique. Comme Mark-Alem, on s'étonne de tout, on veut absolument en apprendre plus... mais on a aussi peur d'en apprendre trop.
La bureaucratie se ressent dans chaque recoin du Palais. Ses longs couloirs gris et froids alignent des rangées régulières et symétriques de portes sans numéro. Derrière celles-ci les employés s'acharnent sur des tâches fastidieuses dont ils sont incapables de percevoir la finalité. Tout le monde agit comme « un peu à côté », étranges et l'air absent...
Grâce ce genre de petits détails amoncelés, l'univers décrit est étonnamment tangible alors que l'on frôle sans cesse le registre absurde. En effet, cette organisation redoutable mobilise une telle foule, chargée de la surveillance de ce qui a tout juste l'air de n'être que du du vent, juste des rêves ! Du non-sens auquel la bureaucratie insuffle du sens, et ce faisant à elle-même aussi.
On pourrait être tenté de croire que les rêves prédisent réellement l'avenir. On nous dit même que l'interprétation des rêves seraient aussi rigoureux que l'algèbre — soit disant, car on nous dit aussi que l'on fait ce que l'on veut tant qu'on use de créativité !
Mais prophétie ou pas, tout le palais donne surtout l'impression de n'être rien d'autre qu'une façade pour des machinations politiques. Aux intrigues du Sultan s'opposent celles de la famille Quprili, auxquelles viennent se greffer les ingérences du lobby du cuivre.
Cependant, cet aspect politique n'est pas très explicité, on a très peu de détails sur les complots qui se trament alors que j'aurais vraiment trouvé intéressant de creuser cet aspect du Palais et de son interaction avec l'extérieur.
En tout cas en interne, on se rend assez vite compte — mais déjà trop tard — que tous les coups sont permis : séquestration et coup de pression sur ceux qui ne rêvent pas comme il faut, la surveillance constante de chacun par chacun, les conséquences terribles d'une erreur ou d'un travail trop bien mené.
Enfin, c'est aussi une histoire de famille, et à travers elle, d'un pan de l'Albanie.
Les Quprili sont une famille ancienne, ayant compté maints vizirs, généraux et ministres depuis l'an 1666. Ils cultivent une culture familiale forte, avec des coutumes et la mémoire des faits historiques de leur famille. (Un passage m'a d'ailleurs beaucoup amusé, où lors d'un dîner de famille la moindre anecdote sur un lointain parent leur semble incroyablement plus intéressante que n'importe quoi d'autre.)
Cependant, ils ont dû quitté leurs terres albanaises pour s'établir à la capitale de l'Empire, siège du pouvoir. L'impérialisme apparaît alors au travers de ce territoire devenu simple province, de la langue imposée (Köprülü en orthographe ottomane), et de la mémoire interdite du passé national. Et cet impérialisme prétend pouvoir s'imposer jusqu'aux rêves.
J'ai trouvé toute cette partie sur la culture familiale des Quprili très intéressante, et plus largement toute cette question de l'identité nationale lorsqu'il n'y a pas ou plus de nation. Sans mon inculture de l'Histoire des Balkans, j'aurais sans doute repéré encore plus d'éléments intéressants, notamment des parallèles avec la réalité. Ce livre me motive à me guérir de cette inculture !
Ce fut donc une lecture agréable. Dépaysante de par son imprégnation par la culture albanaise, elle a toutefois d'un côté universel, ou en tout cas familier avec cette satire de la bureaucratie, des lobbys et des magouilles des gouvernants. J'ai beaucoup apprécié ce mélange bien dosée entre onirisme, dystopie et satire.
Je n'ai cependant pas compris en profondeur toutes les thématiques abordées. Je trouve surtout dommage qu'on ne soit jamais vraiment entré dans le cœur des complots politiques, sans quoi l'histoire aurait pu prendre une ampleur beaucoup plus importante. Mais cela n'avait pas l'air d'être la démarche voulue par l'auteur. À l'avenir, je me laisserais bien tenter par d'autres romans d'Ismaïl Kadaré, avec l'espoir d'y retrouver ce ton et ce genre d'univers si particuliers.
Dualité de la gloire entre écrivain et tyran, ce livre conte les treize versions d'un coup de fil historique, et passe par une délicieuse description de faits historiques a priori insignifiants, nous plongeant dans un milieu passionnant bien qu'archi-documenté. Un récit mystérieux et un peu barré, comme Kadaré en a le secret, nappé d'une agréable couche d'érudition.
L'histoire se déroule dans les montagnes albanaises où sévit la loi du Kanun autrement dit la vendetta. Nous suivons le personnage de Gjorg qui, contraint de venger son frère aîné, tue un homme de la famille ennemie. Il entre alors dans la trêve de 30 jours où il doit effectuer un voyage pour aller payer l'impôt du sang. Il subit la fatalité de son destin et réalise que sa vie s'arrêtera courant avril, date à laquelle les proches du morts reprendront sa vie. En parallèle nous suivons le voyage de noce qu'un couple de la ville effectue dans la région. L'homme est un écrivain qui est fasciné par les coutumes de ces montagnards, sa femme quant à elle devient de plus en plus léthargique au contact de cet environnement morbide, surtout lorsqu'au cours du périple elle croise le regard du jeune condamné Gjorg.
Ismail Kadaré réussi un très beau roman où il rend compte de cette tradition de vendetta qui a perduré pendant des siècles et a décimé des milliers de familles de façon totalement absurde. L'ambiance de la première partie du roman m'a fait penser à celle du désert des tartares de Buzatti avec la description d'une lande à la fois belle mais désolée et de son climat inquiétant et étrange. Les personnages et l'analyse psychologique de ceux-ci est également réussie.
Ismail Kadaré réussi un très beau roman où il rend compte de cette tradition de vendetta qui a perduré pendant des siècles et a décimé des milliers de familles de façon totalement absurde. L'ambiance de la première partie du roman m'a fait penser à celle du désert des tartares de Buzatti avec la description d'une lande à la fois belle mais désolée et de son climat inquiétant et étrange. Les personnages et l'analyse psychologique de ceux-ci est également réussie.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Ismaïl Kadaré
Quiz
Voir plus
LES ROMANS DE KADARE
L'arrivée de deux Irlandais new-yorkais, Max Roth et Willy Norton, dans la ville de N., au coeur de l'Albanie, fait l'effet d'une bombe dont les intéressés auraient bien étouffé l'explosion. Le sous-préfet de N. partage bien sûr l'avis de son ministre : il n'est pas exclu que les deux étrangers soient des espions...
Le grand hiver
Le général de l'armée morte
L'année noire
Le dossier H
10 questions
9 lecteurs ont répondu
Thème :
Ismaïl KadaréCréer un quiz sur cet auteur9 lecteurs ont répondu