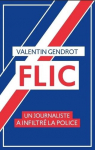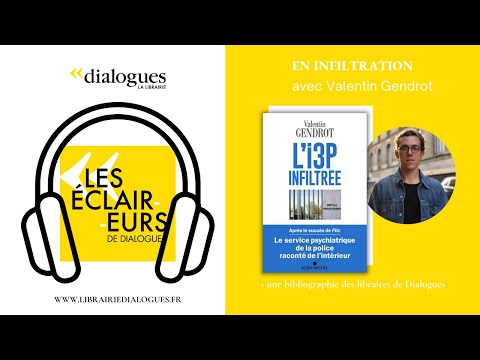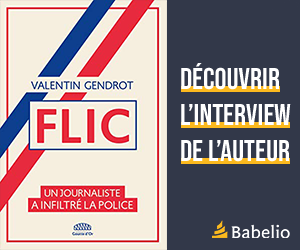Né(e) : 1988
Valentin Gendrot, alias Thomas Morel, est un journaliste et auteur.
Diplômé en 2011 de l'IUT de journalisme de Bordeaux Montaigne, il fait ses débuts dans la presse locale. Heurté par l’opacité des grandes entreprises et par le sort que celles-ci réservent à leurs employés peu qualifiés, il décide d’infiltrer durant dix-huit mois cinq d’entre elles, dans le nord de la France (Cémoi, Clictel, Ranger, Créatis et Toyota) dans le but de prouver la précarisation et l’ubérisation de l’emploi.
Admirateur de l’écrivain et journaliste d’investigation allemand Günter Wallraff (1942), il décide de suivre son chemin à l’été 2014. Cette plongée le conduit à publier "Les Enchaînés. Un an avec des travailleurs précaires et sous-payés" (2017) sous le pseudonyme de Thomas Morel.
Valentin Gendrot est le premier journaliste à avoir infiltré la police pendant près de deux ans. Après avoir suivi une formation de 3 mois à l’école de police de Saint-Malo, il est nommé ADS (adjoint de sécurité), policier contractuel avec permis de port d’armes et droit d’appréhender.
Après une première affectation de quinze mois à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, il intègre le commissariat du 19ème arrondissement, un quartier populaire de l’Est parisien. Là, où il souhaitait aller pour exercer son métier de journaliste et témoigner. Il y restera 6 mois.
Il en a tiré un livre intitulé "Flic" (2020).
Ajouter des informations
« Notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie », écrivait le grand reporter Albert Londres. Notre invité du jour marche sur ses traces. Journaliste indépendant, spécialisé dans l'infiltration, Valentin Gendrot est notamment connu pour avoir infiltré le commissariat du XIXe arrondissement de Paris. Il en a tiré un livre, intitulé Flic, un récit urgent qui dévoile les coulisses d'une profession souvent accusée de violence, de racisme et au taux de suicide anormalement élevé. À l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage, L'I3P infiltrée, il nous parle de cette méthode journalistique singulière et engagée, qui consiste à se mettre dans la peau des autres pour raconter leur vie. À la suite de cet entretien, nous vous proposons quelques conseils de lectures qui sont autant d'invitations à plonger dans d'intenses expériences journalistiques, et aiguiser notre regard sur le monde. Bibliographie : - L'I3P infiltrée, de Valentin Gendrot (éd. Albin Michel) https://www.librairiedialogues.fr/livre/21346729-l-i3p-infiltree-le-service-psychiatrique-de-la--valentin-gendrot-albin-michel - Flic, de Valentin Gendrot (éd. Goutte d'Or) https://www.librairiedialogues.fr/recherche/?q=flic+gendrot - Les Enchaînés, de Thomas Morel (éd. Pocket) https://www.librairiedialogues.fr/livre/15269104-les-enchaines-thomas-morel-pocket - Tête de Turc, de Günter Wallraff (éd. La Découverte) https://www.librairiedialogues.fr/livre/3775940-tete-de-turc-gunter-wallraff-la-decouverte - Dans la peau d'un maton, d'Arthur Frayer (éd. J'ai lu) https://www.librairiedialogues.fr/livre/2030652-dans-la-peau-d-un-maton-arthur-frayer-j-ai-lu - Tokyo Vice, de Jake Adelstein (éd. Points) https://www.librairiedialogues.fr/livre/11738606-tokyo-vice-jake-adelstein-points - Les Humbles ne craignent pas l'eau, de Matthieu Aikins (éd. du sous-sol/Seuil) https://www.librairiedialogues.fr/livre/20370616-les-humbles-ne-craignent-pas-l-eau-un-voyage-i--matthieu-aikins-editions-du-sous-sol
Page 14, Les Arênes, 2017.
– J'avais eu mon bac ES. Et puis, j'ai fait une année de maths à Lille 3, à la fac. J'ai eu mon premier semestre, pas l'autre. J'ai arrêté. Et mon père m'a dit : « Je veux bien t'arrêtes mais pas que tu restes à rien faire. » Alors, deux mois après, j'étais chez Toyota.
Puis, la rencontre avec sa compagne, leur désir d'enfant, l'achat de la maison l'ont peu à peu ancré dans cet emploi devenu durable qu'il n'aime évidemment pas, qui l'empêche, dit-il, de penser. Il sourit en clignant de l'œil.
– Des fois maintenant, je fais des fautes de conjugaison. Ma femme me dit : « Bah, qu'est-ce-qui t'arrive ? » Avant, c'est moi qui corrigeais ses fautes, là, c'est l'inverse...
Sur l'écran, la France vient de marquer un second but, celui de la victoire. Matteo a regagné sa chambre car il doit se lever tôt le lendemain. Son petit ballon de foot est resté au milieu du salon. Au grand dam de sa femme, Fabien a repris la clope. Il en allume une, emplissant l'espace de ses volutes de fumée. L'œil fixé sur l'écran, il soupire doucement.
– Putain, heureusement que j'ai ma femme et mon fils.
Pages 260-261, Les Arênes, 2017.
Simone Weil, La Condition ouvrière, Gallimard, 1937
Page 9, Les Arênes, 2017.
Pages 58-59, Les Arênes, 2017.
Philip Roth ou Paul Auster
La tache ?
9 lecteurs ont répondu