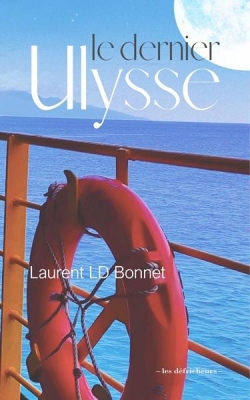Laurent LD Bonnet/5
9 notes
Résumé :
Adaptation contemporaine d'une œuvre parue en 2082 aux éditions Vandoven, ce roman se déroule dans un monde qui pourrait être le nôtre, racontant l'étrange voyage d'un homme qui participe, sans le savoir, au bouleversement du monde éditorial :
Alexandre Mauvalant, réputé pour ses poèmes et ses nouvelles, n'est jamais parvenu à écrire de roman. Son éditeur Paul Vandoven n'en démord pas depuis vingt ans : cet auteur possède la fibre d'un grand romancier.
>Voir plus
Alexandre Mauvalant, réputé pour ses poèmes et ses nouvelles, n'est jamais parvenu à écrire de roman. Son éditeur Paul Vandoven n'en démord pas depuis vingt ans : cet auteur possède la fibre d'un grand romancier.
>Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le dernier UlysseVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
Je ne crois pas, moi, aux vertus foncièrement métamorphiques du trop supposé et admis « adieu suprême des mouchoirs ». Tout voyage n'est qu'une confirmation de soi, parce qu'il est fondé sur un préjugé, préjugé selon lequel le départ et l'aventure produiront un changement d'identité. Or, c'est une contradiction et même une aporie de vouloir qu'on puisse vraiment s'altérer en partant d'une pensée à ce point fixe et grossière : c'est comme d'estimer que l'océan est le lieu de l'onirisme et de la liberté, et s'y jeter avec au cou la grosse pierre d'une conception si étroite et si bête.
J'ai déjà longuement parlé de la manière dont un paradigme lourdement installé dans une perception et dans une intention fige la quantité de ce qu'on peut profondément apprendre et extraire d'une expérience – j'ai développé cette réflexion dans un article intitulé La Comédie de Charleroi ou La Complaisance précède l'Inexpérience. Tout ce qu'on aborde ainsi avec une présomption ou une prévention tirée de la morale populaire risque fort de ne faire que confirmer l'opinion avantageuse et favorable qu'on suppose de cette expérience – pour ne pas dire que ça la réalise toujours. On voudrait flatteusement se prouver de l'aptitude à la variation de soi, alors on empreinte la voie stéréotypée du déplacement, et, pour atteindre à cette sorte de spiritualité qu'on associe au cours léger du bateau et à la blancheur de la voile, on s'appuie sur le paradigme lourd et ancré selon lequel l'exotisme et l'évasion constituent des moyens essentiels. On veut aller intellectuellement loin, on s'arrime d'emblée à un fardeau mental. On prévoit qu'on sortira grandi, alors on s'étire et on se juge sorti de son ancienne mesure. C'est comme ces gens qui, après avoir appris que le soleil comporte de la vitamine D, sont tout de suite plus gentils quand il fait beau, et se sentent galvanisé par la lumière dès le premier photon. On obtenait sans doute autrefois le même résultat avec un bon clystère, pourtant le clystère n'avait nul effet logique sur la santé. On voyage, alors on se sent mieux et meilleur ; même, on se sent mieux et meilleur, si l'on s'examine bien, un peu avant d'avoir voyagé, dès la préparation, en fait. le voyage est un superflu au changement qu'on espère en extraire : rien que l'espérance du changement fait le changement.
Idem pour la rencontre. Toute personne qu'on découvre avec la conviction qu'on en sera modifié n'est qu'un prétexte formé d'avance à se valoriser de ses facultés de compréhension et d'empathie. Frédéric Moreau à bord de la Ville-de-Montereau adore Mme Arnoux aussitôt qu'il la voit parce qu'il s'ennuyait. On prépare d'abord sa vertu, et l'on feint ensuite de s'apercevoir qu'on l'a trouvée par hasard. Ne va-t-on pas soudain s'ouvrir aux autres, devenir cosmopolite, entendre enfin de la pensée même après avoir cessé de s'instruire et de s'édifier pendant vingt ans ? Et comment un homme qui craint fort de quitter sa maison sans sa piqûre, et qui accuse tout le monde de ne pas la prendre, deviendrait-il tout à coup un moindre penseur de l'Altérité ? Allons ! La vérité, c'est que, pour se sentir si bon, on n'avait pas besoin de découvrir quelqu'un. On aurait pu aussi bien se servir d'un livre ou simplement de son imagination : il n'est nulle âme qu'on n'aurait pas pu concevoir en esprit. Ils n'ont pas besoin de changer, les voyageurs : ils ont besoin de se croire changés. Ceux qui vous disent perpétuellement, en voyageant, avoir fait des « découvertes » en général sont des gens étonnamment dénués d'inspiration. Il ne leur semblait tout bonnement pas que telle chose ou tel être existât, et, après l'avoir vue, ils vivront de nouveau exactement comme s'ils en doutaient encore, mais fiers d'être « allés ». On appelle ça « l'expérience », à ce qu'il paraît ; l'expérience, c'est de se déplacer beaucoup dans l'espace pour que les globes oculaires voient beaucoup de couleurs et de formes, et puis rentrer chez soi avec une très vague mémoire de cet espace, de ces couleurs et de ces formes. Un pareil homme vous est supérieur, dit-on, parce qu'il a mal compris ce qu'il a vu directement, tandis que vous êtes son obligé au prétexte que vous avez très bien compris ce que vous n'avez pas vu ou eu besoin de voir en propre. Dans leur quotidien, vos maîtres enferment carrément leur pensée, et puis ils la rouvrent, en gros, provisoirement le temps des vacances, et tout cet argent ou ce temps qu'ils ont dépensé sert à prouver qu'ils vous dominent, que vous ne savez pas, vous, parce que vous n'avez pas l'expérience. C'est ainsi qu'une infirmière de leur connaissance aura toujours plus raison que les statistiques irréfragables que vous apportez de l'hôpital : elle a vu, et donc vous êtes un misérable d'aller sur de telles brisées de « l'expérience ». Il se peut qu'ils tirent de leur témoignage l'impression forte d'une révélation, mais ce sentiment provient principalement de leur obtusion normale. Ils se font une occasion d'ouvrir les yeux, et ils se surprennent tout à coup à voir de la lumière. Ils sont éblouis, et pourquoi ? Parce que pendant une semaine ou deux ils ont ouvert les paupières. Ils ne peuvent imaginer que, toute l'année, vous gardiez, vous, les yeux décillés pour tout contempler : vous vous vantez. Et puis, « ce n'est pas l'expérience, ça ». Vous n'avez pas la mine émerveillée des gens qui vivent des expériences, n'est-ce pas ?
En réalité, il n'y a guère plus de raison d'épanouir sa mentalité en prenant le bateau ou l'avion et en explorant différents pays qu'en adhérant à un club de billes. Parce que, partout à travers le monde, les gens sont ternes et opiniâtres – cela inclut aussi bien le moine d'Asie qui perçoit tout avec les oeillères de sa religion que le jouisseur-né américain qui vous montre sur un yacht combien on peut relativiser la douleur quand le moteur vrombit et hurle. Non, les gens n'ont rien à enseigner à quelqu'un qui serait déjà en mesure de se renseigner par lui-même, ce qui n'est pas encore trop difficile, je pense, à notre époque. Il n'existe plus de sujets de sagesse ; même un professeur est peu disposé à vous expliquer ce qu'il sait, parce qu'il résout et limite sa pensée à fort peu de choses, comme tout le monde. Alors, je sais bien qu'on me reprochera le fameux « relativisme culturel », doctrine selon laquelle, en se rapprochant des modes de vie plus rudes ou philosophes, on réapprend les privilèges de notre civilisation, mais c'est encore décidément un cruel manque d'imagination, tout ça. Est-ce que le Moderne ne se représente pas périodiquement ce que serait sa vie sans les écrans et toutes sortes de commodités ? et est-ce donc qu'il a généralement si peu d'ouverture et d'éveil qu'il faille une occasion de déplacement pour qu'il se figure ce qui n'est, là, point à sa portée ? – est-ce que les films ne lui donnent pas rien qu'un peu l'élan de ce qu'il faut faire pour se transporter virtuellement en dehors de sa propre mentalité ? Moi si. Tous ces voyageurs n'ont manifestement pas la moindre aptitude, dans l'existence ordinaire, à se transposer en esprit. Voudra-t-on alors me faire croire que parce qu'ils sont au Tibet ou en Uruguay et se mêlent aux indigènes, ces gens ont soudain trouvé en eux cette ressource abstractive qu'ils n'avaient pas dans le quotidien de leur pays natal ? Ce que je veux dire, c'est : est-ce qu'on trouve que ces gens, quand ils sont chez eux et en compagnie de leurs collègues, sont déjà capables de se mettre à leur place ? Alors pourquoi supposer qu'ils le feront mieux à dix mille kilomètres de chez eux et parmi des gens auprès de qui ils sont tout à fait disparates ? Non pas, ce n'est pas même seulement vraisemblable, une telle dichotomie : tout ce qu'ils explorent sur leur lieu de villégiature, c'est le tout petit cercle auquel leur permet d'accéder leur pensée. Ils vont ailleurs contempler paysages et cultures… avec les yeux d'un esprit fermé. Ce sont des étrangers en voyage.
Et la durée n'y fait rien : aujourd'hui, on ne s'approprie vraiment rien par la réflexion, on s'imprègne, voilà tout. Six ans au Brésil vous apprennent à parler argentin, et, si vous êtes influençable, vous vous laissez gagner d'une spiritualité socialiste, de moeurs et de coutumes, vous finissez par prendre plaisir à manger tel plat à telle heure – c'est vrai. Mais votre esprit au long de ce processus n'est pas plus empli ; il n'est pas plus grand. On peut exister ainsi un temps interminable même en France, et ne pas savoir de quoi est bâti un véritable esprit français – et c'est le lot commun. La curiosité même n'y suffit pas : on peut tout regarder avec un oeil avide autant que vide. Oui, on sent un pays sans doute, on l'éprouve et on peut même l'assumer : vos doigts pareillement sortent plissés du dont ils ont absorbé l'eau. Mais vos doigts n'en sont pas meilleurs. Tout au mieux, dans vingt ou cent générations, ils seront palmés, c'est-à-dire mieux adaptés. C'est pourquoi on naît musulman en Afrique du Nord, mais on n'est pas plus intelligent pour autant parce qu'on sait son Coran. le voyage ni sa durée ne fait l'esprit. Il faudrait, pour cela, un sens automatique propre à ne retenir que le Grand et le Juste.
le dernier Ulysse – qu'il faut, je crois, écrire sans la première majuscule – serait un récit de voyage et de formation là où il n'existe point – ou disons : presque jamais – de formation par le voyage. Ma théorie ainsi précédemment exposée, je trouve que l'intrigue même la vérifie. C'est la raison pourquoi je n'ai pas terminé ce livre, je n'ai pas terminé le voyage de ce livre, quitté page 239, parce que l'aventure de ce voyage ne semblait ne m'apprendre rien. Alexandre Mauvalant, personnage déjà assez médiocre et imbécile, n'évolue pas. Pas vraiment. Pour être précis, je dirais qu'il ne tire de ses pérégrinations que la facette la plus exposée de tout ce dont il était déjà disposé à croire.
Il regarde, oui. Il n'observe jamais en-dehors de ce qu'il s'apprête à trouver. La mesure d'une expérience inutile – inutile pour le véritable vertige de l'esprit – c'est ce qu'on cherche strictement : Mauvalant n'est jamais surpris, jamais. Il paraît tel le scientifique qui expérimente uniquement selon l'ordre de ce qu'il est en volonté de prouver : tout ce qu'il découvre s'inscrit dans un paradigme antécédent. C'est un peu comme si, sur une planète où ce qu'il y aurait de plus authentique à voir se situait dans le spectre lumineux des infrarouges ou des ultraviolets, un homme se rendait avec ses yeux ordinaires. le protagoniste n'est toujours conditionné que par la conformation de ce qu'il peut voir et entendre – et entendre. C'est en quelque sorte un Occidental qui va en Afrique avec la volonté farouche d'explorer la question de savoir comment les gens vivent en utilisant des billets de banque – transposer cette idée à tous les domaines de l'esprit.
Mauvalant ne voyage pas : il s'enorgueillit de voyager, du moins il se valorise.
C'est piteux vu d'une certaine distance : il n'apprend rien. Tout ça pour rien.
C'est, dans le récit, un écrivain, déjà, qui paraît sans grande sagesse – il me fait, à vrai dire, penser à certains de mes amis d'enfance qui portaient toujours des ciels dans la parole et dans les actes une ridicule immaturité. Après une émission anodine, il reçoit la lettre brève et légèrement mièvre d'une femme qui lui propose une rencontre, et il accepte aussitôt en se fixant la contrainte – chevaleresque, chevaleresque jusqu'à la naïveté – de parcourir tout le trajet à pied jusqu'à elle, et sans s'interdire, au hasard de ses intérêts, des escales de plusieurs mois.
C'est une sorte de marathon, voilà ; c'est le même état d'esprit que le coureur. Il est vide alors il remplit. Il lui faut perdre du temps pour se croire l'illusion de s'y consacrer. On connaît beaucoup de gens qui circonscrivent toute leur expérience au sport : ce sont des « voyageurs du sport », ils prétendront avoir beaucoup appris de cette inanité. Idem, le voyageur tout court.
Mauvalant ne connaît pas cette femme, Anna : elle est un prétexte. Elle ne lui a rien écrit que de très élémentaire. Il est un peu en panne d'inspiration, voilà tout. Un commentateur avisé comprend sans peine qu'il ne fait ce voyage, en s'imposant de telles difficultés, non pour elle, dont il n'a pas la moindre idée, dont la lettre ne permet même pas d'augurer la valeur, mais pour se donner de l'allure – ça sert aussi au roman, bien sûr. Il affecte un héroïsme : c'est un homme qui aime Conrad et London, qui ont voyagé, il aime aussi Nietzsche, il suppose donc que le voyage instruit et rend fort, sans songer que la plupart des marins sont des crétins comme les autres et peut-être plus avinés. Il veut devenir meilleur. Il ne le deviendra pas encore, page 239 ; il ne l'est pas devenu ne serait-ce qu'un peu davantage. Il est parti avec cette idée que voir à l'extérieur développe et épanouit : préjugé commun, stérile, et contre-productif. Il faut plutôt voir en soi-même, voir le vrai de l'homme : sait-on que Nietzsche était souvent sinon la plupart du temps à peu près aveugle ? Certes, parfois le temps qu'on passe à ne rien faire sur des routes incite à réfléchir. Mais je ne suis pas sûr que Mauvalant ait, lui, sur ce point, progressé.
Ah ! autre chose, puérile, puérile ! moderne, contemporaine, contemporaine ! et que j'ai oubliée de dire : Mauvalant va certes voir une femme, une femme avec ses promesses bien sûr, une femme qui l'attend et qui, tout de même, après un tel périple – elle vit aux Canaries –, aurait du mal à ne pas lui exprimer à la fin sa « reconnaissance »… oui, mais Mauvalant est impuissant suite à une opération de la prostate. Pourquoi donc ce but, alors : une femme ?
Triste. Sinistre. Bien contemporain. Et contemporain, dis-je, tout justement parce que la contemporanéité est le lieu où l'enfant-citoyen est incapable de se refuser un caprice, d'abdiquer un bonheur « normal », en un mot : de se résoudre. Il lui faut par d'autres biais obtenir ce qu'il souhaite, faute de savoir s'abstenir d'un désir : il veut encore et toujours l'égalité à laquelle sa conformation même l'interdit. Lors même qu'il n'est plus accessible à certaines jouissances, il veut quand même obtenir le droit d'y prétendre. Alors, Mauvalant persiste à vouloir l'amour de la femme et à vouloir cet amour aussi de façon sexuelle. C'est ce qui fonde, chez « l'immoral » lecteur comme moi, l'impression de suivre pas à pas l'itinéraire d'un handicapé sans puissance, mais sans puissance spirituelle, d'un handicapé dont la pensée plutôt que le corps est handicapé, d'un personnage veule, adolescent-né, mais que l'auteur cependant exhausse un peu comme un exemple ou une incarnation. Je ne prétends pas qu'un tel homme ne saurait être « puissant » en esprit, je suis presque sûr d'avoir rencontré de grands hommes souffrant de dysfonctionnement érectile, et je soupçonne que Nietzsche, que j'admire comme on sait, en faisait partie –, mais je trouve qu'un handicapé qui focalise tout son esprit sur son mal au point de ne jamais cesser de chercher un palliatif à la fois pour le cacher et pour en jouir manque décidément de relativisme et de grandeur : ce handicapé produit un sentiment de misère et de perpétuel inaccompli, de stagnation principielle. C'est un homme qui s'est trompé d'objectif, qui ne conquiert rien, qui ne peut aboutir, parce que sa quête est initialement mal formulée, contradictoire et insoluble comme une équation qui contient intrinsèquement quelque erreur axiomatique. Qu'à la limite, Mauvalant voyage dans l'espoir de s'enivrer du voyage, je veux bien, mais que la destination soit une femme à assouvir, lui qui ne peut précisément pas proposer un plein assouvissement, je veux dire âme et corps, n'est-ce pas là, parmi l'immense somme des plaisirs terrestres, aller chercher bêtement celui qui lui produira la plus sûre frustration ? – qu'il dise au moins à Anna son problème, et le voilà décomplexé tout à coup, mais non ! C'est comme quand un homme contemporain, qui n'a jamais pensé encore à avoir d'enfant, apprend inopinément sa stérilité : à quoi pense-t-il ? à fonder le reste de son existence sur le manque ou le souhait d'une paternité. Mais quoi ? il y a beaucoup mieux à faire et à penser au monde, quand on est impuissant ou stérile, que les femmes ou les bébés ! Moi, par exemple, avec le sale coeur que j'ai, est-ce que je m'en sers de prétexte pour vouloir soudain accomplir de grands efforts physiques ou pour susciter les sentiments d'une femme compatissante ?
… Où la contemporanéité, c'est le refus imbécile de renoncer même à l'illégitime. Dès le commencement, ce périple évoque l'inscription d'un cul-de-jatte à un marathon pour valides ou d'un muet sans langue à un grand concours de chant. Je pardonne, moi, toutes les maladies, sauf les maladies de la volonté et du jugement – et je me résous à n'être fait ni pour le sport ni pour être aimé.
Il faut voir notamment dans ce récit la façon systématique, endémique pour ainsi dire, dont un Contemporain court aux symboles, symboles qui ne sont pas la réalité, symboles qui sont la superficialité la plus antilittéraire du réel. Mauvalant d'abord suit géographiquement le parcours physique d'auteurs qu'il aime, puis il se fie aux réputations des villes qu'il est censé aimer, puis il voit dans les êtres qu'il fréquente les exactes vertus que, depuis son départ, il a toujours aimées.
On en revient exactement à mon observation liminaire. le dernier Ulysse est le récit d'un voyage sans mouvement, d'un voyage d'inertie, d'un voyage qui est l'antipode d'une évolution. C'est le récit du voyage de quelqu'un qui n'a pas bougé, qui n'avait, du moins, nul besoin de se déplacer pour ce qu'il avait à y gagner – du moins jusqu'à la 239e page. Toutes les rencontres dépeintes par Mauvalant sont, il faut le reconnaître, plutôt ébauchées que profondes : on devine des linéaments, des silhouettes, des types, on ne perçoit pas des vies ; on trouve des conventions, à la rigueur une multiplicité de conventions superposées, mais ce sont des fantoches, même s'il s'agit de fantoches dont la banalité est en fait très plausible. Chacun de ces personnages, et c'est parfaitement logique, a la facticité du protagoniste qui les examine en vain : c'est logique qu'ils ne soient profonds, pour ainsi dire, qu'en surface, c'est-à-dire qu'ils n'intéressent quelqu'un qu'en les attributs où n'importe qui est a priori disposé à jeter le regard à cause de prismes sociaux, d'injonctions typiques selon lesquelles il faut observer la valeur d'autrui à tels critères peu personnels ni pertinents. Nul des personnages de ce roman ne devient un individu – jusqu'à présent, page 239. Ils ne sont pourtant pas non plus artificiels : ils sont flous, ils sont vagues, ils sont peu ; on ne sait pas qui ils sont ni s'ils sont. Ils ne sont pas réels : ni aussi superbes que dans les romans, ni aussi piètres qu'en la réalité. Un entre-deux peu consistant. Des successions, des jalons, sans plus, sans substance, sans définition ; des figures, prétextes à « progression » du héros. Des « symboles de », chacun. Des « types », plus ou moins gradués, échelonnés – est-ce par exemple qu'on connaît les motifs de Gloria et d'Aïda que j'ai quittées tout récemment (je devine philologiquement qu'elles sont inspirées de vraies femmes, et Aïda surtout), mais Larsvic, lui, contient l'immaturité du protagoniste dont il ne se différencie guère : ça se voit trop qu'il partage l'âme de Bonnet. Or, ce ne serait pas un si grand mal si le principe de l'intrigue n'était pas que le protagoniste doit s'enrichir de ses rencontres ; mais il est déjà ces autres, dès le début, ces autres lui
Lien : http://henrywar.canalblog.com
J'ai déjà longuement parlé de la manière dont un paradigme lourdement installé dans une perception et dans une intention fige la quantité de ce qu'on peut profondément apprendre et extraire d'une expérience – j'ai développé cette réflexion dans un article intitulé La Comédie de Charleroi ou La Complaisance précède l'Inexpérience. Tout ce qu'on aborde ainsi avec une présomption ou une prévention tirée de la morale populaire risque fort de ne faire que confirmer l'opinion avantageuse et favorable qu'on suppose de cette expérience – pour ne pas dire que ça la réalise toujours. On voudrait flatteusement se prouver de l'aptitude à la variation de soi, alors on empreinte la voie stéréotypée du déplacement, et, pour atteindre à cette sorte de spiritualité qu'on associe au cours léger du bateau et à la blancheur de la voile, on s'appuie sur le paradigme lourd et ancré selon lequel l'exotisme et l'évasion constituent des moyens essentiels. On veut aller intellectuellement loin, on s'arrime d'emblée à un fardeau mental. On prévoit qu'on sortira grandi, alors on s'étire et on se juge sorti de son ancienne mesure. C'est comme ces gens qui, après avoir appris que le soleil comporte de la vitamine D, sont tout de suite plus gentils quand il fait beau, et se sentent galvanisé par la lumière dès le premier photon. On obtenait sans doute autrefois le même résultat avec un bon clystère, pourtant le clystère n'avait nul effet logique sur la santé. On voyage, alors on se sent mieux et meilleur ; même, on se sent mieux et meilleur, si l'on s'examine bien, un peu avant d'avoir voyagé, dès la préparation, en fait. le voyage est un superflu au changement qu'on espère en extraire : rien que l'espérance du changement fait le changement.
Idem pour la rencontre. Toute personne qu'on découvre avec la conviction qu'on en sera modifié n'est qu'un prétexte formé d'avance à se valoriser de ses facultés de compréhension et d'empathie. Frédéric Moreau à bord de la Ville-de-Montereau adore Mme Arnoux aussitôt qu'il la voit parce qu'il s'ennuyait. On prépare d'abord sa vertu, et l'on feint ensuite de s'apercevoir qu'on l'a trouvée par hasard. Ne va-t-on pas soudain s'ouvrir aux autres, devenir cosmopolite, entendre enfin de la pensée même après avoir cessé de s'instruire et de s'édifier pendant vingt ans ? Et comment un homme qui craint fort de quitter sa maison sans sa piqûre, et qui accuse tout le monde de ne pas la prendre, deviendrait-il tout à coup un moindre penseur de l'Altérité ? Allons ! La vérité, c'est que, pour se sentir si bon, on n'avait pas besoin de découvrir quelqu'un. On aurait pu aussi bien se servir d'un livre ou simplement de son imagination : il n'est nulle âme qu'on n'aurait pas pu concevoir en esprit. Ils n'ont pas besoin de changer, les voyageurs : ils ont besoin de se croire changés. Ceux qui vous disent perpétuellement, en voyageant, avoir fait des « découvertes » en général sont des gens étonnamment dénués d'inspiration. Il ne leur semblait tout bonnement pas que telle chose ou tel être existât, et, après l'avoir vue, ils vivront de nouveau exactement comme s'ils en doutaient encore, mais fiers d'être « allés ». On appelle ça « l'expérience », à ce qu'il paraît ; l'expérience, c'est de se déplacer beaucoup dans l'espace pour que les globes oculaires voient beaucoup de couleurs et de formes, et puis rentrer chez soi avec une très vague mémoire de cet espace, de ces couleurs et de ces formes. Un pareil homme vous est supérieur, dit-on, parce qu'il a mal compris ce qu'il a vu directement, tandis que vous êtes son obligé au prétexte que vous avez très bien compris ce que vous n'avez pas vu ou eu besoin de voir en propre. Dans leur quotidien, vos maîtres enferment carrément leur pensée, et puis ils la rouvrent, en gros, provisoirement le temps des vacances, et tout cet argent ou ce temps qu'ils ont dépensé sert à prouver qu'ils vous dominent, que vous ne savez pas, vous, parce que vous n'avez pas l'expérience. C'est ainsi qu'une infirmière de leur connaissance aura toujours plus raison que les statistiques irréfragables que vous apportez de l'hôpital : elle a vu, et donc vous êtes un misérable d'aller sur de telles brisées de « l'expérience ». Il se peut qu'ils tirent de leur témoignage l'impression forte d'une révélation, mais ce sentiment provient principalement de leur obtusion normale. Ils se font une occasion d'ouvrir les yeux, et ils se surprennent tout à coup à voir de la lumière. Ils sont éblouis, et pourquoi ? Parce que pendant une semaine ou deux ils ont ouvert les paupières. Ils ne peuvent imaginer que, toute l'année, vous gardiez, vous, les yeux décillés pour tout contempler : vous vous vantez. Et puis, « ce n'est pas l'expérience, ça ». Vous n'avez pas la mine émerveillée des gens qui vivent des expériences, n'est-ce pas ?
En réalité, il n'y a guère plus de raison d'épanouir sa mentalité en prenant le bateau ou l'avion et en explorant différents pays qu'en adhérant à un club de billes. Parce que, partout à travers le monde, les gens sont ternes et opiniâtres – cela inclut aussi bien le moine d'Asie qui perçoit tout avec les oeillères de sa religion que le jouisseur-né américain qui vous montre sur un yacht combien on peut relativiser la douleur quand le moteur vrombit et hurle. Non, les gens n'ont rien à enseigner à quelqu'un qui serait déjà en mesure de se renseigner par lui-même, ce qui n'est pas encore trop difficile, je pense, à notre époque. Il n'existe plus de sujets de sagesse ; même un professeur est peu disposé à vous expliquer ce qu'il sait, parce qu'il résout et limite sa pensée à fort peu de choses, comme tout le monde. Alors, je sais bien qu'on me reprochera le fameux « relativisme culturel », doctrine selon laquelle, en se rapprochant des modes de vie plus rudes ou philosophes, on réapprend les privilèges de notre civilisation, mais c'est encore décidément un cruel manque d'imagination, tout ça. Est-ce que le Moderne ne se représente pas périodiquement ce que serait sa vie sans les écrans et toutes sortes de commodités ? et est-ce donc qu'il a généralement si peu d'ouverture et d'éveil qu'il faille une occasion de déplacement pour qu'il se figure ce qui n'est, là, point à sa portée ? – est-ce que les films ne lui donnent pas rien qu'un peu l'élan de ce qu'il faut faire pour se transporter virtuellement en dehors de sa propre mentalité ? Moi si. Tous ces voyageurs n'ont manifestement pas la moindre aptitude, dans l'existence ordinaire, à se transposer en esprit. Voudra-t-on alors me faire croire que parce qu'ils sont au Tibet ou en Uruguay et se mêlent aux indigènes, ces gens ont soudain trouvé en eux cette ressource abstractive qu'ils n'avaient pas dans le quotidien de leur pays natal ? Ce que je veux dire, c'est : est-ce qu'on trouve que ces gens, quand ils sont chez eux et en compagnie de leurs collègues, sont déjà capables de se mettre à leur place ? Alors pourquoi supposer qu'ils le feront mieux à dix mille kilomètres de chez eux et parmi des gens auprès de qui ils sont tout à fait disparates ? Non pas, ce n'est pas même seulement vraisemblable, une telle dichotomie : tout ce qu'ils explorent sur leur lieu de villégiature, c'est le tout petit cercle auquel leur permet d'accéder leur pensée. Ils vont ailleurs contempler paysages et cultures… avec les yeux d'un esprit fermé. Ce sont des étrangers en voyage.
Et la durée n'y fait rien : aujourd'hui, on ne s'approprie vraiment rien par la réflexion, on s'imprègne, voilà tout. Six ans au Brésil vous apprennent à parler argentin, et, si vous êtes influençable, vous vous laissez gagner d'une spiritualité socialiste, de moeurs et de coutumes, vous finissez par prendre plaisir à manger tel plat à telle heure – c'est vrai. Mais votre esprit au long de ce processus n'est pas plus empli ; il n'est pas plus grand. On peut exister ainsi un temps interminable même en France, et ne pas savoir de quoi est bâti un véritable esprit français – et c'est le lot commun. La curiosité même n'y suffit pas : on peut tout regarder avec un oeil avide autant que vide. Oui, on sent un pays sans doute, on l'éprouve et on peut même l'assumer : vos doigts pareillement sortent plissés du dont ils ont absorbé l'eau. Mais vos doigts n'en sont pas meilleurs. Tout au mieux, dans vingt ou cent générations, ils seront palmés, c'est-à-dire mieux adaptés. C'est pourquoi on naît musulman en Afrique du Nord, mais on n'est pas plus intelligent pour autant parce qu'on sait son Coran. le voyage ni sa durée ne fait l'esprit. Il faudrait, pour cela, un sens automatique propre à ne retenir que le Grand et le Juste.
le dernier Ulysse – qu'il faut, je crois, écrire sans la première majuscule – serait un récit de voyage et de formation là où il n'existe point – ou disons : presque jamais – de formation par le voyage. Ma théorie ainsi précédemment exposée, je trouve que l'intrigue même la vérifie. C'est la raison pourquoi je n'ai pas terminé ce livre, je n'ai pas terminé le voyage de ce livre, quitté page 239, parce que l'aventure de ce voyage ne semblait ne m'apprendre rien. Alexandre Mauvalant, personnage déjà assez médiocre et imbécile, n'évolue pas. Pas vraiment. Pour être précis, je dirais qu'il ne tire de ses pérégrinations que la facette la plus exposée de tout ce dont il était déjà disposé à croire.
Il regarde, oui. Il n'observe jamais en-dehors de ce qu'il s'apprête à trouver. La mesure d'une expérience inutile – inutile pour le véritable vertige de l'esprit – c'est ce qu'on cherche strictement : Mauvalant n'est jamais surpris, jamais. Il paraît tel le scientifique qui expérimente uniquement selon l'ordre de ce qu'il est en volonté de prouver : tout ce qu'il découvre s'inscrit dans un paradigme antécédent. C'est un peu comme si, sur une planète où ce qu'il y aurait de plus authentique à voir se situait dans le spectre lumineux des infrarouges ou des ultraviolets, un homme se rendait avec ses yeux ordinaires. le protagoniste n'est toujours conditionné que par la conformation de ce qu'il peut voir et entendre – et entendre. C'est en quelque sorte un Occidental qui va en Afrique avec la volonté farouche d'explorer la question de savoir comment les gens vivent en utilisant des billets de banque – transposer cette idée à tous les domaines de l'esprit.
Mauvalant ne voyage pas : il s'enorgueillit de voyager, du moins il se valorise.
C'est piteux vu d'une certaine distance : il n'apprend rien. Tout ça pour rien.
C'est, dans le récit, un écrivain, déjà, qui paraît sans grande sagesse – il me fait, à vrai dire, penser à certains de mes amis d'enfance qui portaient toujours des ciels dans la parole et dans les actes une ridicule immaturité. Après une émission anodine, il reçoit la lettre brève et légèrement mièvre d'une femme qui lui propose une rencontre, et il accepte aussitôt en se fixant la contrainte – chevaleresque, chevaleresque jusqu'à la naïveté – de parcourir tout le trajet à pied jusqu'à elle, et sans s'interdire, au hasard de ses intérêts, des escales de plusieurs mois.
C'est une sorte de marathon, voilà ; c'est le même état d'esprit que le coureur. Il est vide alors il remplit. Il lui faut perdre du temps pour se croire l'illusion de s'y consacrer. On connaît beaucoup de gens qui circonscrivent toute leur expérience au sport : ce sont des « voyageurs du sport », ils prétendront avoir beaucoup appris de cette inanité. Idem, le voyageur tout court.
Mauvalant ne connaît pas cette femme, Anna : elle est un prétexte. Elle ne lui a rien écrit que de très élémentaire. Il est un peu en panne d'inspiration, voilà tout. Un commentateur avisé comprend sans peine qu'il ne fait ce voyage, en s'imposant de telles difficultés, non pour elle, dont il n'a pas la moindre idée, dont la lettre ne permet même pas d'augurer la valeur, mais pour se donner de l'allure – ça sert aussi au roman, bien sûr. Il affecte un héroïsme : c'est un homme qui aime Conrad et London, qui ont voyagé, il aime aussi Nietzsche, il suppose donc que le voyage instruit et rend fort, sans songer que la plupart des marins sont des crétins comme les autres et peut-être plus avinés. Il veut devenir meilleur. Il ne le deviendra pas encore, page 239 ; il ne l'est pas devenu ne serait-ce qu'un peu davantage. Il est parti avec cette idée que voir à l'extérieur développe et épanouit : préjugé commun, stérile, et contre-productif. Il faut plutôt voir en soi-même, voir le vrai de l'homme : sait-on que Nietzsche était souvent sinon la plupart du temps à peu près aveugle ? Certes, parfois le temps qu'on passe à ne rien faire sur des routes incite à réfléchir. Mais je ne suis pas sûr que Mauvalant ait, lui, sur ce point, progressé.
Ah ! autre chose, puérile, puérile ! moderne, contemporaine, contemporaine ! et que j'ai oubliée de dire : Mauvalant va certes voir une femme, une femme avec ses promesses bien sûr, une femme qui l'attend et qui, tout de même, après un tel périple – elle vit aux Canaries –, aurait du mal à ne pas lui exprimer à la fin sa « reconnaissance »… oui, mais Mauvalant est impuissant suite à une opération de la prostate. Pourquoi donc ce but, alors : une femme ?
Triste. Sinistre. Bien contemporain. Et contemporain, dis-je, tout justement parce que la contemporanéité est le lieu où l'enfant-citoyen est incapable de se refuser un caprice, d'abdiquer un bonheur « normal », en un mot : de se résoudre. Il lui faut par d'autres biais obtenir ce qu'il souhaite, faute de savoir s'abstenir d'un désir : il veut encore et toujours l'égalité à laquelle sa conformation même l'interdit. Lors même qu'il n'est plus accessible à certaines jouissances, il veut quand même obtenir le droit d'y prétendre. Alors, Mauvalant persiste à vouloir l'amour de la femme et à vouloir cet amour aussi de façon sexuelle. C'est ce qui fonde, chez « l'immoral » lecteur comme moi, l'impression de suivre pas à pas l'itinéraire d'un handicapé sans puissance, mais sans puissance spirituelle, d'un handicapé dont la pensée plutôt que le corps est handicapé, d'un personnage veule, adolescent-né, mais que l'auteur cependant exhausse un peu comme un exemple ou une incarnation. Je ne prétends pas qu'un tel homme ne saurait être « puissant » en esprit, je suis presque sûr d'avoir rencontré de grands hommes souffrant de dysfonctionnement érectile, et je soupçonne que Nietzsche, que j'admire comme on sait, en faisait partie –, mais je trouve qu'un handicapé qui focalise tout son esprit sur son mal au point de ne jamais cesser de chercher un palliatif à la fois pour le cacher et pour en jouir manque décidément de relativisme et de grandeur : ce handicapé produit un sentiment de misère et de perpétuel inaccompli, de stagnation principielle. C'est un homme qui s'est trompé d'objectif, qui ne conquiert rien, qui ne peut aboutir, parce que sa quête est initialement mal formulée, contradictoire et insoluble comme une équation qui contient intrinsèquement quelque erreur axiomatique. Qu'à la limite, Mauvalant voyage dans l'espoir de s'enivrer du voyage, je veux bien, mais que la destination soit une femme à assouvir, lui qui ne peut précisément pas proposer un plein assouvissement, je veux dire âme et corps, n'est-ce pas là, parmi l'immense somme des plaisirs terrestres, aller chercher bêtement celui qui lui produira la plus sûre frustration ? – qu'il dise au moins à Anna son problème, et le voilà décomplexé tout à coup, mais non ! C'est comme quand un homme contemporain, qui n'a jamais pensé encore à avoir d'enfant, apprend inopinément sa stérilité : à quoi pense-t-il ? à fonder le reste de son existence sur le manque ou le souhait d'une paternité. Mais quoi ? il y a beaucoup mieux à faire et à penser au monde, quand on est impuissant ou stérile, que les femmes ou les bébés ! Moi, par exemple, avec le sale coeur que j'ai, est-ce que je m'en sers de prétexte pour vouloir soudain accomplir de grands efforts physiques ou pour susciter les sentiments d'une femme compatissante ?
… Où la contemporanéité, c'est le refus imbécile de renoncer même à l'illégitime. Dès le commencement, ce périple évoque l'inscription d'un cul-de-jatte à un marathon pour valides ou d'un muet sans langue à un grand concours de chant. Je pardonne, moi, toutes les maladies, sauf les maladies de la volonté et du jugement – et je me résous à n'être fait ni pour le sport ni pour être aimé.
Il faut voir notamment dans ce récit la façon systématique, endémique pour ainsi dire, dont un Contemporain court aux symboles, symboles qui ne sont pas la réalité, symboles qui sont la superficialité la plus antilittéraire du réel. Mauvalant d'abord suit géographiquement le parcours physique d'auteurs qu'il aime, puis il se fie aux réputations des villes qu'il est censé aimer, puis il voit dans les êtres qu'il fréquente les exactes vertus que, depuis son départ, il a toujours aimées.
On en revient exactement à mon observation liminaire. le dernier Ulysse est le récit d'un voyage sans mouvement, d'un voyage d'inertie, d'un voyage qui est l'antipode d'une évolution. C'est le récit du voyage de quelqu'un qui n'a pas bougé, qui n'avait, du moins, nul besoin de se déplacer pour ce qu'il avait à y gagner – du moins jusqu'à la 239e page. Toutes les rencontres dépeintes par Mauvalant sont, il faut le reconnaître, plutôt ébauchées que profondes : on devine des linéaments, des silhouettes, des types, on ne perçoit pas des vies ; on trouve des conventions, à la rigueur une multiplicité de conventions superposées, mais ce sont des fantoches, même s'il s'agit de fantoches dont la banalité est en fait très plausible. Chacun de ces personnages, et c'est parfaitement logique, a la facticité du protagoniste qui les examine en vain : c'est logique qu'ils ne soient profonds, pour ainsi dire, qu'en surface, c'est-à-dire qu'ils n'intéressent quelqu'un qu'en les attributs où n'importe qui est a priori disposé à jeter le regard à cause de prismes sociaux, d'injonctions typiques selon lesquelles il faut observer la valeur d'autrui à tels critères peu personnels ni pertinents. Nul des personnages de ce roman ne devient un individu – jusqu'à présent, page 239. Ils ne sont pourtant pas non plus artificiels : ils sont flous, ils sont vagues, ils sont peu ; on ne sait pas qui ils sont ni s'ils sont. Ils ne sont pas réels : ni aussi superbes que dans les romans, ni aussi piètres qu'en la réalité. Un entre-deux peu consistant. Des successions, des jalons, sans plus, sans substance, sans définition ; des figures, prétextes à « progression » du héros. Des « symboles de », chacun. Des « types », plus ou moins gradués, échelonnés – est-ce par exemple qu'on connaît les motifs de Gloria et d'Aïda que j'ai quittées tout récemment (je devine philologiquement qu'elles sont inspirées de vraies femmes, et Aïda surtout), mais Larsvic, lui, contient l'immaturité du protagoniste dont il ne se différencie guère : ça se voit trop qu'il partage l'âme de Bonnet. Or, ce ne serait pas un si grand mal si le principe de l'intrigue n'était pas que le protagoniste doit s'enrichir de ses rencontres ; mais il est déjà ces autres, dès le début, ces autres lui
Lien : http://henrywar.canalblog.com
L'or des Livres
Emmanuelle Caminnade
Je n'avais encore rien lu de Laurent LD Bonnet, nouvelliste et romancier doublé d'un grand navigateur et voyageur, et ce livre fut pour moi une merveilleuse découverte : celle d'une voix puissante et singulière qui vient redorer le blason du roman, trop souvent galvaudé en cette époque submergée par une «obèse actualité» asséchant l'imaginaire et une «trivialité marchande» uniformisante entravant parfois la liberté du créateur.
Troisième volume d'une tétralogie en cours sur la quête, dont les deux précédents creusaient le thème de la vengeance puis de la rencontre (1), cet ouvrage néanmoins autonome de plus de quatre cents pages se lisant avec avidité explore, lui, celui de la création. Publié par Les défricheurs, petite maison d'édition indépendante et audacieuse, il s'insère parfaitement dans la vision séduisante et stimulante de la littérature prônée par cette dernière, et dans sa collection "Les explorateurs" (2).
Le dernier Ulysse est un livre d'une grande originalité faisant cependant miroiter moult récits ayant façonné notre imaginaire. Jouant de toutes les trames temporelles réelles ou virtuelles dans un roman initiatique flirtant avec le roman d'anticipation ou de science-fiction, tout en lançant avec malice un insistant clin d'oeil à la flamboyante épopée d'Homère, l'auteur s'y interroge sur l'inspiration et les perspectives de la littérature, sur l'écrivain et les pouvoirs de l'imaginaire, mettant en scène toute la chaîne du livre et croquant avec une ironie jubilatoire l'«Olympe littéraire» parisien. Et, au travers de son héros-écrivain masculin, il s'y intéresse aussi à la nature et la valeur de l'homme et à ses chemins de vie, à sa capacité à exercer son libre-arbitre, bouleversant les clichés profondément ancrés de la virilité pour questionner plus en profondeur notre humanité.
1) Salone (Ed. Vents d'ailleurs), roman plusieurs fois primé qui a obtenu le Prix Senghor et Dix secondes (Ed. Vents d'ailleurs) rendant hommage au poème de Baudelaire À une passante . (La légitimité sera le thème du quatrième roman de ce cycle)
2)https://www.editionslesdefricheurs.art/nous-1
Tout débute dans les années 2020. Paul Vandoven, éditeur parisien influent et visionnaire, croit en son auteur Alexandre Mauvalant, nouvelliste et poète ne lui ayant pourtant jamais rapporté le moindre kopeck, car il est convaincu qu'il possède l'étoffe d'un grand romancier. Après une vidéo l'ayant confronté à une polémique sur les réseaux suivie d'une émission de télévision, ce dernier reçoit une lettre d'une certaine Anna Ivanovna vivant solitaire dans une île lointaine des Caraïbes anglaises, qui affirme avoir compris ce qu'il cherchait difficilement à exprimer et semble avoir «deviné sa musique intime».
Alexandre, ce veuf parvenu au milieu de sa vie et ayant toujours aimé la compagnie des femmes, traverse une profonde crise, se sentant prisonnier de ce que le temps lui octroie d'existence mais aussi dépossédé, dévalorisé (3). Une opération vitale (qu'il se garde bien d'ébruiter) l'a en effet privé à jamais de la fonction érectile de son phallus, et il est obsédé par la question de savoir si un homme peut encore être aimé ainsi réduit au statut d'une sorte d'eunuque.
Saisissant l'espoir d'une rencontre improbable pour tenter d'échapper à ses problèmes et de se réinventer, il propose alors à cette inconnue (dont il ne connaît ni l'âge, ni le physique, ni la voix,) de venir la visiter au rythme de la marche et du bateau. Un long et lent voyage à l'ancienne à la hauteur du mystère entourant les deux protagonistes, et fortement encouragé par son éditeur qui y voit l'occasion rêvée pour nourrir l'inspiration romanesque de son poulain. Anna accepte de l'attendre : «Vagabondez, Voyagez, Venez», lui répond-elle. Et notre héros, Zarathoustra en poche, part en quête de l'inaccessible étoile : celle qui donnera sens à son existence.
3) Ne valant pas plus en tant qu'écrivain qu'en tant qu'homme, ce que suggère malicieusement son patronyme
Ce hasardeux périple mû par le désir, par «ce désir d'ELLE au bout du monde», durera quatre ans, le menant de l'Europe à l'Afrique jusqu'aux Canaries où il traversera l'Atlantique pour rejoindre sa Pénélope. Riche de rencontres et de péripéties, il fournira la matière de son premier et unique roman intitulé Ultimus Odysseus : un roman promu à grande échelle qui obtiendra un succès planétaire faisant de lui un écrivain riche et célèbre. Jusqu'à ce qu'Alexandre disparaisse. Cette odyssée ayant modifié l'homme comme l'écrivain lui aura en effet permis de reformuler son existence en découvrant l'essentiel. de se libérer en étant «en phase avec son temps intérieur».
Mais ce n'est pas seulement le récit d'aventures foisonnant de son héros que nous offre l'auteur mais une seconde version posthume de ce dernier livrant aussi «l'autre réalité de son chemin». Un demi siècle après (en 2082), le manuscrit du Dernier Ulysse vient en effet dévoiler la partie immergée de l'iceberg. S'appuyant sur une nouvelle technique permettant d'exploiter ce «substrat créatif» inné dont on n'utilise qu'une part infime de son vivant, ce roman «transcodé», adapté par toute une équipe éditoriale d'après «le reliquat onirique d'Alexandre Mauvalant» pour s'adresser aux lecteurs de «toutes les trames temporelles», est ainsi le premier du genre. Un roman préfacé par Virginia Vandoven (la petite-fille de Paul) qui contribue à éclairer le mystère de l'homme, indissociable de celui de l'écrivain.
Ulysse et la nymphe Calypso ( Angelica Kauffmann)
Laurent LD Bonnet fait preuve d'une imagination intarissable et les nombreux personnages auxquels il donne chair et surtout intimité sont les véritables moteurs de son récit, car c'est bien la rencontre de l'autre au cours de son cheminement qui transforme le héros. Comme chez Homère, les femmes de cette odyssée sont des révélatrices (4), des passeuses qui, d'une étape à l'autre, font progresser ce héros en perte d'identité vers la sérénité (5). Elles sont les épreuves qui forgent l'identité et le destin de cet Ulysse mortel qui devra accepter le vieillissement et donc la mort (mais dans un monde livré au hasard et non aux caprices des Dieux).
La narration maintient toujours notre curiosité en éveil, évitant toute lassitude. Si elle ne perd jamais de vue le cap qui donne l'élan, elle n'avance pas en ligne directe, les sentiers bifurquant au hasard des rencontres. Et une alternance de longues pauses et d'accélérations, traduisant notamment la tension entre ces désirs antagonistes de rester ou de partir, de cheminer ou d'arriver, impulse au voyage une grande dynamique. Tandis que de nombreux flashes-back imbriquent mille et une histoires et que l'auteur apporte beaucoup de vie à ses scènes, tant grâce à la force évocatrice de ses descriptions qu'à d'alertes dialogues et à un humour bien aiguisé.
4) S'il y a de très beaux personnages masculins, ils ont surtout un rôle de mentor, de clairvoyants conseillers ou de confidents. Hormis Andreï Larsvic, "homme-miroir" du héros, sorte de double inversé qui vient l'éclairer sur lui-même
5) Il apprendra ainsi à user de sa dépossession au lieu de la combattre
Encadré d'un prélude et d'un final, le roman est construit comme une symphonie en quatre mouvements aux tempi différents et aux temporalités et points de vue narratifs variés.
Narré d'emblée au passé simple sur le mode du conte par un Ulysse-narrateur, le premier et lent mouvement (Europe), relativement linéaire, initie cette épopée moderne rénovant le mythe antique qui, de Paris à une île suédoise de la Baltique, conduit le héros au Portugal où la rencontre impromptue de la séduisante Agnès lui rappelle son handicap. Et ce n'est qu'après s'être posé de longs mois dans le paisible bourg de Seixal sur l'estuaire du Tage que la bien nommée Beatriz lui offrira un temps, dans sa candeur, l'espérance du paradis.
Tout s'accélère dans le deuxième mouvement (Afrique) qui, agité et saccadé, effectue un saut de vingt et un mois nous propulsant directement dans un vivant présent à l'étape suivante : Matakong où le héros, retenu pendant un an dans la compagnie des douces magiciennes Gloria et Aïda, reprend ses notes pour écrire une sorte de journal racontant mois par mois les multiples péripéties vécues depuis son départ de Seixal. Il raconte ainsi le trépidant parcours qui le conduisit du mythique détroit de Gibraltar et de la ville de Tanger, jusqu'à ce que le cargo d'un sulfureux trafiquant serbe devant théoriquement rejoindre les Canaries le débarque pour une escale en Guinée où il ne reviendra le prendre que bien plus tard. Un parcours rocambolesque l'ayant confronté à l'enfer humain, à «la boue et la douleur», mais aussi terrifié par ce qu'il découvre de l'homme en lui : «Devenir un esclave consentant n'emprunte plus un chemin d'aberration dévolu aux seules personnes dites faibles ou veules. C'est une vocation qui nous concerne tous.»
Le troisième mouvement (Traversées) accompagne le héros aux Canaries où il restera plus longtemps que prévu, ayant noué une idylle prometteuse lui faisant presque oublier son but. Puis, finalement congédié par Malvina Sand, il traversera enfin l'Atlantique vers Montserrat sur le voilier d'un très original Ecossais. Une partie opérant un net ralentissement, proche parfois d'une quasi immobilité, conduisant à une approche plus sereine du temps et s'accordant aussi à l'appréhension de la rencontre avec cette inconnue et du terme du voyage. Retournant au passé et abandonnant le "je" pour la troisième personne, le narrateur y prend alors également en compte le point de vue d'Anna.
Enfin, dans le court dernier mouvement (L'affaire Odysseus) qui nous plonge dans l'accélération contemporaine, nous retournons avec Alexandre dans le monde littéraire parisien pour suivre le lancement de son livre : un réveil brutal.
Et si le Final complète le Prélude/préface en retraçant le chemin éditorial du Dernier Ulysse depuis la disparition d'Alexandre, il faudra attendre de consulter en Annexe les «segments restaurés» ayant résisté au transcodage pour mieux comprendre les raisons de cette disparition.
A contre-courant de la fiction réaliste, et de «ceux qui pour montrer le monde filment leur nombril», Laurent LD Bonnet défend une littérature de l'imaginaire. Et une vision borgesienne du temps sous-tend cet ouvrage où il témoigne d'une certaine parenté avec l'auteur de la Bibliothèque de Babel (6). Dans le dernier Ulysse, le temps est ainsi moins approché dans sa linéarité que dans son épaisseur vertigineuse, dans son universalité riche de tous les possibles. le récit fictionnel vient ainsi toucher à l'éternité : «Chaque histoire offerte avait germé en des milliers d'imaginaires, enfantant de milliers, de millions, de milliards d'autres, emplissant l'univers de l'imaginaire humain d'un gigantesque peuple de personnages qui se contaient ou s'écrivaient dans la trame d'une histoire infinie, toujours en mouvement, à jamais insaisissable».
Et les auteurs survivraient à leur fiction, voyageant dans nos rêves en «animant tout un peuple de personnages qui se mettraient à vivre en nous».
6) Nouvelle publiée en 1941 dans la première partie (Le jardin aux sentiers qui bifurquent) de son recueil Fictions. Une bibliothèque y renferme ainsi tous les livres déjà écrits et ceux à venir nous renvoyant à la quête infinie et éternelle du sens de la vie.
Au contact de ses rencontres, Alexandre Mauvalant fabrique une multitude, une diversité de destins. Par le biais de visions fulgurantes, sortes «d'excroissances temporelles», le voyage lui révèle en effet sa capacité à deviner puis à raconter les destins imaginaires des gens ordinaires rencontrés. Il les voit, perçoit leurs autres vies, découvre ces «destins alternatifs», «tous ces potentiels qui avaient existé». Son imaginaire se révèle ainsi «capable d'accéder au coeur le plus secret de ces gens jusqu'à l'informulable et parfois l'inconscient labyrinthe de leur choix.» Et l'humble rôle de l'écrivain s'avère ainsi celui d'écrire le conte de leur mille et une vie : «Ecrire pour les gens. Ecrire l'irréalisable part d'eux-mêmes, celle qui au bout d'une vie se constitue d'autant de destins que de choix délaissés.»
Une conception qui n'est pas sans évoquer Pierre Michon exaltant de même dans Les vies minuscules cette fiction sans laquelle il ne resterait plus trace de la réalité des petites gens, de "leurs éclatants désirs au sein du réel terne", de ces mille romans que l'avenir a défait.
Cette mutation de son inspiration sous forme de visions favorise par ailleurs une réelle empathie, une fraternité avec tous ces gens, «comme si une part de [lui] était entrée dans leur vie», l'inspiration nouvelle qui l'anime ayant «puisé sa source au coeur de [ses] frères et soeurs de cette terre, au coeur de leur liberté de choisir, présente, encore, toujours même infime». Et la fiction littéraire, dans l'humanité et la fraternité qu'elle induit, apparaît alors comme un rempart contre la barbarie : «Raconter, partager, écrire, lire des milliers d'histoires pour que le lien d'humanité qui nous préserve encore de la barbarie puisse subsister. »
Tout comme une des héroïne d'Auður Ava Olafsdóttir dans La vérité sur la lumière, pour laquelle l'homme est une espèce animale dont la seule supériorité s'avère le "don admirable d'écrire des poèmes", il semble que chez Laurent LD Bonnet «l'infraconscient créatif» soit une «faculté innée constitutive de la nature humaine» : que l'Homo Sapiens soit «avant tout créateur».
Le dernier Ulysse est ainsi un hymne aux pouvoirs de l'imaginaire, au rêve et à la liberté, qui nous propulse dans le royaume enchanteur et incommensurable du récit, l'auteur semblant penser, à l'instar de son personnage-éditeur, que «l'avenir du livre sera onirique ou ne sera PAS».
Un grand livre qui résonne et laisse des traces.
Lien : http://l-or-des-livres-blog-..
Emmanuelle Caminnade
Je n'avais encore rien lu de Laurent LD Bonnet, nouvelliste et romancier doublé d'un grand navigateur et voyageur, et ce livre fut pour moi une merveilleuse découverte : celle d'une voix puissante et singulière qui vient redorer le blason du roman, trop souvent galvaudé en cette époque submergée par une «obèse actualité» asséchant l'imaginaire et une «trivialité marchande» uniformisante entravant parfois la liberté du créateur.
Troisième volume d'une tétralogie en cours sur la quête, dont les deux précédents creusaient le thème de la vengeance puis de la rencontre (1), cet ouvrage néanmoins autonome de plus de quatre cents pages se lisant avec avidité explore, lui, celui de la création. Publié par Les défricheurs, petite maison d'édition indépendante et audacieuse, il s'insère parfaitement dans la vision séduisante et stimulante de la littérature prônée par cette dernière, et dans sa collection "Les explorateurs" (2).
Le dernier Ulysse est un livre d'une grande originalité faisant cependant miroiter moult récits ayant façonné notre imaginaire. Jouant de toutes les trames temporelles réelles ou virtuelles dans un roman initiatique flirtant avec le roman d'anticipation ou de science-fiction, tout en lançant avec malice un insistant clin d'oeil à la flamboyante épopée d'Homère, l'auteur s'y interroge sur l'inspiration et les perspectives de la littérature, sur l'écrivain et les pouvoirs de l'imaginaire, mettant en scène toute la chaîne du livre et croquant avec une ironie jubilatoire l'«Olympe littéraire» parisien. Et, au travers de son héros-écrivain masculin, il s'y intéresse aussi à la nature et la valeur de l'homme et à ses chemins de vie, à sa capacité à exercer son libre-arbitre, bouleversant les clichés profondément ancrés de la virilité pour questionner plus en profondeur notre humanité.
1) Salone (Ed. Vents d'ailleurs), roman plusieurs fois primé qui a obtenu le Prix Senghor et Dix secondes (Ed. Vents d'ailleurs) rendant hommage au poème de Baudelaire À une passante . (La légitimité sera le thème du quatrième roman de ce cycle)
2)https://www.editionslesdefricheurs.art/nous-1
Tout débute dans les années 2020. Paul Vandoven, éditeur parisien influent et visionnaire, croit en son auteur Alexandre Mauvalant, nouvelliste et poète ne lui ayant pourtant jamais rapporté le moindre kopeck, car il est convaincu qu'il possède l'étoffe d'un grand romancier. Après une vidéo l'ayant confronté à une polémique sur les réseaux suivie d'une émission de télévision, ce dernier reçoit une lettre d'une certaine Anna Ivanovna vivant solitaire dans une île lointaine des Caraïbes anglaises, qui affirme avoir compris ce qu'il cherchait difficilement à exprimer et semble avoir «deviné sa musique intime».
Alexandre, ce veuf parvenu au milieu de sa vie et ayant toujours aimé la compagnie des femmes, traverse une profonde crise, se sentant prisonnier de ce que le temps lui octroie d'existence mais aussi dépossédé, dévalorisé (3). Une opération vitale (qu'il se garde bien d'ébruiter) l'a en effet privé à jamais de la fonction érectile de son phallus, et il est obsédé par la question de savoir si un homme peut encore être aimé ainsi réduit au statut d'une sorte d'eunuque.
Saisissant l'espoir d'une rencontre improbable pour tenter d'échapper à ses problèmes et de se réinventer, il propose alors à cette inconnue (dont il ne connaît ni l'âge, ni le physique, ni la voix,) de venir la visiter au rythme de la marche et du bateau. Un long et lent voyage à l'ancienne à la hauteur du mystère entourant les deux protagonistes, et fortement encouragé par son éditeur qui y voit l'occasion rêvée pour nourrir l'inspiration romanesque de son poulain. Anna accepte de l'attendre : «Vagabondez, Voyagez, Venez», lui répond-elle. Et notre héros, Zarathoustra en poche, part en quête de l'inaccessible étoile : celle qui donnera sens à son existence.
3) Ne valant pas plus en tant qu'écrivain qu'en tant qu'homme, ce que suggère malicieusement son patronyme
Ce hasardeux périple mû par le désir, par «ce désir d'ELLE au bout du monde», durera quatre ans, le menant de l'Europe à l'Afrique jusqu'aux Canaries où il traversera l'Atlantique pour rejoindre sa Pénélope. Riche de rencontres et de péripéties, il fournira la matière de son premier et unique roman intitulé Ultimus Odysseus : un roman promu à grande échelle qui obtiendra un succès planétaire faisant de lui un écrivain riche et célèbre. Jusqu'à ce qu'Alexandre disparaisse. Cette odyssée ayant modifié l'homme comme l'écrivain lui aura en effet permis de reformuler son existence en découvrant l'essentiel. de se libérer en étant «en phase avec son temps intérieur».
Mais ce n'est pas seulement le récit d'aventures foisonnant de son héros que nous offre l'auteur mais une seconde version posthume de ce dernier livrant aussi «l'autre réalité de son chemin». Un demi siècle après (en 2082), le manuscrit du Dernier Ulysse vient en effet dévoiler la partie immergée de l'iceberg. S'appuyant sur une nouvelle technique permettant d'exploiter ce «substrat créatif» inné dont on n'utilise qu'une part infime de son vivant, ce roman «transcodé», adapté par toute une équipe éditoriale d'après «le reliquat onirique d'Alexandre Mauvalant» pour s'adresser aux lecteurs de «toutes les trames temporelles», est ainsi le premier du genre. Un roman préfacé par Virginia Vandoven (la petite-fille de Paul) qui contribue à éclairer le mystère de l'homme, indissociable de celui de l'écrivain.
Ulysse et la nymphe Calypso ( Angelica Kauffmann)
Laurent LD Bonnet fait preuve d'une imagination intarissable et les nombreux personnages auxquels il donne chair et surtout intimité sont les véritables moteurs de son récit, car c'est bien la rencontre de l'autre au cours de son cheminement qui transforme le héros. Comme chez Homère, les femmes de cette odyssée sont des révélatrices (4), des passeuses qui, d'une étape à l'autre, font progresser ce héros en perte d'identité vers la sérénité (5). Elles sont les épreuves qui forgent l'identité et le destin de cet Ulysse mortel qui devra accepter le vieillissement et donc la mort (mais dans un monde livré au hasard et non aux caprices des Dieux).
La narration maintient toujours notre curiosité en éveil, évitant toute lassitude. Si elle ne perd jamais de vue le cap qui donne l'élan, elle n'avance pas en ligne directe, les sentiers bifurquant au hasard des rencontres. Et une alternance de longues pauses et d'accélérations, traduisant notamment la tension entre ces désirs antagonistes de rester ou de partir, de cheminer ou d'arriver, impulse au voyage une grande dynamique. Tandis que de nombreux flashes-back imbriquent mille et une histoires et que l'auteur apporte beaucoup de vie à ses scènes, tant grâce à la force évocatrice de ses descriptions qu'à d'alertes dialogues et à un humour bien aiguisé.
4) S'il y a de très beaux personnages masculins, ils ont surtout un rôle de mentor, de clairvoyants conseillers ou de confidents. Hormis Andreï Larsvic, "homme-miroir" du héros, sorte de double inversé qui vient l'éclairer sur lui-même
5) Il apprendra ainsi à user de sa dépossession au lieu de la combattre
Encadré d'un prélude et d'un final, le roman est construit comme une symphonie en quatre mouvements aux tempi différents et aux temporalités et points de vue narratifs variés.
Narré d'emblée au passé simple sur le mode du conte par un Ulysse-narrateur, le premier et lent mouvement (Europe), relativement linéaire, initie cette épopée moderne rénovant le mythe antique qui, de Paris à une île suédoise de la Baltique, conduit le héros au Portugal où la rencontre impromptue de la séduisante Agnès lui rappelle son handicap. Et ce n'est qu'après s'être posé de longs mois dans le paisible bourg de Seixal sur l'estuaire du Tage que la bien nommée Beatriz lui offrira un temps, dans sa candeur, l'espérance du paradis.
Tout s'accélère dans le deuxième mouvement (Afrique) qui, agité et saccadé, effectue un saut de vingt et un mois nous propulsant directement dans un vivant présent à l'étape suivante : Matakong où le héros, retenu pendant un an dans la compagnie des douces magiciennes Gloria et Aïda, reprend ses notes pour écrire une sorte de journal racontant mois par mois les multiples péripéties vécues depuis son départ de Seixal. Il raconte ainsi le trépidant parcours qui le conduisit du mythique détroit de Gibraltar et de la ville de Tanger, jusqu'à ce que le cargo d'un sulfureux trafiquant serbe devant théoriquement rejoindre les Canaries le débarque pour une escale en Guinée où il ne reviendra le prendre que bien plus tard. Un parcours rocambolesque l'ayant confronté à l'enfer humain, à «la boue et la douleur», mais aussi terrifié par ce qu'il découvre de l'homme en lui : «Devenir un esclave consentant n'emprunte plus un chemin d'aberration dévolu aux seules personnes dites faibles ou veules. C'est une vocation qui nous concerne tous.»
Le troisième mouvement (Traversées) accompagne le héros aux Canaries où il restera plus longtemps que prévu, ayant noué une idylle prometteuse lui faisant presque oublier son but. Puis, finalement congédié par Malvina Sand, il traversera enfin l'Atlantique vers Montserrat sur le voilier d'un très original Ecossais. Une partie opérant un net ralentissement, proche parfois d'une quasi immobilité, conduisant à une approche plus sereine du temps et s'accordant aussi à l'appréhension de la rencontre avec cette inconnue et du terme du voyage. Retournant au passé et abandonnant le "je" pour la troisième personne, le narrateur y prend alors également en compte le point de vue d'Anna.
Enfin, dans le court dernier mouvement (L'affaire Odysseus) qui nous plonge dans l'accélération contemporaine, nous retournons avec Alexandre dans le monde littéraire parisien pour suivre le lancement de son livre : un réveil brutal.
Et si le Final complète le Prélude/préface en retraçant le chemin éditorial du Dernier Ulysse depuis la disparition d'Alexandre, il faudra attendre de consulter en Annexe les «segments restaurés» ayant résisté au transcodage pour mieux comprendre les raisons de cette disparition.
A contre-courant de la fiction réaliste, et de «ceux qui pour montrer le monde filment leur nombril», Laurent LD Bonnet défend une littérature de l'imaginaire. Et une vision borgesienne du temps sous-tend cet ouvrage où il témoigne d'une certaine parenté avec l'auteur de la Bibliothèque de Babel (6). Dans le dernier Ulysse, le temps est ainsi moins approché dans sa linéarité que dans son épaisseur vertigineuse, dans son universalité riche de tous les possibles. le récit fictionnel vient ainsi toucher à l'éternité : «Chaque histoire offerte avait germé en des milliers d'imaginaires, enfantant de milliers, de millions, de milliards d'autres, emplissant l'univers de l'imaginaire humain d'un gigantesque peuple de personnages qui se contaient ou s'écrivaient dans la trame d'une histoire infinie, toujours en mouvement, à jamais insaisissable».
Et les auteurs survivraient à leur fiction, voyageant dans nos rêves en «animant tout un peuple de personnages qui se mettraient à vivre en nous».
6) Nouvelle publiée en 1941 dans la première partie (Le jardin aux sentiers qui bifurquent) de son recueil Fictions. Une bibliothèque y renferme ainsi tous les livres déjà écrits et ceux à venir nous renvoyant à la quête infinie et éternelle du sens de la vie.
Au contact de ses rencontres, Alexandre Mauvalant fabrique une multitude, une diversité de destins. Par le biais de visions fulgurantes, sortes «d'excroissances temporelles», le voyage lui révèle en effet sa capacité à deviner puis à raconter les destins imaginaires des gens ordinaires rencontrés. Il les voit, perçoit leurs autres vies, découvre ces «destins alternatifs», «tous ces potentiels qui avaient existé». Son imaginaire se révèle ainsi «capable d'accéder au coeur le plus secret de ces gens jusqu'à l'informulable et parfois l'inconscient labyrinthe de leur choix.» Et l'humble rôle de l'écrivain s'avère ainsi celui d'écrire le conte de leur mille et une vie : «Ecrire pour les gens. Ecrire l'irréalisable part d'eux-mêmes, celle qui au bout d'une vie se constitue d'autant de destins que de choix délaissés.»
Une conception qui n'est pas sans évoquer Pierre Michon exaltant de même dans Les vies minuscules cette fiction sans laquelle il ne resterait plus trace de la réalité des petites gens, de "leurs éclatants désirs au sein du réel terne", de ces mille romans que l'avenir a défait.
Cette mutation de son inspiration sous forme de visions favorise par ailleurs une réelle empathie, une fraternité avec tous ces gens, «comme si une part de [lui] était entrée dans leur vie», l'inspiration nouvelle qui l'anime ayant «puisé sa source au coeur de [ses] frères et soeurs de cette terre, au coeur de leur liberté de choisir, présente, encore, toujours même infime». Et la fiction littéraire, dans l'humanité et la fraternité qu'elle induit, apparaît alors comme un rempart contre la barbarie : «Raconter, partager, écrire, lire des milliers d'histoires pour que le lien d'humanité qui nous préserve encore de la barbarie puisse subsister. »
Tout comme une des héroïne d'Auður Ava Olafsdóttir dans La vérité sur la lumière, pour laquelle l'homme est une espèce animale dont la seule supériorité s'avère le "don admirable d'écrire des poèmes", il semble que chez Laurent LD Bonnet «l'infraconscient créatif» soit une «faculté innée constitutive de la nature humaine» : que l'Homo Sapiens soit «avant tout créateur».
Le dernier Ulysse est ainsi un hymne aux pouvoirs de l'imaginaire, au rêve et à la liberté, qui nous propulse dans le royaume enchanteur et incommensurable du récit, l'auteur semblant penser, à l'instar de son personnage-éditeur, que «l'avenir du livre sera onirique ou ne sera PAS».
Un grand livre qui résonne et laisse des traces.
Lien : http://l-or-des-livres-blog-..
Un livre reçu dans le cadre d'une opération masse critique. Donc merci à Babelio et aux éditions Les Défricheurs.
J'avais cliqué sur ce livre car depuis toujours je suis fan de ce vers « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». Petit aparté, imaginez ma surprise en découvrant le reste du poème de Joachim du Bellay et de m'apercevoir que Du Bellay y exprime sa nostalgie de la Touraine alors qu'il est à Rome. Tous les gouts sont dans la nature mais moi qui adore les voyages, cela m'a laissée perplexe. Fin de l'aparté. Enfin si l'on veut car une fois les 450 pages lues, je suis perplexe face à cet ouvrage. Ai-je aimé ou pas… Je ne saurai être aussi catégorique.
En essayant de faire le bilan de cette lecture, une semaine après l'avoir finie, je me souviens d'un auteur qui a une belle maitrise des mots et de la langue Française. Il y a parfois de belles phrases. Par contre la structure de ce roman est parfois trop touffue voire sans grand intérêt. Pourquoi diable vouloir y mettre un soupçon de science-fiction ? Cela rend le livre brouillon et n'apporte rien à la narration.
Les affres du narrateur sur sa virilité perdue du fait d'un cancer de la prostate sont d'un ennui.... le pauvre chou, il ne bande plus et passe des dizaines de page à se lamenter que plus personne ne va l'aimer. Et pourtant des femmes le choisissent et quand cela lui arrive, et bien il abandonne les femmes qui le désirent (malgré ou à cause de (qui sait)).
La partie sur les méthodes de l'édition n'est pas inintéressante mais pas non plus passionnante.
J'ai préféré et de loin le dialogue entre le capitaine du bateau « fantôme » et le narrateur. Les questions de bonne conscience, de l'action versus l'inaction, des choix et de leurs impacts etc sont bien traitées et donnent de la profondeur à ce roman.
Un roman très inégal en ce qui me concerne.
J'avais cliqué sur ce livre car depuis toujours je suis fan de ce vers « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». Petit aparté, imaginez ma surprise en découvrant le reste du poème de Joachim du Bellay et de m'apercevoir que Du Bellay y exprime sa nostalgie de la Touraine alors qu'il est à Rome. Tous les gouts sont dans la nature mais moi qui adore les voyages, cela m'a laissée perplexe. Fin de l'aparté. Enfin si l'on veut car une fois les 450 pages lues, je suis perplexe face à cet ouvrage. Ai-je aimé ou pas… Je ne saurai être aussi catégorique.
En essayant de faire le bilan de cette lecture, une semaine après l'avoir finie, je me souviens d'un auteur qui a une belle maitrise des mots et de la langue Française. Il y a parfois de belles phrases. Par contre la structure de ce roman est parfois trop touffue voire sans grand intérêt. Pourquoi diable vouloir y mettre un soupçon de science-fiction ? Cela rend le livre brouillon et n'apporte rien à la narration.
Les affres du narrateur sur sa virilité perdue du fait d'un cancer de la prostate sont d'un ennui.... le pauvre chou, il ne bande plus et passe des dizaines de page à se lamenter que plus personne ne va l'aimer. Et pourtant des femmes le choisissent et quand cela lui arrive, et bien il abandonne les femmes qui le désirent (malgré ou à cause de (qui sait)).
La partie sur les méthodes de l'édition n'est pas inintéressante mais pas non plus passionnante.
J'ai préféré et de loin le dialogue entre le capitaine du bateau « fantôme » et le narrateur. Les questions de bonne conscience, de l'action versus l'inaction, des choix et de leurs impacts etc sont bien traitées et donnent de la profondeur à ce roman.
Un roman très inégal en ce qui me concerne.
Lettre capitales Dan Burcea
Meilleure revue littéraire 2021
Le livre de Laurent LD Bonnetle dernier Ulysse est le troisième volet de la tétralogie de la quête en cours d'écriture qui comprend jusqu'à présent trois volumes : Salone (Prix Senghor 2013) – Dix secondes, roman hommage au poème de Baudelaire, “À une passante”.
Ce troisième roman est écrit D'après le Reliquat Onirique d'Alexandre Mauvalant, comme le précise son sous-titre, alors que son Prélude nous avertit sur sa nouveauté, « le premier du genre », nous promettant « qu'il fera débat à toutes les époques ».
Plusieurs précisions s'imposent à ce stade afin de bien tracer les pistes de ce récit qui semble se jouer allègrement de la fiction pour mieux nous attirer vers les contrées du rêve. Signalons ainsi le premier indice qui nous est offert dès les premières lignes du récit et qui pourrait être considéré comme une ouverture incontestable vers le romanesque : « En toute une vie un auteur de fictions n'écrit que quatre mots : Il était une fois. Puis, il confie la suite aux personnages… ».
Usant d'un vrai stratagème narratif, Alexandre Mauvalant, personnage du roman et auteur connu pour avoir publié des nouvelles et des poèmes, confie le rôle d'écrivain-voyageur à un de ses personnages qu'il décrit comme « un drôle de gars, une sorte de messie récalcitrant, héros d'une Nouvelle d'anticipation qui […] avait remporté un succès d'estime ». En réalité, ce personnage à peine dissimulé, n'est qu'une marionnette entre les mains de l'auteur, son alter ego, qui lui fait prononcer comme un ventriloque avec tout autant d'habilité des mots qui reflètent les idées qu'il a dans la tête. Au détour d'un dialogue tenu lors d'une rencontre de promotion d'un de ses livres dans une librairie de Vincennes, ce personnage bizarre ose répéter la fameuse idée que l'auteur lui souffle à l'oreille ; le chemin modifie l'homme de manière aussi certaine que l'accomplissement. Nous reconnaissons bien ici entre autre une allusion à la fameuse citation d'Antonio Machado dans Campos de Castilla (1917): « Caminante! No hay camino, se hace camino al andar » ( Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant).
Ce mot d'ordre joue dans l'économie du récit de voyage le rôle du point déclencheur et celui de l'encrage dans la subjectivité du protagoniste principal Alexandre Mauvalant. Bousculé dans son quotidien, il finira par reconnaître, dans « [s]on rapport au temps, aux lieux, aux gens, aux genres, et à [s]on inspiration », qu'il ne sait pas trop bien quel forme donner à cette envie de dépassement que contient la phrase prononcée de manière quasi inconsciente lors de la soirée de promotion.
La réponse quant à la destination du voyage ne tardera pas à se faire connaître. Cet appel vers le large sera incarné par la lettre d'une mystérieuse dame au nom pittoresque, comme il se doit dans tout bon roman, Anna Ivanovna Maria Rosseló habitant à Saint Peter Parish dans la Montserrat Island dans les Antilles britanniques. L'écrivain-voyageur ne tardera pas à informer cette énigmatique complice des conditions du voyage : pas de moyens rapides de voyage, pas d'avions, donc, juste de la marche et de la navigation en bateau, en partant de France, via l'Espagne et le Portugal, le Gibraltar, l'Afrique du Nord et encore en bateau vers la destination finale.
Mauvalant appelle cette lenteur du voyage « un fatalisme serein et difficile à la fois ». En effet, c'est ainsi qu'il aura l'occasion de planter pour ainsi dire sa tente dans plusieurs lieux, de connaître des gens, de se lier d'amitié avec des personnages pittoresques, de connaître des expériences amoureuses qui mettront à l'épreuve sa virilité abîmée par la maladie, de se plonger dans ses notes de voyage comme dans une vie nouvelle et enchanteresse et de vérifier enfin à ses dépens le changement dont il avait parlé avant de se lancer dans cette aventure.
Le mot aventure doit être scruté ici avec toutes les précautions que suppose une telle expérience. le rythme lent, la propension vers l'introspection de l'homme en quête de sens sur sa condition amoindrie par la maladie penchent plutôt vers un divan intérieur qui prend sens en même temps que la contemplation des paysages qu'il traverse avec les destins des semblables qui lui servent de miroir à sa propre personne. Un exemple de style qui en dit long sur l'oeil attentif du voyageur est la description du détroit de Gibraltar sous la beauté de l'aube. Les nuages sont « de formidables cathédrales de nuées tourmentées qui emplissent le ciel, piétinant les confins d'un horizon argenté ». le tout semble prendre l'allure d'un « mirage d'allure biblique ».
Quant à ses rencontres, deux d'entre elles vont compter dans son voyage. Ce sont celles des capitaines de deux navires aux bord desquelles il va se retrouver et qui vont l'aider à atteindre sa destination. Il ne s'agit pas seulement de directions dans le sens de la navigation, mais dans la même mesure de la recherche intérieure de sa condition d'écrivain. En réalité, Alexandre Mauvalant a un contrat avec Vandoven, son éditeur, à qui il doit envoyer régulièrement des notes de voyage en échange du financement de celui-ci.
Le premier capitaine se nomme Larsvic et son navire s'appelle Prizrack, ce qui signifie Fantôme. Personnage haut en couleurs, ce capitaine serbe s'avère être un trafiquant d'armes. Homme tourmenté par ses nombreuses contradictions, par la méfiance et par la maladie, Larsvic va jouer un rôle décisif dans la vie de Mauvalant. C'est lui qui va lui demander d'écrire sa biographie, et pousser ainsi l'écrivain à s'essayer à l'écriture du roman auquel il aspire depuis toujours, de se frotter à ce qu'il appelle « le vent du destin », expression qui, malgré sa réputation de cliché littéraire, donne substance à son projet invraisemblable.
Une révélation apparaît soudainement dans sa conscience d'artiste et d'écrivain. Il va lui donner un nom inhabituel, le Neuf, un état de grâce, une révélation devant la beauté, « un état de conscience […], un lieu culminant du temps dont il reconnaissait l'évanescence, sans pouvoir la capturer ». Plus encore, cet état est encore plus puissant l'aidant à bouillonner l'eau du temps de sa mémoire, « emportant son homme antérieur, chargé du souvenir fantomal qui, depuis le départ, ne l'avait jamais quitté ». La vocation de l'écrivain va prendre le dessus nous laissant entrevoir un Alexandre Mauvalant de plus en plus confiant dans la réussite de cette entreprise dont il avait toujours hésité d'accepter le défi.
Diggs, le capitaine de l'Improbable, est le deuxième personnage tout aussi haut en couleurs que Larsvic. C'est lui qui va conduire Mauvalant dans cette seconde partie de voyage.
Rencontrera-t-il la mystérieuse Anna Ivanovna Maria Rosseló ? Fera-t-il face à cet ultime épisode de son périple ? Pourquoi a-t-il décidé de passer de la première personne à la troisième pour raconter la seconde partie de son histoire ?
Le lecteur aura tout le loisir de le découvrir.
Remarquons quant à nous pour conclure la finesse de l'écriture de Laurent LD Bonnet, le caractère tourmenté de ses personnages et l'appel impératif de sa démarche qui le fait dire ceci : « Je dois me raconter ! Pourquoi ? Pour ne pas m'oublier ».
On comprend ainsi la vraie nuance définitive et bouleversante du voyage d'Ulysse qui se veut être « le dernier ». Cela met en lumière, tout en respectant les codes du récit de voyage, les ressorts les plus cachés et les plus puissants du destin et du devenir d'un héros pris dans les turbulences de la vie et des besoins de donner sens à la vie d'un écrivain comme lui.
Dan Burcea
Laurent LD Bonnet, le dernier Ulysse, Éditions Les Défricheurs, 2021, 450 pages.
Lien : https://lettrescapitales.com..
Meilleure revue littéraire 2021
Le livre de Laurent LD Bonnetle dernier Ulysse est le troisième volet de la tétralogie de la quête en cours d'écriture qui comprend jusqu'à présent trois volumes : Salone (Prix Senghor 2013) – Dix secondes, roman hommage au poème de Baudelaire, “À une passante”.
Ce troisième roman est écrit D'après le Reliquat Onirique d'Alexandre Mauvalant, comme le précise son sous-titre, alors que son Prélude nous avertit sur sa nouveauté, « le premier du genre », nous promettant « qu'il fera débat à toutes les époques ».
Plusieurs précisions s'imposent à ce stade afin de bien tracer les pistes de ce récit qui semble se jouer allègrement de la fiction pour mieux nous attirer vers les contrées du rêve. Signalons ainsi le premier indice qui nous est offert dès les premières lignes du récit et qui pourrait être considéré comme une ouverture incontestable vers le romanesque : « En toute une vie un auteur de fictions n'écrit que quatre mots : Il était une fois. Puis, il confie la suite aux personnages… ».
Usant d'un vrai stratagème narratif, Alexandre Mauvalant, personnage du roman et auteur connu pour avoir publié des nouvelles et des poèmes, confie le rôle d'écrivain-voyageur à un de ses personnages qu'il décrit comme « un drôle de gars, une sorte de messie récalcitrant, héros d'une Nouvelle d'anticipation qui […] avait remporté un succès d'estime ». En réalité, ce personnage à peine dissimulé, n'est qu'une marionnette entre les mains de l'auteur, son alter ego, qui lui fait prononcer comme un ventriloque avec tout autant d'habilité des mots qui reflètent les idées qu'il a dans la tête. Au détour d'un dialogue tenu lors d'une rencontre de promotion d'un de ses livres dans une librairie de Vincennes, ce personnage bizarre ose répéter la fameuse idée que l'auteur lui souffle à l'oreille ; le chemin modifie l'homme de manière aussi certaine que l'accomplissement. Nous reconnaissons bien ici entre autre une allusion à la fameuse citation d'Antonio Machado dans Campos de Castilla (1917): « Caminante! No hay camino, se hace camino al andar » ( Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant).
Ce mot d'ordre joue dans l'économie du récit de voyage le rôle du point déclencheur et celui de l'encrage dans la subjectivité du protagoniste principal Alexandre Mauvalant. Bousculé dans son quotidien, il finira par reconnaître, dans « [s]on rapport au temps, aux lieux, aux gens, aux genres, et à [s]on inspiration », qu'il ne sait pas trop bien quel forme donner à cette envie de dépassement que contient la phrase prononcée de manière quasi inconsciente lors de la soirée de promotion.
La réponse quant à la destination du voyage ne tardera pas à se faire connaître. Cet appel vers le large sera incarné par la lettre d'une mystérieuse dame au nom pittoresque, comme il se doit dans tout bon roman, Anna Ivanovna Maria Rosseló habitant à Saint Peter Parish dans la Montserrat Island dans les Antilles britanniques. L'écrivain-voyageur ne tardera pas à informer cette énigmatique complice des conditions du voyage : pas de moyens rapides de voyage, pas d'avions, donc, juste de la marche et de la navigation en bateau, en partant de France, via l'Espagne et le Portugal, le Gibraltar, l'Afrique du Nord et encore en bateau vers la destination finale.
Mauvalant appelle cette lenteur du voyage « un fatalisme serein et difficile à la fois ». En effet, c'est ainsi qu'il aura l'occasion de planter pour ainsi dire sa tente dans plusieurs lieux, de connaître des gens, de se lier d'amitié avec des personnages pittoresques, de connaître des expériences amoureuses qui mettront à l'épreuve sa virilité abîmée par la maladie, de se plonger dans ses notes de voyage comme dans une vie nouvelle et enchanteresse et de vérifier enfin à ses dépens le changement dont il avait parlé avant de se lancer dans cette aventure.
Le mot aventure doit être scruté ici avec toutes les précautions que suppose une telle expérience. le rythme lent, la propension vers l'introspection de l'homme en quête de sens sur sa condition amoindrie par la maladie penchent plutôt vers un divan intérieur qui prend sens en même temps que la contemplation des paysages qu'il traverse avec les destins des semblables qui lui servent de miroir à sa propre personne. Un exemple de style qui en dit long sur l'oeil attentif du voyageur est la description du détroit de Gibraltar sous la beauté de l'aube. Les nuages sont « de formidables cathédrales de nuées tourmentées qui emplissent le ciel, piétinant les confins d'un horizon argenté ». le tout semble prendre l'allure d'un « mirage d'allure biblique ».
Quant à ses rencontres, deux d'entre elles vont compter dans son voyage. Ce sont celles des capitaines de deux navires aux bord desquelles il va se retrouver et qui vont l'aider à atteindre sa destination. Il ne s'agit pas seulement de directions dans le sens de la navigation, mais dans la même mesure de la recherche intérieure de sa condition d'écrivain. En réalité, Alexandre Mauvalant a un contrat avec Vandoven, son éditeur, à qui il doit envoyer régulièrement des notes de voyage en échange du financement de celui-ci.
Le premier capitaine se nomme Larsvic et son navire s'appelle Prizrack, ce qui signifie Fantôme. Personnage haut en couleurs, ce capitaine serbe s'avère être un trafiquant d'armes. Homme tourmenté par ses nombreuses contradictions, par la méfiance et par la maladie, Larsvic va jouer un rôle décisif dans la vie de Mauvalant. C'est lui qui va lui demander d'écrire sa biographie, et pousser ainsi l'écrivain à s'essayer à l'écriture du roman auquel il aspire depuis toujours, de se frotter à ce qu'il appelle « le vent du destin », expression qui, malgré sa réputation de cliché littéraire, donne substance à son projet invraisemblable.
Une révélation apparaît soudainement dans sa conscience d'artiste et d'écrivain. Il va lui donner un nom inhabituel, le Neuf, un état de grâce, une révélation devant la beauté, « un état de conscience […], un lieu culminant du temps dont il reconnaissait l'évanescence, sans pouvoir la capturer ». Plus encore, cet état est encore plus puissant l'aidant à bouillonner l'eau du temps de sa mémoire, « emportant son homme antérieur, chargé du souvenir fantomal qui, depuis le départ, ne l'avait jamais quitté ». La vocation de l'écrivain va prendre le dessus nous laissant entrevoir un Alexandre Mauvalant de plus en plus confiant dans la réussite de cette entreprise dont il avait toujours hésité d'accepter le défi.
Diggs, le capitaine de l'Improbable, est le deuxième personnage tout aussi haut en couleurs que Larsvic. C'est lui qui va conduire Mauvalant dans cette seconde partie de voyage.
Rencontrera-t-il la mystérieuse Anna Ivanovna Maria Rosseló ? Fera-t-il face à cet ultime épisode de son périple ? Pourquoi a-t-il décidé de passer de la première personne à la troisième pour raconter la seconde partie de son histoire ?
Le lecteur aura tout le loisir de le découvrir.
Remarquons quant à nous pour conclure la finesse de l'écriture de Laurent LD Bonnet, le caractère tourmenté de ses personnages et l'appel impératif de sa démarche qui le fait dire ceci : « Je dois me raconter ! Pourquoi ? Pour ne pas m'oublier ».
On comprend ainsi la vraie nuance définitive et bouleversante du voyage d'Ulysse qui se veut être « le dernier ». Cela met en lumière, tout en respectant les codes du récit de voyage, les ressorts les plus cachés et les plus puissants du destin et du devenir d'un héros pris dans les turbulences de la vie et des besoins de donner sens à la vie d'un écrivain comme lui.
Dan Burcea
Laurent LD Bonnet, le dernier Ulysse, Éditions Les Défricheurs, 2021, 450 pages.
Lien : https://lettrescapitales.com..
« Et je m'étais habitué au nom conçu par Vandoven, comme on peut s'habituer à porter chaque jour un même modèle de chemise, m'accommodant de son utilité. Mais à la perspective d'être ainsi lâché dans l'arène télévisuelle, je le sentais pour la première fois se greffer sur moi comme une peau, m'intimant une certitude : j'étais, j'allais être plus que jamais et resterais jusqu'à ma mort, Alexandre Mauvalant. »
Voilà comment est né le grand auteur Alexandre Mauvalant. Un auteur de nouvelles, de poèmes ; connu et reconnu, toujours sous la pression de son éditeur qui en veut toujours plus et toujours mieux ! Un éditeur qui aimerait bien de lui le roman ! Mais voilà, Alexandre est en manque ou peut-être en panne d'inspiration. Que pourrait-il bien écrire qui satisfasse autant son éditeur que sa propre plume.
Alors qu'il reçoit de nombreux courriers de fans, il y en a un qui retient particulièrement son attention. La dame qui lui écrit lui propose de la rencontrer dans son île des Caraïbes. Des mots qui sonnent et résonnent en lui comme un challenge : « vagabondez, voyagez, venez ».
Alexandre prendra alors un tournant dans sa vie. Peut-être celui qui le changera… peu importe le temps que cela prendra, Alexandre retrouvera la destinataire de son courrier. Et ce n'est qu'en passant par les terres et les mers qu'il aboutira à son voyage. C'était sa décision. Un challenge qui ravie son éditeur, prêt à tout pour qu'il lui ponde son Roman !
Mais ce parcours difficile qu'Alexandre s'apprête à mener ne sera pas de tout repos ! Relèvera t-il ce challenge jusqu'au bout ?
Voici un livre aussi magnifique que surprenant. Et des surprises il y en aura ! Autant pour notre personnage que pour nous, lecteurs. J'aime ce genre de lecture où nous sommes plongés dans les pensées torturées de notre personnage. L'on se sent presque normal ! Mes chères lectrices et chers lecteurs, vous suivrez une aventure, certes, extraordinaire ; mais le personnage d'Alexandre est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et c'est un compliment ! Sa vie, ses pensées, ses choix… sont ceux que tout un chacun peut rencontrer dans sa vie. J'appelle ce genre de récit des « lectures terre à terre » parce qu'elles s'inspirent d'un personnage aux prises des tourments de la réalité. Et ça, nous le sommes tous et tous les jours !
Merci Babelio pour ce service presse que j'ai obtenu grâce aux Masses Critiques que vous proposez. Ce livre est une belle découverte !
Et à vous, mes chers lecteurs, je vous souhaite un bon voyage. Ne vous y trompez pas ! La destination n'est pas toujours le plus important mais les chemins que l'on prend, eux si ! Bonne lecture 😘
Voilà comment est né le grand auteur Alexandre Mauvalant. Un auteur de nouvelles, de poèmes ; connu et reconnu, toujours sous la pression de son éditeur qui en veut toujours plus et toujours mieux ! Un éditeur qui aimerait bien de lui le roman ! Mais voilà, Alexandre est en manque ou peut-être en panne d'inspiration. Que pourrait-il bien écrire qui satisfasse autant son éditeur que sa propre plume.
Alors qu'il reçoit de nombreux courriers de fans, il y en a un qui retient particulièrement son attention. La dame qui lui écrit lui propose de la rencontrer dans son île des Caraïbes. Des mots qui sonnent et résonnent en lui comme un challenge : « vagabondez, voyagez, venez ».
Alexandre prendra alors un tournant dans sa vie. Peut-être celui qui le changera… peu importe le temps que cela prendra, Alexandre retrouvera la destinataire de son courrier. Et ce n'est qu'en passant par les terres et les mers qu'il aboutira à son voyage. C'était sa décision. Un challenge qui ravie son éditeur, prêt à tout pour qu'il lui ponde son Roman !
Mais ce parcours difficile qu'Alexandre s'apprête à mener ne sera pas de tout repos ! Relèvera t-il ce challenge jusqu'au bout ?
Voici un livre aussi magnifique que surprenant. Et des surprises il y en aura ! Autant pour notre personnage que pour nous, lecteurs. J'aime ce genre de lecture où nous sommes plongés dans les pensées torturées de notre personnage. L'on se sent presque normal ! Mes chères lectrices et chers lecteurs, vous suivrez une aventure, certes, extraordinaire ; mais le personnage d'Alexandre est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et c'est un compliment ! Sa vie, ses pensées, ses choix… sont ceux que tout un chacun peut rencontrer dans sa vie. J'appelle ce genre de récit des « lectures terre à terre » parce qu'elles s'inspirent d'un personnage aux prises des tourments de la réalité. Et ça, nous le sommes tous et tous les jours !
Merci Babelio pour ce service presse que j'ai obtenu grâce aux Masses Critiques que vous proposez. Ce livre est une belle découverte !
Et à vous, mes chers lecteurs, je vous souhaite un bon voyage. Ne vous y trompez pas ! La destination n'est pas toujours le plus important mais les chemins que l'on prend, eux si ! Bonne lecture 😘
Citations et extraits (6)
Voir plus
Ajouter une citation
Dévastant la fin de siècle puis entamant à présent goulû-ment celui-ci, le grand maelstrom industriel et commercial avait envahi tous les secteurs du livre ; uniformisant, apla-nissant les esprits de pans entiers de la chaîne du métier, plus spécialement celui de la Fiction où j’exerçais tant bien que mal.
Un temps je m’y étais senti protégé, comme sanctuarisé, parce que mon inspiration ne se concrétisait que sur un mode qualifié par Vandoven de minimaliste – pour lui évi-ter de dire nanifié. Nouvelle et Poésie étaient des genres qui passaient encore sous les radars de la religion citoyenne œuvrant désormais au chevet de la grande bête-Roman blessée. On y avait vu affluer des hordes de charognards, prophètes autoproclamés d’un nec plus ultra de l’intellectualité-nouvelle-vague brandissant leur manuel du bien-dire et du bien-penser, rien de moins que les apôtres d’une police idéologique imposée à coup de réseaux vir-tuels. Dans la foulée, on avait assisté à la grand-messe de l’autocensure ordonnée par le clergé de la profession et une partie de ceux qui, sans broncher, bouffaient au râtelier d’un media, d’un mouvement politique, d’une entreprise ou d’une cour quelconque. C’est Pierre qui avait attiré mon attention sur la première victime de cette apocalypse ; nous la connaissions bien, cette petite fille habillée de rouge qui apportait un pot de beurre à sa grand-mère. On venait de la retirer d’une bibliothèque scolaire de Barcelone, sous pré-texte qu’elle véhiculait des clichés d’un autre temps. C’est ce jour-là, que mon esprit avait décidé de s’exiler dans son petit territoire des Nouvelles et Poésies. Jusqu’au jour où j’avais posé les fesses sur le canapé du libraire proactif de Vincennes.
Le buzz et l’émission de télévision – j’en prenais cons-cience ici et maintenant – avaient ouvert une brèche qui jamais ne se serait refermée, laissant s’y engouffrer les dernières tendances de la censure mercantile armée de ses sommations à ne plus écrire sur un genre ou un sexe, si on n’en était pas, sur une nation si on n’en était pas, sur une origine ou une autre si on n’en était pas… Je me serais retrouvé dans quelques années à ne plus avoir droit de m’inspirer que d’une lignée de faits allant de Cro-Magnon en Périgord jusqu’à Homo Sapiens en Île-de-France ; et pire, à l’intérieur de ce bornage, encore aurais-je dû ne pas empiéter sur les enclos de mes voisins de genre ou de couleur. Tragi-comédie d’un apartheid intellectuel – à l’image d’autres ségrégations – la mort de mon libre arbitre créateur. Ma mort, en fait.
Partir obligeait ma forteresse à se reconstruire, ailleurs et autrement, mouvante et insaisissable, prolongeant ainsi ma liberté d’écriture.
Elle s’évadait.
Et j’y étais étrangement encouragé par un des chantres et ordonnateurs du monde éditorial, mon Vandoven à moi, qui, finissais-je par comprendre, avait toujours rêvé de renouveler le sang du monstre mourant, lui injecter une hémoglobine nettoyée, rénovée. Peine perdue avait-il déci-dé : un système doit s’éteindre pour renaître, il ne peut se réformer. Mon éditeur envisageait à présent une logique qu’il qualifiait lui-même de révolutionnaire ; planter dans le cœur de la bête une seringue emplie d’adrénaline. Et je le savais bien, ce satané bonhomme m’avait poussé au voyage dans ce but.
Un temps je m’y étais senti protégé, comme sanctuarisé, parce que mon inspiration ne se concrétisait que sur un mode qualifié par Vandoven de minimaliste – pour lui évi-ter de dire nanifié. Nouvelle et Poésie étaient des genres qui passaient encore sous les radars de la religion citoyenne œuvrant désormais au chevet de la grande bête-Roman blessée. On y avait vu affluer des hordes de charognards, prophètes autoproclamés d’un nec plus ultra de l’intellectualité-nouvelle-vague brandissant leur manuel du bien-dire et du bien-penser, rien de moins que les apôtres d’une police idéologique imposée à coup de réseaux vir-tuels. Dans la foulée, on avait assisté à la grand-messe de l’autocensure ordonnée par le clergé de la profession et une partie de ceux qui, sans broncher, bouffaient au râtelier d’un media, d’un mouvement politique, d’une entreprise ou d’une cour quelconque. C’est Pierre qui avait attiré mon attention sur la première victime de cette apocalypse ; nous la connaissions bien, cette petite fille habillée de rouge qui apportait un pot de beurre à sa grand-mère. On venait de la retirer d’une bibliothèque scolaire de Barcelone, sous pré-texte qu’elle véhiculait des clichés d’un autre temps. C’est ce jour-là, que mon esprit avait décidé de s’exiler dans son petit territoire des Nouvelles et Poésies. Jusqu’au jour où j’avais posé les fesses sur le canapé du libraire proactif de Vincennes.
Le buzz et l’émission de télévision – j’en prenais cons-cience ici et maintenant – avaient ouvert une brèche qui jamais ne se serait refermée, laissant s’y engouffrer les dernières tendances de la censure mercantile armée de ses sommations à ne plus écrire sur un genre ou un sexe, si on n’en était pas, sur une nation si on n’en était pas, sur une origine ou une autre si on n’en était pas… Je me serais retrouvé dans quelques années à ne plus avoir droit de m’inspirer que d’une lignée de faits allant de Cro-Magnon en Périgord jusqu’à Homo Sapiens en Île-de-France ; et pire, à l’intérieur de ce bornage, encore aurais-je dû ne pas empiéter sur les enclos de mes voisins de genre ou de couleur. Tragi-comédie d’un apartheid intellectuel – à l’image d’autres ségrégations – la mort de mon libre arbitre créateur. Ma mort, en fait.
Partir obligeait ma forteresse à se reconstruire, ailleurs et autrement, mouvante et insaisissable, prolongeant ainsi ma liberté d’écriture.
Elle s’évadait.
Et j’y étais étrangement encouragé par un des chantres et ordonnateurs du monde éditorial, mon Vandoven à moi, qui, finissais-je par comprendre, avait toujours rêvé de renouveler le sang du monstre mourant, lui injecter une hémoglobine nettoyée, rénovée. Peine perdue avait-il déci-dé : un système doit s’éteindre pour renaître, il ne peut se réformer. Mon éditeur envisageait à présent une logique qu’il qualifiait lui-même de révolutionnaire ; planter dans le cœur de la bête une seringue emplie d’adrénaline. Et je le savais bien, ce satané bonhomme m’avait poussé au voyage dans ce but.
Était-ce dû au poids émotionnel ? Ou à l’emphase facile que m’offrait la scène, sorte d’aura majestueuse qui se dégageait de cette équipe au fonctionnement rodé ? Chaque mouvement de ces hommes correspondait à un rôle coordonné au milieu d’une cascade de cris éjectés en desserrant à peine les dents, codes ponctuant chaque étape de la manutention. Tout cela s’accomplissait dans les faisceaux croisés des projecteurs de pont. Les ombres s’allongeaient, enflaient la gestuelle. Plus qu'une livraison de marchandise, c'était une chorégraphie du métier.
Un ordre bref de Larsvic retentit. Tout s’arrêta. La palanquée, trois tonnes au bas mot, oscillait dans l’air, débordant d’environ un mètre au-dessus de l’embarcation en attente, suivant le roulis régulier qui nous obligeait tous à chalouper au même rythme. J’interrogeai Dakira du regard. Il dressa l’index, me faisant signe de patienter. Un des matelots s’approcha du bastingage, balança une échelle de corde, on vit deux mains s’agripper au plat-bord ; un militaire, guinéen imaginai-je, homme d’une trentaine d’années, vêtu d’un treillis de campagne, cheveux ras, béret rouge glissé sous l’épaulette de son grade, se hissa à bord. Il portait un sac de sport sous le bras, le déposa à terre au pied de la coursive supérieure, leva les yeux et salua Larsvic d’une paume rapide pointée sur la tempe. L’autre hocha de la tête, disparut de la passerelle et réapparut un instant plus tard sur le pont. Les deux hommes se serrèrent la main et engagèrent une brève discussion. Le ton monta après qu'ils eurent vérifié le contenu du sac. Larsvic fit signe au militaire de le suivre.
Un ordre bref de Larsvic retentit. Tout s’arrêta. La palanquée, trois tonnes au bas mot, oscillait dans l’air, débordant d’environ un mètre au-dessus de l’embarcation en attente, suivant le roulis régulier qui nous obligeait tous à chalouper au même rythme. J’interrogeai Dakira du regard. Il dressa l’index, me faisant signe de patienter. Un des matelots s’approcha du bastingage, balança une échelle de corde, on vit deux mains s’agripper au plat-bord ; un militaire, guinéen imaginai-je, homme d’une trentaine d’années, vêtu d’un treillis de campagne, cheveux ras, béret rouge glissé sous l’épaulette de son grade, se hissa à bord. Il portait un sac de sport sous le bras, le déposa à terre au pied de la coursive supérieure, leva les yeux et salua Larsvic d’une paume rapide pointée sur la tempe. L’autre hocha de la tête, disparut de la passerelle et réapparut un instant plus tard sur le pont. Les deux hommes se serrèrent la main et engagèrent une brève discussion. Le ton monta après qu'ils eurent vérifié le contenu du sac. Larsvic fit signe au militaire de le suivre.
Au pied des falaises du mont Risco de la Conception, le El Puertito survivait, adossé à un bout de jetée entre India-nos et la mer, un peu à l’écart en bordure du bassin des pêcheurs, un coin à l’allure pas trop glamour qui par en-droit sentait la poiscaille, les filets mal rincés, le pas tout à fait propre, pas tout à fait fini, en somme l’imparfait. Toute une flopée de personnages s’y donnait rendez-vous, char-riant petites et grandes raisons ; un carénage à prévoir ou un bateau à vendre, une pièce détachée à trouver ou un rêve de navigation à laisser flotter dans les nuages. Derrière trois murets en parpaings, sous un auvent orangé, des gros fûts servaient de siège. Et on badait là, entre un bocadillo especial et une cerveza tropical, à regarder les manœuvres bruyantes des ferries de liaison rapide pour Areciffe, Tene-riffe ou La Gomera, celles de paquebots qui dressaient leurs ombres rectangulaires dans le ciel, et on commentait l’arrivée de lourds cargos en provenance d’Espagne, ou de pays plus lointains qui avançaient leurs pions sur ce petit bout d’Europe.
Une aube brutale inondait le flanc sud de la colline mas-sive et déserte où je parvenais. À mes pieds s’ouvrait un vide qui me parut gigantesque, le rivage septentrional du détroit. Sur ma droite, plantées dans l’ouest océanique, menaçaient de formidables cathédrales de nuées tourmen-tées ; elles emplissaient le ciel, s’avançant sur leurs jambes de pluie boursouflées, piétinant les confins d’un horizon argenté. Alors qu’au sud, le vaste passage s’étendait, nimbé de longues strates cotonneuses qui stagnaient à cinquante mètres au-dessus de la mer, occultant tout navire, toute humanité, formant ainsi une monumentale plaine grise qui s’étalait, calme et irrévocable, jusqu’à la terre d’Afrique, d’où jaillissait, dantesque, comme propulsée devant moi, car dilatée et grossie par les milliards de particules d’humidité en suspension dans l’air, la masse déchiquetée du Djebel Moussa, offerte sur un écrin de brume.
Il faut l’admettre, je ne serai jamais que le petit homme de Reich, aux antipodes de l’homme supérieur, Zarathoustra peut aller se faire voir, pour ce que je comprends, je ne suis pas prêt de muter : Ah, chameau sûrement ! Ça oui, pour me charger de fardeaux pesants, je sais le faire. Les emporter au désert, aussi. Hélas tout s’y enlise. Et l’esprit du Lion ne règne sûrement pas en moi, car je ne saurais conquérir cette liberté d’esprit. Quant à retrouver une prolifique candeur enfantine, n’y pensons même pas. Aucun prophète ne peut rien à la grande maladie dont je suis vraiment atteint : la banalité.
Videos de Laurent LD Bonnet (5)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : imaginaireVoir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Laurent LD Bonnet (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Existe t il un code secret de la rencontre ?
Quel est le prénom de la femme que rencontre Antoine ?
Landra
Léa
Aline
5 questions
1 lecteurs ont répondu
Thème : Dix secondes de
Laurent L.D. BonnetCréer un quiz sur ce livre1 lecteurs ont répondu