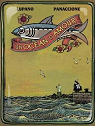Revue Cahiers de Géopoétique
EAN : 9782881822704
Editions Zoé (19/05/1998)
/5
1 notes
Editions Zoé (19/05/1998)
Résumé :
Un monde, c'est ce qui émerge du rapport entre l'homme et la terre. Quand ce rapport est sensible, intelligent, complexe, le monde est monde au sens profond du mot : un bel espace où vivre pleinement. L'ambition des "Cahiers de Géopoétique" est de dresser, d'un point de vue qui ne pas seulement celui de l'Homme, une "magna mundi carta"; une grande carte, une grande charte du monde.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Cahiers de géopoétique, numéro 5Voir plus
Citations et extraits (26)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans deux textes, il en fait même très précisément la généalogie. Le premier s’intitule Histoire de la contemplation physique de l’univers, le deuxième Descriptions poétiques de la nature.
Au premier abord, l’Histoire de la contemplation physique de l’univers pourrait ne sembler qu’une histoire abrégée de la science, des sciences. Mais les sciences séparées ne peuvent fournir que des matériaux pour le fondement de ce que Humboldt appelle «la science du cosmos», ou encore «le développement de l’idée de cosmos», ou bien encore, en citant Otfried Müller, l’élaboration de l’«idée poétique de la terre».
Pour le propos général, il cite son frère, Wilhelm von Humboldt: «Il peut paraître étrange de vouloir allier la poésie, qui se plait dans la variété, la forme et la couleur, aux idées les plus simples et les plus abstruses. Mais cela se justifie pleinement. La poésie, la science, la philosophie et l’histoire ne sont pas essentiellement séparées les unes des autres. Elles sont unies, ou bien quand une certaine étape du progrès humain situe l’homme dans un état unitaire, ou bien quand une inspiration authentiquement poétique projette l’individu dans un tel état.» Humboldt se lance alors dans son historique, en prenant le soin de préciser qu’il va aller vite, qu’il ne s’agit pas de se perdre dans les détails, mais de voir des lignes de crête, de dessiner une configuration (certaines époques, certaines œuvres peuvent n’avoir qu’une ligne intéressante, c’est celle-là qu’il s’agit de dégager, en la combinant avec d’autres dégagées d’autres contextes).
Dans l’Histoire de la contemplation physique de l’univers, Humboldt distingue, en Occident, sept époques, sept aires: 1º la Méditerranée; 2º la Macédoine sous Alexandre le Grand; 3º l’Egypte des Ptolémée; 4º l’Empire romain; 5º l’Arabie; 6º les grandes découvertes océaniques; 7º les découvertes célestes. Grâce à l’esprit «vivant et mobile» des Grecs, la Méditerranée avait connu «un élargissement rapide du cercle des idées». Mais il n’y avait pas que les Grecs, il y avait les Phéniciens, avec leurs voyages et leur alphabet, les Etrusques, avec leur «penchant à cultiver des rapports intimes avec les phénomènes naturels». S’alliaient donc une expansion vers le monde extérieur et une augmentation de la vision contemplative... Avec Alexandre, «le nouveau champ à considérer» prenait d’autres proportions encore: de nouveaux matériaux exigeaient de nouvelles coordinations, une nouvelle compréhension intellectuelle - recherche empirique rencontrant haute spéculation, le tout essayant de trouver son langage. Si, en Egypte, l’école d’Alexandrie tenait à s’enfermer dans la pure érudition, manquant d’«esprit animé», il y eut pourtant Eratosthène, qui avait un «œil intellectuel». A Rome aussi, pour ce qui est de la «formation de conceptions supérieures», il y a un manque, mais Strabon, celui qui, après avoir écrit quarante-trois livres d’histoire, se mit à son ouvrage géographique à l’âge de quatre-vingt-trois ans, avait une bonne connaissance de l’Empire, depuis l’Arménie jusqu’à la côte tyrrhénienne, depuis la mer Noire jusqu’aux bords de l’Afrique, et Pline (Plinius Secundus) sentait qu’il marchait sur des sentiers jamais foulés avant lui («non trita autoribus via»). Dommage qu’il se soit perdu dans des détails de spécialiste, au lieu de garder dans l’esprit une «image unique» potentielle. Chez les Arabes, l’intérêt de Humboldt se porte sur les tribus nomades, qui connaissent «le visage ouvert de la nature» et qui ont «une sensation plus fraîche des choses» qu’il ne fut possible dans les cités grecques et romaines. Chez les voyageurs et géographes arabes, il constate une sensation et une connaissance de l’espace plus grandes encore que, chez Marco Polo ou les moines bouddhistes. Il évoque El-Istachri et son Livre des régions du monde, Ibn Sinâ (Avicenne), le botaniste Ibn Baithar et Ibn Ruschd (Averroes), qui surent suivre «les chemins solitaires du développement des idées». Il se penche ensuite sur les grandes cosmographies qui, en agrandissant la vision des choses, ont ouvert la voie aux découvertes océaniques: le Liber cosmophicus de natura locorum d’Albertus Magnus, le Fenix de las maravillas del Orbe de Raymond Lulle, l’Imago Mundi de Pierre d’Ailly, beaucoup lu par Colomb, sans oublier l’Opus Maius de Roger Bacon. Défilent alors devant nos yeux Plan Carpin, Sir John Mandeville, Balduccio Pegolotti, Ruy Gonzalez de Clavijo, et Colomb lui-même, toujours lui, muni du livre de Pierre d’Ailly ainsi que de la carta de marear que lui avait envoyée Toscanelli de Florence, suivi de Magellan, de Balboa, de Cortez, de Léonard de Vinci, dont les idées les plus intéressantes sont restées longtemps dans ses manuscrits (e.g. le Codex Atlanticus), et Dante, qui avait vu des cartes célestes arabes et parlé avec des voyageurs en Orient, et qui savait allier érudition, errance intellectuelle et inspiration... Et on en arrive à la septième époque, celle de l’ouverture de l’espace astronomique grâce au télescope, où nous rencontrons les figures de Léonard Euler, de Copernic (De revolutionibus orbium caelestium), de Kepler, de Huygens, de Herschel et de Galilée.
Humboldt insiste sur le fait que cette étude, écrite d’une manière «fragmentaire et générale» ne vise ni à être parfaite ni à être complète. C’est très précisément une esquisse. Mais il aurait été prêt à reconnaître que même en tant qu’esquisse, elle peut laisser à désirer, d’un point de vue qui ne soit ni celui de la perfection, ni celui de l’exhaustivité. Par exemple, il n’arrive pas à se maintenir sur, la ligne de crête qu’il s’était proposée - il va parler de la polarisation de la lumière étudiée par Arago, alors que cela appartient à la «science spéciale», et non pas à la «science du cosmos». Et il a des problèmes de composition. En fait, comme on le verra, une des questions que se pose, de plus en plus, Humboldt, est celle d’une poétique - non pas une poétique de la perfection, mais une poétique de la pérégrination: informée, intelligente, animée, réjouissante, éclairante et inspirante. L’essentiel, c’est que, dans son étude fragmentaire sur la «contemplation physique de l’univers», se trouvent quelques-unes de ces pistes qu’il a voulu dessiner, ces pistes de la pensée qui, un jour, mèneront à une «image», c’est-à-dire à une grande vision poétique du monde. L’accent est sur l’ouverture, sur l’avancée. «Les esprits faibles, écrit-il, sont toujours prêts, à toutes les époques, à déclarer avec complaisance que l’humanité a atteint le sommet du progrès intellectuel» - ou, ajouterons-nous, en pensant à l’époque actuelle, à déclarer que tout est terminé. Mais en fait, le champ à explorer devient de plus en plus vaste, l’horizon recule toujours: «il existe des forces, opérant encore silencieusement dans la nature élémentaire, comme dans les délicates cellules des tissus organiques, dont nous ne sommes pas encore conscients mais qui, un jour, entreront dans le champ de la connaissance». Il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup d’observations, beaucoup de combinaisons, et beaucoup de communication. Bref, pour ceux qui sont conscients, le champ s’élargit et s’approfondit tous les jours. Voilà le dernier mot de Humboldt sur la «contemplation physique».
Reste la question de l’expression, qui n’est pas une question secondaire, mais une question primordiale, car l’être de l’homme a besoin de s’exprimer - mais quel homme, quel être, quelle expression? C’est à la «généalogie de l’expression poétique» satisfaisante, éclairante, que s’attache Humboldt dans l’autre étude fondatrice, Descriptions poétiques de la nature. Et de même que dans l’étude sur la «contemplation physique», il n’écrivait pas l’histoire des sciences, de même ici Humboldt n’écrit pas l’histoire de la littérature, mais élabore, grâce à quelques incursions perspicaces et perspectivistes dans le corpus de la littérature mondiale, la géographie de la puissance poétique, c’est-à-dire du rapport le plus profond entre l’homme et... la nature (aucun mot, ici, n’est satisfaisant). Les mots d’Humboldt, comme on a déjà pu le constater, sont ceux de son époque. Humboldt est un scientifique, un intellectuel, qui a une «vision», une «prémonition» de la poésie dont sont incapables la plupart de ceux qui sont appelés ou qui s’appellent «poètes». On est dans le paradoxe, le paradoxe excitant - c’est ce qui remplace avantageusement le paradis. Humboldt va donc utiliser les mots «sentimental» (qui lui vient de Schiller, dont le texte l’Education esthétique de l’humanité n’est pas étranger à tout ce contexte), «romantique», «pittoresque» - mais sa lancée dépasse son langage. Son exploration de la littérature poétique depuis les Grecs et les Romains jusqu’aux «voyageurs modernes» veut ouvrir un espace de possibilités inouïes - encore une fois, il s’agit de repérer, de comparer, de combiner, de composer: géographie multi-dimensionnelle du verbe...
Pour Humboldt, dans la littérature grecque classique, l’accent est mis exclusivement sur l’humain: passion et politique, la nature ne servant que de toile de fond, ou comme répertoire de comparaisons. Même quand on traite plus spécifiquement de la nature, l’approche est descriptive, didactique, il y a peu de «contemplation inspirée». Mais il existe quelques exceptions à cette règle, parmi elles les Dionysiaca de Nonnos de Panopolis. Quant aux Romains, leur esprit est légiste, militaire ou domestique, et leur langue a moins de «mobilité idéale» que le grec, mais Lucrèce se distingue par son «génie fertile», et on trouve une présence de la nature chez Virgile, Horace, Tibulle, Ovide, sans oublier «la belle description d’une forêt druidique» chez Lucain, ce qui fait noter à Humboldt, en passant, que chez les anciennes tribus germaniques et celtiques on constate une véritable «vénération de la nature», exprimée par «de rudes symboles».
Au premier abord, l’Histoire de la contemplation physique de l’univers pourrait ne sembler qu’une histoire abrégée de la science, des sciences. Mais les sciences séparées ne peuvent fournir que des matériaux pour le fondement de ce que Humboldt appelle «la science du cosmos», ou encore «le développement de l’idée de cosmos», ou bien encore, en citant Otfried Müller, l’élaboration de l’«idée poétique de la terre».
Pour le propos général, il cite son frère, Wilhelm von Humboldt: «Il peut paraître étrange de vouloir allier la poésie, qui se plait dans la variété, la forme et la couleur, aux idées les plus simples et les plus abstruses. Mais cela se justifie pleinement. La poésie, la science, la philosophie et l’histoire ne sont pas essentiellement séparées les unes des autres. Elles sont unies, ou bien quand une certaine étape du progrès humain situe l’homme dans un état unitaire, ou bien quand une inspiration authentiquement poétique projette l’individu dans un tel état.» Humboldt se lance alors dans son historique, en prenant le soin de préciser qu’il va aller vite, qu’il ne s’agit pas de se perdre dans les détails, mais de voir des lignes de crête, de dessiner une configuration (certaines époques, certaines œuvres peuvent n’avoir qu’une ligne intéressante, c’est celle-là qu’il s’agit de dégager, en la combinant avec d’autres dégagées d’autres contextes).
Dans l’Histoire de la contemplation physique de l’univers, Humboldt distingue, en Occident, sept époques, sept aires: 1º la Méditerranée; 2º la Macédoine sous Alexandre le Grand; 3º l’Egypte des Ptolémée; 4º l’Empire romain; 5º l’Arabie; 6º les grandes découvertes océaniques; 7º les découvertes célestes. Grâce à l’esprit «vivant et mobile» des Grecs, la Méditerranée avait connu «un élargissement rapide du cercle des idées». Mais il n’y avait pas que les Grecs, il y avait les Phéniciens, avec leurs voyages et leur alphabet, les Etrusques, avec leur «penchant à cultiver des rapports intimes avec les phénomènes naturels». S’alliaient donc une expansion vers le monde extérieur et une augmentation de la vision contemplative... Avec Alexandre, «le nouveau champ à considérer» prenait d’autres proportions encore: de nouveaux matériaux exigeaient de nouvelles coordinations, une nouvelle compréhension intellectuelle - recherche empirique rencontrant haute spéculation, le tout essayant de trouver son langage. Si, en Egypte, l’école d’Alexandrie tenait à s’enfermer dans la pure érudition, manquant d’«esprit animé», il y eut pourtant Eratosthène, qui avait un «œil intellectuel». A Rome aussi, pour ce qui est de la «formation de conceptions supérieures», il y a un manque, mais Strabon, celui qui, après avoir écrit quarante-trois livres d’histoire, se mit à son ouvrage géographique à l’âge de quatre-vingt-trois ans, avait une bonne connaissance de l’Empire, depuis l’Arménie jusqu’à la côte tyrrhénienne, depuis la mer Noire jusqu’aux bords de l’Afrique, et Pline (Plinius Secundus) sentait qu’il marchait sur des sentiers jamais foulés avant lui («non trita autoribus via»). Dommage qu’il se soit perdu dans des détails de spécialiste, au lieu de garder dans l’esprit une «image unique» potentielle. Chez les Arabes, l’intérêt de Humboldt se porte sur les tribus nomades, qui connaissent «le visage ouvert de la nature» et qui ont «une sensation plus fraîche des choses» qu’il ne fut possible dans les cités grecques et romaines. Chez les voyageurs et géographes arabes, il constate une sensation et une connaissance de l’espace plus grandes encore que, chez Marco Polo ou les moines bouddhistes. Il évoque El-Istachri et son Livre des régions du monde, Ibn Sinâ (Avicenne), le botaniste Ibn Baithar et Ibn Ruschd (Averroes), qui surent suivre «les chemins solitaires du développement des idées». Il se penche ensuite sur les grandes cosmographies qui, en agrandissant la vision des choses, ont ouvert la voie aux découvertes océaniques: le Liber cosmophicus de natura locorum d’Albertus Magnus, le Fenix de las maravillas del Orbe de Raymond Lulle, l’Imago Mundi de Pierre d’Ailly, beaucoup lu par Colomb, sans oublier l’Opus Maius de Roger Bacon. Défilent alors devant nos yeux Plan Carpin, Sir John Mandeville, Balduccio Pegolotti, Ruy Gonzalez de Clavijo, et Colomb lui-même, toujours lui, muni du livre de Pierre d’Ailly ainsi que de la carta de marear que lui avait envoyée Toscanelli de Florence, suivi de Magellan, de Balboa, de Cortez, de Léonard de Vinci, dont les idées les plus intéressantes sont restées longtemps dans ses manuscrits (e.g. le Codex Atlanticus), et Dante, qui avait vu des cartes célestes arabes et parlé avec des voyageurs en Orient, et qui savait allier érudition, errance intellectuelle et inspiration... Et on en arrive à la septième époque, celle de l’ouverture de l’espace astronomique grâce au télescope, où nous rencontrons les figures de Léonard Euler, de Copernic (De revolutionibus orbium caelestium), de Kepler, de Huygens, de Herschel et de Galilée.
Humboldt insiste sur le fait que cette étude, écrite d’une manière «fragmentaire et générale» ne vise ni à être parfaite ni à être complète. C’est très précisément une esquisse. Mais il aurait été prêt à reconnaître que même en tant qu’esquisse, elle peut laisser à désirer, d’un point de vue qui ne soit ni celui de la perfection, ni celui de l’exhaustivité. Par exemple, il n’arrive pas à se maintenir sur, la ligne de crête qu’il s’était proposée - il va parler de la polarisation de la lumière étudiée par Arago, alors que cela appartient à la «science spéciale», et non pas à la «science du cosmos». Et il a des problèmes de composition. En fait, comme on le verra, une des questions que se pose, de plus en plus, Humboldt, est celle d’une poétique - non pas une poétique de la perfection, mais une poétique de la pérégrination: informée, intelligente, animée, réjouissante, éclairante et inspirante. L’essentiel, c’est que, dans son étude fragmentaire sur la «contemplation physique de l’univers», se trouvent quelques-unes de ces pistes qu’il a voulu dessiner, ces pistes de la pensée qui, un jour, mèneront à une «image», c’est-à-dire à une grande vision poétique du monde. L’accent est sur l’ouverture, sur l’avancée. «Les esprits faibles, écrit-il, sont toujours prêts, à toutes les époques, à déclarer avec complaisance que l’humanité a atteint le sommet du progrès intellectuel» - ou, ajouterons-nous, en pensant à l’époque actuelle, à déclarer que tout est terminé. Mais en fait, le champ à explorer devient de plus en plus vaste, l’horizon recule toujours: «il existe des forces, opérant encore silencieusement dans la nature élémentaire, comme dans les délicates cellules des tissus organiques, dont nous ne sommes pas encore conscients mais qui, un jour, entreront dans le champ de la connaissance». Il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup d’observations, beaucoup de combinaisons, et beaucoup de communication. Bref, pour ceux qui sont conscients, le champ s’élargit et s’approfondit tous les jours. Voilà le dernier mot de Humboldt sur la «contemplation physique».
Reste la question de l’expression, qui n’est pas une question secondaire, mais une question primordiale, car l’être de l’homme a besoin de s’exprimer - mais quel homme, quel être, quelle expression? C’est à la «généalogie de l’expression poétique» satisfaisante, éclairante, que s’attache Humboldt dans l’autre étude fondatrice, Descriptions poétiques de la nature. Et de même que dans l’étude sur la «contemplation physique», il n’écrivait pas l’histoire des sciences, de même ici Humboldt n’écrit pas l’histoire de la littérature, mais élabore, grâce à quelques incursions perspicaces et perspectivistes dans le corpus de la littérature mondiale, la géographie de la puissance poétique, c’est-à-dire du rapport le plus profond entre l’homme et... la nature (aucun mot, ici, n’est satisfaisant). Les mots d’Humboldt, comme on a déjà pu le constater, sont ceux de son époque. Humboldt est un scientifique, un intellectuel, qui a une «vision», une «prémonition» de la poésie dont sont incapables la plupart de ceux qui sont appelés ou qui s’appellent «poètes». On est dans le paradoxe, le paradoxe excitant - c’est ce qui remplace avantageusement le paradis. Humboldt va donc utiliser les mots «sentimental» (qui lui vient de Schiller, dont le texte l’Education esthétique de l’humanité n’est pas étranger à tout ce contexte), «romantique», «pittoresque» - mais sa lancée dépasse son langage. Son exploration de la littérature poétique depuis les Grecs et les Romains jusqu’aux «voyageurs modernes» veut ouvrir un espace de possibilités inouïes - encore une fois, il s’agit de repérer, de comparer, de combiner, de composer: géographie multi-dimensionnelle du verbe...
Pour Humboldt, dans la littérature grecque classique, l’accent est mis exclusivement sur l’humain: passion et politique, la nature ne servant que de toile de fond, ou comme répertoire de comparaisons. Même quand on traite plus spécifiquement de la nature, l’approche est descriptive, didactique, il y a peu de «contemplation inspirée». Mais il existe quelques exceptions à cette règle, parmi elles les Dionysiaca de Nonnos de Panopolis. Quant aux Romains, leur esprit est légiste, militaire ou domestique, et leur langue a moins de «mobilité idéale» que le grec, mais Lucrèce se distingue par son «génie fertile», et on trouve une présence de la nature chez Virgile, Horace, Tibulle, Ovide, sans oublier «la belle description d’une forêt druidique» chez Lucain, ce qui fait noter à Humboldt, en passant, que chez les anciennes tribus germaniques et celtiques on constate une véritable «vénération de la nature», exprimée par «de rudes symboles».
Chez les poètes hébreux, la nature est l’expression vivante de l’omniprésence de Dieu, et leur intérêt se porte moins sur des phénomènes isolés que sur des «grandes masses». Comment nier la grandeur du Psaume 104: «Les arbres du Seigneur sont pleins de sève, les cèdres du Liban qu’il a plantés...», ou bien encore le livre de Job: «Le Seigneur marche sur les hauteurs de la mer, sur la crête des vagues amoncelées par la tempête» - tout en se disant, peut-être, que dans ce spectacle divin, Dieu occupe un peu trop la scène. Pour Humboldt, le christianisme avait libéré l’œil contemplatif en le détournant des dieux, de sorte que la nature prend toute sa valeur - création et expression de Dieu, certes, comme dans la poésie hébraïque, mais d’une manière moins théocratiquement imposante. Il cite comme un de ses textes préférés une lettre de Basile, un Grec de Cappadoce, ermite chrétien sur les rives de l’Iris en Arménie: «Te parlerai-je du beau chant des oiseaux, et de la profusion de fleurs ? Ce qui me charme le plus, c’est la tranquillité absolue de la région...» Il y a dans cette lettre, dit Humboldt, des sentiments et des sensations plus proches de ceux de l’époque moderne que tout ce que l’on peut trouver chez les Grecs ou chez les Romains. Mais le christianisme allait se détourner de plus en plus de la nature, y voyant le diable, et de toute étude de la nature, y voyant de la sorcellerie... En Asie, l’aube et le soleil resplendissent dans le Rig-Veda, symboles d’une religion cosmique dont on retrouve des éléments dans la mythologie populaire, par exemple la vie de Râma dans la forêt, ou bien encore dans la poésie de Kâlidâsa qui, dans le Meghaduta, décrit le passage d’un nuage ainsi que les paysages qu’il traverse. Chez les Perses (Firdûsî, Hâfiz, Saadi, AI Rûmî) la grande nature est moins présente, leur intérêt se portant sur des paysages aménagés (jardins, fontaines...) et sur des artifices de forme.
Les Arabes, eux, aiment chanter la guerre et l’amour, mais il y a aussi la vie du désert, telle qu’on la trouve dans la romance bédouine Antar. Après ce tour du monde antique, Humboldt, toujours à la recherche d’éléments d’une «poésie de la nature» satisfaisante, se tourne vers le monde moderne, à commencer par Dante Alighieri, «le fondateur inspiré du nouveau monde», dont la puissance référentielle et intellectuelle n’a d’égale que sa sensibilité à des impressions immédiates, telle «il tremolar della marina». Signe des temps aussi, l’ascension du mont Ventoux par Pétrarque, qui, malheureusement, reste empêtré dans l’allégorie et dans la morale. Bembo, par contre, dans son Aetnae Dialogus, donne un tableau animé de la géographie des plantes sur le volcan, depuis les champs de blé de la Sicile jusqu’aux marges enneigées du cratère. Et puis, encore et toujours, Colomb, décrivant la terre nouvelle avec ses arbres et ses fruits et ses lindas aguas, sentant que «mille langues ne suffiraient pas à la dire: "Para hacer relacion a los Reyes de las cosas que vian, no bastaran mil lenguas a referillo, ni la mano para la escribir, que le parecia questaba encantado. "» Et Camoens à Macao, emporté par la mer, le vent et les nuages, marin de l’âme, chantre de la gloire portugaise, qui pourtant parle beaucoup plus des épices, à valeur commerciale, que d’autres plantes tropicales... On passe alors par Shakespeare, sensible à «l’expression individuelle de la nature», et par Milton, sublime, mais dont les descriptions sont plus magnifiques que graphiques, pour arriver au XVIIIe siècle, à l’époque des Buffon, Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, à toute une nouvelle série de tentatives pour s’approcher de la nature et pour dire ce terrain de rencontre d’une manière à la fois exacte et inspirante. Buffon accumule les faits exacts, mais ses phrases sont construites trop artificiellement et on ne sent pas chez lui cette «analogie mystérieuse entre les mouvements de l’esprit et les phénomènes perçus par les sens» qui est l’objet des recherches de Humboldt à ce stade ultime de ses pérégrinations. Chez Rousseau, le moi est souvent trop présent; chez Chateaubriand, pourrait-on dire, aussi, lui dont les passages à travers la terre s’accompagnent toujours de souvenirs historiques. Quant à Bernardin de Saint-Pierre, Humboldt l’a beaucoup lu, et avec délices, mais ses théories sont trop souvent saugrenues. Au fond, dès qu’il est question de nature à l’époque moderne, il est difficile de sortir du pastoral, de l’élégiaque, de l’idyllique, du didactique, de l’excessivement sentimental, etc. On a beau écrire d’une manière élevée, la pauvreté des matériaux et de l’information de base est par trop évidente -d’où, d’ailleurs, des tentatives de compensation par le style. Dans le passé, dans les anciens livres de voyages, par exemple, la pauvreté des matériaux était compensée par la naïveté, par une faculté d’émerveillement enfantine, ou encore par la dramatisation, une coloration épique. Mais rien de tout cela n’est possible aujourd’hui, c’est autre chose qu’il faut trouver. Nous avons affaire à une masse d’informations qu’il s’agit non seulement d’ordonner, mais à laquelle il faut aussi donner une aura, une lumière. Il serait possible d’atteindre à «une espèce de délice intellectuel» que les Anciens ne pouvaient connaître - mais quelle littérature est vraiment à la hauteur? On peut recueillir des éléments par-ci, par-là, mais on attend toujours «un élargissement du champ de l’art», on attend toujours une poétique qui sache «présenter à la contemplation de l’intellect et de l’imagination la riche matière du savoir moderne». Il ne peut être question de vagues analogies, de métaphores creuses, de mythes symbolistes, il s’agit de définition et de respiration, d’exactitude et d’extase, de sensorialité et d’intelligence, et d’une écriture qui soit autre chose que «du style», ou je ne sais quelle «prose poétique» maniérée.
Tout au long de son œuvre, depuis les premières notes prises dans les llanos, ou dans la forêt tropicale humide, ou sur les rives de l’Orénoque, jusqu’aux rédactions et aux compositions de Paris et de Berlin, Humboldt a essayé lui-même de s’approcher de cette littérature plus que «de la littérature» qu’il voyait poindre à l’horizon. On peut dire que cette œuvre consiste en relations, en études et en essais poétiques. Ces «essais poétiques» peuvent se trouver dans les relations et dans les études dont j’ai déjà cité quelques exemples, mais Humboldt y a consacré un livre spécifique, les Ansichten der Natur, traduit en français par Vues de la nature et en anglais par Views of Nature. Il n’y a rien à reprocher à ces deux traductions. Cela vaut cependant la peine de faire remarquer que dans une lettre adressée à son éditeur londonien, Humboldt lui-même écrit «views into nature». On peut imputer cela à l’insuffisance de son anglais, on peut aussi y voir une nuance intéressante.
Il s’agit dans les Ansichten de tentatives de «tableaux intégrés», où se lirait «la coopération des forces» de la nature, dans une prose qui se veut à la fois vigoureuse et flexible, le tout voulant à la fois engager l’imagination, augmenter la connaissance des choses (configurations cachées, relations plastiques profondes), et enrichir la vie par la présentation de nouvelles idées. Avec une petite fable, «La force vitale, ou le génie rhodien», qui n’y a sans doute pas véritablement sa place (mais Humboldt a du mal à «caser» tout ce qui lui vient à l’esprit), il y a dans ce livre six essais en tout: «Les steppes et les déserts», «La vie nocturne des animaux dans la forêt primitive», «Idées pour une physionomie des plantes», «Sur la structure et le mode d’action des volcans», «Le plateau de Caxamarca». Dire que ces essais répondaient complètement à ses vœux serait exagéré, disons simplement que c’est le livre auquel, en fin de compte, il tenait le plus, c’est là qu’il a mis le plus de lui-même, c’est là qu’il a consigné le plus de ses aperçus, c’est là qu’il offre le plus d’indications.
Le voici de nouveau sur les llanos, ces «steppes» du Venezuela:
«C’est dans la Mesa de Paja, par les 9° de latitude, que nous entrâmes dans le bassin des llanos. Le soleil était presque au zénith; la terre partout où elle se montrait stérile et dépouillée de végétation, avait jusqu’à 48° et 50° de température. Aucun souffle de vent ne se faisait sentir à la hauteur à laquelle nous nous trouvions sur nos mulets; cependant, au milieu de ce calme apparent, des tourbillons de poussière s’élevaient sans cesse chassés par ces petits courants d’air qui ne rasent que la surface du sol et qui naissent des différences de température qu’acquièrent le sable nu et les endroits couverts d’herbe. Ces vents de sable augmentent la chaleur suffocante de l’air. Chaque grain de quartz, plus chaud que l’air qui l’entoure, rayonne dans tous les sens, et il est difficile d’observer la température de l’atmosphère sans que des molécules de sable ne viennent frapper contre la boule du thermomètre. Tout autour de nous, les plaines semblaient monter vers le ciel, et cette, vaste et profonde solitude se présentait à nos yeux comme une mer couverte de varech ou d’algues pélagiques. Selon la masse inégale des vapeurs répandues dans l’atmosphère, et selon le décroissement variable de la température des couches d’air superposées, l’horizon, dans quelques parties, était clair et nettement séparé; dans d’autres, il était ondoyant, sinueux et comme strié. La terre s’y confondait avec le ciel. A travers la brume sèche et des bancs de vapeurs on voyait au loin des troncs de palmiers. Dépourvus de leur feuillage et de leurs sommets verdoyants, ces troncs paraissaient comme des mâts de navires qu’on découvre à l’horizon.
Les Arabes, eux, aiment chanter la guerre et l’amour, mais il y a aussi la vie du désert, telle qu’on la trouve dans la romance bédouine Antar. Après ce tour du monde antique, Humboldt, toujours à la recherche d’éléments d’une «poésie de la nature» satisfaisante, se tourne vers le monde moderne, à commencer par Dante Alighieri, «le fondateur inspiré du nouveau monde», dont la puissance référentielle et intellectuelle n’a d’égale que sa sensibilité à des impressions immédiates, telle «il tremolar della marina». Signe des temps aussi, l’ascension du mont Ventoux par Pétrarque, qui, malheureusement, reste empêtré dans l’allégorie et dans la morale. Bembo, par contre, dans son Aetnae Dialogus, donne un tableau animé de la géographie des plantes sur le volcan, depuis les champs de blé de la Sicile jusqu’aux marges enneigées du cratère. Et puis, encore et toujours, Colomb, décrivant la terre nouvelle avec ses arbres et ses fruits et ses lindas aguas, sentant que «mille langues ne suffiraient pas à la dire: "Para hacer relacion a los Reyes de las cosas que vian, no bastaran mil lenguas a referillo, ni la mano para la escribir, que le parecia questaba encantado. "» Et Camoens à Macao, emporté par la mer, le vent et les nuages, marin de l’âme, chantre de la gloire portugaise, qui pourtant parle beaucoup plus des épices, à valeur commerciale, que d’autres plantes tropicales... On passe alors par Shakespeare, sensible à «l’expression individuelle de la nature», et par Milton, sublime, mais dont les descriptions sont plus magnifiques que graphiques, pour arriver au XVIIIe siècle, à l’époque des Buffon, Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, à toute une nouvelle série de tentatives pour s’approcher de la nature et pour dire ce terrain de rencontre d’une manière à la fois exacte et inspirante. Buffon accumule les faits exacts, mais ses phrases sont construites trop artificiellement et on ne sent pas chez lui cette «analogie mystérieuse entre les mouvements de l’esprit et les phénomènes perçus par les sens» qui est l’objet des recherches de Humboldt à ce stade ultime de ses pérégrinations. Chez Rousseau, le moi est souvent trop présent; chez Chateaubriand, pourrait-on dire, aussi, lui dont les passages à travers la terre s’accompagnent toujours de souvenirs historiques. Quant à Bernardin de Saint-Pierre, Humboldt l’a beaucoup lu, et avec délices, mais ses théories sont trop souvent saugrenues. Au fond, dès qu’il est question de nature à l’époque moderne, il est difficile de sortir du pastoral, de l’élégiaque, de l’idyllique, du didactique, de l’excessivement sentimental, etc. On a beau écrire d’une manière élevée, la pauvreté des matériaux et de l’information de base est par trop évidente -d’où, d’ailleurs, des tentatives de compensation par le style. Dans le passé, dans les anciens livres de voyages, par exemple, la pauvreté des matériaux était compensée par la naïveté, par une faculté d’émerveillement enfantine, ou encore par la dramatisation, une coloration épique. Mais rien de tout cela n’est possible aujourd’hui, c’est autre chose qu’il faut trouver. Nous avons affaire à une masse d’informations qu’il s’agit non seulement d’ordonner, mais à laquelle il faut aussi donner une aura, une lumière. Il serait possible d’atteindre à «une espèce de délice intellectuel» que les Anciens ne pouvaient connaître - mais quelle littérature est vraiment à la hauteur? On peut recueillir des éléments par-ci, par-là, mais on attend toujours «un élargissement du champ de l’art», on attend toujours une poétique qui sache «présenter à la contemplation de l’intellect et de l’imagination la riche matière du savoir moderne». Il ne peut être question de vagues analogies, de métaphores creuses, de mythes symbolistes, il s’agit de définition et de respiration, d’exactitude et d’extase, de sensorialité et d’intelligence, et d’une écriture qui soit autre chose que «du style», ou je ne sais quelle «prose poétique» maniérée.
Tout au long de son œuvre, depuis les premières notes prises dans les llanos, ou dans la forêt tropicale humide, ou sur les rives de l’Orénoque, jusqu’aux rédactions et aux compositions de Paris et de Berlin, Humboldt a essayé lui-même de s’approcher de cette littérature plus que «de la littérature» qu’il voyait poindre à l’horizon. On peut dire que cette œuvre consiste en relations, en études et en essais poétiques. Ces «essais poétiques» peuvent se trouver dans les relations et dans les études dont j’ai déjà cité quelques exemples, mais Humboldt y a consacré un livre spécifique, les Ansichten der Natur, traduit en français par Vues de la nature et en anglais par Views of Nature. Il n’y a rien à reprocher à ces deux traductions. Cela vaut cependant la peine de faire remarquer que dans une lettre adressée à son éditeur londonien, Humboldt lui-même écrit «views into nature». On peut imputer cela à l’insuffisance de son anglais, on peut aussi y voir une nuance intéressante.
Il s’agit dans les Ansichten de tentatives de «tableaux intégrés», où se lirait «la coopération des forces» de la nature, dans une prose qui se veut à la fois vigoureuse et flexible, le tout voulant à la fois engager l’imagination, augmenter la connaissance des choses (configurations cachées, relations plastiques profondes), et enrichir la vie par la présentation de nouvelles idées. Avec une petite fable, «La force vitale, ou le génie rhodien», qui n’y a sans doute pas véritablement sa place (mais Humboldt a du mal à «caser» tout ce qui lui vient à l’esprit), il y a dans ce livre six essais en tout: «Les steppes et les déserts», «La vie nocturne des animaux dans la forêt primitive», «Idées pour une physionomie des plantes», «Sur la structure et le mode d’action des volcans», «Le plateau de Caxamarca». Dire que ces essais répondaient complètement à ses vœux serait exagéré, disons simplement que c’est le livre auquel, en fin de compte, il tenait le plus, c’est là qu’il a mis le plus de lui-même, c’est là qu’il a consigné le plus de ses aperçus, c’est là qu’il offre le plus d’indications.
Le voici de nouveau sur les llanos, ces «steppes» du Venezuela:
«C’est dans la Mesa de Paja, par les 9° de latitude, que nous entrâmes dans le bassin des llanos. Le soleil était presque au zénith; la terre partout où elle se montrait stérile et dépouillée de végétation, avait jusqu’à 48° et 50° de température. Aucun souffle de vent ne se faisait sentir à la hauteur à laquelle nous nous trouvions sur nos mulets; cependant, au milieu de ce calme apparent, des tourbillons de poussière s’élevaient sans cesse chassés par ces petits courants d’air qui ne rasent que la surface du sol et qui naissent des différences de température qu’acquièrent le sable nu et les endroits couverts d’herbe. Ces vents de sable augmentent la chaleur suffocante de l’air. Chaque grain de quartz, plus chaud que l’air qui l’entoure, rayonne dans tous les sens, et il est difficile d’observer la température de l’atmosphère sans que des molécules de sable ne viennent frapper contre la boule du thermomètre. Tout autour de nous, les plaines semblaient monter vers le ciel, et cette, vaste et profonde solitude se présentait à nos yeux comme une mer couverte de varech ou d’algues pélagiques. Selon la masse inégale des vapeurs répandues dans l’atmosphère, et selon le décroissement variable de la température des couches d’air superposées, l’horizon, dans quelques parties, était clair et nettement séparé; dans d’autres, il était ondoyant, sinueux et comme strié. La terre s’y confondait avec le ciel. A travers la brume sèche et des bancs de vapeurs on voyait au loin des troncs de palmiers. Dépourvus de leur feuillage et de leurs sommets verdoyants, ces troncs paraissaient comme des mâts de navires qu’on découvre à l’horizon.
Mais si Humboldt est américaniste, s’il nage dans tout ce courant américain, il est un moment de l’histoire américaine et américaniste qu’il affectionne tout particulièrement, c’est le moment de la première découverte et de ses suites, immédiates, ce que j’aimerais appeler le moment colombien.
«A aucune autre époque depuis la fondation des sociétés, écrit-il, le cercle des idées, en ce qui touche le monde extérieur et les rapports de l’espace, n’avait été si soudainement élargi et d’une manière si merveilleuse.» Ce «cercle d’idées» comprenait, entre autres, la composition de l’atmosphère et ses rapports avec l’organisation humaine, la distribution des climats au penchant des cordillères, les lois du magnétisme, la liaison des volcans entre eux, le soulèvement successif des chaînes de montagne, la direction des courants pélagiques... Mais, et il insiste là-dessus, il n’y avait pas que «de la science», il y avait comme un sens nouveau, il y avait un charme. Le «nouveau travail des esprits» allait s’élargissant, de cercle concentrique en cercle concentrique. Il revient sur cet élargissement du cercle, du savoir à une espèce d’horizon du savoir, une sorte d’aura du savoir, dans le passage suivant: «Aux époques héroïques de, leur histoire, les Portugais et les Castillans ne furent pas seulement guidés par la soif de l’or, comme on l’a supposé, faute de comprendre l’esprit de ces temps. Tout le monde se sentait entraîné vers les hasards des expéditions lointaines. Les noms d’Haïti, de Cubagua, de Darien avaient séduit les imaginations au commencement du XVIe siècle, comme, depuis les voyages d’Anton et de Cook, les noms de Tinian et d’Otahiti... Plus tard, quand les mœurs s’adoucirent et que toutes les parties du monde s’ouvrirent à la fois, cette curiosité inquiète fut entretenue par d’autres causes et prit une direction nouvelle. Les esprits s’enflammèrent d’un amour passionné pour la nature... Les vues s’élevèrent en même temps que s’agrandissait le cercle de l’observation scientifique. La tendance sentimentale et poétique, qui se trouvait déjà au fond des cœurs, prit une forme plus arrêtée avec la fin du XVIe siècle, et donna naissance à des œuvres littéraires inconnues des temps antérieurs.» Mais tout ce que je viens d’évoquer se concentre aux yeux de Humboldt dans la figure même de Christophe Colomb. Même dépourvu de savoir scientifique précis, mais par son simple sens de l’observation, Colomb avait lui-même contribué aux avancées scientifiques, notamment en ce qui concerne le magnétisme terrestre, la flexion des bandes isothermes et la botanique, par exemple dans cette lettre écrite d’Haïti en octobre 1498, citée par Humboldt: «Chaque fois que, quittant les côtes d’Espagne, je me dirige vers l’Inde, je sens, dès que j’ai fait cent milles marins à l’ouest des Açores, un changement extraordinaire dans le mouvement des corps célestes, dans la température de l’air et dans l’état de la mer. En observant ces changements avec une attention scrupuleuse, j’ai reconnu que l’aiguille aimantée, dont la déclinaison avait lieu jusque-là dans la direction du nord-est, passait au nord-ouest; et après avoir franchi cette ligne, comme on gravit le dos d’une colline, j’ai trouvé la mer couverte d’une telle quantité d’herbes marines, semblables à de petites branches de pins et portant pour fruits des pistaches, que les vaisseaux semblaient devoir manquer d’eau et échouer sur un bas-fond. Avant la limite dont je viens de parler, nous n’avions trouvé aucune trace de ces herbes marines. Je remarquai aussi en arrivant à cette ligne de démarcation, placée, je le répète, à cent milles vers l’ouest des Açores, que la mer s’apaise subitement, et que presque aucun vent ne l’agite plus. Lorsque nous descendîmes des îles Canaries jusqu’au parallèle de Sierra Leone, il nous fallut souffrir une chaleur horrible; mais dès que nous eûmes franchi la limite que j’ai indiquée, le climat changea, l’air s’adoucit et la fraîcheur augmenta à mesure que nous avancions vers l’ouest.» Mais ce n’est pas encore cela qui intéresse le plus Humboldt chez Colomb. C’est, dans les lettres et le journal maritime, le «profond sentiment de la nature» qui animait le grand voyageur, ainsi que «la noblesse et la simplicité d’expression» avec lesquelles il décrivit «la vie de la terre, et le ciel, inconnu jusque-là, qui se découvrait à ses regards (viage nuevo al nuevo ciel i mundo que fasta entonces estaba en oculto)».Humboldt revient sur cet aspect plus «sensible», plus «poétique» dans le passage suivant: «Nous apprenons ici, par le journal d’un homme dépourvu de toute culture littéraire, quelle puissance peuvent exercer sur une âme sensible les beautés caractéristiques de la nature. L’émotion ennoblit le langage. Les écrits de l’amiral, surtout lorsque, âgé déjà de soixante-sept ans, il accomplit son quatrième voyage et raconte sa vision merveilleuse sur la côte de Veragua, sont, sinon plus châtiés, du moins plus entraînants que le roman pastoral de Boccace, les deux Arcadies de Sannasar et de Sidney, le Salicio y Nemoroso de Garcilasso ou la Diana de Jorge de Montemayor.» Nous avons là les prémices d’une littérature géopoétique.
Quand Humboldt revient de son voyage américain, c’est une poétique de cette sorte qu’il a en tête, et pour lui, c’est à l’élaboration et à la propagation de cette poétique que devraient s’appliquer les esprits. Il s’agit de l’accomplissement d’une de ces «grandes pensées dont la source est dans les profondeurs de l’âme». Après le voyage physique, donc, avec ses résultats, le voyage mental, avec son réseau.
Toute œuvre d’envergure demande des ressources illimitées et quelque chose comme une éternité. Humboldt avait dépensé la moitié de sa fortune pour son voyage, il allait en dépenser l’autre moitié dans la publication des «actes» de ce voyage. On sent qu’il envie, un peu, le grand botaniste colombien, Don José Celestino Mutis, qui avait été l’ami de Linné, et à qui le roi versait pour ses travaux dix mille piastres par an - d’autant plus qu’au moment où Humboldt le rencontra, Mutis avait depuis quinze ans une trentaine de peintres à sa disposition. Mais Humboldt est beaucoup plus qu’un grand botaniste, et sa recherche profonde était moins visible, moins perceptible, moins concevable - certains auraient pu dire même «non scientifique». Certes, il a fait de grandes contributions à la botanique: de son voyage il avait rapporté cinquante-huit mille espèces de plantes, dont trois mille six cents inconnues. Avec ses mesures astronomiques et trigonométriques, il avait fait une grande contribution à la géodésie, comme à bien d’autres branches de la science. Avec sa géographie des plantes (à plusieurs points de son voyage, il dresse le tableau des étages de végétation), il est à l’origine de ce qu’on appelle la géographie tridimensionnelle. Et il n’allait jamais cesser de s’intéresser à tous les aspects de la recherche scientifique, «soit qu’il s’agisse (je le cite) de l’électromagnétisme, de la polarisation de la lumière, des effets produits par les substances diathermanes, ou des phénomènes physiologiques que présentent les organismes vivants - vaste ensemble de merveilles qui se déroulent à nos regards comme un monde nouveau dont nous touchons à peine le seuil !» Mais c’est encore autre chose qui l’attire, qui l’inspire. En jouant un peu sur les mots, on pourrait dire qu’il s’intéresse à une géographie quadridimensionnelle. Disons qu’il veut ajouter une dimension de plus à la géographie, à la science, à la connaissance. Et cette dimension est plus qu’une dimension «humaniste», comme dans la géographie dite humaine. Au cours de son voyage, Humboldt s’était rendu compte d’une dimension de l’existence où une conscience humaine est certes présente, mais où l’image de l’homme dont nous avons philosophiquement et psychologiquement l’habitude n’a plus de raison d’être: «Dans cet intérieur des terres du nouveau continent, on s’accoutume presque à regarder l’homme comme n’étant point essentiel à l’ordre de la nature.» Un dépouillement de l’homme, un être moins imposé et imposant, serait à l’ordre du jour... Il n’est certes pas aisé de trouver un concept global adéquat. D’une manière générale, notre vocabulaire conceptuel laisse beaucoup à désirer. Si l’ethnographie se veut uniquement collectrice et descriptive, l’ethnologie se permet, à partir de matériaux ethnographiques, d’élaborer des théories. Par analogie, si la géographie est la description de la terre, la géologie devrait signifier «théorie de la terre», mais il n’en est rien - nous avons affaire seulement à un aspect spécial et spécialiste de la géographie. Humboldt, comme on l’a constaté, utilise assez souvent le terme de «géognose», mais là aussi, le sens est très spécifique -il s’agit de la configuration de la terre, non pas de la configuration d’un nouvel esprit général des choses. Au cours de son voyage, Humboldt avait été abordé par des gens munis de vagues et confuses notions d’astronomie et de physique qui voulaient parler de «nouvelle philosophie» - il trouvait ça absurde, comme il aurait trouvé absurdes tant d’autres «nouveautés». Pour des raisons que j’ai déjà évoquées, et pour d’autres qui vont émerger de ce qui va suivre, je pense que le terme le plus adéquat est «géopoétique». L’œuvre de Humboldt constitue une approche, et une des plus intéressantes, de ce que l’on peut appeler «géopoétique» aujourd’hui.
«A aucune autre époque depuis la fondation des sociétés, écrit-il, le cercle des idées, en ce qui touche le monde extérieur et les rapports de l’espace, n’avait été si soudainement élargi et d’une manière si merveilleuse.» Ce «cercle d’idées» comprenait, entre autres, la composition de l’atmosphère et ses rapports avec l’organisation humaine, la distribution des climats au penchant des cordillères, les lois du magnétisme, la liaison des volcans entre eux, le soulèvement successif des chaînes de montagne, la direction des courants pélagiques... Mais, et il insiste là-dessus, il n’y avait pas que «de la science», il y avait comme un sens nouveau, il y avait un charme. Le «nouveau travail des esprits» allait s’élargissant, de cercle concentrique en cercle concentrique. Il revient sur cet élargissement du cercle, du savoir à une espèce d’horizon du savoir, une sorte d’aura du savoir, dans le passage suivant: «Aux époques héroïques de, leur histoire, les Portugais et les Castillans ne furent pas seulement guidés par la soif de l’or, comme on l’a supposé, faute de comprendre l’esprit de ces temps. Tout le monde se sentait entraîné vers les hasards des expéditions lointaines. Les noms d’Haïti, de Cubagua, de Darien avaient séduit les imaginations au commencement du XVIe siècle, comme, depuis les voyages d’Anton et de Cook, les noms de Tinian et d’Otahiti... Plus tard, quand les mœurs s’adoucirent et que toutes les parties du monde s’ouvrirent à la fois, cette curiosité inquiète fut entretenue par d’autres causes et prit une direction nouvelle. Les esprits s’enflammèrent d’un amour passionné pour la nature... Les vues s’élevèrent en même temps que s’agrandissait le cercle de l’observation scientifique. La tendance sentimentale et poétique, qui se trouvait déjà au fond des cœurs, prit une forme plus arrêtée avec la fin du XVIe siècle, et donna naissance à des œuvres littéraires inconnues des temps antérieurs.» Mais tout ce que je viens d’évoquer se concentre aux yeux de Humboldt dans la figure même de Christophe Colomb. Même dépourvu de savoir scientifique précis, mais par son simple sens de l’observation, Colomb avait lui-même contribué aux avancées scientifiques, notamment en ce qui concerne le magnétisme terrestre, la flexion des bandes isothermes et la botanique, par exemple dans cette lettre écrite d’Haïti en octobre 1498, citée par Humboldt: «Chaque fois que, quittant les côtes d’Espagne, je me dirige vers l’Inde, je sens, dès que j’ai fait cent milles marins à l’ouest des Açores, un changement extraordinaire dans le mouvement des corps célestes, dans la température de l’air et dans l’état de la mer. En observant ces changements avec une attention scrupuleuse, j’ai reconnu que l’aiguille aimantée, dont la déclinaison avait lieu jusque-là dans la direction du nord-est, passait au nord-ouest; et après avoir franchi cette ligne, comme on gravit le dos d’une colline, j’ai trouvé la mer couverte d’une telle quantité d’herbes marines, semblables à de petites branches de pins et portant pour fruits des pistaches, que les vaisseaux semblaient devoir manquer d’eau et échouer sur un bas-fond. Avant la limite dont je viens de parler, nous n’avions trouvé aucune trace de ces herbes marines. Je remarquai aussi en arrivant à cette ligne de démarcation, placée, je le répète, à cent milles vers l’ouest des Açores, que la mer s’apaise subitement, et que presque aucun vent ne l’agite plus. Lorsque nous descendîmes des îles Canaries jusqu’au parallèle de Sierra Leone, il nous fallut souffrir une chaleur horrible; mais dès que nous eûmes franchi la limite que j’ai indiquée, le climat changea, l’air s’adoucit et la fraîcheur augmenta à mesure que nous avancions vers l’ouest.» Mais ce n’est pas encore cela qui intéresse le plus Humboldt chez Colomb. C’est, dans les lettres et le journal maritime, le «profond sentiment de la nature» qui animait le grand voyageur, ainsi que «la noblesse et la simplicité d’expression» avec lesquelles il décrivit «la vie de la terre, et le ciel, inconnu jusque-là, qui se découvrait à ses regards (viage nuevo al nuevo ciel i mundo que fasta entonces estaba en oculto)».Humboldt revient sur cet aspect plus «sensible», plus «poétique» dans le passage suivant: «Nous apprenons ici, par le journal d’un homme dépourvu de toute culture littéraire, quelle puissance peuvent exercer sur une âme sensible les beautés caractéristiques de la nature. L’émotion ennoblit le langage. Les écrits de l’amiral, surtout lorsque, âgé déjà de soixante-sept ans, il accomplit son quatrième voyage et raconte sa vision merveilleuse sur la côte de Veragua, sont, sinon plus châtiés, du moins plus entraînants que le roman pastoral de Boccace, les deux Arcadies de Sannasar et de Sidney, le Salicio y Nemoroso de Garcilasso ou la Diana de Jorge de Montemayor.» Nous avons là les prémices d’une littérature géopoétique.
Quand Humboldt revient de son voyage américain, c’est une poétique de cette sorte qu’il a en tête, et pour lui, c’est à l’élaboration et à la propagation de cette poétique que devraient s’appliquer les esprits. Il s’agit de l’accomplissement d’une de ces «grandes pensées dont la source est dans les profondeurs de l’âme». Après le voyage physique, donc, avec ses résultats, le voyage mental, avec son réseau.
Toute œuvre d’envergure demande des ressources illimitées et quelque chose comme une éternité. Humboldt avait dépensé la moitié de sa fortune pour son voyage, il allait en dépenser l’autre moitié dans la publication des «actes» de ce voyage. On sent qu’il envie, un peu, le grand botaniste colombien, Don José Celestino Mutis, qui avait été l’ami de Linné, et à qui le roi versait pour ses travaux dix mille piastres par an - d’autant plus qu’au moment où Humboldt le rencontra, Mutis avait depuis quinze ans une trentaine de peintres à sa disposition. Mais Humboldt est beaucoup plus qu’un grand botaniste, et sa recherche profonde était moins visible, moins perceptible, moins concevable - certains auraient pu dire même «non scientifique». Certes, il a fait de grandes contributions à la botanique: de son voyage il avait rapporté cinquante-huit mille espèces de plantes, dont trois mille six cents inconnues. Avec ses mesures astronomiques et trigonométriques, il avait fait une grande contribution à la géodésie, comme à bien d’autres branches de la science. Avec sa géographie des plantes (à plusieurs points de son voyage, il dresse le tableau des étages de végétation), il est à l’origine de ce qu’on appelle la géographie tridimensionnelle. Et il n’allait jamais cesser de s’intéresser à tous les aspects de la recherche scientifique, «soit qu’il s’agisse (je le cite) de l’électromagnétisme, de la polarisation de la lumière, des effets produits par les substances diathermanes, ou des phénomènes physiologiques que présentent les organismes vivants - vaste ensemble de merveilles qui se déroulent à nos regards comme un monde nouveau dont nous touchons à peine le seuil !» Mais c’est encore autre chose qui l’attire, qui l’inspire. En jouant un peu sur les mots, on pourrait dire qu’il s’intéresse à une géographie quadridimensionnelle. Disons qu’il veut ajouter une dimension de plus à la géographie, à la science, à la connaissance. Et cette dimension est plus qu’une dimension «humaniste», comme dans la géographie dite humaine. Au cours de son voyage, Humboldt s’était rendu compte d’une dimension de l’existence où une conscience humaine est certes présente, mais où l’image de l’homme dont nous avons philosophiquement et psychologiquement l’habitude n’a plus de raison d’être: «Dans cet intérieur des terres du nouveau continent, on s’accoutume presque à regarder l’homme comme n’étant point essentiel à l’ordre de la nature.» Un dépouillement de l’homme, un être moins imposé et imposant, serait à l’ordre du jour... Il n’est certes pas aisé de trouver un concept global adéquat. D’une manière générale, notre vocabulaire conceptuel laisse beaucoup à désirer. Si l’ethnographie se veut uniquement collectrice et descriptive, l’ethnologie se permet, à partir de matériaux ethnographiques, d’élaborer des théories. Par analogie, si la géographie est la description de la terre, la géologie devrait signifier «théorie de la terre», mais il n’en est rien - nous avons affaire seulement à un aspect spécial et spécialiste de la géographie. Humboldt, comme on l’a constaté, utilise assez souvent le terme de «géognose», mais là aussi, le sens est très spécifique -il s’agit de la configuration de la terre, non pas de la configuration d’un nouvel esprit général des choses. Au cours de son voyage, Humboldt avait été abordé par des gens munis de vagues et confuses notions d’astronomie et de physique qui voulaient parler de «nouvelle philosophie» - il trouvait ça absurde, comme il aurait trouvé absurdes tant d’autres «nouveautés». Pour des raisons que j’ai déjà évoquées, et pour d’autres qui vont émerger de ce qui va suivre, je pense que le terme le plus adéquat est «géopoétique». L’œuvre de Humboldt constitue une approche, et une des plus intéressantes, de ce que l’on peut appeler «géopoétique» aujourd’hui.
François Arago, astronome et physicien, un des principaux amis et interlocuteurs de Humboldt à Paris, lui disait à propos de ses écrits: «Tu ne sais pas construire; tes livres sont comme des tableaux sans cadre.» C’est rigoureusement vrai. Mais nous n’en tiendrons pas rigueur à Humboldt, nous ne considérerons pas cette caractéristique comme un défaut. C’est en cela que consiste l’intérêt de l’œuvre humboldtienne: elle ne se laisse pas facilement encadrer. Cela est vrai à un niveau purement compositionnel: quand il se met à écrire un essai de quinze pages, il le fait suivre de cent cinquante pages de notes (celui qui déclare que cela est «académique» est complètement à côté de la question). Mais c’est vrai aussi à un niveau conceptuel.
Humboldt est géographe, mais son œuvre déborde du cadre d’une certaine conception française de la géographie. En matière de géographie, la France s’était beaucoup distinguée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Je pense notamment à la fondation, sous le règne de Louis XIV, en 1666, de l’Académie des sciences, qui avait pour mission de préciser la mesure de la terre et de fixer la forme de la terre. Y brilla Picard, qui fonda l’Observatoire de Paris. On peut penser aussi aux cartes de la Chine dressées par les missionnaires jésuites, aux observations faites à Cayenne (1671-1673) par l’astronome Richer, qui constate le premier que la terre n’est pas une sphère, mais un sphéroïde aplati aux deux pôles. On peut égrener d’autres grands noms de la géographie française: La Condamine, Maupertuis, Nicolas Sanson, Guillaume Delisle, d’Anville... Mais dès qu’on arrive à Sébastien de Beaulieu, premier ingénieur du roi, maréchal de camp, le slogan «la géographie sert à faire la guerre» vient à l’esprit - c’est dans ce contexte qu’il trouve son application. La géographie sert à faire la guerre (les opérations militaires ont besoin de cartes) et à faire la chasse (je pense ici à «la carte des chasses du Roi» faite par Berthier entre 1764 et 1773).Certes, au XVIlle siècle, la géographie française maintient sa réputation, avec des monographies cartographiques comme celle des Pyrénées par Roussel, celle des Alpes par Raymond, celle des côtes maritimes de France par Lerouge, et avec toute la série des «Neptune»: le Neptune français de Sauveur, le Neptune oriental de Mannevillette, le Neptune américano-septentrional de Bonne, le Neptune du Cattégat et de la Baltique de Brache, qui date de 1809. Mais le XIXe siècle, géographiquement, n’est plus français. Le dernier monument est sans doute le Précis de la géographie universelle de Maltebrun (1810). A partir de cette date, les grandes études géographiques disparaissent en France, et même les études tout court: il subsiste une seule chaire de géographie, à la Sorbonne, qui se cantonne dans l’étude de la géographie antique (Homère, Hérodote...). Certes, il existe la Société de géographie, mais elle a peu de membres. C’est l’Allemagne qui prend la relève, avec l’énorme masse des travaux de Karl Ritter, à commencer par Erdkunde (Connaissance de la terre) de 1817: «La géographie dans ses rapports avec la nature et l’histoire de l’homme ou géographie universelle comparée, considérée comme base de l’enseignement des sciences physiques et historiques.» Ritter meurt au moment de la sortie de son dix-septième volume (sur l’Asie), laissant des mémoires «destinés à servir de base à une manière plus scientifique d’étudier la géographie».
Avec Ritter, nous passons de la géopolitique à la géognose et à la géographie humaine.
Si féru qu’il soit de culture française, Humboldt appartient plutôt à cette lignée-là. Mais il a ses propres caractéristiques, ses propres élans, qui font qu’il est encore autre chose.
Parlons d’abord de sa méthode. Voici ce qu’il écrit au début de son voyage: «Frappés d’un grand nombre d’objets à la fois, nous éprouvâmes quelque embarras à nous assujettir à une marche régulière d’études et d’observations.» La multiplicité du réel et l’excitation de l’esprit rendent difficile l’adaptation à une discipline routinière. Cela dit, tout au long de son itinéraire, Humboldt accumule les mesures et les calculs (ce n’est que rarement, par exemple la première fois qu’il voit l’océan Pacifique, qu’il oublie son baromètre). Mais il n’en oublie pas le sens de l’ouverture et la sensation du démesuré. Il veut éviter les «rêves systématiques» et les «théories abstraites». Empiriste, il ne se contente pas d’une simple accumulation de faits; théoricien, il se méfie des idées trop vite faites. «Je me suis proposé, écrit-il, [... ] de tenir un juste milieu entre deux routes suivies par les savants... Les uns, se livrant à des hypothèses brillantes mais fondées sur des bases peu solides, ont tiré des résultats généraux d’un petit nombre de faits isolés... D’autres savants ont accumulé des matériaux sans s’élever à aucune idée générale, méthode stérile dans l’histoire des peuples comme dans les différentes branches des sciences physiques.» Méthodologiquement, il se tient sur le «juste milieu» entre deux routes. Mais ce «milieu» demande quelque chose d’encore plus complexe. Ailleurs, il dira que le travail consiste à «recueillir, observer, vérifier et combiner». Ailleurs encore, qu’il s’agit de «saisir les éléments divers d’un vaste paysage». Je dirais volontiers que Humboldt sait pratiquer l’extravagance sans se perdre, et qu’il sait pratiquer la rigueur sans se figer.
Parlons maintenant du terrain. Le terrain de Humboldt, c’est l’Amérique, dont il dit: «Si l’Amérique n’occupe pas une place distinguée dans l’histoire du genre humain et des anciennes révolutions qui l’ont agité, elle offre un champ d’autant plus vaste aux travaux du physicien. Nulle part ailleurs la Nature ne l’appelle plus vivement à s’élever à des idées générales sur la cause des phénomènes et sur leur enchaînement mutuel.» Dans ce champ américain, du moins à ce moment-là, la politique, préoccupée de priorités et d’utilité immédiate, était moins présente, et les disciplines étaient moins étanches les unes aux autres: une liberté de mouvement s’alliait à la nécessité d’être multidisciplinaire. Humboldt est américaniste, au grand sens, si je puis dire, du mot. Il ressemble à ce Samuel Hearne, d’abord aspirant dans la marine royale britannique, ensuite agent de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui allait suivre la rivière de la Mine-de-Cuivre jusqu’à la mer Glaciale (La Pérouse, s’étant emparé des établissements britanniques pendant la guerre d’Amérique, avait trouvé son manuscrit - et le lui rendit, à la condition qu’il le publie, ce qui fut fait en 1795). On peut évoquer aussi dans ce contexte le personnage d’Alexander Mackenzie, agent de la North-West Fur Company, qui va d’abord vers la mer Glaciale, ensuite vers le Pacifique. On peut penser à Lewis et Clark qui remontent le Missouri et traversent les Rocheuses. A Zebulon Pike, qui explore les sources du Mississippi, le bassin de l’Arkansas, le Nouveau Mexique et le Texas. Au Major Long, à Nicollet, à Duflot de Mofras, à Fremont... Humboldt fut au courant de tous ces travaux dans le Nord. Et il était au courant aussi de ce qui s’était passé dans le Sud, depuis les descriptions de la Patagonie du père Falkner jusqu’aux voyages de Lima au Paraguay de Weddell, en passant par les expéditions de Don Felix de Azara au Rio de la Plata, celle du Dr Martins au Brésil, celle de Walter Bates en Amazonie, celle de Fitzroy au détroit de Magellan, celle de Basil Hall au Chili, celle de Pentland en Bolivie, celle d’Alcide d’Orbigny dans les Andes, celle de Schomburgk dans le bassin de l’Orénoque... Il a tout l’espace américain, toutes les recherches américanistes en tête. Et il suit lui-même ses pistes américaines non seulement dans un esprit d’investigation, non seulement avec curiosité, mais avec plaisir: «Le plaisir que l’on éprouve, écrit-il, n’est pas dû seulement à l’intérêt que prend le naturaliste aux objets de son étude, il tient à un sentiment commun à tous les hommes qui sont élevés dans les habitudes de la civilisation. On se voit en contact avec un monde nouveau, avec une nature sauvage et indomptée. Tantôt c’est le jaguar, belle panthère de l’Amérique, qui paraît sur le rivage; tantôt c’est le hocco à plumes noires et à tête huppée, qui se promène lentement le long des sauso. Les animaux de classes les plus différentes se succèdent les uns aux autres. Es como en el Paraiso, disait notre pilote, vieil Indien des missions.» Humboldt partage cette sensation paradisiaque, tout en ne versant pas dans une mythologie facile, que ce soit celle de l’Age d’Or ou celle du Bon Sauvage. Les choses sont compliquées, et non sans contradictions. Au cours de ses pérégrinations dans les terres sauvages, il arrive à Humboldt d’imaginer des entrepôts, des centres de civilisation. Mais dès la fin de son voyage, donc dès le tout début du XIXe siècle, il constate la disparition de palmiers et de bambous autour de La Havane et remarque avec amertume que «la civilisation avance». Là aussi, il y aurait une méthode, une route du «milieu» à trouver.
Humboldt est géographe, mais son œuvre déborde du cadre d’une certaine conception française de la géographie. En matière de géographie, la France s’était beaucoup distinguée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Je pense notamment à la fondation, sous le règne de Louis XIV, en 1666, de l’Académie des sciences, qui avait pour mission de préciser la mesure de la terre et de fixer la forme de la terre. Y brilla Picard, qui fonda l’Observatoire de Paris. On peut penser aussi aux cartes de la Chine dressées par les missionnaires jésuites, aux observations faites à Cayenne (1671-1673) par l’astronome Richer, qui constate le premier que la terre n’est pas une sphère, mais un sphéroïde aplati aux deux pôles. On peut égrener d’autres grands noms de la géographie française: La Condamine, Maupertuis, Nicolas Sanson, Guillaume Delisle, d’Anville... Mais dès qu’on arrive à Sébastien de Beaulieu, premier ingénieur du roi, maréchal de camp, le slogan «la géographie sert à faire la guerre» vient à l’esprit - c’est dans ce contexte qu’il trouve son application. La géographie sert à faire la guerre (les opérations militaires ont besoin de cartes) et à faire la chasse (je pense ici à «la carte des chasses du Roi» faite par Berthier entre 1764 et 1773).Certes, au XVIlle siècle, la géographie française maintient sa réputation, avec des monographies cartographiques comme celle des Pyrénées par Roussel, celle des Alpes par Raymond, celle des côtes maritimes de France par Lerouge, et avec toute la série des «Neptune»: le Neptune français de Sauveur, le Neptune oriental de Mannevillette, le Neptune américano-septentrional de Bonne, le Neptune du Cattégat et de la Baltique de Brache, qui date de 1809. Mais le XIXe siècle, géographiquement, n’est plus français. Le dernier monument est sans doute le Précis de la géographie universelle de Maltebrun (1810). A partir de cette date, les grandes études géographiques disparaissent en France, et même les études tout court: il subsiste une seule chaire de géographie, à la Sorbonne, qui se cantonne dans l’étude de la géographie antique (Homère, Hérodote...). Certes, il existe la Société de géographie, mais elle a peu de membres. C’est l’Allemagne qui prend la relève, avec l’énorme masse des travaux de Karl Ritter, à commencer par Erdkunde (Connaissance de la terre) de 1817: «La géographie dans ses rapports avec la nature et l’histoire de l’homme ou géographie universelle comparée, considérée comme base de l’enseignement des sciences physiques et historiques.» Ritter meurt au moment de la sortie de son dix-septième volume (sur l’Asie), laissant des mémoires «destinés à servir de base à une manière plus scientifique d’étudier la géographie».
Avec Ritter, nous passons de la géopolitique à la géognose et à la géographie humaine.
Si féru qu’il soit de culture française, Humboldt appartient plutôt à cette lignée-là. Mais il a ses propres caractéristiques, ses propres élans, qui font qu’il est encore autre chose.
Parlons d’abord de sa méthode. Voici ce qu’il écrit au début de son voyage: «Frappés d’un grand nombre d’objets à la fois, nous éprouvâmes quelque embarras à nous assujettir à une marche régulière d’études et d’observations.» La multiplicité du réel et l’excitation de l’esprit rendent difficile l’adaptation à une discipline routinière. Cela dit, tout au long de son itinéraire, Humboldt accumule les mesures et les calculs (ce n’est que rarement, par exemple la première fois qu’il voit l’océan Pacifique, qu’il oublie son baromètre). Mais il n’en oublie pas le sens de l’ouverture et la sensation du démesuré. Il veut éviter les «rêves systématiques» et les «théories abstraites». Empiriste, il ne se contente pas d’une simple accumulation de faits; théoricien, il se méfie des idées trop vite faites. «Je me suis proposé, écrit-il, [... ] de tenir un juste milieu entre deux routes suivies par les savants... Les uns, se livrant à des hypothèses brillantes mais fondées sur des bases peu solides, ont tiré des résultats généraux d’un petit nombre de faits isolés... D’autres savants ont accumulé des matériaux sans s’élever à aucune idée générale, méthode stérile dans l’histoire des peuples comme dans les différentes branches des sciences physiques.» Méthodologiquement, il se tient sur le «juste milieu» entre deux routes. Mais ce «milieu» demande quelque chose d’encore plus complexe. Ailleurs, il dira que le travail consiste à «recueillir, observer, vérifier et combiner». Ailleurs encore, qu’il s’agit de «saisir les éléments divers d’un vaste paysage». Je dirais volontiers que Humboldt sait pratiquer l’extravagance sans se perdre, et qu’il sait pratiquer la rigueur sans se figer.
Parlons maintenant du terrain. Le terrain de Humboldt, c’est l’Amérique, dont il dit: «Si l’Amérique n’occupe pas une place distinguée dans l’histoire du genre humain et des anciennes révolutions qui l’ont agité, elle offre un champ d’autant plus vaste aux travaux du physicien. Nulle part ailleurs la Nature ne l’appelle plus vivement à s’élever à des idées générales sur la cause des phénomènes et sur leur enchaînement mutuel.» Dans ce champ américain, du moins à ce moment-là, la politique, préoccupée de priorités et d’utilité immédiate, était moins présente, et les disciplines étaient moins étanches les unes aux autres: une liberté de mouvement s’alliait à la nécessité d’être multidisciplinaire. Humboldt est américaniste, au grand sens, si je puis dire, du mot. Il ressemble à ce Samuel Hearne, d’abord aspirant dans la marine royale britannique, ensuite agent de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui allait suivre la rivière de la Mine-de-Cuivre jusqu’à la mer Glaciale (La Pérouse, s’étant emparé des établissements britanniques pendant la guerre d’Amérique, avait trouvé son manuscrit - et le lui rendit, à la condition qu’il le publie, ce qui fut fait en 1795). On peut évoquer aussi dans ce contexte le personnage d’Alexander Mackenzie, agent de la North-West Fur Company, qui va d’abord vers la mer Glaciale, ensuite vers le Pacifique. On peut penser à Lewis et Clark qui remontent le Missouri et traversent les Rocheuses. A Zebulon Pike, qui explore les sources du Mississippi, le bassin de l’Arkansas, le Nouveau Mexique et le Texas. Au Major Long, à Nicollet, à Duflot de Mofras, à Fremont... Humboldt fut au courant de tous ces travaux dans le Nord. Et il était au courant aussi de ce qui s’était passé dans le Sud, depuis les descriptions de la Patagonie du père Falkner jusqu’aux voyages de Lima au Paraguay de Weddell, en passant par les expéditions de Don Felix de Azara au Rio de la Plata, celle du Dr Martins au Brésil, celle de Walter Bates en Amazonie, celle de Fitzroy au détroit de Magellan, celle de Basil Hall au Chili, celle de Pentland en Bolivie, celle d’Alcide d’Orbigny dans les Andes, celle de Schomburgk dans le bassin de l’Orénoque... Il a tout l’espace américain, toutes les recherches américanistes en tête. Et il suit lui-même ses pistes américaines non seulement dans un esprit d’investigation, non seulement avec curiosité, mais avec plaisir: «Le plaisir que l’on éprouve, écrit-il, n’est pas dû seulement à l’intérêt que prend le naturaliste aux objets de son étude, il tient à un sentiment commun à tous les hommes qui sont élevés dans les habitudes de la civilisation. On se voit en contact avec un monde nouveau, avec une nature sauvage et indomptée. Tantôt c’est le jaguar, belle panthère de l’Amérique, qui paraît sur le rivage; tantôt c’est le hocco à plumes noires et à tête huppée, qui se promène lentement le long des sauso. Les animaux de classes les plus différentes se succèdent les uns aux autres. Es como en el Paraiso, disait notre pilote, vieil Indien des missions.» Humboldt partage cette sensation paradisiaque, tout en ne versant pas dans une mythologie facile, que ce soit celle de l’Age d’Or ou celle du Bon Sauvage. Les choses sont compliquées, et non sans contradictions. Au cours de ses pérégrinations dans les terres sauvages, il arrive à Humboldt d’imaginer des entrepôts, des centres de civilisation. Mais dès la fin de son voyage, donc dès le tout début du XIXe siècle, il constate la disparition de palmiers et de bambous autour de La Havane et remarque avec amertume que «la civilisation avance». Là aussi, il y aurait une méthode, une route du «milieu» à trouver.
4
La « poïétique » matérielle
La matière, c’est donc d’abord le simple ; c’est ensuite le complexe ou le compact en tant qu’il signe la singularité d’une culture ; c’est enfin, et j’y arrive, la condition, dans la double entente du terme : ou comment une logique de la restriction et une physique de la rareté se subliment en sort ou en destin, au sens métaphysique. Leroi-Gourhan, en somme, énonce la poésie de la poïesis.
L’axiome dont il part, le voici : « C’est la matière qui conditionne toute technique et non pas les moyens ou les forces [15] ? » Il est remarquable que, des quatre causes identifiées par Aristote et que, peu ou prou, la tradition conservera, deux seulement soient ici évoquées, la cause matérielle et la cause efficiente, tandis que Leroi-Gourhan paraît négliger tant la cause formelle que la cause finale. Tout se passerait donc comme si, du côté de l’objet produit, la forme, c’est-à dire l’essence, disparaissait derrière la matière et comme si, du côté du producteur cette fois, l’intention ou la fin était éclipsée par la force… La fabrication — la poïesis — se réduirait alors au « dialogue » d’une matière rétive à la forme et d’un ouvrier dépourvu d’objectif ? Que signifie donc cet anti-aristotélisme de principe de Leroi-Gourhan ? Peut-on vraiment fabriquer, achever un artefact, si on ne sait pas ce qu’on veut faire de la matière et si on ne sait pas désigner ce qu’on a produit ? Ne se trouve-t-on pas alors dans la situation, exactement anti-technique (en ce que la technè est sans mimèsis, autrement dit sans plan ni modèle préalables, semblant se contredire elle-même), décrite comme bricolage par la célèbre analyse de Lévi-Strauss [16] ? Si le bricolage revient à faire, comme on dit, « avec les moyens du bord », à subordonner l’objectif au groupement aléatoire des objets trouvés sur place, il consiste, dans le fait, en « un dialogue de la matière et des moyens d’exécution ». N’est-ce pas, mot pour mot presque, ce qu’affirme Leroi-Gourhan de la technique et ne faut-il pas conclure de là que les deux auteurs décrivent le même phénomène sous deux appellations ? Il n’en est rien cependant. D’abord parce que Lévi-Strauss, en tout cas, oppose consciemment technique et bricolage et s’appuie même sur la confrontation pour faire ressortir les traits distincts des deux activités ; ensuite parce que le « dialogue » technique, chez Leroi-Gourhan, est nettement caractérisé comme impair, inégal, puisque la matière prime sur les moyens et les forces. Il ne s’agit donc pas de la même réalité. La question reste entière : comment s’expliquer l’évacuation par l’auteur de L’homme et la matière, des dimensions essentielle et finale qui commandent la pensée de la technique depuis les Grecs à partir du binôme technè-mimèsis ?
À mon sens, la réponse se ramène à la thèse franche : le « noétique » ou le « représentatif » n’a pas, chez Leroi-Gourhan, de titre étiologique ; en d’autres termes, il s’induit du moteur et du gestuel. Concrètement, cela signifie que les causes formelle et finale sont dépendantes, bien loin de pouvoir dicter les clauses du contrat passé entre le technicien et le milieu. Il nous faut donc examiner brièvement en quoi et comment, tant d’ailleurs au niveau technique que sur le plan esthétique, l’intention de l’« agent » se découvre sur le tas (ce qui, entre parenthèses réduit considérablement la distance entre la technique et le bricolage, ou plutôt, peut-être, le collage…) et apparaît comme le produit d’une négociation préalable. La vérité, c’est que la matière, qui s’impose d’ailleurs par sa multiplicité, ne se laisse pas « prendre » ou « attaquer » n’importe comment. Par exemple, « c’est parce que l’homme n’a pas d’autre prise sur le bois qu’en le coupant sous un certain angle, sous une pression déterminée, que les formes, les emmanchements des outils sont classifiables [17] ». En somme, le contact premier est matière contre matière, geste (au sens le plus physique du mot) contre structure (au sens le plus résistant, c’est-à-dire le plus inerte). Et Leroi-Gourhan se plaît à rappeler que la première question, plus mimée bien sûr que formulée, est : « comment prendre contact ? ». L’action sur la matière, considérée sous ce jour, ricoche ainsi beaucoup moins sur un objectif mental soi-disant fixé, sur une décision, qu’elle ne s’assure, d’ailleurs en une sorte de work in progress, dans et par la palabre gestuelle qui sait spontanément se faire l’avocat des deux parties en présence, la passive et la conative. Le geste technique est un schème, mi-physique mi-sémiotique dans lequel le vouloir et le dire (ou le faire) sont d’abord découplés et cherchent, justement, à se rejoindre au cœur de la matière. En ce sens, l’histoire de la technique est celle de l’exténuation — ou encore de la dévitalisation — du geste, progressivement abandonné, pour ne pas dire, même écarté, au profit de son calque symbolique. Si la main, comme dit quelque part Leroi-Gourhan, « tend vers le cerveau », c’est bien qu’au commencement le cerveau lui-même est, si l’on peut risquer cette image, éminemment « manuel ». L’intention techno-esthétique n’est pas claire d’avance. Elle est au contraire grise et plombée ; la forme est pleine de matière ; ce qui revient à dire que la forme est et reste une certaine manière — une certaine matière — de la matière. La forme, au sens technique comme, plus encore sans doute au plan esthétique, est la mise en relation de la matière avec elle-même. En somme, il y a deux grands gestes techniques : prendre et frapper (avec, pour ce dernier, plus spécialement « anthropien », tout le rameau des percussions) ; ils défèrent au vœu secret, poétique, de la matière, d’être altérée, multipliée, transférée, transportée — tout en restant ce qu’elle est : si foncièrement passive que tous les efforts pour la transformer gardent, devant eux, toujours ouverte, une voie infinie.
« On n’a jamais rencontré un outil créé de toutes pièces pour un usage à trouver sur des matières à découvrir [18]. » L’« artefact » tient plus à la terre et aux « lois de la matière » qu’à une subtile inspiration de tête. En somme, il n’y a pas de fabrication neutre et la plastique, loin d’être l’art de tout faire de n’importe quoi, est plutôt celui d’assouplir l’indispensable rigidité première. Bref : il faut que ça résiste d’abord. Ce n’est que sur cette base et dans ces conditions que la forme et la fonction peuvent se marier. Là se trouve aussi, pour Leroi-Gourhan, le lieu de l’esthétique : exactement au carrefour des deux. La « qualité esthétique », écrit-il, est liée à « la rencontre de la fonction et de la forme [19] ». Les concepts de forme pure et/ou de fonction quelconque sont également absurdes. Toute forme est encore matière ; toute fonction est encore rythme. Cette viscéralité, que j’appellerais hylè-rythmique, la technique l’a pour condition mais l’art en fait sa vocation. Et Leroi-Gourhan d’ouvrir un débat, que je ne peux ici qu’évoquer : la crise du figuralisme n’est-elle pas le corollaire d’une machinisation entraînant irrémissiblement « le broyage progressif de la pensée mythologique » ?
La matière a été, jusqu’ici, ce qui, dans le sens le plus fort du mot, a situé l’homme et lui a permis d’habiter le monde. J’ai cru, en sollicitant peut-être parfois la pensée d’André Leroi-Gourhan, pouvoir montrer trois côtés de la matière, qui sont aussi d’ailleurs trois cotes. Il me semble que la prise en compte groupée de ces repères silhouette un espace paradoxal, restreint-profus, contraint et libre, mythique et utopique auquel, si je ne me trompe, le qualificatif « géopoétique » ne serait pas incongrûment rapporté. De la « mécanique vivante » à la « poïétique » techno-esthétique (même si Leroi-Gourhan n’emploie pas ce terme) en passant par les rythmes ethniques grisés de leur singularité, la conséquence est bonne. La matière est base, nœud et environ : condition tridimensionnelle du vivant humain, pétri dans la nature, inscrit dans une culture, promis à un monde. L’essentiel, c’est de ne pas déchirer cet espace, mais de le remodeler sans cesse pour que nos gestes médiateurs continuent de puiser leur sens et leur fonction dans les larges et vieilles options de la terre animée.
Michel GUERIN
La « poïétique » matérielle
La matière, c’est donc d’abord le simple ; c’est ensuite le complexe ou le compact en tant qu’il signe la singularité d’une culture ; c’est enfin, et j’y arrive, la condition, dans la double entente du terme : ou comment une logique de la restriction et une physique de la rareté se subliment en sort ou en destin, au sens métaphysique. Leroi-Gourhan, en somme, énonce la poésie de la poïesis.
L’axiome dont il part, le voici : « C’est la matière qui conditionne toute technique et non pas les moyens ou les forces [15] ? » Il est remarquable que, des quatre causes identifiées par Aristote et que, peu ou prou, la tradition conservera, deux seulement soient ici évoquées, la cause matérielle et la cause efficiente, tandis que Leroi-Gourhan paraît négliger tant la cause formelle que la cause finale. Tout se passerait donc comme si, du côté de l’objet produit, la forme, c’est-à dire l’essence, disparaissait derrière la matière et comme si, du côté du producteur cette fois, l’intention ou la fin était éclipsée par la force… La fabrication — la poïesis — se réduirait alors au « dialogue » d’une matière rétive à la forme et d’un ouvrier dépourvu d’objectif ? Que signifie donc cet anti-aristotélisme de principe de Leroi-Gourhan ? Peut-on vraiment fabriquer, achever un artefact, si on ne sait pas ce qu’on veut faire de la matière et si on ne sait pas désigner ce qu’on a produit ? Ne se trouve-t-on pas alors dans la situation, exactement anti-technique (en ce que la technè est sans mimèsis, autrement dit sans plan ni modèle préalables, semblant se contredire elle-même), décrite comme bricolage par la célèbre analyse de Lévi-Strauss [16] ? Si le bricolage revient à faire, comme on dit, « avec les moyens du bord », à subordonner l’objectif au groupement aléatoire des objets trouvés sur place, il consiste, dans le fait, en « un dialogue de la matière et des moyens d’exécution ». N’est-ce pas, mot pour mot presque, ce qu’affirme Leroi-Gourhan de la technique et ne faut-il pas conclure de là que les deux auteurs décrivent le même phénomène sous deux appellations ? Il n’en est rien cependant. D’abord parce que Lévi-Strauss, en tout cas, oppose consciemment technique et bricolage et s’appuie même sur la confrontation pour faire ressortir les traits distincts des deux activités ; ensuite parce que le « dialogue » technique, chez Leroi-Gourhan, est nettement caractérisé comme impair, inégal, puisque la matière prime sur les moyens et les forces. Il ne s’agit donc pas de la même réalité. La question reste entière : comment s’expliquer l’évacuation par l’auteur de L’homme et la matière, des dimensions essentielle et finale qui commandent la pensée de la technique depuis les Grecs à partir du binôme technè-mimèsis ?
À mon sens, la réponse se ramène à la thèse franche : le « noétique » ou le « représentatif » n’a pas, chez Leroi-Gourhan, de titre étiologique ; en d’autres termes, il s’induit du moteur et du gestuel. Concrètement, cela signifie que les causes formelle et finale sont dépendantes, bien loin de pouvoir dicter les clauses du contrat passé entre le technicien et le milieu. Il nous faut donc examiner brièvement en quoi et comment, tant d’ailleurs au niveau technique que sur le plan esthétique, l’intention de l’« agent » se découvre sur le tas (ce qui, entre parenthèses réduit considérablement la distance entre la technique et le bricolage, ou plutôt, peut-être, le collage…) et apparaît comme le produit d’une négociation préalable. La vérité, c’est que la matière, qui s’impose d’ailleurs par sa multiplicité, ne se laisse pas « prendre » ou « attaquer » n’importe comment. Par exemple, « c’est parce que l’homme n’a pas d’autre prise sur le bois qu’en le coupant sous un certain angle, sous une pression déterminée, que les formes, les emmanchements des outils sont classifiables [17] ». En somme, le contact premier est matière contre matière, geste (au sens le plus physique du mot) contre structure (au sens le plus résistant, c’est-à-dire le plus inerte). Et Leroi-Gourhan se plaît à rappeler que la première question, plus mimée bien sûr que formulée, est : « comment prendre contact ? ». L’action sur la matière, considérée sous ce jour, ricoche ainsi beaucoup moins sur un objectif mental soi-disant fixé, sur une décision, qu’elle ne s’assure, d’ailleurs en une sorte de work in progress, dans et par la palabre gestuelle qui sait spontanément se faire l’avocat des deux parties en présence, la passive et la conative. Le geste technique est un schème, mi-physique mi-sémiotique dans lequel le vouloir et le dire (ou le faire) sont d’abord découplés et cherchent, justement, à se rejoindre au cœur de la matière. En ce sens, l’histoire de la technique est celle de l’exténuation — ou encore de la dévitalisation — du geste, progressivement abandonné, pour ne pas dire, même écarté, au profit de son calque symbolique. Si la main, comme dit quelque part Leroi-Gourhan, « tend vers le cerveau », c’est bien qu’au commencement le cerveau lui-même est, si l’on peut risquer cette image, éminemment « manuel ». L’intention techno-esthétique n’est pas claire d’avance. Elle est au contraire grise et plombée ; la forme est pleine de matière ; ce qui revient à dire que la forme est et reste une certaine manière — une certaine matière — de la matière. La forme, au sens technique comme, plus encore sans doute au plan esthétique, est la mise en relation de la matière avec elle-même. En somme, il y a deux grands gestes techniques : prendre et frapper (avec, pour ce dernier, plus spécialement « anthropien », tout le rameau des percussions) ; ils défèrent au vœu secret, poétique, de la matière, d’être altérée, multipliée, transférée, transportée — tout en restant ce qu’elle est : si foncièrement passive que tous les efforts pour la transformer gardent, devant eux, toujours ouverte, une voie infinie.
« On n’a jamais rencontré un outil créé de toutes pièces pour un usage à trouver sur des matières à découvrir [18]. » L’« artefact » tient plus à la terre et aux « lois de la matière » qu’à une subtile inspiration de tête. En somme, il n’y a pas de fabrication neutre et la plastique, loin d’être l’art de tout faire de n’importe quoi, est plutôt celui d’assouplir l’indispensable rigidité première. Bref : il faut que ça résiste d’abord. Ce n’est que sur cette base et dans ces conditions que la forme et la fonction peuvent se marier. Là se trouve aussi, pour Leroi-Gourhan, le lieu de l’esthétique : exactement au carrefour des deux. La « qualité esthétique », écrit-il, est liée à « la rencontre de la fonction et de la forme [19] ». Les concepts de forme pure et/ou de fonction quelconque sont également absurdes. Toute forme est encore matière ; toute fonction est encore rythme. Cette viscéralité, que j’appellerais hylè-rythmique, la technique l’a pour condition mais l’art en fait sa vocation. Et Leroi-Gourhan d’ouvrir un débat, que je ne peux ici qu’évoquer : la crise du figuralisme n’est-elle pas le corollaire d’une machinisation entraînant irrémissiblement « le broyage progressif de la pensée mythologique » ?
La matière a été, jusqu’ici, ce qui, dans le sens le plus fort du mot, a situé l’homme et lui a permis d’habiter le monde. J’ai cru, en sollicitant peut-être parfois la pensée d’André Leroi-Gourhan, pouvoir montrer trois côtés de la matière, qui sont aussi d’ailleurs trois cotes. Il me semble que la prise en compte groupée de ces repères silhouette un espace paradoxal, restreint-profus, contraint et libre, mythique et utopique auquel, si je ne me trompe, le qualificatif « géopoétique » ne serait pas incongrûment rapporté. De la « mécanique vivante » à la « poïétique » techno-esthétique (même si Leroi-Gourhan n’emploie pas ce terme) en passant par les rythmes ethniques grisés de leur singularité, la conséquence est bonne. La matière est base, nœud et environ : condition tridimensionnelle du vivant humain, pétri dans la nature, inscrit dans une culture, promis à un monde. L’essentiel, c’est de ne pas déchirer cet espace, mais de le remodeler sans cesse pour que nos gestes médiateurs continuent de puiser leur sens et leur fonction dans les larges et vieilles options de la terre animée.
Michel GUERIN
autres livres classés : mers et océansVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Revue Cahiers de Géopoétique (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
A l'abordage : la mer et la littérature
Qui est l'auteur du célèbre roman "Le vieil homme et la mer" ?
William Faulkner
John Irving
Ernest Hemingway
John Steinbeck
10 questions
504 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, mer
, océansCréer un quiz sur ce livre504 lecteurs ont répondu