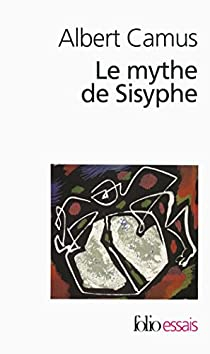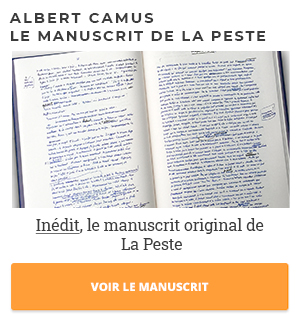le Mythe de Sisyphe est un essai d' Albert Camus, publié en 1942 .IL fait parti du " cycle de l' absurde", avec Caligula, l' Etranger et le Malentendu
Pour écrire un tel essai, Camus s' est inspiré de la mythologie grecque. L' auteur fait le rapprochement entre la vie comme un éternel recommencement obéissant
à l' absurde, et Sisyphe, héros de la mythologie grecque, puni par les dieux à faire remonter, continuellement, un rocher au sommet d' une montagne tout en sachant, qu' à la fin elle retombera et qu' il doit recommencer .
Même s' il s' agit de mythologie, la question qui vient à l' esprit est la suivante :
Pourquoi Sisyphe a été condamné à cette peine et quel est le crime qu' il a commis ? Camus cite plusieurs versions du mythe :
1/ La plupart explique la punition de Sisyphe par une insulte faite aux dieux.
2/ Une version, prête à Sisyphe, mourant, la volonté d' éprouver l' amour de sa femme, en lui demandant de ne pas lui donner une sépulture et de jeter son corps sur la place publique, après sa mort .
3/ Selon une autre version, Sisyphe découvrit la liaison amoureuse entre le maître de l' Olympe, Zeus, et Eugine. IL révéla cette liaison au père d' Eugine Ceci irrita les dieux qui le condamnèrent à pousser au sommet d' une
montagne un rocher, qui roule inéluctablement vers la vallée avant que le but du héros ne soit atteint.
Contrairement au Sisyphe que l' on présente habituellement dans la mythologie, Camus considère " qu' il faut imaginer Sisyphe heureux" . Sisyphe trouve son bonheur dans l' accomplissement de la tâche qu' il entreprend, et non dans la signification de cette tâche .
Pour écrire un tel essai, Camus s' est inspiré de la mythologie grecque. L' auteur fait le rapprochement entre la vie comme un éternel recommencement obéissant
à l' absurde, et Sisyphe, héros de la mythologie grecque, puni par les dieux à faire remonter, continuellement, un rocher au sommet d' une montagne tout en sachant, qu' à la fin elle retombera et qu' il doit recommencer .
Même s' il s' agit de mythologie, la question qui vient à l' esprit est la suivante :
Pourquoi Sisyphe a été condamné à cette peine et quel est le crime qu' il a commis ? Camus cite plusieurs versions du mythe :
1/ La plupart explique la punition de Sisyphe par une insulte faite aux dieux.
2/ Une version, prête à Sisyphe, mourant, la volonté d' éprouver l' amour de sa femme, en lui demandant de ne pas lui donner une sépulture et de jeter son corps sur la place publique, après sa mort .
3/ Selon une autre version, Sisyphe découvrit la liaison amoureuse entre le maître de l' Olympe, Zeus, et Eugine. IL révéla cette liaison au père d' Eugine Ceci irrita les dieux qui le condamnèrent à pousser au sommet d' une
montagne un rocher, qui roule inéluctablement vers la vallée avant que le but du héros ne soit atteint.
Contrairement au Sisyphe que l' on présente habituellement dans la mythologie, Camus considère " qu' il faut imaginer Sisyphe heureux" . Sisyphe trouve son bonheur dans l' accomplissement de la tâche qu' il entreprend, et non dans la signification de cette tâche .
Pierre qui roule...
Je ne sais pas vous, mais lorsque je pose un acte, je doute de sa validité, du sens qu'il peut revêtir. Je me dis qu'il pourrait être tout autre et qu'il aurait cependant la même importance, le même sens ou plutôt le même non-sens...
Chez Camus, c'est autre chose, à la relecture, le Mythe de Sisyphe est toujours aussi vertigineux et son évidence apparaît dans une flamboyance sans appel.
Tout commence par la question fondamentale du suicide, selon que la vie vaut ou non d'être vécue.
Sur cette question essentielle, le philosophe (existentialiste athée) met en garde contre les risques d'une pensée, (souvent mise en action par un simple "souci") trop introspective "c'est commencer d'être miné" et d'une lucidité exacerbée (dont Char écrivait qu'elle est "la blessure la plus rapprochée du soleil"). Il se réfère à deux postures possibles : celle de la Palisse ou celle du Quichotte, l'idéal étant un mix des deux, savant équilibre de l'étude rationnelle et du lyrisme.
Le suicide est donc un aveu d'incompréhension devant l'habitude, l'agitation quotidienne ainsi que devant le scandale de la souffrance et de la finitude qui génère ce sentiment d'absurdité qu'une logique poussée à son extrême entraîne jusqu'à l'irréversible abdication.
Il souligne une anomalie, le monde est "épais", une pensée anthropomorphique ne permet pas "d'unifier" ; un animal, une pierre nous sont étrangers ; la nature, un paysage "plus lointains qu'un paradis perdu" peuvent nous nier. Ainsi, "cette épaisseur et cette étrangeté du monde" participent de l'absurde.
Tentation de l'inutile, devant les apories toujours repoussées du travail scientifique et d'une physique dont les issues s'apparentent à l'oeuvre d'art.
Nul réconfort métaphysique ; que serait une liberté donnée par un être supérieur pour qui "n'a pas le sens de la hiérarchie" ? pas plus que celui de l'opportuniste pari pascalien.
Camus comprend mal également le revirement dostoïevskien d'un Kirilov se tuant pour être déifié, face aux espoirs d'une vie éternelle des Karamazov.
A cette absence de finalité et d'espoir (qui n'est pas le désespoir), répondent cependant une conscience cherchant sa direction, des intentions au coeur d'un présent, un mouvement, un devoir d'intelligence, des échanges humains et pour ne pas "ruminer", l'imagination, source de créations, fussent-elles éphémères.
Choisir entre "la croix ou l'épée", la contemplation ou l'action, bien que les sachant inutiles mais, dans dans une certaine mise à distance de l'événement, "faire comme si" et devant un hasard toujours "roi",savoir user de l'esquive...
Préférer encore la mutilation d'Oedipe, résistant ainsi au désespoir et à la tentation du suicide ; cette résistance devenant l'affirmation que "tout est bien".
C'est donc précisément l'absence de sens de l'existence qui en fait son intérêt.
Ainsi, pour Camus comme pour les stoïciens, l'homme peut et doit affronter le destin, enrichissement vers une certaine liberté intérieure :
"Il faut traiter le destin par le mépris"
Sauf que...
Peut-être ne convient-il pas de trop taquiner l'absurde ni provoquer
le fatum, les concepts ont parfois la susceptibilité exacerbée.
Le quatre janvier mille neuf cent soixante, la Facel Vega dans laquelle Albert Camus avait pris place s'est heurtée à l'épaisseur du réel ("ce qui résiste" - Serge Leclaire) et l'absurde, ainsi dépossédé de son objet s'est naturellement dissout.
L'écrivain a rejoint le minéral, tant chanté dans Noces et l'eté, avec lequel il aspirait parfois à se confondre.
La pierre délaissée a cessé son mouvement.
"Ce monde n'a plus son reflet dans un univers supérieur, mais le ciel des formes se figure dans le peuple des images de cette terre."
A noter que quelques mois plus tard, Sagan de justesse fut épargnée mais pourtant prévenus, Nimier ( "Il n'y a que les routes pour calmer la vie") et Huguenin abandonnèrent à l'asphalte beaucoup de leur superbe.
Bon voilà, j'ai terminé mon devoir de vacances, m'en vais sagement reprendre ma petite auto, puis maintenant que sont posées partout des limites et même aux vitesses, j'aurai l'absurde modeste, le destin besogneux ; pas de désir de suicide excepté peut-être une pendaison à un cou.
D'ailleurs, je n'intéresse guère les dieux, impassibles et somnolents dans la torpeur estivale.
,
Sitôt le personnage de ''L'étranger” abandonné à son triste sort, l'envie de rester un petit moment encore en compagnie d'Albert Camus s'est imposée naturellement.
D'un point de vue chronologique le choix de l'essai ”Le mythe de Sisyphe”, publié également en 1942 dans le cadre de la tétralogie “Le cycle de l'absurde”, semble aller de soi.
“Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide”. Malgré cet incipit quelque peu intransigeant, cet essai ne fait pas l'apologie du suicide, tant s'en faut.
Selon Camus, la passion et la révolte sont les meilleures armes pour combattre l'absurdité de la vie.
Pour échapper au tourment de sa propre finitude, à l'inutilité d'une vie, l'homme doit être habité d'un esprit tourné vers les relations humaines, épris de liberté dans la pleine conscience de ses pouvoirs et de ses limites.
L'homme conquérant doit essayer de constamment tendre vers “l'étonnante grandeur de l'esprit humain”.
Si le ton est parfois un peu péremptoire, le style de Camus n'est pas rébarbatif. Pour étayer ses dires l'écrivain se réfère souvent à d'illustres aînés, les passionnés de philosophie apprécieront.
Mes carences en la matière m'ont sans doute privé de quelques subtilités mais je n'ai pas éprouvé de lassitude à suivre l'auteur dans ses pérégrinations existentielles.
“Le mythe de Sisyphe” constitue une approche intéressante de la pensée camusienne. Le titre est éloquent mais la lecture de cette oeuvre pas le moins du monde éreintante.
D'un point de vue chronologique le choix de l'essai ”Le mythe de Sisyphe”, publié également en 1942 dans le cadre de la tétralogie “Le cycle de l'absurde”, semble aller de soi.
“Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide”. Malgré cet incipit quelque peu intransigeant, cet essai ne fait pas l'apologie du suicide, tant s'en faut.
Selon Camus, la passion et la révolte sont les meilleures armes pour combattre l'absurdité de la vie.
Pour échapper au tourment de sa propre finitude, à l'inutilité d'une vie, l'homme doit être habité d'un esprit tourné vers les relations humaines, épris de liberté dans la pleine conscience de ses pouvoirs et de ses limites.
L'homme conquérant doit essayer de constamment tendre vers “l'étonnante grandeur de l'esprit humain”.
Si le ton est parfois un peu péremptoire, le style de Camus n'est pas rébarbatif. Pour étayer ses dires l'écrivain se réfère souvent à d'illustres aînés, les passionnés de philosophie apprécieront.
Mes carences en la matière m'ont sans doute privé de quelques subtilités mais je n'ai pas éprouvé de lassitude à suivre l'auteur dans ses pérégrinations existentielles.
“Le mythe de Sisyphe” constitue une approche intéressante de la pensée camusienne. Le titre est éloquent mais la lecture de cette oeuvre pas le moins du monde éreintante.
"Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux:c'est le suicide-Albert Camus commence son livre avec cette phrase si violente de vérité et nous assène avec tout son poids son cri existentialiste tout le long de cet essai.... l''absurde
Albert Camus expose méthodiquement comme une analyse sans sentiment une froide démonstration de son sujet ......IL cherche ses conséquences plus qu'il traque les moyens ...De Jaspers à Heidegger .de Chestov à Kierkegaard de Nietzsche aussi de Don Juan à Kirilov , Albert Camus taille avec précision son petit diamant qui brille de son éclat l 'âme de notre Homme révolté pour en devenir sa Philosophie d'une vie ....
Kafka Dostoïevski deux écrivains fabuleux hantent beaucoup Albert Camus dans cet essai pour leur consacrer deux chapitres ....le suicide chez Dostoïevski et l'absurde chez Kafka .....
Il me faudra une seconde ou plus pour sortir la quintessence de cet ouvrage ....au plaisir de ce bon moment d'enrichissement métaphysique.Philosophique .....
Albert Camus expose méthodiquement comme une analyse sans sentiment une froide démonstration de son sujet ......IL cherche ses conséquences plus qu'il traque les moyens ...De Jaspers à Heidegger .de Chestov à Kierkegaard de Nietzsche aussi de Don Juan à Kirilov , Albert Camus taille avec précision son petit diamant qui brille de son éclat l 'âme de notre Homme révolté pour en devenir sa Philosophie d'une vie ....
Kafka Dostoïevski deux écrivains fabuleux hantent beaucoup Albert Camus dans cet essai pour leur consacrer deux chapitres ....le suicide chez Dostoïevski et l'absurde chez Kafka .....
Il me faudra une seconde ou plus pour sortir la quintessence de cet ouvrage ....au plaisir de ce bon moment d'enrichissement métaphysique.Philosophique .....
Camus a toujours rejetté les philosophes de salon , il se revendique comme l'anti Sartre , ce qui lui vaudra d'ailleurs beaucoup de problémes . Camus c'est le philosophe dela base , le fils d'un homme simple mort à la guerre , dont il va reprendre les principes de vie pour en faire les siens . Sa mére , muette ou quasiment , était sa seconde référence . Venant d'un millieu pauvre , Camus ne pouvait étre dans le sillage de Sartre . Son oeuvre ne pouvait donc qu'étre différente de celle de Sartre . L'absurdité de cette existence occupe une place essentielle dans la pensée de Camus . Il était donc logique qu'ici l'on retrouve cette thématique . Et quoi de plus absurde que Sisyphe et son rocher ? Camus a partir de cette évidence élabore tout un cheminement pour comprendre le'pourquoi d'une vie absurde . La force de son essai c'est qu'il est accessible a tous et que chacun peut si il le veut bien découvrir la pensée de celui qui reste aujourd'hui encore une référence incontournable des lettres contemporaines .
Quelques notes de lecture pour mémoire.
- le thème de cet essai est l'absurde, qui est une évidence pour Camus (au moment où il a écrit le mythe de Sisyphe):
"...Cette évidence, c'est l'absurde. C'est ce divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit, ma nostalgie d'unité, cet univers dispersé et la contradiction qui les enchaîne."
L'incompréhension du monde -de la vie- tels que Camus les perçoit, l'incapacité à leur reconnaître une signification amènent l'homme "absurde" à bannir l'espoir de son univers.
- des deux positions imaginées en conséquence, le suicide et la révolte (à comprendre fondamentalement comme le non-suicide), Camus évacue la première sans vraiment le justifier, me semble-t-il. Il ne s'agit donc absolument pas d'un livre sur le suicide malgré ce que pourrait laisser penser le titre du premier chapitre et sa célèbre première phrase.
- l'homme absurde (comprendre: l'homme ayant pris conscience de l'absurdité de la situation) décide de vivre; il me semble que Camus n'explique pas pourquoi et je trouve ça incompréhensible. Ici se situe à mon avis l'écart immense entre l'homme -même absurde- et Sisyphe. Sisyphe n'a le choix qu'entre être sans espoir (i.e. absurde) ou sans espoir et désespéré, mais obligatoirement vivant.
- après avoir posé les bases de son essai, défini le contour et la méthode (un raisonnement absurde), Camus caractérise l'absurde dans l'homme avec des exemples génériques (Dom Juan, l'acteur de théâtre, le conquérant) et le traque dans la création artistique. J'en retiens notamment que l'acte, voire la répétition de l'acte (quantité) prime sur la finalité au point que celle-ci est purement et simplement niée; en effet, rien ne peut légitimer une quelconque finalité puisque tout se termine par la mort (le seul sens de la vie, c'est de conduire à la mort; c'est un sens unique). L'homme, pour qui il existe une finalité (ultime ou partielle) de ses actes, ne fait pas partie du sujet.
- la démarche de Camus s'entend sur un plan strictement individuel. La dimension collective, n'étant pas abordée, j'en déduis qu'elle n'est pas, pour lui, un facteur susceptible de modifier son évidence de départ. Point de réflexion.
- de même que Nietzsche rêvait avec le Zarathoustra d'avoir écrit un cinquième évangile remplaçant les quatre premiers, d'une certaine façon on pourrait dire que Camus, ayant acté que Dieu était décidément mort, "essaye" de créer le nouveau catéchisme ou le vademecum de l'homme absurde. En pratique, on peut concrètement venir ici, en tant qu'homme, tester son niveau et, pour peu qu'on soit créateur, chercher pour son oeuvre l'award de l'absurdité. Ne nous y trompons pas, il y a potentiellement beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
- l'immense intelligence de Camus affleure à chaque ligne, chaque paragraphe. Presque chaque phrase pèse une tonne de sens qu'il faut apprécier idéalement avec du recul, du temps, des bases culturelles qui tous m'ont fait défaut; la séquence des phrases fait continûment progresser le propos, sans temps mort ; j'avoue que souvent la pensée de l'auteur est trop agile pour moi et qu'alors j'ai besoin de combler, laborieusement, les transitions qu'il ne prend pas toujours soin de tracer, même en pointillé
- la forme est, comme toujours chez Camus, un bonheur, mais, me semble-t-il, encore plus ici où il a -je l'imagine avec beaucoup de naïveté- le souci d'être particulièrement compréhensible vu le sujet; les phrases sont simples, souvent courtes; les idées exposées précisément et avec économie.
A relire, en homme absurde, i.e. sans raison autre que relire pour le plaisir qui ne se soucie pas de l'utilité. ...Plus l'apport à mon édification, car, tout bien réfléchi et toute honte bue....je crois, hélas, que je ne suis pas (encore) absurde.
Addendum suite aux commentaires
- le magnifique "il faut imaginer Sisyphe heureux" est une réussite littéraire mais n'a pas pour moi place dans cet essai sinon comme projection vers autre chose. le concept de bonheur, aucunement défini et seulement abordé dans les deux dernières pages introduit un champ lexical nouveau qui rompt l'unité de l'ouvrage et me laisse pressentir le remords de l'auteur qui affirmerait, trop tard, "On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelque manuel du bonheur." ....Avec plaisir, Albert!
- le thème de cet essai est l'absurde, qui est une évidence pour Camus (au moment où il a écrit le mythe de Sisyphe):
"...Cette évidence, c'est l'absurde. C'est ce divorce entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit, ma nostalgie d'unité, cet univers dispersé et la contradiction qui les enchaîne."
L'incompréhension du monde -de la vie- tels que Camus les perçoit, l'incapacité à leur reconnaître une signification amènent l'homme "absurde" à bannir l'espoir de son univers.
- des deux positions imaginées en conséquence, le suicide et la révolte (à comprendre fondamentalement comme le non-suicide), Camus évacue la première sans vraiment le justifier, me semble-t-il. Il ne s'agit donc absolument pas d'un livre sur le suicide malgré ce que pourrait laisser penser le titre du premier chapitre et sa célèbre première phrase.
- l'homme absurde (comprendre: l'homme ayant pris conscience de l'absurdité de la situation) décide de vivre; il me semble que Camus n'explique pas pourquoi et je trouve ça incompréhensible. Ici se situe à mon avis l'écart immense entre l'homme -même absurde- et Sisyphe. Sisyphe n'a le choix qu'entre être sans espoir (i.e. absurde) ou sans espoir et désespéré, mais obligatoirement vivant.
- après avoir posé les bases de son essai, défini le contour et la méthode (un raisonnement absurde), Camus caractérise l'absurde dans l'homme avec des exemples génériques (Dom Juan, l'acteur de théâtre, le conquérant) et le traque dans la création artistique. J'en retiens notamment que l'acte, voire la répétition de l'acte (quantité) prime sur la finalité au point que celle-ci est purement et simplement niée; en effet, rien ne peut légitimer une quelconque finalité puisque tout se termine par la mort (le seul sens de la vie, c'est de conduire à la mort; c'est un sens unique). L'homme, pour qui il existe une finalité (ultime ou partielle) de ses actes, ne fait pas partie du sujet.
- la démarche de Camus s'entend sur un plan strictement individuel. La dimension collective, n'étant pas abordée, j'en déduis qu'elle n'est pas, pour lui, un facteur susceptible de modifier son évidence de départ. Point de réflexion.
- de même que Nietzsche rêvait avec le Zarathoustra d'avoir écrit un cinquième évangile remplaçant les quatre premiers, d'une certaine façon on pourrait dire que Camus, ayant acté que Dieu était décidément mort, "essaye" de créer le nouveau catéchisme ou le vademecum de l'homme absurde. En pratique, on peut concrètement venir ici, en tant qu'homme, tester son niveau et, pour peu qu'on soit créateur, chercher pour son oeuvre l'award de l'absurdité. Ne nous y trompons pas, il y a potentiellement beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
- l'immense intelligence de Camus affleure à chaque ligne, chaque paragraphe. Presque chaque phrase pèse une tonne de sens qu'il faut apprécier idéalement avec du recul, du temps, des bases culturelles qui tous m'ont fait défaut; la séquence des phrases fait continûment progresser le propos, sans temps mort ; j'avoue que souvent la pensée de l'auteur est trop agile pour moi et qu'alors j'ai besoin de combler, laborieusement, les transitions qu'il ne prend pas toujours soin de tracer, même en pointillé
- la forme est, comme toujours chez Camus, un bonheur, mais, me semble-t-il, encore plus ici où il a -je l'imagine avec beaucoup de naïveté- le souci d'être particulièrement compréhensible vu le sujet; les phrases sont simples, souvent courtes; les idées exposées précisément et avec économie.
A relire, en homme absurde, i.e. sans raison autre que relire pour le plaisir qui ne se soucie pas de l'utilité. ...Plus l'apport à mon édification, car, tout bien réfléchi et toute honte bue....je crois, hélas, que je ne suis pas (encore) absurde.
Addendum suite aux commentaires
- le magnifique "il faut imaginer Sisyphe heureux" est une réussite littéraire mais n'a pas pour moi place dans cet essai sinon comme projection vers autre chose. le concept de bonheur, aucunement défini et seulement abordé dans les deux dernières pages introduit un champ lexical nouveau qui rompt l'unité de l'ouvrage et me laisse pressentir le remords de l'auteur qui affirmerait, trop tard, "On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelque manuel du bonheur." ....Avec plaisir, Albert!
Que dire ? Un point de vue où l'auteur convoque Kierkegaard, Kafka, Chestov, Nietzsche et d'autres...
On écarte la religion (chrétienne) pour mieux y revenir à plusieurs reprises.
On écarte les pensées orientales (du Moyen-Orient au Japon) parce qu'elles sont gênantes, parce qu'elles contredisent dès le début et là on y revient plus.
Je résume : La vie est absurde mais le suicide est absurde.
C'est un point de vue très partiel.
On écarte la religion (chrétienne) pour mieux y revenir à plusieurs reprises.
On écarte les pensées orientales (du Moyen-Orient au Japon) parce qu'elles sont gênantes, parce qu'elles contredisent dès le début et là on y revient plus.
Je résume : La vie est absurde mais le suicide est absurde.
C'est un point de vue très partiel.
Quatrième livre abandonné en 2013. Ca fait presque un an que je l'ai emprunté à un collègue, je m'étais donné jusqu'à aujourd'hui pour le finir, et je patauge complètement.
Autant la première partie m'a beaucoup intéressée, autant le reste n'a été pour moi qu'une suite de mots qui n'avaient pas vraiment de sens.
De toute façon, mon point de vue est à l'opposé de celui de Camus, et comme il veut à tout prix me montrer que j'ai tort, je n'arrive plus à l'écouter.
Page 110, je m'arrête là pour cette aventure qui aura été bien laborieuse.
Autant la première partie m'a beaucoup intéressée, autant le reste n'a été pour moi qu'une suite de mots qui n'avaient pas vraiment de sens.
De toute façon, mon point de vue est à l'opposé de celui de Camus, et comme il veut à tout prix me montrer que j'ai tort, je n'arrive plus à l'écouter.
Page 110, je m'arrête là pour cette aventure qui aura été bien laborieuse.
J'ai entendu parler de cet essai en classe de première pour avoir étudié L'Etranger du même auteur et étant passionnée de légendes grecques, je me suis laissée tenter mais je suis franchement déçue par le travail de l'auteur car j'ai trouvé son essai long malgré les 150 pages et rébarbatif à mort même le petit texte sur Sisyphe qui me faisait tant envie a été sans saveur
Lien : http://leschroniquesdemilie...
Lien : http://leschroniquesdemilie...
Connaître le sort de Sisyphe nous éclaircit d'emblée sur les intentions d'Albert Camus :
« Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. »
Pauvre Sisyphe –et pauvre homme absurde. Car tout homme n'est pas Sisyphe, mais l'est seulement celui qui aura été un jour frappé par un instant de lucidité féroce. A partir de ce moment-là se révèle la question philosophique majeure : la vie mérite-t-elle d'être vécue malgré son inutilité absolue et apparente ? Si non, il faut se suicider. Si oui, il faut trouver une bonne raison de continuer à vivre. Celui-là qui continue est l'homme absurde, jonglant d'un jour sur l'autre entre espoir et lassitude.
Dans son exposé de la question, Albert Camus se montre austère et très peu engageant. Cherchant peut-être à prendre de la distance avec son sujet, il détaille les arguments et les réflexions avec une rigueur scientifique qui sied peu à la question, qui rebute souvent par une impression de manque d'empathie, mais qui finit toutefois de bouleverser par la pertinence des vérités ainsi discrètement révélées.
Inspiré et nourri de figures littéraires, Albert Camus disparaît le temps de deux chapitres derrière les interprétations absurdes des oeuvres de Dostoïevski et de Kafka. Il nous donne ainsi la possibilité de renouveler notre regard et de compatir avec ces hommes absurdes qui, pour faire fuir la terreur de la mort, ont créé ce qu'on appelle parfois « l'oeuvre d'une vie ».
Le mythe de Sisyphe est utilisé à escient pour dépasser son aspect tragique. Sisyphe est-il désespéré ? Parfois, sans doute, mais « il faut imaginer Sisyphe heureux » car « la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme ». Si la seule et ultime raison qui nous conserve vivant est la vie elle-même, alors cela suffit.
Vraiment ? Il faut imaginer Albert heureux. Et si l'on y parvient, c'est que nous-mêmes le sommes encore un peu.
Lien : http://colimasson.over-blog...
« Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. »
Pauvre Sisyphe –et pauvre homme absurde. Car tout homme n'est pas Sisyphe, mais l'est seulement celui qui aura été un jour frappé par un instant de lucidité féroce. A partir de ce moment-là se révèle la question philosophique majeure : la vie mérite-t-elle d'être vécue malgré son inutilité absolue et apparente ? Si non, il faut se suicider. Si oui, il faut trouver une bonne raison de continuer à vivre. Celui-là qui continue est l'homme absurde, jonglant d'un jour sur l'autre entre espoir et lassitude.
Dans son exposé de la question, Albert Camus se montre austère et très peu engageant. Cherchant peut-être à prendre de la distance avec son sujet, il détaille les arguments et les réflexions avec une rigueur scientifique qui sied peu à la question, qui rebute souvent par une impression de manque d'empathie, mais qui finit toutefois de bouleverser par la pertinence des vérités ainsi discrètement révélées.
Inspiré et nourri de figures littéraires, Albert Camus disparaît le temps de deux chapitres derrière les interprétations absurdes des oeuvres de Dostoïevski et de Kafka. Il nous donne ainsi la possibilité de renouveler notre regard et de compatir avec ces hommes absurdes qui, pour faire fuir la terreur de la mort, ont créé ce qu'on appelle parfois « l'oeuvre d'une vie ».
Le mythe de Sisyphe est utilisé à escient pour dépasser son aspect tragique. Sisyphe est-il désespéré ? Parfois, sans doute, mais « il faut imaginer Sisyphe heureux » car « la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme ». Si la seule et ultime raison qui nous conserve vivant est la vie elle-même, alors cela suffit.
Vraiment ? Il faut imaginer Albert heureux. Et si l'on y parvient, c'est que nous-mêmes le sommes encore un peu.
Lien : http://colimasson.over-blog...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Albert Camus (102)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz sur l´Etranger par Albert Camus
L´Etranger s´ouvre sur cet incipit célèbre : "Aujourd´hui maman est morte...
Et je n´ai pas versé de larmes
Un testament sans héritage
Tant pis
Ou peut-être hier je ne sais pas
9 questions
4804 lecteurs ont répondu
Thème : L'étranger de
Albert CamusCréer un quiz sur ce livre4804 lecteurs ont répondu