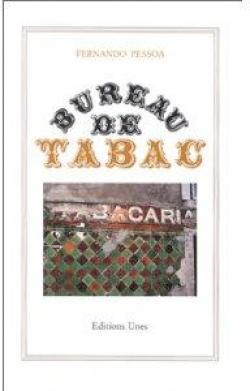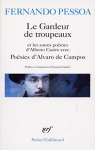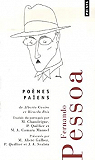Critiques filtrées sur 4 étoiles
« Je ne suis rien / Jamais je ne serai rien. / Je ne puis vouloir être rien. / Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. »
Un homme à sa fenêtre regarde le bureau de tabac d'en face et c'est déjà tout le désarroi de la vie qui nous saute au visage…
Cet homme c'est Alvaro de Campos, l'un des nombreux hétéronymes dont s'est servi le grand poète et homme de lettres portugais Fernando Pessoa (1888-1935) pour bâtir une oeuvre gigantesque, complexe et multiple.
« Les hétéronymes littéraires auront une telle force dans l'oeuvre de Pessoa, ils seront à l'origine d'une création littéraire si unique que l'auteur leur trouvera même à chacun une biographie justifiant leurs différences. »
Alvaro de Campos est un ingénieur en mécanique ; être tourmenté, solitaire et paradoxal, il est l'incarnation de l'homme moderne désillusionné dans l'oeuvre de Pessoa.
Mille pensées l'assaillent, l'accablent, l'agressent, le rongent. Sa vision du monde, entre désir de rêve et réalité, sa lucidité, franche et désenchantée sur le monde et sur sa propre condition, ses remarques moroses, ses opinions saturniennes… s'égrènent au fil d'une poésie trouble, triste et fascinante, dont l'envoûtement joue sur des registres émotionnels entre ombre et lumière, entre feu et air, entre souffle chaud et fluide glacial, comme une caresse après les coups…
Des mots, tout simples, puissants comme un tourment, jetés en pâture avec la force « intranquille » du poète, dans le vide sidéral de nos destinées, dans le gouffre sans fond de notre vacuité existentielle.
Etre, faire, paraître, devenir…toutes ces actions menées…Pour quoi ? Toutes ces choses effectuées avec la peur chagrine de ne pas laisser de trace. Mais pour mener où ? Tous ces masques derrière lesquels nous nous camouflons. Dans quel but ?
« Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis ? »
Entre espoir et désespoir, aspiration et désespérance, perpétuel questionnement sur le sens de l'existence et sur le pourquoi des choses, Alvaro de Campos, de la fenêtre de sa petite chambre, s'abîme dans un flot tumultueux de pensées métaphysiques qui le conduisent au bord d'un découragement duquel sourd quelquefois une irrépressible rage de vivre.
« Sentir de toutes les manières, / Vivre tout de tous les côtés, / Être la même chose de toutes les façons possibles en même temps, / Réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments / En un seul moment diffus, profus, total et lointain. »
Sa poésie, sans versification et sans construction, sans rimes, sans pieds qui ne se comptent, est une poésie quasi parlée, monologuée, soliloquée dans une effervescence et dans un débit de paroles qui fusent avec toute la force de l'affliction, et impriment un immense sentiment de solitude.
« Je suis seul, d'une solitude jamais atteinte, / creux en dedans, sans futur ni passé. »
Ses mots s'enlisent dans la tourbe lente d'une conscience désespérée, mais s'arment du charme cruel et vénéneux des Tubéreuses, comme une très belle plante poussant dans la fange, orchidée au parfum subtil née des relents d'un l'esprit tourmenté.
Pensée torturée, forcée, profanée, dans un grand désir de la tordre et de la pressurer pour en faire sortir ce qui se cache au plus profond de soi, et ainsi, si profondément juste et sincère qu'elle en devient lumineuse, ardente, comme éclairée de l'intérieur, riche de tout ce qu'elle entraîne comme interrogations et questionnements.
Une lente et longue « marche vers soi, vers la connaissance » de cet être multiple qui définit l'homme et le poète.
Quête de soi, cheminement intérieur, alliés à une volonté acharnée de comprendre à quoi sert l'existence, s'il y a un but, une finalité, en même temps que la figure d'un grand doute s'insinue et s'infiltre, se colle aux parois perturbées de l'esprit, s'en empare pour, de son travail de suspicion, faire oeuvre de déréliction. « Qu'il est difficile d'être soi-même et de ne voir que le visible ! »
Et il y a un tel sentiment de vacuité dans tous les mots du poète, un tel espace à combler, une telle certitude du néant… que cela fait mal mais que cela est beau, d'une beauté grave, tragique, poignante, d'un désenchantement ironique et mordant.
« Bureau de tabac » est une poésie qui est et qui rend triste, de ce genre de tristesse qui étend son voile brumeux de nostalgie sur les êtres qu'elle touche mais dont on ne peut s'empêcher de parcourir et continuer la lecture, en scandant chaque mot, en en goûtant la sève généreuse et empoisonnée, en s'imprégnant de son rythme envoûtant et lancinant de brûlante saudade portugaise.
Poésie transcendante, touchant au sublime, à la fois réelle au plus près du réel et abstraite au plus près du rêve…
« Ainsi, étranger à moi-même, je lis
Mon être, comme les pages d'un livre.
Je ne prévois point la suite,
J'oublie le passé.
Je note sur la marge des pages lues
Ce que j'ai cru sentir.
Je relis et je me dis: “Est-ce moi?”
Dieu le sait, car il l'a écrit. »
Un homme à sa fenêtre regarde le bureau de tabac d'en face et c'est déjà tout le désarroi de la vie qui nous saute au visage…
Cet homme c'est Alvaro de Campos, l'un des nombreux hétéronymes dont s'est servi le grand poète et homme de lettres portugais Fernando Pessoa (1888-1935) pour bâtir une oeuvre gigantesque, complexe et multiple.
« Les hétéronymes littéraires auront une telle force dans l'oeuvre de Pessoa, ils seront à l'origine d'une création littéraire si unique que l'auteur leur trouvera même à chacun une biographie justifiant leurs différences. »
Alvaro de Campos est un ingénieur en mécanique ; être tourmenté, solitaire et paradoxal, il est l'incarnation de l'homme moderne désillusionné dans l'oeuvre de Pessoa.
Mille pensées l'assaillent, l'accablent, l'agressent, le rongent. Sa vision du monde, entre désir de rêve et réalité, sa lucidité, franche et désenchantée sur le monde et sur sa propre condition, ses remarques moroses, ses opinions saturniennes… s'égrènent au fil d'une poésie trouble, triste et fascinante, dont l'envoûtement joue sur des registres émotionnels entre ombre et lumière, entre feu et air, entre souffle chaud et fluide glacial, comme une caresse après les coups…
Des mots, tout simples, puissants comme un tourment, jetés en pâture avec la force « intranquille » du poète, dans le vide sidéral de nos destinées, dans le gouffre sans fond de notre vacuité existentielle.
Etre, faire, paraître, devenir…toutes ces actions menées…Pour quoi ? Toutes ces choses effectuées avec la peur chagrine de ne pas laisser de trace. Mais pour mener où ? Tous ces masques derrière lesquels nous nous camouflons. Dans quel but ?
« Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis ? »
Entre espoir et désespoir, aspiration et désespérance, perpétuel questionnement sur le sens de l'existence et sur le pourquoi des choses, Alvaro de Campos, de la fenêtre de sa petite chambre, s'abîme dans un flot tumultueux de pensées métaphysiques qui le conduisent au bord d'un découragement duquel sourd quelquefois une irrépressible rage de vivre.
« Sentir de toutes les manières, / Vivre tout de tous les côtés, / Être la même chose de toutes les façons possibles en même temps, / Réaliser en soi toute l'humanité de tous les moments / En un seul moment diffus, profus, total et lointain. »
Sa poésie, sans versification et sans construction, sans rimes, sans pieds qui ne se comptent, est une poésie quasi parlée, monologuée, soliloquée dans une effervescence et dans un débit de paroles qui fusent avec toute la force de l'affliction, et impriment un immense sentiment de solitude.
« Je suis seul, d'une solitude jamais atteinte, / creux en dedans, sans futur ni passé. »
Ses mots s'enlisent dans la tourbe lente d'une conscience désespérée, mais s'arment du charme cruel et vénéneux des Tubéreuses, comme une très belle plante poussant dans la fange, orchidée au parfum subtil née des relents d'un l'esprit tourmenté.
Pensée torturée, forcée, profanée, dans un grand désir de la tordre et de la pressurer pour en faire sortir ce qui se cache au plus profond de soi, et ainsi, si profondément juste et sincère qu'elle en devient lumineuse, ardente, comme éclairée de l'intérieur, riche de tout ce qu'elle entraîne comme interrogations et questionnements.
Une lente et longue « marche vers soi, vers la connaissance » de cet être multiple qui définit l'homme et le poète.
Quête de soi, cheminement intérieur, alliés à une volonté acharnée de comprendre à quoi sert l'existence, s'il y a un but, une finalité, en même temps que la figure d'un grand doute s'insinue et s'infiltre, se colle aux parois perturbées de l'esprit, s'en empare pour, de son travail de suspicion, faire oeuvre de déréliction. « Qu'il est difficile d'être soi-même et de ne voir que le visible ! »
Et il y a un tel sentiment de vacuité dans tous les mots du poète, un tel espace à combler, une telle certitude du néant… que cela fait mal mais que cela est beau, d'une beauté grave, tragique, poignante, d'un désenchantement ironique et mordant.
« Bureau de tabac » est une poésie qui est et qui rend triste, de ce genre de tristesse qui étend son voile brumeux de nostalgie sur les êtres qu'elle touche mais dont on ne peut s'empêcher de parcourir et continuer la lecture, en scandant chaque mot, en en goûtant la sève généreuse et empoisonnée, en s'imprégnant de son rythme envoûtant et lancinant de brûlante saudade portugaise.
Poésie transcendante, touchant au sublime, à la fois réelle au plus près du réel et abstraite au plus près du rêve…
« Ainsi, étranger à moi-même, je lis
Mon être, comme les pages d'un livre.
Je ne prévois point la suite,
J'oublie le passé.
Je note sur la marge des pages lues
Ce que j'ai cru sentir.
Je relis et je me dis: “Est-ce moi?”
Dieu le sait, car il l'a écrit. »
Avec ce (très) court recueil, je découvre un poète dont je ne savais rien auparavant. Ce poème correspond à l'hétéronyme Alvaro de Campos (il en a plusieurs pour lesquels il a écrit différents textes), et au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un hétéronyme, comme moi il y a peu, il s'agit d'un pseudonyme auquel on donnerait vie, lui façonnant une biographie ainsi qu'un style indépendant de soi.
Un homme, à la lucarne de sa chambre donnant sur une rue et un bureau de tabac, se trouve en ce point qui frôle le non-retour, où le moindre être vivant vaut bien plus que soi-même, où l'on n'est plus qu'un souffle, une feuille au vent. On suit ses découragements, sa défaite, son éloignement du monde jusqu'à ce que le bureau de tabac le ramène auprès de nous. Poème, très court récit, introspection, c'est un peu tout ça et c'est presque doux, de la douceur de la mélancolie.
Un homme, à la lucarne de sa chambre donnant sur une rue et un bureau de tabac, se trouve en ce point qui frôle le non-retour, où le moindre être vivant vaut bien plus que soi-même, où l'on n'est plus qu'un souffle, une feuille au vent. On suit ses découragements, sa défaite, son éloignement du monde jusqu'à ce que le bureau de tabac le ramène auprès de nous. Poème, très court récit, introspection, c'est un peu tout ça et c'est presque doux, de la douceur de la mélancolie.
Toute une vie bien ratée de Pierre Autin-Grenier, dessine en épitaphe les premiers vers du poème Bureau de tabac de Fernando Pessoa, Je ne suis rien, je ne serai jamais rien …, je suis intrigué par ces mots, je recherche, j'arpente et déniche ce recueil, bilingue, traduit par Rémy Hourcade aux éditions Unes. Sous le nom de Alvaro de Campos, un des pseudonymes de l'auteur Portugais, écrit le 15 janvier 1928 à Lisbonne, ce poème navigue son écoulement pour être publié pour la première fois dans le numéro 39 de la revue Presença, en France, il aura deux parutions en 1955 et 1968, celles-ci sont épuisées, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Fernando Pessoa, une édition prestige de 1000 exemplaires sur Centaure ivoire fut tirée. Ce court poème est comme une désolation de l'instant, où respire Cioran et ces Syllogismes de l'amertume, et de l'inconvénient d'être né, la mélancolie maladive d'Arthur Schopenhauer savoure l'instant de ces vers, venez-vous perdre dans ces mots et laissez-vous transporter dans cette réflexion métaphysique.
De sa fenêtre, un homme regarde ce que la vue lui offre, une rue, un bureau de tabac, puis s'échappent des pensées sur l'existence, sur lui-même, comme un Sartre dans La nausée, dès les premiers mots , il n'est rien, mais il porte tous les rêves du monde, sa rue oscille dans le va-et-vient continuel, étant une impasse des pensées, puis cette déambulation qui promène le poète vers des chemins de vies où la mort est présente, elle moisit les murs et blanchit les cheveux, la vérité et la mort errent ensemble, comme Pierre Autin-Grenier, Fernando Pessoa par l'homme qui regarde par la fenêtre dit « J'ai tout raté », est-ce lui cet homme, avec ce « je » , je n'ai pas voulu interposer le « je » avec l'auteur, pour fuir ce poème vers les lecteurs, qui pourront s'y identifier, mais je sais pertinemment que le « je » est bien l'auteur, cet homme dans l'année de ces 40 ans, en proie avec son alcoolisme, qui le tuera 7 ans plus tard, il est de la génération montante des modernes, fuyant après l'instauration de la dictature civile, ces propos sur la dictature militaire, il est dans ce poème, cet homme qui est dans le désenchantement, face à ce Bureaux de tabac qui trône devant sa fenêtre, lui, posé dans l'immobilité de son être, isolé dans sa chambre, regardant le vie et son quotidien.
Cette déambulation introspective, celle d'un promeneur dans les dédales de sa pensée, le bureau de Tabac face à lui, cette façade bien réelle, mais l'intérieur le rêve si échappe, en laissant cette réalité tournoyer de l'intérieur, celle de la nature et là la multitude l'angoisse, le nombre le rend invisible, la génie que Rimbaud touchera par la main de Dieu, cette main sera-t-elle celle de notre poète, résistera-t-il à l'histoire, sera-t-il le sommet de la montagne, ce vertige d'être ce génie, au lieu de devenir ce fumier qui consomme notre chair à notre mort, inconnu des autres, du monde qui élève le génie et laisse les autres dans des asiles pour avoir gouté au vertige du savoir, celui de la conquête, comme peut-être crédule Don Quichotte dans l'illusion de sa folie. le rêve emporte la réalité pour sentir palpiter cet espoir qui anime les hommes et les femmes, cette conquête que l'on souhaite, Napoléon reste ce conquérant inutile face aux rêves de notre narrateur, il est perdu dans ces songes de conquête comme aspiré par le virtuel de son être, statique face à la réalité, il se perd dans ces chimères, ces rhizomes qui transpirent son cerveau, Kant, le Christ sont des apprentis face au savoir qu'il créé dans son imaginaire, restant dans la mansarde, cet héros s'englue dans l'illusion du virtuel, laissant le réel aux autres, tous lui échappe, est-il dans un délire, ce poème est-il un rêve qu'il consume, ou une saoulerie qui le grise, cet homme étendu dans son lit, conquérant de literie, cet homme s'éveille de sa conscience pour cette métaphore du monde chocolat, cette gourmandise puis cet homme s'enlise dans les couloirs de son âme , il est en quête d'une muse, comme ceux d'une autre époque, comme si, dans l'égarement de son être, il voulait être ailleurs, dans un temps qui était, mais son coeur est un seau vidé, et soudain la réalité le regarde dans ses yeux au-delà de cette fenêtre, l'existence anime la vie de la rue, les boutiques, les trottoirs, les voitures passent, la vie est là devant sa fenêtre, La nausée est là pas très loin, L'étranger le ronge, comme Meursault de Camus, la narrateur regarde son existence encore et encore, comme si il ne l'avait pas vécu, tel le lézard dont sa queue coupée continue de s'agiter au-delà de lui, ce masque adhère à son être, il veut être celui qu'il désire être sans être celui qu'il pense être, son être devient inoffensif…..
Le temps érode les souvenirs, les existences se meurent et vivent à travers les choses que l'on n'oublie pas comme ces vers ou l'enseigne du Bureau de tabac, puis tout deviendra poussière, le cycle de la vie se perpétue dans cet espace, ce monde, cette galaxie, les vers et les enseignes renaitront dans une autre réalité, cette farandole constelle la vue de Fernando Pessoa, l'incertitude, je suis le tout, je suis le rien comme Nietzsche. La vie d'en face du Bureau de tabac réveille notre homme perdu dans sa méditation exploratoire, la cigarette se consomme en lui, la fumée est la route qu'il doit suivre, tout s'arrête en lui, cette métaphysique intime n'est qu'une indisposition, une échappée belle, une excroissance de son être, il devient soudain le fumeur, il est dans la liberté d'inhaler ce tabac qui goudronne ces poumons, le Destin lui accorde cette faveur pour faire durer cet instant, la liberté de fumer, et la main tendu d'un client du Bureau de tabac le sort de son exile métaphysique, c'est un ami Estève (Estève-n'a-pas-de-métaphysique), et soudain la vie continue, notre fumeur salue cette connaissance, faisant sourire le patron du Tabac et l'idéal et l'espoir resteront muet, la connaissance du l'univers venant s'effacer pour vivre sa vie, comme celle de Fernando Pessoa.
Il est toujours difficile de pouvoir critiquer un poème, j'ai plutôt navigué dans les émotions qui ont animées ma lecture, les sensations qui ont suées ma chair, le poème anime l'instant du poète mais aussi celui du lecteur qui souvent se l'approprie et le digère, il marque au fer rouge le lecteur de son empreinte et le poème comme le poéte sont aspirés dans le tube digestif du lecteur pour y être dissout dans l'essence même que le lecteur voudra bien se l'approprier. Fernando Pessoa a su me prendre la main pour voyager dans son univers, j'aime me perdre ainsi dans les mots d'un autre pour nager dans le contre-courant de ces vers, pour y sentir la saveur et la coucher dans mes mots plus humbles et maladroits.
De sa fenêtre, un homme regarde ce que la vue lui offre, une rue, un bureau de tabac, puis s'échappent des pensées sur l'existence, sur lui-même, comme un Sartre dans La nausée, dès les premiers mots , il n'est rien, mais il porte tous les rêves du monde, sa rue oscille dans le va-et-vient continuel, étant une impasse des pensées, puis cette déambulation qui promène le poète vers des chemins de vies où la mort est présente, elle moisit les murs et blanchit les cheveux, la vérité et la mort errent ensemble, comme Pierre Autin-Grenier, Fernando Pessoa par l'homme qui regarde par la fenêtre dit « J'ai tout raté », est-ce lui cet homme, avec ce « je » , je n'ai pas voulu interposer le « je » avec l'auteur, pour fuir ce poème vers les lecteurs, qui pourront s'y identifier, mais je sais pertinemment que le « je » est bien l'auteur, cet homme dans l'année de ces 40 ans, en proie avec son alcoolisme, qui le tuera 7 ans plus tard, il est de la génération montante des modernes, fuyant après l'instauration de la dictature civile, ces propos sur la dictature militaire, il est dans ce poème, cet homme qui est dans le désenchantement, face à ce Bureaux de tabac qui trône devant sa fenêtre, lui, posé dans l'immobilité de son être, isolé dans sa chambre, regardant le vie et son quotidien.
Cette déambulation introspective, celle d'un promeneur dans les dédales de sa pensée, le bureau de Tabac face à lui, cette façade bien réelle, mais l'intérieur le rêve si échappe, en laissant cette réalité tournoyer de l'intérieur, celle de la nature et là la multitude l'angoisse, le nombre le rend invisible, la génie que Rimbaud touchera par la main de Dieu, cette main sera-t-elle celle de notre poète, résistera-t-il à l'histoire, sera-t-il le sommet de la montagne, ce vertige d'être ce génie, au lieu de devenir ce fumier qui consomme notre chair à notre mort, inconnu des autres, du monde qui élève le génie et laisse les autres dans des asiles pour avoir gouté au vertige du savoir, celui de la conquête, comme peut-être crédule Don Quichotte dans l'illusion de sa folie. le rêve emporte la réalité pour sentir palpiter cet espoir qui anime les hommes et les femmes, cette conquête que l'on souhaite, Napoléon reste ce conquérant inutile face aux rêves de notre narrateur, il est perdu dans ces songes de conquête comme aspiré par le virtuel de son être, statique face à la réalité, il se perd dans ces chimères, ces rhizomes qui transpirent son cerveau, Kant, le Christ sont des apprentis face au savoir qu'il créé dans son imaginaire, restant dans la mansarde, cet héros s'englue dans l'illusion du virtuel, laissant le réel aux autres, tous lui échappe, est-il dans un délire, ce poème est-il un rêve qu'il consume, ou une saoulerie qui le grise, cet homme étendu dans son lit, conquérant de literie, cet homme s'éveille de sa conscience pour cette métaphore du monde chocolat, cette gourmandise puis cet homme s'enlise dans les couloirs de son âme , il est en quête d'une muse, comme ceux d'une autre époque, comme si, dans l'égarement de son être, il voulait être ailleurs, dans un temps qui était, mais son coeur est un seau vidé, et soudain la réalité le regarde dans ses yeux au-delà de cette fenêtre, l'existence anime la vie de la rue, les boutiques, les trottoirs, les voitures passent, la vie est là devant sa fenêtre, La nausée est là pas très loin, L'étranger le ronge, comme Meursault de Camus, la narrateur regarde son existence encore et encore, comme si il ne l'avait pas vécu, tel le lézard dont sa queue coupée continue de s'agiter au-delà de lui, ce masque adhère à son être, il veut être celui qu'il désire être sans être celui qu'il pense être, son être devient inoffensif…..
Le temps érode les souvenirs, les existences se meurent et vivent à travers les choses que l'on n'oublie pas comme ces vers ou l'enseigne du Bureau de tabac, puis tout deviendra poussière, le cycle de la vie se perpétue dans cet espace, ce monde, cette galaxie, les vers et les enseignes renaitront dans une autre réalité, cette farandole constelle la vue de Fernando Pessoa, l'incertitude, je suis le tout, je suis le rien comme Nietzsche. La vie d'en face du Bureau de tabac réveille notre homme perdu dans sa méditation exploratoire, la cigarette se consomme en lui, la fumée est la route qu'il doit suivre, tout s'arrête en lui, cette métaphysique intime n'est qu'une indisposition, une échappée belle, une excroissance de son être, il devient soudain le fumeur, il est dans la liberté d'inhaler ce tabac qui goudronne ces poumons, le Destin lui accorde cette faveur pour faire durer cet instant, la liberté de fumer, et la main tendu d'un client du Bureau de tabac le sort de son exile métaphysique, c'est un ami Estève (Estève-n'a-pas-de-métaphysique), et soudain la vie continue, notre fumeur salue cette connaissance, faisant sourire le patron du Tabac et l'idéal et l'espoir resteront muet, la connaissance du l'univers venant s'effacer pour vivre sa vie, comme celle de Fernando Pessoa.
Il est toujours difficile de pouvoir critiquer un poème, j'ai plutôt navigué dans les émotions qui ont animées ma lecture, les sensations qui ont suées ma chair, le poème anime l'instant du poète mais aussi celui du lecteur qui souvent se l'approprie et le digère, il marque au fer rouge le lecteur de son empreinte et le poème comme le poéte sont aspirés dans le tube digestif du lecteur pour y être dissout dans l'essence même que le lecteur voudra bien se l'approprier. Fernando Pessoa a su me prendre la main pour voyager dans son univers, j'aime me perdre ainsi dans les mots d'un autre pour nager dans le contre-courant de ces vers, pour y sentir la saveur et la coucher dans mes mots plus humbles et maladroits.
N°277 – Juillet 2007
BUREAU DE TABAC – Alvaro de Campos [Fernando PESSOA] Edition UNES.
C'est sans doute une drôle d'idée et assurément un manque d'humilité de ma part que de vouloir présenter ce poète qu'on ne présente plus, de vouloir parler de lui dont on parle encore, et pour longtemps, d'oser commenter une partie de son oeuvre... Eh bien j'ose puisqu'il me fascine toujours, davantage peut-être par ce qu'il a été que par ce qu'il a écrit..
C'est un bien étrange tableau que nous dessine Alvaro de Campos, alias Fernando Pessoa. Il est à la fois tout en nuances et plein de couleurs crues, de coups de pinceaux abrupts. La forme interpelle d'abord. Ce poème est écrit en strophes inégales et sans grande logique, alternativement descriptives (la rue)et introspectives (ses interrogations sur lui-même et sur le monde)en insistant toutefois sur ces dernières, sans beaucoup d'action, avec cependant des remarques de nature philosophique mais aussi inattendues, comme l'allusion au chocolat qu'une improbable petite fille est invitée à manger. L'auteur nous indique qu'il préfère cette friandise à la métaphysique! Cela laisse une curieuse impression de phrases juxtaposées et parfois contradictoires, comme nées d'une écriture automatique.
Il semble que nous ayons affaire à quelqu'un de désespéré qui s'approche de sa fenêtre avec le sentiment diffus qu'il ne verra pas la fin de la journée. Nous n'avons pas de renseignements précis sur lui ni sur l'étage où se trouve cette ouverture, mais, j'ai l'impression qu'elle est au moins au premier, en ce sens qu'elle semble ouvrir sur un vide attirant. Cette impression suicidaire est corroborée par les idées fugitives qui sont couchées sur le papier, comme s'il était urgent de les exprimer au fur et à mesure qu'elles lui viennent. Tout commence par une sorte d'aphorisme [« Je ne suis rien »] qui évoque un sentiment d'impuissance, tout aussitôt suivi de son contraire[« Je ne peux vouloir être rien »], puis viennent pêle-mêle des remarques sur le monde auquel il appartient et qu'il va sans doute quitter. Il fait allusion à la mort, au destin, au temps qui passe, se dit lucide, perplexe, se déclare « raté » parce que le hasard ne lui a pas été favorable et il remâche ses échecs, que ceux-ci soient de sa faute [« Je jette tout par terre comme j'ai jeté ma vie – J'ai fait de moi ce que je ne pensais pas et ce que je pouvais faire de moi, je ne l'ai pas fait - J'ai enjambé la formation qu'on m'a donnée par la fenêtre de derrière »] ou simplement de celle du hasard [« Le domino que j'ai mis n'était pas le bon », pour aussitôt se demander s'il n'est pas au contraire un génie méconnu[« Génie? En ce moment, cent mille cerveaux se prennent en rêve, comme moi, pour des génies »], ce qui engendre une interrogation sur lui-même[« Que sais-je ce que je serai, moi qui ne sais qui je suis? »], une sorte d'auto-suffisance de celui qui a toujours été incompris et qui dénonce le côté dérisoire de cette vie [« Toujours une chose aussi inutile que l'autre, toujours l'impossible en face du réel »]. Il se sent en ce monde « comme en exil», « comme un chien toléré par la direction parce qu'il est inoffenssif » avec la mort « qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes » et dont on ne sait, en cet instant, s'il la souhaite ou s'il la redoute.
Son désarroi est grand qu'il exprime par des mots forts [« Mon coeur est un seau vide »]. Cet homme est un adulte et nous imaginons qu'enfant il avait déjà tissé des projets d'avenir qui ne sont maintenant plus que des souvenirs inconsistants [« Je porte en moi tous les rêves du monde »] Il a vu dans la vie une extraordinaire occasion de faire bouger les choses, de faire changer ce vieux monde, d'y laisser sa marque, mais ses rêves se sont révélés être des chimères. [« Combien d'aspirations hautes, nobles et lucides... ne verrons jamais la lumière du vrai soleil »] . En cela il est le reflet de la condition humaine. C'est un simple humain assujetti à la fuite du temps, à la vieillesse, à la mort, au destin « qui mène la carriole de tout sur la route de rien ». Pour lui cette prise de conscience génère un malaise [« Foulant aux pieds la conscience de se sentir exister, comme un tapis où trébuche un ivrogne »], un doute [« Non, je ne crois pas en moi » - « Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais qui je suis »] et rien d'autre ne pourra l'en guérir, ni les religions [Dieu?] ni même l'écriture et surtout pas la métaphysique qui « n'est que le résultat d'une indisposition ».
C'est un être tourmenté, facette hétéronyme de Pessoa, à la fois conscient de son inexistence et porteur d'ambitions qu'il n'atteindra jamais, un paradoxe apparent. Il le sait et le déplore, le regrette aussi parce qu'on ne peut se satisfaire d'une telle image de soi-même, coincé entre réalité et rêve. C'est aussi un idéaliste qui fait prévaloir l'écriture et attend vainement le succès, la notoriété peut-être [« Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvrît la porte, au pied d'un mur sans porte qui chantait la chanson de l'Infini dans un poulailler »]. Il me semble qu'il entretient avec son écriture une relation à la fois salvatrice et malsaine en ce sens qu'il vit par elle et pour elle, mais la légitime notoriété qu'il en attendait n'a jamais été au rendez-vous où peut-être ressent-il une impossibilité de s'exprimer complètement? Dès lors, il en parle comme d'un « portail en ruines sur l'impossible » et allume une cigarette au lieu de prendre la plume, comme si, en cet instant, sa fumée, bleue et légère, valait mieux que tout!
Il s'interroge sur l'inutilité de ce qu'il a écrit mais pense sérieusement à recommencer, fait allusion aux femmes qui consolent du mal de vivre pour revenir au spectacle de la rue, véritable toile de fond dynamique de cette évocation, au patron du tabac d'en face, à un client, à une cigarette qu'il allume, à la fille de la blanchisseuse qu'il pourrait épouser et ainsi être heureux. Ce client c'est « Estève-n'a-pas-de-métaphysique », et à qui tout son univers est étranger, il le connaît, le salue, c'est comme si la vie reprenait le dessus avec son quotidien, comme si la seule vue de cet homme suffisait à lui rendre l'envie de vivre.
C'est le texte d'un désespéré que le spectacle simple du réel, la rue, la boutique du buraliste d'en face, le patron avec son cou endolori, le client qui est simplement venu acheter du tabac, fait reprendre temporairement goût à la vie. A tout le moins a-t-il décidé lui-même de lui donner une dernière chance, même s'il avoue que ce monde lui et étranger, qu'il n'a rien à y faire. « L'univers s'est refermé sur moi sans idéal et sans espoir et le patron du Tabac a souri. »
© Hervé GAUTIER - juillet 2007.
Lien : http://hervegautier.e-monsit..
L'étrangeté de vivre rend perplexe, semble dire Alvaro de Campos dans Bureau de tabac. Dans ce poème, il accumule les négations, les négations de négations. Il soumet l'existence au rayons X des pensées, emboitées les unes dans les autres comme des poupées russes. Examinons ces pensées à la loupe, au microscope, jusqu'à leur disparition complète. Vous avez dit dérisoire ?
"Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde".
"J'ai tout raté. Comme je n'avais aucune ambition, peut-être que ce tout n'était rien".
"J'ai vécu, j'ai étudié, j'ai aimé, et j'ai même cru,
Et maintenant j'envie chaque mendiant pour la seule raison qu'il n'est pas moi (...)
Peut-être n'as tu existé que comme un lézard auquel on a coupé la queue,
Et finalement c'est la queue du lézard qui continue d'exister, et de façon fort agitée !"
Alvaro semble déboussolé. Il a tout manqué, a horreur de lui-même, s'autoflagelle. Intoxiqué de négativité, il oscille entre scepticisme et sentimentalité.
"Mange tes chocolats, fillette, mange donc tes chocolats !
Écoute, à part le chocolat, il n'y a pas de métaphysique au monde.
Écoute, toutes les religions n'enseignent rien de mieux que la confiserie.
Mange, petite cochonne, mange !
Ah ! Si seulement j'étais capable de manger des chocolats avec ton naturel !"
Alvaro de Campos jouit de voir ses pensées s'évaporer comme fumées de cigarettes. Il porte tant de masques que certains collent à son visage. le torticolis de son âme perçoit tout de travers. Métaphysique du chocolat ou de l'absurde ? Salut, Alvaro !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Fernando Pessoa (92)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1228 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1228 lecteurs ont répondu