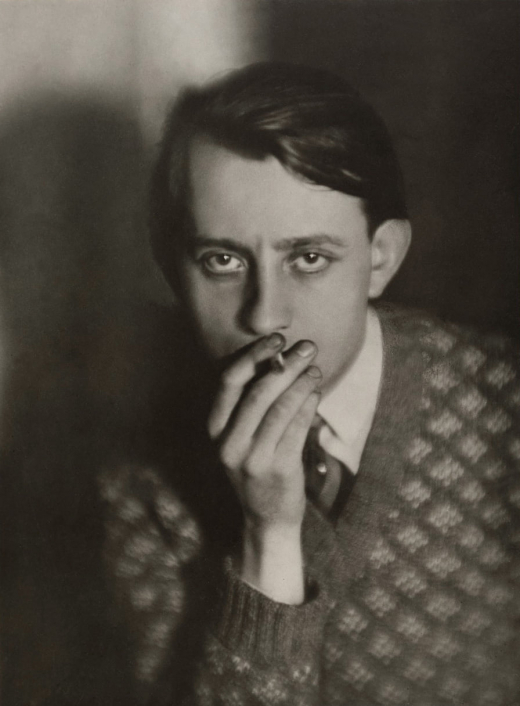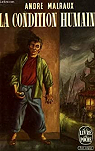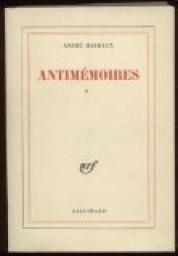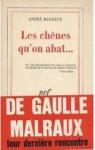Critiques de André Malraux (275)
Classique de la littérature française du XXe siècle ce livre était depuis trop longtemps dans ma bibliothèque. J'en ai profité pour le lire, enfin ... Globalement, ça peut paraître un peu daté, mais c'est plaisant tout de même d'être transporté dans la Chine des années 1920 avec les luttes entre les communistes et les partisans du Kuomintang. Le livre propose surtout - en lien avec le titre - une réflexion sur l'engagement, les choix que nous faisons, le bien et le mal, la mort et la vie etc ...
Ce livre me laisse un sentiment mitigé. Il est indéniablement très bien écrit. Mais cependant, il me laisse assez froid. C'est à cause de plusieurs éléments. D'une part, la multiplication des personnages, sans lien apparent entre eux. Cela rend très dur le passage des chapitres. Le point de vue, très extérieur, n'aide pas non plus. Enfin, les discussions parfois très didactiques, où l'auteur veut opposer des idées et des façons d'être plutôt que de dérouler le fil narratif, contribuent à éloigner le lecteur. L'absence de femmes, de passion d'amour, enfin, qui a été noté par beaucoup bien qu'elle puisse aider à concentrer le propos, le refroidissent également beaucoup. Ce que je note là n'est pas un défaut, c'est la contrepartie des immenses qualités que recèle le livre, qui par cette distance qu'il instaure, nous éclaire, certes de plus loin, mais avec plus de précision aussi, sur les motivations des hommes, sur les changements qu'elle génère en eux, sur l'idéal, sur la mort. Je n'ai pas été déçu d'avoir vaincu ma réticence initiale.
La Condition humaine
André Malraux / Prix Goncourt 1933
Une œuvre majeure du XXe siècle.
« Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait l’estomac …fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu’une ombre… »
Nous sommes le 21 mars 1927 à minuit trente, en pleine scène de crime, dans une chambre d’hôtel de Shangaï, une ville en état de siège, la plus grande ville de Chine. Son acte commis, poignarder un trafiquant d’armes, Tchen, activiste communiste, rejoint Kyo son camarade qui depuis plus d’un mois prépare l’insurrection. Il n’a pas oublié le document récupéré sur le mort, trafiquant d’armes, et qui permettra de s’approprier une cargaison d’armes d’un bateau ancré dans le port, armes qui manquent cruellement aux insurgés. Pour réaliser cette opération, Tchen et Kyo vont bénéficier de la complicité du baron de Clappique, un personnage trouble et multiface.
Après l’échec des émeutes de février, le comité central du parti communiste chinois a chargé Kyo de la coordination des forces insurrectionnelles. Le groupe de révolutionnaires communistes qui prépare le soulèvement de la ville comporte comme organisateurs outre Tchen et son maître à penser Gisors le père de Kyo, Kyo lui-même et un certain Katow, russe dévoué par idéalisme à la cause communiste chinoise, ancien militant de la révolution de 1917.
Tchen se confie à Gisors et lui avoue sa fascination pour le sang et la mort : il se sent l’âme d’un terroriste. Il n’aspire à aucune gloire, à aucun bonheur. Il sait qu’il n’est pas de ceux dont s’occupe le bonheur. Il est capable de vaincre mais non de vivre dans la victoire. Il n’attend que la mort. Et il veut lui donner le sens que d’autres donnent à la vie. La souffrance du monde, il aime mieux la diminuer que d’en rendre compte. Il n’aime pas une humanité qui est faite de la contemplation de la souffrance. Mourir le plus haut possible, telle est son ambition, mais assez lucide pour mépriser même les objets de son ambition et son ambition même. Ses idées jusque-là l’avaient fait vivre, maintenant elles pouvaient le tuer.
Les armes sont distribuées à travers toute la ville aux combattants clandestins sous la surveillance de Kyo.
Le 22 mars commence l’insurrection. On peut voir aussi des manifestants porter des banderoles : « Plus que douze heures de travail par jour », « Plus de travail des enfants au-dessous de huit ans », « droit de s’asseoir pour les ouvrières ». Les troupes de Tchang Kaï Chek sont attendues en renfort. Ferral, le président de la chambre de commerce française persuade les milieux d’affaires de soutenir Tchang Kaï Chek. Ses intérêts commerciaux avant tout !
Alors que la situation est très favorable aux insurgés, Tchang Kaï Chek s’oppose aux révolutionnaires, pactise avec les forces modérées et exige que les insurgés rendent les armes. Kyo alors décide de se rendre à Han Kéou, le siège du Komintern (Internationale communiste) afin de rencontrer le délégué Vologuine pour savoir s’ils peuvent garder les armes. Vologuine est partisan de jouer le temps. Tchen arrive à Han Kéou à son tour et confirme que pour lui la seule solution est d’assassiner Tchang Kaï Chek, et il tient à le faire lui-même, car pour lui ce serait l’extase avec sa propre mort en point d’orgue. L’Internationale est dubitative, et Kyo et Tchen ne sont pas du même avis.
Le 11 avril l’insurrection bat son plein. Tchen aidé de deux complices échoue dans son premier attentat contre Tchang Kaï Chek. Il prépare un second attentat en décidant de se jeter avec sa bombe sur la voiture de Tchang Kaï Chek. La chance n’est pas avec lui ce jour-là et pour jamais.
Puis Kyo et May sont arrêtés et Kyo jeté en prison. Hemmelrich, communiste belge activiste voit sa famille assassinée. Avec Katow il décide de se venger contre Tchang Kaï Chek. Gisors tentera alors de sauver son fils avec l’aide de Clappique. Les prisonniers torturés sont ensuite brûlés vifs dans la chaudière d’une locomotive. Kyo se suicide au cyanure et Katow marche en héros au supplice avec courage en offrant sa dose de cyanure à deux jeunes chinois. Clappique parvient à s’échapper grâce à un subterfuge. Un chapitre bouleversant de ce roman ou le tragique le dispute au grandiose.
La fin du livre se termine à Paris où Ferral ne peut sauver le consortium français en Chine, et à Kobé où May retrouve Gisors et sa pipe à opium et la méditation.
Voilà résumés brièvement les temps forts de l’histoire.
La Condition Humaine est un roman qui montre qu’outre l’irréductible échéance liée à la mort avec ses multiples et souvent indicibles souffrances il est donné à chacun de choisir son destin. La vie est une tragédie, reste à lui donner un sens. La Révolution au nom d’une foi en la fraternité en est un. C’est ce que les héros de la Condition Humaine ont choisi pour échapper à l’angoisse de n’être qu’un homme. L’amour aussi est présent dans ce livre pour adoucir cette condition et la solitude. Misère et héroïsme se conjuguent tout au long des chapitres de ce roman grandiose et d’une intelligence rare. De la dernière partie émane un parfum d’insoutenable.
Les héros de ce roman ont choisi pour combat de vaincre l’humiliation par le biais de la Révolution. Pour vaincre l’angoisse et l’absurdité existentielles, certains ont choisi l’amour, mais pas n’importe quel amour, un amour fusionnel et total, celui qu’éprouvent Kyo et May l’un pour l’autre et qui est susceptible de briser la profonde solitude des êtres. D’autres ont choisi de s’engager dans l’Histoire et d’agir pour influer sur le courant de leur destinée. Ce roman met en lumière la misère humaine, celle d’une humanité qui peut être héroïque et grandiose malgré l’irréductible et absurde échéance liée à la mort et les indicibles souffrances de la vie. Telle est la Condition humaine qui permet de choisir son destin à qui le veut. La vie peut être jugée tragique, mais il faut lui donner un sens. Ainsi la Révolution au nom d’une foi en la fraternité est une arme contre la misère qui enchaîne l‘homme et le prive de dignité. L’homme peut lutter contre sa condition. Ce roman est considéré comme le précurseur de la mouvance existentialiste dont Sartre et Camus seront les grandes figures.
Pour bien comprendre le roman, il faut retenir que le Kuomintang fut fondé en 1912 par SunYat Sen et domina le gouvernement central de la république de Chine à partir de 1928, jusqu’à la prise de pouvoir par les communistes en 1949. Dans le roman, en mars 1927, l’armée révolutionnaire du Kuomintang sous le commandement de Tchang Kaï Chek, marche vers Shangaï pour conquérir la ville où sur place les communistes préparent le terrain en soulevant le peuple. Cependant, Tchang Kaï Chek se méfie des communistes qui ont de plus en plus d’influence et décide de les trahir. Avec l’aide de l’Occident, il fait assassiner des milliers d’ouvriers et de dirigeants communistes le 12 avril 1927.
La technique d’écriture de Malraux est très particulière et d’aucuns l’ont comparée à des techniques cinématographiques en juxtaposant différents plans de façon discontinue, ce qui induit un style parfois heurté et haché, épuré et concis, le lecteur devant faire l’effort de reconstituer la réalité pour accéder à une lecture à plusieurs niveaux. Ipso facto la lecture n’est pas toujours aisée et une concentration certaine est requise. Toutefois un moment de stupeur passé, le lecteur vibre au fil des pages grâce à un style efficace et limpide et une analyse psychologique des personnages remarquable, qui eux-mêmes se questionnent constamment. Une bonne connaissance de l’histoire de la Chine après 1917 c’est à dire de la période de Sun Yat Sen et Tchang Kaï Chek, est requise pour bien comprendre tous les ressorts de cette Révolution qui se cherche.
Un roman majeur, fort, non engagé sur le plan politique, publié en 1933, classé en 5e position des 100 meilleurs livres du XXe siècle. Je l’avais lu à l’âge de 18 ans c’est à dire il y a 60 ans. Je n’en avais pas saisi toute la puissance, l’intelligence et l’humanité. Je pense que c’est à présent fait.
André Malraux / Prix Goncourt 1933
Une œuvre majeure du XXe siècle.
« Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait l’estomac …fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu’une ombre… »
Nous sommes le 21 mars 1927 à minuit trente, en pleine scène de crime, dans une chambre d’hôtel de Shangaï, une ville en état de siège, la plus grande ville de Chine. Son acte commis, poignarder un trafiquant d’armes, Tchen, activiste communiste, rejoint Kyo son camarade qui depuis plus d’un mois prépare l’insurrection. Il n’a pas oublié le document récupéré sur le mort, trafiquant d’armes, et qui permettra de s’approprier une cargaison d’armes d’un bateau ancré dans le port, armes qui manquent cruellement aux insurgés. Pour réaliser cette opération, Tchen et Kyo vont bénéficier de la complicité du baron de Clappique, un personnage trouble et multiface.
Après l’échec des émeutes de février, le comité central du parti communiste chinois a chargé Kyo de la coordination des forces insurrectionnelles. Le groupe de révolutionnaires communistes qui prépare le soulèvement de la ville comporte comme organisateurs outre Tchen et son maître à penser Gisors le père de Kyo, Kyo lui-même et un certain Katow, russe dévoué par idéalisme à la cause communiste chinoise, ancien militant de la révolution de 1917.
Tchen se confie à Gisors et lui avoue sa fascination pour le sang et la mort : il se sent l’âme d’un terroriste. Il n’aspire à aucune gloire, à aucun bonheur. Il sait qu’il n’est pas de ceux dont s’occupe le bonheur. Il est capable de vaincre mais non de vivre dans la victoire. Il n’attend que la mort. Et il veut lui donner le sens que d’autres donnent à la vie. La souffrance du monde, il aime mieux la diminuer que d’en rendre compte. Il n’aime pas une humanité qui est faite de la contemplation de la souffrance. Mourir le plus haut possible, telle est son ambition, mais assez lucide pour mépriser même les objets de son ambition et son ambition même. Ses idées jusque-là l’avaient fait vivre, maintenant elles pouvaient le tuer.
Les armes sont distribuées à travers toute la ville aux combattants clandestins sous la surveillance de Kyo.
Le 22 mars commence l’insurrection. On peut voir aussi des manifestants porter des banderoles : « Plus que douze heures de travail par jour », « Plus de travail des enfants au-dessous de huit ans », « droit de s’asseoir pour les ouvrières ». Les troupes de Tchang Kaï Chek sont attendues en renfort. Ferral, le président de la chambre de commerce française persuade les milieux d’affaires de soutenir Tchang Kaï Chek. Ses intérêts commerciaux avant tout !
Alors que la situation est très favorable aux insurgés, Tchang Kaï Chek s’oppose aux révolutionnaires, pactise avec les forces modérées et exige que les insurgés rendent les armes. Kyo alors décide de se rendre à Han Kéou, le siège du Komintern (Internationale communiste) afin de rencontrer le délégué Vologuine pour savoir s’ils peuvent garder les armes. Vologuine est partisan de jouer le temps. Tchen arrive à Han Kéou à son tour et confirme que pour lui la seule solution est d’assassiner Tchang Kaï Chek, et il tient à le faire lui-même, car pour lui ce serait l’extase avec sa propre mort en point d’orgue. L’Internationale est dubitative, et Kyo et Tchen ne sont pas du même avis.
Le 11 avril l’insurrection bat son plein. Tchen aidé de deux complices échoue dans son premier attentat contre Tchang Kaï Chek. Il prépare un second attentat en décidant de se jeter avec sa bombe sur la voiture de Tchang Kaï Chek. La chance n’est pas avec lui ce jour-là et pour jamais.
Puis Kyo et May sont arrêtés et Kyo jeté en prison. Hemmelrich, communiste belge activiste voit sa famille assassinée. Avec Katow il décide de se venger contre Tchang Kaï Chek. Gisors tentera alors de sauver son fils avec l’aide de Clappique. Les prisonniers torturés sont ensuite brûlés vifs dans la chaudière d’une locomotive. Kyo se suicide au cyanure et Katow marche en héros au supplice avec courage en offrant sa dose de cyanure à deux jeunes chinois. Clappique parvient à s’échapper grâce à un subterfuge. Un chapitre bouleversant de ce roman ou le tragique le dispute au grandiose.
La fin du livre se termine à Paris où Ferral ne peut sauver le consortium français en Chine, et à Kobé où May retrouve Gisors et sa pipe à opium et la méditation.
Voilà résumés brièvement les temps forts de l’histoire.
La Condition Humaine est un roman qui montre qu’outre l’irréductible échéance liée à la mort avec ses multiples et souvent indicibles souffrances il est donné à chacun de choisir son destin. La vie est une tragédie, reste à lui donner un sens. La Révolution au nom d’une foi en la fraternité en est un. C’est ce que les héros de la Condition Humaine ont choisi pour échapper à l’angoisse de n’être qu’un homme. L’amour aussi est présent dans ce livre pour adoucir cette condition et la solitude. Misère et héroïsme se conjuguent tout au long des chapitres de ce roman grandiose et d’une intelligence rare. De la dernière partie émane un parfum d’insoutenable.
Les héros de ce roman ont choisi pour combat de vaincre l’humiliation par le biais de la Révolution. Pour vaincre l’angoisse et l’absurdité existentielles, certains ont choisi l’amour, mais pas n’importe quel amour, un amour fusionnel et total, celui qu’éprouvent Kyo et May l’un pour l’autre et qui est susceptible de briser la profonde solitude des êtres. D’autres ont choisi de s’engager dans l’Histoire et d’agir pour influer sur le courant de leur destinée. Ce roman met en lumière la misère humaine, celle d’une humanité qui peut être héroïque et grandiose malgré l’irréductible et absurde échéance liée à la mort et les indicibles souffrances de la vie. Telle est la Condition humaine qui permet de choisir son destin à qui le veut. La vie peut être jugée tragique, mais il faut lui donner un sens. Ainsi la Révolution au nom d’une foi en la fraternité est une arme contre la misère qui enchaîne l‘homme et le prive de dignité. L’homme peut lutter contre sa condition. Ce roman est considéré comme le précurseur de la mouvance existentialiste dont Sartre et Camus seront les grandes figures.
Pour bien comprendre le roman, il faut retenir que le Kuomintang fut fondé en 1912 par SunYat Sen et domina le gouvernement central de la république de Chine à partir de 1928, jusqu’à la prise de pouvoir par les communistes en 1949. Dans le roman, en mars 1927, l’armée révolutionnaire du Kuomintang sous le commandement de Tchang Kaï Chek, marche vers Shangaï pour conquérir la ville où sur place les communistes préparent le terrain en soulevant le peuple. Cependant, Tchang Kaï Chek se méfie des communistes qui ont de plus en plus d’influence et décide de les trahir. Avec l’aide de l’Occident, il fait assassiner des milliers d’ouvriers et de dirigeants communistes le 12 avril 1927.
La technique d’écriture de Malraux est très particulière et d’aucuns l’ont comparée à des techniques cinématographiques en juxtaposant différents plans de façon discontinue, ce qui induit un style parfois heurté et haché, épuré et concis, le lecteur devant faire l’effort de reconstituer la réalité pour accéder à une lecture à plusieurs niveaux. Ipso facto la lecture n’est pas toujours aisée et une concentration certaine est requise. Toutefois un moment de stupeur passé, le lecteur vibre au fil des pages grâce à un style efficace et limpide et une analyse psychologique des personnages remarquable, qui eux-mêmes se questionnent constamment. Une bonne connaissance de l’histoire de la Chine après 1917 c’est à dire de la période de Sun Yat Sen et Tchang Kaï Chek, est requise pour bien comprendre tous les ressorts de cette Révolution qui se cherche.
Un roman majeur, fort, non engagé sur le plan politique, publié en 1933, classé en 5e position des 100 meilleurs livres du XXe siècle. Je l’avais lu à l’âge de 18 ans c’est à dire il y a 60 ans. Je n’en avais pas saisi toute la puissance, l’intelligence et l’humanité. Je pense que c’est à présent fait.
Première critique de livre sur Babelio, quelle angoisse! Je ne pensais pas faire un jour parti de l'excellent collège de critiques Babeliens. Et pourtant je me suis souvent imaginé me risquant à l'exercice, posant un commentaire élogieux sur une oeuvre qui m'aurait marqué. Finalement et sans que je ne puisse l'expliquer, c'est par une oeuvre qui m'aura fait souffrir que je commence.
Un ami fan inconditionnel de l'auteur après de nombreuses tentatives m'avait finalement convaincu d'entamer cette lecture. Je m'y plongeais donc avec plaisir de découvrir cet auteur qui fut objet de nombres de nos discussions. Malheureusement, j'ai assez vite étant décontenancé, d'abord par le cadre spatio-temporel que je ne maîtrisais pas du tout, mais également par le nombre de personnages aux noms confusants et pour lesquels je n'ai su trouver de réels repères me permettant de les différencier. Ce roman, je l'ai donc parcouru, parfois même survolé, avec un manque certain d'identification et donc de projection dans sa narration. Certaines critiques l'ont déjà evoqué avant moi, j'ai eu la sensation de passer à côté de ce monument de la littérature.
Toutefois, je note quand même que des thèmes intemporels y sont abordés, parfois avec brio, comme la relation face à la mort, la croyance, la dévotion et la recherche de soi. Certains dialogues glaciaux touchent du doigt ces questions universelles et confèrent au roman son titre de chef d'oeuvre. Une lecture que je recommencerai vraisemblablement dans quelques années.
Un ami fan inconditionnel de l'auteur après de nombreuses tentatives m'avait finalement convaincu d'entamer cette lecture. Je m'y plongeais donc avec plaisir de découvrir cet auteur qui fut objet de nombres de nos discussions. Malheureusement, j'ai assez vite étant décontenancé, d'abord par le cadre spatio-temporel que je ne maîtrisais pas du tout, mais également par le nombre de personnages aux noms confusants et pour lesquels je n'ai su trouver de réels repères me permettant de les différencier. Ce roman, je l'ai donc parcouru, parfois même survolé, avec un manque certain d'identification et donc de projection dans sa narration. Certaines critiques l'ont déjà evoqué avant moi, j'ai eu la sensation de passer à côté de ce monument de la littérature.
Toutefois, je note quand même que des thèmes intemporels y sont abordés, parfois avec brio, comme la relation face à la mort, la croyance, la dévotion et la recherche de soi. Certains dialogues glaciaux touchent du doigt ces questions universelles et confèrent au roman son titre de chef d'oeuvre. Une lecture que je recommencerai vraisemblablement dans quelques années.
1er livre de Malraux que je commence à lire. Cela commence plutôt bien, l'écriture précise des perceptions, sensations et pensées d'un tueur s'apprêtant à assassiner. Je me remémore Crime et Châtiment.. Mais ensuite on est davantage dans un roman politico-espionnage, une sorte de version plus complexe, élaborée, recherchée de Shangaï Express (collection S.A.S..), avec un style parfois proche d'un scenario et des descriptions un peu cinématographiques.
Pour y comprendre quelque chose il faut avoir une sacrée connaissance de l'insurrection de Shangaï de 1924, épisode déjà complexe en lui-même..
J'arrive au dialogue entre l'un des personnages semble-t-il principal et sa femme (ou épouse ou compagne..) qui lui dit qu'elle vient de coucher avec un autre.. et là je me dis que ces dialogues sont confus et sans intérêt (Hemingway a fait mieux il me semble dans l'Adieu aux Armes ou Pour qui sonne le glas , lus il y a fort longtemps..), alors j'abandonne car le roman fait plus de 400 pages et je n'en suis qu'à la 63ième... Je ne veux pas m'infliger une lecture que je ne vais sans doute pas apprécier. La vie est trop courte pour cela et le bonhomme Malraux (avec son épouse) de cette époque-là, "aventurier" comme on dit, c'est-à-dire pilleur (il a découpé à la scie des bas-reliefs.. ), trafiquant d'oeuvres asiatiques (et condamné pour cela mais il réussira à avoir sa peine bien diminuée), menteur, intriguant pour cheminer dans le monde parisien de l'édition, vendeurs de faux tableaux, c'est-à-dire escroc, , bref une sorte de voyou chic etc.. ne m'est pas du tout sympathique (je sais : chacun se débrouille comme il peut). Même si ses engagements dans les années 30 semblent plus nobles et que l'homme d'après-guerre avait un côté fascinant, son passé des années 20 pour moi ne passe pas. J'essayerai quand même je pense de commencer l'espoir et même peut-être la Voie Royale par curiosité et pour me donner une chance d'évoluer dans mon jugement.
La 1ére fois j'avais abandonné dès la page 63 mais la lecture d'avis positifs mentionnant notamment une fin littérairement réussie j'ai repris mon courage, le livre à deux mains et la lecture. Le récit des 1ères heures de cette insurrection est beaucoup plus facile à suivre mais ce qui se passe est très confus faute d'avoir bien identifier les personnages et bientôt (p.141) revient une scène de pensées d'un homme vis-à-vis d'une femme et je n'en peux plus de ce blablabla incompréhensible, sans intérêt, sentencieux, se donnant des airs mais vides. En plus la suite redevient totalement confuse. Cette fois je laisse tomber à la page 166.
Pour y comprendre quelque chose il faut avoir une sacrée connaissance de l'insurrection de Shangaï de 1924, épisode déjà complexe en lui-même..
J'arrive au dialogue entre l'un des personnages semble-t-il principal et sa femme (ou épouse ou compagne..) qui lui dit qu'elle vient de coucher avec un autre.. et là je me dis que ces dialogues sont confus et sans intérêt (Hemingway a fait mieux il me semble dans l'Adieu aux Armes ou Pour qui sonne le glas , lus il y a fort longtemps..), alors j'abandonne car le roman fait plus de 400 pages et je n'en suis qu'à la 63ième... Je ne veux pas m'infliger une lecture que je ne vais sans doute pas apprécier. La vie est trop courte pour cela et le bonhomme Malraux (avec son épouse) de cette époque-là, "aventurier" comme on dit, c'est-à-dire pilleur (il a découpé à la scie des bas-reliefs.. ), trafiquant d'oeuvres asiatiques (et condamné pour cela mais il réussira à avoir sa peine bien diminuée), menteur, intriguant pour cheminer dans le monde parisien de l'édition, vendeurs de faux tableaux, c'est-à-dire escroc, , bref une sorte de voyou chic etc.. ne m'est pas du tout sympathique (je sais : chacun se débrouille comme il peut). Même si ses engagements dans les années 30 semblent plus nobles et que l'homme d'après-guerre avait un côté fascinant, son passé des années 20 pour moi ne passe pas. J'essayerai quand même je pense de commencer l'espoir et même peut-être la Voie Royale par curiosité et pour me donner une chance d'évoluer dans mon jugement.
La 1ére fois j'avais abandonné dès la page 63 mais la lecture d'avis positifs mentionnant notamment une fin littérairement réussie j'ai repris mon courage, le livre à deux mains et la lecture. Le récit des 1ères heures de cette insurrection est beaucoup plus facile à suivre mais ce qui se passe est très confus faute d'avoir bien identifier les personnages et bientôt (p.141) revient une scène de pensées d'un homme vis-à-vis d'une femme et je n'en peux plus de ce blablabla incompréhensible, sans intérêt, sentencieux, se donnant des airs mais vides. En plus la suite redevient totalement confuse. Cette fois je laisse tomber à la page 166.
Très bob livre dont j'ai retenu qu'en politique, il faut parfois savoir être cruel et oser assassiner un opposant lorsque celui-ci représente un obstacle à la réalisation de ses idéaux de liberté et de justice.
Je crois me rappeler que le livre commence par l'assassinat de cet homme d'affaire très riche, très décadent et très corrompu.
Le personnage principal apprend ainsi que pour réussir un assassinat, il faut planter le couteau près du coeur est remonter.
Ce passage m'avait marqué et j'ai compris que résister peut parfois vouloir dire : devenir cruel !
Je crois me rappeler que le livre commence par l'assassinat de cet homme d'affaire très riche, très décadent et très corrompu.
Le personnage principal apprend ainsi que pour réussir un assassinat, il faut planter le couteau près du coeur est remonter.
Ce passage m'avait marqué et j'ai compris que résister peut parfois vouloir dire : devenir cruel !
L'ouvrage de Malraux ne dure que cent-soixante pages, mais il a nécessité une lecture longue et attentive de ma part.
Le choc des cultures peut-être courtois, mais il n'en apparaît pas moins profond et violent en ce premier quart angoissé du vingtième siècle!
La Chine n'est plus une forteresse fermée, devenue perméable à cette culture de l'Europe amenée de l'ouest.
Malraux, dans ce livre-dialogue épistolaire, se montre prémonitoire devant cette Chine qui mute... Comme si une sorte de "mal" insidieux et inexorable s'emparait de la Chine.
À l'aune de l'actualité du vingt-et unième siècle, lire ou relire cette Tentation n'est pas sans intérêt, donc.
Le choc des cultures peut-être courtois, mais il n'en apparaît pas moins profond et violent en ce premier quart angoissé du vingtième siècle!
La Chine n'est plus une forteresse fermée, devenue perméable à cette culture de l'Europe amenée de l'ouest.
Malraux, dans ce livre-dialogue épistolaire, se montre prémonitoire devant cette Chine qui mute... Comme si une sorte de "mal" insidieux et inexorable s'emparait de la Chine.
À l'aune de l'actualité du vingt-et unième siècle, lire ou relire cette Tentation n'est pas sans intérêt, donc.
Pour moi cela a été une vraie révélation il y a 30 ans et à nouveau...Malraux décrit la psychologie complexe d'une série de personnages enchevêtrés dans leur propres idéaux, principes, vices et vertus. La culpabilité, l'amour ou son absence buttent aussi avec la Grande Histoire, l'opium et les marchands d'art s'invitant à la première révolution chinoise manquée. Que vaut la vie? Il manque un peu de personnages féminins dans cette vie d'aventuriers, seulement 2.
"Les voix du silence" est une histoire nietzschéenne de l'art mondial depuis les tableaux des cavernes d'Altamira réalisés il y 36,000 ans jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle. Il est depuis plus que soixante-dix ans un des livres incontournables dans le domaine. Il gardera ce statut tant et aussi longtemps que l'on considère Nietzsche comme un philosophe important. Les dieux (chrétiens, bouddhique, et autres) sont morts. L'art est l'absolu qui dirige les artistes .
La tradition artistique est une suite de surpassements nietzschéens où chaque génération d'artistes fait une révolution contre la précédente: "Magiques, cosmiques, sacrées, religieuses les grandes œuvres nous atteignent du fond du passé comme autant de Zarathoustras inventés par autant de Nietzsches." (p. 617)
D'autres facteurs vont contribuer à la longévité des "Voix de silence." Il réussit brillamment à intégrer les arts asiatiques, africaines, polynésiens et européens dans une seule tradition. Son style est superbe et Malraux possède un don remarquable pour l'aphorisme.
Pour moi, la plus grande force du livre c'est l'emploi que fait Malraux de 636 photographies en noir-et-blancs qui sont présents dans le volume. (On y trouve aussi 15 photographies orphelines en couleur qui ne contribuent rien.) Les photographies en noir-et-blanc sont placées sur les pages avec texte très près des places ou Malraux les discutent. Je n'ai jamais vu un autre livre d'art ou les photographies appuient aussi bien ce que l'auteur écrit. Malraux prend grand avantage du profondeur de champ supéreir de la photographie en noir-et-blanc. Aussi, il exploite très bien sa capacité de mieux présenter la forme et la composition deux éléments qui se s'estompent dans les photos en couleurs. Parce que "Les voix de silence" plait, on accepte plus facilement ses thèses nietzschéennes.
Malraux propose deux grand concepts: (1) celui du musée imaginaire et (2) celui des métamorphoses.
Le musée imaginaire est l'ensemble de toutes les œuvres d'art de toutes les provenances qui exerce une influence sur l'artiste et qui le met en face avec un statut quo contre lequel il va se révolter. D'après Malraux l'artiste vit dans un contexte historique et une tradition culturelle qui le nourrissent. L'artiste va essayer de surpasser son contexte en créant son propre style.
Les métamorphoses sont les avatars des composants artistiques ou éléments stylistique. Dans la deuxième partie du livre qui s' intitule "Les métamorphoses d'Apollon" Malraux nous montre comment Apollon de l'art hellénique est devenu le Christ Pantocrator de l'église chrétienne orthodoxe et plus tard le Bouddha de la tradition de Gandhara en Inde. Malraux cite les influences sur l'art francais des estampes japonaises au XIXe siècle et des masques africains au XXe siècle comme phénomènes similaires.
Pour Malraux tout va pour le mieux dans le meilleurs de monde. L'histoire de l'art continue et c'est la seule chose qui compte. Je suis plutôt de l'avis que Dieu vit toujours et que c'est Nietzsche qui est mort. Néanmoins Malraux présente avec brio les idées Nietzschéennes et il est impossible de ne pas aimer Malraux pour son enthousiasme pour les arts plastiques.
La tradition artistique est une suite de surpassements nietzschéens où chaque génération d'artistes fait une révolution contre la précédente: "Magiques, cosmiques, sacrées, religieuses les grandes œuvres nous atteignent du fond du passé comme autant de Zarathoustras inventés par autant de Nietzsches." (p. 617)
D'autres facteurs vont contribuer à la longévité des "Voix de silence." Il réussit brillamment à intégrer les arts asiatiques, africaines, polynésiens et européens dans une seule tradition. Son style est superbe et Malraux possède un don remarquable pour l'aphorisme.
Pour moi, la plus grande force du livre c'est l'emploi que fait Malraux de 636 photographies en noir-et-blancs qui sont présents dans le volume. (On y trouve aussi 15 photographies orphelines en couleur qui ne contribuent rien.) Les photographies en noir-et-blanc sont placées sur les pages avec texte très près des places ou Malraux les discutent. Je n'ai jamais vu un autre livre d'art ou les photographies appuient aussi bien ce que l'auteur écrit. Malraux prend grand avantage du profondeur de champ supéreir de la photographie en noir-et-blanc. Aussi, il exploite très bien sa capacité de mieux présenter la forme et la composition deux éléments qui se s'estompent dans les photos en couleurs. Parce que "Les voix de silence" plait, on accepte plus facilement ses thèses nietzschéennes.
Malraux propose deux grand concepts: (1) celui du musée imaginaire et (2) celui des métamorphoses.
Le musée imaginaire est l'ensemble de toutes les œuvres d'art de toutes les provenances qui exerce une influence sur l'artiste et qui le met en face avec un statut quo contre lequel il va se révolter. D'après Malraux l'artiste vit dans un contexte historique et une tradition culturelle qui le nourrissent. L'artiste va essayer de surpasser son contexte en créant son propre style.
Les métamorphoses sont les avatars des composants artistiques ou éléments stylistique. Dans la deuxième partie du livre qui s' intitule "Les métamorphoses d'Apollon" Malraux nous montre comment Apollon de l'art hellénique est devenu le Christ Pantocrator de l'église chrétienne orthodoxe et plus tard le Bouddha de la tradition de Gandhara en Inde. Malraux cite les influences sur l'art francais des estampes japonaises au XIXe siècle et des masques africains au XXe siècle comme phénomènes similaires.
Pour Malraux tout va pour le mieux dans le meilleurs de monde. L'histoire de l'art continue et c'est la seule chose qui compte. Je suis plutôt de l'avis que Dieu vit toujours et que c'est Nietzsche qui est mort. Néanmoins Malraux présente avec brio les idées Nietzschéennes et il est impossible de ne pas aimer Malraux pour son enthousiasme pour les arts plastiques.
"L'espoir" d'André Malraux est plate à mort ce qui est malheureux car sa thématique complète bien celle de "La condition humaine." "La condition humaine" a pour sujet la suppression des communistes de Shanghai en 1927 par le Kuomintang sous le commandement de Tchang Kaï-Chek. "L'espoir" raconte l'histoire de la victoire en 1938 des républicaines dans la bataille de Teruel contre les forces Nationalistes de Franco. Les personnages des deux romans sont surtout des intellectuels. Les paysans et les ouvriers sont largement absents des deux œuvres.
André Malraux n'avait pas visité Shanghai au moment ou il a écrit "La condition humaine". Ses descriptions de Shanghai ont pour base son séjour de deux ans en Indochine. Par contre Malraux a été un combattant dans la guerre espagnole en 1936 et 1937. Malheureusement sa participation aux événements semble avoir nui à son roman sur la guerre contre Franco. Je suis d'accord avec Olivier Todd, le biographe de Malraux, qui croit que le grand problème est la manque de femmes parmi les personnages principaux. Les personnages féminins es histories d'amour donne un piquant à "La condition humaine" un piquant qui manque drôlement à "L'espoir."
"La condition humaine" s'adresse surtout à la question de l'engagement tandis que "L'espoir" décrit l'apprentissage difficile dans l'art de la guerre des dirigeants des forces Républicaines (c'est à a dire les antifascistes qui s'opposaient aux Nationalistes de Franco).
D'abord Républicaine étaient trop naïfs. Ils misaient trop sur l'élan et sous-estimaient l'importance de la technologie moderne. Ils croyaient que les révolutions se faisaient toujours aux barricades et ne se rendaient compte de l'importance ni des avions ni des tanks:
"Cette guerre va être une guerre technique, et nous la conduisons en ne parlant que de sentiments." (p. 135)
"La révolution russe a été la première révolution du XXe siècle ; mais notez que militairement elle est la dernière du XIXe siècle. Ni aviation ni tanks chez les tsaristes. Des barricades chez les révolutionnaires. Comment sont nés les barricades? Pour lutter contre les cavaleries royales le peuple n'ayant jamais de cavalerie. L'Espagne est actuellement couvert de barricades - contre l'aviation de Franco." (p. 136)
Pour finir sur une note d'espoir, Malraux raconte à la fin du roman la bataille de Teruel où les Républicaines qui se servent brillamment des blindés et des avions pour emporter la victoire. Comme Malraux savait fort bien c'était trop peu trop tard.
"L'espoir" n'est plus depuis bien des années actuelles et ses qualités littéraires sont nulles. Je lui donne deux étoiles comme un témoignage pertinent de la guerre d'Espagne.
André Malraux n'avait pas visité Shanghai au moment ou il a écrit "La condition humaine". Ses descriptions de Shanghai ont pour base son séjour de deux ans en Indochine. Par contre Malraux a été un combattant dans la guerre espagnole en 1936 et 1937. Malheureusement sa participation aux événements semble avoir nui à son roman sur la guerre contre Franco. Je suis d'accord avec Olivier Todd, le biographe de Malraux, qui croit que le grand problème est la manque de femmes parmi les personnages principaux. Les personnages féminins es histories d'amour donne un piquant à "La condition humaine" un piquant qui manque drôlement à "L'espoir."
"La condition humaine" s'adresse surtout à la question de l'engagement tandis que "L'espoir" décrit l'apprentissage difficile dans l'art de la guerre des dirigeants des forces Républicaines (c'est à a dire les antifascistes qui s'opposaient aux Nationalistes de Franco).
D'abord Républicaine étaient trop naïfs. Ils misaient trop sur l'élan et sous-estimaient l'importance de la technologie moderne. Ils croyaient que les révolutions se faisaient toujours aux barricades et ne se rendaient compte de l'importance ni des avions ni des tanks:
"Cette guerre va être une guerre technique, et nous la conduisons en ne parlant que de sentiments." (p. 135)
"La révolution russe a été la première révolution du XXe siècle ; mais notez que militairement elle est la dernière du XIXe siècle. Ni aviation ni tanks chez les tsaristes. Des barricades chez les révolutionnaires. Comment sont nés les barricades? Pour lutter contre les cavaleries royales le peuple n'ayant jamais de cavalerie. L'Espagne est actuellement couvert de barricades - contre l'aviation de Franco." (p. 136)
Pour finir sur une note d'espoir, Malraux raconte à la fin du roman la bataille de Teruel où les Républicaines qui se servent brillamment des blindés et des avions pour emporter la victoire. Comme Malraux savait fort bien c'était trop peu trop tard.
"L'espoir" n'est plus depuis bien des années actuelles et ses qualités littéraires sont nulles. Je lui donne deux étoiles comme un témoignage pertinent de la guerre d'Espagne.
J'aurai dû lire quelques articles sur l'Internet avant d'entreprendre la lecture des "Antimémoires" d'André Malraux car j'étais beaucoup trop lent à comprendre que le livre était bourré de mensonges extravagantes. J'ai manqué les indices du premier chapitre où Malraux annonce qu'il est né en Alsace, que son nom famille est Berger et que son grand-père avait fréquenté Nietzsche. Je pensais que Malraux aurait abandonné son vrai nom plus tard parce qu'il était trop boche. J'ai décidé de faire des recherches à la page 380 où dans un passage qui relate ses activités comme membre de la Résistance francais en 1944, l'auteur décrit "Malraux" comme son nom de guerre.
J'ai appris du "Wikipedia" (1) que le nom de Malraux a toujours été Malraux; (2) qu'il est né à Paris; (3) que son grand-père a été n'avait jamais côtoyé Nietzsche; et (4) que Malraux est généralement reconnu comme un mythomane (à la limite un menteur pathologique). J'ai trouvé aussi à la page web des "Amitiés internationales d'André Malraux" un article très pertinent de Moncef Khemri de la faculté de lettres de Tunis qui a pour titre "Les antimémoires: entre autobiographie et autofiction" où Khemri présente la thèse que le livre est une œuvre de métafiction postmoderne. D'après Khemri, Malraux a décrit sa vie comme il aurait souhaité qu'elle avait été. Khemri ajoute que le passage où Malraux décrit sa participation dans une bataille contre les allemands en 1940 est une fiction pure. Khemri nous rappelle que le Baron de Clappique avec lequel Malraux discute de la guerre de Viet Nam est un personnage de la "Condition humaine" qui n' a jamais existé. Finalement, Khemri nous informe qu'il y a beaucoup de longues passages dans les "Antimémoires" que Malraux a tiré de ses romans.
La thèse de Khemri est ingénieuse mais elle ne me redonne pas confiance dans le livre qui n'est pas à mes yeux postmoderne mais simplement mensonger. Pourtant, la manque de véracité n'est pas forcément une mauvaise chose. Malraux explique dans son introduction qu'il donne le titre "Antimémoires" à son livre parce qu'il ne contient pas de "mémoires" traditionnelles dont il y a deux catégories: (1) des confessions (Saint-Augustin, Rousseaux) ou (2) des oeuvres où l'écrivain raconte sa vie avec introspection (Chateaubriand, T.E. Lawrence.) Selon Malraux ses "Antimémoires" offre plutôt le récit des moments dans son parcours qui lui ont posé la question: "Quel est le sens de la vie."
Un incident majeur a été un simulacre d'exécution auquel les allemands l'ont fait participer en 1944. Malheureusement à cause des nombreux mensonges dans le livre, le lecteur ne peut pas être certain que ce simulacre d'exécution ait bel et bien eu lieu.
Malraux croit aussi que l'art fait réfléchir au sens de la vie et les idées qu'il présente au sujet de l'art constituent le meilleur élément de son livre. Il écrit beaucoup sur l'art des tombeaux (les pyramides, les grands mausolées, etc.) que l'on a crée selon Malraux non pour honorer les ancêtres mais pour contrôler l'avenir.
Dans les "Antimémoires" Malraux présente aussi une exposé bien réussi de son concept de "Musée imaginaire" selon lequel les oeuvres d'art dans le monde contemporain se trouvent délivrés de leur fonction. Un crucifix n'est plus un crucifix. Un portrait n'est plus la représentation d'une vraie personne. Dans le musée imaginaire, il n'y a ni vénération ni ressemblance. Les objets d'art diffèrent des choses et se trouvent confrontées les uns contre les autres. Dieu n'y est pour rien et t l'homme a le champs libre pour définir l'univers à sa guise. Malraux constate que partout au tiers monde (l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud) on construit des musées.
Dans sa vie, Malraux a rencontré dans sa vie bien des chefs politiques importants du 20e siècle. Dans les "Antimémoires"on trouve des longues conversations que Malraux a eu avec Chou En-lai, Charles de Gaulle, Mao Tsé-toung et Jawaharlal Nehru . Malraux semble croire aussi que ces entretiens s avec les grands politiciens de son époque lui ont mise en face-à -face avec l'énigme de la vie. La qualité de ces discussions, telles que rapportées par Malraux est très inégale.
La pire est celle avec Mao. Malraux accepte trop volontiers la version de Mao sur le la Grande Marche. Il reproche à Mao les persécutions des Tibétains mais il ne dit pas un mot au sujet de la famine de 1958-1962. Malraux est aussi très élogieux au sujet de Ho Chi Minh. La conversation avec Nehru qu'il présente est par contre superbe.
Il y a des bons moments dans les "Antimémoires" de Malraux mais dans l'ensemble elles sont affreuses.
J'ai appris du "Wikipedia" (1) que le nom de Malraux a toujours été Malraux; (2) qu'il est né à Paris; (3) que son grand-père a été n'avait jamais côtoyé Nietzsche; et (4) que Malraux est généralement reconnu comme un mythomane (à la limite un menteur pathologique). J'ai trouvé aussi à la page web des "Amitiés internationales d'André Malraux" un article très pertinent de Moncef Khemri de la faculté de lettres de Tunis qui a pour titre "Les antimémoires: entre autobiographie et autofiction" où Khemri présente la thèse que le livre est une œuvre de métafiction postmoderne. D'après Khemri, Malraux a décrit sa vie comme il aurait souhaité qu'elle avait été. Khemri ajoute que le passage où Malraux décrit sa participation dans une bataille contre les allemands en 1940 est une fiction pure. Khemri nous rappelle que le Baron de Clappique avec lequel Malraux discute de la guerre de Viet Nam est un personnage de la "Condition humaine" qui n' a jamais existé. Finalement, Khemri nous informe qu'il y a beaucoup de longues passages dans les "Antimémoires" que Malraux a tiré de ses romans.
La thèse de Khemri est ingénieuse mais elle ne me redonne pas confiance dans le livre qui n'est pas à mes yeux postmoderne mais simplement mensonger. Pourtant, la manque de véracité n'est pas forcément une mauvaise chose. Malraux explique dans son introduction qu'il donne le titre "Antimémoires" à son livre parce qu'il ne contient pas de "mémoires" traditionnelles dont il y a deux catégories: (1) des confessions (Saint-Augustin, Rousseaux) ou (2) des oeuvres où l'écrivain raconte sa vie avec introspection (Chateaubriand, T.E. Lawrence.) Selon Malraux ses "Antimémoires" offre plutôt le récit des moments dans son parcours qui lui ont posé la question: "Quel est le sens de la vie."
Un incident majeur a été un simulacre d'exécution auquel les allemands l'ont fait participer en 1944. Malheureusement à cause des nombreux mensonges dans le livre, le lecteur ne peut pas être certain que ce simulacre d'exécution ait bel et bien eu lieu.
Malraux croit aussi que l'art fait réfléchir au sens de la vie et les idées qu'il présente au sujet de l'art constituent le meilleur élément de son livre. Il écrit beaucoup sur l'art des tombeaux (les pyramides, les grands mausolées, etc.) que l'on a crée selon Malraux non pour honorer les ancêtres mais pour contrôler l'avenir.
Dans les "Antimémoires" Malraux présente aussi une exposé bien réussi de son concept de "Musée imaginaire" selon lequel les oeuvres d'art dans le monde contemporain se trouvent délivrés de leur fonction. Un crucifix n'est plus un crucifix. Un portrait n'est plus la représentation d'une vraie personne. Dans le musée imaginaire, il n'y a ni vénération ni ressemblance. Les objets d'art diffèrent des choses et se trouvent confrontées les uns contre les autres. Dieu n'y est pour rien et t l'homme a le champs libre pour définir l'univers à sa guise. Malraux constate que partout au tiers monde (l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud) on construit des musées.
Dans sa vie, Malraux a rencontré dans sa vie bien des chefs politiques importants du 20e siècle. Dans les "Antimémoires"on trouve des longues conversations que Malraux a eu avec Chou En-lai, Charles de Gaulle, Mao Tsé-toung et Jawaharlal Nehru . Malraux semble croire aussi que ces entretiens s avec les grands politiciens de son époque lui ont mise en face-à -face avec l'énigme de la vie. La qualité de ces discussions, telles que rapportées par Malraux est très inégale.
La pire est celle avec Mao. Malraux accepte trop volontiers la version de Mao sur le la Grande Marche. Il reproche à Mao les persécutions des Tibétains mais il ne dit pas un mot au sujet de la famine de 1958-1962. Malraux est aussi très élogieux au sujet de Ho Chi Minh. La conversation avec Nehru qu'il présente est par contre superbe.
Il y a des bons moments dans les "Antimémoires" de Malraux mais dans l'ensemble elles sont affreuses.
De retour du Cambodge, je reviens vers ce livre que je pensais avoir lu trop jeune... et la même impression s'impose : à part le rendu réussi de l'omniprésence sensuelle de la forêt, le reste est confus, le style n'aidant en rien, difficile à suivre non pas par sa complexité mais par le manque de lien parfois d'une phrase à l'autre (on ne sait même plus qui parle !), très intellectualisé.
Presque de la colère après cette seconde lecture, où l'attente était peut-être trop grande !
Presque de la colère après cette seconde lecture, où l'attente était peut-être trop grande !
"La Condition humaine" accompagne chaque âge de ma vie, et selon les circonstances l'un ou l'autre des destins des personnages me parle davantage. Quel sens donner à sa vie ? Comment in fine être en mesure d'affronter la mort ? Adolescent, le livre m'impressionnait, tel un monument. Plus âgé, je le lis davantage comme un compagnon qui lui aussi a vieilli. Un côté année trente ratiocinant a certainement pris un coup de vieux, mais le génie de Malraux consiste à ce que "faire son âge" soit aussi une qualité, une patine, plutôt qu'un défaut. Et puis, quel souffle aux deux bouts du récit, de la moustiquaire à la chaudière de la locomotive !
Franchement, c'était dur. J'ai cru que je n'allais jamais réussir à finir ce livre. Vraiment l'écriture d'André Malraux n'est pas faite pour moi.
Je ne vais pas plus accabler Malraux car si je le note si mal c'est par ce que la langue ne m'a pas plus du tout. C'est tout à fait personnelle, pour être honnête j'ai trouvé ça particulièrement ennuyant et je n'ai pas vraiment d'argumentaire. (peut-être par ce que je n'ai pas tout compris)
Pourtant, le thème est vraiment intéressant et j'attendais beaucoup de ce roman. Toutefois rien à faire, j'avais l'impression que les phrases n'avaient aucun sens et il me fallait les relire plusieurs fois pour leur en trouver. Je retiens quand même des moments marquants et à peu près agréable à lire, avec des questionnements vraiment pertinants sur la mort, la dignité, les femmes, la religion. Mais le reste...
Je ne pense pas qu'il faut s'appitoyer lorsque l'on ne comprend pas une oeuvre pourtant considérée comme charnière, prix Goncourt, etc... Même si on se sent particulièrement idiot ( je parle pour les jeunes ). Parfois ce n'est pas fait pour nous, ou on l'a lu trop tôt.
Faites votre propre avis.
Je ne vais pas plus accabler Malraux car si je le note si mal c'est par ce que la langue ne m'a pas plus du tout. C'est tout à fait personnelle, pour être honnête j'ai trouvé ça particulièrement ennuyant et je n'ai pas vraiment d'argumentaire. (peut-être par ce que je n'ai pas tout compris)
Pourtant, le thème est vraiment intéressant et j'attendais beaucoup de ce roman. Toutefois rien à faire, j'avais l'impression que les phrases n'avaient aucun sens et il me fallait les relire plusieurs fois pour leur en trouver. Je retiens quand même des moments marquants et à peu près agréable à lire, avec des questionnements vraiment pertinants sur la mort, la dignité, les femmes, la religion. Mais le reste...
Je ne pense pas qu'il faut s'appitoyer lorsque l'on ne comprend pas une oeuvre pourtant considérée comme charnière, prix Goncourt, etc... Même si on se sent particulièrement idiot ( je parle pour les jeunes ). Parfois ce n'est pas fait pour nous, ou on l'a lu trop tôt.
Faites votre propre avis.
Présenter un tel livre est gageure au vu de tant d'exposés pertinents littérairement parlants magnifiques de justesse d'appréciation
Peut être essayer d'en retirer
Grandeur magnificence toute autant pitoyablement atroce de par ses erreurs et tentatives d'approcher LA VÉRITÉ
Engagement et combats menés en ce sens vers justice et équité
Telle est la complexité parfois aberrante de la condition humaine en général aux prises avec le Mal et ses composantes savamment orchestrées
Et qui sous couvert de le vaincre en tout cas mener une lute acharnée contre ses racines mêmes et ses fondements en arrive somme toute à y sombrer en le perpetrant et en véhiculant ses germes de violence
Une critique de sociétés de pouvoirs en puissance de leurs acharnements à régner
En face les combats menés en âme et conscience pour les contourner..
Problématique de l'engagement
De ce qui en est détourné
Des raisons même d'exister de se le vouloir en toute intégrité
Peut être essayer d'en retirer
Grandeur magnificence toute autant pitoyablement atroce de par ses erreurs et tentatives d'approcher LA VÉRITÉ
Engagement et combats menés en ce sens vers justice et équité
Telle est la complexité parfois aberrante de la condition humaine en général aux prises avec le Mal et ses composantes savamment orchestrées
Et qui sous couvert de le vaincre en tout cas mener une lute acharnée contre ses racines mêmes et ses fondements en arrive somme toute à y sombrer en le perpetrant et en véhiculant ses germes de violence
Une critique de sociétés de pouvoirs en puissance de leurs acharnements à régner
En face les combats menés en âme et conscience pour les contourner..
Problématique de l'engagement
De ce qui en est détourné
Des raisons même d'exister de se le vouloir en toute intégrité
« Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire? Frapperait-il au travers? L’angoisse lui tordait l’estomac; il connaissait sa propre fermeté, mais n’était capable en cet instant que d’y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu’une ombre, et d’où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même - de la chair d’homme. »
La condition humaine, André Malraux @editionsfolio
Ainsi débute le tout premier Folio édité en 1972… le tout premier Folio!
Celui-ci s’inscrit bien dans la pensée de son temps, celle d’un monde qui se remettait de deux guerres en Europe, tiraillé par le conflit qui opposait les deux grandes puissances mondiales de l’époque, conflit qui se jouait en Asie avec la montée du communisme…
Un monde sombre, torturé, tourmenté…
« Mon père pense, dit lentement Kyo, que le fond de l’homme est l’angoisse, la conscience de sa propre fatalité, d’où naissent toutes les peurs, même celle de la mort… »
La réflexion portée par ce roman est profonde et plus large que la seule montée en puissance du communisme en Chine…
« Tout ce pour quoi les hommes acceptent de se faire tuer, au-delà de l’intérêt, tend plus ou moins confusément à justifier cette condition en la fondant en dignité: christianisme pour l’esclavage, nation pour le citoyen, communisme pour l’ouvrier. »
Elle questionne les fondamentaux de nos sociétés, la base des sociétés de l’Antiquité.
« Un dieu peut posséder […] mais il ne peut conquérir. L’idéal d’un dieu, n’est-ce pas, c’est de devenir homme en sachant qu’il retrouvera sa puissance; et le rêve de l’homme, de devenir dieu sans perdre sa personnalité… »
Un roman sombre qui interroge, analyse, met en ombres toute une génération et ses tourments!
Vous connaissez la phrase: « Il faut neuf mois pour faire un homme, et un seul jour pour le tuer. » Nous l’avons su autant qu’on peut le savoir l’un et l’autre… May, écoutez: il ne faut pas neuf mois, il faut soixante ans de sacrifices, de volonté, de… de tant de choses! Et quand cet homme est fait, quand il n’y a plus en lui rien de l’enfance, ni de l’adolescence, quand, vraiment, il est un homme, il n’est plus bon qu’à mourir. »
Voici le tout premier classique proposé par Folio, et depuis il y en eut tant d’autres… pour notre plus grand plaisir!
Merci Folio pour ces 50 ans de découverte et d’enseignement 🌟
La condition humaine, André Malraux @editionsfolio
Ainsi débute le tout premier Folio édité en 1972… le tout premier Folio!
Celui-ci s’inscrit bien dans la pensée de son temps, celle d’un monde qui se remettait de deux guerres en Europe, tiraillé par le conflit qui opposait les deux grandes puissances mondiales de l’époque, conflit qui se jouait en Asie avec la montée du communisme…
Un monde sombre, torturé, tourmenté…
« Mon père pense, dit lentement Kyo, que le fond de l’homme est l’angoisse, la conscience de sa propre fatalité, d’où naissent toutes les peurs, même celle de la mort… »
La réflexion portée par ce roman est profonde et plus large que la seule montée en puissance du communisme en Chine…
« Tout ce pour quoi les hommes acceptent de se faire tuer, au-delà de l’intérêt, tend plus ou moins confusément à justifier cette condition en la fondant en dignité: christianisme pour l’esclavage, nation pour le citoyen, communisme pour l’ouvrier. »
Elle questionne les fondamentaux de nos sociétés, la base des sociétés de l’Antiquité.
« Un dieu peut posséder […] mais il ne peut conquérir. L’idéal d’un dieu, n’est-ce pas, c’est de devenir homme en sachant qu’il retrouvera sa puissance; et le rêve de l’homme, de devenir dieu sans perdre sa personnalité… »
Un roman sombre qui interroge, analyse, met en ombres toute une génération et ses tourments!
Vous connaissez la phrase: « Il faut neuf mois pour faire un homme, et un seul jour pour le tuer. » Nous l’avons su autant qu’on peut le savoir l’un et l’autre… May, écoutez: il ne faut pas neuf mois, il faut soixante ans de sacrifices, de volonté, de… de tant de choses! Et quand cet homme est fait, quand il n’y a plus en lui rien de l’enfance, ni de l’adolescence, quand, vraiment, il est un homme, il n’est plus bon qu’à mourir. »
Voici le tout premier classique proposé par Folio, et depuis il y en eut tant d’autres… pour notre plus grand plaisir!
Merci Folio pour ces 50 ans de découverte et d’enseignement 🌟
Ce livre était dans ma liste de livre à lire depuis un petit moment. Je me suis lancée. Mon avis est un peu mitigé. J’ai aimé les personnages et suivre leur évolution, leur émotion, leur révolution. Mais les passages historiques sur la révolution chinoise est un peu compliquée à démêler si on n’est pas connaisseur de cette période. Je me suis un peu perdue dans les parties politiques.
Un roman qui retrace l'atmosphère pesante de la "brousse" cambodgienne, le foisonnement hostile de la nature, végétation, insectes mais aussi des hommes. Tout fourmille et crée une tension palpable, pesante. Aucun moment de sérénitė. Pour les 2 protagonistes , c'est un moyen de se sentir en vie.
Voilà un bien énigmatique texte. André Malraux, homme de tous les combats, vient rendre visite à la Boisserie pendant l’hiver 1970 au général De Gaulle retiré des affaires depuis peu. Malraux sait ou plutôt sent que cette visite sera la dernière. De Gaulle aussi.
Les deux hommes nouent un dialogue déroutant qui aborde tous les grands moments de leurs vies protéiformes. Tous les combats, toutes les luttes, toutes les difficultés traversées et parfois surmontées, tous les échecs, sont là. Pêle-mêle, dans ce texte digne d’un dialogue de Platon. Souvent, on ne sait qui parle, du général ou du romancier. Mais qu’importe.
Le ton est grave et solennel. Le monde fut leur terrain de jeu ou plutôt leur champ de bataille et tout défile sans ordre ni préséance. C’est beau, déroutant, fulgurant, drôle parfois, dérisoire et bien sûr unique en son genre. Combien d’auteurs ont, de toute leur vie, lancé ce qui deviendra L’appel du 18 juin ?
On y parle de la France comme Homère parlait d’Ithaque. Encore et toujours. On parle du monde et bien sûr de la guerre. De cette dernière Guerre qui a tout ravagé.
Un livre qui se termine par un crescendo de phrases très émouvantes qui évoquent à s’y méprendre Les Misérables. Malraux cite De Gaulle s’écriant : « Enfin, j’aurai fait ce que j’aurai pu. »
Comment ne pas repenser alors qu’au moment de mourir, Jean Valjean, regardant les chandeliers de l’évêque de Digne qui ont sauvé sa vie, s’écria : « Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi, là-haut. J’ai fait ce que j’ai pu. »
Il semble bien que, au soir de la vie, nous n’ayons d’autre solution que de faire cet humble constat et dire « j’ai fait ce que j’ai pu ».
Les deux hommes nouent un dialogue déroutant qui aborde tous les grands moments de leurs vies protéiformes. Tous les combats, toutes les luttes, toutes les difficultés traversées et parfois surmontées, tous les échecs, sont là. Pêle-mêle, dans ce texte digne d’un dialogue de Platon. Souvent, on ne sait qui parle, du général ou du romancier. Mais qu’importe.
Le ton est grave et solennel. Le monde fut leur terrain de jeu ou plutôt leur champ de bataille et tout défile sans ordre ni préséance. C’est beau, déroutant, fulgurant, drôle parfois, dérisoire et bien sûr unique en son genre. Combien d’auteurs ont, de toute leur vie, lancé ce qui deviendra L’appel du 18 juin ?
On y parle de la France comme Homère parlait d’Ithaque. Encore et toujours. On parle du monde et bien sûr de la guerre. De cette dernière Guerre qui a tout ravagé.
Un livre qui se termine par un crescendo de phrases très émouvantes qui évoquent à s’y méprendre Les Misérables. Malraux cite De Gaulle s’écriant : « Enfin, j’aurai fait ce que j’aurai pu. »
Comment ne pas repenser alors qu’au moment de mourir, Jean Valjean, regardant les chandeliers de l’évêque de Digne qui ont sauvé sa vie, s’écria : « Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi, là-haut. J’ai fait ce que j’ai pu. »
Il semble bien que, au soir de la vie, nous n’ayons d’autre solution que de faire cet humble constat et dire « j’ai fait ce que j’ai pu ».
Malraux a commencé l’écriture des Antimémoires en 1965, lors d’un voyage qui devait le mener en Chine pour rencontrer Mao. Un voyage diplomatique (il était ministre à l’époque), mais fait d’une étrange manière, par bateau. Mais Malraux est dans un état dépressif profond, et le but du voyage, dont la partie officielle sera définie tardivement, est aussi de lui permettre de reprendre pied.
En 1965 Malraux a depuis un bon moment terminé sa carrière de romancier. Il s’est tourné à la suite vers des écrits sur l’art, et il pensait d’ailleurs profiter du voyage qui s’offrait à lui pour travailler sur une nouvelle version du Musée imaginaire. Mais au Caire, il se lance dans l’écriture des Antimémoires, qui vont initier une nouvelle époque dans sa création, celle du mémorialiste. D’autres textes autobiographiques suivront, Malraux va les intégrer dans un cadre commun sous le titre Le miroir des limbes, dont les Antimémoires sont une première partie. Bien plus célèbre que les ouvrages suivants, et qui dès sa parution a rencontré un grand succès, à la fois auprès du public et de la critique.
Le genre des mémoires à l’époque où Malraux s’est lancé dans son entreprise, a une acception plus large qu’aujourd’hui :
« Les Mémoires du XXe siècle sont de deux natures. D’une part, le témoignage sur des événements : c’est parfois, dans les Mémoires de guerre du général de Gaulle, dans Les Sept Piliers de la sagesse, le récit de l’exécution d’un grand dessein. D’autre part, l’introspection dont Gide est le dernier représentant illustre, conçue comme étude de l’homme. » ( Antimémoires)
C’est donc à la fois les Mémoires, mais aussi les autobiographies, ou comme le dit Malraux les Confessions. Il pense ce dernier genre obsolète, à cause de la psychanalyse, bien plus efficace pour décortiquer les profondeurs humaines. L’évolution actuelle de la littérature lui donnera complètement tort sur ce point. Mais cela indique la direction qu’il compte donner à son texte : en aucun cas il ne s’agit d’essayer de comprendre comment sa personnalité s’est construite, ni encore moins d’évoquer des souvenirs attendris du passé. Malraux dit d’ailleurs :
« Réfléchir sur la vie — sur la vie en face de la mort — sans doute n’est-ce qu’approfondir son
interrogation. [...] En face de cette question, que m’importe ce qui n’importe qu’à moi ? Presque tous les écrivains que je connais aiment leur enfance, je déteste la mienne. J’ai peu ou mal appris à me créer moi-même, si se créer, c’est s’accommoder de cette auberge sans routes qui s’appelle la vie. J’ai su quelquefois agir, mais l’intérêt de l’action, sauf lorsqu’elle s’élève à l’histoire, est dans ce qu’on fait et non dans ce qu’on dit. Je ne m’intéresse guère. (Antimémoires).
Malraux revendique donc pour son texte le genre des Mémoire, qu’il considère en prise avec l’action, avec l’histoire en train de se faire. Il a l’ambition de mener une réflexion sur la condition humaine, et non pas une introspection, qui rechercherait une vie dans sa singularité. La connaissance de soi est impossible et inutile, la question pertinente est non pas « qui je suis » mais « qu’est-ce qu’une vie ».
Mais s’il se voit mémorialiste, il questionne, voire déconstruit le genre des mémoires. Il réfute l’effacement trompeur de l’auteur au profit de l’observateur, prétendant à l’objectivité, il est présent en permanence et vit les événements qu’il décrit.
Il met aussi en cause la linéarité du récit. Comme le roman, les Mémoires doivent dépasser le récit, au-delà des faits, chercher le sens, toucher l’éternel au-delà de l’instant. L’auteur doit trouver une sorte de troisième dimension. D’où une dramatisation de la narration, il s’agit de mettre en scène, rendre présent. De très nombreux dialogues sont un outil utilisé abondamment par Malraux pour arriver à ce résultats. Comme les mises en abîmes, la mise en lien de moments différents qui se répondent : les différentes parties du texte entremêlent presque systématiquement deux-trois moments temporels parfois séparés par des décennies. L’unité du récit est un artifice, qui empêche la recherche des enjeux existentiels.
Enfin, il s’agit pour Malraux de mettre à nu les mécanisme de la mémoire, dans laquelle différents moments cohabitent, les périodes s’entremêlent, se répondent, ce qui va ensemble, non pas par la chronologie mais par le sens, s’agrège. Il s’agit de redonner la première place à une mémoire personnelle, en action, qui se met en scène. C’est par cela que le titre d’Antimémoires prend son sens : il ne s’agit pas d’une description d’événements où le moi de l’écrivain s’efface, ou fait semblant de le faire, mais où au contraire il est mis en avant, théâtralisé.
Evidemment cela peut agacer, car le personnage Malraux, avec ses excès, son emphase, est présent de bout en bout. Lorsqu’il fait parler Nehru, c’est lui qu’on entend parler, jusque dans ses tics de langage, ses partis pris. Mais en allant jusqu’au bout de sa démarche, il finit par faire apparaître son dessein, une réflexion sur l’histoire, sur les ressorts des actions, sur ce qu’il considère comme essentiel au-delà de l’écume des événements. Et il garde de son expérience de romancier un talent certain à construire, à tenir en haleine, à relever un détail, à caractériser. Si on arrive à trouver le rythme, cela devient très prenant, passionnant par moments. Et le livre continue à questionner une fois la dernière page tournée.
En 1965 Malraux a depuis un bon moment terminé sa carrière de romancier. Il s’est tourné à la suite vers des écrits sur l’art, et il pensait d’ailleurs profiter du voyage qui s’offrait à lui pour travailler sur une nouvelle version du Musée imaginaire. Mais au Caire, il se lance dans l’écriture des Antimémoires, qui vont initier une nouvelle époque dans sa création, celle du mémorialiste. D’autres textes autobiographiques suivront, Malraux va les intégrer dans un cadre commun sous le titre Le miroir des limbes, dont les Antimémoires sont une première partie. Bien plus célèbre que les ouvrages suivants, et qui dès sa parution a rencontré un grand succès, à la fois auprès du public et de la critique.
Le genre des mémoires à l’époque où Malraux s’est lancé dans son entreprise, a une acception plus large qu’aujourd’hui :
« Les Mémoires du XXe siècle sont de deux natures. D’une part, le témoignage sur des événements : c’est parfois, dans les Mémoires de guerre du général de Gaulle, dans Les Sept Piliers de la sagesse, le récit de l’exécution d’un grand dessein. D’autre part, l’introspection dont Gide est le dernier représentant illustre, conçue comme étude de l’homme. » ( Antimémoires)
C’est donc à la fois les Mémoires, mais aussi les autobiographies, ou comme le dit Malraux les Confessions. Il pense ce dernier genre obsolète, à cause de la psychanalyse, bien plus efficace pour décortiquer les profondeurs humaines. L’évolution actuelle de la littérature lui donnera complètement tort sur ce point. Mais cela indique la direction qu’il compte donner à son texte : en aucun cas il ne s’agit d’essayer de comprendre comment sa personnalité s’est construite, ni encore moins d’évoquer des souvenirs attendris du passé. Malraux dit d’ailleurs :
« Réfléchir sur la vie — sur la vie en face de la mort — sans doute n’est-ce qu’approfondir son
interrogation. [...] En face de cette question, que m’importe ce qui n’importe qu’à moi ? Presque tous les écrivains que je connais aiment leur enfance, je déteste la mienne. J’ai peu ou mal appris à me créer moi-même, si se créer, c’est s’accommoder de cette auberge sans routes qui s’appelle la vie. J’ai su quelquefois agir, mais l’intérêt de l’action, sauf lorsqu’elle s’élève à l’histoire, est dans ce qu’on fait et non dans ce qu’on dit. Je ne m’intéresse guère. (Antimémoires).
Malraux revendique donc pour son texte le genre des Mémoire, qu’il considère en prise avec l’action, avec l’histoire en train de se faire. Il a l’ambition de mener une réflexion sur la condition humaine, et non pas une introspection, qui rechercherait une vie dans sa singularité. La connaissance de soi est impossible et inutile, la question pertinente est non pas « qui je suis » mais « qu’est-ce qu’une vie ».
Mais s’il se voit mémorialiste, il questionne, voire déconstruit le genre des mémoires. Il réfute l’effacement trompeur de l’auteur au profit de l’observateur, prétendant à l’objectivité, il est présent en permanence et vit les événements qu’il décrit.
Il met aussi en cause la linéarité du récit. Comme le roman, les Mémoires doivent dépasser le récit, au-delà des faits, chercher le sens, toucher l’éternel au-delà de l’instant. L’auteur doit trouver une sorte de troisième dimension. D’où une dramatisation de la narration, il s’agit de mettre en scène, rendre présent. De très nombreux dialogues sont un outil utilisé abondamment par Malraux pour arriver à ce résultats. Comme les mises en abîmes, la mise en lien de moments différents qui se répondent : les différentes parties du texte entremêlent presque systématiquement deux-trois moments temporels parfois séparés par des décennies. L’unité du récit est un artifice, qui empêche la recherche des enjeux existentiels.
Enfin, il s’agit pour Malraux de mettre à nu les mécanisme de la mémoire, dans laquelle différents moments cohabitent, les périodes s’entremêlent, se répondent, ce qui va ensemble, non pas par la chronologie mais par le sens, s’agrège. Il s’agit de redonner la première place à une mémoire personnelle, en action, qui se met en scène. C’est par cela que le titre d’Antimémoires prend son sens : il ne s’agit pas d’une description d’événements où le moi de l’écrivain s’efface, ou fait semblant de le faire, mais où au contraire il est mis en avant, théâtralisé.
Evidemment cela peut agacer, car le personnage Malraux, avec ses excès, son emphase, est présent de bout en bout. Lorsqu’il fait parler Nehru, c’est lui qu’on entend parler, jusque dans ses tics de langage, ses partis pris. Mais en allant jusqu’au bout de sa démarche, il finit par faire apparaître son dessein, une réflexion sur l’histoire, sur les ressorts des actions, sur ce qu’il considère comme essentiel au-delà de l’écume des événements. Et il garde de son expérience de romancier un talent certain à construire, à tenir en haleine, à relever un détail, à caractériser. Si on arrive à trouver le rythme, cela devient très prenant, passionnant par moments. Et le livre continue à questionner une fois la dernière page tournée.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de André Malraux
Lecteurs de André Malraux Voir plus
Quiz
Voir plus
André Malraux
Quel roman d’André Malraux obtient le prix Goncourt ?
«La Métamorphose des dieux»
«L’Espoir»
«La condition humaine»
11 questions
106 lecteurs ont répondu
Thème :
André MalrauxCréer un quiz sur cet auteur106 lecteurs ont répondu