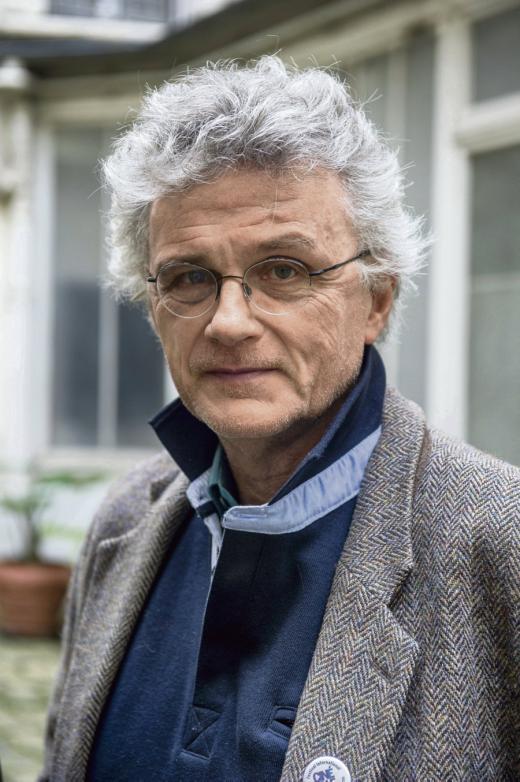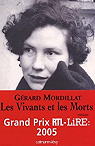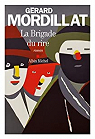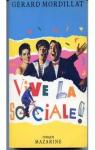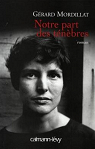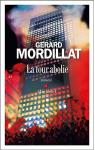Critiques de Gérard Mordillat (423)
Je n'ai pas tout compris. L'histoire est bizarre, tirée par les cheveux, n'avance pas beaucoup et se termine en queue de poisson.
Le dessin en noir et blanc est assez profond et interpellant. Mais cela donne un sentiment d'oppression qui rend la lecture de cette Bd assez pénible.
Le dessin en noir et blanc est assez profond et interpellant. Mais cela donne un sentiment d'oppression qui rend la lecture de cette Bd assez pénible.
La lecture du roman Les Vivants et les Morts, de Gérard Mordillat, m'avait beaucoup marqué. Lorsque j'ai appris que le livre avait été adapté en série pour la télévision, j'étais curieux de comparer les deux. Or, je n'ai pas été déçu.
Après avoir vu les six premiers épisodes, je me suis rendu compte que cette immense fresque sociale et souvent très intimiste, ne pouvait être adaptée que par son auteur lui-même. Le récit est tellement dense que la réalisation a imposé de résumer certaines parties de l’histoire en deux épisodes.
Les Vivants et les Morts permet de comprendre de l’intérieur ce qui s’est passé et se passe encore lorsque la finance l’emporte sur l’humain. Cette recherche permanente et obsessionnelle du profit détruit tout simplement la vie. L’auteur décortique bien le mécanisme diabolique mis au point pour réussir à déposséder les ouvriers de leur outil de travail.
Les ouvriers, les employés sont prêts à tous les sacrifices pour conserver ce qui est leur dignité et leur fierté. D’autres hommes – méritent-ils ce nom ? – n’hésitent pas à employer tous les stratagèmes pour parvenir à leurs fins. Témoins de ce spectacle désolant, les hommes politiques sont pathétiques et Gérard Mordillat démontre bien toute leur impuissance devant ce véritable massacre. Les vrais décideurs sont ailleurs et ils se gardent bien de se montrer.
Les deux derniers volets de cette terrible histoire bien trop contemporaine m’ont laissé KO. La révolte de toute une ville qui sent qu’on est en train de l’assassiner, est montrée avec brio et beaucoup de réalisme par le réalisateur : « Qui sème la misère récolte la colère ! »
Ce sont les femmes qui font prendre conscience à tous du drame qui se joue alors que, de réunion en réunion, responsables et hommes politiques tentent d’en finir en douceur. Arrive alors la répression aveugle et dévastatrice des forces de l’ordre. L’auteur nous montre bien que ce sont ceux qui les dirigent, de loin, par radio, qui portent la faute de la catastrophe qui s’amorce.
Dans le film, Marie Denarnaud qui joue le rôle de Dallas, se révèle vraiment dans ses deux derniers épisodes où elle est tout simplement extraordinaire de présence, de force et d’émotion. Elle vole même la vedette à son mari, Rudy, joué par un très bon Robinson Stévenin, et finit par imposer sa volonté.
Inutile de détailler tout ce qui se passe dans Les Vivants et les Morts, tellement cette histoire est dense et riche en émotions. L’œuvre cinématographique réalisée est à la hauteur du roman et tout le mérite en revient à Gérard Mordillat et à tous ceux qui l’ont soutenu pour réaliser cette superbe fresque.
Que vous ayez vu ou pas le film, lisez sans plus tarder le livre, vous ne le regretterez pas !
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
Après avoir vu les six premiers épisodes, je me suis rendu compte que cette immense fresque sociale et souvent très intimiste, ne pouvait être adaptée que par son auteur lui-même. Le récit est tellement dense que la réalisation a imposé de résumer certaines parties de l’histoire en deux épisodes.
Les Vivants et les Morts permet de comprendre de l’intérieur ce qui s’est passé et se passe encore lorsque la finance l’emporte sur l’humain. Cette recherche permanente et obsessionnelle du profit détruit tout simplement la vie. L’auteur décortique bien le mécanisme diabolique mis au point pour réussir à déposséder les ouvriers de leur outil de travail.
Les ouvriers, les employés sont prêts à tous les sacrifices pour conserver ce qui est leur dignité et leur fierté. D’autres hommes – méritent-ils ce nom ? – n’hésitent pas à employer tous les stratagèmes pour parvenir à leurs fins. Témoins de ce spectacle désolant, les hommes politiques sont pathétiques et Gérard Mordillat démontre bien toute leur impuissance devant ce véritable massacre. Les vrais décideurs sont ailleurs et ils se gardent bien de se montrer.
Les deux derniers volets de cette terrible histoire bien trop contemporaine m’ont laissé KO. La révolte de toute une ville qui sent qu’on est en train de l’assassiner, est montrée avec brio et beaucoup de réalisme par le réalisateur : « Qui sème la misère récolte la colère ! »
Ce sont les femmes qui font prendre conscience à tous du drame qui se joue alors que, de réunion en réunion, responsables et hommes politiques tentent d’en finir en douceur. Arrive alors la répression aveugle et dévastatrice des forces de l’ordre. L’auteur nous montre bien que ce sont ceux qui les dirigent, de loin, par radio, qui portent la faute de la catastrophe qui s’amorce.
Dans le film, Marie Denarnaud qui joue le rôle de Dallas, se révèle vraiment dans ses deux derniers épisodes où elle est tout simplement extraordinaire de présence, de force et d’émotion. Elle vole même la vedette à son mari, Rudy, joué par un très bon Robinson Stévenin, et finit par imposer sa volonté.
Inutile de détailler tout ce qui se passe dans Les Vivants et les Morts, tellement cette histoire est dense et riche en émotions. L’œuvre cinématographique réalisée est à la hauteur du roman et tout le mérite en revient à Gérard Mordillat et à tous ceux qui l’ont soutenu pour réaliser cette superbe fresque.
Que vous ayez vu ou pas le film, lisez sans plus tarder le livre, vous ne le regretterez pas !
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
Lucy est une jeune américaine qui souhaite faire éclater au grand jour sa vision de Jésus. Et celle-ci est très éloignée de ce que prône les évangiles, ce qui ne va pas plaire à tous.
Au départ cela commence plutôt bien. On nous présente Lucy. C'est une jeune réalisatrice américaine qui a perdu la foi et on nous explique son combat pour démystifier Jésus.
Mais par la suite pas mal d'éléments m'ont laissé sur le carreau. Tout d'abord Henry qu'on a du mal à cerner. Il semble toujours au bord de la folie, au point de se revivre en ce nazaréen bien loin des messages de l'évangile. On ne comprend pas ce qu'il cherche.
Et ensuite l'histoire prend une tournure confuse quand le Ku Klux Klan intervient, brule tout et que Thomas, leur chef spirituel, se lance dans de la propagande. S'enchaine des scènes de combat et de violence entre le KKK et un groupe sortit d'on ne sait où on ne sait pourquoi.
Le dessin en camaïeu de gris de Liberge est par contre toujours un régal.
Au départ cela commence plutôt bien. On nous présente Lucy. C'est une jeune réalisatrice américaine qui a perdu la foi et on nous explique son combat pour démystifier Jésus.
Mais par la suite pas mal d'éléments m'ont laissé sur le carreau. Tout d'abord Henry qu'on a du mal à cerner. Il semble toujours au bord de la folie, au point de se revivre en ce nazaréen bien loin des messages de l'évangile. On ne comprend pas ce qu'il cherche.
Et ensuite l'histoire prend une tournure confuse quand le Ku Klux Klan intervient, brule tout et que Thomas, leur chef spirituel, se lance dans de la propagande. S'enchaine des scènes de combat et de violence entre le KKK et un groupe sortit d'on ne sait où on ne sait pourquoi.
Le dessin en camaïeu de gris de Liberge est par contre toujours un régal.
Six copains vont décider de venger l'un des leurs et enlève le responsable qu'ils vont obliger à travailler au fond d'une cave.
Pendant que Ramut perce ses trous et bat des records de productivité eux perdent leurs illusions.
C'est drôle et tendre,avec des dialogues percutants, des personnages attachants.
Satire de notre société aveuglée par l'argent,sujet adoré par Mordillat, c'est l'intérêt de la caricature d'appuyer là où ça fait mal.
Pendant que Ramut perce ses trous et bat des records de productivité eux perdent leurs illusions.
C'est drôle et tendre,avec des dialogues percutants, des personnages attachants.
Satire de notre société aveuglée par l'argent,sujet adoré par Mordillat, c'est l'intérêt de la caricature d'appuyer là où ça fait mal.
Lu pour répondre à un item d'un challenge, je suis agréablement surprise. Le résumé et le titre ne me disaient rien qui vaille, et ma fois, je me suis très vite attachée aux personnages, à leur combat, la vie en cité, les galères pour trouver du boulot, la lutte des ouvriers face à un patronage abusif, Joséphine sans papier qui lutte et se cache pour ne pas être expulsée. Samuel en quête d'identité, et doit affronter le racisme au quotidien. Xenia qui vient de se faire 'larguer" et doit faire face aux charges familiales seule. Et puis tous les autres qui viennent agrandir la ronde de la société, avec leurs coups bas, et pour d'autres leurs mains tendues, leurs bras ouverts.
Un excellent roman social, mais qui peint sans pathos la réalité même édulcorée , mais on ressent bien la misère, la lutte au quotidien pour garder la tête hors de l'eau.
Au final, j'ai passé un bon moment de lecture, avec une plume très agréable, je note cet auteur et vais sans doute aller vers d'autres romans.
Un excellent roman social, mais qui peint sans pathos la réalité même édulcorée , mais on ressent bien la misère, la lutte au quotidien pour garder la tête hors de l'eau.
Au final, j'ai passé un bon moment de lecture, avec une plume très agréable, je note cet auteur et vais sans doute aller vers d'autres romans.
Quelques clichés mais une lecture qui pousse à se questionner sur la perspective (bien réelle) dépeinte dans l'ouvrage et les options pour s'y opposer. Ce livre surfe sur la vague des thématiques politiques / sociales du moment (violences policières, surveillance de masse, réduction des libertés publiques, réformes législatives afin de détricoter des acquis sociaux durement obtenus au nom du Saint Profit...), mais je trouve qu'il le fait bien, avec finesse et poésie. J'ai aimé suivre ces femmes et leurs combats. Je pense que cette lecture aurait été un véritable coup de cœur si certaines femmes avaient été décrites comme véritablement engagées, libres et épanouies, mais je trouve aussi que ce livre décrit une réalité qui existe bel et bien : les femmes continuent d'être définies (et de se définir) par les figures masculines qui gravitent autour d'elles. Mon point central, qui pourrait changer mon impression du tout au tout, est donc simple : si l'auteur a conscience et a volontairement décidé d'aborder la question du féminisme, du militantisme et de la lutte des femmes par le biais des "femmes de, sœurs de" pour dénoncer ces mécanismes, c'est une belle réussite. En revanche, si Mordillat pense avoir publié ici un hymne à la gloire de femmes fortes et indépendantes, de modèles du féminisme moderne et de se positionner par la même occasion comme un auteur féministe et engagé, c'est un échec cuisant. Je n'ai pas la réponse à cette équation car je ne l'ai pas cherchée. J'ai aimé ce livre, les questions qu'il aborde et la manière dont il le fait et cela m'a suffit.
Ayant un a-priori assez positif sur les deux auteurs, au travers du travail de création très original bien qu'austère de Monsieur Mardi-gras Descendres et l'engagement de toujours de Mordillat sur les questions d'actualité et du parler vrai, je me suis précipité sur cette hypothèse d'une prise d'otage d'ouvriers licenciés sur le bateau de nouvel-an affrété par les traders qui les ont mis à la porte. Immédiatement on pense aux 1%, Occupy wall-street et au diptyque musclé Renato Jones. L'éditeur en rajoute une couche avec un sticker rouge sur la "BD de la révolte sociale"... Cela aurait pu et l'espace des premières pages, bien trash, nous présentant les mœurs délurées des ultra-riches à la mode "loup de wall-street", on pense qu'on va lire un album jusqu'au-boutiste et rock'n'roll. Malheureusement bien vite Mordillat se croit obligé d'installer un scénario de thriller avec ses échanges entre preneurs d'otage et cabinet de crise de l'Etat et ses flash-back expliquant les coulisses du rachat de l'entreprise. Au travers des dialogues et des explications du chef des rebelles le scénariste nous place quelques dénonciations du fonctionnement bien connu de ce monde sans loi
et sans morale où seul l’appât du gain compte. [...]
Lire la suite sur le blog:
Lien : https://etagereimaginaire.wo..
et sans morale où seul l’appât du gain compte. [...]
Lire la suite sur le blog:
Lien : https://etagereimaginaire.wo..
Abandonné, décidément j'ai beaucoup de problèmes avec les livres actuellement, je n'arrive pas à entrer dans l'histoire depuis mon dernier ( Roger Ikor : les eaux mêlées ) est-ce la fatigue qui nous submerge après les fêtes de Noël ? Je n'en sais rien mais actuellement c'est un moment de creux et de vide que je ressens dont j'ai beaucoup de mal à émerger.
A la prochaine critique qui je l'espère ne tardera pas trop,en même temps je me suis " gavée" des D.V.D :les piliers de la terre et un monde sans fin d'après les romans de Ken Follet ,cadeau de ma fille et j'ai adoré ,je cherche désespérément le 3ème :
Une colonne de feu mais je pense qu' il n'est pas sorti en D.V.D. Si vous en saviez plus que moi à ce sujet dites -le moi merci par avance.
A la prochaine critique qui je l'espère ne tardera pas trop,en même temps je me suis " gavée" des D.V.D :les piliers de la terre et un monde sans fin d'après les romans de Ken Follet ,cadeau de ma fille et j'ai adoré ,je cherche désespérément le 3ème :
Une colonne de feu mais je pense qu' il n'est pas sorti en D.V.D. Si vous en saviez plus que moi à ce sujet dites -le moi merci par avance.
Ce tome est le troisième d'une trilogie : Le Suaire, tome 1 : Lirey, 1357 paru en 2018, Le Suaire - Turin, 1898 (2018), celui-ci paru en paru en 2019. Les 3 tomes ont été coécrits par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, dessinés et encrés avec nuances de gris par Éric Liberge. Ce tome peut être lu sans avoir lu les deux premiers, mais ce serait dommage de s'en priver, et cela risque de rendre quelques pages inintelligibles.
En 2019, à Lirey en Champagne, Lucy Bernheim, cinéaste américaine, se tient devant la chapelle collégiale, et elle la photographie. Elle est interpellée par le père de Brok avec qui elle a rendez-vous. Il tient dans la main la clé qui permet d'ouvrir la chapelle, et il l'invite à le suivre pour une visite. Lucy Bernheim observe la fresque mur, lit les panneaux d'informations sur le Saint Suaire, sur Geoffroy de Charny (1300-1356). Elle explique au père de Brok son projet de film. Il lui propose de continuer la conversation au presbytère. Une fois au chaud, le père de Brok explique la raison pour laquelle le suaire ne peut pas être celui de Jésus, ni celui de quelqu'un d'autre. Il lui fait la démonstration de la fabrication de traces similaires sur un linge. Lucy Bernheim s'étonne auprès de lui que tant de gens croient encore au fait que ce suaire puisse être authentique. Le père de Brok évoque la position équivoque de l'Église, les laïcs qui se sont acharnés à montrer que le linge était le suaire de Jésus, la preuve par la datation la carbone 14 qui a conduit à remettre en cause la science plutôt que d'accepter les résultats. Il interroge Lucy sur ce qui la motive à faire un film : elle veut ainsi combattre l'intégrisme catholique lié à l'extrême droite qui font de l'image du suaire un usage politique aux États-Unis.
Une fois la conversation terminée, Lucy Bernheim va marcher dans la campagne. Chemin faisant, elle observe les champs de neige, les ânes, un corbeau un chien. Elle aperçoit au loin un bosquet d'arbres par lequel elle se sent attirée. Elle quitte le chemin pour s'y rendre. Elle aperçoit une sœur en habit qui lui tient un panier sans rien dire et qui la prend par la main pour qu'elle l'accompagne. Elles marchent jusqu'à un endroit où se trouvent des planches sur des tréteaux. Le corps d'un homme trop long est allongé nu dessus. Elles déplient le drap que porte la sœur pour l'en recouvrir. La sœur commence à appliquer des onguents sur le drap pour marquer le relief du corps. Puis elle se tourne vers Lucy et lui fait un signe d'au revoir. Lucy Bernheim a des visions d'un homme crucifié sur une croix avec une couronne d'épine, d'une femme allongée sur son lit, de Lucie une bonne sœur, d'Henri évêque de Troyes en 1357, de Lucia Pastore d'Urbino et de son père le Baron, d'Enrico Spitiero, et d'autres personnes encore. Quelques jours plus tard, elle se trouve à Turin pour voir le suaire. Elle fait le point avec un des techniciens de son équipe de tournage. Elle se souvient de la première fois où elle a vu le suaire à Turin avec Thomas Crowley, son professeur de théologie à Berkeley. Elle évoque son retour proche aux États-Unis et le fait qu'elle va aller voir une pièce de théâtre sur Jésus à Broadway.
En entamant ce troisième tome, le lecteur sait qu'il s'agit du dernier et qu'il vient conclure la trilogie. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre, entre une évocation de Suaire de Turin tel qu'il est aujourd'hui considéré, l'histoire d'une nouvelle femme dont la vie y est liée (comme celle de Lucie et de Lucia précédemment) et une mise en scène de la foi catholique et de quelques croyants. Il constate très rapidement que les coscénaristes ont bien conçu leur récit en 3 chapitres : évocation de Lucie et de Lucia, évocation d'Henri et d'Enrico, reprise du motif de la vision de la sœur Lucie déjà utilisé dans le tome 2, et prise position claire sur la nature frauduleuse du suaire, fabriqué en 1357, sciemment utilisé comme relique créée ex nihilo. De ce point de vue, il s'agit d'une bande dessinée à charge qui établit le suaire comme une imposture. Les auteurs avaient déjà présenté une possibilité de fabrication du suaire dans le tome 1. Ils avaient ensuite évoqué des raisons techniques impliquant qu'il ne pouvait s'agir des marques laissées par un corps humain sur un drap. Ils exposent d'autres éléments dans ce troisième tome : un exemple de procédé de fabrication de telles marques (une démonstration effectuée par le professeur Henri Broch), les résultats de la datation au carbone 14 établissant que le drap a été tissé au quatorzième siècle. Le père de Brok énonce que la science ne peut rien faire quand l'esprit humain a décidé de croire, les preuves tangibles n'ayant aucun effet.
Dès le premier tome, le lecteur connaît donc l'opinion des auteurs et sait qu'ils vont développer leur histoire sur la base de ce point de vue. Comme dans les 2 tomes précédents, ils commencent par exposer des connaissances relatives à l'histoire du Suaire de Turin. Mais très vite, le récit prend une autre tournure, la même que celle des 2 tomes précédents. Lucy Bernheim se retrouve aux prises avec la croyance religieuse, avec la foi qui nourrit le fanatisme d'un individu. Cette orientation du récit peut décontenancer si le lecteur est resté sur les documentaires de Mordillat et Prieur. En plus, les auteurs n'y vont pas avec le dos de la cuillère en ce qui concerne le mysticisme : visions pour Lucia Bernheim (de Lucie, mais aussi de la crucifixion décrite en prologue du premier tome), sous-entendu de réincarnation ou au minimum de destins liés, de cycles (Lucie/Lucia/Lucy tourmentée et opposée à Henri/Enrico/Henry), symbolisme de la croix, des anges, des démons, du brame du cerf… Le récit prend même un tournant grand guignol avec une crucifixion au temps présent, et un fanatisme de foule. Le propos donne l'impression d'être amoindri par le recours à ces éléments exagérés, comme si les auteurs ne pouvaient pas parler du Suaire, de la Foi, de la religion sans la transformer en des rituels déments, ce qui viennent s'ajouter à la forgerie de la relique.
Comme dans les 2 tomes précédents, Éric Liberge impressionne par la qualité de ses planches et de sa narration graphique. À nouveau les auteurs ont choisi de faire la part belle aux pages sans texte : elles sont au nombre de 25 sur un total de 68. Il n'est pas facile de raconter une histoire sans mot : de raconter quelque chose de substantiel, et d'être certain de la bonne compréhension du lecteur. Dans ce tome, cela commence avec la promenade de Lucy Bernheim dans la campagne pendant 6 pages muettes, suivies par 2 compositions complexes muettes en pages 14 & 15. En page 8, le lecteur regarde pour partie le paysage par les yeux de Lucy Bernheim, et pour l'autre partie la voit avancer avec son bâton de marche. L'artiste œuvre dans un registre réaliste et descriptif, permettant d'observer les animaux et l'environnement enneigé. Il éprouve la sensation de se promener aux côtés de la jeune femme et ressent le calme des lieux. Le dessinateur dose avec subtilité les blancs sur la page (espace vierge) de telle sorte à ce que la transition vers un état de conscience différent s'opère sans heurt. La rencontre entre Lucy et Lucie apparaît comme un fait normal, ce n'est que l'écho avec une scène semblable dans le tome 2 entre Lucie et Lucia qui révèle la nature onirique du moment. Les pages 14 & 15 s'avèrent plus complexes et plus ambitieuses. Dans la première, Liberge doit réussir à faire prendre conscience au lecteur du poids psychologique qu'exerce la religion sur l'esprit de Lucy, et dans la seconde évoquer cette impression de cycle se répétant de Lucie à Lucia à Lucy. Le résultat est clair, lisible et compréhensible, malgré la liberté d'interprétation générée par l'absence de mot. Il réitère cette sensation de remémoration en page 21, où le lecteur retrouve l'image du cerf en train de bramer. Il n'y a que le dessin en pleine page (p. 26) dont l'interprétation n'est pas si évidente.
Du début jusqu’à la fin, Éric Liberge est entièrement au service du récit dans tout ce qu'il a de plus exigeant. Il a donné vie à des personnages inoubliables et distincts. Le lecteur peut voir aussi bien les ressemblances que les différences entre Lucie, Lucia et Lucy et elles ne se limitent pas à leur tenue vestimentaire. Il a adopté une direction d'acteurs naturaliste, ce qui colle parfaitement à l'esprit de réalisme du récit. Il sait installer des décors cohérents et conformes à la réalité, pour des endroits aussi différents que la campagne autour de Lirey, l'architecture de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, l'aménagement de la chapelle de Guarini, le quartier de Broadway à New York, l'urbanisme de la ville de Corpus Christi au Texas (300.000 à 400.000 habitants), différents lieux associés aux Évangiles pour Le baiser aux lépreux, Les marchands du Temple, l'oliveraie de Gethsémani où des gardes du Sanhédrin font irruption. Il donne une force de conviction peu commune aux reconstitutions de ces scènes des Évangiles. Il réussit à trouver les bons cadrages, le bon séquençage pour rendre compte de la folie qui anime la foule dans la dernière séquence hallucinée.
Le lecteur se laisse donc transporter par la force de conviction de la narration visuelle, par sa précision et sa capacité à faire coexister le littéral très précis et la vision du ressenti de certains personnages. Ce n'est pas une mince affaire car le récit est teinté par le ressenti de Lucy Bernheim tout du long, et par les assauts du fanatisme masqué ou à découvert, jusqu'à une projection agrandie du linceul dans le ciel au cours d'un rassemblement à Corpus Christi, et même l'apparition du Christ dans le ciel. Le lecteur doit accepter que pour Gérard Mordillat et Jérôme Prieur parler de la Foi et du fanatisme, c'est sortir du rationalisme et qu'il faut donc employer un mode narratif adapté, passer au ressenti, à la métaphore, avoir recours à des comportements irrationnels. Sous réserve d'accepter ce mode narratif, le récit fait sens : une femme se confrontant à un traumatisme, devant exorciser ses croyances, et donc remettre en cause celles des autres. Les images deviennent alors la concrétisation de cette violence conflictuelle psychique. La page de fin devient une invitation à célébrer autre chose que la mort du Christ, ou l'utilisation d'un subterfuge (une fausse relique) pour préférer un autre usage à ce linge.
Ce troisième tome vient conclure cette trilogie surprenante, à bien des égards. Il ne s'agit pas d'une bande dessinée servant de support à un exposé historique ou technique sur le Suaire de Turin. Il s'agit bel et bien d'un récit, d'un roman se déroulant sur 3 époques (1357, 1898, 2019), suivant à chaque fois une femme différente, mais liées toutes les 3 par l'oppression du fanatisme religieux, d'une foi patriarcale s'imposant à elle. Éric Liberge est épatant de bout en bout, illustrant ce roman ambitieux de manière réaliste et précise, tout en réussissant à faire coexister des moments de visions, de mysticisme, sans les rendre naïfs ou crétins. Le lecteur peut se projeter à chaque époque, dans chaque lieu, et côtoyer des individus plausibles. Il apparaît très rapidement que les auteurs ont construit leur récit dans les moindres détails, que ce soient les images récurrentes comme celle de la Passion, ou des correspondances comme les ânes dans un pré en page 8, annonçant l'étrange monologue d'Henry en page 19. Au final, le ressenti du lecteur sur cette œuvre est partagé. Il a découvert un récit atypique, très personnel, particulièrement bien exécuté, mettant en scène des thématiques complexes comme la Foi, ses excès, la prédominance des croyances sur les faits scientifiquement prouvés, les contraintes implicites qu'exerce un système dominant sur tout ou partie de la population. Afin de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, il faut avoir conscience que les auteurs ne font aucun compromis avec une religion qui cautionne le mensonge des fausses reliques pour assurer en partie la foi de croyants.
En 2019, à Lirey en Champagne, Lucy Bernheim, cinéaste américaine, se tient devant la chapelle collégiale, et elle la photographie. Elle est interpellée par le père de Brok avec qui elle a rendez-vous. Il tient dans la main la clé qui permet d'ouvrir la chapelle, et il l'invite à le suivre pour une visite. Lucy Bernheim observe la fresque mur, lit les panneaux d'informations sur le Saint Suaire, sur Geoffroy de Charny (1300-1356). Elle explique au père de Brok son projet de film. Il lui propose de continuer la conversation au presbytère. Une fois au chaud, le père de Brok explique la raison pour laquelle le suaire ne peut pas être celui de Jésus, ni celui de quelqu'un d'autre. Il lui fait la démonstration de la fabrication de traces similaires sur un linge. Lucy Bernheim s'étonne auprès de lui que tant de gens croient encore au fait que ce suaire puisse être authentique. Le père de Brok évoque la position équivoque de l'Église, les laïcs qui se sont acharnés à montrer que le linge était le suaire de Jésus, la preuve par la datation la carbone 14 qui a conduit à remettre en cause la science plutôt que d'accepter les résultats. Il interroge Lucy sur ce qui la motive à faire un film : elle veut ainsi combattre l'intégrisme catholique lié à l'extrême droite qui font de l'image du suaire un usage politique aux États-Unis.
Une fois la conversation terminée, Lucy Bernheim va marcher dans la campagne. Chemin faisant, elle observe les champs de neige, les ânes, un corbeau un chien. Elle aperçoit au loin un bosquet d'arbres par lequel elle se sent attirée. Elle quitte le chemin pour s'y rendre. Elle aperçoit une sœur en habit qui lui tient un panier sans rien dire et qui la prend par la main pour qu'elle l'accompagne. Elles marchent jusqu'à un endroit où se trouvent des planches sur des tréteaux. Le corps d'un homme trop long est allongé nu dessus. Elles déplient le drap que porte la sœur pour l'en recouvrir. La sœur commence à appliquer des onguents sur le drap pour marquer le relief du corps. Puis elle se tourne vers Lucy et lui fait un signe d'au revoir. Lucy Bernheim a des visions d'un homme crucifié sur une croix avec une couronne d'épine, d'une femme allongée sur son lit, de Lucie une bonne sœur, d'Henri évêque de Troyes en 1357, de Lucia Pastore d'Urbino et de son père le Baron, d'Enrico Spitiero, et d'autres personnes encore. Quelques jours plus tard, elle se trouve à Turin pour voir le suaire. Elle fait le point avec un des techniciens de son équipe de tournage. Elle se souvient de la première fois où elle a vu le suaire à Turin avec Thomas Crowley, son professeur de théologie à Berkeley. Elle évoque son retour proche aux États-Unis et le fait qu'elle va aller voir une pièce de théâtre sur Jésus à Broadway.
En entamant ce troisième tome, le lecteur sait qu'il s'agit du dernier et qu'il vient conclure la trilogie. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre, entre une évocation de Suaire de Turin tel qu'il est aujourd'hui considéré, l'histoire d'une nouvelle femme dont la vie y est liée (comme celle de Lucie et de Lucia précédemment) et une mise en scène de la foi catholique et de quelques croyants. Il constate très rapidement que les coscénaristes ont bien conçu leur récit en 3 chapitres : évocation de Lucie et de Lucia, évocation d'Henri et d'Enrico, reprise du motif de la vision de la sœur Lucie déjà utilisé dans le tome 2, et prise position claire sur la nature frauduleuse du suaire, fabriqué en 1357, sciemment utilisé comme relique créée ex nihilo. De ce point de vue, il s'agit d'une bande dessinée à charge qui établit le suaire comme une imposture. Les auteurs avaient déjà présenté une possibilité de fabrication du suaire dans le tome 1. Ils avaient ensuite évoqué des raisons techniques impliquant qu'il ne pouvait s'agir des marques laissées par un corps humain sur un drap. Ils exposent d'autres éléments dans ce troisième tome : un exemple de procédé de fabrication de telles marques (une démonstration effectuée par le professeur Henri Broch), les résultats de la datation au carbone 14 établissant que le drap a été tissé au quatorzième siècle. Le père de Brok énonce que la science ne peut rien faire quand l'esprit humain a décidé de croire, les preuves tangibles n'ayant aucun effet.
Dès le premier tome, le lecteur connaît donc l'opinion des auteurs et sait qu'ils vont développer leur histoire sur la base de ce point de vue. Comme dans les 2 tomes précédents, ils commencent par exposer des connaissances relatives à l'histoire du Suaire de Turin. Mais très vite, le récit prend une autre tournure, la même que celle des 2 tomes précédents. Lucy Bernheim se retrouve aux prises avec la croyance religieuse, avec la foi qui nourrit le fanatisme d'un individu. Cette orientation du récit peut décontenancer si le lecteur est resté sur les documentaires de Mordillat et Prieur. En plus, les auteurs n'y vont pas avec le dos de la cuillère en ce qui concerne le mysticisme : visions pour Lucia Bernheim (de Lucie, mais aussi de la crucifixion décrite en prologue du premier tome), sous-entendu de réincarnation ou au minimum de destins liés, de cycles (Lucie/Lucia/Lucy tourmentée et opposée à Henri/Enrico/Henry), symbolisme de la croix, des anges, des démons, du brame du cerf… Le récit prend même un tournant grand guignol avec une crucifixion au temps présent, et un fanatisme de foule. Le propos donne l'impression d'être amoindri par le recours à ces éléments exagérés, comme si les auteurs ne pouvaient pas parler du Suaire, de la Foi, de la religion sans la transformer en des rituels déments, ce qui viennent s'ajouter à la forgerie de la relique.
Comme dans les 2 tomes précédents, Éric Liberge impressionne par la qualité de ses planches et de sa narration graphique. À nouveau les auteurs ont choisi de faire la part belle aux pages sans texte : elles sont au nombre de 25 sur un total de 68. Il n'est pas facile de raconter une histoire sans mot : de raconter quelque chose de substantiel, et d'être certain de la bonne compréhension du lecteur. Dans ce tome, cela commence avec la promenade de Lucy Bernheim dans la campagne pendant 6 pages muettes, suivies par 2 compositions complexes muettes en pages 14 & 15. En page 8, le lecteur regarde pour partie le paysage par les yeux de Lucy Bernheim, et pour l'autre partie la voit avancer avec son bâton de marche. L'artiste œuvre dans un registre réaliste et descriptif, permettant d'observer les animaux et l'environnement enneigé. Il éprouve la sensation de se promener aux côtés de la jeune femme et ressent le calme des lieux. Le dessinateur dose avec subtilité les blancs sur la page (espace vierge) de telle sorte à ce que la transition vers un état de conscience différent s'opère sans heurt. La rencontre entre Lucy et Lucie apparaît comme un fait normal, ce n'est que l'écho avec une scène semblable dans le tome 2 entre Lucie et Lucia qui révèle la nature onirique du moment. Les pages 14 & 15 s'avèrent plus complexes et plus ambitieuses. Dans la première, Liberge doit réussir à faire prendre conscience au lecteur du poids psychologique qu'exerce la religion sur l'esprit de Lucy, et dans la seconde évoquer cette impression de cycle se répétant de Lucie à Lucia à Lucy. Le résultat est clair, lisible et compréhensible, malgré la liberté d'interprétation générée par l'absence de mot. Il réitère cette sensation de remémoration en page 21, où le lecteur retrouve l'image du cerf en train de bramer. Il n'y a que le dessin en pleine page (p. 26) dont l'interprétation n'est pas si évidente.
Du début jusqu’à la fin, Éric Liberge est entièrement au service du récit dans tout ce qu'il a de plus exigeant. Il a donné vie à des personnages inoubliables et distincts. Le lecteur peut voir aussi bien les ressemblances que les différences entre Lucie, Lucia et Lucy et elles ne se limitent pas à leur tenue vestimentaire. Il a adopté une direction d'acteurs naturaliste, ce qui colle parfaitement à l'esprit de réalisme du récit. Il sait installer des décors cohérents et conformes à la réalité, pour des endroits aussi différents que la campagne autour de Lirey, l'architecture de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, l'aménagement de la chapelle de Guarini, le quartier de Broadway à New York, l'urbanisme de la ville de Corpus Christi au Texas (300.000 à 400.000 habitants), différents lieux associés aux Évangiles pour Le baiser aux lépreux, Les marchands du Temple, l'oliveraie de Gethsémani où des gardes du Sanhédrin font irruption. Il donne une force de conviction peu commune aux reconstitutions de ces scènes des Évangiles. Il réussit à trouver les bons cadrages, le bon séquençage pour rendre compte de la folie qui anime la foule dans la dernière séquence hallucinée.
Le lecteur se laisse donc transporter par la force de conviction de la narration visuelle, par sa précision et sa capacité à faire coexister le littéral très précis et la vision du ressenti de certains personnages. Ce n'est pas une mince affaire car le récit est teinté par le ressenti de Lucy Bernheim tout du long, et par les assauts du fanatisme masqué ou à découvert, jusqu'à une projection agrandie du linceul dans le ciel au cours d'un rassemblement à Corpus Christi, et même l'apparition du Christ dans le ciel. Le lecteur doit accepter que pour Gérard Mordillat et Jérôme Prieur parler de la Foi et du fanatisme, c'est sortir du rationalisme et qu'il faut donc employer un mode narratif adapté, passer au ressenti, à la métaphore, avoir recours à des comportements irrationnels. Sous réserve d'accepter ce mode narratif, le récit fait sens : une femme se confrontant à un traumatisme, devant exorciser ses croyances, et donc remettre en cause celles des autres. Les images deviennent alors la concrétisation de cette violence conflictuelle psychique. La page de fin devient une invitation à célébrer autre chose que la mort du Christ, ou l'utilisation d'un subterfuge (une fausse relique) pour préférer un autre usage à ce linge.
Ce troisième tome vient conclure cette trilogie surprenante, à bien des égards. Il ne s'agit pas d'une bande dessinée servant de support à un exposé historique ou technique sur le Suaire de Turin. Il s'agit bel et bien d'un récit, d'un roman se déroulant sur 3 époques (1357, 1898, 2019), suivant à chaque fois une femme différente, mais liées toutes les 3 par l'oppression du fanatisme religieux, d'une foi patriarcale s'imposant à elle. Éric Liberge est épatant de bout en bout, illustrant ce roman ambitieux de manière réaliste et précise, tout en réussissant à faire coexister des moments de visions, de mysticisme, sans les rendre naïfs ou crétins. Le lecteur peut se projeter à chaque époque, dans chaque lieu, et côtoyer des individus plausibles. Il apparaît très rapidement que les auteurs ont construit leur récit dans les moindres détails, que ce soient les images récurrentes comme celle de la Passion, ou des correspondances comme les ânes dans un pré en page 8, annonçant l'étrange monologue d'Henry en page 19. Au final, le ressenti du lecteur sur cette œuvre est partagé. Il a découvert un récit atypique, très personnel, particulièrement bien exécuté, mettant en scène des thématiques complexes comme la Foi, ses excès, la prédominance des croyances sur les faits scientifiquement prouvés, les contraintes implicites qu'exerce un système dominant sur tout ou partie de la population. Afin de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, il faut avoir conscience que les auteurs ne font aucun compromis avec une religion qui cautionne le mensonge des fausses reliques pour assurer en partie la foi de croyants.
"Vive la sociale!" est un titre intrigant dont j'ai appris qu'il était le cri de ralliement des communards au mur des Fédérés. Alors forcément j'ai apprécié.
Dans ce premier roman, Gérard Mordillat s'est inspiré de son enfance dans le 20ème arrondissement de Paris. J'ai lu la première version car il a été réécrit plusieurs fois et adapté au cinéma.
Le narrateur se nomme Maurice Decques. Il doit trouver sa place dans une famille heureuse où l'ambiance est chaude entre un père communiste, une mère anarchiste et un grand frère socialiste. Il va construire sa personnalité dans cette euphorie familiale et engagée autour du "Naufragé volontaire" d’Alain Bombard, un livre qui lui donnera le goût de l'aventure (pas forcément du voyage). Comme il n'aime pas l'école et a un tempérament de plaisantin, il exercera plusieurs métiers avant de se "stabiliser" en s'associant à ses amis d'enfance Pater et Vantrou pour devenir organisateur de noces et banquets où il peut exercer ses talents comiques.
Il ne lui reste qu'à trouver la femme de sa vie, ce qu'il fait en rencontrant Genichka, une musicienne originaire de Toulouse. Mais la jeune femme ne va pas vraiment s'épanouir à Paris d'autant plus que son mari est toujours parti faire le couillon pour amuser les noceuses et noceurs.
Ce qui est appréciable chez Mordillat c'est sa façon de décrire l'ambiance avec des anecdotes cocasses qui dressent le paysage sociologique d'une époque, notamment celle des années 60. Drôle et un peu provocateur il réussit parfaitement la première moitié du roman, qui est la plus autobiographique. La deuxième partie et surtout la fin est moins bien pour moi parce que le ton est beaucoup plus grave et sérieux pour son personnage plutôt burlesque.
Lu en décembre 2019
Dans ce premier roman, Gérard Mordillat s'est inspiré de son enfance dans le 20ème arrondissement de Paris. J'ai lu la première version car il a été réécrit plusieurs fois et adapté au cinéma.
Le narrateur se nomme Maurice Decques. Il doit trouver sa place dans une famille heureuse où l'ambiance est chaude entre un père communiste, une mère anarchiste et un grand frère socialiste. Il va construire sa personnalité dans cette euphorie familiale et engagée autour du "Naufragé volontaire" d’Alain Bombard, un livre qui lui donnera le goût de l'aventure (pas forcément du voyage). Comme il n'aime pas l'école et a un tempérament de plaisantin, il exercera plusieurs métiers avant de se "stabiliser" en s'associant à ses amis d'enfance Pater et Vantrou pour devenir organisateur de noces et banquets où il peut exercer ses talents comiques.
Il ne lui reste qu'à trouver la femme de sa vie, ce qu'il fait en rencontrant Genichka, une musicienne originaire de Toulouse. Mais la jeune femme ne va pas vraiment s'épanouir à Paris d'autant plus que son mari est toujours parti faire le couillon pour amuser les noceuses et noceurs.
Ce qui est appréciable chez Mordillat c'est sa façon de décrire l'ambiance avec des anecdotes cocasses qui dressent le paysage sociologique d'une époque, notamment celle des années 60. Drôle et un peu provocateur il réussit parfaitement la première moitié du roman, qui est la plus autobiographique. La deuxième partie et surtout la fin est moins bien pour moi parce que le ton est beaucoup plus grave et sérieux pour son personnage plutôt burlesque.
Lu en décembre 2019
Magnifique triptyque. Les trois auteurs nous proposent une saine réflexion sur le fanatisme religieux, la manipulation des foules par la peur et la religiosité dans des périodes de troubles et d'inquiétudes. C'est au milieu du XIV° siècle que débute cette histoire. En pleine crise mystique et de doutes liées aux épidémies de peste, l'économie des reliques bat son plein et un prieur d'une abbaye à l'idée de créer une relique avec la prétendue image du Christ qui serait le tissu ayant enveloppé le corps crucifié de Jésus : le Saint Suaire. A la fin du XIX° siècle à Turin, là où le Suaire est arrivé, le régime monarchique vacille sous la pression des révoltes populaires, la montée des revendications de démocratie, la religion demeure le pivot de la société s'appuyant sur des dogmes et des croyances dont la vénération du Saint Suaire est mis en cause par la science, les connaissances archéologiques et la lecture comparée et critique des évangiles. Enfin, au XXI° siècle, une réalisatrice tente de combattre par l'art et l'image la montée du puritanisme et du fanatisme religieux aux Etats-unis en mettant en image le texte d'Antonin Artaud "la vie de l'homme", positionnant Jésus comme simplement un Juif de Palestine se révoltant contre le pouvoir romain et surtout des élites juives.
Ce triple album est également une belle réflexion sur le rôle de l'image, sur les relations hommes-femmes au travers des siècles. C'est également en filigrane le rappel que l'antisémitisme a été de tout temps le recours pour la religion catholique de canaliser les peurs et les doutes.
Le dessin d'Eric Liberge est grandiose qui s'appuie sur un scénario magistralement écrit. L'idée astucieuse d'ajouter comme une relation au-delà du temps entre les personnages de Lucie, Lucia et Lucy permet aux auteurs d'apporter rétroactivement des éclairages sur la psychologie des personnes et parfois tenter une réflexion universelle les idées, les réflexions de l'homme au cours des siècles sa place dans le monde, la recherche d'une vérité au travers des religions, des croyances, de la science.
Un cycle de trois albums qui ouvre une multitude de piste de réflexion arrivant fort à propos dans notre début de XXI° siècle en proie aux doutes, aux interrogations sur notre avenir et au recours aux croyances religieuses ou autres développant le fanatisme et l'intolérance.
Ce triple album est également une belle réflexion sur le rôle de l'image, sur les relations hommes-femmes au travers des siècles. C'est également en filigrane le rappel que l'antisémitisme a été de tout temps le recours pour la religion catholique de canaliser les peurs et les doutes.
Le dessin d'Eric Liberge est grandiose qui s'appuie sur un scénario magistralement écrit. L'idée astucieuse d'ajouter comme une relation au-delà du temps entre les personnages de Lucie, Lucia et Lucy permet aux auteurs d'apporter rétroactivement des éclairages sur la psychologie des personnes et parfois tenter une réflexion universelle les idées, les réflexions de l'homme au cours des siècles sa place dans le monde, la recherche d'une vérité au travers des religions, des croyances, de la science.
Un cycle de trois albums qui ouvre une multitude de piste de réflexion arrivant fort à propos dans notre début de XXI° siècle en proie aux doutes, aux interrogations sur notre avenir et au recours aux croyances religieuses ou autres développant le fanatisme et l'intolérance.
"Les vivants et les morts" est un roman consacré à la misère ouvrière face à ceux qui détiennent l'argent et donc, le pouvoir.
C'est un livre de révolte, on vit de l'intérieur ce que ressentent les ouvriers qui ont une usine qui va fermer...
Avec "notre part des ténèbres", l'auteur va encore plus loin en mettant en scène une prise d'otage des gens de pouvoir par des salariés licenciés d'une entreprise... inversion des valeurs, inversion des rapports de force... ce livre nous interroge sur la place des classes sociales aujourd'hui.
Magnifique livre à la gloire de ceux qui luttent pour un monde plus équitable..
C'est un livre de révolte, on vit de l'intérieur ce que ressentent les ouvriers qui ont une usine qui va fermer...
Avec "notre part des ténèbres", l'auteur va encore plus loin en mettant en scène une prise d'otage des gens de pouvoir par des salariés licenciés d'une entreprise... inversion des valeurs, inversion des rapports de force... ce livre nous interroge sur la place des classes sociales aujourd'hui.
Magnifique livre à la gloire de ceux qui luttent pour un monde plus équitable..
Ce tome est le deuxième d'une trilogie : Le Suaire, tome 1 : Lirey, 1357 paru en 2018, celui-ci également paru en 2018, Le Suaire (Tome 3) paru en 2019. Les 3 tomes ont été coécrits par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, dessinés et encrés avec nuances de gris par Éric Liberge. Ce tome peut être lu sans avoir lu le premier.
À Turin en 1898, le mercredi 28 mai, dans le palais du baron Tomaso Partore d'Urbino, sa fille Lucia reçoit son amant Enrico Spitiero dans sa chambre. Au milieu de l'acte, s'imposent des images : des épines de ronce sur les épaules d'un homme, une flagellation d'un homme avec des chats à neuf queues, un cerf en plein brame sur le toit du palais. Le lendemain, Lucia Pastore d'Urbino se réveille et constate qu'il y a du sang sur ses draps. Elle se lève, fait ses ablutions et essaye d'enlever le sang en frottant le drap avec du savon. Les traces ne partent pas. Elle sort de sa chambre en peignoir, avec les draps dans ses bras. Elle passe sans se faire voir devant la cuisinière et parvient à jeter les draps dans le fourneau. Elle repart en courant, en bousculant une servante, en espérant ne pas avoir été reconnue. Elle rentre dans sa chambre, s'agenouille devant un tableau du Christ en croix et se met à prier. Plus tard dans la journée, elle participe à sa leçon de chant particulière. Le baron Tomaso Pastore d'Urbino entre dans la pièce, félicite sa fille et lui indique qu'il a une surprise pour elle, qu'elle doit le suivre.
Lucia et son père sortent du palais par la cour intérieure, et la jeune femme peut voir une jeune fille se faire disputer par une femme de ménage, pour un drap retrouvé à moitié calciné dans le poêle. Lucia et son père montent dans l'automobile à moteur qui a été préparée. Le chauffeur les emmène en centre-ville. Le baron Pastore d'Urbiono prend un journal à un garçon les vendant dans la rue annonçant une une sur les fêtes du cinquantième anniversaire de la Maison de Savoie. Au pied de la cathédrale, le peuple manifeste contre la monarchie. À la gare ferroviaire, l'évêque descend du train, et se rend en voiture avec chauffeur jusqu'à a cathédrale. Le peuple l'acclame sur son passage. À l'intérieur de la cathédrale Saint Jean Baptiste, le chevalier Secondo Pia supervise les préparatifs nécessaires à accomplir la mission que lui a confiée le roi : photographier la sainte relique qu'est le Saint Suaire. Parmi les invités, sont présents Lucia et son père, Enrico Spitiero et son épouse Teresa, le cardinal, le photographe et une foule de gens. Le baron Pastore d'Urbino, principal financeur de la photographie, s'offusque de la présence de Spitiero, député socialiste et athée notoire.
Le premier tome se déroulait à Lirey en Champagne et évoquait la méthode probable de fabrication du Suaire de Turin, en 1537. Cette série avait été annoncée dès le départ comme une trilogie et le lecteur se demande quel sera l'argument de cette deuxième partie. Le titre indique que le récit se déroule à Turin, en Italie en 1898. Le lecteur se rend vite compte que le propos des auteurs n'est pas de raconter les différents voyages du suaire. Il n'est pas fait mention de la manière dont il est parvenu à Turin ou comment le Saint-Siège a officialisé sa position sur l'authenticité de la relique par une bulle papale du 26 avril 1506. Si l'année 1898 ne lui parle pas, le lecteur découvre une séquence introductive de 8 pages sans texte (à l'exception de la date et du nom de la ville) montrant l'accouplement de deux amants, et la destruction des draps souillés. Il fait ainsi la connaissance de Lucia dans le plus simple appareil, et apprécie la clarté de la narration visuelle. Comme dans le premier tome, Éric Liberge réalise des dessins dans un registre réaliste et descriptif. Les personnages présentent des morphologies normales et variées, sans sublimation des attributs musculaires ou autres. Il est patent qu'il s'est fortement investi pour que la fidélité de la reconstitution historique : les tenues vestimentaires, les bâtiments (architecture extérieure et aménagement intérieur), le mode de vie dans la maisonnée des Pastore d'Urbino. Ainsi le lecteur admire la façade du palais des Pastore d'Urbino, l'aménagement de l'immense cuisine et les différents ustensiles, la décoration luxueuse du salon de musique, le modèle de voiture utilisée par le baron, l'intérieur de la cathédrale de Turin et son architecture Renaissance, le carnaval dans les rues de Turin, etc. C'est un vrai plaisir que de pouvoir ainsi se projeter dans cette ville à cette époque, en ayant confiance dans la qualité de la reconstitution.
Avant tout, le lecteur découvre une histoire d'amour entre une jeune fille de bonne famille que son père va marier, et un homme marié d'une obédience politique opposée à celle du père de Lucia. L'artiste la met en images de manière naturaliste, sans l'enjoliver par des dessins romantiques. Il montre une femme qui a de la personnalité et la tête sur les épaules, qui sait se servir de son intelligence, pas du tout une victime manipulée dans une société patriarcale. Le lecteur ne reste pas insensible au charme de sa jeunesse, l'empathie lui faisant aussi éprouver l'ardeur de sa passion pour Enrico Spitiero, son respect filial pour son père, son plaisir à chanter, sa terreur à se retrouver ballottée par la foule du carnaval, son intelligence en effectuant des déductions sur ce que permet de voir la photographie de Secondo Pia, son désarroi causé par des impressions mystiques. La qualité de la direction d'acteurs donne de l'assurance aux personnages masculins : au baron celle de sa position et de sa fortune, à Enrico Spitiero celle de sa beauté et de ses convictions politiques, à Secondo Pia celle de sa maîtrise technique. Le lecteur peut ainsi voir comme chacun est animé par les actions qu'il est en train de réaliser et par la manière dont il se comporte vis-à-vis des autres.
Ce récit impressionne également par l'évocation visuelle en creux du contexte social. Lorsque Lucia se rend dans la cuisine pour y brûler son drap, le lecteur peut se faire une idée du niveau de richesse du Baron Tomaso Pastore d'Urbino. Pendant le voyage en voiture, il voit le peuple manifester contre la monarchie, puis il voit la répression exercée par la police. Cette toile de fond n'apparaît que fugacement, presqu'incidemment, mais le lecteur y prêtera plus d'attention s'il dispose déjà d'une notion du contexte historique de cette époque dans cette région du monde. Il en va de même pour l'importance de la photographie réalisée par Secondo Pia. Le lecteur peut être étonné par le fait que ce soit l'archevêque qui remette en cause l'authenticité du suaire, ou par le manque d'informations quant aux enjeux de cette photographie. Là encore, il comprend mieux ces détails s'il est déjà familier de l'histoire du Suaire de Turin : le déclin du culte des reliques à la fin du dix-neuvième siècle et le regain d'intérêt pour le suaire grâce à cette photographie.
Lors de la séquence d'ouverture, Éric Liberge juxtapose différents types d'informations sur une même page. Alors que Lucia et Enrico sont en train de faire l'amour, il apparaît l'image de la statue du cerf sur le dôme du palais, la main droite du Christ transpercée d'un clou sur la croix, des épines transperçant la chair des épaules d'un homme, un homme flagellé par deux autres. Ces juxtapositions agissent comme un rapprochement, une association d'idées dont il n'est pas précisé si elle est l'œuvre de Lucia ou d'Enrico, ou une métaphore voulue par les auteurs. Un peu plus tard, en scrutant la photographie du linceul, Lucia fait l'expérience d'une remémoration, comme si elle se retrouvait face à Lucie en 1357 à Lirey. Encore plus tard elle fait à nouveau l'expérience d'une vision pendant l'amour, et l'image du cerf revient. Cette dernière est une image régulièrement utilisée pour évoquer la virilité masculine, par exemple dans l'excellente bande dessinée Le dernier brame (2011) de Jean-Claude Servais. La flagellation et la mortification étaient déjà présentes dans le premier tome, symbolisant les tourments intérieurs de Lucie une jeune nonne déchirée entre ses vœux à venir et l'amour que lui porte son cousin Henri. Dans ce deuxième tome, Lucia est elle aussi sous le joug d'un conflit psychique : son amour physique pour un homme marié politiquement opposé à son père, et une demande en mariage avec le fils d'une famille importante. Ces 2 hommes sont également opposés sur la nature du linceul : véritable relique ou supercherie fabriquée de toute pièce. Dans le tome précédent et dans celui-ci Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont choisi leur camp entre les 2 possibilités, attachant la vérité au personnage à qui l'Histoire donnera raison quant à l'évolution politique de la société. Lucie incarne alors l'individu soumis aux règles en vigueur, et devant réussir à en percevoir l'iniquité pour s'affranchir de ces lois, de cette structure sociale que l'histoire de l'humanité a fait apparaître comme un outil d'oppression injuste. Dans la mesure où ils y associent les croyances religieuses de l'époque, leur jugement de valeur est clair.
Avec ce deuxième tome, le lecteur prend mieux conscience de la nature du récit de cette trilogie. L'écriture de Jérôme Prieur et de Gérad Mordillat suppose que le lecteur soit déjà familier de l'histoire du suaire de Turin pour pouvoir percevoir tous les enjeux du récit. À l'instar du premier tome, cette histoire est avant tout une bande dessinée, où la majeure partie des informations est portée par la narration visuelle, Éric Liberge réalisant une reconstitution historique de très bonne facture, et mettant en scène des personnages qui s'incarnent générant une forte empathie chez le lecteur. Le lecteur peut se retrouver un peu décontenancé s'il s'attendait plus à l'histoire du suaire de Turin qu'à un drame aux résonances métaphoriques.
À Turin en 1898, le mercredi 28 mai, dans le palais du baron Tomaso Partore d'Urbino, sa fille Lucia reçoit son amant Enrico Spitiero dans sa chambre. Au milieu de l'acte, s'imposent des images : des épines de ronce sur les épaules d'un homme, une flagellation d'un homme avec des chats à neuf queues, un cerf en plein brame sur le toit du palais. Le lendemain, Lucia Pastore d'Urbino se réveille et constate qu'il y a du sang sur ses draps. Elle se lève, fait ses ablutions et essaye d'enlever le sang en frottant le drap avec du savon. Les traces ne partent pas. Elle sort de sa chambre en peignoir, avec les draps dans ses bras. Elle passe sans se faire voir devant la cuisinière et parvient à jeter les draps dans le fourneau. Elle repart en courant, en bousculant une servante, en espérant ne pas avoir été reconnue. Elle rentre dans sa chambre, s'agenouille devant un tableau du Christ en croix et se met à prier. Plus tard dans la journée, elle participe à sa leçon de chant particulière. Le baron Tomaso Pastore d'Urbino entre dans la pièce, félicite sa fille et lui indique qu'il a une surprise pour elle, qu'elle doit le suivre.
Lucia et son père sortent du palais par la cour intérieure, et la jeune femme peut voir une jeune fille se faire disputer par une femme de ménage, pour un drap retrouvé à moitié calciné dans le poêle. Lucia et son père montent dans l'automobile à moteur qui a été préparée. Le chauffeur les emmène en centre-ville. Le baron Pastore d'Urbiono prend un journal à un garçon les vendant dans la rue annonçant une une sur les fêtes du cinquantième anniversaire de la Maison de Savoie. Au pied de la cathédrale, le peuple manifeste contre la monarchie. À la gare ferroviaire, l'évêque descend du train, et se rend en voiture avec chauffeur jusqu'à a cathédrale. Le peuple l'acclame sur son passage. À l'intérieur de la cathédrale Saint Jean Baptiste, le chevalier Secondo Pia supervise les préparatifs nécessaires à accomplir la mission que lui a confiée le roi : photographier la sainte relique qu'est le Saint Suaire. Parmi les invités, sont présents Lucia et son père, Enrico Spitiero et son épouse Teresa, le cardinal, le photographe et une foule de gens. Le baron Pastore d'Urbino, principal financeur de la photographie, s'offusque de la présence de Spitiero, député socialiste et athée notoire.
Le premier tome se déroulait à Lirey en Champagne et évoquait la méthode probable de fabrication du Suaire de Turin, en 1537. Cette série avait été annoncée dès le départ comme une trilogie et le lecteur se demande quel sera l'argument de cette deuxième partie. Le titre indique que le récit se déroule à Turin, en Italie en 1898. Le lecteur se rend vite compte que le propos des auteurs n'est pas de raconter les différents voyages du suaire. Il n'est pas fait mention de la manière dont il est parvenu à Turin ou comment le Saint-Siège a officialisé sa position sur l'authenticité de la relique par une bulle papale du 26 avril 1506. Si l'année 1898 ne lui parle pas, le lecteur découvre une séquence introductive de 8 pages sans texte (à l'exception de la date et du nom de la ville) montrant l'accouplement de deux amants, et la destruction des draps souillés. Il fait ainsi la connaissance de Lucia dans le plus simple appareil, et apprécie la clarté de la narration visuelle. Comme dans le premier tome, Éric Liberge réalise des dessins dans un registre réaliste et descriptif. Les personnages présentent des morphologies normales et variées, sans sublimation des attributs musculaires ou autres. Il est patent qu'il s'est fortement investi pour que la fidélité de la reconstitution historique : les tenues vestimentaires, les bâtiments (architecture extérieure et aménagement intérieur), le mode de vie dans la maisonnée des Pastore d'Urbino. Ainsi le lecteur admire la façade du palais des Pastore d'Urbino, l'aménagement de l'immense cuisine et les différents ustensiles, la décoration luxueuse du salon de musique, le modèle de voiture utilisée par le baron, l'intérieur de la cathédrale de Turin et son architecture Renaissance, le carnaval dans les rues de Turin, etc. C'est un vrai plaisir que de pouvoir ainsi se projeter dans cette ville à cette époque, en ayant confiance dans la qualité de la reconstitution.
Avant tout, le lecteur découvre une histoire d'amour entre une jeune fille de bonne famille que son père va marier, et un homme marié d'une obédience politique opposée à celle du père de Lucia. L'artiste la met en images de manière naturaliste, sans l'enjoliver par des dessins romantiques. Il montre une femme qui a de la personnalité et la tête sur les épaules, qui sait se servir de son intelligence, pas du tout une victime manipulée dans une société patriarcale. Le lecteur ne reste pas insensible au charme de sa jeunesse, l'empathie lui faisant aussi éprouver l'ardeur de sa passion pour Enrico Spitiero, son respect filial pour son père, son plaisir à chanter, sa terreur à se retrouver ballottée par la foule du carnaval, son intelligence en effectuant des déductions sur ce que permet de voir la photographie de Secondo Pia, son désarroi causé par des impressions mystiques. La qualité de la direction d'acteurs donne de l'assurance aux personnages masculins : au baron celle de sa position et de sa fortune, à Enrico Spitiero celle de sa beauté et de ses convictions politiques, à Secondo Pia celle de sa maîtrise technique. Le lecteur peut ainsi voir comme chacun est animé par les actions qu'il est en train de réaliser et par la manière dont il se comporte vis-à-vis des autres.
Ce récit impressionne également par l'évocation visuelle en creux du contexte social. Lorsque Lucia se rend dans la cuisine pour y brûler son drap, le lecteur peut se faire une idée du niveau de richesse du Baron Tomaso Pastore d'Urbino. Pendant le voyage en voiture, il voit le peuple manifester contre la monarchie, puis il voit la répression exercée par la police. Cette toile de fond n'apparaît que fugacement, presqu'incidemment, mais le lecteur y prêtera plus d'attention s'il dispose déjà d'une notion du contexte historique de cette époque dans cette région du monde. Il en va de même pour l'importance de la photographie réalisée par Secondo Pia. Le lecteur peut être étonné par le fait que ce soit l'archevêque qui remette en cause l'authenticité du suaire, ou par le manque d'informations quant aux enjeux de cette photographie. Là encore, il comprend mieux ces détails s'il est déjà familier de l'histoire du Suaire de Turin : le déclin du culte des reliques à la fin du dix-neuvième siècle et le regain d'intérêt pour le suaire grâce à cette photographie.
Lors de la séquence d'ouverture, Éric Liberge juxtapose différents types d'informations sur une même page. Alors que Lucia et Enrico sont en train de faire l'amour, il apparaît l'image de la statue du cerf sur le dôme du palais, la main droite du Christ transpercée d'un clou sur la croix, des épines transperçant la chair des épaules d'un homme, un homme flagellé par deux autres. Ces juxtapositions agissent comme un rapprochement, une association d'idées dont il n'est pas précisé si elle est l'œuvre de Lucia ou d'Enrico, ou une métaphore voulue par les auteurs. Un peu plus tard, en scrutant la photographie du linceul, Lucia fait l'expérience d'une remémoration, comme si elle se retrouvait face à Lucie en 1357 à Lirey. Encore plus tard elle fait à nouveau l'expérience d'une vision pendant l'amour, et l'image du cerf revient. Cette dernière est une image régulièrement utilisée pour évoquer la virilité masculine, par exemple dans l'excellente bande dessinée Le dernier brame (2011) de Jean-Claude Servais. La flagellation et la mortification étaient déjà présentes dans le premier tome, symbolisant les tourments intérieurs de Lucie une jeune nonne déchirée entre ses vœux à venir et l'amour que lui porte son cousin Henri. Dans ce deuxième tome, Lucia est elle aussi sous le joug d'un conflit psychique : son amour physique pour un homme marié politiquement opposé à son père, et une demande en mariage avec le fils d'une famille importante. Ces 2 hommes sont également opposés sur la nature du linceul : véritable relique ou supercherie fabriquée de toute pièce. Dans le tome précédent et dans celui-ci Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont choisi leur camp entre les 2 possibilités, attachant la vérité au personnage à qui l'Histoire donnera raison quant à l'évolution politique de la société. Lucie incarne alors l'individu soumis aux règles en vigueur, et devant réussir à en percevoir l'iniquité pour s'affranchir de ces lois, de cette structure sociale que l'histoire de l'humanité a fait apparaître comme un outil d'oppression injuste. Dans la mesure où ils y associent les croyances religieuses de l'époque, leur jugement de valeur est clair.
Avec ce deuxième tome, le lecteur prend mieux conscience de la nature du récit de cette trilogie. L'écriture de Jérôme Prieur et de Gérad Mordillat suppose que le lecteur soit déjà familier de l'histoire du suaire de Turin pour pouvoir percevoir tous les enjeux du récit. À l'instar du premier tome, cette histoire est avant tout une bande dessinée, où la majeure partie des informations est portée par la narration visuelle, Éric Liberge réalisant une reconstitution historique de très bonne facture, et mettant en scène des personnages qui s'incarnent générant une forte empathie chez le lecteur. Le lecteur peut se retrouver un peu décontenancé s'il s'attendait plus à l'histoire du suaire de Turin qu'à un drame aux résonances métaphoriques.
Une bande d'anciens copains joueurs de hand ball se retrouvent et décident de kidnapper un journaliste fervent chroniqueur d'idées toutes faites et communément admises par la bien-pensance libérale. Il décident de le faire travailler comme ses chroniques le préconisent en se déguisant en 7 nains pour ne pas être reconnus. Trés drôle et critique acerbe des médias .
La Passion
Le Suaire, planche du tome 3 © Futoropolis / Liberge / Mordillat / Prieur [Résumé] Corpus Christi, 2019 conclue un récit éminemment symbolique et solidement documenté où Gerard Mordillat et Jerome Prieur s’appuient sur le Suaire pour décortiquer les liens complexes et tortueux reliant l’homme, la foi et le pouvoir. Le récit est plus tortueux que celui des deux précédents opus, comme si sa dimension symbolique avait estompé le récit proprement dit, au risque d’y perdre plus d’un lecteur…
Si le fanatisme est au cœur de ce troisième opus, l’album met surtout en lumière les dangers que peuvent faire peser sur les croyants les mensonges que l’Eglise a forgé et alimenté au fil des siècles pour asseoir son pouvoir. Eric Liberge fait une nouvelle fois montre de son saisissant talent en nous offrant des planches de toute beauté qui font la part belle aux ombres et à la lumière et qui sont indéniablement la grande force de la série…
Avec ce troisième tome aux accents apocalyptiques, les auteurs concluent un diptyque envoûtant et dérangeant qui nous rappelle combien les religions, sensées élever l’homme, peuvent le rabaisser et l’avilir… Que de crimes encore seront commis au nom de Dieu…
Lien : http://sdimag.fr/index.php?r..
Le Suaire, planche du tome 3 © Futoropolis / Liberge / Mordillat / Prieur [Résumé] Corpus Christi, 2019 conclue un récit éminemment symbolique et solidement documenté où Gerard Mordillat et Jerome Prieur s’appuient sur le Suaire pour décortiquer les liens complexes et tortueux reliant l’homme, la foi et le pouvoir. Le récit est plus tortueux que celui des deux précédents opus, comme si sa dimension symbolique avait estompé le récit proprement dit, au risque d’y perdre plus d’un lecteur…
Si le fanatisme est au cœur de ce troisième opus, l’album met surtout en lumière les dangers que peuvent faire peser sur les croyants les mensonges que l’Eglise a forgé et alimenté au fil des siècles pour asseoir son pouvoir. Eric Liberge fait une nouvelle fois montre de son saisissant talent en nous offrant des planches de toute beauté qui font la part belle aux ombres et à la lumière et qui sont indéniablement la grande force de la série…
Avec ce troisième tome aux accents apocalyptiques, les auteurs concluent un diptyque envoûtant et dérangeant qui nous rappelle combien les religions, sensées élever l’homme, peuvent le rabaisser et l’avilir… Que de crimes encore seront commis au nom de Dieu…
Lien : http://sdimag.fr/index.php?r..
Très bon travail.
On arrive à se faire une petite idée sur ce qu'a été le christianisme des premières heures.
On arrive à se faire une petite idée sur ce qu'a été le christianisme des premières heures.
L' opposition entre les 2 types de classes sociales aurait pu amener un très bon sujet.
La vulgarité s'est intégrée (Peut-être pour marquer encore plus les oppositions).
Elle n'était vraiment pas utile.
C'est la mauvaise note de ce récit.
Dommage.
La vulgarité s'est intégrée (Peut-être pour marquer encore plus les oppositions).
Elle n'était vraiment pas utile.
C'est la mauvaise note de ce récit.
Dommage.
Ce récit est mené de main de maître par un écrivain au meilleur de son art. N'oublions pas non plus l'incroyable travail graphique de son complice Eric Libergé qui parvient par son trait à mettre en place l'atmosphère de ce thriller social, tout en faisant monter le pression. Un récit intelligent sur notre société actuelle.
Lien : http://www.sceneario.com/bd_..
Lien : http://www.sceneario.com/bd_..
Difficile d'avoir un avis tranché sur cette histoire : si au démarrage, cela semble un peu fou mais pourquoi pas? Des ouvriers licenciés qui prennent en otage lors d'une croisière mirifique, tous les responsables de la fermeture de leur usine. Les raisons des uns et des autres, les trop nombreux personnages, font que cela devient plutôt confus sur la deuxième moitié de l'ouvrage?
Et après cela part en cacahuète...Il n'y a pas d'autres termes. le jusqu'au boutisme de certains personnages sont too much pour moi. Avis tout personnel.
C'est bien fait mais trop excessif. Sans doute un vrai pamphlet social.
Et après cela part en cacahuète...Il n'y a pas d'autres termes. le jusqu'au boutisme de certains personnages sont too much pour moi. Avis tout personnel.
C'est bien fait mais trop excessif. Sans doute un vrai pamphlet social.
C'est un peu comme les slogans arborés par les Gilets Jaunes on trouve de tout, on retiendras l'empathie et la solidarité manifester par ces auteurs, ce qui est loin de la réalité de terrain. Voir vidéo des "Livres dans la boucle".
Lien : https://www.youtube.com/watc..
Lien : https://www.youtube.com/watc..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Gérard Mordillat
Lecteurs de Gérard Mordillat (2145)Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature par l'image
"La femme au perroquet", Courbet 1866. 💙
Crime et châtiment
Alcools
La condition humaine
Guerre et paix
Gros câlin
Un roi sans divertissement
La falaise des fous
L'autre sommeil
Un coeur simple
Ceux de 14
Le 2 mai 1808 suivi de Baylen
11 questions
32 lecteurs ont répondu
Thèmes :
peinture
, littératureCréer un quiz sur cet auteur32 lecteurs ont répondu