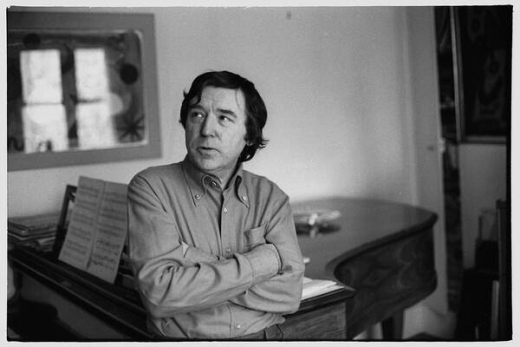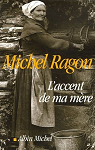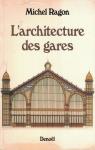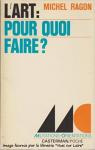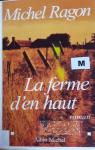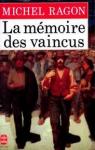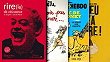Critiques de Michel Ragon (137)
J'ai découvert Michel Ragon avec "La mémoire des vaincus", grande fresque sur l'anarchie absolument passionnante. Quand j'ai vu qu'il avait écrit un texte sur ses origines, je n'ai pu que me précipiter dessus !
Malheureusement, je n'ai pas du tout accroché avec ce texte-ci. J'ai trouvé l'auteur assez méprisant envers ses propres origines. Il semble en partie au moins, consciemment ou non, renier l'endroit d'où il vient, la culture qui l'a vu naître. Le ton qu'il emploie pour parler de sa famille m'a beaucoup gênée.
Tout comme l'auteur, je viens d'une région au patrimoine bien marqué, j'ai un accent et je vis loin de chez moi. Une thématique qui me touche donc énormément. Mais la manière dont le sujet est traité ici m'a déçue, par la distance prise avec ses racines et le ton condescendant souvent employé. Un texte qui m'a laissé un goût amer.
Lien : http://madimado.com/2012/06/..
Malheureusement, je n'ai pas du tout accroché avec ce texte-ci. J'ai trouvé l'auteur assez méprisant envers ses propres origines. Il semble en partie au moins, consciemment ou non, renier l'endroit d'où il vient, la culture qui l'a vu naître. Le ton qu'il emploie pour parler de sa famille m'a beaucoup gênée.
Tout comme l'auteur, je viens d'une région au patrimoine bien marqué, j'ai un accent et je vis loin de chez moi. Une thématique qui me touche donc énormément. Mais la manière dont le sujet est traité ici m'a déçue, par la distance prise avec ses racines et le ton condescendant souvent employé. Un texte qui m'a laissé un goût amer.
Lien : http://madimado.com/2012/06/..
Fils d'un militaire de la Coloniale, Michel Ragon passa son enfance en Vendée à Fontenay le Comte et sa jeunesse à Nantes auprès de sa mère, humble femme du peuple paysan de l'ouest avant de partir tenter sa chance à Paris. Partant du personnel et de l'anecdotique, il en vient assez vite aux drames de la Vendée, souvent cantonnés à un des épisode des révoltes chouannes alors que le pays dut subir guerres de religion, implantation huguenote, révocation de l'Edit de Nantes, dragonnades, émigration en Acadie, déportation en Louisiane (« le grand Chambardement ») et bien sûr le monstrueux génocide qui débuta en 1793.
Ragon propose une explication des causes bien différente des versions habituelles, renvoyant dos à dos les habituelles thèses royalistes ou républicaines. La révolte vendéenne ne fut au départ qu'une jacquerie de plus, totalement paysanne et prolétarienne donc ni religieuse, ni royaliste. Les bourgeois n'y prirent pas part et y furent même complètement hostiles. Les nobliaux se firent tirer l'oreille pour en prendre la tête. De plus, elle ne concerna qu'une partie du territoire vendéen, celui qui fut le plus ardemment protestant et qui était quasiment déchristianisé à l'époque. Aucune ville, aucun hiérarque catholique, excepté les prêtres réfractaires, aucun noble de haute lignée n'y adhéra. (Ils étaient même plus nombreux à encadrer l'armée bleue) Quant aux émigrés, jamais ils n'aidèrent le mouvement, bien au contraire. Le futur Louis XVIII ne leva pas le petit doigt alors qu'il aurait suffi que l'armée royale fasse sa jonction à Granville où l'attendaient pas moins de 80 000 hommes pour balayer Robespierre et son régime. « Si profitant de leurs étonnants succès, Charrette et Cathelineau eussent réuni leurs forces pour marcher sur la Capitale, c'en était fait de la République ; rien n'eût arrêté la marche triomphale des armées royales. Le drapeau blanc eût flotté sur Notre-Dame... » écrira Napoléon Ier. En réalité, royalistes et révolutionnaires se méfiaient terriblement de ce peuple insurgé contre toute forme d'oppression.
Se révoltèrent-ils pour échapper à la conscription ? Ragon rejette également cette thèse car la Vendée fournira toujours un des plus gros contingent de soldats à la République et s'illustrera pendant les deux guerres mondiales (Tranchée des baïonnettes, Résistance). Alors pourquoi ces va-nu-pieds prirent-ils les armes et se lancèrent-ils dans cette aventure désespérée, dans cette révolution dans la révolution ? Pour Ragon, ils furent vite déçus par la tournure que prit le nouveau régime qui se mit à augmenter les impôts, à réduire les libertés et en particulier celle de culte et surtout à favoriser leurs ennemis de toujours : les bourgeois qui profitèrent de la vente des biens de l'Eglise pour accaparer les terres et pressurer un peu plus les paysans. Le résultat en fut les longues années de massacre et de politique de terre brulée (Colonnes infernales de Tureau, Noyades de Carrier à Nantes, massacre avec tortures de femmes et d'enfants aux Lucs et sur tout le territoire). Au total autant de victimes et de dégâts que pendant la Guerre de Sécession ou pendant la guerre civile en Espagne. Excusez du peu. Et un silence aussi honteux qu'étourdissant de tous ceux qui ont voix au chapitre à travers les siècles. Une révolution qui étrangle, brûle, étripe, liquide plus révolutionnaire qu'elle, c'est impossible, impensable, inimaginable !
Et pourtant l'horreur vendéenne portait en germe tant de génocides, d'ethnocides ou d'épurations ethniques : des koulaks aux Ukrainiens et aux Polonais sous Staline, sans oublier les Irlandais, les Arméniens en 1915, les Juifs par les nazis de 33 à 45 et plus près de nous, les Cambodgiens sous Pol Pot, les Biafrais, les Rwandais et tant d'autres...
Bravo à Michel Ragon pour avoir si magistralement traité ce difficile sujet (ce livre est une véritable somme, avec documents, annexes, déjà un véritable classique sur la question) et à cette merveilleuse collection « Terre Humaine » qui permet au plus grand nombre d'appréhender l'ethnologie historique ou contemporaine et faire découvrir tant de figures étonnantes ou touchantes comme Anta, Toinou, Sylvère et comme cette maman vendéenne de Michel Ragon.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Ragon propose une explication des causes bien différente des versions habituelles, renvoyant dos à dos les habituelles thèses royalistes ou républicaines. La révolte vendéenne ne fut au départ qu'une jacquerie de plus, totalement paysanne et prolétarienne donc ni religieuse, ni royaliste. Les bourgeois n'y prirent pas part et y furent même complètement hostiles. Les nobliaux se firent tirer l'oreille pour en prendre la tête. De plus, elle ne concerna qu'une partie du territoire vendéen, celui qui fut le plus ardemment protestant et qui était quasiment déchristianisé à l'époque. Aucune ville, aucun hiérarque catholique, excepté les prêtres réfractaires, aucun noble de haute lignée n'y adhéra. (Ils étaient même plus nombreux à encadrer l'armée bleue) Quant aux émigrés, jamais ils n'aidèrent le mouvement, bien au contraire. Le futur Louis XVIII ne leva pas le petit doigt alors qu'il aurait suffi que l'armée royale fasse sa jonction à Granville où l'attendaient pas moins de 80 000 hommes pour balayer Robespierre et son régime. « Si profitant de leurs étonnants succès, Charrette et Cathelineau eussent réuni leurs forces pour marcher sur la Capitale, c'en était fait de la République ; rien n'eût arrêté la marche triomphale des armées royales. Le drapeau blanc eût flotté sur Notre-Dame... » écrira Napoléon Ier. En réalité, royalistes et révolutionnaires se méfiaient terriblement de ce peuple insurgé contre toute forme d'oppression.
Se révoltèrent-ils pour échapper à la conscription ? Ragon rejette également cette thèse car la Vendée fournira toujours un des plus gros contingent de soldats à la République et s'illustrera pendant les deux guerres mondiales (Tranchée des baïonnettes, Résistance). Alors pourquoi ces va-nu-pieds prirent-ils les armes et se lancèrent-ils dans cette aventure désespérée, dans cette révolution dans la révolution ? Pour Ragon, ils furent vite déçus par la tournure que prit le nouveau régime qui se mit à augmenter les impôts, à réduire les libertés et en particulier celle de culte et surtout à favoriser leurs ennemis de toujours : les bourgeois qui profitèrent de la vente des biens de l'Eglise pour accaparer les terres et pressurer un peu plus les paysans. Le résultat en fut les longues années de massacre et de politique de terre brulée (Colonnes infernales de Tureau, Noyades de Carrier à Nantes, massacre avec tortures de femmes et d'enfants aux Lucs et sur tout le territoire). Au total autant de victimes et de dégâts que pendant la Guerre de Sécession ou pendant la guerre civile en Espagne. Excusez du peu. Et un silence aussi honteux qu'étourdissant de tous ceux qui ont voix au chapitre à travers les siècles. Une révolution qui étrangle, brûle, étripe, liquide plus révolutionnaire qu'elle, c'est impossible, impensable, inimaginable !
Et pourtant l'horreur vendéenne portait en germe tant de génocides, d'ethnocides ou d'épurations ethniques : des koulaks aux Ukrainiens et aux Polonais sous Staline, sans oublier les Irlandais, les Arméniens en 1915, les Juifs par les nazis de 33 à 45 et plus près de nous, les Cambodgiens sous Pol Pot, les Biafrais, les Rwandais et tant d'autres...
Bravo à Michel Ragon pour avoir si magistralement traité ce difficile sujet (ce livre est une véritable somme, avec documents, annexes, déjà un véritable classique sur la question) et à cette merveilleuse collection « Terre Humaine » qui permet au plus grand nombre d'appréhender l'ethnologie historique ou contemporaine et faire découvrir tant de figures étonnantes ou touchantes comme Anta, Toinou, Sylvère et comme cette maman vendéenne de Michel Ragon.
Lien : http://www.etpourquoidonc.fr/
Je me suis ennuyée à lire ce livre que je voulais sans cesse abandonner, mais qui me retenait malgré tout grâce à de jolies phrases poétiques, des images familiales pleines de tendresse, que l'auteur nous fait partager, liées au souvenir de ses parents et notamment de sa mère.
Sa volonté d'informer, de transmettre des connaissances sur une époque, celle de ses parents, sur le monde paysan, l'histoire de la Vendée, les longues pages descriptives m'ont bien souvent lassée au cours de ma lecture.
J'ai aimé le trop court chapitre où l'auteur décrit les quelques photos qu'il possède de sa mère.
Sa volonté d'informer, de transmettre des connaissances sur une époque, celle de ses parents, sur le monde paysan, l'histoire de la Vendée, les longues pages descriptives m'ont bien souvent lassée au cours de ma lecture.
J'ai aimé le trop court chapitre où l'auteur décrit les quelques photos qu'il possède de sa mère.
D'une voix entendue au téléphone en passant par l'histoire de la Vendée, sociale et linguistique, Michel Ragon nous fait part de son questionnement sur la distinction langue académique/patois, nous rappelant que les patois sont des langues à part entière et qu'ils ont une histoire. Vouloir à tout prix cacher ses origines, renoncer à sa langue maternelle, c'est renoncer à une part de soi. La langue de Michel Ragon et de sa mère, à qui il rend hommage dans ce livre, est celle de Rabelais mais aussi la langue toujours parlée en Acadie, région canadienne constituée de vendéens qui ont fait perdurer le patois. Récit très riche sur les codes sociaux, la distinction et les jugements qui sont faits quant aux usages de la langue française.
Dommage il ne parle pas de la part grandissante du numérique dans l'architecture et des plateformes comme Archidvisor (www.archidvisor.com)
Lien : https://www.archidvisor.com
Lien : https://www.archidvisor.com
Un livre passionnant, largement illustré, sur des lieux passionnants et chargés de départs, de retours et de drames....du stricte point de vue architectural, cela va de soit.
Un beau travail.
Un beau travail.
Essai qui s'avère très agréable à lire. Le début laisse présager beaucoup de réponses qui resteront pour certaines d'entre elles en suspend. Dommage.
Néanmoins je recommande la lecture qui, si elle n'est pas parfaite, regorge d'intérêt.
Néanmoins je recommande la lecture qui, si elle n'est pas parfaite, regorge d'intérêt.
J'ai emprunté ce livre dans le milieu des années 90 édité alors par Berger-Levrault et je m'en souviens toujours ! Excellent, bien illustré, très accessible et passionnant sur l'histoire des villes depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours. Un must-have pour ceux qui s'intéressent au sujet.
Connaissant Michel Ragon plutôt pour ses ouvrages sur l'architecture, j'ai été surpris de découvrir ce récit de voyage ; un voyage de plusieurs semaines effectué en 1957.
L'auteur raconte avec objectivité, "d'ailleurs toujours relative" précise-t-il, ce séjour. Avec aussi un ton assez sarcastique, nullement déplaisant. Il décrit la ville de Tokyo, les comportements de ses habitants, la place faite aux femmes, évoque brièvement les eta (les burakumin groupe social discriminé), les habitudes prises suite à l'occupation américaine. Analysant les dernières décennies de l'histoire japonaise, il pointe notamment l'incompréhension qui persiste entre les pays occidentaux et le Japon sur qui "on s'est toujours trompé".
Ses commentaires sur l'esthétisme (leur art du cérémonial), leur art (les japonismes), la religion ou le suicide, suite aux conversations qu'il a avec hôtes, sont intéressantes. Le long chapitre qu'il consacre à Kyoto montre le grand plaisir et l'intérêt qu'il a eu pour cette ville. De même, se rendant sur Hokkaido il découvre les Aînous - les Peaux-rouges blancs du Japon- et leur discrimination. Bien que publié il y a soixante ans, ces notes de voyage sont bien plaisantes à lire.
L'auteur raconte avec objectivité, "d'ailleurs toujours relative" précise-t-il, ce séjour. Avec aussi un ton assez sarcastique, nullement déplaisant. Il décrit la ville de Tokyo, les comportements de ses habitants, la place faite aux femmes, évoque brièvement les eta (les burakumin groupe social discriminé), les habitudes prises suite à l'occupation américaine. Analysant les dernières décennies de l'histoire japonaise, il pointe notamment l'incompréhension qui persiste entre les pays occidentaux et le Japon sur qui "on s'est toujours trompé".
Ses commentaires sur l'esthétisme (leur art du cérémonial), leur art (les japonismes), la religion ou le suicide, suite aux conversations qu'il a avec hôtes, sont intéressantes. Le long chapitre qu'il consacre à Kyoto montre le grand plaisir et l'intérêt qu'il a eu pour cette ville. De même, se rendant sur Hokkaido il découvre les Aînous - les Peaux-rouges blancs du Japon- et leur discrimination. Bien que publié il y a soixante ans, ces notes de voyage sont bien plaisantes à lire.
L’histoire de Gustave et ses enfants de date pas d’hier et pourtant j’ai rencontré des familles qui vivaient encore comme ça en Lozère, il n’y a pas si longtemps. Même en Bretagne où je vis maintenant il y a une ferme tenue par une femme et son fils où il y a encore de la terre battue en guise de sol. Je n’ose parler de leur peur de l’étranger (un étranger est une personne qui n’est pas originaire du village ou du hameau), de leur peur de se faire voler leur travail, leurs terres. Bref, vieux ou pas ce sont des gens qui vivent dans la peur des autres. Alors quand le fils de Gustave rentre avec sa femme noire, on ne peut pas dire qu’ils sont bien accueillis par le reste de la famille. La ferme est trop petite pour eux tous mais ils font avec. C’est histoire d’une vie de paysans aimant leur terre sans pouvoir aimer les autres, vivant presque en reclus, mais profitant de leur campagne. Je ne sais pas ce qui m‘a pris de choisir ce livre mais je ne regrette pas cette lecture agréable malgré la campagne et ses habitants.
Lien : http://pyrouette.canalblog.c..
Lien : http://pyrouette.canalblog.c..
En Vendée, au début de l’autre siècle, trois personnes vivent ou plutôt survivent dans une modeste ferme isolée : le vieux Gustave, 80 ans, Alfred, son fils qui assure la majorité des travaux et son épouse Emilie, malade de la poitrine. La première femme d’Alfred et celle de Gustave sont mortes de la tuberculose. Les enfants d’Alfred ont très tôt été placés dans des fermes alentour. Quant à Ernest le fils cadet, il est parti très tôt puis s’est engagé dans la Coloniale. Un jour, le voilà qui débarque à la ferme avec des galons de sergent, une petite pension et une compagne du plus bel ébène prénommée Aïcha… Quel accueil recevront-ils ?
« La ferme d’en haut » est un roman de terroir comme savait si bien en écrire le très regretté Michel Ragon. L’intrigue est intéressante et fait bien écho aux problématiques actuelles. Cette cohabitation tout à fait étrange pour l’époque est parfaitement et subtilement décrite. Elle pose le problème du racisme, de l’incompréhension d’une petite communauté surprise dans ses habitudes. Sans révéler la montée des tensions ni la réalité du drame final, le lecteur remarquera la légèreté et le doigté de l’auteur qui, de manière intelligente, se contente de décrire situations et sentiments sans prendre parti ni délivrer le moindre prêchi-prêcha politiquement correct. À chacun de tirer ses conclusions. Lecture agréable. Style minimaliste comme on les aime. Un bon Ragon, sans doute pas le meilleur.
Lien : http://www.bernardviallet.fr
« La ferme d’en haut » est un roman de terroir comme savait si bien en écrire le très regretté Michel Ragon. L’intrigue est intéressante et fait bien écho aux problématiques actuelles. Cette cohabitation tout à fait étrange pour l’époque est parfaitement et subtilement décrite. Elle pose le problème du racisme, de l’incompréhension d’une petite communauté surprise dans ses habitudes. Sans révéler la montée des tensions ni la réalité du drame final, le lecteur remarquera la légèreté et le doigté de l’auteur qui, de manière intelligente, se contente de décrire situations et sentiments sans prendre parti ni délivrer le moindre prêchi-prêcha politiquement correct. À chacun de tirer ses conclusions. Lecture agréable. Style minimaliste comme on les aime. Un bon Ragon, sans doute pas le meilleur.
Lien : http://www.bernardviallet.fr
Gustave est un personnage attachant qui finalement revoit sa façon d'appréhender le monde et le changement de celui-ci. Le passage des générations est parfois bien difficile.
Par des mots simples et un style dépouillé, Michel Ragon nous emmène dans un huis-clos familial dans le monde de la paysannerie vendéenne.
Dans les années 30, l'arrivée d'une "nouère" venue d'Afrique avec le fils cadet de la ferme n'est pas banale, elle provoque rumeurs et méfiance chez les campagnards dont les mentalités sont encore empreintes de superstition.
C'est un roman court, agréable, et accessible à tous.
Dans les années 30, l'arrivée d'une "nouère" venue d'Afrique avec le fils cadet de la ferme n'est pas banale, elle provoque rumeurs et méfiance chez les campagnards dont les mentalités sont encore empreintes de superstition.
C'est un roman court, agréable, et accessible à tous.
Un beau texte sur la nature (comme les romans de Giono ?) à la langue poétique, imagée et rythmée de quelques refrains.
Sur une année, avec un chapitre par mois qui marque les saisons à la ferme, l'auteur raconte le retour des colonies d'un fils parti il y a 20 ans et que son père et son frère qui a repris la ferme avec sa femme n'attendaient pas...
Non seulement le militaire revient d'Afrique pour vivre à la ferme sans l'intention d'y travailler mais en plus il y amène sa femme, Aïcha, qui est "bien trop nouère".
La ferme d'en haut est isolée alors on reste sur les interactions entre le vieil homme et ses fils avec les deux belles-filles. Aïcha porte un regard ébloui d'enfant qui découvre la richesse d'un pays tempéré... et s'attire le respect par sa force de travail et son éternelle bonne humeur... tout en titillant les hommes de la maison par son innocente sensualité.
Le deuxième thème est finalement la nostalgie et l'impossible retour au pays de celui qui a goûté à l'Afrique. Un roman curieux et beau.
Sur une année, avec un chapitre par mois qui marque les saisons à la ferme, l'auteur raconte le retour des colonies d'un fils parti il y a 20 ans et que son père et son frère qui a repris la ferme avec sa femme n'attendaient pas...
Non seulement le militaire revient d'Afrique pour vivre à la ferme sans l'intention d'y travailler mais en plus il y amène sa femme, Aïcha, qui est "bien trop nouère".
La ferme d'en haut est isolée alors on reste sur les interactions entre le vieil homme et ses fils avec les deux belles-filles. Aïcha porte un regard ébloui d'enfant qui découvre la richesse d'un pays tempéré... et s'attire le respect par sa force de travail et son éternelle bonne humeur... tout en titillant les hommes de la maison par son innocente sensualité.
Le deuxième thème est finalement la nostalgie et l'impossible retour au pays de celui qui a goûté à l'Afrique. Un roman curieux et beau.
Acheté dans une ressourcerie du Gard parce que j'avais déjà lu Michel Ragon ("La mémoire des vaincus" et" Georges et Louise") "La louve de Mervent"m'a éclairé sur une période que je connais mal:les guerres de Vendée, la Chouannerie et cette période post-napoleonnienne.
Les guerres de Vendée ,ce sont ces "pésans" qui combattent le roi en place Louis XVIII pour en mettre un autre Henri V via la régence de la Duchesse de Berry.....De 1832 à 1836 ,les chouans disparaitront spasmodiquement de la forêt qui les abrite.Et c'est justement cette forêt là si bien décrite par Michel Ragon qui m'a séduit dans ce récit historique.J'ai aussi apprécié la description de la vie quotidienne de cette paysannerie vendéenne.Tête de Loup et sa compagne la Louve de Mervent forme un couple de hors-la loi sympathique et inoubliable.
Les guerres de Vendée ,ce sont ces "pésans" qui combattent le roi en place Louis XVIII pour en mettre un autre Henri V via la régence de la Duchesse de Berry.....De 1832 à 1836 ,les chouans disparaitront spasmodiquement de la forêt qui les abrite.Et c'est justement cette forêt là si bien décrite par Michel Ragon qui m'a séduit dans ce récit historique.J'ai aussi apprécié la description de la vie quotidienne de cette paysannerie vendéenne.Tête de Loup et sa compagne la Louve de Mervent forme un couple de hors-la loi sympathique et inoubliable.
Une plongée dans l’insurrection vendéenne de 1832. Car oui, peu de gens le savent, mais il y eut plusieurs guerres de Vendée. La grande, en 1793, puis les petites. Celle-ci fut la dernière. Dirigée contre Louis-Philippe et la monarchie de Juillet, elle fut déclenchée par Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, dite « la duchesse de Berry », belle-fille de Charles X. Une tentative ratée, mal conçue, organisée avec un amateurisme total, de mettre sur le trône son fils, Henri d’Artois, dernier des Bourbons directs.
Concrètement, le livre fait suite aux ‘Mouchoirs rouges de Cholet’, ayant lui pour cadre l’insurrection de 1793. Le personnage principal n’y était encore qu’un enfant, né d’une femme violée par un hussard républicain, recueilli et élevé comme son fils par l’un des survivants. Maintenant, il est adulte, et a développé un étrange pouvoir : c’est un « meneur de loup ». On touche là à un mythe particulièrement ancien, qu’on rencontrait encore dans nos campagnes il n’y a pas si longtemps.
Surnommé Tête-de-loup – parce qu’en plus de s’en faire obéir il leur ressemble – le héros se joint à l’insurrection. Par tradition familiale d’un part. Et puis, comme toutes les révoltes, c’est l’occasion de régler ses comptes avec le meunier arnaqueur, le créancier, le hobereau cherchant à racheter ses terres par des moyens peu honnêtes… Mais en quelques escarmouches c’est la débâcle. Reste la forêt, asile de toujours des proscrits…
Roman très bien écrit et agréable à lire sur un évènement oublié de l’histoire de France. Il vous fera également découvrir l’existence de la discrète Petite Église de Vendée, qui fit dissidence de la grande…
Concrètement, le livre fait suite aux ‘Mouchoirs rouges de Cholet’, ayant lui pour cadre l’insurrection de 1793. Le personnage principal n’y était encore qu’un enfant, né d’une femme violée par un hussard républicain, recueilli et élevé comme son fils par l’un des survivants. Maintenant, il est adulte, et a développé un étrange pouvoir : c’est un « meneur de loup ». On touche là à un mythe particulièrement ancien, qu’on rencontrait encore dans nos campagnes il n’y a pas si longtemps.
Surnommé Tête-de-loup – parce qu’en plus de s’en faire obéir il leur ressemble – le héros se joint à l’insurrection. Par tradition familiale d’un part. Et puis, comme toutes les révoltes, c’est l’occasion de régler ses comptes avec le meunier arnaqueur, le créancier, le hobereau cherchant à racheter ses terres par des moyens peu honnêtes… Mais en quelques escarmouches c’est la débâcle. Reste la forêt, asile de toujours des proscrits…
Roman très bien écrit et agréable à lire sur un évènement oublié de l’histoire de France. Il vous fera également découvrir l’existence de la discrète Petite Église de Vendée, qui fit dissidence de la grande…
Ce livre est intéressant et apporte de nombreuses informations sur le Paris militant d'avant la première guerre mondiale, ainsi que sur la révolution russe. Cependant après l'aventure soviétique de Fred, la narration reste la même, mais simplement dans d'autres environnements ce qui devient pesant au fil des pages et rend la seconde partie du roman de plus en plus monotone malgré les multiples péripéties.
Alfred BARTHELEMY est un gamin des rues. Dans le Paris d'avant la Grande Guerre, la curiosité quide ses pas vers son premier amour – indélébile – et sa destinée : la Liberté. Des amours, il y en aura d'autres, mais de Liberté il n'y en a qu'une et Fred aura la chance dans son entourage de compter parmi les plus éminents penseurs et révolutionnaires de son temps.
A travers les époques et l'Europe, Fred sera tantôt sur le front, tantôt à l'usine. Tantôt en Russie, tantôt en Espagne; puis à nouveau, flirtera avec les pavés de la capitale pour y investir les quais de ses brochures et de ses livres, dernières traces d'une vie aussi inimaginable qu’insoupçonnée.
Michel RAGON signe avec ce roman un trésor de fresque historique sur fond populaire empreint d'Anarchisme. Magistralement structuré autour des évènements marquants du XXème siècle, Fred nous immerge depuis l'intérieur auprès des syndicats ouvriers, du Polit Buro, des révolutionnaires Espagnoles… On y croise un nombre impressionnant de penseurs et révolutionnaires comme Kropotkine, Lénine, Makhno ou encore Durruti qui permettent d'appréhender l'Histoire Sociale et les divers courants de pensée de l'époque avec une vision qui tient presque de la première main tant l’érudition de l’auteur donne vie à l’ouvrage, créant l’illusion que Fred BARTHELEMY a réellement foulé cette Terre.
Je ne peux m'étendre plus sur cet excellent ouvrage dont la lecture a été un plaisir que j'aimerai vous laisser intact. A mi-chemin entre Roman et leçon d'Histoire, lire La Mémoire Des Vaincus c'est inévitablement prendre une claque face aux dévouement de certains hommes pour la Liberté.
En revisitant les évènements à travers les yeux de Fred, c'est tout un pan caché de l'Histoire du XXème siècle qui dévoile sa complexité et offre ses lettres de noblesse à la Philosophie Anarchiste, par trop méconnue et dévoyée.
Une pépite.
A travers les époques et l'Europe, Fred sera tantôt sur le front, tantôt à l'usine. Tantôt en Russie, tantôt en Espagne; puis à nouveau, flirtera avec les pavés de la capitale pour y investir les quais de ses brochures et de ses livres, dernières traces d'une vie aussi inimaginable qu’insoupçonnée.
Michel RAGON signe avec ce roman un trésor de fresque historique sur fond populaire empreint d'Anarchisme. Magistralement structuré autour des évènements marquants du XXème siècle, Fred nous immerge depuis l'intérieur auprès des syndicats ouvriers, du Polit Buro, des révolutionnaires Espagnoles… On y croise un nombre impressionnant de penseurs et révolutionnaires comme Kropotkine, Lénine, Makhno ou encore Durruti qui permettent d'appréhender l'Histoire Sociale et les divers courants de pensée de l'époque avec une vision qui tient presque de la première main tant l’érudition de l’auteur donne vie à l’ouvrage, créant l’illusion que Fred BARTHELEMY a réellement foulé cette Terre.
Je ne peux m'étendre plus sur cet excellent ouvrage dont la lecture a été un plaisir que j'aimerai vous laisser intact. A mi-chemin entre Roman et leçon d'Histoire, lire La Mémoire Des Vaincus c'est inévitablement prendre une claque face aux dévouement de certains hommes pour la Liberté.
En revisitant les évènements à travers les yeux de Fred, c'est tout un pan caché de l'Histoire du XXème siècle qui dévoile sa complexité et offre ses lettres de noblesse à la Philosophie Anarchiste, par trop méconnue et dévoyée.
Une pépite.
C'est le type de roman qui se fait passer pour une biographie afin de dépeindre un milieu, ici l'anarchisme français du 20e siècle. De la bande à Bonnot de la Belle Epoque aux soubresauts de mai 68, on suit Fred dans son apprentissage de la vie et de la politique jusqu'à Moscou et Barcelone. S'il est toujours délicat de discerner le réel du fictif dans ce type d'ouvrage, j'ai l'impression qu'il transmet néanmoins l'ambiance qui animait une partie de la gauche française entre 1910 et 1960.
L'écriture est agréable à suivre, les portraits de personnalités sont bien brossés et les anonymes assez dynamiques pour faire le lien sans temps mort.
L'écriture est agréable à suivre, les portraits de personnalités sont bien brossés et les anonymes assez dynamiques pour faire le lien sans temps mort.
Une formidable aventure littéraire qui ouvre la porte a beaucoup de connaissances et lectures potentielles!
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Michel Ragon
Lecteurs de Michel Ragon (1068)Voir plus
Quiz
Voir plus
LOGIQUE ET AMUSANT (LE RETOUR)
Je suis dans le noir complet, dans une pièce où se trouve une commode contenant des chaussettes. Celles-ci sont seulement bleues ou roses. Quel est le nombre minimum de chaussettes que je dois prendre (dans l'obscurité totale) afin d'être certain de me retrouver dehors avec une paire de chaussettes de la même couleur ?
2
3
4
7 questions
680 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur680 lecteurs ont répondu