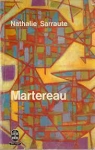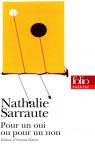Critiques de Nathalie Sarraute (279)
Dans ce texte Nathalie Sarraute fait resurgir ses émotions, sensations et impressions d'enfance pour ébaucher sous un angle tout à fait particulier son auto-portrait en petite fille.
C'est assez inattendu. L'image fragmentée donne l'impression de regarder un dessin à la façon de Picasso. En début de lecture j'ai été déconcertée par ce style quasiment cubiste avec ses différents points de vue et le morcellement de la narration. Puis je me suis habituée pour finalement apprécier cette itinérance dans les souvenirs de la petite Natacha. Je l'ai découverte avec gourmandise, à petite dose, comme en grignotant une petite madeleine que l'on laisse fondre sur la langue pour bien en savourer le goût . Ce goût ineffable de l'enfance à la saveur douce-amère que l'on garde tous en bouche, qui s'estompe avec le temps mais que l'on aimerait pouvoir raviver éternellement. Un prodige que seule la littérature peut accomplir...
Nathalie Sarraute qui a découvert très tôt le pouvoir des mots, nous livre ici une émouvante démonstration de leur puissance aussi bien enchanteresse que maléfique.
C'est assez inattendu. L'image fragmentée donne l'impression de regarder un dessin à la façon de Picasso. En début de lecture j'ai été déconcertée par ce style quasiment cubiste avec ses différents points de vue et le morcellement de la narration. Puis je me suis habituée pour finalement apprécier cette itinérance dans les souvenirs de la petite Natacha. Je l'ai découverte avec gourmandise, à petite dose, comme en grignotant une petite madeleine que l'on laisse fondre sur la langue pour bien en savourer le goût . Ce goût ineffable de l'enfance à la saveur douce-amère que l'on garde tous en bouche, qui s'estompe avec le temps mais que l'on aimerait pouvoir raviver éternellement. Un prodige que seule la littérature peut accomplir...
Nathalie Sarraute qui a découvert très tôt le pouvoir des mots, nous livre ici une émouvante démonstration de leur puissance aussi bien enchanteresse que maléfique.
Sans surprise, après le Silence et le Mensonge, Nathalie Sarraute a continué à explorer la question du tropisme et donc, de ce que qui ne peut pas se dire, dans cette troisième pièce. Troisième variation sur un même thème.
Isma, ce titre possède une sonorité qui fait penser évidemment à un prénom de femme, et qui ne dévoilera sa signification qu'à la fin de la pièce. En passant, merci donc pour le divulgâchage de la quatrième de couverture en Folio, repris ici et là : le fait qu'on n'en vienne que très lentement et très tardivement à ce titre, Isma, revêt une grande importance ; pourquoi l'éditeur fait-il le choix de tout lâcher dès le départ ??? Bref. Dans Isma, huit hommes et femmes reviennent peut-être d'une exposition, ou y sont encore, dont un couple central appelé ELLE et LUI, les autres couples étant identifiés comme F.1, H.2, etc, etc. H.1 reproche à LUI, en particulier, de s'être moqué, plus exactement d'avoir dénigré, un cinquième couple, absent : les Dubuit. Il est décidé qu'on arrêtera les moqueries et que la conversation s'orientera vers des sujets, disons, convenables. Mais le sujet des Dubuit traîne dans toutes les têtes, excepté dans celle de H.1, et rien n'amuse tant la galerie que d'entendre ELLE et LUI continuer leur entreprise de démolition. H.1 se retire du groupe, qui se ressoude d'autant mieux pour parler à foison des Dubuit.
Je ne partage que moyennement l'analyse d'Arnaud Rykner dans le volume de la Pléiade consacré à Nathalie Sarraute (oui, je suis prétentieuse à ce point !) Lui y voit avant tout une bacchanale, donc une référence à Dyonysos, donc une réflexion sur le théâtre - même s'il n'écrit pas clairement le mot méta-théâtre, il est question de ça pour lui. Or, si effectivement la relance dans le groupe du sujet des Dubuit provoque une orgie d'anecdotes plus délirantes les unes que les autres - et Rykner a effectivement raison de noter que les références à la nourriture et à la dévoration sont récurrentes -, il ne me semble pas que ce soit le plus marquant dans la pièce, ni l'essentiel. Tous les personnages vont se laisser aller sans vergogne, se délecter des anecdotes sur les Dubuit, tous vont s'abandonner à inventer des histoires sorties de nulle part à propos des Dubuit, oui. Mais tous... sauf ELLE et LUI. Là où tous les autres personnages croient voir un groupe uni dans un même élan fantasmatique, qui leur sert visiblement d'exutoire, ELLE et LUI ressentent une coupure nette, qui les séparent des autres. Eux n'éprouvent pas le même plaisir. On voit tout de suite que les histoires que les uns et les autres inventent sur les Dubuit sont le fruit de leur propre refoulement et n'a rien à faire avec ce qui dérange ELLE et LUI. Parce que, évidemment, comme on est chez Sarraute, il y a bien quelque chose qui les dérange. Mais ils n'en parlent pas, et on comprend qu'avant le début de la pièce, ils ont passé leur temps à se moquer des Dubuit sans jamais parler de ce petit truc qui les travaille incessamment, sans doute depuis des mois ou des années.
Par conséquent, rupture il y a bien entre ELLE et LUI et le reste du groupe. Chacun veut faire dire à ELLE et LUI pourquoi ils se moquent des Dubuit, quelle est la raison profonde de leur aversion, de leur rancoeur, de leur jalousie, de tout ce qu'on veut. D'où la flopée d'anecdotes inventées par le groupe sur les Dubuit : tous cherchent pourquoi ELLE et LUI ont pris les Dubuit pour cible. Il faut au groupe une bonne raison, une raison claire et nette, une raison qu'on puisse classifier. Et on en revient donc à un sujet qui est au centre des préoccupations de Sarraute. ELLE et LUI ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se moquent des DUBUIT, que d'ailleurs ils aiment bien. Au fond d'eux, il y a une minuscule petite chose qu'ils ne peuvent pas nommer, du moins surtout pas en public, et qui ne rentre dans aucune catégorie. Sarraute en profite d'ailleurs pour fustiger la psychanalyse - pas forcément de manière très fine -, parce qu'elle déteste l'idée de tout ranger dans des cases. le coeur du problème est en tout cas ici : ELLE et LUI ne peuvent pas dire aux autres ce qui les taraude, mais les autres veulent absolument savoir, ils veulent entendre dire ce qui est indicible. Et ils vont donc travailler au corps ELLE et LUI jusqu'à ce qu'ils lâchent le morceau. Et jusqu'à ce que le morceau en question ne leur convienne pas du tout, puisque la petite chose qui taraude ELLE et LUI n'est pas de l'ordre du raisonnable. Ils ne détestent pas les Dubuit, les Dubuit n'ont pas commis de meurtre, les Dubuit n'ont pas le nez ou les oreilles curieusement et détestablement formés, etc., etc. le tropisme - puisqu'il faut bien lâcher le mot -, cette petite chose apparemment insignifiante et enfouie, ne se dit pas. Il résiste à l'analyse. Il ne renter pas dans une catégorie. Ce qui fait de ELLE et LUI, et non plus des Dubuit, un couple de parias...
Challenge Théâtre 2018-2019
Isma, ce titre possède une sonorité qui fait penser évidemment à un prénom de femme, et qui ne dévoilera sa signification qu'à la fin de la pièce. En passant, merci donc pour le divulgâchage de la quatrième de couverture en Folio, repris ici et là : le fait qu'on n'en vienne que très lentement et très tardivement à ce titre, Isma, revêt une grande importance ; pourquoi l'éditeur fait-il le choix de tout lâcher dès le départ ??? Bref. Dans Isma, huit hommes et femmes reviennent peut-être d'une exposition, ou y sont encore, dont un couple central appelé ELLE et LUI, les autres couples étant identifiés comme F.1, H.2, etc, etc. H.1 reproche à LUI, en particulier, de s'être moqué, plus exactement d'avoir dénigré, un cinquième couple, absent : les Dubuit. Il est décidé qu'on arrêtera les moqueries et que la conversation s'orientera vers des sujets, disons, convenables. Mais le sujet des Dubuit traîne dans toutes les têtes, excepté dans celle de H.1, et rien n'amuse tant la galerie que d'entendre ELLE et LUI continuer leur entreprise de démolition. H.1 se retire du groupe, qui se ressoude d'autant mieux pour parler à foison des Dubuit.
Je ne partage que moyennement l'analyse d'Arnaud Rykner dans le volume de la Pléiade consacré à Nathalie Sarraute (oui, je suis prétentieuse à ce point !) Lui y voit avant tout une bacchanale, donc une référence à Dyonysos, donc une réflexion sur le théâtre - même s'il n'écrit pas clairement le mot méta-théâtre, il est question de ça pour lui. Or, si effectivement la relance dans le groupe du sujet des Dubuit provoque une orgie d'anecdotes plus délirantes les unes que les autres - et Rykner a effectivement raison de noter que les références à la nourriture et à la dévoration sont récurrentes -, il ne me semble pas que ce soit le plus marquant dans la pièce, ni l'essentiel. Tous les personnages vont se laisser aller sans vergogne, se délecter des anecdotes sur les Dubuit, tous vont s'abandonner à inventer des histoires sorties de nulle part à propos des Dubuit, oui. Mais tous... sauf ELLE et LUI. Là où tous les autres personnages croient voir un groupe uni dans un même élan fantasmatique, qui leur sert visiblement d'exutoire, ELLE et LUI ressentent une coupure nette, qui les séparent des autres. Eux n'éprouvent pas le même plaisir. On voit tout de suite que les histoires que les uns et les autres inventent sur les Dubuit sont le fruit de leur propre refoulement et n'a rien à faire avec ce qui dérange ELLE et LUI. Parce que, évidemment, comme on est chez Sarraute, il y a bien quelque chose qui les dérange. Mais ils n'en parlent pas, et on comprend qu'avant le début de la pièce, ils ont passé leur temps à se moquer des Dubuit sans jamais parler de ce petit truc qui les travaille incessamment, sans doute depuis des mois ou des années.
Par conséquent, rupture il y a bien entre ELLE et LUI et le reste du groupe. Chacun veut faire dire à ELLE et LUI pourquoi ils se moquent des Dubuit, quelle est la raison profonde de leur aversion, de leur rancoeur, de leur jalousie, de tout ce qu'on veut. D'où la flopée d'anecdotes inventées par le groupe sur les Dubuit : tous cherchent pourquoi ELLE et LUI ont pris les Dubuit pour cible. Il faut au groupe une bonne raison, une raison claire et nette, une raison qu'on puisse classifier. Et on en revient donc à un sujet qui est au centre des préoccupations de Sarraute. ELLE et LUI ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se moquent des DUBUIT, que d'ailleurs ils aiment bien. Au fond d'eux, il y a une minuscule petite chose qu'ils ne peuvent pas nommer, du moins surtout pas en public, et qui ne rentre dans aucune catégorie. Sarraute en profite d'ailleurs pour fustiger la psychanalyse - pas forcément de manière très fine -, parce qu'elle déteste l'idée de tout ranger dans des cases. le coeur du problème est en tout cas ici : ELLE et LUI ne peuvent pas dire aux autres ce qui les taraude, mais les autres veulent absolument savoir, ils veulent entendre dire ce qui est indicible. Et ils vont donc travailler au corps ELLE et LUI jusqu'à ce qu'ils lâchent le morceau. Et jusqu'à ce que le morceau en question ne leur convienne pas du tout, puisque la petite chose qui taraude ELLE et LUI n'est pas de l'ordre du raisonnable. Ils ne détestent pas les Dubuit, les Dubuit n'ont pas commis de meurtre, les Dubuit n'ont pas le nez ou les oreilles curieusement et détestablement formés, etc., etc. le tropisme - puisqu'il faut bien lâcher le mot -, cette petite chose apparemment insignifiante et enfouie, ne se dit pas. Il résiste à l'analyse. Il ne renter pas dans une catégorie. Ce qui fait de ELLE et LUI, et non plus des Dubuit, un couple de parias...
Challenge Théâtre 2018-2019
Je poursuis mon exploration de Nathalie Sarraute avec un livre glané au hasard des étagères chez un bouquiniste.
Disent les imbéciles demande des pré-requis pour être un tant soit peu élucidé, effleuré plutôt. Je ne dirai pas l'avoir compris ; j'ai entraperçu des lueurs, eu des intuitions, ressenti des frémissements, pensé rejoindre furtivement la pensée de l'autrice, grâce à ce que je crois avoir retenu de mes précédentes lectures. Entrer directement dans ce livre ne me parait pas envisageable, il ne permet pas de se familiariser avec elle.
De quoi parle-t-on ici ? Pas de récit, pas de trame narrative, pas de personnages, mais plutôt des moments, des dialogues, des mots jetés en pâture, et beaucoup d'expressions, des expressions idiomatiques, toutes faites, qui ordonnancent le langage, tout en le dévitalisant, des expressions vides de sens qu'on s'envoie à la figure pour marquer sa supériorité, derrière lesquelles on se réfugie, on se cache aussi.
Cela commence par une scène familiale, des petits-enfants entourant, chérissant une grand-mère. Comme elle est mignonne, disent-ils ! Mais bientôt la situation dérape, l'un d'entre eux étant mis à l'écart. Il est jaloux et la grand-mère n'est peut-être pas aussi mignonne que cela. Nous la quittons pour nous retrouver auprès d'un grand Maître, inventeur d'une idée, bardé de certitudes, prompt à défendre ses positions contre les imbéciles.
Sarraute organise sa pensée autour de deux plans. Le premier est celui des sensations, des réactions primaires, des éléments inconscients à la base des comportements. C'est la notion de Tropismes qu'elle traque tout au long de son oeuvre. Nous sommes dans le domaine des pulsions, du non-dit, de l'informel, de l'indicible, en amont du langage, de l'identité, du moi structuré, à la racine des émotions et des perceptions. Sa démarche est alors proche de celle de Virginia Woolf en quête elle aussi des vibrations des instants de vie. Elle tend à aller au coeur de l'intimité et de l'authenticité des êtres dépouillés des carcans institutionnels et collectifs.
Le deuxième plan est celui du langage, le langage qui enferme les individus, contraint et déforme la communication, catégorise, confère des assignations, des rôles en fonction de représentations sociales, assoie les relations de domination entre les puissants et les imbéciles, les hommes et les femmes.
Nous comprenons que le mépris nourri par Nathalie Sarraute à l'égard du langage et des mots l'ait éloignée de la théorie psychanalytique. Elle poursuit le même but mais souhaite emprunter une autre voie, ce qui est paradoxal puisque les mots sont son instrument de travail.
Avec ce livre exigeant, difficile d'accès, j'ai eu l'impression de faire un petit bout de chemin avec cette passionnante autrice.
Nathalie Sarraute nous le confirme, l’enfance s’arrête le jour de l’entrée au lycée. Après cette étape de la vie, les souvenirs perdent de leurs spontanéité et naïveté. Ils s’imbibent des influences externes comme le buvard de l’encre sur la page écrite à la plume.
A 80 ans passés, Nathalie Sarraute ressent la nécessité figer sur le papier ce qui lui reste de ses souvenirs enfouis sous la « couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs blanchâtres, molles, ouatées qui se défont, qui disparaissent avec l’enfance… ». Une façon de les cristalliser pour … pour qui, pourquoi d’ailleurs ?
Sans doute pour faire connaître à qui s’intéresse à cette auteure ce qui a pu faire germer et fertiliser l’œuvre qu’elle abandonne à la postérité. Enfance est un ouvrage qui ne présente à mes yeux d’intérêt que pour approfondir sa connaissance d’une auteure qu’on a pu apprécier à la lecture de son œuvre. Un ouvrage qui met bout à bout des séquences de la prime jeunesse de son auteure, séquences certes fondatrices de la personne, mais qui ne présentent pas grand intérêt à qui fait du vagabondage littéraire et une incursion fugitive dans la bibliographie d'un auteur.
Le grand garçon que je suis doit confesser n’avoir pas été passionné par les histoires de petites filles que Nathalie Sarraute relate dans cet ouvrage bien nommé, même si le procédé narratif est original et l’écriture agréable. Je pense qu’il ne faut pas faire connaissance avec l’œuvre de Nathalie Sarraute avec cet ouvrage. Il doit en revanche trouver tout son intérêt en éclairage sur les sources d’inspiration qui ont pu être à l’origine de tel ou tel autre ouvrage de son œuvre.
A 80 ans passés, Nathalie Sarraute ressent la nécessité figer sur le papier ce qui lui reste de ses souvenirs enfouis sous la « couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs blanchâtres, molles, ouatées qui se défont, qui disparaissent avec l’enfance… ». Une façon de les cristalliser pour … pour qui, pourquoi d’ailleurs ?
Sans doute pour faire connaître à qui s’intéresse à cette auteure ce qui a pu faire germer et fertiliser l’œuvre qu’elle abandonne à la postérité. Enfance est un ouvrage qui ne présente à mes yeux d’intérêt que pour approfondir sa connaissance d’une auteure qu’on a pu apprécier à la lecture de son œuvre. Un ouvrage qui met bout à bout des séquences de la prime jeunesse de son auteure, séquences certes fondatrices de la personne, mais qui ne présentent pas grand intérêt à qui fait du vagabondage littéraire et une incursion fugitive dans la bibliographie d'un auteur.
Le grand garçon que je suis doit confesser n’avoir pas été passionné par les histoires de petites filles que Nathalie Sarraute relate dans cet ouvrage bien nommé, même si le procédé narratif est original et l’écriture agréable. Je pense qu’il ne faut pas faire connaissance avec l’œuvre de Nathalie Sarraute avec cet ouvrage. Il doit en revanche trouver tout son intérêt en éclairage sur les sources d’inspiration qui ont pu être à l’origine de tel ou tel autre ouvrage de son œuvre.
Les mots me manquent...
Théâtre de Nathalie Sarraute, recueil de pièces plus ou moins courtes, est pour le moins déroutant.
J'ai presque envie de dire que cette œuvre si particulière vient de déconstruire en peu de temps toute l'idée que je me faisais du théâtre.
Les personnages n'en sont pas vraiment. Disons qu'ils sont si anonymes qu'ils pourraient être vous, moi, le quidam qui passe dans la rue. D'ailleurs Nathalie Sarraute ne leur donne pas souvent de nom. Ils sont des couples, des hommes, des femmes sans passé ou presque, sans avenir, sans caractéristique particulière, sans volonté propre. Ils sont le plus souvent identifiés par Lui, Elle ou encore H.1, H.2, H.3 , F.1, F.2, F.3 ...
Les décors sont inexistants. Les lieux se définissent par les dialogues eux-même mais l'auteure ne les précise jamais.
L'histoire qui se déroule est intemporelle mais quand je dis "histoire" , je me fourvoie. Il n'y a pas d'histoire à proprement dit.
Les dialogues partent d'un rien. D'un tout petit rien, les répliques s'emballent, les vérités qui ne veulent pas être dites finissent par fuser, les émotions s'expriment, les regrets, les colères, les rancunes...
Nathalie Sarraute développe l'art du non-dit, des points de suspension à répétition.
Qu'il doit être difficile d'interpréter une de ces pièces pour y mettre toute l'intensité et la profondeur qui existe dans ces silences. Et quand on sait que certaines pièces ont été écrites pour la radio, cela parait un pari encore plus fou !
Plus encore que pour toutes les autres pièces de théâtre que j'ai déjà lues sans les avoir vues, j'ai eu besoin de voir, d'entendre les acteurs. Merci Youtube ! J'ai pu y regarder l'admirable interprétation d'André Dussollier et de Jean-Louis Trintignant de la pièce Pour un oui ou pour un non.
Par leur talent, le texte prend tout son sens !
En me documentant un peu sur Nathalie Sarraute, j'ai pu lire ça et là, qu'elle utilisait le terme de "tropismes" pour évoquer des mouvements instinctifs, déclenchés par la présence des autres ou encore par leurs paroles.
Les pièces qui composent ce recueil sont effectivement un parfait reflet de la complexité des rapports humains régis par une codification sociale, une part importante de non-dits ou de phrases stéréotypées qui peuvent conduire à des comportements parfois étranges et inexpliqués, ou encore à des disputes sans queue ni tête déclenchées pour un oui ou pour un non ...
En conclusion, je dirai qu'il est bien difficile de dire ce qu'on n'a pas envie de dire mais il est encore plus compliqué de le cacher complètement !
Alors ne me faites pas dire que je n'ai pas aimé ce recueil...et on restera bons amis !
Théâtre de Nathalie Sarraute, recueil de pièces plus ou moins courtes, est pour le moins déroutant.
J'ai presque envie de dire que cette œuvre si particulière vient de déconstruire en peu de temps toute l'idée que je me faisais du théâtre.
Les personnages n'en sont pas vraiment. Disons qu'ils sont si anonymes qu'ils pourraient être vous, moi, le quidam qui passe dans la rue. D'ailleurs Nathalie Sarraute ne leur donne pas souvent de nom. Ils sont des couples, des hommes, des femmes sans passé ou presque, sans avenir, sans caractéristique particulière, sans volonté propre. Ils sont le plus souvent identifiés par Lui, Elle ou encore H.1, H.2, H.3 , F.1, F.2, F.3 ...
Les décors sont inexistants. Les lieux se définissent par les dialogues eux-même mais l'auteure ne les précise jamais.
L'histoire qui se déroule est intemporelle mais quand je dis "histoire" , je me fourvoie. Il n'y a pas d'histoire à proprement dit.
Les dialogues partent d'un rien. D'un tout petit rien, les répliques s'emballent, les vérités qui ne veulent pas être dites finissent par fuser, les émotions s'expriment, les regrets, les colères, les rancunes...
Nathalie Sarraute développe l'art du non-dit, des points de suspension à répétition.
Qu'il doit être difficile d'interpréter une de ces pièces pour y mettre toute l'intensité et la profondeur qui existe dans ces silences. Et quand on sait que certaines pièces ont été écrites pour la radio, cela parait un pari encore plus fou !
Plus encore que pour toutes les autres pièces de théâtre que j'ai déjà lues sans les avoir vues, j'ai eu besoin de voir, d'entendre les acteurs. Merci Youtube ! J'ai pu y regarder l'admirable interprétation d'André Dussollier et de Jean-Louis Trintignant de la pièce Pour un oui ou pour un non.
Par leur talent, le texte prend tout son sens !
En me documentant un peu sur Nathalie Sarraute, j'ai pu lire ça et là, qu'elle utilisait le terme de "tropismes" pour évoquer des mouvements instinctifs, déclenchés par la présence des autres ou encore par leurs paroles.
Les pièces qui composent ce recueil sont effectivement un parfait reflet de la complexité des rapports humains régis par une codification sociale, une part importante de non-dits ou de phrases stéréotypées qui peuvent conduire à des comportements parfois étranges et inexpliqués, ou encore à des disputes sans queue ni tête déclenchées pour un oui ou pour un non ...
En conclusion, je dirai qu'il est bien difficile de dire ce qu'on n'a pas envie de dire mais il est encore plus compliqué de le cacher complètement !
Alors ne me faites pas dire que je n'ai pas aimé ce recueil...et on restera bons amis !
Comme toujours dans le théâtre de Nathalie Sarraute, l'argument part d'un petit rien qui se transforme en cataclysme. Entrent sur la scène un certain nombre de personnages, un groupes d'amis, dont on va assez rapidement confondre les prénoms - Simone, Yvonne, Jacques, Jeanne, etc. Il sont en train de parler d'un incident qui a eu lieu dans une soirée d'où ils reviennent tout juste : le dénommé Pierre - un des protagonistes - a surpris une de leurs relations, Madeleine, en flagrant délit de mensonge. Elle s'est ouvertement plainte de l'augmentation des tickets de métro, comme si cela avait un impact important sur son propre budget, alors que tout le monde la sait richissime. Pierre a répliqué en lui faisant remarquer que, pourtant , elle était l'unique héritière du fameux roi de l'acier. Il serait un brin logique que les amis de Pierre reviennent de leur soirée avec des remarques telles que "Ah, vous avez vu la tête de Madeleine ? Ça lui servira de leçon ! " " Elle ne l'avait pas volée, celle-là ! ", etc., etc. Or, pas du tout. C'est Pierre qui va subir le courroux du groupe.
Non pas qu'ils aient spécialement envie de défendre Madeleine. Mais voilà, Pierre a mis les pieds dans le plat, il a commis une bévue : ça ne se fait pas de prendre les gens en délit de mensonge et de leur dire leur fait, même s'ils vous exaspèrent au plus haut point. On les laisse dire. C'est une sorte de contrat social tacite, qui évite les affrontements. Qui évite qu'on soit honnêtes les uns avec les autres, donc, quitte à jouer avec les définitions et à appeler le mensonge "vérité". C'est un contrat social tacite qui repose sur l'hypocrisie. Rompre ce contrat, c'est bouleverser l'ordre des choses. C'est commencer à se poser des questions. Mentir, ne pas mentir, laisser mentir ? Ce n'est pas que certains membres du groupe n'admirent pas le culot de Pierre, mais eux n'oseraient jamais. Et les voilà tous confrontés à différentes visions du mensonge : celle de Pierre, dont Jacques dit qu'il est "une machine à détecter le mensonge", celle de Jeanne, qui dit ne jamais mentir, celle De Robert, qui dit s'amuser des mensonges des autres. Les voilà embourbés dans un flot de questions qu'ils préféraient éviter, et qui cherchent à s'en sortir. Pour y échapper, ils vont donc jouer au "psychodrame", dont fut féru Moreno. Pour apprendre à Jeanne ou à Pierre à faire face à un menteur, par exemple. Robert le cynique jouera le menteur, endossant le rôle d'un ami à eux, menteur patenté. Puis les rôles vont être redistribués, et chacun va soupçonner l'autre de mensonge. Même si on va chercher à faire passer Pierre pour un être déraisonnable - pour le moins -, au final, le psychodrame n'aura aucune vertu thérapeutique. Tout ça prend plutôt l'allure d'un nœud de vipères.
Les dialogues vont peu à peu engluer les protagonistes dans leurs dilemmes, le jeu que jouera Simone s'imposant comme le zénith du drame - ment-elle, ne ment-elle pas, joue-t-elle , ne joue-t-elle pas ? Son "Bon, bon, bien sûr, je jouais..." semble clore l'affaire. Rien n'est moins sûr. Rien n'a jamais été plus confus, si ce n'est que chacun - sauf Pierre, que l'aplomb de Simone laisse tout de même pantois d'admiration - semble vouloir retourner au plus vite à son mode de vie... mensonger, hypocrite, mauvaise langue. Mais sans faux pas, sans dérapage aucun. Ce qui paraît, dès lors, extrêmement compromis.
Challenge Théâtre 2017-2018
Non pas qu'ils aient spécialement envie de défendre Madeleine. Mais voilà, Pierre a mis les pieds dans le plat, il a commis une bévue : ça ne se fait pas de prendre les gens en délit de mensonge et de leur dire leur fait, même s'ils vous exaspèrent au plus haut point. On les laisse dire. C'est une sorte de contrat social tacite, qui évite les affrontements. Qui évite qu'on soit honnêtes les uns avec les autres, donc, quitte à jouer avec les définitions et à appeler le mensonge "vérité". C'est un contrat social tacite qui repose sur l'hypocrisie. Rompre ce contrat, c'est bouleverser l'ordre des choses. C'est commencer à se poser des questions. Mentir, ne pas mentir, laisser mentir ? Ce n'est pas que certains membres du groupe n'admirent pas le culot de Pierre, mais eux n'oseraient jamais. Et les voilà tous confrontés à différentes visions du mensonge : celle de Pierre, dont Jacques dit qu'il est "une machine à détecter le mensonge", celle de Jeanne, qui dit ne jamais mentir, celle De Robert, qui dit s'amuser des mensonges des autres. Les voilà embourbés dans un flot de questions qu'ils préféraient éviter, et qui cherchent à s'en sortir. Pour y échapper, ils vont donc jouer au "psychodrame", dont fut féru Moreno. Pour apprendre à Jeanne ou à Pierre à faire face à un menteur, par exemple. Robert le cynique jouera le menteur, endossant le rôle d'un ami à eux, menteur patenté. Puis les rôles vont être redistribués, et chacun va soupçonner l'autre de mensonge. Même si on va chercher à faire passer Pierre pour un être déraisonnable - pour le moins -, au final, le psychodrame n'aura aucune vertu thérapeutique. Tout ça prend plutôt l'allure d'un nœud de vipères.
Les dialogues vont peu à peu engluer les protagonistes dans leurs dilemmes, le jeu que jouera Simone s'imposant comme le zénith du drame - ment-elle, ne ment-elle pas, joue-t-elle , ne joue-t-elle pas ? Son "Bon, bon, bien sûr, je jouais..." semble clore l'affaire. Rien n'est moins sûr. Rien n'a jamais été plus confus, si ce n'est que chacun - sauf Pierre, que l'aplomb de Simone laisse tout de même pantois d'admiration - semble vouloir retourner au plus vite à son mode de vie... mensonger, hypocrite, mauvaise langue. Mais sans faux pas, sans dérapage aucun. Ce qui paraît, dès lors, extrêmement compromis.
Challenge Théâtre 2017-2018
Première pièce de Nathalie Sarraute, le silence fut créée pour la radio, tout comme le mensonge, à la demande de Werner Spies (qui deviendra plus tard une référence pour son travail sur Max Ernst). Avec le théâtre, Nathalie Sarraute allait devoir s'attaquer à un véritable paradoxe : faire dire à des personnages ce que, d'habitude, dans sa littérature, ils taisaient : ces petits malaises dont on ne peut se détacher mais qu'on ne révèle pas aux autres, ces non-dits derrière lesquels se cachent des déferlantes de l'inconscient, ces "mouvements intérieurs" qui ne peuvent se dévoiler à la société et qui minent ceux qui les éprouvent. On est bien dans ce qu'elle a nommé les tropismes, à la différence qu'avec le théâtre, il va lui falloir transformer le sous-texte en texte. Ce qui lui parut impossible tout d'abord, et lui fit refuser l'offre de Werner Spies. Qui insista.
La trouvaille de Nathalie Sarraute fut de mettre justement dans la bouche de ses personnages les mots qu'ils ne devraient pas prononcer, ce qu'il ne diraient jamais en temps normal, qui les fait donc déborder du cadre des convenances sociales. C'est pourquoi ils ont du mal à mettre des mots sur leur malaise, c'est pourquoi ils bafouillent, c'est pourquoi ils parlent régulièrement de folie. Ça explique aussi en partie pourquoi ils semblent adopter parfois un langage artificiel (même si l'auteure ira vers plus de naturel langagier dans une pièce comme Pour un oui ou pour un non). le silence fonctionne donc de cette façon : des personnages, et surtout un personnage, H.1, qui disent ce qu'il ne sont pas censés dire.
H.1 est, dès le début de la pièce, mis mal à l'aise par les compliments de ses amis qui l'écoutent parler de détails architecturaux de l'art byzantin, de "petits auvents", précisément. Il cherche à les arrêter, il ne veut pas continuer à parler, il se sent pris en défaut. de flagornerie ? de méconnaissance du sujet ? de manque d'éloquence ? Toujours est-il que les autres insistent et qu'il s'énerve, et c'est déjà là que la crise survient, avant même qu'un autre personnage soit mis en cause. Il est incapable de s'expliquer sur ce malaise, dont les raisons lui paraissent évidentes. Donc, en toute logique, les autres sont incapables de le comprendre. Et le voilà persuadé qu'ils se moquent de lui. Pire, il y a Jean-Pierre (le seul qui possède un prénom bien défini dès le départ), qui se tait. Ce qui provoque une nouvelle crise chez H.1, ou plutôt la porte à son apogée. Et chacun de parler de Jean-Pierre, qui serait timide, qui serait ceci ou cela, qui aurait telle ou telle raison de se taire, bref, qui donne lieu à tous les fantasmes sur son silence, sur ses motifs, sur les gens qui se taisent et qui sont mystérieux ou insupportables - tout ceci non sans humour de la part de l'auteure. Toute cette partie de la pièce relève donc de cette structure inventée par Nathalie Sarraute : chacun dit tout et n'importe quoi, fantasme à loisir et, donc, dit ce qu'il ne dirait jamais en société (peut-être même ce qu'il ne se dirait pas à lui-même, les autre servant de catalyseurs). Jusqu'au moment où H.1 se calme, reprend son hiatus sur les auvents, et que Jean-Pierre PARLE. On ne saura donc pas si Jean-Pierre aurait parlé si H.1 ne s'était pas énervé dès le début de la pièce, on ne saura pas pourquoi il parle à ce moment précis alors qu'il s'est tu pendant que les autres étaient atteints de logorrhée. Et il semble que la boucle se referme, que la pièce reprend au début, telle qu'elle aurait dû se dérouler si les normes avaient été respectées.
Un simple silence, mieux, une attitude silencieuse, est donc facteur de crise dans un groupe social qui se connaît bien et qui, jusque-là, fonctionnait parfaitement selon ses propres rites et le respect de ceux-ci. Pourquoi H.1 déborde-t-il d'un coup (débordement qu'il attribue d'ailleurs à Jean-Pierre, à un rire supposé de Jean-Pierre, et non à lui-même) ? le titre est censé nous faire penser que c'est le silence de Jean-Pierre, ou plutôt l'effet qu'il produit sur H.1, d'abord, puis sur tout le monde, que c'est ce silence qui révèle le malaise de H.1, qui va s'étendre aux autres. Mais on voit bien dès la première réplique que le malaise est déjà installé (comme il l'est dans les autres pièces de Sarraute que j'ai pu lire). Donc, j'ai une petite réserve sur la structure de la pièce, parce que le malaise premier de H.1 et sa réaction au silence de Jean-Pierre vont se séparer ou se confondre, et que la pièce m'a paru parfois se déliter, se fondre dans un manque d'homogénéité. Vous me direz que c'est à la mesure de H.1, qui multiplie les contradictions et les phrases inachevées... Sans doute ai-je besoin de relire cette pièce, car Nathalie Sarraute ne se saisit pas d'emblée, d'un coup d'un seul. Je reste donc en suspens sur ce point pour l'instant. En revanche, pour tout ce qui est du projet sarrautien sur les tropismes, voilà qui m'intéresse de toute façon au plus haut point.
Challenge Théâtre 2017-2018
La trouvaille de Nathalie Sarraute fut de mettre justement dans la bouche de ses personnages les mots qu'ils ne devraient pas prononcer, ce qu'il ne diraient jamais en temps normal, qui les fait donc déborder du cadre des convenances sociales. C'est pourquoi ils ont du mal à mettre des mots sur leur malaise, c'est pourquoi ils bafouillent, c'est pourquoi ils parlent régulièrement de folie. Ça explique aussi en partie pourquoi ils semblent adopter parfois un langage artificiel (même si l'auteure ira vers plus de naturel langagier dans une pièce comme Pour un oui ou pour un non). le silence fonctionne donc de cette façon : des personnages, et surtout un personnage, H.1, qui disent ce qu'il ne sont pas censés dire.
H.1 est, dès le début de la pièce, mis mal à l'aise par les compliments de ses amis qui l'écoutent parler de détails architecturaux de l'art byzantin, de "petits auvents", précisément. Il cherche à les arrêter, il ne veut pas continuer à parler, il se sent pris en défaut. de flagornerie ? de méconnaissance du sujet ? de manque d'éloquence ? Toujours est-il que les autres insistent et qu'il s'énerve, et c'est déjà là que la crise survient, avant même qu'un autre personnage soit mis en cause. Il est incapable de s'expliquer sur ce malaise, dont les raisons lui paraissent évidentes. Donc, en toute logique, les autres sont incapables de le comprendre. Et le voilà persuadé qu'ils se moquent de lui. Pire, il y a Jean-Pierre (le seul qui possède un prénom bien défini dès le départ), qui se tait. Ce qui provoque une nouvelle crise chez H.1, ou plutôt la porte à son apogée. Et chacun de parler de Jean-Pierre, qui serait timide, qui serait ceci ou cela, qui aurait telle ou telle raison de se taire, bref, qui donne lieu à tous les fantasmes sur son silence, sur ses motifs, sur les gens qui se taisent et qui sont mystérieux ou insupportables - tout ceci non sans humour de la part de l'auteure. Toute cette partie de la pièce relève donc de cette structure inventée par Nathalie Sarraute : chacun dit tout et n'importe quoi, fantasme à loisir et, donc, dit ce qu'il ne dirait jamais en société (peut-être même ce qu'il ne se dirait pas à lui-même, les autre servant de catalyseurs). Jusqu'au moment où H.1 se calme, reprend son hiatus sur les auvents, et que Jean-Pierre PARLE. On ne saura donc pas si Jean-Pierre aurait parlé si H.1 ne s'était pas énervé dès le début de la pièce, on ne saura pas pourquoi il parle à ce moment précis alors qu'il s'est tu pendant que les autres étaient atteints de logorrhée. Et il semble que la boucle se referme, que la pièce reprend au début, telle qu'elle aurait dû se dérouler si les normes avaient été respectées.
Un simple silence, mieux, une attitude silencieuse, est donc facteur de crise dans un groupe social qui se connaît bien et qui, jusque-là, fonctionnait parfaitement selon ses propres rites et le respect de ceux-ci. Pourquoi H.1 déborde-t-il d'un coup (débordement qu'il attribue d'ailleurs à Jean-Pierre, à un rire supposé de Jean-Pierre, et non à lui-même) ? le titre est censé nous faire penser que c'est le silence de Jean-Pierre, ou plutôt l'effet qu'il produit sur H.1, d'abord, puis sur tout le monde, que c'est ce silence qui révèle le malaise de H.1, qui va s'étendre aux autres. Mais on voit bien dès la première réplique que le malaise est déjà installé (comme il l'est dans les autres pièces de Sarraute que j'ai pu lire). Donc, j'ai une petite réserve sur la structure de la pièce, parce que le malaise premier de H.1 et sa réaction au silence de Jean-Pierre vont se séparer ou se confondre, et que la pièce m'a paru parfois se déliter, se fondre dans un manque d'homogénéité. Vous me direz que c'est à la mesure de H.1, qui multiplie les contradictions et les phrases inachevées... Sans doute ai-je besoin de relire cette pièce, car Nathalie Sarraute ne se saisit pas d'emblée, d'un coup d'un seul. Je reste donc en suspens sur ce point pour l'instant. En revanche, pour tout ce qui est du projet sarrautien sur les tropismes, voilà qui m'intéresse de toute façon au plus haut point.
Challenge Théâtre 2017-2018
C'est une relecture, pour moi.
Ce n'est pas le premier livre de Nathalie Sarraute que je lis, mais celui-ci est de loin le plus facile! A quatre-vingts ans passés, l'auteure fait un retour dans ses souvenirs d'enfance. Un double lui servira de garde-fous, d'empêcheuse de tomber dans les platitudes, les poncifs des souvenirs d'enfance. Sans cesse, face à une affirmation, elle remet en doute sa mémoire, les sentiments qu'elle ait pu éprouver à tels moments.
A son habitude, elle étudie minutieusement, décortique gestes et regards, au-delà de la parole. Ici, ses sujets d'étude sont évidemment ses parents, séparés lorsqu'elle avait à peine deux ans, et entre lesquels elle passe sa petite enfance. Un père aimant mais peu démonstratif, une mère insouciante et égocentrique (même si Sarraute ne le dit jamais elle-même), une belle-mère envieuse et parfois injuste.
C'est l'école qui la tiendra debout, qui la sauvera, comme on dit.
L'utilisation du double fonctionne à merveille, permet de proposer des alternatives, un autre regard sur les événements, même si les deux narrateurs sont bien identifiés comme une seule personne. Le récit commence et finit comme si tout cela n'était pas si important, un exercice un peu prétentieux ou vain, qu'elle tente puis va délaisser. Par pudeur? Douleur? C'est en tout cas un belle introspection dans la vie intérieure d'une grande écrivaine, une tentative réussie qui permet de mieux saisir son travail de tâtonnements et de volonté de précision dans son oeuvre.
Ce n'est pas le premier livre de Nathalie Sarraute que je lis, mais celui-ci est de loin le plus facile! A quatre-vingts ans passés, l'auteure fait un retour dans ses souvenirs d'enfance. Un double lui servira de garde-fous, d'empêcheuse de tomber dans les platitudes, les poncifs des souvenirs d'enfance. Sans cesse, face à une affirmation, elle remet en doute sa mémoire, les sentiments qu'elle ait pu éprouver à tels moments.
A son habitude, elle étudie minutieusement, décortique gestes et regards, au-delà de la parole. Ici, ses sujets d'étude sont évidemment ses parents, séparés lorsqu'elle avait à peine deux ans, et entre lesquels elle passe sa petite enfance. Un père aimant mais peu démonstratif, une mère insouciante et égocentrique (même si Sarraute ne le dit jamais elle-même), une belle-mère envieuse et parfois injuste.
C'est l'école qui la tiendra debout, qui la sauvera, comme on dit.
L'utilisation du double fonctionne à merveille, permet de proposer des alternatives, un autre regard sur les événements, même si les deux narrateurs sont bien identifiés comme une seule personne. Le récit commence et finit comme si tout cela n'était pas si important, un exercice un peu prétentieux ou vain, qu'elle tente puis va délaisser. Par pudeur? Douleur? C'est en tout cas un belle introspection dans la vie intérieure d'une grande écrivaine, une tentative réussie qui permet de mieux saisir son travail de tâtonnements et de volonté de précision dans son oeuvre.
Cela faisait très longtemps que je n’avais pas lu cette auteure si cérébrale, à l’écriture inimitable toute en pensées fugitives et contradictoires. Je reconnais que ce torrent de flux de conscience ne peut pas plaire à tout le monde. Et la prose de Nathalie Sarraute demande beaucoup d’attention. Il faut également dépasser son aspect un peu étouffant : être dans les pensées et seulement dans les pensées de ses personnages, qu’on peut largement trouver trop désincarnés, n’est pas toujours de tout repos.
Dans ce roman, paru en 1953, un quatuor de grands bourgeois, (mari entrepreneur, femme entretenue, leur fille et leur neveu) demandent à un certain Martereau, issu d’un milieu plus modeste, de leur servir de prête-nom pour l’achat d’un pavillon proche de Paris.
On est dans les pensées du neveu, qui est hypersensible aux fluctuations d’humeur et de discours des uns et des autres. Il a pourtant fait de Martereau une sorte de modèle de ce que devrait être un homme droit, à l’abri du doute et des petits arrangements avec la vérité. Mais cela se lézardera inévitablement, comme pour les autres personnes de son entourage.
On pourra trouver cette tempête sous un crâne un peu longuette sur la distance. Pour ma part le style de Nathalie Sarraute me semble tellement fort que je m’y retrouve, sinon à l’aise, du moins en mesure d’apprécier cette littérature expérimentale au ton si particulier.
Dans ce roman, paru en 1953, un quatuor de grands bourgeois, (mari entrepreneur, femme entretenue, leur fille et leur neveu) demandent à un certain Martereau, issu d’un milieu plus modeste, de leur servir de prête-nom pour l’achat d’un pavillon proche de Paris.
On est dans les pensées du neveu, qui est hypersensible aux fluctuations d’humeur et de discours des uns et des autres. Il a pourtant fait de Martereau une sorte de modèle de ce que devrait être un homme droit, à l’abri du doute et des petits arrangements avec la vérité. Mais cela se lézardera inévitablement, comme pour les autres personnes de son entourage.
On pourra trouver cette tempête sous un crâne un peu longuette sur la distance. Pour ma part le style de Nathalie Sarraute me semble tellement fort que je m’y retrouve, sinon à l’aise, du moins en mesure d’apprécier cette littérature expérimentale au ton si particulier.
Bon, là, je m'avoue vaincue. C'est la première et la seule pièce de Nathalie Sarraute qui m'ait ennuyée et à laquelle je ne n'arrive pas à m'intéresser. Peut-être d'ailleurs suis-je passée à côté de certaines choses, car plus j'avançais dans la lecture, moins j'étais concentrée. La pièce est pourtant très courte.
Il est bien question, encore une fois, de tropisme, mais je ne vois pas bien où l'auteure a voulu en venir. Ici deux hommes, H.1 et H.2, sont certains que F., l'associée de H.2, est en désaccord avec eux sur une "idée" précise dont ils ont parlé plus tôt devant elle. Ils sont également persuadés qu'elle-même porte une idée différente, mais plus ou moins idiote ou aberrante selon leurs propres critères. Mais H.1 s'en moque, alors que ce désaccord, cette idée contraire à la sienne, obsède H.2. Qui s'en va chercher du soutien et le trouve en la personne de H.3, sorti du nulle part (ou peut-être du public, auquel il s'est adressé pour trouver un appui). Ils essaieront de convaincre F. de son erreur, en vain, et H.2 terminera sur un monologue pour le moins curieux sur la vérité.
L'idée dont ont parlé H.1 et H.2 avant le début de la pièce, on ne la connaîtra pas. Pas plus que celle de F. On voit bien que Nathalie Sarraute a voulu aller jusqu'au bout de l'idée (justement) que le tropisme est indicible, qu'il reste une petite chose floue et entêtante, mais jamais tangible. Donc on reste dans le flou autant que faire se peut, à tel point qu'il me semble que Sarraute se heurte là à une limite qu'elle n'arrive pas à franchir. Parler de ce qui ne se dit pas, c'était pour elle une gageure dès sa première pièce. Seulement, en arriver à ce point de non-dit au théâtre, en ne s'appuyant que sur des paroles, ce n'est plus une gageure, c'est un obstacle de la taille d'une montagne.
Pour moi ça ne fonctionne pas, et pour le coup, je ne peux guère dire autre chose de la pièce. J'ai la sensation que le sujet de la pièce est dévoyé, qu'on ne voit plus qu'un type qui ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui, notamment s'il considère que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui lui sont inférieurs (socialement, intellectuellement, etc.) Et pourtant on saisit bien que ce n'est pas là le sujet de la pièce.
Soit la pièce est ratée, soit je n'ai rien compris, soit c'est un peu des deux, mais toujours est-il que là, à cet instant précis, le but de Sarraute ne me paraît pas voir été atteint. Sans doute faudrait-il que je la relise avec plus d'attention, sans doute devrais-je approfondir ma connaissance de Nathalie Sarraute. Toujours est-il que je reste pour l'instant très dubitative face à ce texte.
Challenge Théâtre 2018-2019
Il est bien question, encore une fois, de tropisme, mais je ne vois pas bien où l'auteure a voulu en venir. Ici deux hommes, H.1 et H.2, sont certains que F., l'associée de H.2, est en désaccord avec eux sur une "idée" précise dont ils ont parlé plus tôt devant elle. Ils sont également persuadés qu'elle-même porte une idée différente, mais plus ou moins idiote ou aberrante selon leurs propres critères. Mais H.1 s'en moque, alors que ce désaccord, cette idée contraire à la sienne, obsède H.2. Qui s'en va chercher du soutien et le trouve en la personne de H.3, sorti du nulle part (ou peut-être du public, auquel il s'est adressé pour trouver un appui). Ils essaieront de convaincre F. de son erreur, en vain, et H.2 terminera sur un monologue pour le moins curieux sur la vérité.
L'idée dont ont parlé H.1 et H.2 avant le début de la pièce, on ne la connaîtra pas. Pas plus que celle de F. On voit bien que Nathalie Sarraute a voulu aller jusqu'au bout de l'idée (justement) que le tropisme est indicible, qu'il reste une petite chose floue et entêtante, mais jamais tangible. Donc on reste dans le flou autant que faire se peut, à tel point qu'il me semble que Sarraute se heurte là à une limite qu'elle n'arrive pas à franchir. Parler de ce qui ne se dit pas, c'était pour elle une gageure dès sa première pièce. Seulement, en arriver à ce point de non-dit au théâtre, en ne s'appuyant que sur des paroles, ce n'est plus une gageure, c'est un obstacle de la taille d'une montagne.
Pour moi ça ne fonctionne pas, et pour le coup, je ne peux guère dire autre chose de la pièce. J'ai la sensation que le sujet de la pièce est dévoyé, qu'on ne voit plus qu'un type qui ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui, notamment s'il considère que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui lui sont inférieurs (socialement, intellectuellement, etc.) Et pourtant on saisit bien que ce n'est pas là le sujet de la pièce.
Soit la pièce est ratée, soit je n'ai rien compris, soit c'est un peu des deux, mais toujours est-il que là, à cet instant précis, le but de Sarraute ne me paraît pas voir été atteint. Sans doute faudrait-il que je la relise avec plus d'attention, sans doute devrais-je approfondir ma connaissance de Nathalie Sarraute. Toujours est-il que je reste pour l'instant très dubitative face à ce texte.
Challenge Théâtre 2018-2019
Faire passer tant de choses en si peu de pages, quelle performance et quel talent...
Cette pièce de théâtre voit s'affronter 2 hommes, sans prénom (H1 et H2). Ils sont amis, depuis toujours, mais s'éloignent comme ça, pour une remarque dite sur un certain ton, pour rien...
Pour rien vraiment? Parfois on prend sur soi depuis des années pour faire vivre une relation, parce qu'on y tient. Et puis on arrive au bout de son effort, à la fin de sa patience, et un mot suffit à anéantir une relation.
J'ai trouvé cette pièce extrêmement forte, et juste. Elle m'a effrayée aussi, car nous sommes tous potentiellement H1 ou H2.
Cette pièce de théâtre voit s'affronter 2 hommes, sans prénom (H1 et H2). Ils sont amis, depuis toujours, mais s'éloignent comme ça, pour une remarque dite sur un certain ton, pour rien...
Pour rien vraiment? Parfois on prend sur soi depuis des années pour faire vivre une relation, parce qu'on y tient. Et puis on arrive au bout de son effort, à la fin de sa patience, et un mot suffit à anéantir une relation.
J'ai trouvé cette pièce extrêmement forte, et juste. Elle m'a effrayée aussi, car nous sommes tous potentiellement H1 ou H2.
Je n'ai pas pour habitude de lire du théâtre et je ne suis pas forcément à l'aise avec ce genre littéraire (je préfère voir des pièces). Mais s'agissant d'une lecture scolaire pour mon cours de littérature française, je m'y suis collée... sans grand problème puisque la pièce est très courte et que son sujet m'intéressais.
Deux amis discutent : H1 reproche à H2 de s'être éloigné et ce dernier lui avoue qu'il n'a pas apprécié une phrase qu'H1 lui a dite. H2 a la réputation de rompre ses relations sans raison, ce dont H1 lui fait part.
Ce dialogue compose la pièce et, quoique surprenant, c'était chouette à lire. En effet, la structure du texte est ici très importante, notamment avec l'utilisation récurrente de points de suspension. Les subtilités du langage sont, en quelques sortes, décortiquées. L'autrice a fait un travail intéressant avec ce texte.
Même si j'ai aimé lire cette pièce, la lecture a été parfois déroutante parce que presque absurde, mais j'ai bien aimé l'idée et j'aimerais, à l'occasion, la voir jouée !
Deux amis discutent : H1 reproche à H2 de s'être éloigné et ce dernier lui avoue qu'il n'a pas apprécié une phrase qu'H1 lui a dite. H2 a la réputation de rompre ses relations sans raison, ce dont H1 lui fait part.
Ce dialogue compose la pièce et, quoique surprenant, c'était chouette à lire. En effet, la structure du texte est ici très importante, notamment avec l'utilisation récurrente de points de suspension. Les subtilités du langage sont, en quelques sortes, décortiquées. L'autrice a fait un travail intéressant avec ce texte.
Même si j'ai aimé lire cette pièce, la lecture a été parfois déroutante parce que presque absurde, mais j'ai bien aimé l'idée et j'aimerais, à l'occasion, la voir jouée !
C'est en 1932 que l'auteure a écrit le premier des 18 textes qui feront partie de la première édition de Tropismes parue en 1939 aux éditions Denoël. Il faudra cinq ans à Sarraute pour rédiger ces 18 brefs textes (« On ne peut pas imaginer la lenteur de ce travail » écrira-t-elle), et ensuite deux ans pour être éditée, allant de refus en refus, tant son œuvre est atypique. Elle écrira entre 1939 et 1941 six nouveaux textes qui prendront place dans la nouvelle édition de l'ouvrage entreprise à la demande d'Alain Robbe-Grillet aux Editions de Minuit en 1957, un des textes de la première version a été en revanche supprimé, c'est cette édition que est considérée comme définitive et éditée en l'état actuellement. Cette genèse extrêmement longue montre l'importance de ce texte pour l'auteure : « Au fond, je n'aurai vécu que pour une idée fixe » déclare-t-elle à la fin de sa vie, tous ses textes poursuivant au fond la traque de ces tropismes.
Emprunté au vocabulaire de la biologie, la notion de tropisme est essentielle dans l'oeuvre de Sarraute. Elle traduit la démarche de l'ateure qui s'attache à saisir des manifestations infimes du moi, à transformer en langage les vibrations, les tremblements du « ressenti », les mouvements intérieurs produits sous l'effet d'une sollicitation extérieure, « des mouvements ténus, qui glissent très rapidement au seuil de notre conscience » et se déroulent comme de véritables « actions dramatiques intérieures ». Il s'agit de saisir le plus authentique, le plus véritable, l'essence des êtres, au-delà de l'anecdotique, d'un narratif convenu, les éléments originaires, les mécanismes de la conscience antérieurs à l'expression. Cela nécessite d'un travail particulier sur la langue, sur l'expression, sur la ponctuation. Chaque mot doit être signifiant et juste.
Tout cela peut sembler théorique, abstrait, froid, alors que c'est tout le contraire. Je ne sais trop comment traduire le plaisir euphorique et intense que ces textes m'ont procuré. La justesse des mots, le rythme des phrases, la densité des contenus : ces textes sont essentiels, rien n'est gratuit, rien n'est du remplissage, tout est là parce que cela signifie, capte quelque chose de fondamental, qui gît au fond de chacun d'entre nous. C'est comme une sorte de vibration à l'unisson de notre moi le plus profond.
Une des expériences les plus fortes que la littérature m'ait donnée.
Emprunté au vocabulaire de la biologie, la notion de tropisme est essentielle dans l'oeuvre de Sarraute. Elle traduit la démarche de l'ateure qui s'attache à saisir des manifestations infimes du moi, à transformer en langage les vibrations, les tremblements du « ressenti », les mouvements intérieurs produits sous l'effet d'une sollicitation extérieure, « des mouvements ténus, qui glissent très rapidement au seuil de notre conscience » et se déroulent comme de véritables « actions dramatiques intérieures ». Il s'agit de saisir le plus authentique, le plus véritable, l'essence des êtres, au-delà de l'anecdotique, d'un narratif convenu, les éléments originaires, les mécanismes de la conscience antérieurs à l'expression. Cela nécessite d'un travail particulier sur la langue, sur l'expression, sur la ponctuation. Chaque mot doit être signifiant et juste.
Tout cela peut sembler théorique, abstrait, froid, alors que c'est tout le contraire. Je ne sais trop comment traduire le plaisir euphorique et intense que ces textes m'ont procuré. La justesse des mots, le rythme des phrases, la densité des contenus : ces textes sont essentiels, rien n'est gratuit, rien n'est du remplissage, tout est là parce que cela signifie, capte quelque chose de fondamental, qui gît au fond de chacun d'entre nous. C'est comme une sorte de vibration à l'unisson de notre moi le plus profond.
Une des expériences les plus fortes que la littérature m'ait donnée.
Une enfance qui ressurgit avec ses figures. Les parents séparés. Le père, tout d’abord, exilé russe, dont on nous dit qu’il essaie de reconstituer son usine de produits chimiques. La mère qui vit en Russie avec le gentil Kolia.
Mais Nathalie, vers 8 ans, est accueillie plus longtemps chez son père et Véra, sa nouvelle compagne, qui met au monde Lili.
Si son père l’entoure d’une affection jamais démentie, on ne saura jamais quel degré d’affection lui porte sa belle-mère qui n’a que quinze ans de plus qu’elle. Elle lui posera la question, à brûle-pourpoint: est-ce-que tu me détestes ?
Le troisième personnage, le plus important, c’est l’école de la République, l’école laïque française. L’école devient le hâvre protecteur pour cette enfant aux excellentes notes, ballotée entre ses parents, obligée faire des choix d’adulte. Elle vit là-bas un moment de perfection au cours d’une simple récitation. L’école est « un monde aux confins tracés avec une grande précision, un monde solide, partout visible, juste à ma mesure. ». Elle éprouve précisément le sentiment que l’enseignement primaire cherche à donner.
Ce court livre est écrit sous forme de dialogue intérieur, un ping pong verbal, une auto-psychanalyse où les souvenirs enfuis, enfouis, se raniment à la lueur du présent, mais sont vacillant car on ne connaît pas leur degré de véracité, à quel point ils sont reconstruits. Un fil minuscule les unit et ils émergent en ribambelle de la brume du passé.
Lien : http://killing-ego.blogspot...
Mais Nathalie, vers 8 ans, est accueillie plus longtemps chez son père et Véra, sa nouvelle compagne, qui met au monde Lili.
Si son père l’entoure d’une affection jamais démentie, on ne saura jamais quel degré d’affection lui porte sa belle-mère qui n’a que quinze ans de plus qu’elle. Elle lui posera la question, à brûle-pourpoint: est-ce-que tu me détestes ?
Le troisième personnage, le plus important, c’est l’école de la République, l’école laïque française. L’école devient le hâvre protecteur pour cette enfant aux excellentes notes, ballotée entre ses parents, obligée faire des choix d’adulte. Elle vit là-bas un moment de perfection au cours d’une simple récitation. L’école est « un monde aux confins tracés avec une grande précision, un monde solide, partout visible, juste à ma mesure. ». Elle éprouve précisément le sentiment que l’enseignement primaire cherche à donner.
Ce court livre est écrit sous forme de dialogue intérieur, un ping pong verbal, une auto-psychanalyse où les souvenirs enfuis, enfouis, se raniment à la lueur du présent, mais sont vacillant car on ne connaît pas leur degré de véracité, à quel point ils sont reconstruits. Un fil minuscule les unit et ils émergent en ribambelle de la brume du passé.
Lien : http://killing-ego.blogspot...
La pièce est dans un premier temps enregistrée et diffusée par Radio France en décembre 1981, avant d'être publiée au début de 1982. Elle sera créée sur scène pour la première fois à New York, en 1985 dans une mise en scène de Simone Benmussa, qui assurera également la première mise en scène française en 1986, sur la petite scène du théâtre du Rond-Point. C'est la dernière pièce écrite par Nathalie Sarraute, et celle qui est la plus jouée, en France et à l'étranger. C'est la seule qu'il m'ait été donné de voir sur une scène, au Lucernaire il y 7-8 ans.
Deux hommes, H1 et H2, amis de longue date. H1 vient voir H2 et lui demander pourquoi il semble l'éviter. Après de grandes réticences, ce dernier évoque un incident mineur, dans lequel H1 aurait fait preuve de condescendance à son encontre. H1 proteste, des voisins appelés pour juger le différent ne comprennent pas où est le problème, mais petit à petit, le ressenti mineur fait ressurgir d'autres événements microscopiques mais qui ont laissé des traces, chacun des deux hommes au final en veut à l'autre, sans pouvoir donner, pour étayer leur antagonisme, que des petits faits d'une grande banalité, sans rien de vraiment grave à chaque fois, et qui sont extrêmement subjectifs à évaluer. Mais qui au final font apparaître une vision de l'existence, des valeurs, qui ne sont pas les mêmes, et qui rendent l'autre odieux.
C'est vraiment une pièce très réussie, peut-être la plus aboutie de Nathalie Sarraute, ce qui fait regretter qu'elle soit la dernière, parce qu'au final, malgré la paradoxe du tropisme, si difficile en théorie à faire apparaître sur scène, cela marche très bien ici. La parole oblige à traquer le presque invisible au quotidien, ce qui fait réagir instinctivement sans forcément mettre des mots dessus : le dialogue théâtral permet une analyse du phénomène. Ce qui paraît aller de soi, ce qui est le comportement « normal » dans une société, est en réalité une convention, une norme imposée subtilement, et intégrée de manière inconsciente : le bonheur, la réussite, la pertinence même de ces catégories, est discutée dans la pièce. Sans en avoir l'air, à partir de quelques micro-événements quotidiens, comme tout le monde en vit l'auteur analyse le phénomène. Ce qu'on appelle amitié, ce qui lie ou sépare les individus, est aussi examiné. Au terme du processus, exprimer leurs ressentis, aller traquer au plus profond l'authenticité subjective d'une interaction, met en évidence l'incompatibilité des deux « amis » : ce qui rendait leur relation supportable, était que chacun garde pour soi l'agacement vis-à-vis de l'autre, et un sentiment de supériorité lié à l'incompréhension supposée de celui d'en face. Dire met en lumière la faille qui les sépare, sans aucun moyen de la réduire. C'est un constat d'incompatibilité définitive.
C'est à la fois très riche et complexe, sans empêcher une grande efficacité dramatique. La pièce est magistralement construite, avec une progression au niveau du dévoilement de la thématique, tout en étant très drôle. Une grande réussite.
Deux hommes, H1 et H2, amis de longue date. H1 vient voir H2 et lui demander pourquoi il semble l'éviter. Après de grandes réticences, ce dernier évoque un incident mineur, dans lequel H1 aurait fait preuve de condescendance à son encontre. H1 proteste, des voisins appelés pour juger le différent ne comprennent pas où est le problème, mais petit à petit, le ressenti mineur fait ressurgir d'autres événements microscopiques mais qui ont laissé des traces, chacun des deux hommes au final en veut à l'autre, sans pouvoir donner, pour étayer leur antagonisme, que des petits faits d'une grande banalité, sans rien de vraiment grave à chaque fois, et qui sont extrêmement subjectifs à évaluer. Mais qui au final font apparaître une vision de l'existence, des valeurs, qui ne sont pas les mêmes, et qui rendent l'autre odieux.
C'est vraiment une pièce très réussie, peut-être la plus aboutie de Nathalie Sarraute, ce qui fait regretter qu'elle soit la dernière, parce qu'au final, malgré la paradoxe du tropisme, si difficile en théorie à faire apparaître sur scène, cela marche très bien ici. La parole oblige à traquer le presque invisible au quotidien, ce qui fait réagir instinctivement sans forcément mettre des mots dessus : le dialogue théâtral permet une analyse du phénomène. Ce qui paraît aller de soi, ce qui est le comportement « normal » dans une société, est en réalité une convention, une norme imposée subtilement, et intégrée de manière inconsciente : le bonheur, la réussite, la pertinence même de ces catégories, est discutée dans la pièce. Sans en avoir l'air, à partir de quelques micro-événements quotidiens, comme tout le monde en vit l'auteur analyse le phénomène. Ce qu'on appelle amitié, ce qui lie ou sépare les individus, est aussi examiné. Au terme du processus, exprimer leurs ressentis, aller traquer au plus profond l'authenticité subjective d'une interaction, met en évidence l'incompatibilité des deux « amis » : ce qui rendait leur relation supportable, était que chacun garde pour soi l'agacement vis-à-vis de l'autre, et un sentiment de supériorité lié à l'incompréhension supposée de celui d'en face. Dire met en lumière la faille qui les sépare, sans aucun moyen de la réduire. C'est un constat d'incompatibilité définitive.
C'est à la fois très riche et complexe, sans empêcher une grande efficacité dramatique. La pièce est magistralement construite, avec une progression au niveau du dévoilement de la thématique, tout en étant très drôle. Une grande réussite.
Créée sur France Culture en 1972, la pièce sera jouée pour la première fois en 1975, dans une mise en scène de Claude Régy, dans la petite salle du théâtre Orsay et publiée la même année.
Une pièce à trois, dans un cadre familial avec trois protagonistes : Elle, Lui et Le fils. Une œuvre d'art indéfinie, que Lui trouve beau et veut faire dire à Elle qu'elle aussi. Mais la présence du fils empêche Elle de répéter « C'est beau ». Un conflit entre les deux homme s'exprime, le fils est renvoyé dans sa chambre. Elle et Lui discutent du problème, essaient de le cerner : qu'est-ce qui fait que dire « C'est beau » est impossible en présence du fils. Le retour du fils semble amorcer un compromis, il est prêt à dire « C'est chouette », mais un autre différent surgit aussitôt sur un sujet musical...
Alors évidemment il y a une multitude d'interprétations possibles. Le différent est-il de nature esthétique (tout le monde n'apprécie pas les mêmes créations) ou porte-t-il sur la manière d'exprimer son ressenti ? Le « C'est beau » qui confine au cliché est-il refusé uniquement à cause de cela ? Mais toute forme d'expression ne vire-t-elle pas au cliché à la longue ? Et comment faire la part d'une véritable émotion devant une œuvre d'art et la mise en scène sociale, du spectateur devant une œuvre d'art, en présence d'autres spectateurs, qui ont des attentes sur le comportement à avoir dans cette situation ? Ce que l'on aime ou pas, la manière dont on l'exprime, nous situe dans un groupe, nous identifie. Qu'est-ce qui est vraiment authentique et personnel dans le rapport que l'on a avec une œuvre d'art et qu'est ce qui relève de codes sociaux, d'une communication sociale ? Mais la pièce renvoie aussi sur la question du pouvoir qu'instaurent les échelles de valeurs esthétiques : qui décide de la valeur d'une œuvre, et qui peut donc déclasser un autre individu qui porte les « mauvais » jugements ?
Cela semble terriblement sérieux et abstrait, mais je suis absolument certaine que ce texte peut-être parfaitement désopilant sur une scène, il y a un vrai potentiel burlesque dans ces répliques, dans ces personnages si proches de ceux que l'on pourrait rencontrer avec leurs phrases toutes faites, mais avec un petit quelque chose de décalé, d'un peu absurde. Mais qui oserait le monter aujourd'hui....
Une pièce à trois, dans un cadre familial avec trois protagonistes : Elle, Lui et Le fils. Une œuvre d'art indéfinie, que Lui trouve beau et veut faire dire à Elle qu'elle aussi. Mais la présence du fils empêche Elle de répéter « C'est beau ». Un conflit entre les deux homme s'exprime, le fils est renvoyé dans sa chambre. Elle et Lui discutent du problème, essaient de le cerner : qu'est-ce qui fait que dire « C'est beau » est impossible en présence du fils. Le retour du fils semble amorcer un compromis, il est prêt à dire « C'est chouette », mais un autre différent surgit aussitôt sur un sujet musical...
Alors évidemment il y a une multitude d'interprétations possibles. Le différent est-il de nature esthétique (tout le monde n'apprécie pas les mêmes créations) ou porte-t-il sur la manière d'exprimer son ressenti ? Le « C'est beau » qui confine au cliché est-il refusé uniquement à cause de cela ? Mais toute forme d'expression ne vire-t-elle pas au cliché à la longue ? Et comment faire la part d'une véritable émotion devant une œuvre d'art et la mise en scène sociale, du spectateur devant une œuvre d'art, en présence d'autres spectateurs, qui ont des attentes sur le comportement à avoir dans cette situation ? Ce que l'on aime ou pas, la manière dont on l'exprime, nous situe dans un groupe, nous identifie. Qu'est-ce qui est vraiment authentique et personnel dans le rapport que l'on a avec une œuvre d'art et qu'est ce qui relève de codes sociaux, d'une communication sociale ? Mais la pièce renvoie aussi sur la question du pouvoir qu'instaurent les échelles de valeurs esthétiques : qui décide de la valeur d'une œuvre, et qui peut donc déclasser un autre individu qui porte les « mauvais » jugements ?
Cela semble terriblement sérieux et abstrait, mais je suis absolument certaine que ce texte peut-être parfaitement désopilant sur une scène, il y a un vrai potentiel burlesque dans ces répliques, dans ces personnages si proches de ceux que l'on pourrait rencontrer avec leurs phrases toutes faites, mais avec un petit quelque chose de décalé, d'un peu absurde. Mais qui oserait le monter aujourd'hui....
C'est la première pièce écrite par Nathalie Sarraute, à la demande insistante de Werner Spies travaillant pour une radio de Stuttgart. La pièce sera créée en traduction allemande sur les ondes de cette radio en avril 1964 ; cette version sera reprise par diverses radios allemandes et européennes en général. En parallèle, le texte paraît en février 1964 au Mercure de France. La première création sur scène, dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault, a lieu en 1967. La pièce est créée à l'occasion de l'inauguration de la petite salle de l'Odéon ; dans la même représentation figure Le mensonge, une autre pièce courte de Sarraute. Une autre mise en scène mémorable est celle de Jacques Lassalle, pour l'inauguration du Vieux-Colombier, devenu la deuxième salle de la Comédie Française. Certains ont reproché à cette mise en scène de trop tirer la pièce vers le comique, mais Sarraute n'y voyait pas d'inconvénients, et semblait même, d'après ses déclaration, préférer cette mise en scène.
La pièce comporte 6 protagonistes : 3 hommes et 3 femmes. Ils sont désignés comme H1, F1 etc. Une notable exception, le troisième homme, Jean-Pierre, le seul qui s'affiche sous son prénom. H1 raconte ses vacances, et il en vient à une sorte de cliché sur des ravissantes maisons en bois avec des auvents. Il en vient à douter de l'intérêt de ce qu'il raconte, malgré les encouragements de autres personnages. Enfin, de certains, parce que Jean-Pierre se tait. Et ce silence semble provoquer un malaise, le doute. Tout le monde se met à interpréter le silence en question : timidité, mépris etc. Chacun projette ses doutes, ses angoisses. Le silence de Jean-Pierre semble faire dérailler la machine social, obliger les personnages à s'interroger sur le sens des échanges banals, sans doute un peu creux, du discours qu'ils tiennent. Mais il suffit de quelques mots, aussi insignifiants soient-ils de Jean-Pierre, pour que la machine reparte, et que le doute disparaisse.
C'est à la fois très réaliste, dans ce récit de souvenirs touristiques un peu préfabriqués, et irréel, par le déraillement qui intervient tout d'un coup, sans raison, juste le silence d'un personnage qui vide d'une certaine manière de sens un échange social banal, ou plutôt qui fait apparaître son inanité. Une sorte de déchirure dans la trame du quotidien se produit, qui permet d'entrapercevoir un grand vide derrière le rideau. Qu'il faut cacher le plus vite, en faisant rentrer les choses dans l'ordre.
J'adorerais le voir sur scène, je pense vraiment qu'on peut le jouer de manières très différentes, entre un comique débridé, et quelque chose qui pourrait être tout simplement angoissant.
La pièce comporte 6 protagonistes : 3 hommes et 3 femmes. Ils sont désignés comme H1, F1 etc. Une notable exception, le troisième homme, Jean-Pierre, le seul qui s'affiche sous son prénom. H1 raconte ses vacances, et il en vient à une sorte de cliché sur des ravissantes maisons en bois avec des auvents. Il en vient à douter de l'intérêt de ce qu'il raconte, malgré les encouragements de autres personnages. Enfin, de certains, parce que Jean-Pierre se tait. Et ce silence semble provoquer un malaise, le doute. Tout le monde se met à interpréter le silence en question : timidité, mépris etc. Chacun projette ses doutes, ses angoisses. Le silence de Jean-Pierre semble faire dérailler la machine social, obliger les personnages à s'interroger sur le sens des échanges banals, sans doute un peu creux, du discours qu'ils tiennent. Mais il suffit de quelques mots, aussi insignifiants soient-ils de Jean-Pierre, pour que la machine reparte, et que le doute disparaisse.
C'est à la fois très réaliste, dans ce récit de souvenirs touristiques un peu préfabriqués, et irréel, par le déraillement qui intervient tout d'un coup, sans raison, juste le silence d'un personnage qui vide d'une certaine manière de sens un échange social banal, ou plutôt qui fait apparaître son inanité. Une sorte de déchirure dans la trame du quotidien se produit, qui permet d'entrapercevoir un grand vide derrière le rideau. Qu'il faut cacher le plus vite, en faisant rentrer les choses dans l'ordre.
J'adorerais le voir sur scène, je pense vraiment qu'on peut le jouer de manières très différentes, entre un comique débridé, et quelque chose qui pourrait être tout simplement angoissant.
Cinquième pièce de l'auteur, la première qu'elle dit avoir écrit vraiment pour le théâtre, c'est pourtant à la radio de Cologne qu'elle est créée en 1978. La création théâtrale en français eut lieu en 1980 dans la mise en scène de Claude Régy.
Le personnage principal, H. 2, est très perturbé par l'attitude de F., son assistante. Cette dernière a semblé par son silence réservé, mettre en cause l'exposition d'une opinion que H. 2 pensait d'un bon sens incontestable. Il n'arrive pas à chasser cette pensée de son esprit pendant une conversation avec H. 1. F. lui paraît avoir une idée en tête, différente de la sienne, et qui remet en cause cette dernière. H. 1 se retire, il est remplacé par H. 3 qui va essayer d'apporter son soutien à H. 2 pour faire abdiquer F. et chasser son idée. Mais F. résiste, et son idée, dont on ne saura rien, semble menacer tout le monde de H. 2 d'effondrement. F. finit par rendre les armes : mais le fait-elle vraiment, où joue-t-elle un jeu pour être tranquille ? Et l'idée qu'elle avait en tête, n'a-t-elle pas sa propre vie ailleurs ?
Une pièce que j'ai trouvée assez vertigineuse. La difficulté extrême à supporter la différence de l'autre, la menace que cela représente, la vie autonome des idées, qui se répandent, comme une maladie. L'impossibilité du contrôle aussi, l'autre est imprévisible et peut toujours échapper d'une façon ou d'une autre, même s'il semble se résigner. Un geste, une expression du visage, ont des sens qui peuvent ouvrir des perspectives sans fin.
Cela n'empêche pas la pièce d'être drôle pas moments, en particulier par des jeux d'interaction avec le spectateur (lecteur?). Une belle réussite.
Le personnage principal, H. 2, est très perturbé par l'attitude de F., son assistante. Cette dernière a semblé par son silence réservé, mettre en cause l'exposition d'une opinion que H. 2 pensait d'un bon sens incontestable. Il n'arrive pas à chasser cette pensée de son esprit pendant une conversation avec H. 1. F. lui paraît avoir une idée en tête, différente de la sienne, et qui remet en cause cette dernière. H. 1 se retire, il est remplacé par H. 3 qui va essayer d'apporter son soutien à H. 2 pour faire abdiquer F. et chasser son idée. Mais F. résiste, et son idée, dont on ne saura rien, semble menacer tout le monde de H. 2 d'effondrement. F. finit par rendre les armes : mais le fait-elle vraiment, où joue-t-elle un jeu pour être tranquille ? Et l'idée qu'elle avait en tête, n'a-t-elle pas sa propre vie ailleurs ?
Une pièce que j'ai trouvée assez vertigineuse. La difficulté extrême à supporter la différence de l'autre, la menace que cela représente, la vie autonome des idées, qui se répandent, comme une maladie. L'impossibilité du contrôle aussi, l'autre est imprévisible et peut toujours échapper d'une façon ou d'une autre, même s'il semble se résigner. Un geste, une expression du visage, ont des sens qui peuvent ouvrir des perspectives sans fin.
Cela n'empêche pas la pièce d'être drôle pas moments, en particulier par des jeux d'interaction avec le spectateur (lecteur?). Une belle réussite.
On retrouve ici quatre essais écrits par Nathalie Sarraute dans lesquelles elle développe un certain nombre de théories sur ce que l'on appelle "le nouveau roman". Selon elle, le lecteur se focalise trop sur les personnages au lieu de s'intéresser tout simplement à la psychologie qui émane d'eux mais qui cependant ne leur est pas propre. Le romancier, dans le "nouveau roman" doit donc faire perdre ses points de repère au lecteur en "dépersonnalisant" en quelque sorte les héros pour que le lecteur se concentre dorénavant essentiellement sur la psychologie dans son ensemble qui peut s'appliquer à plusieurs personnes et non pas propre à ce personnage en particulier.
Un peu difficile d'approche par moments mais, en résumé, Nathalie Sarraute a été l'un des précurseurs à poser les bases du "nouveau roman" et c'est ce qui fait de cet ouvrage un classique à ne pas manquer !
Un peu difficile d'approche par moments mais, en résumé, Nathalie Sarraute a été l'un des précurseurs à poser les bases du "nouveau roman" et c'est ce qui fait de cet ouvrage un classique à ne pas manquer !
Ecrite en 1966 pour la radio, il s’agit de la deuxième pièce de Nathalie Sarraute, après Le silence. Suite à la création radiophonique, la pièce a été montée au théâtre par Jean-Louis Barrault à l’Odéon, précédée par Le silence.
Il s’agit d’une œuvre courte (une quarantaine de pages en édition de poche), qui comporte néanmoins neuf personnages, identifiés par leurs prénoms. Lorsque la pièce commence, un débat est en cours : Pierre n’a pu s’empêcher de dénoncer un mensonge d’un personnage qui n’apparaît pas sur scène, ce que blâment les autres intervenants. Le mensonge en cause étant plutôt une mise en valeur de la personne qui le faisaient, sans véritable incidence pour les autres, un mensonge gratuit, celui que tout le monde ou presque fait plus ou moins régulièrement pour donner une meilleure image de soi, aux autres et à soi-même. La majorité dans le groupe est opposée à démonter ce genre de propos, le vivre ensemble (comme on dit maintenant) nécessite de passer sur ce type de propos, qui au fond, ne font de mal à personne. Les membres du groupe chapitrent donc Pierre, et tentent de soigner son irrépressible besoin de vérité à tout prix. Condamnation morale, psychodrame, ou plutôt jeu de rôle, sont utilisées pour faire bouger le récalcitrant. Mais ce dernier a de la ressource, et au final, il fait bouger les lignes chez certains, ou tout au moins provoque un malaise. Avant une sorte de pirouette finale.
Pièce brillante, qui sous une allure anodine pose des questions essentielles, en particulier sur les rapports sociaux, sur la nature des échanges entre les individus. Au-delà de la parole, des faits ou informations transmises, l’essentiel n’est-il pas l’affect, le subjectif, ce que l’on renvoie à l’autre de lui. La poursuite scrupuleuse de la vérité n’est-elle pas juste une manière d’établir un rapport de force en sa faveur ? Ou au contraire, laisser dire l’autre tout en n’en pensant pas moins n’est-il pas un moyen de domination ? Il n’y a pas de réelle bienveillance entre les personnages de la pièce, chacun se positionne dans la hiérarchie sociale, mais la pièce n’est clairement pas psychologique, il y a une approche presque abstraite des questionnements posés. Ce qui ne l’empêche pas d’être drôle, ce qui est incontestablement un tour de force. Une œuvre brillante, forte, sous une apparence modeste.
Je regrette que les pièces de Nathalie Sarraute ne soient pas plus jouées, sans doute en partie à cause de leur formats atypiques. Pour avoir vu Pour un oui, pour un non, je sais à quel point cela peut-être efficace sur une scène ; je suis sûre que Le mensonge peut l’être tout autant, s’il est bien joué.
Il s’agit d’une œuvre courte (une quarantaine de pages en édition de poche), qui comporte néanmoins neuf personnages, identifiés par leurs prénoms. Lorsque la pièce commence, un débat est en cours : Pierre n’a pu s’empêcher de dénoncer un mensonge d’un personnage qui n’apparaît pas sur scène, ce que blâment les autres intervenants. Le mensonge en cause étant plutôt une mise en valeur de la personne qui le faisaient, sans véritable incidence pour les autres, un mensonge gratuit, celui que tout le monde ou presque fait plus ou moins régulièrement pour donner une meilleure image de soi, aux autres et à soi-même. La majorité dans le groupe est opposée à démonter ce genre de propos, le vivre ensemble (comme on dit maintenant) nécessite de passer sur ce type de propos, qui au fond, ne font de mal à personne. Les membres du groupe chapitrent donc Pierre, et tentent de soigner son irrépressible besoin de vérité à tout prix. Condamnation morale, psychodrame, ou plutôt jeu de rôle, sont utilisées pour faire bouger le récalcitrant. Mais ce dernier a de la ressource, et au final, il fait bouger les lignes chez certains, ou tout au moins provoque un malaise. Avant une sorte de pirouette finale.
Pièce brillante, qui sous une allure anodine pose des questions essentielles, en particulier sur les rapports sociaux, sur la nature des échanges entre les individus. Au-delà de la parole, des faits ou informations transmises, l’essentiel n’est-il pas l’affect, le subjectif, ce que l’on renvoie à l’autre de lui. La poursuite scrupuleuse de la vérité n’est-elle pas juste une manière d’établir un rapport de force en sa faveur ? Ou au contraire, laisser dire l’autre tout en n’en pensant pas moins n’est-il pas un moyen de domination ? Il n’y a pas de réelle bienveillance entre les personnages de la pièce, chacun se positionne dans la hiérarchie sociale, mais la pièce n’est clairement pas psychologique, il y a une approche presque abstraite des questionnements posés. Ce qui ne l’empêche pas d’être drôle, ce qui est incontestablement un tour de force. Une œuvre brillante, forte, sous une apparence modeste.
Je regrette que les pièces de Nathalie Sarraute ne soient pas plus jouées, sans doute en partie à cause de leur formats atypiques. Pour avoir vu Pour un oui, pour un non, je sais à quel point cela peut-être efficace sur une scène ; je suis sûre que Le mensonge peut l’être tout autant, s’il est bien joué.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Nathalie Sarraute
Quiz
Voir plus
Nathalie Sarraute et son œuvre
Dans quel pays est née Nathalie Sarraute ?
France
Royaume-Uni
Pologne
Russie
10 questions
41 lecteurs ont répondu
Thème :
Nathalie SarrauteCréer un quiz sur cet auteur41 lecteurs ont répondu