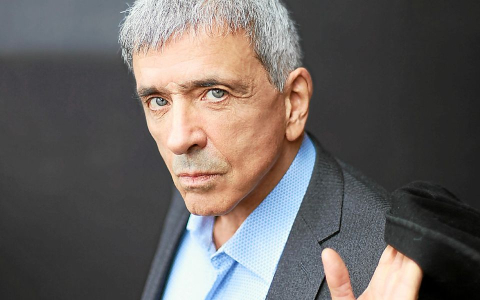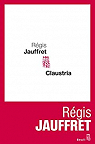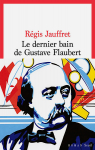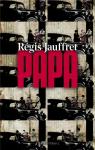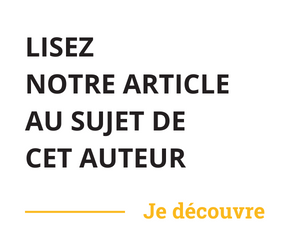Critiques de Régis Jauffret (549)
Vous avez tous entendu parler de l'affaire Fritzl ? Oui ? Très bien. Maintenant oubliez-la. Ceci est une œuvre de fiction. Et même si elle s'appuie et se nourrit de ce fait divers, cette histoire est un roman. Prenez Flaubert, il a assez répété que Madame Bovary n'était pas une simple transcription de l'affaire Delamare. Ces choses dites, voici le roman.
Autriche, ville d'Amstetten. Pendant 24 ans, Josef Fritzl a séquestré sa fille Angelika dans la cave de la maison familiale. Il lui a fait dix enfants, trois qu'il a élevés avec son épouse Anneliese dans la maison et les autres qui sont morts ou restés cloîtrés avec leur mère. C'est l'histoire du « petit peuple de la cave » qui nous est racontée. Mais c'est aussi les années qui ont précédé l'enfermement : l'adolescence violée d'Angelika, ses tentatives pour échapper à son père, l'enfance et la jeunesse de Josef et ce qui a forgé son goût pour la brutalité et le viol. Apparaît également une histoire qui n'existe que pour l'auteur, celle d'un des rescapés, Roman, plus de 45 ans après la sortie de la cave. Puisque je vous dis que ce texte est un roman – ou un Roman – croyez-moi ! Pas question de refaire le procès des voisins et des proches qui n'ont pas entendus les bruits venus du sous-sol.
La majeure partie du texte relate l'existence dans la cave, le quotidien rythmé par une absence de repères – ou ceux, évanescents, venus de la télévision – l'angoisse perpétuelle de manquer de nourriture ou d'être privé d'eau et d'électricité. Fritzl, seigneur capricieux, apparaît quand bon lui semble, approvisionne quand ça lui chante et reprend pour punir et mater. Selon le modèle et l'habitude autrichiens, il n'est qu'un tyran ordinaire qui bat femme et enfants. Mais sa volonté de dominer rappelle quelque peu l'hybris des Grecs antiques : Fritzl aime la terreur et la soumission qu'il provoque et il se moque de la folie qu'il cause. Brutal et jouisseur, il tire aussi son plaisir des affaires immobilières qu'il mène. Il rêve de s'annexer des morceaux d'Autriche et de bâtir un empire à sa mesure.
En arrière-plan se tient Anneliese, toute entière soumise au démon domestique qu'elle a épousé. Elle aligne son comportement sur le sien et bat sa fille avec autant de hargne. Elle ne s'interroge pas sur sa disparition, refuse d'y penser, oublie les possibles. « Anneliese passait son temps à renier ses oreilles, à se dire qu'elles perdaient parfois la raison. Ils étaient rares les instants où elles leur accordaient le bénéfice du doute. Plus rares encore ceux où elle se permettait d'évoquer timidement la bande-son de la cave à Fritzl. » (p. 307)
La libération, traitée sur quelques chapitres, n'apparaît pas comme un bienfait. « L'air libre les avait tués lentement comme une émanation délétère. » (p. 11) Sans cesse, les victimes et le bourreau répètent qu'il y a eu du bonheur. « Roman est allé respirer à la fenêtre. L'air lui manquait en se souvenant. Il regardait au loin. Il se sentait coupable d'avoir été si heureux dans la cave. D'aimer son père, aussi. » (p. 40) C'est là que surgit le plus insoutenable : de l'horreur est née une certaine forme de contentement et d'épanouissement. Les spectateurs et les étrangers ne peuvent le comprendre, eux qui n'ont que répulsion fascinée pour cette « poche de cauchemar sous la terre autrichienne » (p. 12 & 13). Il faudrait que les enfants aveugles crient leur reconnaissance d'avoir été sauvés, mais ils se terrent et cherchent sans cesse à retrouver le confort rassurant de la cave exigüe. « Il avait gardé la nostalgie du sous-sol. Cette conque, cette coquille qu'ils remplissaient toute entière comme jaune et blanc d'un œuf. » (p. 27)
L'auteur, qui se met en scène dans son enquête, imagine les suites de cette affaire, ses retombées médiatiques et ses exploitations par le cinéma ou l'édition. Il interroge l'horreur par le prisme du consommable. Il constate que, comme souvent, tout est bon pour vendre, même si la recette est mauvaise. « Les victimes sont décevantes, parfois les martyrs ne sont pas des héros. » (p. 32) Dans son enquête – réelle ou non – il visite la trop fameuse cave et c'est la que se déroule une des scènes les plus terribles du roman : son guide et lui sont assaillis par une foule de rats à laquelle ils n'échappent qu'en fuyant à toutes jambes. Voilà que l'horreur a tenté de s'emparer d'eux, de les recouvrir. En quittant ainsi les lieux, des questions sont restées sans réponse, mais c'est sûrement mieux ainsi. « Si comme dans l'Enfer de Dante il y avait des cercles dans la cave, tout le monde a préféré s'abstenir de les visiter tous. » (p. 83) Enfin, création ou vérité, une phrase lancée à l'auteur témoigne de l'ambivalence de son travail : « Au revoir, écrivain. D'après le site que j'ai regardé tout à l'heure, on vous prend pour un cinglé. Alors personne ne vous croira. » (p. 184) Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit, savoir s'il faut croire ou non ce qu'écrit Régis Jauffret ? Mais puisqu'on vous dit que c'est un roman, c'est écrit sur la couverture.
Ce sur quoi il vaut mieux s'interroger, c'est sur notre capacité à nous enfermer nous-mêmes. Fritzl a poussé l'expérience à l'extrême. Mais bien fous serions-nous si nos pensions que nous sommes libres. « On habite toujours un espace clos, on ne court jamais bien loin, les voitures suivent des routes, les trains des rails, les avions, les fusées ne rejoindront jamais l'infini. On se cogne toujours quelque part. » (p. 321)
Ouvrir ce livre, c'est ouvrir la porte de la cave et suivre Fritzl dans le souterrain. C'est faire ce que chacun a fait après la révélation de cette funeste histoire : imaginer le spectacle de cette famille captive. S'il est bien impossible de partager et de ressentir ce que cela fut, il suffit de soulever la trappe pour respirer les relents du rêve étrange d'un homme ivre de domination. Mais tout cela, on le doit à l'imagination de l'auteur. Bien que très probable, la ronde des psychiatres, des journalistes et des enquêteurs est inventée. Inventée aussi l'étrange relation entre Fritzl et son avocat. Fantasmées les années obscures du petit peuple de la cave. « Leur histoire devenue bientôt un conte de sorcière, un mythe dont on doutera des origines. Angelika et les ombres sur l'écran de la caverne dont Socrate ne dira jamais rien. Les phrases inhabitées des médias, des causeurs, des fabricants de romans. La cohorte des apprentis Platon, des jongleurs, bateleurs de la syntaxe, la poudre aux yeux du . » (p. 535)
Claustria enferme le lecteur. Ne riez pas, ce n'est pas qu'une formule. Véritablement, j'ai été prise et captive de cette histoire. Elle s'est accrochée, ne m'a pas lâchée. Plus approchait le terme du roman et moins je savais si je devais être soulagée ou déçue. Claustria est un roman de l'ambivalence : j'ai aimé être captive, j'en ai redemandé quitte, pour cela, à devoir encore assister à l'horreur. De la pitié pour Angelika et les enfants, oui j'en ai eu. Mais j'ai aimé ce roman, encore plus.
Autriche, ville d'Amstetten. Pendant 24 ans, Josef Fritzl a séquestré sa fille Angelika dans la cave de la maison familiale. Il lui a fait dix enfants, trois qu'il a élevés avec son épouse Anneliese dans la maison et les autres qui sont morts ou restés cloîtrés avec leur mère. C'est l'histoire du « petit peuple de la cave » qui nous est racontée. Mais c'est aussi les années qui ont précédé l'enfermement : l'adolescence violée d'Angelika, ses tentatives pour échapper à son père, l'enfance et la jeunesse de Josef et ce qui a forgé son goût pour la brutalité et le viol. Apparaît également une histoire qui n'existe que pour l'auteur, celle d'un des rescapés, Roman, plus de 45 ans après la sortie de la cave. Puisque je vous dis que ce texte est un roman – ou un Roman – croyez-moi ! Pas question de refaire le procès des voisins et des proches qui n'ont pas entendus les bruits venus du sous-sol.
La majeure partie du texte relate l'existence dans la cave, le quotidien rythmé par une absence de repères – ou ceux, évanescents, venus de la télévision – l'angoisse perpétuelle de manquer de nourriture ou d'être privé d'eau et d'électricité. Fritzl, seigneur capricieux, apparaît quand bon lui semble, approvisionne quand ça lui chante et reprend pour punir et mater. Selon le modèle et l'habitude autrichiens, il n'est qu'un tyran ordinaire qui bat femme et enfants. Mais sa volonté de dominer rappelle quelque peu l'hybris des Grecs antiques : Fritzl aime la terreur et la soumission qu'il provoque et il se moque de la folie qu'il cause. Brutal et jouisseur, il tire aussi son plaisir des affaires immobilières qu'il mène. Il rêve de s'annexer des morceaux d'Autriche et de bâtir un empire à sa mesure.
En arrière-plan se tient Anneliese, toute entière soumise au démon domestique qu'elle a épousé. Elle aligne son comportement sur le sien et bat sa fille avec autant de hargne. Elle ne s'interroge pas sur sa disparition, refuse d'y penser, oublie les possibles. « Anneliese passait son temps à renier ses oreilles, à se dire qu'elles perdaient parfois la raison. Ils étaient rares les instants où elles leur accordaient le bénéfice du doute. Plus rares encore ceux où elle se permettait d'évoquer timidement la bande-son de la cave à Fritzl. » (p. 307)
La libération, traitée sur quelques chapitres, n'apparaît pas comme un bienfait. « L'air libre les avait tués lentement comme une émanation délétère. » (p. 11) Sans cesse, les victimes et le bourreau répètent qu'il y a eu du bonheur. « Roman est allé respirer à la fenêtre. L'air lui manquait en se souvenant. Il regardait au loin. Il se sentait coupable d'avoir été si heureux dans la cave. D'aimer son père, aussi. » (p. 40) C'est là que surgit le plus insoutenable : de l'horreur est née une certaine forme de contentement et d'épanouissement. Les spectateurs et les étrangers ne peuvent le comprendre, eux qui n'ont que répulsion fascinée pour cette « poche de cauchemar sous la terre autrichienne » (p. 12 & 13). Il faudrait que les enfants aveugles crient leur reconnaissance d'avoir été sauvés, mais ils se terrent et cherchent sans cesse à retrouver le confort rassurant de la cave exigüe. « Il avait gardé la nostalgie du sous-sol. Cette conque, cette coquille qu'ils remplissaient toute entière comme jaune et blanc d'un œuf. » (p. 27)
L'auteur, qui se met en scène dans son enquête, imagine les suites de cette affaire, ses retombées médiatiques et ses exploitations par le cinéma ou l'édition. Il interroge l'horreur par le prisme du consommable. Il constate que, comme souvent, tout est bon pour vendre, même si la recette est mauvaise. « Les victimes sont décevantes, parfois les martyrs ne sont pas des héros. » (p. 32) Dans son enquête – réelle ou non – il visite la trop fameuse cave et c'est la que se déroule une des scènes les plus terribles du roman : son guide et lui sont assaillis par une foule de rats à laquelle ils n'échappent qu'en fuyant à toutes jambes. Voilà que l'horreur a tenté de s'emparer d'eux, de les recouvrir. En quittant ainsi les lieux, des questions sont restées sans réponse, mais c'est sûrement mieux ainsi. « Si comme dans l'Enfer de Dante il y avait des cercles dans la cave, tout le monde a préféré s'abstenir de les visiter tous. » (p. 83) Enfin, création ou vérité, une phrase lancée à l'auteur témoigne de l'ambivalence de son travail : « Au revoir, écrivain. D'après le site que j'ai regardé tout à l'heure, on vous prend pour un cinglé. Alors personne ne vous croira. » (p. 184) Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit, savoir s'il faut croire ou non ce qu'écrit Régis Jauffret ? Mais puisqu'on vous dit que c'est un roman, c'est écrit sur la couverture.
Ce sur quoi il vaut mieux s'interroger, c'est sur notre capacité à nous enfermer nous-mêmes. Fritzl a poussé l'expérience à l'extrême. Mais bien fous serions-nous si nos pensions que nous sommes libres. « On habite toujours un espace clos, on ne court jamais bien loin, les voitures suivent des routes, les trains des rails, les avions, les fusées ne rejoindront jamais l'infini. On se cogne toujours quelque part. » (p. 321)
Ouvrir ce livre, c'est ouvrir la porte de la cave et suivre Fritzl dans le souterrain. C'est faire ce que chacun a fait après la révélation de cette funeste histoire : imaginer le spectacle de cette famille captive. S'il est bien impossible de partager et de ressentir ce que cela fut, il suffit de soulever la trappe pour respirer les relents du rêve étrange d'un homme ivre de domination. Mais tout cela, on le doit à l'imagination de l'auteur. Bien que très probable, la ronde des psychiatres, des journalistes et des enquêteurs est inventée. Inventée aussi l'étrange relation entre Fritzl et son avocat. Fantasmées les années obscures du petit peuple de la cave. « Leur histoire devenue bientôt un conte de sorcière, un mythe dont on doutera des origines. Angelika et les ombres sur l'écran de la caverne dont Socrate ne dira jamais rien. Les phrases inhabitées des médias, des causeurs, des fabricants de romans. La cohorte des apprentis Platon, des jongleurs, bateleurs de la syntaxe, la poudre aux yeux du . » (p. 535)
Claustria enferme le lecteur. Ne riez pas, ce n'est pas qu'une formule. Véritablement, j'ai été prise et captive de cette histoire. Elle s'est accrochée, ne m'a pas lâchée. Plus approchait le terme du roman et moins je savais si je devais être soulagée ou déçue. Claustria est un roman de l'ambivalence : j'ai aimé être captive, j'en ai redemandé quitte, pour cela, à devoir encore assister à l'horreur. De la pitié pour Angelika et les enfants, oui j'en ai eu. Mais j'ai aimé ce roman, encore plus.
Un grand merci à Babelio ainsi qu'aux éditions de Seuil pour m'avoir permis de lire la plume de Jauffret à travers le dernier bain de Flaubert et de redécouvrir la biographie de ce dernier.
Alors qu'il prend un bain, Gustave Flaubert meurt. C'est à partir de là que tout le déroulé de sa vie va nous apparaître à travers le récit du narrateur qui n'est autre que le fameux écrivain lui-même, s'exprimant à la première personne en s'adressant directement au lecteur dans un premier temps, le récit est à la troisième personne dans la deuxième partie du livre.
Jauffret à travers Flaubert nous fait le récit de la période de l'enfance précoce et de la jeunesse de Flaubert en Normandie et son lot de souvenirs familiaux, scolaires, l'omniprésence de la lecture puis de l'écriture qui ont occupé la vie du héros, une vie vouée à ces deux passions, c'est d'une part l'intérêt et l'enthousiasme de l'enfant et de l'adolescent lecteur pour tous les genres de livres, l'identification forte aux personnages et à leurs actions, puis les anecdotes sur les maladresses de l'écrivain distrait, trop absorbé par ses lectures ainsi que le nombre incalculables de livres que Flaubert a ingurgité pour l'écriture de Bouvard et Pécuchet. L'auteur nous raconte tout ceci avec humour.
L'auteur nous livre également des passages plus ou moins connus de la vie de Flaubert avec son lot d'amours pour les deux sexes, la débauche durant sa jeunesse, les considérations sur la vision du sexe de ce siècle mais aussi l'amour véritable qui a foudroyé Flaubert, cet amour disparu trop tôt, la maladie invalidante pour un écrivain, la peur qu'elle engendre.
Dans le livre il est aussi question de la mort, des deuils précoces qui ont touché Flaubert.
C'est un roman dans lesquels les personnages de Flaubert prennent en charge la critique de ses oeuvres, se mettent à la place du lecteur, de l'auteur, du narrateur permettant de brouiller les codes traditionnels de la narration, Le fantôme d'Emma Bovary hante le récit. Il en est de même pour le style, si cher à Flaubert, Jauffret mêlant l'écriture classique à un style plus actuel et qui lui est personnel, le récit est parsemé de remarques humoristiques et satiriques comme les aimait Flaubert. Jauffret reconstruit aussi des scènes de la vie du grand écrivain, devenant ainsi l'écrivain- relais nous transmettant de manière romancée avec son art de conter la biographie, le personnage et la construction de l'oeuvre de Flaubert.
Jauffret reprend également les expressions de Flaubert et de son époque pour donner un rendu réaliste à son personnage fort autour duquel tourne le récit. Flaubert est caractérisé par l'humour, l'ironie, la satire, le cynisme mais aussi par une grande sensibilité, une certaine solitude contrebalancée par le goût des bonnes choses de la vie.
Des allers-retours, des télescopages entre les deux époques ont lieu, la nôtre, celle de Jauffret / Flaubert nous interpellant de son 19e siècle. On sent ainsi le mélange des époques dans le style, les tonalités, la prise en charge de la parole par les personnages mimant le travail et les recherches de Flaubert sur l'écriture et le genre du roman pour le renouveler.
Dans son roman, Jauffret rend un vibrant hommage à Gustave Flaubert à la mesure de ce que ce dernier a apporté à la littérature française.
Alors qu'il prend un bain, Gustave Flaubert meurt. C'est à partir de là que tout le déroulé de sa vie va nous apparaître à travers le récit du narrateur qui n'est autre que le fameux écrivain lui-même, s'exprimant à la première personne en s'adressant directement au lecteur dans un premier temps, le récit est à la troisième personne dans la deuxième partie du livre.
Jauffret à travers Flaubert nous fait le récit de la période de l'enfance précoce et de la jeunesse de Flaubert en Normandie et son lot de souvenirs familiaux, scolaires, l'omniprésence de la lecture puis de l'écriture qui ont occupé la vie du héros, une vie vouée à ces deux passions, c'est d'une part l'intérêt et l'enthousiasme de l'enfant et de l'adolescent lecteur pour tous les genres de livres, l'identification forte aux personnages et à leurs actions, puis les anecdotes sur les maladresses de l'écrivain distrait, trop absorbé par ses lectures ainsi que le nombre incalculables de livres que Flaubert a ingurgité pour l'écriture de Bouvard et Pécuchet. L'auteur nous raconte tout ceci avec humour.
L'auteur nous livre également des passages plus ou moins connus de la vie de Flaubert avec son lot d'amours pour les deux sexes, la débauche durant sa jeunesse, les considérations sur la vision du sexe de ce siècle mais aussi l'amour véritable qui a foudroyé Flaubert, cet amour disparu trop tôt, la maladie invalidante pour un écrivain, la peur qu'elle engendre.
Dans le livre il est aussi question de la mort, des deuils précoces qui ont touché Flaubert.
C'est un roman dans lesquels les personnages de Flaubert prennent en charge la critique de ses oeuvres, se mettent à la place du lecteur, de l'auteur, du narrateur permettant de brouiller les codes traditionnels de la narration, Le fantôme d'Emma Bovary hante le récit. Il en est de même pour le style, si cher à Flaubert, Jauffret mêlant l'écriture classique à un style plus actuel et qui lui est personnel, le récit est parsemé de remarques humoristiques et satiriques comme les aimait Flaubert. Jauffret reconstruit aussi des scènes de la vie du grand écrivain, devenant ainsi l'écrivain- relais nous transmettant de manière romancée avec son art de conter la biographie, le personnage et la construction de l'oeuvre de Flaubert.
Jauffret reprend également les expressions de Flaubert et de son époque pour donner un rendu réaliste à son personnage fort autour duquel tourne le récit. Flaubert est caractérisé par l'humour, l'ironie, la satire, le cynisme mais aussi par une grande sensibilité, une certaine solitude contrebalancée par le goût des bonnes choses de la vie.
Des allers-retours, des télescopages entre les deux époques ont lieu, la nôtre, celle de Jauffret / Flaubert nous interpellant de son 19e siècle. On sent ainsi le mélange des époques dans le style, les tonalités, la prise en charge de la parole par les personnages mimant le travail et les recherches de Flaubert sur l'écriture et le genre du roman pour le renouveler.
Dans son roman, Jauffret rend un vibrant hommage à Gustave Flaubert à la mesure de ce que ce dernier a apporté à la littérature française.
Régis Jauffret propose ici un livre très intime en se tournant vers le passé de son père, après la découverte d'un documentaire sur la police de Vichy, tourné en 1943 et où il retrouve celui-ci menotté entre deux policiers de la Gestapo. N'ayant jamais entendu parler de cet épisode, il mène une enquête à la fois historique et familiale afin de percer le mystère de cet homme qu'il ne connaît pas vraiment.
Régis Jauffret exhume son enfance, la rencontre de ses parents, sa naissance… Son père, Alfred Jauffret, employé dans l'entreprise d'un cousin, vit une véritable tragédie en raison d'une surdité devenue totale et d'une bipolarité consécutive à ses traitements qui l'isolent de plus en plus. Par petites touches, l'auteur va plonger dans ses souvenirs afin de redessiner l'homme qui n'a jamais eu un vrai comportement de père.
La part de fiction est aussi réduite que possible, toutefois, ayant peu d'informations, l'imaginaire lui permet d'émettre des hypothèses et de faire surgir le passé. « La réalité justifie la fiction » écrit Jauffret ; en effet, sans la fiction ce livre ne pourrait pas exister. Les mots sont quelquefois durs, mais réalistes, parfois atténués par la description de moments de complicité, souvenirs d'enfance, mais le plus souvent inventés.
Il essaie de comprendre qui était ce père absent, sans relief et sans passions, qu'il n'admirait pas, et cette alternance de souvenirs et d'imagination lui permet de façonner un père plus proche de celui qu'il aurait aimé avoir. « On a le droit de rêver son père », de découvrir qu'on pourrait l'aimer malgré ses lacunes.
L'ensemble du récit forme un portrait original et sans concession d'un homme qui « n'existait pas beaucoup », mais il donne finalement le sentiment que l'auteur a enfin trouvé un père.
Régis Jauffret exhume son enfance, la rencontre de ses parents, sa naissance… Son père, Alfred Jauffret, employé dans l'entreprise d'un cousin, vit une véritable tragédie en raison d'une surdité devenue totale et d'une bipolarité consécutive à ses traitements qui l'isolent de plus en plus. Par petites touches, l'auteur va plonger dans ses souvenirs afin de redessiner l'homme qui n'a jamais eu un vrai comportement de père.
La part de fiction est aussi réduite que possible, toutefois, ayant peu d'informations, l'imaginaire lui permet d'émettre des hypothèses et de faire surgir le passé. « La réalité justifie la fiction » écrit Jauffret ; en effet, sans la fiction ce livre ne pourrait pas exister. Les mots sont quelquefois durs, mais réalistes, parfois atténués par la description de moments de complicité, souvenirs d'enfance, mais le plus souvent inventés.
Il essaie de comprendre qui était ce père absent, sans relief et sans passions, qu'il n'admirait pas, et cette alternance de souvenirs et d'imagination lui permet de façonner un père plus proche de celui qu'il aurait aimé avoir. « On a le droit de rêver son père », de découvrir qu'on pourrait l'aimer malgré ses lacunes.
L'ensemble du récit forme un portrait original et sans concession d'un homme qui « n'existait pas beaucoup », mais il donne finalement le sentiment que l'auteur a enfin trouvé un père.
Régis Jauffret décrit son enfance et montre combien son père Alfred était peu présent "Un personnage secondaire". Ainsi, lorsqu'il voit son père à la télévision arrêté par la Gestapo, il s'interroge et se met à rêver d'un père qui, s'il n'avait pas été sourd et assommé par des neuroleptiques, aurait été un héros.
Son père devient alors celui qu'il aurait souhaité, un père puissant, un père aimant, un héros. "Il faut toujours se méfier des romanciers. Quand le réel leur déplaît, ils le remplacent par une fiction."
Les passages qui m'ont le plus émue sont ceux qui montrent ô combien un seul geste, une seule petite attention d'Alfred envers son fils prend une importance démesurée aux yeux de Régis.
La fin est extrêmement émouvante et conclu de façon majestueuse ce roman autobiographique.
"Malgré tout, ce bonheur inventé restera dans ma mémoire pour illuminer le visage de ce père tant désiré dont la vie m'a frustré."
Son père devient alors celui qu'il aurait souhaité, un père puissant, un père aimant, un héros. "Il faut toujours se méfier des romanciers. Quand le réel leur déplaît, ils le remplacent par une fiction."
Les passages qui m'ont le plus émue sont ceux qui montrent ô combien un seul geste, une seule petite attention d'Alfred envers son fils prend une importance démesurée aux yeux de Régis.
La fin est extrêmement émouvante et conclu de façon majestueuse ce roman autobiographique.
"Malgré tout, ce bonheur inventé restera dans ma mémoire pour illuminer le visage de ce père tant désiré dont la vie m'a frustré."
Il y a deux ans, totalement par hasard, le romancier Regis Jauffret regarde un documentaire sur le Régime de Vichy et tombe sur une séquence très courte- à peine 7 secondes- dans laquelle il reconnait immédiatement son propre père, qui est emmené menotté par deux agents de la Gestapo.
N'ayant jamais eu vent de cet épisode pourtant important dans la vie de son père, Régis Jauffret, qui n'avait jamais beaucoup considéré son géniteur, être effacé et peu aimant, se met à enquêter sur lui en recueillant des témoignages de son famille encore vivante ou en consultant des archives et surtout se met à avoir une image différente de son père et lui réinventer un destin plus romanesque que l'image qu'il avait de lui.
Régis Jauffret a éprouvé ainsi le désir ( le besoin?) que son père soit autre chose que ce qu’il a montré, et et c’est là tout l'objet de cette enquête qui prendra sa source dans la maison familiale de l’enfance du narrateur à Marseille.
Il faut dire qu'Alfred Jauffret était a priori un être d'une envergure assez médiocre: sourd, effacé, bipolaire, assommé par les médicaments, avare en mots et en geste d'affection : on ne peut pas dire que le portrait que l'auteur de "Micro-Fictions" fait de son père avant qu'il ne découvre ces images modifiant sa perpection de lui soit des plus flatteuses.
Et c'est grâce à ce roman, et donc à la littérature que Jauffret, par petites touches non dépourvues d'humour mais complètement délestées de pathos et de sentimentalisme, repart à la rencontre de son géniteur et lui offre une seconde chance et parvient in fine à utiliser ce mot qu'il n'avait jamais osé pour parler de lui: ce "papa" dont le titre du roman est totalement légitime.
Plus intime et touchante qu'à l'accoutumée, la plume, toujours épurée et à l'os de Jauffret réussit son challenge. La littérature comme seconde chance pour redorer l'image d'un être a priori sans histoire: le défi était de taille sur le papier et Jauffret le réussit haut la main !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
N'ayant jamais eu vent de cet épisode pourtant important dans la vie de son père, Régis Jauffret, qui n'avait jamais beaucoup considéré son géniteur, être effacé et peu aimant, se met à enquêter sur lui en recueillant des témoignages de son famille encore vivante ou en consultant des archives et surtout se met à avoir une image différente de son père et lui réinventer un destin plus romanesque que l'image qu'il avait de lui.
Régis Jauffret a éprouvé ainsi le désir ( le besoin?) que son père soit autre chose que ce qu’il a montré, et et c’est là tout l'objet de cette enquête qui prendra sa source dans la maison familiale de l’enfance du narrateur à Marseille.
Il faut dire qu'Alfred Jauffret était a priori un être d'une envergure assez médiocre: sourd, effacé, bipolaire, assommé par les médicaments, avare en mots et en geste d'affection : on ne peut pas dire que le portrait que l'auteur de "Micro-Fictions" fait de son père avant qu'il ne découvre ces images modifiant sa perpection de lui soit des plus flatteuses.
Et c'est grâce à ce roman, et donc à la littérature que Jauffret, par petites touches non dépourvues d'humour mais complètement délestées de pathos et de sentimentalisme, repart à la rencontre de son géniteur et lui offre une seconde chance et parvient in fine à utiliser ce mot qu'il n'avait jamais osé pour parler de lui: ce "papa" dont le titre du roman est totalement légitime.
Plus intime et touchante qu'à l'accoutumée, la plume, toujours épurée et à l'os de Jauffret réussit son challenge. La littérature comme seconde chance pour redorer l'image d'un être a priori sans histoire: le défi était de taille sur le papier et Jauffret le réussit haut la main !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Extraites du gros recueil « Microfictions », ces nouvelles brèves ne dépassant pas une ou deux pages veulent rendre compte du sentiment amoureux dans ce qu’il a de plus noir, de plus abject ou décadent.
L’Amour chez Régis Jauffret ne rime pas avec toujours, il ne s’associe pas à la perception éthérée du Beau, ni ne s’auréole de pensées harmonieuses ou de sentiments purs et immaculés.
Ici nul romantisme, nul abandon, nulle inclinaison aimable.
L’amour y est assorti de sentiments vils, méprisables et dégradants. Le désir y est sale, honteux et sordide.
Les hommes y sont des monstres, des pervers ou des chiffes molles.
« Le sexe a toujours eu peu d’importance pour ma femme. Elle a fait coudre le sien. Elle espérait qu’il finirait par se cicatriser et disparaître sans laisser de trace. »
Les femmes y sont mesquines, dénuées de scrupules ou pétries de ressentiment.
« Mon mari ne me tue pas, mais il gagne si mal sa vie qu’il ne vaut guère mieux qu’un meurtrier. Il m’assassine à petit feu avec son salaire miteux. Je suis pourvue de cinq enfants adorables que je laisserais volontiers sur le bord de la route en échange d’une dent en céramique et d’un rendez-vous chez le coiffeur. »
Tous sont acculés par des désirs malsains, ou bien par un manque de désir et un rejet de l’Autre qui confinent à l’obsession.
Misère sexuelle et morale, dénigrement, avilissement et rancœur, expulsés comme un flot de bile à la face du lecteur en séquences brèves certes, mais si dures et si violentes que l’on ne peut lire que peu à peu, avec parcimonie, une histoire à la fois, sous peine d’en avoir la nausée, écœuré par cette indigence de sentiments qui rend les êtres pitoyables, pathétiques et rebutants.
Régis Jauffret fait exploser ces petits éclats de vie misérable comme on se sert d’un pistolet à grenaille, en canardant le lecteur à coup d’histoires déprimantes et monstrueuses dans ce qu’elles mettent en scène d’individus infâmes, hélas si proches de la réalité.
Malgré la qualité d’écriture, toujours aussi puissante et percutante, on en ressort déstabilisé, endolori, avec la sensation douloureuse du pigeon mitraillé de plomb.
La concision des nouvelles (pas plus de quelques lignes parfois) n’a n’égale que la brusquerie et la férocité avec lesquelles l’auteur du magistral « Claustria » nous les assènent, avec la volonté de faire mal et de nous malmener.
Sèches, coupantes, lapidaires, exécrables de tant de médiocrité, impeccablement écrites mais par trop désespérantes.
« L’amour, marché de dupes, où je n’ai que trop longtemps vendu mes charmes et ma jeunesse, et pleuré des jets d’eau comme si j’avais voulu rincer le trottoir après que tous les étals eurent été démontés. »
Ce que c’est que l’amour selon Régis Jauffret ? Un sentiment cruel et impitoyable qui ne donne qu’une envie, celle de s’enferrer dans la solitude…
L’Amour chez Régis Jauffret ne rime pas avec toujours, il ne s’associe pas à la perception éthérée du Beau, ni ne s’auréole de pensées harmonieuses ou de sentiments purs et immaculés.
Ici nul romantisme, nul abandon, nulle inclinaison aimable.
L’amour y est assorti de sentiments vils, méprisables et dégradants. Le désir y est sale, honteux et sordide.
Les hommes y sont des monstres, des pervers ou des chiffes molles.
« Le sexe a toujours eu peu d’importance pour ma femme. Elle a fait coudre le sien. Elle espérait qu’il finirait par se cicatriser et disparaître sans laisser de trace. »
Les femmes y sont mesquines, dénuées de scrupules ou pétries de ressentiment.
« Mon mari ne me tue pas, mais il gagne si mal sa vie qu’il ne vaut guère mieux qu’un meurtrier. Il m’assassine à petit feu avec son salaire miteux. Je suis pourvue de cinq enfants adorables que je laisserais volontiers sur le bord de la route en échange d’une dent en céramique et d’un rendez-vous chez le coiffeur. »
Tous sont acculés par des désirs malsains, ou bien par un manque de désir et un rejet de l’Autre qui confinent à l’obsession.
Misère sexuelle et morale, dénigrement, avilissement et rancœur, expulsés comme un flot de bile à la face du lecteur en séquences brèves certes, mais si dures et si violentes que l’on ne peut lire que peu à peu, avec parcimonie, une histoire à la fois, sous peine d’en avoir la nausée, écœuré par cette indigence de sentiments qui rend les êtres pitoyables, pathétiques et rebutants.
Régis Jauffret fait exploser ces petits éclats de vie misérable comme on se sert d’un pistolet à grenaille, en canardant le lecteur à coup d’histoires déprimantes et monstrueuses dans ce qu’elles mettent en scène d’individus infâmes, hélas si proches de la réalité.
Malgré la qualité d’écriture, toujours aussi puissante et percutante, on en ressort déstabilisé, endolori, avec la sensation douloureuse du pigeon mitraillé de plomb.
La concision des nouvelles (pas plus de quelques lignes parfois) n’a n’égale que la brusquerie et la férocité avec lesquelles l’auteur du magistral « Claustria » nous les assènent, avec la volonté de faire mal et de nous malmener.
Sèches, coupantes, lapidaires, exécrables de tant de médiocrité, impeccablement écrites mais par trop désespérantes.
« L’amour, marché de dupes, où je n’ai que trop longtemps vendu mes charmes et ma jeunesse, et pleuré des jets d’eau comme si j’avais voulu rincer le trottoir après que tous les étals eurent été démontés. »
Ce que c’est que l’amour selon Régis Jauffret ? Un sentiment cruel et impitoyable qui ne donne qu’une envie, celle de s’enferrer dans la solitude…
Une liaison sado-masochiste entre un "prince de la finance et sa putain" (sic). Relation sulfureuse à souhait, puisque les rôles de domination/soumission ne se limitent pas aux jeux sexuels. L'homme est richissime, donc tout-puissant (il manipule les ministres à l'envi), tyrannique, sadique avec tous, sans scrupules, sans tabous. Il jouit d'humilier, mais aussi d'être maltraité lorsqu'il le décide, et de frôler la mort de très près. C'est sa maîtresse qui domine lors de leurs "séances", mais c'est toujours lui qui fixe les règles.
Si le "maître" se révèle aussi répugnant que pitoyable, la jeune femme paraît en revanche attachante et paumée. Son témoignage suscite bien des questions. Amour ou vénalité de sa part ? Besoin de se sentir indispensable à un homme, indubitablement. Sexe ? oui, du tendre (très rarement) au plus dérangeant (principalement). Argent, pouvoir et perversité par-dessus tout... Quid du mari ? lui aussi pervers ? ou lâche et veule ?
Régis Jauffret s'est inspiré pour écrire ce roman de l'affaire "Edouard Stern". Cette fiction est l'occasion pour le lecteur de prendre conscience de son propre voyeurisme. De sa jubilation malsaine à se repaître de sordide et de détails indécents, de son plaisir mesquin à voir un riche/puissant tomber, traîné dans la boue, victime de sa sexualité (cf. DSK).
Malgré le sentiment de malaise qui ne m'a pas quittée, j'ai dévoré ce roman. Ceci notamment grâce à une plume précise qui va à l'essentiel, au fond de la fange, sans exhibitionnisme pour autant.
--- Régis Jauffret, un auteur que j'ai envie de découvrir davantage.
Si le "maître" se révèle aussi répugnant que pitoyable, la jeune femme paraît en revanche attachante et paumée. Son témoignage suscite bien des questions. Amour ou vénalité de sa part ? Besoin de se sentir indispensable à un homme, indubitablement. Sexe ? oui, du tendre (très rarement) au plus dérangeant (principalement). Argent, pouvoir et perversité par-dessus tout... Quid du mari ? lui aussi pervers ? ou lâche et veule ?
Régis Jauffret s'est inspiré pour écrire ce roman de l'affaire "Edouard Stern". Cette fiction est l'occasion pour le lecteur de prendre conscience de son propre voyeurisme. De sa jubilation malsaine à se repaître de sordide et de détails indécents, de son plaisir mesquin à voir un riche/puissant tomber, traîné dans la boue, victime de sa sexualité (cf. DSK).
Malgré le sentiment de malaise qui ne m'a pas quittée, j'ai dévoré ce roman. Ceci notamment grâce à une plume précise qui va à l'essentiel, au fond de la fange, sans exhibitionnisme pour autant.
--- Régis Jauffret, un auteur que j'ai envie de découvrir davantage.
"Pardonnez nos enfances, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfantés" chantait Daniel Darc*.
D'enfance et de parents, il est beaucoup question dans ce court récit. Régis Jauffret raconte comment, un soir de 2018, il reconnaît son père à la télévision, dans un documentaire sur la police de Vichy. Sur les images d'archives, son père vient d'être arrêté et emmené par la Gestapo. Stupeur. Et incompréhension, car jamais cet épisode n'a été évoqué au sein de la famille.
Jauffret raconte alors son père ; du moins, des bribes de père (une "dentelle de papa" écrit-il), car celui-ci, atteint de surdité puis de dépression, n'était qu'une présence abstraite dans la vie de l'auteur. Ce faisant, ce dernier cherche également à résoudre le mystère de cette vidéo, et imagine à cette occasion toutes sortes de scenarii pour y parvenir. Il imagine alors un autre homme, un autre père, qu'il oppose à tous les sentiments éprouvés à l'égard de son géniteur tout au long de son existence.
C'est donc un drôle de récit, à la fois dur, émouvant, autobiographique, fictif, et violemment cru. J'ai bien aimé les réflexions sur l'enfance qui l'émaillent. J'ai aussi été touchée par cette quête du père, cette recherche de la vérité, ce besoin de pardon. Et aussi par cette volonté d'être heureux malgré tout : "un de ces souvenirs de bonheur qui vous donnent raison de n'être jamais entré chez un armurier pour acheter de quoi vous tirer une balle dans la tête".
Une étrange affaire, donc.
* d'après le titre d'un livre de Muriel Rigal
D'enfance et de parents, il est beaucoup question dans ce court récit. Régis Jauffret raconte comment, un soir de 2018, il reconnaît son père à la télévision, dans un documentaire sur la police de Vichy. Sur les images d'archives, son père vient d'être arrêté et emmené par la Gestapo. Stupeur. Et incompréhension, car jamais cet épisode n'a été évoqué au sein de la famille.
Jauffret raconte alors son père ; du moins, des bribes de père (une "dentelle de papa" écrit-il), car celui-ci, atteint de surdité puis de dépression, n'était qu'une présence abstraite dans la vie de l'auteur. Ce faisant, ce dernier cherche également à résoudre le mystère de cette vidéo, et imagine à cette occasion toutes sortes de scenarii pour y parvenir. Il imagine alors un autre homme, un autre père, qu'il oppose à tous les sentiments éprouvés à l'égard de son géniteur tout au long de son existence.
C'est donc un drôle de récit, à la fois dur, émouvant, autobiographique, fictif, et violemment cru. J'ai bien aimé les réflexions sur l'enfance qui l'émaillent. J'ai aussi été touchée par cette quête du père, cette recherche de la vérité, ce besoin de pardon. Et aussi par cette volonté d'être heureux malgré tout : "un de ces souvenirs de bonheur qui vous donnent raison de n'être jamais entré chez un armurier pour acheter de quoi vous tirer une balle dans la tête".
Une étrange affaire, donc.
* d'après le titre d'un livre de Muriel Rigal
Un homme de 87 ans se marie.
Je me demande comment, vu son âge l'histoire va pouvoir tenir 275 pages.
Mais, à la page 27, je me rends compte qu'il s'agit en fait de nouvelles.
Je n'affectionne pas particulièrement, mais là, je me suis régalée.
Des nouvelles sur la vieillesse.
Et avec le ton et le style de l'auteur, on ne peut que se régaler.
D'accord, certaines sont bien glauques, mais d'autres sont tellement tendres, ou loufoques.
Ils en vivent des choses tous ces vieux !
Quand on est jeune, on croit qu'ils sont finis, qu'il ne se passe plus rien, mais que nenni.
Ils ne sont peut-être pas loin de la tombe, mais leur personnalité est toujours bien présente et ils ne s'en laissent pas conter.
Il fallait le talent d'écrivain de Régis Jauffret et sa belle écriture pour mener à bien ces seize nouvelles délectables.
Même si je les ai toutes aimées, ma préférence va à « L'explosion du langage », un petit chef d'oeuvre de littérature.
Je me demande comment, vu son âge l'histoire va pouvoir tenir 275 pages.
Mais, à la page 27, je me rends compte qu'il s'agit en fait de nouvelles.
Je n'affectionne pas particulièrement, mais là, je me suis régalée.
Des nouvelles sur la vieillesse.
Et avec le ton et le style de l'auteur, on ne peut que se régaler.
D'accord, certaines sont bien glauques, mais d'autres sont tellement tendres, ou loufoques.
Ils en vivent des choses tous ces vieux !
Quand on est jeune, on croit qu'ils sont finis, qu'il ne se passe plus rien, mais que nenni.
Ils ne sont peut-être pas loin de la tombe, mais leur personnalité est toujours bien présente et ils ne s'en laissent pas conter.
Il fallait le talent d'écrivain de Régis Jauffret et sa belle écriture pour mener à bien ces seize nouvelles délectables.
Même si je les ai toutes aimées, ma préférence va à « L'explosion du langage », un petit chef d'oeuvre de littérature.
Pendant quelques jours , j'ai regardé ce livre sans pouvoir l'ouvrir avec la crainte de lire une histoire monstrueuse , d'être voyeuse , de ne pas savoir prendre du recul , puis j'ai commencé quelques pages et j'ai de nouveau attendu quelques jours avant de me lancer et ..... de ne plus savoir m'arrêter .
Impossible pour un tel sujet de mettre 5 étoiles et pourtant , je ne m'attendais pas à un tel talent , un véritable tour de force de l'auteur , ce récit , roman , fiction tout à la fois ne tombe jamais dans le voyeurisme et en cela je remercie l'auteur , avant de le lire j'avais lu les critiques très positives et en le lisant , j'ai compris ; le talent de l'auteur réussit à dire l'indicible , comme il le dit lui -même , comme si cette histoire allait devenir un conte avec un ogre des temps modernes et ne plus être réelle , pour pouvoir être entendue .
Nous sommes dans la cave avec Angelika , nous sommes elle , elle qui attend la visite de son père-bourreau , qui la prive d'électricité , d'eau , de nourriture , qui va lui faire des enfants , certains qu'il remontera , certains qui deviendront les enfants d'en-bas .
Ce père pris dans sa folie , fier de cette famille , lors de son arrestation , la police médusée va entendre son délire , qu'il livre avec le sourire , il a essayé de créer une famille à sa démesure , où il est le père tout puissant .
L'auteur n'a pas choisi un récit linéaire , il fait des retours en arrière comme le temps dans la cave , qui n'était pas linéaire , parfois long , sans but , parfois des hallucinations de le vie libre , parfois même des moments de bonheur , même si ça nous semble encore plus horrible , oui la victime a eu des moments de bonheur pour que sa raison ne vacille pas , les enfants ont eu une enfance ' même dans la cave l'enfance est tenace ' , récit qui suit les souvenirs qui ne sont pas linéaires non plus .
Impossible pour un tel sujet de mettre 5 étoiles et pourtant , je ne m'attendais pas à un tel talent , un véritable tour de force de l'auteur , ce récit , roman , fiction tout à la fois ne tombe jamais dans le voyeurisme et en cela je remercie l'auteur , avant de le lire j'avais lu les critiques très positives et en le lisant , j'ai compris ; le talent de l'auteur réussit à dire l'indicible , comme il le dit lui -même , comme si cette histoire allait devenir un conte avec un ogre des temps modernes et ne plus être réelle , pour pouvoir être entendue .
Nous sommes dans la cave avec Angelika , nous sommes elle , elle qui attend la visite de son père-bourreau , qui la prive d'électricité , d'eau , de nourriture , qui va lui faire des enfants , certains qu'il remontera , certains qui deviendront les enfants d'en-bas .
Ce père pris dans sa folie , fier de cette famille , lors de son arrestation , la police médusée va entendre son délire , qu'il livre avec le sourire , il a essayé de créer une famille à sa démesure , où il est le père tout puissant .
L'auteur n'a pas choisi un récit linéaire , il fait des retours en arrière comme le temps dans la cave , qui n'était pas linéaire , parfois long , sans but , parfois des hallucinations de le vie libre , parfois même des moments de bonheur , même si ça nous semble encore plus horrible , oui la victime a eu des moments de bonheur pour que sa raison ne vacille pas , les enfants ont eu une enfance ' même dans la cave l'enfance est tenace ' , récit qui suit les souvenirs qui ne sont pas linéaires non plus .
Habitué à décrire, dans ses précédents romans, des situations de folie et de sadisme, Régis Jauffret choisit de raconter, avec Dans le ventre de Klara, la grossesse de la mère d’Adolf Hitler, à partir des rares documents historiques, apportant ainsi sa contribution à l’Histoire.
Enfermé dans une contrainte extrême, ce portrait de femme du XIXè siècle décrit le chemin vers la folie où sa moindre parcelle de liberté lui sera étouffée. La description des différentes formes de domination répondra aux événements historiques à venir : l’enfant à naître, devenu adulte, va osciller entre venger les souffrances infligées à sa mère et répondre aux volontés viriles de son père. Avec ce roman, l’écrivain revient à la fiction avec un roman âpre, dense et terrifiant à la fois, mais absolument réussi !
Brins d’histoire
Klara raconte sa vie muselée, contrainte, réduite à un esclavage domestique suivant la volonté d’Aloïs. Sa culpabilité, de ne jamais pouvoir le satisfaire, elle la retourne contre elle jusqu’à s’abîmer dans la dévotion. Sa peur de perdre l’enfant qu’elle porte est omniprésente, elle qui a déjà mis au mode d’autres enfants qui sont morts depuis.
Pour échapper à ces émotions mortifères, elle tente de conserver une part de liberté. Elle écrit son ressenti dans des petits carnets, d’une écriture qui, au fil du temps, devient illisible. Son passage de domestique à épouse de l’homme qu’elle appelle Oncle, ne lui donne aucun avantage. Car la loi de l’homme, violent, y règne avec brutalité, en paroles et en actes. La mère d’Hitler vit dans la peur, la soumission et l’enfermement.
Emprisonnée par la domination masculine, Klara garde sa foi vivace. Mais, au lieu d’y trouver le réconfort nécessaire, elle subit, là encore, les diktats de la religion, incarnée par un abbé, étriqué dans ses principes intégristes. Il la soumet aux paroles de dieu en fustigeant ses actions dignes, pense-t-il, du diable.
Dénigrée par son mari et aussi par son confesseur, elle n’a que l’écriture pour trouver un peu de plaisir dans sa vie de misère. Mais, au fil des pages, cette espace de liberté sera restreinte aussi. Aucune colère pourtant, jamais ne s’exprime !
C’est le portrait d’une société enfermée dans un patriarcat absolu et une religion omniprésente où l’antisémitisme y est constant et où le rêve d’une grandeur retrouvée berce les rêves de chacun. Cette partie reculée de l’Autriche, proche de la frontière avec l’Allemagne, porte dans sa société, le contexte de l’acceptation de la dictature à venir.
Fiction pour expliquer l’Histoire
Reconnu pour ses combats contre les manipulations de toutes sortes, Régis Jauffret se propose d’éclairer la personnalité d’Hitler par la personnalité de sa mère, subissant le joug de contraintes extrêmes ne pouvant qu’entamer sa santé mentale.
Ainsi, et Régis Jauffret le rappelle, Adolf est le fruit d’un inceste entre Aloïs et sa nièce, Klara. Malgré cela, l’église a légitimé leur mariage, ce qui renforce la culpabilité de la jeune femme qui se considère comme le diable incarné. Comme un écho à son roman Claustria, paru en 2012, pour lequel il avait été condamné en diffamation pour avoir dénoncé des lois autrichiennes assez liberticides sur l’inceste, Dans le ventre de Klara reprend les faits historiques et envisage leurs conséquences sur ses personnages du XIXè siècle.
L’Oncle ressemble aussi au héros d’un de ses précédents romans, La Ballade de Rikers Island, publié en 2014 sur le prédateur sexuel qu’était DSK. Car, Régis Jauffret terrifie en décrivant les appétits sexuels de cet homme que Klara subit complètement, même avant le décès de sa première femme.
Autant dire que l’univers de ce nouveau roman en exploitant les faits historiques ne pouvait qu’interesser Régis Jauffret !
Une réussite !
L’étau ressenti à la lecture devient de plus en plus insupportable. La domination vécue par Klara, de plus en plus contraignante, étouffe l’espace du lecteur. La narration oblige plusieurs fois à arrêter la lecture pour reprendre son souffle, la puissance fictionnelle devenant insupportable !
L’oscillation entre l’empathie et la répulsion est constante : la sympathie grandit pour la fragilité de cette femme, puis quelques pages plus loin, la colère revient devant cette folie mystique qui semble plus la cadenasser. Son acceptation, que toutes ces violences sont des signes de dieu pour éprouver sa croyance, est insoutenable.
Évidemment, Régis Jauffret aborde l’antisémitisme de la famille et laisse sous-entendre, sans s’y attarder, la possible ascendance juive du futur Führer. Rien n’ayant été prouvé généalogiquement, il lui était difficile de suivre cette thèse.
L’art de la narration de Régis Jauffret n’est plus à présenter. Dans le ventre de Klara, le style est percutant et puissant. Présenter ici comme responsable de toutes les erreurs, le personnage justifie la protection que le jeune Hitler lui a accordée lors de sa jeunesse et la douleur qu’il a ressentie lors de sa mort. Mais, la haine de ce père brutal et violent qui ne cesse de dénigrer ceux qui l’entoure a dû provoquer des envies de violences dont l’homme n’a eu de cesse de se venger.
En conclusion,
La banalisation du mal dont Hannah Arendt a développé le concept s’illustre ici dans le quotidien des brimades et de l’enfermement de cette femme. Fonctionnaire médiocre, Aloïs maltraite, harcèle et dénigre son entourage de façon systématique avec l’assentiment de l’église, sans aucun affect. Il commet les crimes de viols, d’agressions sexuelles, de violences physiques et psychologiques sans aucun ressenti et en toute impunité puisque sa femme est une “moins que rien”, incapable, paresseuse, bête et habitée par le diable…Un quotidien de crimes répétés, inéluctablement, sans répit et sans affect !
Une démonstration implacable, un style maîtrisé, des personnages inoubliables, des clefs de compréhension…Un grand roman assurément !
Lien : https://vagabondageautourdes..
Enfermé dans une contrainte extrême, ce portrait de femme du XIXè siècle décrit le chemin vers la folie où sa moindre parcelle de liberté lui sera étouffée. La description des différentes formes de domination répondra aux événements historiques à venir : l’enfant à naître, devenu adulte, va osciller entre venger les souffrances infligées à sa mère et répondre aux volontés viriles de son père. Avec ce roman, l’écrivain revient à la fiction avec un roman âpre, dense et terrifiant à la fois, mais absolument réussi !
Brins d’histoire
Klara raconte sa vie muselée, contrainte, réduite à un esclavage domestique suivant la volonté d’Aloïs. Sa culpabilité, de ne jamais pouvoir le satisfaire, elle la retourne contre elle jusqu’à s’abîmer dans la dévotion. Sa peur de perdre l’enfant qu’elle porte est omniprésente, elle qui a déjà mis au mode d’autres enfants qui sont morts depuis.
Pour échapper à ces émotions mortifères, elle tente de conserver une part de liberté. Elle écrit son ressenti dans des petits carnets, d’une écriture qui, au fil du temps, devient illisible. Son passage de domestique à épouse de l’homme qu’elle appelle Oncle, ne lui donne aucun avantage. Car la loi de l’homme, violent, y règne avec brutalité, en paroles et en actes. La mère d’Hitler vit dans la peur, la soumission et l’enfermement.
Emprisonnée par la domination masculine, Klara garde sa foi vivace. Mais, au lieu d’y trouver le réconfort nécessaire, elle subit, là encore, les diktats de la religion, incarnée par un abbé, étriqué dans ses principes intégristes. Il la soumet aux paroles de dieu en fustigeant ses actions dignes, pense-t-il, du diable.
Dénigrée par son mari et aussi par son confesseur, elle n’a que l’écriture pour trouver un peu de plaisir dans sa vie de misère. Mais, au fil des pages, cette espace de liberté sera restreinte aussi. Aucune colère pourtant, jamais ne s’exprime !
C’est le portrait d’une société enfermée dans un patriarcat absolu et une religion omniprésente où l’antisémitisme y est constant et où le rêve d’une grandeur retrouvée berce les rêves de chacun. Cette partie reculée de l’Autriche, proche de la frontière avec l’Allemagne, porte dans sa société, le contexte de l’acceptation de la dictature à venir.
Fiction pour expliquer l’Histoire
Reconnu pour ses combats contre les manipulations de toutes sortes, Régis Jauffret se propose d’éclairer la personnalité d’Hitler par la personnalité de sa mère, subissant le joug de contraintes extrêmes ne pouvant qu’entamer sa santé mentale.
Ainsi, et Régis Jauffret le rappelle, Adolf est le fruit d’un inceste entre Aloïs et sa nièce, Klara. Malgré cela, l’église a légitimé leur mariage, ce qui renforce la culpabilité de la jeune femme qui se considère comme le diable incarné. Comme un écho à son roman Claustria, paru en 2012, pour lequel il avait été condamné en diffamation pour avoir dénoncé des lois autrichiennes assez liberticides sur l’inceste, Dans le ventre de Klara reprend les faits historiques et envisage leurs conséquences sur ses personnages du XIXè siècle.
L’Oncle ressemble aussi au héros d’un de ses précédents romans, La Ballade de Rikers Island, publié en 2014 sur le prédateur sexuel qu’était DSK. Car, Régis Jauffret terrifie en décrivant les appétits sexuels de cet homme que Klara subit complètement, même avant le décès de sa première femme.
Autant dire que l’univers de ce nouveau roman en exploitant les faits historiques ne pouvait qu’interesser Régis Jauffret !
Une réussite !
L’étau ressenti à la lecture devient de plus en plus insupportable. La domination vécue par Klara, de plus en plus contraignante, étouffe l’espace du lecteur. La narration oblige plusieurs fois à arrêter la lecture pour reprendre son souffle, la puissance fictionnelle devenant insupportable !
L’oscillation entre l’empathie et la répulsion est constante : la sympathie grandit pour la fragilité de cette femme, puis quelques pages plus loin, la colère revient devant cette folie mystique qui semble plus la cadenasser. Son acceptation, que toutes ces violences sont des signes de dieu pour éprouver sa croyance, est insoutenable.
Évidemment, Régis Jauffret aborde l’antisémitisme de la famille et laisse sous-entendre, sans s’y attarder, la possible ascendance juive du futur Führer. Rien n’ayant été prouvé généalogiquement, il lui était difficile de suivre cette thèse.
L’art de la narration de Régis Jauffret n’est plus à présenter. Dans le ventre de Klara, le style est percutant et puissant. Présenter ici comme responsable de toutes les erreurs, le personnage justifie la protection que le jeune Hitler lui a accordée lors de sa jeunesse et la douleur qu’il a ressentie lors de sa mort. Mais, la haine de ce père brutal et violent qui ne cesse de dénigrer ceux qui l’entoure a dû provoquer des envies de violences dont l’homme n’a eu de cesse de se venger.
En conclusion,
La banalisation du mal dont Hannah Arendt a développé le concept s’illustre ici dans le quotidien des brimades et de l’enfermement de cette femme. Fonctionnaire médiocre, Aloïs maltraite, harcèle et dénigre son entourage de façon systématique avec l’assentiment de l’église, sans aucun affect. Il commet les crimes de viols, d’agressions sexuelles, de violences physiques et psychologiques sans aucun ressenti et en toute impunité puisque sa femme est une “moins que rien”, incapable, paresseuse, bête et habitée par le diable…Un quotidien de crimes répétés, inéluctablement, sans répit et sans affect !
Une démonstration implacable, un style maîtrisé, des personnages inoubliables, des clefs de compréhension…Un grand roman assurément !
Lien : https://vagabondageautourdes..
Voilà un roman qui déroute, de part sa forme épistolaire mais surtout pas le verbe de l'auteur.
Une jeune femme écrit à sa belle-mère au sujet de sa rupture avec Geoffrey, le fils et amant. Au début, ces deux femmes sont à la limite de la haine puis se rapprochent dangereusement jusqu'à la folie autour de leur haine commune Geoffrey qui est rapidement envisagé comme un futur festin alimentaire...
L'auteur réussit à travers les lettres à dresser le portrait de ces deux femmes, à inoculer un vent de folie et dresse le portrait le plus détestable de l'Homme dans toute sa splendeur.
C'est une pluie de métaphores qui s'invite, des adjectifs cruels, fous qui s'immiscent dans le texte et un rythme tantôt lent, tantôt déroutant.
Au final, que l'on adhère ou pas, l'histoire et le style ne nous laissent pas indifférent et pour ma part, j'ai apprécié cette lecture particulière
Une jeune femme écrit à sa belle-mère au sujet de sa rupture avec Geoffrey, le fils et amant. Au début, ces deux femmes sont à la limite de la haine puis se rapprochent dangereusement jusqu'à la folie autour de leur haine commune Geoffrey qui est rapidement envisagé comme un futur festin alimentaire...
L'auteur réussit à travers les lettres à dresser le portrait de ces deux femmes, à inoculer un vent de folie et dresse le portrait le plus détestable de l'Homme dans toute sa splendeur.
C'est une pluie de métaphores qui s'invite, des adjectifs cruels, fous qui s'immiscent dans le texte et un rythme tantôt lent, tantôt déroutant.
Au final, que l'on adhère ou pas, l'histoire et le style ne nous laissent pas indifférent et pour ma part, j'ai apprécié cette lecture particulière
Je me rends compte que je découvre Régis Jauffret avec ce récit, et je sais que ce livre est atypique par rapport à ses autres ouvrages.
Ici c'est un récit très personnel, puisque suite à un documentaire télévisé, il reconnait son père qui est emmené par des gestapistes devant l'appartement familial.
Dans sa famille, personne n'est au courant de cet épisode et il va essayer de mener une véritable enquête sur cette période.
Il va aussi devoir revenir sur l'histoire de ce père qui lui a toujours été étranger.
En effet son père était bipolaire et atteint de surdité, et au fil des années il va peu à peu s'enfermer dans son monde.
Régis Jauffret a vécu une enfance sans véritables relations avec lui, il le regrette et même le lui reproche.
Ce livre va lui servir à explorer l'histoire familiale et à peu à peu retrouver un certain apaisement.
Son style, très personnel, à l'humour mordant, donne un ton très particulier à ce récit.
Il me reste à découvrir Régie Jauffret dans d'autres textes…
Ici c'est un récit très personnel, puisque suite à un documentaire télévisé, il reconnait son père qui est emmené par des gestapistes devant l'appartement familial.
Dans sa famille, personne n'est au courant de cet épisode et il va essayer de mener une véritable enquête sur cette période.
Il va aussi devoir revenir sur l'histoire de ce père qui lui a toujours été étranger.
En effet son père était bipolaire et atteint de surdité, et au fil des années il va peu à peu s'enfermer dans son monde.
Régis Jauffret a vécu une enfance sans véritables relations avec lui, il le regrette et même le lui reproche.
Ce livre va lui servir à explorer l'histoire familiale et à peu à peu retrouver un certain apaisement.
Son style, très personnel, à l'humour mordant, donne un ton très particulier à ce récit.
Il me reste à découvrir Régie Jauffret dans d'autres textes…
De très loin , une de mes plus mauvaises lectures. Des mots bien enrobés qui se superposent et se suivent . Mais il ne se dégage aucune émotion à la lecture de Papa , juste de la lassitude, voire de l'irritation de subir la frustration capricieuse de l'auteur dont le père, Alfred, n'est pas le héros qu'il aurait tellement voulu qu'il soit. Et ce livre n'a pas d'histoire... n'a pas de fond...n'a pas de tripes. Juste du glucose.
Je m'étais montré dithyrambique à la lecture des 500 nouvelles de “Microfictions”, si controversées.
Il faut dire que Jauffret aime saupoudrer dans sa narration un humour (mais en est-ce ?) sardonique, sulfureux et acide.
Dans ce court livre narrant l’histoire d’un crime commis par une femme prise dans une relation sado-masochiste avec un homme riche, c’est du Jauffret pur jus.
Du sarcasme à souhait, jouant sur le fil entre le fait divers et l’invention : “Dans ce livre, je m’enfonce dans un crime. Je le visite, je le photographie, je le filme, je l’enregistre, je le mixe, je le falsifie. Je suis romancier, je mens comme un meurtrier.”
Avec Jauffret, il faut pouvoir respirer, lire à petits pas, comme j’ai pu le faire entre deux nouvelles calibrées d’une page et demie.
Avec ce roman, j'ai été un peu noyé, comme un plongeur en apnée qui ne peut rejoindre la surface.
Mais je sais qu’il existe un deuxième tome de “Microfictions” …
" A cinquante-deux ans, l’ancien gamin Roman Fritzl était le dernier survivant du petit peuple de la cave. "
C’est sur cette sentence lapidaire que s’ouvre Claustria, roman qui évoque la sordide affaire "Fritzl" : la séquestration d’une jeune autrichienne par son père dans la cave de la maison familiale pendant 24 ans, années au cours desquelles elle a donné naissance à 7 enfants et les a élevés dans des conditions plus que précaires.
Et c’est avec une telle phrase que son auteur, Régis Jauffret, parvient d’emblée à s’emparer complètement du fait-divers, à l’inscrire dans une temporalité fictionnelle et à en faire un grand roman choc. Car si l’écrivain a passé beaucoup de temps en Autriche pour enquêter sur cette affaire, il a souhaité aussi clairement revendiquer l’appartenance au genre romanesque de ce texte: "Ce livre n’est autre qu’un roman, fruit de la création de son auteur", peut on lire en avertissement au début de l’ouvrage. Tout au long de ces 545 pages, Régis Jauffret nous entraîne avec lui dans une spirale étonnante qui mêle reconstitution des faits, interrogation sur la violence et sur l’horreur, réflexion philosophique - car le fait-divers n’est pas sans faire écho à l’allégorie de la caverne de Platon -, et enfin procès d’une nation toute entière, l’Autriche. L’exercice de funambule littéraire auquel s’est livré l’auteur était périlleux, pour ne pas dire "casse gueule". Il a fallu tout l’immense talent de Jauffret pour ne pas tomber, en nous faisant basculer avec lui, dans une ignominie voyeuriste. Son style particulier crée heureusement la distance nécessaire. Il n'en demeure pas moins que cela reste une lecture éprouvante et dérangeante. Un roman captivant mais que l’on referme avec plaisir. Les lecteurs seront prévenus, la plongée dans Claustria est une épreuve dont on ne sort pas indemne.
C’est sur cette sentence lapidaire que s’ouvre Claustria, roman qui évoque la sordide affaire "Fritzl" : la séquestration d’une jeune autrichienne par son père dans la cave de la maison familiale pendant 24 ans, années au cours desquelles elle a donné naissance à 7 enfants et les a élevés dans des conditions plus que précaires.
Et c’est avec une telle phrase que son auteur, Régis Jauffret, parvient d’emblée à s’emparer complètement du fait-divers, à l’inscrire dans une temporalité fictionnelle et à en faire un grand roman choc. Car si l’écrivain a passé beaucoup de temps en Autriche pour enquêter sur cette affaire, il a souhaité aussi clairement revendiquer l’appartenance au genre romanesque de ce texte: "Ce livre n’est autre qu’un roman, fruit de la création de son auteur", peut on lire en avertissement au début de l’ouvrage. Tout au long de ces 545 pages, Régis Jauffret nous entraîne avec lui dans une spirale étonnante qui mêle reconstitution des faits, interrogation sur la violence et sur l’horreur, réflexion philosophique - car le fait-divers n’est pas sans faire écho à l’allégorie de la caverne de Platon -, et enfin procès d’une nation toute entière, l’Autriche. L’exercice de funambule littéraire auquel s’est livré l’auteur était périlleux, pour ne pas dire "casse gueule". Il a fallu tout l’immense talent de Jauffret pour ne pas tomber, en nous faisant basculer avec lui, dans une ignominie voyeuriste. Son style particulier crée heureusement la distance nécessaire. Il n'en demeure pas moins que cela reste une lecture éprouvante et dérangeante. Un roman captivant mais que l’on referme avec plaisir. Les lecteurs seront prévenus, la plongée dans Claustria est une épreuve dont on ne sort pas indemne.
J'ai longtemps hésité avant de lire ce roman. A priori, je ne suis pas attirée par les faits divers scabreux et je n'aime pas que mon rôle de lecteur se transforme en voyeur. Puis, j'ai entendu Régis Jauffret parler de son livre à La Grande Librairie.
Si l'auteur parvient à me faire comprendre comment un être humain peut en arriver à de telles extrémités, cette lecture m'intéresse. L'évocation de l'allégorie de la caverne m'a incitée à découvrir ce roman fiction.
Car, certes, les faits ont réellement existé et le nom du père bourreau est conservé, par contre, l'enquête et l'analyse sont une pure fiction de l'auteur.
Le style et la construction m'ont particulièrement convaincue de continuer cette lecture jusqu'à son dénouement. L'auteur ne peut éviter l'atrocité des actes mais il se contente heureusement de les citer sans tomber dans le voyeurisme et l'étalage pornographique. Le style très fluide et les incursions métaphoriques, romanesques aident à supporter l'horreur de la situation. La construction qui allie l'enquête de l'auteur, le récit du jugement et les pensées d'Angelika, la fille séquestrée est aussi une manière d'alléger (si cela est toutefois possible) la narration.
L'auteur a satisfait mon besoin de comprendre la nature humaine jusque dans ses perversités les plus complexes.
Josef Fritzl est un tortionnaire inhumain qui considère les femmes comme des objets de plaisir et de satisfaction de ses moindres désirs. Il me semble que cet être sans remords et même fier de ce rêve accompli, est parfaitement analysé. De sa jeunesse où il voue une amour incestueux non réalisé à sa mère jusqu'à l'âge adulte où il commence avec la séquestration de sa mère, l'homme évolue vers une brutalité, un sadisme de plus en plus poussé. Il n'y a chez cet homme aucune trace de remords, de folie et c'est ce qui est particulièrement insoutenable.
Ensuite, l'analyse des réactions d'Angelika, quoique choquante dans le besoin de séduire son père, est elle aussi parfaitement décortiquée. Comment peut-on encore avoir des réactions humaines après tant d'années d'enfermement dans une grotte où l'on ne perçoit que les ombres de l'humanité? Bien sûr, la jeune femme était heureuse de voir apparaître son bourreau quand il venait de lui couper eau, électricité et vivres pendant des jours. La télé et cet homme abject étaient pour "le peuple de la cave" le seul lien humain, la seule source de plaisir. C'est très choquant mais c'est malheureusement très compréhensible.
Et je pense que Régis Jauffret a réussi à me faire réfléchir, à me faire comprendre ces mécanismes de dérive comportementale en situation extrême.
Si les allusions à l'Autriche responsable, au nazisme ne m'ont pas choquées, je ne pense pas qu'elles apportent d'informations complémentaires à la compréhension du comportement de Fritzl. L'auteur a voulu tout simplement s'insurger contre la légèreté de la peine pour ce crime incestueux. Malheureusement, de telles barbaries n'ont pas de nation, de religion ou d'appartenance idéologique et elles peuvent surgir dans n'importe quel cerveau humain.
L'image finale de l'oiseau qui retourne dans sa cage, dans son bercail est assez perturbante et ouvre en fin de livre une grande perplexité. C'est un livre qui dérange mais qui est remarquablement développé par l'auteur pour m'interpeller sur la nature humaine et sa complexité.
Lien : http://surlaroutedejostein.o..
Si l'auteur parvient à me faire comprendre comment un être humain peut en arriver à de telles extrémités, cette lecture m'intéresse. L'évocation de l'allégorie de la caverne m'a incitée à découvrir ce roman fiction.
Car, certes, les faits ont réellement existé et le nom du père bourreau est conservé, par contre, l'enquête et l'analyse sont une pure fiction de l'auteur.
Le style et la construction m'ont particulièrement convaincue de continuer cette lecture jusqu'à son dénouement. L'auteur ne peut éviter l'atrocité des actes mais il se contente heureusement de les citer sans tomber dans le voyeurisme et l'étalage pornographique. Le style très fluide et les incursions métaphoriques, romanesques aident à supporter l'horreur de la situation. La construction qui allie l'enquête de l'auteur, le récit du jugement et les pensées d'Angelika, la fille séquestrée est aussi une manière d'alléger (si cela est toutefois possible) la narration.
L'auteur a satisfait mon besoin de comprendre la nature humaine jusque dans ses perversités les plus complexes.
Josef Fritzl est un tortionnaire inhumain qui considère les femmes comme des objets de plaisir et de satisfaction de ses moindres désirs. Il me semble que cet être sans remords et même fier de ce rêve accompli, est parfaitement analysé. De sa jeunesse où il voue une amour incestueux non réalisé à sa mère jusqu'à l'âge adulte où il commence avec la séquestration de sa mère, l'homme évolue vers une brutalité, un sadisme de plus en plus poussé. Il n'y a chez cet homme aucune trace de remords, de folie et c'est ce qui est particulièrement insoutenable.
Ensuite, l'analyse des réactions d'Angelika, quoique choquante dans le besoin de séduire son père, est elle aussi parfaitement décortiquée. Comment peut-on encore avoir des réactions humaines après tant d'années d'enfermement dans une grotte où l'on ne perçoit que les ombres de l'humanité? Bien sûr, la jeune femme était heureuse de voir apparaître son bourreau quand il venait de lui couper eau, électricité et vivres pendant des jours. La télé et cet homme abject étaient pour "le peuple de la cave" le seul lien humain, la seule source de plaisir. C'est très choquant mais c'est malheureusement très compréhensible.
Et je pense que Régis Jauffret a réussi à me faire réfléchir, à me faire comprendre ces mécanismes de dérive comportementale en situation extrême.
Si les allusions à l'Autriche responsable, au nazisme ne m'ont pas choquées, je ne pense pas qu'elles apportent d'informations complémentaires à la compréhension du comportement de Fritzl. L'auteur a voulu tout simplement s'insurger contre la légèreté de la peine pour ce crime incestueux. Malheureusement, de telles barbaries n'ont pas de nation, de religion ou d'appartenance idéologique et elles peuvent surgir dans n'importe quel cerveau humain.
L'image finale de l'oiseau qui retourne dans sa cage, dans son bercail est assez perturbante et ouvre en fin de livre une grande perplexité. C'est un livre qui dérange mais qui est remarquablement développé par l'auteur pour m'interpeller sur la nature humaine et sa complexité.
Lien : http://surlaroutedejostein.o..
Bigote naïve à la logorrhée étourdissante, Klara est une femme d’un autre temps, un temps où la considération pour le sexe faible était proche de zéro. Un temps où le devoir de la femme était de servir les besoins de l’homme en étant le récipient de son désir, matrice fertile pour sa descendance, tout en ayant en charge la tenue du foyer.
Peut-être pour se préserver de la violence de son quotidien, fait de viols, de coups et de brimades, Klara est dépeinte comme une femme à l’esprit fantasque. Elle se plaît à le laisser dériver au gré de ses réflexions, de ses angoisses, de ses rêves, se repentant sans cesse, à la moindre sortie du cadre, et allant à confesse au moindre prétexte pour expier ses pensées impies, pour le plus grand plaisir d’un confesseur sadique et prompt à condamner ses ouailles…
Alors qu’elle a déjà perdu deux enfants en bas âge, Klara découvre qu’elle est de nouveau enceinte… Aloïs, son oncle, mais aussi le père de son enfant, est sûr que ce sera un fils, un soldat, un commandant, bref un grand homme… Quant à Klara, quoi qu’il devienne, elle sait déjà qu’elle chérira cet enfant plus que tout…
Je dois dire que traiter de l’un des plus grands criminels du XXème siècle en revenant sur sa genèse, alors qu’il n’est encore qu’un embryon en développement, était plutôt une idée de départ originale autant que séduisante! Un récit qui ne cherche pas à disculper, mais seulement à remettre en contexte une histoire méconnue. Fruit d’un remariage et d’une relation incestueuse entre un homme abusif et violent, obsédé par sa réussite sociale et une femme soumise et bigote, on imagine aisément que l’enfance du jeune Adolf n’a pas dû être joyeuse tous les jours…
Néanmoins, ce qui intéresse ici Régis Jauffret, n’est pas tant ce qui grandit “dans le ventre de Klara”, que les conditions dans lesquelles se déroulent cette grossesse. Portrait saisissant d’une femme qui oscille entre folie, culpabilité permanente, frustration mais aussi rêves de grandeur, Klara est un personnage ambivalent que j’ai trouvé profondément agaçant et antipathique. Bien que victime de sa condition, je n’ai pas réussi à être touchée par cette femme éprise de mots et d’écriture, qui tente, en cachette, de s’extraire du joug patriarcal et de libérer la parole, mais qui ne parvient qu’à produire une véritable logorrhée irritante et bien souvent indigeste.
Malgré un sujet intéressant, j’ai trouvé la plume de Régis Jauffret trop factuelle, trop sèche, trop tournée vers le mystique aussi. Bref, j’ai eu l’impression de rester en dehors du texte, même si, objectivement, je pense qu’il a de nombreuses qualités qui peuvent plaire. A réessayer plus tard peut-être! Il y a des fois ou ce n’est juste pas le bon moment, surtout lorsqu’on sort d’une lecture particulièrement enthousiasmante…
Peut-être pour se préserver de la violence de son quotidien, fait de viols, de coups et de brimades, Klara est dépeinte comme une femme à l’esprit fantasque. Elle se plaît à le laisser dériver au gré de ses réflexions, de ses angoisses, de ses rêves, se repentant sans cesse, à la moindre sortie du cadre, et allant à confesse au moindre prétexte pour expier ses pensées impies, pour le plus grand plaisir d’un confesseur sadique et prompt à condamner ses ouailles…
Alors qu’elle a déjà perdu deux enfants en bas âge, Klara découvre qu’elle est de nouveau enceinte… Aloïs, son oncle, mais aussi le père de son enfant, est sûr que ce sera un fils, un soldat, un commandant, bref un grand homme… Quant à Klara, quoi qu’il devienne, elle sait déjà qu’elle chérira cet enfant plus que tout…
Je dois dire que traiter de l’un des plus grands criminels du XXème siècle en revenant sur sa genèse, alors qu’il n’est encore qu’un embryon en développement, était plutôt une idée de départ originale autant que séduisante! Un récit qui ne cherche pas à disculper, mais seulement à remettre en contexte une histoire méconnue. Fruit d’un remariage et d’une relation incestueuse entre un homme abusif et violent, obsédé par sa réussite sociale et une femme soumise et bigote, on imagine aisément que l’enfance du jeune Adolf n’a pas dû être joyeuse tous les jours…
Néanmoins, ce qui intéresse ici Régis Jauffret, n’est pas tant ce qui grandit “dans le ventre de Klara”, que les conditions dans lesquelles se déroulent cette grossesse. Portrait saisissant d’une femme qui oscille entre folie, culpabilité permanente, frustration mais aussi rêves de grandeur, Klara est un personnage ambivalent que j’ai trouvé profondément agaçant et antipathique. Bien que victime de sa condition, je n’ai pas réussi à être touchée par cette femme éprise de mots et d’écriture, qui tente, en cachette, de s’extraire du joug patriarcal et de libérer la parole, mais qui ne parvient qu’à produire une véritable logorrhée irritante et bien souvent indigeste.
Malgré un sujet intéressant, j’ai trouvé la plume de Régis Jauffret trop factuelle, trop sèche, trop tournée vers le mystique aussi. Bref, j’ai eu l’impression de rester en dehors du texte, même si, objectivement, je pense qu’il a de nombreuses qualités qui peuvent plaire. A réessayer plus tard peut-être! Il y a des fois ou ce n’est juste pas le bon moment, surtout lorsqu’on sort d’une lecture particulièrement enthousiasmante…
Je souhaite tout d’abord remercier les éditions du Seuil et l’opération Masse Critique pour cette lecture du Dernier bain de Gustave Flaubert de Régis Jauffret.
Le roman de Régis Jauffret se divise en deux parties avant de se conclure sur un « chutier ». Cela commence à la première personne : Flaubert raconte Gustave. C’est le moment du « Je », de l’homme derrière l’écrivain, de l’être de chair qui a vécu, souffert de crises d’épilepsie, d’abcès dentaires et de syphilis. Ce sera l’occasion pour nous de découvrir l’enfance auprès d’un père médecin et d’une mère aimante, la bourgeoisie rouennaise, les premiers émois, et l’appétit de vivre de l’écrivain.
Il faut ensuite distinguer l’homme (Gustave) de l’auteur (devenu à la fois légende, marque, et même investissement financier pour la famille Flaubert). Et c’est dans une deuxième partie intitulée « Il » que Régi Jauffret, en bon scribe, se fait plaisir à faire se manifester les personnages de l’œuvre : Madame Bovary et quelques autres antihéros viennent accabler leur créateur de reproches. Je ne suis pas un grand connaisseur de Flaubert. Je n’ai certainement pas apprécié à sa juste valeur.
Enfin, le roman s’achève sur un chutier vraiment écrit trop petit pour être lisible. C’est une note finale décevante pour ma part et un coup de poker de la part de l’éditeur.
Jauffret nous offre un imaginaire vivant, une vie rêvée plus vraie que nature, peut-être un peu trop hermétique au néophyte que je suis.
Le roman de Régis Jauffret se divise en deux parties avant de se conclure sur un « chutier ». Cela commence à la première personne : Flaubert raconte Gustave. C’est le moment du « Je », de l’homme derrière l’écrivain, de l’être de chair qui a vécu, souffert de crises d’épilepsie, d’abcès dentaires et de syphilis. Ce sera l’occasion pour nous de découvrir l’enfance auprès d’un père médecin et d’une mère aimante, la bourgeoisie rouennaise, les premiers émois, et l’appétit de vivre de l’écrivain.
Il faut ensuite distinguer l’homme (Gustave) de l’auteur (devenu à la fois légende, marque, et même investissement financier pour la famille Flaubert). Et c’est dans une deuxième partie intitulée « Il » que Régi Jauffret, en bon scribe, se fait plaisir à faire se manifester les personnages de l’œuvre : Madame Bovary et quelques autres antihéros viennent accabler leur créateur de reproches. Je ne suis pas un grand connaisseur de Flaubert. Je n’ai certainement pas apprécié à sa juste valeur.
Enfin, le roman s’achève sur un chutier vraiment écrit trop petit pour être lisible. C’est une note finale décevante pour ma part et un coup de poker de la part de l’éditeur.
Jauffret nous offre un imaginaire vivant, une vie rêvée plus vraie que nature, peut-être un peu trop hermétique au néophyte que je suis.
Ce livre est une farce. Jauffret nous en met plein la vue, nous propose deux héroïnes qui passent par toutes les phases épistolaires. Jauffret joue avec nous , leur faisant dire tout et son contraire. Tantôt résignées, tantôt pleines d'espoirs, elles sont toujours excessives. On rit de tels personnages. A un moment cependant, l'action ne progresse plus. Les deux mégères radotent, se perdent dans leurs élucubrations, deviennent grotesques. On les trouve ridicules, mais ne les confondons pas avec l'auteur !
Sur l'écriture, on notera que pour mettre en scène ses trois personnages, Jauffret a choisi d'accumuler les images par 3. Dans la plupart des phrases, les images, toujours réussies, vont par trois.
Paraphrasant une pensée de Jeanne, on peut se demander au final "quel est le sens de ce galimatias". Jauffret ne cache pas sa réponse dans la même lettre : "je vous répondrai que je n'en sais rien et m'en soucie comme de colin-tampon".
Sur l'écriture, on notera que pour mettre en scène ses trois personnages, Jauffret a choisi d'accumuler les images par 3. Dans la plupart des phrases, les images, toujours réussies, vont par trois.
Paraphrasant une pensée de Jeanne, on peut se demander au final "quel est le sens de ce galimatias". Jauffret ne cache pas sa réponse dans la même lettre : "je vous répondrai que je n'en sais rien et m'en soucie comme de colin-tampon".
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Régis Jauffret
Quiz
Voir plus
Hunger Games Tome 1
Qui est l'auteur de la trilogie Hunger Games ?
J.K.Rowling
Suzanne Collins
Stephen King
Stephenie Meyer
15 questions
2986 lecteurs ont répondu
Thème : Hunger Games, tome 1 de
Suzanne CollinsCréer un quiz sur cet auteur2986 lecteurs ont répondu