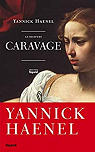Critiques de Yannick Haenel (366)
De très jolies phrases qu'on est obligé de relire 3 fois car on y comprend rien, à part l'auteur peut-être. Alors oui, cela se veut être un roman littéraire. Mais je me suis ennuyée. Normal puisque le narrateur passe son temps dans son lit à regarder Apocalypse now. Pas besoin de le voir, on nous résume les meilleures scènes... de temps en temps, il se relève car il a un désir : que le scénario qu'il vient d'écrire soit enfin compris. Seul un fou comme Cimino peut y voir un grain de vérité, et il a la chance de le rencontrer. Les 100 dernières pages sont un peu plus animées car il rencontre aussi l'amour et perd son chien. A vrai dire, j'étais ennuyée pour le chien et j'espérais qu'il le retrouve. C'est pour cette raison que je suis allée jusqu'au bout de mes peines...
Définition de croustillant selon le site du CNRTL : Libre, osé. Couplet, programme, récit croustillant; histoire croustillante; conte croustillant de Voltaire. (Quasi-) synon. grivois. Il y a toutes sortes de citations des Pères; mais cela n'est pas croustillant du tout (Péladan, Vice supr.,1884, p. 238):
3. B.-A. , Se dit du rendu de certains morceaux d'un aspect vif et séduisant`` (Adeline, Lex. termes art, 1884). Troyon a de petites toiles croustillantes (Goncourt, Journal,1892, p. 272).Déjà, dans la « Nature morte aux oranges » [de Matisse], la matière croustillante de la « chambre » se fait plus unie (Lhote, Peint.,1942, p. 75).
Rem. La docum. atteste croustillerie, subst. fém. Grivoiserie. La vieille et vigoureuse pâte de la gauloiserie et croustillerie nationale (L. Daudet, Universaux, 1935, p. 133).
Voici ce que j’attendais !!! Lorsque j’ai ouvert le paquet, la couverture rouge m’a de suite attirée et me laissait entrevoir une lecture « affreusement croustillante » !!!
En lisant la préface de Vincent Jaury, fort bien titrée « La dinde n e fait pas recette » je note les mots ironique « Ce titre, « Noël, quel bonheur !, est ironique. Bien sûr, je l’ai choisi avec mon camarade Sébastien Rault, éditeur de ce livre, car j’ai moi-même, comme beaucoup d’autres, cette distance si contemporaine qu’est l’ironie ». OK, cela me convient parfaitement.
Je passe gaillardement à la lecture de la première nouvelle «Vers les animaux » de Yannick Haenel » et là…… mon sourire ironique devient grimace, pas tout saisi, il est vrai que le côté psychédélique ne me convient pas….
Je continue « Noël dernier » de Vincent Delecroix : jolie version moderne et remastérisée des 33 ans et donc anniversaire de la nativité. Oui une douce ironie qui m’a plu.
Mais, la rencontre entre le livre et la lectrice ne s’est pas fait. Je me suis ennuyée. Ces Noëls m’ont laissé un goût triste, morne et amer alors que j’attendais du sanglant.
3. B.-A. , Se dit du rendu de certains morceaux d'un aspect vif et séduisant`` (Adeline, Lex. termes art, 1884). Troyon a de petites toiles croustillantes (Goncourt, Journal,1892, p. 272).Déjà, dans la « Nature morte aux oranges » [de Matisse], la matière croustillante de la « chambre » se fait plus unie (Lhote, Peint.,1942, p. 75).
Rem. La docum. atteste croustillerie, subst. fém. Grivoiserie. La vieille et vigoureuse pâte de la gauloiserie et croustillerie nationale (L. Daudet, Universaux, 1935, p. 133).
Voici ce que j’attendais !!! Lorsque j’ai ouvert le paquet, la couverture rouge m’a de suite attirée et me laissait entrevoir une lecture « affreusement croustillante » !!!
En lisant la préface de Vincent Jaury, fort bien titrée « La dinde n e fait pas recette » je note les mots ironique « Ce titre, « Noël, quel bonheur !, est ironique. Bien sûr, je l’ai choisi avec mon camarade Sébastien Rault, éditeur de ce livre, car j’ai moi-même, comme beaucoup d’autres, cette distance si contemporaine qu’est l’ironie ». OK, cela me convient parfaitement.
Je passe gaillardement à la lecture de la première nouvelle «Vers les animaux » de Yannick Haenel » et là…… mon sourire ironique devient grimace, pas tout saisi, il est vrai que le côté psychédélique ne me convient pas….
Je continue « Noël dernier » de Vincent Delecroix : jolie version moderne et remastérisée des 33 ans et donc anniversaire de la nativité. Oui une douce ironie qui m’a plu.
Mais, la rencontre entre le livre et la lectrice ne s’est pas fait. Je me suis ennuyée. Ces Noëls m’ont laissé un goût triste, morne et amer alors que j’attendais du sanglant.
Une nouvelle lecture : un émerveillement, intact comme à la première découverte. J’avais peur d’être déçue ou moins charmée par ce livre, mais il n’en a rien été. L’inconvénient est qu’il me semble toujours aussi difficile d’en parler de façon juste après un tel éblouissement poétique ; je vais pourtant m’y efforcer, en essayant de ne pas trop me répéter par rapport à mon premier avis, afin de vous donner – peut-être – envie de le lire vous aussi.
Ce que j’apprécie particulièrement dans ce texte, c’est l’écriture d’Yannick Haenel. Il tente de « [t]rouver les phrases qui réveilleront la puissance poétique des tapisseries de la Dame à la licorne. » (p. 12) et y parvient parfaitement selon moi. Lorsque j’avais vu une reproduction de cette œuvre à la fin du livre, j’y étais restée assez insensible : sous les mots de cet auteur par contre, elle prend vie, rougit et me touche profondément. Grâce à cette analyse, j’ai perçu toute la richesse, la beauté et la charge érotique de ces tapisseries. Cela mène le narrateur à une réflexion sur l’art en général, la poésie plus particulièrement, et le désir qui l’anime, la sous-tend.
Yannick Haenel ne fait pas ce parcours initiatique seul, mais y invite son lecteur par l’usage de la seconde personne du singulier : cela a tendance à me déranger habituellement (je n’aime pas me sentir forcée à entrer dans un texte), mais j’ai eu cette fois la sensation d’être « étrangement invité[e] » (p. 15) et prise par la main avec douceur. Les réflexions sont amenées progressivement, en suivant le cheminement de pensée du narrateur, ce qui permet de construire ce savoir avec lui et de mieux l’assimiler.
À nouveau, les mots me manquent pour parler de ce magnifique texte et transmettre mon émerveillement. Je ne peux donc que vous inviter à mon tour à vous laisser emmener par Yannick Haenel au musée de Cluny, dans la salle des tapisseries de La Dame à la licorne.
Lien : http://minoualu.blogspot.com..
Ce que j’apprécie particulièrement dans ce texte, c’est l’écriture d’Yannick Haenel. Il tente de « [t]rouver les phrases qui réveilleront la puissance poétique des tapisseries de la Dame à la licorne. » (p. 12) et y parvient parfaitement selon moi. Lorsque j’avais vu une reproduction de cette œuvre à la fin du livre, j’y étais restée assez insensible : sous les mots de cet auteur par contre, elle prend vie, rougit et me touche profondément. Grâce à cette analyse, j’ai perçu toute la richesse, la beauté et la charge érotique de ces tapisseries. Cela mène le narrateur à une réflexion sur l’art en général, la poésie plus particulièrement, et le désir qui l’anime, la sous-tend.
Yannick Haenel ne fait pas ce parcours initiatique seul, mais y invite son lecteur par l’usage de la seconde personne du singulier : cela a tendance à me déranger habituellement (je n’aime pas me sentir forcée à entrer dans un texte), mais j’ai eu cette fois la sensation d’être « étrangement invité[e] » (p. 15) et prise par la main avec douceur. Les réflexions sont amenées progressivement, en suivant le cheminement de pensée du narrateur, ce qui permet de construire ce savoir avec lui et de mieux l’assimiler.
À nouveau, les mots me manquent pour parler de ce magnifique texte et transmettre mon émerveillement. Je ne peux donc que vous inviter à mon tour à vous laisser emmener par Yannick Haenel au musée de Cluny, dans la salle des tapisseries de La Dame à la licorne.
Lien : http://minoualu.blogspot.com..
Autoportrait de l’écrivain.
Ce livre ne se raconte pas. Ce n’est ni un roman, ni un récit, ni une autobiographie, ni un essai.
Ce livre se regarde.
C’est plutôt un tableau de Yannick Haenel peint par lui-même, devant nous, de pages en pages, de mots en mots comme des touches de couleurs.
C’est plutôt un tableau peint par le lecteur, aussi, de pages en pages, de mots en mots où l’auteur, Yannick Haenel, apparaitrait de plus en plus nettement au fur et à mesure de notre lecture. Comme une sorte de révélateur.
On y voit de belles touches sur la lecture et l’écriture.
«Dans l’instant illimité de la lecture, on est partout et nulle part.»
«Je vivais donc ainsi, dans une chambre, avec du papier et de l’encre, deux ou trois livres et mon manteau, du café, des biscuits. J’étais l’homme le plus heureux du monde.»
On y voit les couleurs de la solitude où «le silence et le corps se confondent.».
«Comment s’appelle cette liberté qui s’ouvre dans la solitude, qui vous arrache aux critères, à l’échange, à la durée ?»
On y voit cette très belle teinte sur la solitude du lecteur : «Lire vous sépare des échanges de convention.»
On y voit, dessinés, des labyrinthes évanouissants. «Le bonheur est plus fort que le labyrinthe, parce qu’il in clut le labyrinthe.»
Haenel a écrit un roman intitulé «Cercle" comme un passage qui va s'ouvrir...
J’aime beaucoup l’écriture de Yannick Haenel.
Ce livre ne se raconte pas. Ce n’est ni un roman, ni un récit, ni une autobiographie, ni un essai.
Ce livre se regarde.
C’est plutôt un tableau de Yannick Haenel peint par lui-même, devant nous, de pages en pages, de mots en mots comme des touches de couleurs.
C’est plutôt un tableau peint par le lecteur, aussi, de pages en pages, de mots en mots où l’auteur, Yannick Haenel, apparaitrait de plus en plus nettement au fur et à mesure de notre lecture. Comme une sorte de révélateur.
On y voit de belles touches sur la lecture et l’écriture.
«Dans l’instant illimité de la lecture, on est partout et nulle part.»
«Je vivais donc ainsi, dans une chambre, avec du papier et de l’encre, deux ou trois livres et mon manteau, du café, des biscuits. J’étais l’homme le plus heureux du monde.»
On y voit les couleurs de la solitude où «le silence et le corps se confondent.».
«Comment s’appelle cette liberté qui s’ouvre dans la solitude, qui vous arrache aux critères, à l’échange, à la durée ?»
On y voit cette très belle teinte sur la solitude du lecteur : «Lire vous sépare des échanges de convention.»
On y voit, dessinés, des labyrinthes évanouissants. «Le bonheur est plus fort que le labyrinthe, parce qu’il in clut le labyrinthe.»
Haenel a écrit un roman intitulé «Cercle" comme un passage qui va s'ouvrir...
J’aime beaucoup l’écriture de Yannick Haenel.
Dans le vingtième arrondissement de Paris, un écrivain traîne sa dépression dans son appartement de deux pièces en descendant des bouteilles de vodka et en regardant en boucle « Voyage au bout de l’enfer » et « Apocalypse now ». Il a écrit un scénario de 700 pages sur la vie d’Herman Melville et rêverait qu’il soit mis en scène par Michael Cimino.
Entre rêve et réalité, le récit alterne des évènements extraordinaires : rencontre et discussions avec Cimino à New-York, dîner chez Bofinger avec Isabelle Huppert, nuits torrides avec la séduisante directrice du musée de la chasse, cérémonie funéraire à Colmar dans la salle du retable d’Issenheim, et les marasmes de la dépression. Ceux-ci sont agrémentés de situations triviales et comiques liées aux évènements de son voisinage et à la garde affectueuse du chien de son voisin retors.
L’on est séduit par le « style ondoyant » de Yannick Haenel, son érudition qu’il sait fort bien partager, l’extravagance des situations que vit son personnage, auxquelles on croit cependant.
Ses réflexions sur l’existence et en particulier sur l’attitude à adopter face à la solitude et à la « socialisation » m’ont intéressé.
Un excellent livre, dans la veine du « Trésorier-payeur ».
Entre rêve et réalité, le récit alterne des évènements extraordinaires : rencontre et discussions avec Cimino à New-York, dîner chez Bofinger avec Isabelle Huppert, nuits torrides avec la séduisante directrice du musée de la chasse, cérémonie funéraire à Colmar dans la salle du retable d’Issenheim, et les marasmes de la dépression. Ceux-ci sont agrémentés de situations triviales et comiques liées aux évènements de son voisinage et à la garde affectueuse du chien de son voisin retors.
L’on est séduit par le « style ondoyant » de Yannick Haenel, son érudition qu’il sait fort bien partager, l’extravagance des situations que vit son personnage, auxquelles on croit cependant.
Ses réflexions sur l’existence et en particulier sur l’attitude à adopter face à la solitude et à la « socialisation » m’ont intéressé.
Un excellent livre, dans la veine du « Trésorier-payeur ».
Dans un contexte où le capitalisme semble s’être essoufflé au point de ne plus constituer un système viable pour notre société; il m’a semblé très intriguant d’apprendre à connaître ce « Trésorier-payeur » qui n’en est pas un, ce personnage fantasque que rien ne destinait à travailler dans une institution bancaire mais que son entêtement et son improbable quête de vérité ont amené à y faire carrière. A-t-on jamais entendu parler d’un banquier entièrement désintéressé ? Mieux, un banquier accueillant des pauvres surendettés dans la dépendance au fond de son jardin avant de collaborer avec Emmaüs pour leur trouver du travail ? Certains l’appelaient le « banquier-anarchiste », d’autres le prenaient véritablement pour un illuminé, mais Georges Bataille était bien plus que ça, un esprit libre, guidé seulement par sa recherche de transcendence et son amour de la volupté.
Soyons honnêtes, le début de ce récit a failli me faire abandonner cette lecture. Yannick Haenel n’a pas réussi à m’accrocher avec son propos introductif un peu perché où il explique sa participation à cette exposition dans les anciens locaux de la Banque de France de Béthune, laquelle l’a amené à s’intéresser au personnage du Trésorier-payeur. Pourtant, j’ai persévéré et beaucoup plus apprécié le récit par la suite, trouvant assez fascinant ce personnage complètement décalé. On ne comprend pas très bien ce qu’il cherche dans ce monde qui semble à mille lieues du sien, et pourtant, on finit par se passionner à ses côtés pour ses recherches nocturnes et ses envolées philosophiques.
C’est intéressant de voir comment, à travers un texte très littéraire, sur un sujet finalement assez romanesque, Yannick Haenel parvient à nous amener des réflexions sur l’état du capitalisme et ses dérives, sur les moments-clés qui ont entraîné la complète dérégulation du marché, sur les mécanismes idéologiques à l’oeuvre derrière ce qui n’était initialement qu’une monnaie d’échange. C’est donc toute une réflexion philosophique sur notre monde que le personnage atypique de Georges Bataille offre, et c’est une richesse incroyable, pour peu qu’on s’accroche un peu ! La prose de Yannick Haenel en elle-même m’a parfois perdue mais m’a également offert de magnifiques passages que je garde précieusement et aurais plaisir à relire.
Lien : https://theunamedbookshelf.c..
Soyons honnêtes, le début de ce récit a failli me faire abandonner cette lecture. Yannick Haenel n’a pas réussi à m’accrocher avec son propos introductif un peu perché où il explique sa participation à cette exposition dans les anciens locaux de la Banque de France de Béthune, laquelle l’a amené à s’intéresser au personnage du Trésorier-payeur. Pourtant, j’ai persévéré et beaucoup plus apprécié le récit par la suite, trouvant assez fascinant ce personnage complètement décalé. On ne comprend pas très bien ce qu’il cherche dans ce monde qui semble à mille lieues du sien, et pourtant, on finit par se passionner à ses côtés pour ses recherches nocturnes et ses envolées philosophiques.
C’est intéressant de voir comment, à travers un texte très littéraire, sur un sujet finalement assez romanesque, Yannick Haenel parvient à nous amener des réflexions sur l’état du capitalisme et ses dérives, sur les moments-clés qui ont entraîné la complète dérégulation du marché, sur les mécanismes idéologiques à l’oeuvre derrière ce qui n’était initialement qu’une monnaie d’échange. C’est donc toute une réflexion philosophique sur notre monde que le personnage atypique de Georges Bataille offre, et c’est une richesse incroyable, pour peu qu’on s’accroche un peu ! La prose de Yannick Haenel en elle-même m’a parfois perdue mais m’a également offert de magnifiques passages que je garde précieusement et aurais plaisir à relire.
Lien : https://theunamedbookshelf.c..
Ce livre est bien plus qu'un compte-rendu du procès des attentats de Janvier 2015. C'est un livre qui va beaucoup plus loin, qui questionne les notions de vérité, de justice, de parole.C'est un document d'une intelligente rare, qui pose des questions cruciales et donne à réfléchir. Et les dessins sont incroyables ! Une sacrée claque !
Ce livre est le témoignage du procès des accusés d’être les complices des terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo et l’Hyper casher en janvier 2015. C’est une lecture prenante et aussi dérangeante. J’ai déjà assisté, dans le public à des procès d’assises et je dois dire que j’ai retrouvé là la même ambiance solennelle, la parole prend ici un sens tout particulier.
Les dessins (caricatures !?!) de Boucq y sont pour beaucoup. Il a su capter pour chacun des témoins les attitudes, les gestes.
J’ai été émue, bouleversée par les témoignages des rescapés mesurant combien il a dû être difficile et peut être, je l’espère, salvateur que leur douleur soit ainsi entendue, qu’il leur soit permis de déposer au pied de la société ces moments d’horreur qui ont fait basculer leur vie.
J’ai été complètement ahurie par la bêtise, l’inconscience et l’arrogance de ces complices qui trafiquent, vivent en marge et sont offusqués que la justice de notre société leur demande des comptes.
Le texte de Yannick Haenel est fort, précis, respectant chaque individu. On le sent touché, éprouvé par ce qu’il entend et pénétré par la tâche qui est la sienne.
C’est un récit fort que je n’ai pas pu faire dans la continuité, sans que cela ne nuise à la lecture
Les dessins (caricatures !?!) de Boucq y sont pour beaucoup. Il a su capter pour chacun des témoins les attitudes, les gestes.
J’ai été émue, bouleversée par les témoignages des rescapés mesurant combien il a dû être difficile et peut être, je l’espère, salvateur que leur douleur soit ainsi entendue, qu’il leur soit permis de déposer au pied de la société ces moments d’horreur qui ont fait basculer leur vie.
J’ai été complètement ahurie par la bêtise, l’inconscience et l’arrogance de ces complices qui trafiquent, vivent en marge et sont offusqués que la justice de notre société leur demande des comptes.
Le texte de Yannick Haenel est fort, précis, respectant chaque individu. On le sent touché, éprouvé par ce qu’il entend et pénétré par la tâche qui est la sienne.
C’est un récit fort que je n’ai pas pu faire dans la continuité, sans que cela ne nuise à la lecture
Œuvre d'exception, permettant de conserver trace d'un procès, qui par nature n'est qu'ephemere et difficile d'accès au public.
Les nombreux témoignages, tous très justes, permettent d'avoir une vision complète des attentats de Charlie Hebdo et nous font plonger dans la nébuleuse islamiste, qui a ici la particularité d'être également exercée par des délinquants presque "traditionnels".
Les nombreux témoignages, tous très justes, permettent d'avoir une vision complète des attentats de Charlie Hebdo et nous font plonger dans la nébuleuse islamiste, qui a ici la particularité d'être également exercée par des délinquants presque "traditionnels".
je condamne ce bouquin au feu et son promoteur à la géhenne mais pour ne pas me fâcher définitivement je me suis obligé à réfléchir pour dire pourquoi et je me suis obligé à le faire par écrit. (L’écrit oblige à être précis et à argumenter sérieusement). J’ai donc élaborer mon jugement sur ce livre avec mes attendus que je vais lire : (Comme au tribunal des flagrants délires de Desproges). Si c’est trop chiant arrêtez moi...
On émerge du chaos et eux racontent qu’on y est ou que ça s’aggrave...
L’homme est un être fondamentalement nuisible qui a dévasté la planète et qui va disparaître grâce à la technologie ( cybernétique, algorithmes, nucléaire etc...)
C’est même pas la peine d’essayer puisque « tout est accompli »
Pas la peine de critiquer la consommation, la production, les interactions dans le monde social ou socio-économique concret dans lequel nous vivons...
Les êtres humains sont des prédateurs imbéciles asservi au capitalisme spéculatif et inconscient de l’être..
Donc soit on devient des poulets d’élevage avec des puces de la Silicon Valley connectées à la matrice, soit on fait en sorte que la technologie ne nous asservisse pas »
Mon hypothèse :
Il y a des gens qui développent des fonds de placement éthiques ou socialement responsables, des traders qui doutent de leur utilité et qui changent de vie, des salariés solidaires dans le travail,, des médecins qui contournent pour soigner correctement, des consommateurs qui regardent leur ordinateur et leur téléphone comme des outils quelconques sans phobie ni fascination..
Emmanuel ...qui fait des chiffres chez Amazon à Munich.. Kiné
Donc ce bouquin pour moi c’est de l’anthropologie de bistrot ou de fin de repas ...
Pour la partie « dispositif » entendu comme la nouvelle idéologie calquée sur l’absolutisme judéo-chrétien:
On a mis deux siècles à passer d’une exégèse allegorico/mystique à une exégèse historico/critique
À trouver un équilibre fragile entre religion et République, entre liberté individuelle et destin collectif.
À se débarrasser des croyances dans la croyance, de dogme religieux, de la dictature de traditions mal pensées, dévoyées, mal assimilées, inadaptées à la réalité d’aujourd’hui et de demain.
Et surtout à ne plus être figés, hypnotisés par un texte fantasmé, idéalisé, divinisé – et trahi par une institution qui ne poursuivait qu’un but: d’abord le pouvoir politique, économique et moral puis à force de le perdre aujourd’hui l’asservissement de l’intelligence...
Et on s’en est trouvé bien car ça a été et c’est un progrès considérable sur la barbarie...
On a intégré l’hellénisme et Rome dans le christianisme, puis le christianisme dans les Lumières, les Lumières dans la laïcité et nous sommes en train d’intégrer notre identité dans la mondialisation.( On a pas l’exclusivité mondiale de la spiritualité)
Donc la conclusion :
Comment aider les utilisateurs à reprendre la main ? Comment développer des outils qui aident les utilisateurs à atteindre leurs propres objectifs plutôt que ceux de leurs concepteurs ? Comment encourager des modèles d’affaires qui ne reposent pas sur la captation de l’attention des utilisateurs ? Comment promouvoir le respect de l’attention comme l’on promeut le respect de la vie privée des utilisateurs ? Comment sortir des flux d’incitations et de récompenses qui favorisent les comportements compulsifs et addictifs ? Comment favoriser une conception plus éthique de l’expérience utilisateur elle-même ? Peut-on promouvoir un design responsable, durable, qui ne cherche pas à exploiter nos vulnérabilités, mais nous redonne de la liberté ? » Vaste programme.
On émerge du chaos et eux racontent qu’on y est ou que ça s’aggrave...
L’homme est un être fondamentalement nuisible qui a dévasté la planète et qui va disparaître grâce à la technologie ( cybernétique, algorithmes, nucléaire etc...)
C’est même pas la peine d’essayer puisque « tout est accompli »
Pas la peine de critiquer la consommation, la production, les interactions dans le monde social ou socio-économique concret dans lequel nous vivons...
Les êtres humains sont des prédateurs imbéciles asservi au capitalisme spéculatif et inconscient de l’être..
Donc soit on devient des poulets d’élevage avec des puces de la Silicon Valley connectées à la matrice, soit on fait en sorte que la technologie ne nous asservisse pas »
Mon hypothèse :
Il y a des gens qui développent des fonds de placement éthiques ou socialement responsables, des traders qui doutent de leur utilité et qui changent de vie, des salariés solidaires dans le travail,, des médecins qui contournent pour soigner correctement, des consommateurs qui regardent leur ordinateur et leur téléphone comme des outils quelconques sans phobie ni fascination..
Emmanuel ...qui fait des chiffres chez Amazon à Munich.. Kiné
Donc ce bouquin pour moi c’est de l’anthropologie de bistrot ou de fin de repas ...
Pour la partie « dispositif » entendu comme la nouvelle idéologie calquée sur l’absolutisme judéo-chrétien:
On a mis deux siècles à passer d’une exégèse allegorico/mystique à une exégèse historico/critique
À trouver un équilibre fragile entre religion et République, entre liberté individuelle et destin collectif.
À se débarrasser des croyances dans la croyance, de dogme religieux, de la dictature de traditions mal pensées, dévoyées, mal assimilées, inadaptées à la réalité d’aujourd’hui et de demain.
Et surtout à ne plus être figés, hypnotisés par un texte fantasmé, idéalisé, divinisé – et trahi par une institution qui ne poursuivait qu’un but: d’abord le pouvoir politique, économique et moral puis à force de le perdre aujourd’hui l’asservissement de l’intelligence...
Et on s’en est trouvé bien car ça a été et c’est un progrès considérable sur la barbarie...
On a intégré l’hellénisme et Rome dans le christianisme, puis le christianisme dans les Lumières, les Lumières dans la laïcité et nous sommes en train d’intégrer notre identité dans la mondialisation.( On a pas l’exclusivité mondiale de la spiritualité)
Donc la conclusion :
Comment aider les utilisateurs à reprendre la main ? Comment développer des outils qui aident les utilisateurs à atteindre leurs propres objectifs plutôt que ceux de leurs concepteurs ? Comment encourager des modèles d’affaires qui ne reposent pas sur la captation de l’attention des utilisateurs ? Comment promouvoir le respect de l’attention comme l’on promeut le respect de la vie privée des utilisateurs ? Comment sortir des flux d’incitations et de récompenses qui favorisent les comportements compulsifs et addictifs ? Comment favoriser une conception plus éthique de l’expérience utilisateur elle-même ? Peut-on promouvoir un design responsable, durable, qui ne cherche pas à exploiter nos vulnérabilités, mais nous redonne de la liberté ? » Vaste programme.
C’est entendu. Le Caravage est un génie. Et Yannick Haenel en est un admirateur éperdu. L’artiste a fait irruption dans sa vie alors que l’écrivain était âgé de 15 ans. Il feuillette un livre de peinture italienne lorsque Judith lui apparaît, procurant chez lui un émoi tel que seul un adolescent, peut-être, peut en connaître. L’ouvrage ne présente qu’un détail du tableau : il ignore la besogne à laquelle la jeune femme est en train de se livrer. Qu’importe. Sa beauté le hante et il retourne constamment vers elle. Il en est tellement épris qu’il finit par découper la page du livre pour pouvoir conserver ce portrait auprès de lui.
Parvenu à l’âge adulte, bien qu’il ne soit plus en possession de cette image et qu’il n’ait jamais su qui en était l’auteur, le souvenir de cette femme et du trouble qu’elle suscita reste vif. Jusqu’au jour où il la revoit, au palais Barberini, à Rome. Lui apparaît alors ce qu’elle est en train d’accomplir. La révélation d’Eros et Thanatos le foudroie.
Au-delà du vertige de la beauté, il veut cerner la nature de l’émotion, entrevoir l’origine de l’éblouissement. Par ses mots, à travers ce feu qu’est aussi l’écriture, il veut tenter de circonscrire ce qui semble échapper à l’entendement.
Du Caravage Yannick Haenel connaît à présent et les oeuvres et la vie. Il sait les rixes, il sait le désordre des nuits, il sait la fréquentation des prostituées, il sait les amours avec des hommes, il sait en somme ce qu’il nomme le folklore de sa vie. Tout ce qu’on présente de l’artiste et qui jette bien souvent un voile sur son oeuvre. Mais ceci ne révèle pourtant rien de l’intensité de sa vie ni du secret de sa personne ou du mystère de la création.
Or c’est bien cette part la plus intime que cherche à saisir Haenel en écrivant cette insolite biographie entendant se moquer des accidents d’une existence. Ceux-ci, loin d’éclairer l’oeuvre, ne seraient au contraire que de lointaines manifestations du feu qui brûle l’artiste lorsque sa main tient le pinceau : « Seules comptent les heures passées face à la toile, face à la page blanche ; seul cet excès, bien plus fou que toute beuverie, plus enivrant que toute orgie, plus profond que tout dérèglement, atteint cette radicalité qui est au coeur de l’art et vous ouvre à la vérité. »
Le Caravage est sans doute l’un des artistes à être allé le plus loin dans ce don inconditionnel de soi, dans cette manière de vivre l’exigence de l’art qui seule permet d’échapper à l’état de servitude imposé par la condition humaine.
Une fois qu’on a compris cela, les événements biographiques invitent à une autre lecture de l’oeuvre, celle à laquelle se livre Haenel. Une lecture passionnante et d’une très grande acuité. Parfois, je le concède bien volontiers, il arrive que l’écrivain nous perde quelque peu, tant sa quête aborde d’insondables horizons... C’est sans doute que ses questionnements ne sont pas du même ordre que les nôtres. L’écrivain établit en effet un parallèle entre le geste pictural et celui de l’écriture. Il opère un phénomène d’identification qui, naturellement, nous échappe. Mais il nous oblige aussi à reconsidérer notre propre rapport à l’art et à interroger le regard que nous posons sur l’artiste. Et sa lecture des tableaux du Caravage, les relations qu’il établit avec les éléments biographiques sont absolument passionnantes et jettent sur cette oeuvre immense, et plus généralement sur le processus de création, un éclairage tout à fait fascinant.
Sachez enfin que cet ouvrage se lit son ordinateur ou une monographie de l’artiste à portée de main. Car, et ce n’est pas là le moindre des bonheurs qu’il nous offre, il invite constamment à aller découvrir ou redécouvrir les tableaux qu'il nous présente avec tant de finesse et d'intelligence. Se conjuguent ainsi l’incommensurable beauté de l’art pictural du Caravage et celle tout aussi envoutante de l’art littéraire qu’est celui de Yannick Haenel.
Lien : https://www.youtube.com/chan..
Parvenu à l’âge adulte, bien qu’il ne soit plus en possession de cette image et qu’il n’ait jamais su qui en était l’auteur, le souvenir de cette femme et du trouble qu’elle suscita reste vif. Jusqu’au jour où il la revoit, au palais Barberini, à Rome. Lui apparaît alors ce qu’elle est en train d’accomplir. La révélation d’Eros et Thanatos le foudroie.
Au-delà du vertige de la beauté, il veut cerner la nature de l’émotion, entrevoir l’origine de l’éblouissement. Par ses mots, à travers ce feu qu’est aussi l’écriture, il veut tenter de circonscrire ce qui semble échapper à l’entendement.
Du Caravage Yannick Haenel connaît à présent et les oeuvres et la vie. Il sait les rixes, il sait le désordre des nuits, il sait la fréquentation des prostituées, il sait les amours avec des hommes, il sait en somme ce qu’il nomme le folklore de sa vie. Tout ce qu’on présente de l’artiste et qui jette bien souvent un voile sur son oeuvre. Mais ceci ne révèle pourtant rien de l’intensité de sa vie ni du secret de sa personne ou du mystère de la création.
Or c’est bien cette part la plus intime que cherche à saisir Haenel en écrivant cette insolite biographie entendant se moquer des accidents d’une existence. Ceux-ci, loin d’éclairer l’oeuvre, ne seraient au contraire que de lointaines manifestations du feu qui brûle l’artiste lorsque sa main tient le pinceau : « Seules comptent les heures passées face à la toile, face à la page blanche ; seul cet excès, bien plus fou que toute beuverie, plus enivrant que toute orgie, plus profond que tout dérèglement, atteint cette radicalité qui est au coeur de l’art et vous ouvre à la vérité. »
Le Caravage est sans doute l’un des artistes à être allé le plus loin dans ce don inconditionnel de soi, dans cette manière de vivre l’exigence de l’art qui seule permet d’échapper à l’état de servitude imposé par la condition humaine.
Une fois qu’on a compris cela, les événements biographiques invitent à une autre lecture de l’oeuvre, celle à laquelle se livre Haenel. Une lecture passionnante et d’une très grande acuité. Parfois, je le concède bien volontiers, il arrive que l’écrivain nous perde quelque peu, tant sa quête aborde d’insondables horizons... C’est sans doute que ses questionnements ne sont pas du même ordre que les nôtres. L’écrivain établit en effet un parallèle entre le geste pictural et celui de l’écriture. Il opère un phénomène d’identification qui, naturellement, nous échappe. Mais il nous oblige aussi à reconsidérer notre propre rapport à l’art et à interroger le regard que nous posons sur l’artiste. Et sa lecture des tableaux du Caravage, les relations qu’il établit avec les éléments biographiques sont absolument passionnantes et jettent sur cette oeuvre immense, et plus généralement sur le processus de création, un éclairage tout à fait fascinant.
Sachez enfin que cet ouvrage se lit son ordinateur ou une monographie de l’artiste à portée de main. Car, et ce n’est pas là le moindre des bonheurs qu’il nous offre, il invite constamment à aller découvrir ou redécouvrir les tableaux qu'il nous présente avec tant de finesse et d'intelligence. Se conjuguent ainsi l’incommensurable beauté de l’art pictural du Caravage et celle tout aussi envoutante de l’art littéraire qu’est celui de Yannick Haenel.
Lien : https://www.youtube.com/chan..
Plus qu’une biographie, Yannick Haenel nous invite à découvrir l’œuvre et les sources d’inspiration du Caravage à travers un véritable travail de réhabilitation de l’artiste.
On sent chez l’auteur une véritable passion pour le peintre. Et c’est à travers ses œuvres qu’il nous propose de cheminer, partant du principe que la vie de l’artiste, ses complexités se trouvent toutes entières dans ses tableaux.
Un peu compliqué à suivre pour une néophyte comme moi, le livre reste toutefois passionnant par le rythme que Yannick Haenel y insuffle et par son ton moderne alors même qu’il s’agit d’un peintre des XVI et XVIIèmes siècles. L’auteur sait nous faire partager sa passion et ses émotions, nées de sa rencontre à 15 ans avec Judith décapitant Holopherne.
Pour être parfaitement compréhensible peut-être faudrait-il lire ce livre avec, a portée de main, les reproductions des peintures dont il est question.
On sent chez l’auteur une véritable passion pour le peintre. Et c’est à travers ses œuvres qu’il nous propose de cheminer, partant du principe que la vie de l’artiste, ses complexités se trouvent toutes entières dans ses tableaux.
Un peu compliqué à suivre pour une néophyte comme moi, le livre reste toutefois passionnant par le rythme que Yannick Haenel y insuffle et par son ton moderne alors même qu’il s’agit d’un peintre des XVI et XVIIèmes siècles. L’auteur sait nous faire partager sa passion et ses émotions, nées de sa rencontre à 15 ans avec Judith décapitant Holopherne.
Pour être parfaitement compréhensible peut-être faudrait-il lire ce livre avec, a portée de main, les reproductions des peintures dont il est question.
Dans un récit chronologique, émaillé de flashbacks, Yannick Haenel nous fait partager une tranche de vie d'un écrivain, obnubilé par le scénario qu'il a écrit et pour lequel il ne trouve pas de réalisateur. En donnant pour titre à son livre une citation issue des Carnets de Proust, il indique déjà au lecteur ce que sera ce roman : une lutte, à la limite de la folie, pour ne pas se faire expulser du royaume des élus. Les références christiques et bibliques sont au moins aussi nombreuses et importantes que les références littéraires et artistiques. En 33 chapitres, il traite régulièrement des thématiques du sacrifice, de l'errance, de la rédemption. Il cherche sans fin des interlocuteurs à "l'intérieur de la tête mystiquement alvéolée", en référence à Moby Dick et Melville, dont il fait le sujet de son scénario. Il oscille en permanence entre ces références symboliques et celles de la chasse et de la guerre (le Vietnam, l'histoire personnelle de Tot, Fontainebleau), à la recherche de son "daim blanc".
Ce parcours initiatique trouve son acte fondateur, on le découvre tardivement, dans un événement sordide qui questionne le narrateur et par contrecoup, le lecteur, sur le sens de l'existence. L'oeuvre d'un écrivain peut/doit-elle être contenu dans sa propre existence? N'être faite que d'"aventures"?
En revanche, la fin, en forme d'"happy end" m'a un peu déçue. La résolution rapide du conflit intérieur qui l'occupe pendant 300 pages en une pseudo-révélation créé un décalage un peu sec. Dommage.
Ce parcours initiatique trouve son acte fondateur, on le découvre tardivement, dans un événement sordide qui questionne le narrateur et par contrecoup, le lecteur, sur le sens de l'existence. L'oeuvre d'un écrivain peut/doit-elle être contenu dans sa propre existence? N'être faite que d'"aventures"?
En revanche, la fin, en forme d'"happy end" m'a un peu déçue. La résolution rapide du conflit intérieur qui l'occupe pendant 300 pages en une pseudo-révélation créé un décalage un peu sec. Dommage.
J'ai lu dernièrement La Carte des Mendelssohn de Diane Meur, qu'elle a écrit après deux années passées à Berlin et où le temps, habituellement perçu comme linéaire, prend la forme d'une sphère de ramifications en perpétuelle expansion. Diane Meur se met en scène pour offrir au lecteur le récit de l'élaboration de son livre. Comme le hasard fait toujours bien les choses, Cercle (oeuvre bien antérieure) traite également du temps comme espace, place Berlin au cœur d'un récit d'un auteur en train d'écrire son oeuvre... Étonnant, non?
Dans le roman de Yannick Haenel, le temps se libère de la mort pour se tourner vers l'amour par une écoute de la langue. Le temps n'est donc plus compté, mais raconté. Il se charge alors d'une profondeur extatique. Le personnage, Jean Deichel, tel une Jeanne d'Arc, entend non pas des voix mais des phrases. Elles vont bouleverser sa vie et lui donner sens. De Paris à Prague en passant par Berlin et la Pologne, Jean Deichel rejoue l'Odyssée et le grand périple du Pequod, entre sirènes envoûtantes, méduses angoissantes et baleine blanche. Cet Ulysse-Ismaël moderne, qui pourra apparaître étonnant, comique et attachant pour certains, lourd, prétentieux et insupportables pour d'autres, vivra son purgatoire et son enfer pour, peut-être, connaître, son paradis. Mais que nous l'aimions ou pas, à la lecture de Cercle, nous sommes vivants.
Dans le roman de Yannick Haenel, le temps se libère de la mort pour se tourner vers l'amour par une écoute de la langue. Le temps n'est donc plus compté, mais raconté. Il se charge alors d'une profondeur extatique. Le personnage, Jean Deichel, tel une Jeanne d'Arc, entend non pas des voix mais des phrases. Elles vont bouleverser sa vie et lui donner sens. De Paris à Prague en passant par Berlin et la Pologne, Jean Deichel rejoue l'Odyssée et le grand périple du Pequod, entre sirènes envoûtantes, méduses angoissantes et baleine blanche. Cet Ulysse-Ismaël moderne, qui pourra apparaître étonnant, comique et attachant pour certains, lourd, prétentieux et insupportables pour d'autres, vivra son purgatoire et son enfer pour, peut-être, connaître, son paradis. Mais que nous l'aimions ou pas, à la lecture de Cercle, nous sommes vivants.
Cela faisait un moment que je voulais lire "Les renards pâles" de Yannick Haenel. J'ai donc sauté sur l'occasion la semaine passée.
Que dire de ce roman?
Deux parties: une première haletante et passionnante, une seconde très politique et bien moins intéressante selon moi.
La première partie est structurée en courts chapitres qui permettent au lecteur de rapidement s'immerger dans l'histoire. L'utilisation du "je" est très bien pensé.
La deuxième partie est un "plaidoyer politique" sur les sans-papier et plus généralement la vie aujourd'hui avec ses difficultés.
Le style est agréable, poétique par moment, vulgaire (pardon moderne devrais je dire) à d'autres. Mais je n'ai pas compris le passage du je de la première partie au nous de la seconde. On se perd dans le "combat" mené par le "je" de la première partie.
Cela devient touffu et surtout compliqué, donc incompréhensible pour moi.
Cela partait pourtant si bien... J'aurai du m'arrêter à la fin de la 1ere partie.
3 étoiles et je recommande quand même car ce mélange libertaire-romanesque est rare, donc intéressant à lire.
Que dire de ce roman?
Deux parties: une première haletante et passionnante, une seconde très politique et bien moins intéressante selon moi.
La première partie est structurée en courts chapitres qui permettent au lecteur de rapidement s'immerger dans l'histoire. L'utilisation du "je" est très bien pensé.
La deuxième partie est un "plaidoyer politique" sur les sans-papier et plus généralement la vie aujourd'hui avec ses difficultés.
Le style est agréable, poétique par moment, vulgaire (pardon moderne devrais je dire) à d'autres. Mais je n'ai pas compris le passage du je de la première partie au nous de la seconde. On se perd dans le "combat" mené par le "je" de la première partie.
Cela devient touffu et surtout compliqué, donc incompréhensible pour moi.
Cela partait pourtant si bien... J'aurai du m'arrêter à la fin de la 1ere partie.
3 étoiles et je recommande quand même car ce mélange libertaire-romanesque est rare, donc intéressant à lire.
Non, décidément, presque aucune de ces nouvelles ne m'a plu... et lorsqu'elle semblait être plus sympathique, la chute me laisse sur ma faim. C'est pourquoi je ne lui accorde malheureusement qu'une toute petite étoile, car là, j'avoue, attirée par la couverture plutôt jolie et un à-priori où je me disait, tiens, pourquoi pas des histoires un peu décalées sur Noël pour changer du tout beau tout gentil de l'accoutumée. Idée originale au début mais, selon moi, mal ficelée! Donc, vous avez pu le deviner, je suis un peu déçue, je me suis ennuyée dans ma lecture, des histoires, hormis une peut-être sur un amour perdu, sans queue ni tête et surtout sans réel intérêt.
Dommage que Babelio ne mette pas la critique presse de l'Express sur la fiche (intitulée "Yannick Haenel ou l'art de l'enfumage", très bien trouvé), qui reflète mon avis sur le sujet.
Je concède à l'auteur son écriture poétique, pas désagréable, et une idée de départ alléchante, intriguante. C'est tout.
La première partie m'a laissée perplexe, pas totalement conquise mais en attente de la suite. L'histoire de ce chômeur d'âge moyen, qui se fait jeter de sa chambre de bonne et emménage dans la voiture d'un ami rue de Chine dans le XXème (référence à la Commune), et qui passe son temps à errer dans son arrondissement, à boire de la vinasse avec ses amis et à refaire (ou pas, à son sujet) le monde de manière plus égalitaire (on entre dans l'ère Sarkozy à ce moment là), devient ami avec des éboueurs maliens et se pose des questions sur les Renards pâles, jusqu'à sa rencontre avec "La Reine de Pologne", aussi paumée que lui et qui va lui donner accès à ces Renards Pâles (après une jolie scène "grivoise" dans le cimetière du Père Lachaise), cette histoire n'est pas trop mal. C'est une première partie tout de même étrange, avec quelques aspects trop caricaturaux, trop de références à Beckett et à Godot (n'est pas Beckett qui veut), et à la Commune et ses martyrs...
Puis vient la seconde partie, où le narrateur (ou l'auteur on ne sait plus trop) nous conte la manifestation muette et masquée des Renards Pâles (dont fait partie notre héros désormais). Le narration passe du "je" au "nous", et le personnage s'adresse à "vous" (qui représente les riches politiques, bobos, oisifs de France, ou tout simplement ceux qui ne soutiennent pas la cause, ne prennent pas parti), le ton devient accusateur, culpabilisant, mélangeant cette manifestation calme et pacifique et l'excès des Renards Pâles (brûlons les cartes d'identités, cessons toute activité et emmerdons le système). C'est irritant, c'est assez grotesque, et malgré une très bonne idée et un message important, on y croit pas une seule seconde... je n'y crois en tout cas. Et là c'est la déception.
Donc non, malgré sa prose travaillée, les Renards Pâles est pour moi un flop retentissant.
J'attends d'autres avis pour comprendre l'engouement que peut susciter le livre !
Je concède à l'auteur son écriture poétique, pas désagréable, et une idée de départ alléchante, intriguante. C'est tout.
La première partie m'a laissée perplexe, pas totalement conquise mais en attente de la suite. L'histoire de ce chômeur d'âge moyen, qui se fait jeter de sa chambre de bonne et emménage dans la voiture d'un ami rue de Chine dans le XXème (référence à la Commune), et qui passe son temps à errer dans son arrondissement, à boire de la vinasse avec ses amis et à refaire (ou pas, à son sujet) le monde de manière plus égalitaire (on entre dans l'ère Sarkozy à ce moment là), devient ami avec des éboueurs maliens et se pose des questions sur les Renards pâles, jusqu'à sa rencontre avec "La Reine de Pologne", aussi paumée que lui et qui va lui donner accès à ces Renards Pâles (après une jolie scène "grivoise" dans le cimetière du Père Lachaise), cette histoire n'est pas trop mal. C'est une première partie tout de même étrange, avec quelques aspects trop caricaturaux, trop de références à Beckett et à Godot (n'est pas Beckett qui veut), et à la Commune et ses martyrs...
Puis vient la seconde partie, où le narrateur (ou l'auteur on ne sait plus trop) nous conte la manifestation muette et masquée des Renards Pâles (dont fait partie notre héros désormais). Le narration passe du "je" au "nous", et le personnage s'adresse à "vous" (qui représente les riches politiques, bobos, oisifs de France, ou tout simplement ceux qui ne soutiennent pas la cause, ne prennent pas parti), le ton devient accusateur, culpabilisant, mélangeant cette manifestation calme et pacifique et l'excès des Renards Pâles (brûlons les cartes d'identités, cessons toute activité et emmerdons le système). C'est irritant, c'est assez grotesque, et malgré une très bonne idée et un message important, on y croit pas une seule seconde... je n'y crois en tout cas. Et là c'est la déception.
Donc non, malgré sa prose travaillée, les Renards Pâles est pour moi un flop retentissant.
J'attends d'autres avis pour comprendre l'engouement que peut susciter le livre !
Jan Karski est l’homme qui fut officiellement mandaté par deux juifs du ghetto de Varsovie, en 1942, pour dire, à la ville et au monde, qu’à Varsovie, en Pologne, on exterminait dans les pires conditions une part de l’humanité.
De Londres à Washington, l’histoire de ce résistant messager polonais nous est retracée en trois tableaux.
Le témoignage direct de Karski dans Shoah de Claude Lanzmann, un résumé du livre écrit par Karski lui-même et enfin une part fictionnelle où finalement Haenel met du littéraire dans ce qui ne fut au préalable que du littéral.
La force de témoignage de Karski réside d’abord dans ce qu’il n’est pas juif. Tout juste se définira-t-il après guerre comme un catholique-juif.
Au-delà, c’est d’abord un Homme qui parle des Hommes aux Hommes. De beaux développements sur la notion de crime contre l’Humanité, mais aussi la surdité organisée, presque assumée des alliés dans le refus d’entendre le messager Karski. Car rien n’aura bougé après que le message fut délivré. Par non-conformité avec les objectifs de guerre, pour ne pas froisser l’allié soviétique par fond d’antisémitisme largement répandu, quelles qu’en furent les raisons, le résistant de Pologne, ce pays qui ne fut quasiment jamais rien dans l’histoire, ne pouvait que se heurter à tous ces murs.
C’est là, à ce moment que se combine le passage de l’état de messager à celui de témoin que restera Karski, jusqu’au bout, hanté par ce qu’il vit, par les nuits blanches qui lui permirent de continuer de faire vivre encore les morts, pris entre le seul silence vrai et la parole libératoire.
Ce livre de Yannick Haenel est une œuvre utile. Tels Semprun et Primo Levi et d’autres encore, il nous appartient à tous, de savoir que ce message exista. Que l’humanité sait elle-même aller jusqu’à nier son humanité et finalement toujours porter en elle ce silence égoïste, ce mutisme complice, dont elle a beau se mordre les doigts mais qui figurent comme un horizon indépassable.
De Londres à Washington, l’histoire de ce résistant messager polonais nous est retracée en trois tableaux.
Le témoignage direct de Karski dans Shoah de Claude Lanzmann, un résumé du livre écrit par Karski lui-même et enfin une part fictionnelle où finalement Haenel met du littéraire dans ce qui ne fut au préalable que du littéral.
La force de témoignage de Karski réside d’abord dans ce qu’il n’est pas juif. Tout juste se définira-t-il après guerre comme un catholique-juif.
Au-delà, c’est d’abord un Homme qui parle des Hommes aux Hommes. De beaux développements sur la notion de crime contre l’Humanité, mais aussi la surdité organisée, presque assumée des alliés dans le refus d’entendre le messager Karski. Car rien n’aura bougé après que le message fut délivré. Par non-conformité avec les objectifs de guerre, pour ne pas froisser l’allié soviétique par fond d’antisémitisme largement répandu, quelles qu’en furent les raisons, le résistant de Pologne, ce pays qui ne fut quasiment jamais rien dans l’histoire, ne pouvait que se heurter à tous ces murs.
C’est là, à ce moment que se combine le passage de l’état de messager à celui de témoin que restera Karski, jusqu’au bout, hanté par ce qu’il vit, par les nuits blanches qui lui permirent de continuer de faire vivre encore les morts, pris entre le seul silence vrai et la parole libératoire.
Ce livre de Yannick Haenel est une œuvre utile. Tels Semprun et Primo Levi et d’autres encore, il nous appartient à tous, de savoir que ce message exista. Que l’humanité sait elle-même aller jusqu’à nier son humanité et finalement toujours porter en elle ce silence égoïste, ce mutisme complice, dont elle a beau se mordre les doigts mais qui figurent comme un horizon indépassable.
Je viens de lire et apprécié le roman « Jan Karski » de Yannick Haenel. Jai relu ensuite les réserves émises quant à ce roman par Annette Wieviorka dans « Lire» de mai-juin 2010 Elle dit, notamment qu’ «en outre sa thèse de la complicité des Alliés dans l’accomplissement de la solution finale est historiquement inepte.» Le magasine précise que les travaux de Madame Wieviorka sur l’extermination des Juifs d’Europe font autorité. Elle a, en effet, publié en 2005 «Auschwitz, 60 ans après» (Robert Laffont) pour lequel elle a reconstitué minutieusement les étapes de l’entreprise d’Auschwitz et les mécanismes de son fonctionnement, rendant ainsi à l’Histoire la réalité de ce camp afin qu’il ne soit pas simplement un concept désincarné, synonyme de Shoah.
En 1983, dans «Lire » n°97, Elie Wiesel, interrogé par Antoine de Gaudemar, disait ceci : « Quand le président Carter m’a nommé président de la Commission présidentielle de l’Holocauste, il m’a fait venir à la Maison-Blanche et il m’ a dit : ‘J’ai fait préparer quelque chose pour vous.’ Il s’a&gissait d’une série de photos aériennes, prises depuis un bombardier américain pendant une attaque contre une usine installée près d’Auschwitz. Eh bien, sur ces photos, on voit tout : le camp, les installations, les cheminées fumantes des crématoires, les fosses communes. Par ailleurs, on sait que des photos de Birkenau étaient parvenues à Londres, à Washington, et au Vatican dès 1942. A l’ouest, on savait, il suffit de lire les journaux…. Le massacre de la communauté juive de Kiev à Babi-Yar en 1941 y est rapporté, trois mois après peut-être, mais il est rapporté, l’insurrection du ghetto de Varsovie y est mentionnée dès le lendemain, et l’existence du camp d’Auschwitz également. »
Et la même année 2005 de la parution de l’ouvrage d’Annette Wieyiorka, paraissait chez Calmann-Lévy/Mémoire de la Shoah le livre «Secrets officiels : ce que les nazis planifiaient, ce que les Britanniques et les Américains savaient » de Richard Breitman. L’auteur a étudié et analysé d’innombrables archives et nombreux de ces documents attestent que non seuelement les Alliés détenaient bien des informations précises sur les camps mais aussi qu’ils possédaient des options d’interventions réalistes qu’ils n’ont pas appliquées. Raison pour laquelle, sans doute, ces archives ont été maintenues secrètes pendant des décennies.
On peut donc en déduire que les alliés étaient complices puisqu’ils savaient, pouvaient agir et ne l’ont pas fait. Et si cette complicité est attestée par des archives officielles, il n’est plus question d’historiquement inepte
En 1983, dans «Lire » n°97, Elie Wiesel, interrogé par Antoine de Gaudemar, disait ceci : « Quand le président Carter m’a nommé président de la Commission présidentielle de l’Holocauste, il m’a fait venir à la Maison-Blanche et il m’ a dit : ‘J’ai fait préparer quelque chose pour vous.’ Il s’a&gissait d’une série de photos aériennes, prises depuis un bombardier américain pendant une attaque contre une usine installée près d’Auschwitz. Eh bien, sur ces photos, on voit tout : le camp, les installations, les cheminées fumantes des crématoires, les fosses communes. Par ailleurs, on sait que des photos de Birkenau étaient parvenues à Londres, à Washington, et au Vatican dès 1942. A l’ouest, on savait, il suffit de lire les journaux…. Le massacre de la communauté juive de Kiev à Babi-Yar en 1941 y est rapporté, trois mois après peut-être, mais il est rapporté, l’insurrection du ghetto de Varsovie y est mentionnée dès le lendemain, et l’existence du camp d’Auschwitz également. »
Et la même année 2005 de la parution de l’ouvrage d’Annette Wieyiorka, paraissait chez Calmann-Lévy/Mémoire de la Shoah le livre «Secrets officiels : ce que les nazis planifiaient, ce que les Britanniques et les Américains savaient » de Richard Breitman. L’auteur a étudié et analysé d’innombrables archives et nombreux de ces documents attestent que non seuelement les Alliés détenaient bien des informations précises sur les camps mais aussi qu’ils possédaient des options d’interventions réalistes qu’ils n’ont pas appliquées. Raison pour laquelle, sans doute, ces archives ont été maintenues secrètes pendant des décennies.
On peut donc en déduire que les alliés étaient complices puisqu’ils savaient, pouvaient agir et ne l’ont pas fait. Et si cette complicité est attestée par des archives officielles, il n’est plus question d’historiquement inepte
Varsovie, 1942. La Pologne est dévastée par les nazis et les Soviétiques. Jan Karski est un messager de la Résistance polonaise auprès du gouvernement en exil à Londres. Il rencontre deux hommes qui le font entrer clandestinement dans le ghetto, afin qu'il dise aux Alliés ce qu'il a vu, et qu'il les prévienne que les Juifs d'Europe sont en train d'être exterminés.
Jan Karski traverse l'Europe en guerre, alerte les Anglais, et rencontre le président Roosevelt en Amérique. Trente-cinq ans plus tard, il raconte sa mission de l'époque dans Shoah, le grand film de Claude Lanzmann.
Mais pourquoi les Alliés ont-ils laissé faire l'extermination des Juifs d'Europe ?
Mon avis :
Un livre en trois parties : d'abord le récit de la séquence du film "Shoah" de Claude Lanzman dans laquelle Jan Karski apporte son témoignage. Puis le résumé du livre de Jan Karski sur son travail de messager pendant la Seconde guerre mondiale. Enfin, la partie romancée du livre dans laquelle l'auteur raconte la vie du messager polonais depuis le début de la guerre jusqu'à son apparition dans le film.
Certe, ce livre insiste sur l'indicible de la Shoah et la non-compréhension de ceux à qui le messager porte son message ; sur l'aveuglement volontaire des Alliés qui ne voulaient pas intervenir civilement mais préféraient des cibles militaires, permettant aux nazis de continuer leur oeuvre d'extermination.
Certe, l'auteur insiste sur le fait que le messager devient petit à petit le message que personne n'a voulu entendre, condamnant des milliers des personnes à la mort.
Certe, l'auteur revient sur le massacre des généraux polonais de Katyn injustement attribué à Hitler alors que ce sont les soviétiques qui ont orchestrés la fin de l'armée polonaise.
Mais en lisant ce livre, une phrase me revient en tête, celle d'"Ubu roi" : "l'histoire se passe en Pologne, c'est à dire nulle part". Mon impression est que dans ce livre, l'auteur a tenté de montrer que la Pologne n'est pas ce "pays nulle part" mais un bel et bien un vrai pays de résistants, contrairement à ce que l'histoire officielle veut nous le schématiser.
Je ne rentrerai pas dans la polémique suscitée par ce livre, car ce que je retiens, c'est la phrase de Claude Lanzman à Jan Karski : sur le mémorial de Yad Vachem, il y a surtout des noms de justes polonais.
L'image que je retiendrai :
Celle d'un homme hantant les coulisses du pouvoir mais ne pouvant expliquer ni faire comprendre l'indissible.
Lien : http://motamots.canalblog.co..
Jan Karski traverse l'Europe en guerre, alerte les Anglais, et rencontre le président Roosevelt en Amérique. Trente-cinq ans plus tard, il raconte sa mission de l'époque dans Shoah, le grand film de Claude Lanzmann.
Mais pourquoi les Alliés ont-ils laissé faire l'extermination des Juifs d'Europe ?
Mon avis :
Un livre en trois parties : d'abord le récit de la séquence du film "Shoah" de Claude Lanzman dans laquelle Jan Karski apporte son témoignage. Puis le résumé du livre de Jan Karski sur son travail de messager pendant la Seconde guerre mondiale. Enfin, la partie romancée du livre dans laquelle l'auteur raconte la vie du messager polonais depuis le début de la guerre jusqu'à son apparition dans le film.
Certe, ce livre insiste sur l'indicible de la Shoah et la non-compréhension de ceux à qui le messager porte son message ; sur l'aveuglement volontaire des Alliés qui ne voulaient pas intervenir civilement mais préféraient des cibles militaires, permettant aux nazis de continuer leur oeuvre d'extermination.
Certe, l'auteur insiste sur le fait que le messager devient petit à petit le message que personne n'a voulu entendre, condamnant des milliers des personnes à la mort.
Certe, l'auteur revient sur le massacre des généraux polonais de Katyn injustement attribué à Hitler alors que ce sont les soviétiques qui ont orchestrés la fin de l'armée polonaise.
Mais en lisant ce livre, une phrase me revient en tête, celle d'"Ubu roi" : "l'histoire se passe en Pologne, c'est à dire nulle part". Mon impression est que dans ce livre, l'auteur a tenté de montrer que la Pologne n'est pas ce "pays nulle part" mais un bel et bien un vrai pays de résistants, contrairement à ce que l'histoire officielle veut nous le schématiser.
Je ne rentrerai pas dans la polémique suscitée par ce livre, car ce que je retiens, c'est la phrase de Claude Lanzman à Jan Karski : sur le mémorial de Yad Vachem, il y a surtout des noms de justes polonais.
L'image que je retiendrai :
Celle d'un homme hantant les coulisses du pouvoir mais ne pouvant expliquer ni faire comprendre l'indissible.
Lien : http://motamots.canalblog.co..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Yannick Haenel
Lecteurs de Yannick Haenel (2016)Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature à l'école
Michel Tournier écrit en 1971 Vendredi ou la vie sauvage, souvent étudié au collège. Il s’agit d’une adaptation pour la jeunesse d’un autre de ses romans. Lequel ?
Robinson Crusoé
Vendredi ou les limbes du Pacifique
Vendredi et Dimanche
Seul au monde
10 questions
89 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, école
, généralisteCréer un quiz sur cet auteur89 lecteurs ont répondu