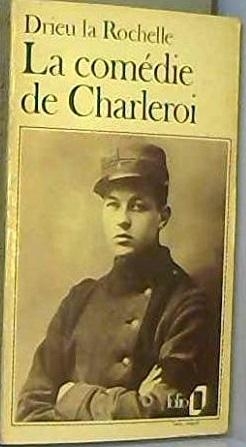Je suis prêt à parier qu'avant "l'affaire" 50 millions de Français ignoraient tout de Pierre Drieu la Rochelle. Jusqu'à son existence. Et pourtant, aussitôt qu'il fut question en 2012 de le faire entrer dans la prestigieuse collection de la pléiade : branle bas de combat général ! Une partie des médias enfourchèrent aussitôt leur "Dada" habituel. C'était le retour de la bête immonde...nous allions revivre les heures les plus sombres de notre histoire. N'avaient-ils pas des sujets plus importants à traiter ? D'ailleurs, avaient-ils lu un seul livre de lui ? Leur seul souci était de dire qu'un fasciste ne pouvait devenir un grand écrivain et que le lire vous faisait devenir automatiquement un affreux nostalgique de Benito. La liberté d'expression oui ! mais pas pour tout le monde...il ne faut pas déconner quand même.
Jean-Marc Reiser disait "On vit une époque formidable". Il n'avait pas tout vu. Aujourd'hui plus les événements sont lointains, plus les sectaires s'y intéressent. Je crains qu'un jour le massacre de la Saint-Barthélemy nous revienne dans la gueule...
Car enfin 70 ans après les faits, est-ce que la publication de Pierre Drieu la Rochelle dans la pléiade allait relancer les guerres, les famines et autres fléaux qui existent de par le monde ? Restons sérieux deux minutes.
En 1970, quand le livre de poche a publié La Comédie de Charleroi, il n'y eu aucune protestation, aucune hystérie alors que figuraient déjà au catalogue trois autres livres du même auteur (Gilles, l'Homme à cheval, le Feu follet).
Alors ? Faut-il aujourd'hui créer des brigades spéciales chargées de brûler tous les livres de Drieu ? (tiens, cela me rappelle quelque chose).
Faut-il condamner lourdement tout individu qui vendra, qui lira, qui possédera un ouvrage de Pierre Drieu la Rochelle ?
Orwell ! ils sont devenus fous.
Quiconque aura lu La comédie de Charleroi ne pourra que constater le talent de son auteur. Seul un grand écrivain a les capacités de faire naître un tel livre. Tout le reste n'a rien à voir avec la littérature. Hélas nous vivons une époque où les barbares n'ont que faire des livres.
Ils ne lisent pas, ils hurlent.
Jean-Marc Reiser disait "On vit une époque formidable". Il n'avait pas tout vu. Aujourd'hui plus les événements sont lointains, plus les sectaires s'y intéressent. Je crains qu'un jour le massacre de la Saint-Barthélemy nous revienne dans la gueule...
Car enfin 70 ans après les faits, est-ce que la publication de Pierre Drieu la Rochelle dans la pléiade allait relancer les guerres, les famines et autres fléaux qui existent de par le monde ? Restons sérieux deux minutes.
En 1970, quand le livre de poche a publié La Comédie de Charleroi, il n'y eu aucune protestation, aucune hystérie alors que figuraient déjà au catalogue trois autres livres du même auteur (Gilles, l'Homme à cheval, le Feu follet).
Alors ? Faut-il aujourd'hui créer des brigades spéciales chargées de brûler tous les livres de Drieu ? (tiens, cela me rappelle quelque chose).
Faut-il condamner lourdement tout individu qui vendra, qui lira, qui possédera un ouvrage de Pierre Drieu la Rochelle ?
Orwell ! ils sont devenus fous.
Quiconque aura lu La comédie de Charleroi ne pourra que constater le talent de son auteur. Seul un grand écrivain a les capacités de faire naître un tel livre. Tout le reste n'a rien à voir avec la littérature. Hélas nous vivons une époque où les barbares n'ont que faire des livres.
Ils ne lisent pas, ils hurlent.
Difficile de critiquer Drieu la Rochelle sans évoquer l'auteur. Il fit partie avec Céline, Brasillach et Montherlant, du quatuor des grands écrivains collaborationnistes, qui choisirent le camp de l'Allemagne et du Maréchal. Il y en eut beaucoup d'autres bien sûr, dont certains (Paul Chack, Abel Bonnard, Suarez…) furent même condamnés à mort à la libération. Mais ils étaient les plus connus, les plus symboliques, les plus talentueux aussi (si l'on met de côté le cas Chardonne), et ce sont leurs noms qui restèrent, marqués d'infamie, face au quatuor de Kessel, Aragon, Vercors et Romain Gary symbolisant eux la Résistance. Mais pourquoi avaient-ils fait ce choix ? Difficile de ne pas ouvrir l'un de leur livre sans espérer y trouver la réponse…
Est-elle ici ? Peut-être bien. Ce sont les souvenirs de guerre de Drieu la Rochelle. de la Grande Guerre. La première. Une suite de courts récits, récit de campagnes, de bombardements, de shrapnel et de mitrailleuses. de permissions, de casernes, d'hôpitaux. de transports de troupes par train, par bateaux, à pied. Il s'en dégage une odeur fade et rance. Celle des corps sales transpirant dans le drap raide et beaucoup trop chaud des uniformes. de la piquette acide, infecte, avalée par litres. Il y est question de combats, aussi. Et surtout du sentiment d'être dans une armée de paysans et de boutiquiers, qui même déguisés en héros ne sont à l'évidence que des paysans et des boutiquiers.
L'être qui a écrit ses lignes n'était, je pense, pas matériellement capable de résister à quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est un être dont le ressort intérieur est brisé, dont toute la personne est comme effondrée en lui-même.
Est-elle ici ? Peut-être bien. Ce sont les souvenirs de guerre de Drieu la Rochelle. de la Grande Guerre. La première. Une suite de courts récits, récit de campagnes, de bombardements, de shrapnel et de mitrailleuses. de permissions, de casernes, d'hôpitaux. de transports de troupes par train, par bateaux, à pied. Il s'en dégage une odeur fade et rance. Celle des corps sales transpirant dans le drap raide et beaucoup trop chaud des uniformes. de la piquette acide, infecte, avalée par litres. Il y est question de combats, aussi. Et surtout du sentiment d'être dans une armée de paysans et de boutiquiers, qui même déguisés en héros ne sont à l'évidence que des paysans et des boutiquiers.
L'être qui a écrit ses lignes n'était, je pense, pas matériellement capable de résister à quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est un être dont le ressort intérieur est brisé, dont toute la personne est comme effondrée en lui-même.
Pierre Drieu la Rochelle a écrit ce recueil de nouvelles à propos de la guerre 14/18 en 1934. Bien qu'inspirées de son expérience personnelle, elles témoignent d'une certaine distance par rapport à l'évènement comme à travers «Le lieutenant de tirailleurs » ou « le Déserteur » dans lesquelles la forme moderne de la guerre occidentale est analysée et fortement critiquée. Dans la première nouvelle, « La Comédie de Charleroi », l'accent est mis sur l'inhumanité des combats et de la mort du soldat, ainsi que sur le rôle pathétique de la mère bourgeoise qui joue la comédie même devant la tombe de son fils, en quête permanente d'un statut social pour masquer la vanité de son existence.
Drieu n'est pas contre la guerre en soi – bien qu'il rejoigne ceux qui ont dénoncé l'absurdité de celle-ci - mais contre cette guerre moderne dans laquelle l'homme n'est plus rien qu'une chair à canon démocratique. Il est pour une armée de métier, avec de vrais chefs qui vont au combat à la tête de leurs troupes et ne sont pas à l'abri dans leurs bureaux. D'où sa nostalgie de terres plus authentiques comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Et des guerres lointaines du Moyen Age…
Ce sont tous les mensonges de la guerre et de l'après-guerre qui sont évoqués, l'héroïsme dérisoire, les vantardises des planqués, les femmes vénales et sans tendresse, les faux exploits et les vrais lâchetés. On y retrouve également les champs de morts, le martèlement des obus, les blessés, la peur, les maladies, les conditions de vie difficiles.
Une très belle écriture, un point de vue original, marqué par une réflexion sur la décadence des vieilles nations européennes, de la bourgeoisie et de l'impasse vers laquelle se précipite le vieux monde…en route vers les totalitarismes. Drieu lui-même se prendra à leur piège ce qui ne remet pas en cause son talent d'écrivain.
Drieu n'est pas contre la guerre en soi – bien qu'il rejoigne ceux qui ont dénoncé l'absurdité de celle-ci - mais contre cette guerre moderne dans laquelle l'homme n'est plus rien qu'une chair à canon démocratique. Il est pour une armée de métier, avec de vrais chefs qui vont au combat à la tête de leurs troupes et ne sont pas à l'abri dans leurs bureaux. D'où sa nostalgie de terres plus authentiques comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Et des guerres lointaines du Moyen Age…
Ce sont tous les mensonges de la guerre et de l'après-guerre qui sont évoqués, l'héroïsme dérisoire, les vantardises des planqués, les femmes vénales et sans tendresse, les faux exploits et les vrais lâchetés. On y retrouve également les champs de morts, le martèlement des obus, les blessés, la peur, les maladies, les conditions de vie difficiles.
Une très belle écriture, un point de vue original, marqué par une réflexion sur la décadence des vieilles nations européennes, de la bourgeoisie et de l'impasse vers laquelle se précipite le vieux monde…en route vers les totalitarismes. Drieu lui-même se prendra à leur piège ce qui ne remet pas en cause son talent d'écrivain.
Drieu et la Grande Guerre.
Un condensé de l'aberrante nature humaine dans ces six nouvelles avec pour toile de fond 14-18.
De la Bataille des Frontières à Verdun, Drieu La Rochelle nous témoigne de ses émotions intimes sur cette expérience métaphysique inique, abominable, transfigurant tous les codes sociétaux.
Un condensé de l'aberrante nature humaine dans ces six nouvelles avec pour toile de fond 14-18.
De la Bataille des Frontières à Verdun, Drieu La Rochelle nous témoigne de ses émotions intimes sur cette expérience métaphysique inique, abominable, transfigurant tous les codes sociétaux.
Avant d'évoquer le texte proprement dit, je préviens par avance que je vais décevoir les collectionneurs de repentance en n'insistant pas lourdement sur le passé collaborationniste de l'auteur de la Comédie de Charleroi. Je laisse ce soin à d'autres…
Ce recueil de six nouvelles raconte la guerre [la Première] en six tableaux ; une guerre que Drieu La Rochelle a faite, comme beaucoup d'autres, et qui l'imprégnera durablement – il y sera blessé trois fois.
Le narrateur, qui nous traîne dans son sillage à travers ces tableaux peints avec un regard perçant et implacable, oscille entre exaltation et découragement, patriotisme et nihilisme, courage et lâcheté, enthousiasme et ennui, etc., comme pour exprimer toute la moelle d'une expérience hors-norme qui le pousse à ces comportements paradoxaux. Car la guerre « n'a jamais été faite uniquement par ceux à qui elle plaisait, et ceux-là ont toujours été tentés de la faire, plutôt qu'à leur pareils, aux autres. »
Cette guerre est nouvelle : « une guerre pour bureaucrates, ingénieurs, un supplice inventé par des ingénieurs sadiques pour des bureaucrates tristes. » C'est une « guerre d'usines », avec pour corollaire la mort industrielle, où les chefs « sont chargés de déverser des trains de viande dans le néant »…
Tout commence en accompagnant à Charleroi une femme snob et mère d'un soldat mort au combat, dont le narrateur était le camarade avant de devenir le secrétaire de ladite mère. À partir de là, dans le décor de ses premières frayeurs et exaltations de soldat, il se souvient. Tout commence (je me répète) pendant cet été 1914, quand on « achevait de rassembler le bétail le plus héroïquement passif qu'ait jamais eu à prendre en compte l'Histoire qui brasse les troupeaux ». Ce Grand troupeau, écrivait Jean Giono…
Troupeau qui se résume ainsi : « Au fond, j'avais senti autour de moi l'accablement de toute cette médiocrité qui fut pour moi le plus grand supplice de la guerre, cette médiocrité qui avait trop peur pour fuir et trop peur aussi pour vaincre et qui resta là pendant quatre ans, entre les deux solutions. »
Tout le texte recèle de ces phrases fusant comme des balles tirées non plus à la face de l'ennemi mais celle du lecteur, réceptacle de ces pages pleines de dualité. le narrateur pousse le bouchon très loin, jusque dans la basse luxure, à Marseille en transit, ne nous épargnant pas même les détails de sa dysenterie dans les Dardanelles. Parce qu'il en aura vu du pays ; c'était partout une « jungle de fer » : « ces lieux où j'avais tant souffert et la souffrance m'avait fait connaître certaines extrémités de moi-même. »
Puis il y a ces généralités cinglantes, dont certaines feraient aujourd'hui craindre le pire sur les réseaux (a)sociaux : « Les femmes sont presque toujours des actrices, des caricatures attendrissantes de leurs hommes. » Il y a aussi celle-ci, exemplaire : « L'oeuvre d'art la plus réussie est une déception pour qui a tenu dans ses mains la misérable vérité ; elle peut pourtant lui apporter une ivresse favorable à ses chers souvenirs. »
D'autre fois, une sorte de cynisme l'emporte : « Je ne suis pas ici en tant que patriote, mais en tant que bourgeois raffiné, avide d'expériences. Je viens vers le peuple par un romantisme transposé, méconnaissable, un romantisme taciturne et dandy. » Il y a, enfin, l'aveu fataliste quand il est question d'avenir : « Les patriotes mourront au fond d'une cave. »
Quant à la guerre, elle le perturbera jusqu'au bord de l'armistice, en 1918, et il ira défier le sort en s'approchant du front alors qu'il n'en avait plus l'obligation. La guerre déconstruit autant qu'elle construit les êtres qui s'y frottent, terrible paradoxe : « Je pressentais confusément ce que j'ai éprouvé depuis, qu'un même abandon délibéré à la mort serait la base de toutes mes actions », avouant par ailleurs : « Je n'ai jamais eu besoin d'action que par spasmes. » Inconstance d'un esprit tourmenté autant par lui-même que les événements.
Enfin, il y a cette phrase, prononcée en Amérique du Sud par un déserteur, des années après le conflit ; phrase qui ressemble étrangement au destin de Drieu La Rochelle, interrompu par son suicide en mars 1945 (moi qui m'étais promis de ne pas en parler… !) : « J'ai joué franchement avec les hommes : je leur ai donné en justes parts mon dégoût et ma tendresse. » Parce que la guerre démasque le soldat dans ses plus profonds retranchements, il est désormais condamné à tout voir chez ses semblables, le haut comme le bas…
Dans ces pages, la guerre joue ce rôle dont parlent parfois ceux qui l'ont faite : un révélateur de soi-même. 1914-1918, deux dates qui n'auront pas abîmé que les corps, mais aussi, et plus durablement les esprits. Certains se seront précipités plus tard dans des abandons funestes. Cependant, le temps des rancoeurs n'est plus ; il faut lire désormais Drieu La Rochelle pour ce qu'il est : un écrivain.
Ce recueil de six nouvelles raconte la guerre [la Première] en six tableaux ; une guerre que Drieu La Rochelle a faite, comme beaucoup d'autres, et qui l'imprégnera durablement – il y sera blessé trois fois.
Le narrateur, qui nous traîne dans son sillage à travers ces tableaux peints avec un regard perçant et implacable, oscille entre exaltation et découragement, patriotisme et nihilisme, courage et lâcheté, enthousiasme et ennui, etc., comme pour exprimer toute la moelle d'une expérience hors-norme qui le pousse à ces comportements paradoxaux. Car la guerre « n'a jamais été faite uniquement par ceux à qui elle plaisait, et ceux-là ont toujours été tentés de la faire, plutôt qu'à leur pareils, aux autres. »
Cette guerre est nouvelle : « une guerre pour bureaucrates, ingénieurs, un supplice inventé par des ingénieurs sadiques pour des bureaucrates tristes. » C'est une « guerre d'usines », avec pour corollaire la mort industrielle, où les chefs « sont chargés de déverser des trains de viande dans le néant »…
Tout commence en accompagnant à Charleroi une femme snob et mère d'un soldat mort au combat, dont le narrateur était le camarade avant de devenir le secrétaire de ladite mère. À partir de là, dans le décor de ses premières frayeurs et exaltations de soldat, il se souvient. Tout commence (je me répète) pendant cet été 1914, quand on « achevait de rassembler le bétail le plus héroïquement passif qu'ait jamais eu à prendre en compte l'Histoire qui brasse les troupeaux ». Ce Grand troupeau, écrivait Jean Giono…
Troupeau qui se résume ainsi : « Au fond, j'avais senti autour de moi l'accablement de toute cette médiocrité qui fut pour moi le plus grand supplice de la guerre, cette médiocrité qui avait trop peur pour fuir et trop peur aussi pour vaincre et qui resta là pendant quatre ans, entre les deux solutions. »
Tout le texte recèle de ces phrases fusant comme des balles tirées non plus à la face de l'ennemi mais celle du lecteur, réceptacle de ces pages pleines de dualité. le narrateur pousse le bouchon très loin, jusque dans la basse luxure, à Marseille en transit, ne nous épargnant pas même les détails de sa dysenterie dans les Dardanelles. Parce qu'il en aura vu du pays ; c'était partout une « jungle de fer » : « ces lieux où j'avais tant souffert et la souffrance m'avait fait connaître certaines extrémités de moi-même. »
Puis il y a ces généralités cinglantes, dont certaines feraient aujourd'hui craindre le pire sur les réseaux (a)sociaux : « Les femmes sont presque toujours des actrices, des caricatures attendrissantes de leurs hommes. » Il y a aussi celle-ci, exemplaire : « L'oeuvre d'art la plus réussie est une déception pour qui a tenu dans ses mains la misérable vérité ; elle peut pourtant lui apporter une ivresse favorable à ses chers souvenirs. »
D'autre fois, une sorte de cynisme l'emporte : « Je ne suis pas ici en tant que patriote, mais en tant que bourgeois raffiné, avide d'expériences. Je viens vers le peuple par un romantisme transposé, méconnaissable, un romantisme taciturne et dandy. » Il y a, enfin, l'aveu fataliste quand il est question d'avenir : « Les patriotes mourront au fond d'une cave. »
Quant à la guerre, elle le perturbera jusqu'au bord de l'armistice, en 1918, et il ira défier le sort en s'approchant du front alors qu'il n'en avait plus l'obligation. La guerre déconstruit autant qu'elle construit les êtres qui s'y frottent, terrible paradoxe : « Je pressentais confusément ce que j'ai éprouvé depuis, qu'un même abandon délibéré à la mort serait la base de toutes mes actions », avouant par ailleurs : « Je n'ai jamais eu besoin d'action que par spasmes. » Inconstance d'un esprit tourmenté autant par lui-même que les événements.
Enfin, il y a cette phrase, prononcée en Amérique du Sud par un déserteur, des années après le conflit ; phrase qui ressemble étrangement au destin de Drieu La Rochelle, interrompu par son suicide en mars 1945 (moi qui m'étais promis de ne pas en parler… !) : « J'ai joué franchement avec les hommes : je leur ai donné en justes parts mon dégoût et ma tendresse. » Parce que la guerre démasque le soldat dans ses plus profonds retranchements, il est désormais condamné à tout voir chez ses semblables, le haut comme le bas…
Dans ces pages, la guerre joue ce rôle dont parlent parfois ceux qui l'ont faite : un révélateur de soi-même. 1914-1918, deux dates qui n'auront pas abîmé que les corps, mais aussi, et plus durablement les esprits. Certains se seront précipités plus tard dans des abandons funestes. Cependant, le temps des rancoeurs n'est plus ; il faut lire désormais Drieu La Rochelle pour ce qu'il est : un écrivain.
Il serait faux de prétendre que l'expérience d'un événement conditionne la qualité ou la profondeur de celui qui le relate, comme si c'était nécessairement qu'à force d'expériences on gagnait en profondeur. En grande part, et je crois même en majorité, l'existence ne précède pas l'essence – Sartre était décidément trop superficiel. C'est plutôt la qualité d'une personne qui détermine si elle a bel et bien « vécu » l'événement, si elle l'a vécu complètement, en tirant de l'expérience un dense enseignement, n'en laissant rien perdre. Il ne suffit jamais de vivre pour penser bien personnellement le vécu. Beaucoup traversent l'existence avec quantité de préjugés qu'ils appliquent comme une grille de lecture uniforme et lénifiante sur tout ce qui leur arrive, comme un tamis qui en égrène les saillies et en déforment la réalité, sur toutes leurs perceptions et intellections, de sorte que non seulement ce qu'ils voient garde à jamais la saveur médiocre de ce préjugé initial, mais qu'ils ne peuvent voir que ce que les bornes de leurs préjugés leur permettent de trouver : ils sont ainsi affectés exactement comme ils sont censés l'être, et, sans avoir vécu leurs épreuves, on devine ce qu'ils vont en dire et qui correspond tout juste aux limites de ce qu'ils peuvent ressentir et comprendre sans qu'ils en soient davantage édifiés. On ne retient pas d'une expérience une philosophie ou même une pensée neuve si l'on n'est pas préparé ou apte à en extraire la leçon ; on ne parle avec justesse que de ce qu'on a vécu avec intégrité et avec singularité, à l'abri des influences et des paradigmes préconçus, de tout ce qui en altère à la fois la réception et le constat, et en atténue la teneur et la pertinence. Tout ce qu'on perçoit avec le regard de la banalité ne vaut à peu près rien comme expérience parce qu'on ne se l'approprie pas, parce qu'on l'assimile avec l'esprit commun d'autrui, avec une mentalité de foule, de n'importe qui, de celui qui ne l'a pas intériorisé ni même vraiment vécu, et l'on devient la morale en même temps que la vox populi, on ne fait que répéter des schémas de pensée et donc d'actions, on devient un homme-proverbe en pensées comme en actes. Il y a ainsi nombre d'expériences et probablement la plupart, peut-être toutes, qu'on recopie en soi-même comme on en a entendu parler ou très exactement comme il « faut » les vivre, et pas autrement ; on n'y intègre rien de sa propre personne, on les vit comme une répétition de théâtre, un numéro dont on est inextricablement imprégné, avec réactions et répliques toutes prêtes. On emprunte à des moeurs, parce qu'on les estime valables, des comportements issus de soi-disant « valeurs » en vérité impensées, puis on y appose des justifications au regard de cet ordre moral préétabli souvent socialement, et toutes nos raisons, toutes nos réflexions, on ne songe même pas qu'elles ne sont que des automatismes, que personne en nous n'a puisé des circonstances qu'une pâle imitation de ce qui est attendu ou vraisemblable, systématiquement sans surprise vu de quelque distance, et que nous nous plaisons parfois à appeler notre « devoir ». Non, les événements ne nous altèrent pas, ne nous enseignent pas, ils ne modifient rien en nous, ne font que confirmer nos tendances et nos soupçons où la facilité nous plonge, parce que ce que nous étions avant de les traverser était d'une nature telle que nous ne savions déjà que réagir et nullement être. Alors nous suivons ce courant qui nous emporte encore, mais c'est toujours la même eau et dans la même direction, le bain n'a pas changé, ni la position et l'indolence de notre corps sur l'onde : il est écrit depuis longtemps qu'à tel flux nous nous noierons ou flotterons de telle façon, ça ne devrait vraiment surprendre personne, la manière dont les gens prétendent s'être tournés sur le dos ou s'être mis à nager ; ils savaient nager ou faire la planche, ils n'ont fait que s'en souvenir ; ils ont créé de toute pièce la pensée qu'ils ne le savaient pas auparavant pour se donner de la fierté d'avoir « su réagir » ; de sorte que tout ce qu'ils appellent « événement » de leur vie est une continuité de mentalité paresseuse, une inertie, sans changement. Rien ne les rencontre ; ils ne sont soulevés par rien. Ils persévèrent. Ils persistent. On sera ce qu'on est déjà, même après ces « épreuves » ; on sait d'avance tout ce qu'ils feront et penseront, à très peu près. Un préjugé-routine nivèle tout accident de la route. Il n'y a pas d'accident : profondément, tout est égalisé ; il n'y a qu'en superficie qu'on croit distinguer des pics, des apparences de monts, de fausses montagnes, des rumeurs de vaux et de collines, des réputations de reliefs, des reconnaissances de topographie, mais la forme de ces données est tellement codifiée que leur théorie universelle s'oppose à la réalité particulière, et que c'est tout à fait la différence entre la carte et le territoire.
C'est bien ainsi que tout ce qui nous arrive n'est qu'un stimulus qui avait déjà en nous sa réponse : nous ne songeons pas en propre, ni à ce que nous faisons, ni à ce que nous pensons, parce qu'un foncier réflexe de routine et d'irréflexion conditionne nos conclusions, de sorte que nos « événements » n'ont pas d'influence, n'occasionnent aucune inflexion sur le cours de nos existences ; mais ces conclusions en réalité n'ont pas changé du fait de l'événement, elles n'ont été que révélées par lui, en germes plus ou moins inconscients l'événement les ont exprimées, et rien de plus ; voilà en quoi nous sommes et demeurons identiques et inauthentiques. Il faut profondément être, en identités autonomes et intègres, disposant d'un fond propre de sensations et d'analyses, pour compter dans l'espace et le temps, pour exister et pour voir, pour pouvoir s'empêcher de seulement réagir en se conformant perpétuellement à des préjugés antérieurs. C'est en cela que l'essence, largement, précède l'existence : tout ce qu'on croit déduire de la vie est ce qu'on est disposé au préalable à en penser, et c'est la limite même de nos perceptions. On ne voit que ce qui nous est plausible, que les informations que nous sommes aptes et prêts à considérer et à intellectuellement traiter, et le reste disparaît de notre phénoménologie ; toutes nos réflexions sur des faits sont contenues en théories en nous avant la survenue des faits, nul n'est vraiment modifié altéré, ou bouleversé par un fait imprévu en ce que la conclusion de ce fait était déjà inscrite en nous dans notre compréhension relative et obtuse de la réalité, en ce que nous avions pour principe ou pour dogme d'admettre tel ordre ou telle catégorie de fait de telle manière, avec telle interprétation ou tel crible c'est-à-dire avec telle « morale ». Pour le psychopathologue du Contemporain qui souhaiterait établir un classement systématique de ces événements et de ces réactions, il ne s'agirait que de savoir les anticiper avec un certain esprit d'épiderme pour en déceler le sentiment expédient, le sentiment standard, le sentiment-type ; chacun n'expérimente la vie qu'avec le prisme réducteur d'une mentalité formatée, au point que tout ce qu'on perçoit consiste uniquement, sauf chez de rares individus, en ce que notre plus ou moins grande fermeture d'esprit permet de distinguer.
Pour inclure un exemple éloquent à cette réflexion, je dirais que le Contemporain, en toutes ses expériences, est pareil à l'étranger des Inuits qui ne regarde la neige globalement que comme une masse friable, froide et blanche : pour son hôte, c'est toute une complexité, une perplexité, une somme de connotations capitales non simplement selon les sensations qu'elle suggère mais selon les conceptions, nombreuses et variées, antérieures même à la pensée, de la notion et du vocable, de ces inférences préétablies (pour un Inuit, la neige, selon son état, est un risque de péril mortel ou de faveur naturelle) ; autrement dit, pour éprouver la subtilité pleine et profonde de l'expérience « neige », il ne suffit pas de la voir ou toucher, il faut l'appréhender en-dehors des préconceptions les plus typiques et grossières, en-dehors des simplifications les plus stériles et catégoriques, et la sonder suivant des modes d'analyse d'une grande diversité de distance et de points de vue, mais aussi l'intérioriser selon le mode le plus subjectif c'est-à-dire en s'extrayant de toutes les objectivités référencées et en y recherchant ce qu'elle décèle en soi de plus vierge, de plus intrinsèque et inaltéré, de plus idiosyncratique et dissemblable. À ces conditions seulement la neige, ou toute autre expérience, cesse d'être la copie d'une morale acquise et recopiée, jusqu'à sa teneur sensorielle c'est-à-dire jusqu'à son état : il est indéniable que l'Inuit perçoit la neige autrement que nous, et, pour appréhender la neige, s'il applique lui aussi une grille de lecture, cette grille est presque infiniment plus élaborée que la nôtre, de sorte que quand il doit inférer ou déduire à partir de la neige, il agit et pense nécessairement avec une supérieure complexité, presque infiniment – où je démontre que non seulement ce qu'on conclut d'un fait mais sa réalité dépend intrinsèquement des préconceptions notamment morales dont on fonde son jugement, jugement qu'on ne construit généralement que par imitation issue d'un environnement proche et par suite d'une éducation de conformité. Comment donc serions-nous chamboulés, comment pourrions-nous être révolutionnés d'un événement dont nous sommes incapables de rien que sentir la nouveauté ? Même la maladie et la mort – surtout la maladie et la mort – se conçoivent avec une somme faramineuse de préjugés et d'inculcations entravant leur exacte considération en tant que faits, de sorte que, non, nous n'en vivons pas l'expression inaltérée : nous ne faisons peu ou prou que reconduire les sentiments et pensées sur la maladie et sur la mort tels que notre société nous les dicte ; nous sommes trop sociaux avant que d'être, d'être vraiment par soi-même, et ainsi toutes nos expériences en sortent lénifiées et égalisées, nous ne vivons pas ce que nous prétendons vivre, nous conformons nos sens à une interprétation unanime des phénomènes qu'on rencontre et dont nous ne percevons que des parcelles validées. Toute notre réalité est une fragmentation et une réduction.
Ce qui suit en est la démonstration dure : la plupart des lettres authentiques de poilus ne font que répéter les mêmes visions détournées de préconceptions semblables ; je veux dire, et c'est terrible, que n'importe qui d'un peu imaginatif et rigoureux parlerait pareillement de ce conflit sans l'avoir expérimenté, rien qu'après avoir suivi une synthèse historique ; on croirait lire une imagerie uniforme où ne s'investit pas d'individu, imagerie dont la raison ne tient pas du tout aux faits identiques dont le rapport peut fort bien ne pas différer beaucoup, mais à une attention portée aux mêmes impressions manifestement recopiées, aux mêmes espérances et rancunes nettement imbibés, aux mêmes intentions de rumeurs et de plaintes ayant préexisté à la guerre ou s'étant transmises au sein des soldats à l'arrière ou sur le front, aux mêmes éléments dont l'analyse révèle qu'ils ne sont pas plus évidents qu'universels mais bel et bien élus selon leur complaisante et rassurant unanimité, toutes représentations, en somme, à l'exclusion d'une version personnelle et unique du fait vécu, à l'exclusion d'un regard profond porté sur son environnement en relation avec soi, à l'exclusion d'un sentiment et d'une réflexion plus qu'automatiques et superficiels qui diffèreraient des autres et tâcheraient à quêter, notamment, quelque essence de la guerre en rapport avec une singularité. Je ne reproche évidemment pas aux combattants d'avoir relaté les mêmes réalités puisqu'ils en furent témoins, mais je constate avec objectivité et comme philologue qu'ils n'ont accordé d'importance qu'à des faits auxquels ils étaient intellectuellement préparés, qu'ils ont automatiquement exclu de leurs observations tout ce qui échappait au bain connu des consensus, qu'ils ont ainsi rapporté ce qu'il convenait de remarquer plutôt que ce qu'en tant qu'individu ils auraient pu vouloir remarquer, de sorte qu'ils n'ont même vu au coeur de la tourmente que ce qu'ils étaient disposés à voir, que ce que leur esprit se croyait autorisé à penser, et bien souvent ce n'est qu'après avoir lu un témoignage différent du leur qu'ils se sont permis de relater eux aussi ce fait, sans pourtant la conscience de cette influence, si bien que ce n'est que par somme d'inspirations, pour ainsi dire, que le fait s'est mis à exister, c'est-à-dire à exister comme considérable dans le champ des perceptions : c'est cette sélection qui constitue la preuve même que ces soldats n'ont vécu la bataille qu'avec un esprit commun, autrement dit qu'avec le tamis de la grégarité et du consensus au point qu'il serait relativement facile de produire des faux où les mêmes tropismes se rencontreraient et où, hormis certains noms et dates pour lesquels il faudrait minutieusement se renseigner, on serait sans grande peine à traduire la pensée médiocrement majoritaire d'un poilu selon son niveau social (j'ai d'ailleurs eu l'occasion, à ce que je crois, de confondre une de ces mystifications, mais le faux témoignage dont il s'agit s'inscrit dans une telle société d'adulation qu'il ne m'a pas été loisible de convaincre ses lecteurs de la falsification et que j'ai préféré abandonner dès l'abord toute démonstration qui, pour exacte et concordante d'un point de vue philologique, aurait été fâcheuse à de nombreux idolâtres).
Ainsi, un être imaginatif n'a pas besoin d'expérimenter les tranchées pour en retranscrire l'horreur de façon persuasive, et je prétends qu'il n'en avait guère besoin non plus à l'époque, puisque c'est toujours la même description dans les témoignages, grossièrement rendue, très uniforme, et donc à la fois grossièrement et uniformément vécue, sans recherche de particularité et sans nette altération imputable au point de vue – c'est sans parler encore de l'Histoire comme propagande et opportunité qui défend « moralement » qu'on attaque des discours officiels. Si l'on y regarde bien, c'est à croire qu'en la rédaction de ces lettres a dominé inconsciemment un principe de conformité, une volonté de typicité, un désir d'accumulation et d'insistance pour l'édification, comme cela se rencontre dans les sondages lorsque les Français expriment tous la même opinion de façon presque délibérée pour indiquer massivement une défiance, ou comme dans la pétition où l'on feint de s'accorder parfaitement avec le manifeste en dépit des nuances pour faire valoir un gros contentieux. On force la réalité à l'identique parce qu'on ne la regarde qu'en usant des outils du général, et l'on en ignore et abstrait la réalité intérieure, on annihile l'individu en s'en épargnant la recherche, parce que l'identité est plus difficile à saisir que la conformité, et pourtant c'est bien cette réalité-ci qui finirait par constituer le témoignage général si elle était suffisamment communiquée jusqu'à imprégner les moeurs. Comme chacun adapte son discours à ce que l'interlocuteur ou le lecteur est disposé à entendre, on vérifie toujours au préalable que son propos a déjà été accepté ailleurs, nos perceptions même relèvent aussitôt si cette réalité qu'on est tenté d'atteindre est convenable avant de la considérer et de l'assimiler, et l'on se fie, avant de relater un fait, avant même que sa sensation s'intègre à soi, à ce qu'un grand nombre de gens ont pu en communiquer avec acceptabilité, tel grand nombre qui toujours ne se fonda que sur les témoignages d'un petit nombre, les rares à avoir véritablement vécu et rapporté l'événement les premiers, en quoi chez l'homme la perception d'un phénomène enfle ni plus ni moins comme une rumeur et presque indépendamment de la réalité, ou disons de la profondeur, de ce phénomène. On adhère d'abord à une version de telle expérience, après quoi seulement on vit l'expérience en adéquation avec cette version : mais rares sont les personnes capables de se détacher virginalement de toute antériorité convenable d'un phénomène auquel ils sont mêlés pour le vivre pleinement et tel qu'il est.
Et puis, quand un jour un individu véritable prend la parole pour chercher une vérité au mépris de ce qui est unanime et admis, et par exemple sur la guerre, cela donne quelque Marc Bloch et L'étrange défaite où chacun s'étonne d'avoir vécu les mêmes faits sans avoir songé à les raconter, parce que l'unique et le profond étaient inaccessibles à des esprits désireux surtout de ne pas se distinguer, sans doute pour être aisément crus, cependant que surgit une impression d'évidence. Tout à coup, le fait diffère et l'histoire change, tout se complète d'une vision qui donne corps à une réalité ignorée c'est-à-dire méprisée, on découvre qu'il existe quelque vérité universelle que tout l'univers a tu faute d'oser y toucher, et l'histoire se trouve augmentée qui n'était composée que d'une collection de rapports convergents, dont la convergence était une condition de recevabilité, la voici soudain subitement altérée d'un seul témoignage qui explique ce qu'on n'avait pas réussi à démêler, il n'a fallu qu'une sensibilité intacte et approfondie pour exhumer un fait qui s'avère plus vraisemblable et systématique dans l'ensemble d'une période que ce que peut-être dix mille hommes ou même davantage ont communiqué en ne recourant justement qu'à un commun esprit-de-vraisemblance c'est-à-dire en ne faisant que voir et dire ce qu'ils se supposaient tenus ou condamnés de voir et de dire. Cette manie presque instinctive, sociale, d'abonder les versions répandues pour se couler une place au sein d'un environnement médiocre est ce qui nuit le plus au monde, à l'innovation et à la grandeur : personne ne tente d'audace, chacun envisage le moindre écart à la doxa avec scepticisme et crainte, on est envahi d'un immense doute de soi à l'impression de la plus petite différence qu'on se retient alors d'exprimer au point de la bannir de ses sens, et ainsi tout demeure ou est considérablement ralenti, l'humanité se fige qui tient surtout à ressembler, au point que même la réalité ne peut plus être examinée que suivant un angle très répandu, cette réalité qui se confond avec le banal et s'y enracine, qui ne tire sa substance que de l'idée vague de sa vraisemblance. En cela, une véritable éducation devrait être une école de la sensibilisation au péril de l'uniforme qui devient aveuglement et même mensonge bienséant, et pas du tout consister en ces établissements on l'on n'enseigne au contraire qu'à respecter des procédures et des paroles sur des fondements aussi fragiles que l'autorité des professeurs et des diplômes. On n'y devrait pas se contenter de lire des textes et de consulter des documents, mais lire en soi et y consulter plutôt la superbe plausibilité de tout ce qui n'a pas été documenté jusqu'alors. Quelle grandiose avancée ce serait alors dans tous les domaines de la connaissance : ne pas se limiter à des codes ou à des dogmes extérieurs et préétablis ni pour déduire ni pour percevoir ! Admettre en n'importe quelle science l'éventualité par défaut d'une incomplétude ou d'une insuffisance, y supposer la lacune par principe ! Il y aurait le moyen de ne pas se résoudre aux experts et aux expertises comme notre époque basse tend à le faire par paresse et donc par « confiance ». On trouverait peut-être, assez soudain, que la plupart de nos certitudes ne sont fondées que sur le souci homogène de ne pas les réfuter.
Drieu La Rochelle compte parmi ceux qui, après toutes les unanimités concordantes sur la relation de la première guerre mondiale, a su explorer l'inconnu avec assez d'identité pour en relever des réalités qui ne furent jamais si nettement d
C'est bien ainsi que tout ce qui nous arrive n'est qu'un stimulus qui avait déjà en nous sa réponse : nous ne songeons pas en propre, ni à ce que nous faisons, ni à ce que nous pensons, parce qu'un foncier réflexe de routine et d'irréflexion conditionne nos conclusions, de sorte que nos « événements » n'ont pas d'influence, n'occasionnent aucune inflexion sur le cours de nos existences ; mais ces conclusions en réalité n'ont pas changé du fait de l'événement, elles n'ont été que révélées par lui, en germes plus ou moins inconscients l'événement les ont exprimées, et rien de plus ; voilà en quoi nous sommes et demeurons identiques et inauthentiques. Il faut profondément être, en identités autonomes et intègres, disposant d'un fond propre de sensations et d'analyses, pour compter dans l'espace et le temps, pour exister et pour voir, pour pouvoir s'empêcher de seulement réagir en se conformant perpétuellement à des préjugés antérieurs. C'est en cela que l'essence, largement, précède l'existence : tout ce qu'on croit déduire de la vie est ce qu'on est disposé au préalable à en penser, et c'est la limite même de nos perceptions. On ne voit que ce qui nous est plausible, que les informations que nous sommes aptes et prêts à considérer et à intellectuellement traiter, et le reste disparaît de notre phénoménologie ; toutes nos réflexions sur des faits sont contenues en théories en nous avant la survenue des faits, nul n'est vraiment modifié altéré, ou bouleversé par un fait imprévu en ce que la conclusion de ce fait était déjà inscrite en nous dans notre compréhension relative et obtuse de la réalité, en ce que nous avions pour principe ou pour dogme d'admettre tel ordre ou telle catégorie de fait de telle manière, avec telle interprétation ou tel crible c'est-à-dire avec telle « morale ». Pour le psychopathologue du Contemporain qui souhaiterait établir un classement systématique de ces événements et de ces réactions, il ne s'agirait que de savoir les anticiper avec un certain esprit d'épiderme pour en déceler le sentiment expédient, le sentiment standard, le sentiment-type ; chacun n'expérimente la vie qu'avec le prisme réducteur d'une mentalité formatée, au point que tout ce qu'on perçoit consiste uniquement, sauf chez de rares individus, en ce que notre plus ou moins grande fermeture d'esprit permet de distinguer.
Pour inclure un exemple éloquent à cette réflexion, je dirais que le Contemporain, en toutes ses expériences, est pareil à l'étranger des Inuits qui ne regarde la neige globalement que comme une masse friable, froide et blanche : pour son hôte, c'est toute une complexité, une perplexité, une somme de connotations capitales non simplement selon les sensations qu'elle suggère mais selon les conceptions, nombreuses et variées, antérieures même à la pensée, de la notion et du vocable, de ces inférences préétablies (pour un Inuit, la neige, selon son état, est un risque de péril mortel ou de faveur naturelle) ; autrement dit, pour éprouver la subtilité pleine et profonde de l'expérience « neige », il ne suffit pas de la voir ou toucher, il faut l'appréhender en-dehors des préconceptions les plus typiques et grossières, en-dehors des simplifications les plus stériles et catégoriques, et la sonder suivant des modes d'analyse d'une grande diversité de distance et de points de vue, mais aussi l'intérioriser selon le mode le plus subjectif c'est-à-dire en s'extrayant de toutes les objectivités référencées et en y recherchant ce qu'elle décèle en soi de plus vierge, de plus intrinsèque et inaltéré, de plus idiosyncratique et dissemblable. À ces conditions seulement la neige, ou toute autre expérience, cesse d'être la copie d'une morale acquise et recopiée, jusqu'à sa teneur sensorielle c'est-à-dire jusqu'à son état : il est indéniable que l'Inuit perçoit la neige autrement que nous, et, pour appréhender la neige, s'il applique lui aussi une grille de lecture, cette grille est presque infiniment plus élaborée que la nôtre, de sorte que quand il doit inférer ou déduire à partir de la neige, il agit et pense nécessairement avec une supérieure complexité, presque infiniment – où je démontre que non seulement ce qu'on conclut d'un fait mais sa réalité dépend intrinsèquement des préconceptions notamment morales dont on fonde son jugement, jugement qu'on ne construit généralement que par imitation issue d'un environnement proche et par suite d'une éducation de conformité. Comment donc serions-nous chamboulés, comment pourrions-nous être révolutionnés d'un événement dont nous sommes incapables de rien que sentir la nouveauté ? Même la maladie et la mort – surtout la maladie et la mort – se conçoivent avec une somme faramineuse de préjugés et d'inculcations entravant leur exacte considération en tant que faits, de sorte que, non, nous n'en vivons pas l'expression inaltérée : nous ne faisons peu ou prou que reconduire les sentiments et pensées sur la maladie et sur la mort tels que notre société nous les dicte ; nous sommes trop sociaux avant que d'être, d'être vraiment par soi-même, et ainsi toutes nos expériences en sortent lénifiées et égalisées, nous ne vivons pas ce que nous prétendons vivre, nous conformons nos sens à une interprétation unanime des phénomènes qu'on rencontre et dont nous ne percevons que des parcelles validées. Toute notre réalité est une fragmentation et une réduction.
Ce qui suit en est la démonstration dure : la plupart des lettres authentiques de poilus ne font que répéter les mêmes visions détournées de préconceptions semblables ; je veux dire, et c'est terrible, que n'importe qui d'un peu imaginatif et rigoureux parlerait pareillement de ce conflit sans l'avoir expérimenté, rien qu'après avoir suivi une synthèse historique ; on croirait lire une imagerie uniforme où ne s'investit pas d'individu, imagerie dont la raison ne tient pas du tout aux faits identiques dont le rapport peut fort bien ne pas différer beaucoup, mais à une attention portée aux mêmes impressions manifestement recopiées, aux mêmes espérances et rancunes nettement imbibés, aux mêmes intentions de rumeurs et de plaintes ayant préexisté à la guerre ou s'étant transmises au sein des soldats à l'arrière ou sur le front, aux mêmes éléments dont l'analyse révèle qu'ils ne sont pas plus évidents qu'universels mais bel et bien élus selon leur complaisante et rassurant unanimité, toutes représentations, en somme, à l'exclusion d'une version personnelle et unique du fait vécu, à l'exclusion d'un regard profond porté sur son environnement en relation avec soi, à l'exclusion d'un sentiment et d'une réflexion plus qu'automatiques et superficiels qui diffèreraient des autres et tâcheraient à quêter, notamment, quelque essence de la guerre en rapport avec une singularité. Je ne reproche évidemment pas aux combattants d'avoir relaté les mêmes réalités puisqu'ils en furent témoins, mais je constate avec objectivité et comme philologue qu'ils n'ont accordé d'importance qu'à des faits auxquels ils étaient intellectuellement préparés, qu'ils ont automatiquement exclu de leurs observations tout ce qui échappait au bain connu des consensus, qu'ils ont ainsi rapporté ce qu'il convenait de remarquer plutôt que ce qu'en tant qu'individu ils auraient pu vouloir remarquer, de sorte qu'ils n'ont même vu au coeur de la tourmente que ce qu'ils étaient disposés à voir, que ce que leur esprit se croyait autorisé à penser, et bien souvent ce n'est qu'après avoir lu un témoignage différent du leur qu'ils se sont permis de relater eux aussi ce fait, sans pourtant la conscience de cette influence, si bien que ce n'est que par somme d'inspirations, pour ainsi dire, que le fait s'est mis à exister, c'est-à-dire à exister comme considérable dans le champ des perceptions : c'est cette sélection qui constitue la preuve même que ces soldats n'ont vécu la bataille qu'avec un esprit commun, autrement dit qu'avec le tamis de la grégarité et du consensus au point qu'il serait relativement facile de produire des faux où les mêmes tropismes se rencontreraient et où, hormis certains noms et dates pour lesquels il faudrait minutieusement se renseigner, on serait sans grande peine à traduire la pensée médiocrement majoritaire d'un poilu selon son niveau social (j'ai d'ailleurs eu l'occasion, à ce que je crois, de confondre une de ces mystifications, mais le faux témoignage dont il s'agit s'inscrit dans une telle société d'adulation qu'il ne m'a pas été loisible de convaincre ses lecteurs de la falsification et que j'ai préféré abandonner dès l'abord toute démonstration qui, pour exacte et concordante d'un point de vue philologique, aurait été fâcheuse à de nombreux idolâtres).
Ainsi, un être imaginatif n'a pas besoin d'expérimenter les tranchées pour en retranscrire l'horreur de façon persuasive, et je prétends qu'il n'en avait guère besoin non plus à l'époque, puisque c'est toujours la même description dans les témoignages, grossièrement rendue, très uniforme, et donc à la fois grossièrement et uniformément vécue, sans recherche de particularité et sans nette altération imputable au point de vue – c'est sans parler encore de l'Histoire comme propagande et opportunité qui défend « moralement » qu'on attaque des discours officiels. Si l'on y regarde bien, c'est à croire qu'en la rédaction de ces lettres a dominé inconsciemment un principe de conformité, une volonté de typicité, un désir d'accumulation et d'insistance pour l'édification, comme cela se rencontre dans les sondages lorsque les Français expriment tous la même opinion de façon presque délibérée pour indiquer massivement une défiance, ou comme dans la pétition où l'on feint de s'accorder parfaitement avec le manifeste en dépit des nuances pour faire valoir un gros contentieux. On force la réalité à l'identique parce qu'on ne la regarde qu'en usant des outils du général, et l'on en ignore et abstrait la réalité intérieure, on annihile l'individu en s'en épargnant la recherche, parce que l'identité est plus difficile à saisir que la conformité, et pourtant c'est bien cette réalité-ci qui finirait par constituer le témoignage général si elle était suffisamment communiquée jusqu'à imprégner les moeurs. Comme chacun adapte son discours à ce que l'interlocuteur ou le lecteur est disposé à entendre, on vérifie toujours au préalable que son propos a déjà été accepté ailleurs, nos perceptions même relèvent aussitôt si cette réalité qu'on est tenté d'atteindre est convenable avant de la considérer et de l'assimiler, et l'on se fie, avant de relater un fait, avant même que sa sensation s'intègre à soi, à ce qu'un grand nombre de gens ont pu en communiquer avec acceptabilité, tel grand nombre qui toujours ne se fonda que sur les témoignages d'un petit nombre, les rares à avoir véritablement vécu et rapporté l'événement les premiers, en quoi chez l'homme la perception d'un phénomène enfle ni plus ni moins comme une rumeur et presque indépendamment de la réalité, ou disons de la profondeur, de ce phénomène. On adhère d'abord à une version de telle expérience, après quoi seulement on vit l'expérience en adéquation avec cette version : mais rares sont les personnes capables de se détacher virginalement de toute antériorité convenable d'un phénomène auquel ils sont mêlés pour le vivre pleinement et tel qu'il est.
Et puis, quand un jour un individu véritable prend la parole pour chercher une vérité au mépris de ce qui est unanime et admis, et par exemple sur la guerre, cela donne quelque Marc Bloch et L'étrange défaite où chacun s'étonne d'avoir vécu les mêmes faits sans avoir songé à les raconter, parce que l'unique et le profond étaient inaccessibles à des esprits désireux surtout de ne pas se distinguer, sans doute pour être aisément crus, cependant que surgit une impression d'évidence. Tout à coup, le fait diffère et l'histoire change, tout se complète d'une vision qui donne corps à une réalité ignorée c'est-à-dire méprisée, on découvre qu'il existe quelque vérité universelle que tout l'univers a tu faute d'oser y toucher, et l'histoire se trouve augmentée qui n'était composée que d'une collection de rapports convergents, dont la convergence était une condition de recevabilité, la voici soudain subitement altérée d'un seul témoignage qui explique ce qu'on n'avait pas réussi à démêler, il n'a fallu qu'une sensibilité intacte et approfondie pour exhumer un fait qui s'avère plus vraisemblable et systématique dans l'ensemble d'une période que ce que peut-être dix mille hommes ou même davantage ont communiqué en ne recourant justement qu'à un commun esprit-de-vraisemblance c'est-à-dire en ne faisant que voir et dire ce qu'ils se supposaient tenus ou condamnés de voir et de dire. Cette manie presque instinctive, sociale, d'abonder les versions répandues pour se couler une place au sein d'un environnement médiocre est ce qui nuit le plus au monde, à l'innovation et à la grandeur : personne ne tente d'audace, chacun envisage le moindre écart à la doxa avec scepticisme et crainte, on est envahi d'un immense doute de soi à l'impression de la plus petite différence qu'on se retient alors d'exprimer au point de la bannir de ses sens, et ainsi tout demeure ou est considérablement ralenti, l'humanité se fige qui tient surtout à ressembler, au point que même la réalité ne peut plus être examinée que suivant un angle très répandu, cette réalité qui se confond avec le banal et s'y enracine, qui ne tire sa substance que de l'idée vague de sa vraisemblance. En cela, une véritable éducation devrait être une école de la sensibilisation au péril de l'uniforme qui devient aveuglement et même mensonge bienséant, et pas du tout consister en ces établissements on l'on n'enseigne au contraire qu'à respecter des procédures et des paroles sur des fondements aussi fragiles que l'autorité des professeurs et des diplômes. On n'y devrait pas se contenter de lire des textes et de consulter des documents, mais lire en soi et y consulter plutôt la superbe plausibilité de tout ce qui n'a pas été documenté jusqu'alors. Quelle grandiose avancée ce serait alors dans tous les domaines de la connaissance : ne pas se limiter à des codes ou à des dogmes extérieurs et préétablis ni pour déduire ni pour percevoir ! Admettre en n'importe quelle science l'éventualité par défaut d'une incomplétude ou d'une insuffisance, y supposer la lacune par principe ! Il y aurait le moyen de ne pas se résoudre aux experts et aux expertises comme notre époque basse tend à le faire par paresse et donc par « confiance ». On trouverait peut-être, assez soudain, que la plupart de nos certitudes ne sont fondées que sur le souci homogène de ne pas les réfuter.
Drieu La Rochelle compte parmi ceux qui, après toutes les unanimités concordantes sur la relation de la première guerre mondiale, a su explorer l'inconnu avec assez d'identité pour en relever des réalités qui ne furent jamais si nettement d
D'un livre il faudrait pouvoir parler comme si l'on n'en connaissait pas l'auteur, tant le destin de Drieu, fascisme et collaboration, pèse lourd sur la lecture de son oeuvre. Comme il n'a pas le style flamboyant de Céline, il n'est pas intouchable et peine un peu plus à convaincre. La Comédie de Charleroi est pourtant un beau livre ; mais surtout, elle constitue une belle ouverture à la compréhension de ce XXe siècle qui s'éloigne de nous.
En six nouvelles, Drieu nous montre comment la guerre peut s'emparer d'un tout jeune adulte, l'imprégner jusqu'à la moelle et marquer sa pensée d'un sceau indélébile.
Celle de 14 fut gagnée par la France et ses alliés, dit-on. Pourtant, le sentiment qui domine, d'un bout à l'autre du livre est la défaite, celle d'une jeunesse broyée, décimée sans états d'âme par des chefs incompétents.
La guerre du narrateur oscille constamment entre l'héroïsme gratuit pour soi et pour la patrie et l'esquive roublarde à la limite de la désertion.
Si quelques individus tirent leur épingle du jeu, l'immense majorité des cadres ne sont que des exécutants bornés. Les officiers, de simples contremaîtres. En aucun cas des chefs au plein sens du terme.
Pourtant, le narrateur sent naître en lui une capacité de dépassement, un rapport nouveau de l'individu exceptionnel à la masse. L'idée d'un chef singulier, hors du système, charismatique, incarnation d'une valeur supérieure revient dans tous les temps forts du livre, sporadiquement mais avec insistance.
Autre thème : le dégoût pour la démocratie et les politiques, tenus pour responsables de la gabegie mortifère qui règne dans l'armée. Démocratie et avilissement vont de pair, systématiquement.
Autre thème encore : les vrais acteurs de cette guerre et les seuls hommes au vrai sens du terme sont les combattants. Amis ou ennemis, ils valent plus que ceux qui les ont conduits au massacre. Or la guerre industrielle escamote abolit l'humanité et interdit tout affrontement entre des hommes et partant toute rencontre.
La guerre n'efface pas les barrières de classes. Pourtant, au-delà des clivages sociaux d'autres liens se dessinent. le narrateur, jeune bourgeois, ne se voit au départ aucun point commun avec les paysans et les ouvriers qu'il côtoie. Il finira néanmoins par les rejoindre, mais sans jamais se fondre à eux. Toujours au-dessus, avec un cran d'avance, Il apprend à manipuler les foules jusqu'à mener sa propre guerre, à être le plus malin à défaut d'être le plus fort.
Enfin, on est étonné par la présence insistante et ambiguë des juifs dans ce roman. Si Drieu les distingue, c'est pour souligner leur zèle et leur courage dans l'effort (vain ?) visant à se montrer plus français que les Français eux-mêmes.
Bref, n'interprétons pas ce livre à la lumière de positions que l'auteur ne prendra que plus tard, mais reconnaissons que dans cet après-guerre où tout est remis en question sans qu'apparemment rien ne change, tous les destins, toutes les dérives sont possibles, et la catastrophe inévitable.
Or, ne vivons-nous pas aujourd'hui une période analogue où les fronts se renversent, où mots les plus simples, comme bonheur, avenir, liberté ou progrès se brouillent ou, pire, inversent leur sens ?
En six nouvelles, Drieu nous montre comment la guerre peut s'emparer d'un tout jeune adulte, l'imprégner jusqu'à la moelle et marquer sa pensée d'un sceau indélébile.
Celle de 14 fut gagnée par la France et ses alliés, dit-on. Pourtant, le sentiment qui domine, d'un bout à l'autre du livre est la défaite, celle d'une jeunesse broyée, décimée sans états d'âme par des chefs incompétents.
La guerre du narrateur oscille constamment entre l'héroïsme gratuit pour soi et pour la patrie et l'esquive roublarde à la limite de la désertion.
Si quelques individus tirent leur épingle du jeu, l'immense majorité des cadres ne sont que des exécutants bornés. Les officiers, de simples contremaîtres. En aucun cas des chefs au plein sens du terme.
Pourtant, le narrateur sent naître en lui une capacité de dépassement, un rapport nouveau de l'individu exceptionnel à la masse. L'idée d'un chef singulier, hors du système, charismatique, incarnation d'une valeur supérieure revient dans tous les temps forts du livre, sporadiquement mais avec insistance.
Autre thème : le dégoût pour la démocratie et les politiques, tenus pour responsables de la gabegie mortifère qui règne dans l'armée. Démocratie et avilissement vont de pair, systématiquement.
Autre thème encore : les vrais acteurs de cette guerre et les seuls hommes au vrai sens du terme sont les combattants. Amis ou ennemis, ils valent plus que ceux qui les ont conduits au massacre. Or la guerre industrielle escamote abolit l'humanité et interdit tout affrontement entre des hommes et partant toute rencontre.
La guerre n'efface pas les barrières de classes. Pourtant, au-delà des clivages sociaux d'autres liens se dessinent. le narrateur, jeune bourgeois, ne se voit au départ aucun point commun avec les paysans et les ouvriers qu'il côtoie. Il finira néanmoins par les rejoindre, mais sans jamais se fondre à eux. Toujours au-dessus, avec un cran d'avance, Il apprend à manipuler les foules jusqu'à mener sa propre guerre, à être le plus malin à défaut d'être le plus fort.
Enfin, on est étonné par la présence insistante et ambiguë des juifs dans ce roman. Si Drieu les distingue, c'est pour souligner leur zèle et leur courage dans l'effort (vain ?) visant à se montrer plus français que les Français eux-mêmes.
Bref, n'interprétons pas ce livre à la lumière de positions que l'auteur ne prendra que plus tard, mais reconnaissons que dans cet après-guerre où tout est remis en question sans qu'apparemment rien ne change, tous les destins, toutes les dérives sont possibles, et la catastrophe inévitable.
Or, ne vivons-nous pas aujourd'hui une période analogue où les fronts se renversent, où mots les plus simples, comme bonheur, avenir, liberté ou progrès se brouillent ou, pire, inversent leur sens ?
Recueil de nouvelles du sulfureux ou peu fréquentable Drieu La Rochelle traitant de la Première Guerre Mondiale, avec un narrateur omniprésent qu'on identifie forcément à l'auteur.
Univers étrange. En effet, il est marquant de traiter de cette guerre sans vraiment relater un combat, une bataille, si ce n'est par une ellipse. Par contre, on tisse peu à peu un portrait du narrateur, avec ses angoisses dont la possibilité d'une mort imminente soulève le couvercle des aspirations juvéniles escamotées : rêves de gloire, d'honneur et d'amour. Si dans un premier temps, on est à la rencontre d'un jeune homme juste sorti de l'adolescence et de ses nécessités, un esprit empreint de désillusion, d'empathie envers l'autre semble installer au final un humaniste des temps modernes. Drieu revendique son origine et son conformisme petit-bourgeois, comme une identité ou une culture, pour mieux les mettre en défaut et en montrer les mesquineries et bassesses, tout particulièrement dans les nouvelles de la comédie de Charleroi et le chien de l'Ecriture. La fine frontière étanche entre lui et les autres est un thème récurrent de ces nouvelles : Drieu se sent toujours plus ou moins décalé ou inadapté aux situations qu'il narre. Ses relations nécessaires avec le gente féminine sont purement hygiéniques et leurs représentantes semblent le plus souvent peu dignes d'intérêt, pour ne pas dire stupides. Son sens de l'ordre et de la patrie sont par contre un élément majeur de ces nouvelles. Sur ce dernier point, Drieu la Rochelle ne fait pas l'apanage des idées dont il se fera le héraut par la suite. Non il se questionne surtout sur le rôle et la propension à commander et surtout la sienne qu'il juge rapidement devoir se limiter au niveau du simple bidasse.
Mais surtout il y a le style de Drieu qui a encore une fois fait mouche, bien des années après Gilles dont je ne garde plus qu'un agréable souvenir. Comme je n'ai plus l'ouvrage sous la main, vos invocations n'y feront rien : vous n'obtiendrez pas le moindre petit extrait
Ce recueil comprend cinq nouvelles :
La comédie de Charleroi
La plus longue de ses nouvelles. le narrateur est le secrétaire particulier de Madame Prantzen, riche bourgeoise qui a perdu son fils unique dans des combats à Charleroi. le narrateur était plus une connaissance de régiment qu'un camarade et a vécu les événements qui ont conduit à la perte du fils. Dans cette nouvelle, deux récit se chevauchent : le pèlerinage bigoto-patriotique de cette bourgeoise qui se rend en Belgique habillée en infirmière et engoncée dans ses médailles, qui ne sait pas aimer et ne se vit et se voit que par son rang, sa fortune, ses relations brillantes surtout si elles sont ministérielles et qui jouit presque de pouvoir jouer les pietas éplorées grâce à son fils qui a eu la courtoisie de bien vouloir devenir un héros de guerre. Les carolorégiens bien qu'en pointillés ne sont pas oubliés. le second récit nous transmet les souvenirs fulgurants qui transpercent le narrateur à mesure qu'il se déplace sur les lieux de la bataille. A mon avis, la nouvelle la plus réussie !
Le chien de l'Ecriture
Un fils de bourgeois, initialement dans le corps prestigieux des dragons, se retrouve affecté dans l'infanterie où il crève de trouille d'aller à l'assaut et demande inlassablement son affectation dans l'aviation. Très belle chute qui donne tout son sens à la nouvelle.
Le voyage des Dardannelles
Le narrateur demande à être affecté sur le front turc. Cela sera essentiellement l'occasion de nous proposer une description de certains de ses camarades peu recommandables, de donner un tableau en gris sale de Marseille ainsi que de la vie de camp avant l'embarquement.
Le déserteur
Après-guerre, le narrateur se trouve en Amérique latine et échange des propos avec un déserteur de la première heure. Petite étude philosophique sur le droit de déserter.
La fin d'une guerre
En cette fin de conflit, le narrateur se retrouve interprète auprès des armées américaines. C'est l'heure des bilans et surtout de partir et de passer à autre chose …
Univers étrange. En effet, il est marquant de traiter de cette guerre sans vraiment relater un combat, une bataille, si ce n'est par une ellipse. Par contre, on tisse peu à peu un portrait du narrateur, avec ses angoisses dont la possibilité d'une mort imminente soulève le couvercle des aspirations juvéniles escamotées : rêves de gloire, d'honneur et d'amour. Si dans un premier temps, on est à la rencontre d'un jeune homme juste sorti de l'adolescence et de ses nécessités, un esprit empreint de désillusion, d'empathie envers l'autre semble installer au final un humaniste des temps modernes. Drieu revendique son origine et son conformisme petit-bourgeois, comme une identité ou une culture, pour mieux les mettre en défaut et en montrer les mesquineries et bassesses, tout particulièrement dans les nouvelles de la comédie de Charleroi et le chien de l'Ecriture. La fine frontière étanche entre lui et les autres est un thème récurrent de ces nouvelles : Drieu se sent toujours plus ou moins décalé ou inadapté aux situations qu'il narre. Ses relations nécessaires avec le gente féminine sont purement hygiéniques et leurs représentantes semblent le plus souvent peu dignes d'intérêt, pour ne pas dire stupides. Son sens de l'ordre et de la patrie sont par contre un élément majeur de ces nouvelles. Sur ce dernier point, Drieu la Rochelle ne fait pas l'apanage des idées dont il se fera le héraut par la suite. Non il se questionne surtout sur le rôle et la propension à commander et surtout la sienne qu'il juge rapidement devoir se limiter au niveau du simple bidasse.
Mais surtout il y a le style de Drieu qui a encore une fois fait mouche, bien des années après Gilles dont je ne garde plus qu'un agréable souvenir. Comme je n'ai plus l'ouvrage sous la main, vos invocations n'y feront rien : vous n'obtiendrez pas le moindre petit extrait
Ce recueil comprend cinq nouvelles :
La comédie de Charleroi
La plus longue de ses nouvelles. le narrateur est le secrétaire particulier de Madame Prantzen, riche bourgeoise qui a perdu son fils unique dans des combats à Charleroi. le narrateur était plus une connaissance de régiment qu'un camarade et a vécu les événements qui ont conduit à la perte du fils. Dans cette nouvelle, deux récit se chevauchent : le pèlerinage bigoto-patriotique de cette bourgeoise qui se rend en Belgique habillée en infirmière et engoncée dans ses médailles, qui ne sait pas aimer et ne se vit et se voit que par son rang, sa fortune, ses relations brillantes surtout si elles sont ministérielles et qui jouit presque de pouvoir jouer les pietas éplorées grâce à son fils qui a eu la courtoisie de bien vouloir devenir un héros de guerre. Les carolorégiens bien qu'en pointillés ne sont pas oubliés. le second récit nous transmet les souvenirs fulgurants qui transpercent le narrateur à mesure qu'il se déplace sur les lieux de la bataille. A mon avis, la nouvelle la plus réussie !
Le chien de l'Ecriture
Un fils de bourgeois, initialement dans le corps prestigieux des dragons, se retrouve affecté dans l'infanterie où il crève de trouille d'aller à l'assaut et demande inlassablement son affectation dans l'aviation. Très belle chute qui donne tout son sens à la nouvelle.
Le voyage des Dardannelles
Le narrateur demande à être affecté sur le front turc. Cela sera essentiellement l'occasion de nous proposer une description de certains de ses camarades peu recommandables, de donner un tableau en gris sale de Marseille ainsi que de la vie de camp avant l'embarquement.
Le déserteur
Après-guerre, le narrateur se trouve en Amérique latine et échange des propos avec un déserteur de la première heure. Petite étude philosophique sur le droit de déserter.
La fin d'une guerre
En cette fin de conflit, le narrateur se retrouve interprète auprès des armées américaines. C'est l'heure des bilans et surtout de partir et de passer à autre chose …
Drieu La Rochelle raconte son expérience de la grande guerre qu'il a vécu en discontinu. A tout le moins, il se donne le beau rôle et la fiabilité des anecdotes est sujette à caution. C'est pourtant une oeuvre intéressante à plus d'un titre.
S'il ne nous apprend pas grand chose sur l'horreur de cette guerre, il est intéressant de constater qu'il la considère comme la guerre moderne, alors que 25 ans plus tard, cette manière de combattre, arc-bouté dans les tranchées sous un déluge de feu, sera totalement dépassée (et les Français avec, qui croyaient à leur ligne Maginot). Mais elle est moderne en effet, par rapport aux guerres passées, parce qu'il n'y a plus de corps à corps, que l'héroïsme a disparu, et qu'on se fait massacrer par milliers en une après midi sans même voir un ennemi. Drieu La Rochelle le regrette et son romantisme des guerres anciennes est mis à rude épreuve.
Il en dit beaucoup plus sur sa vision de la société. Drieu la Rochelle a une conscience aiguë de son origine bourgeoise et il laisse éclater un certain mépris pour les classes inférieures. C'est un élitiste, sans aucun doute. Il a d'ailleurs conscience également qu'il existe une classe encore au dessus de la sienne, celle des aristocrates et des grands bourgeois, et on sent un grand regret de ne pas y appartenir. Bref, c'est un homme de droite et on ne s'étonne pas qu'il ait finalement mal fini pendant la seconde guerre mondiale.
Il montre aussi un antisémitisme bon teint, presque naturel pourrait-on dire, qu'on aurait du mal à lui reprocher dans la mesure où les hommes de cette époque, après des siècles d'un catholicisme haineux envers les déicides (les juifs), l'étaient presque tous.
On s'ennuie quand même assez souvent, les récits sont peu soutenus, mais valent surtout par les discussions et réflexions qu'il engage sur la société, le monde, les système idéologiques, etc.
Vaut le coup d'être lu pour mieux connaître le personnage.
S'il ne nous apprend pas grand chose sur l'horreur de cette guerre, il est intéressant de constater qu'il la considère comme la guerre moderne, alors que 25 ans plus tard, cette manière de combattre, arc-bouté dans les tranchées sous un déluge de feu, sera totalement dépassée (et les Français avec, qui croyaient à leur ligne Maginot). Mais elle est moderne en effet, par rapport aux guerres passées, parce qu'il n'y a plus de corps à corps, que l'héroïsme a disparu, et qu'on se fait massacrer par milliers en une après midi sans même voir un ennemi. Drieu La Rochelle le regrette et son romantisme des guerres anciennes est mis à rude épreuve.
Il en dit beaucoup plus sur sa vision de la société. Drieu la Rochelle a une conscience aiguë de son origine bourgeoise et il laisse éclater un certain mépris pour les classes inférieures. C'est un élitiste, sans aucun doute. Il a d'ailleurs conscience également qu'il existe une classe encore au dessus de la sienne, celle des aristocrates et des grands bourgeois, et on sent un grand regret de ne pas y appartenir. Bref, c'est un homme de droite et on ne s'étonne pas qu'il ait finalement mal fini pendant la seconde guerre mondiale.
Il montre aussi un antisémitisme bon teint, presque naturel pourrait-on dire, qu'on aurait du mal à lui reprocher dans la mesure où les hommes de cette époque, après des siècles d'un catholicisme haineux envers les déicides (les juifs), l'étaient presque tous.
On s'ennuie quand même assez souvent, les récits sont peu soutenus, mais valent surtout par les discussions et réflexions qu'il engage sur la société, le monde, les système idéologiques, etc.
Vaut le coup d'être lu pour mieux connaître le personnage.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Drieu La Rochelle (42)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3206 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3206 lecteurs ont répondu