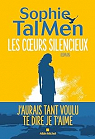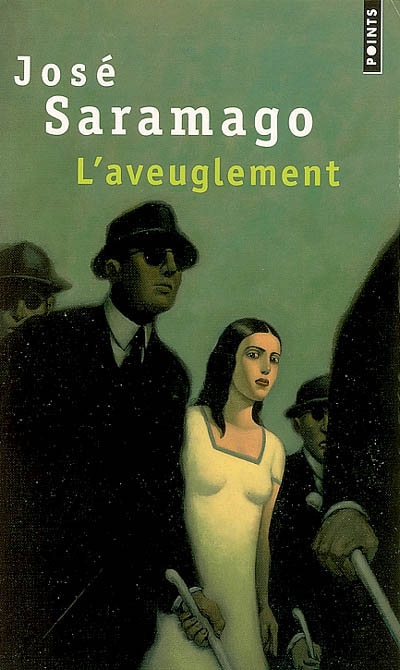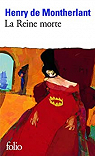David LivingstoneHenry Morton StanleyCharles Livingstone
EAN : 978B0000DLN8H
P., le Cercle du Bibliophile, (Vers 1975) (30/11/-1)
/5
2 notes
P., le Cercle du Bibliophile, (Vers 1975) (30/11/-1)
Résumé :
Édition critique, limitée à 4000 exemplaires numérotés, rassemblant deux classiques britanniques du récit de voyage et d'exploration en Afrique :
- "Narrative of an Expedition to the Zambesi and its Tributaries" (1865) par David et Charles Livingstone.
- "How I found Livingstone" (1872) par Henry Morton Stanley.
Traductions d'époque en français par Henriette Loreau, avec de nombreuses reproductions des gravures des éditions originales anglaises.... >Voir plus
- "Narrative of an Expedition to the Zambesi and its Tributaries" (1865) par David et Charles Livingstone.
- "How I found Livingstone" (1872) par Henry Morton Stanley.
Traductions d'époque en français par Henriette Loreau, avec de nombreuses reproductions des gravures des éditions originales anglaises.... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Du Zambèze au TanganyikaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
La littérature coloniale est née en Angleterre, inspirée des premiers colons britanniques qui explorèrent des territoires encore inconnus. Alors qu'en France, une certaine hiérarchie administrative oeuvra pour que les premiers colons soient essentiellement des militaires et des fonctionnaires de l'État, tenus à une certaine confidentialité, le Royaume-Uni, fidèle à sa pensée libérale, délégua d'abord des marchands, car l'Angleterre étant une île, l'import-export par voie maritime y était particulièrement développé depuis déjà plusieurs siècles, ce qui a d'ailleurs généré la piraterie, ce qui est une forme illégale de commerce, puis l'activité des corsaires, ce qui est l'appellation légalisée de cette même forme illégale de commerce.
Le premier homme à écrire des ouvrages coloniaux de fiction, quoique inspirés de faits réels, était un marchand du nom de Frederick Marryat, auquel on doit pas moins de 26 romans d'aventures exotiques, publiés entre 1829 et 1848, qui furent traduits en français dès 1833 et connurent un immense succès jusqu'au Second Empire.
Cependant, son cas reste isolé. Bien vite, ce furent les explorateurs, qui publièrent d'autant plus volontiers les récits de leurs voyages que le produit des ventes de leurs livres leur permettait de financer une nouvelle expédition. L'exploration était en effet une tâche ingrate, car au contraire du marchand, non seulement l'explorateur ne faisait pas de commerce, mais il devait aussi se charger de cadeaux, histoire d'amadouer les populations locales et d'obtenir ainsi des informations sur telle ou telle région qui devait être explorée.
Alors que la France s'installait en Afrique de l'Ouest, région touffue par endroits, mais offrant aussi des grandes plaines désertiques ou pré-désertiques qui, en dépit des températures élevées, facilitaient les déplacements des caravanes, les Britanniques héritèrent de l'Afrique de l'Est, région bien plus belle mais terriblement sauvage et extrêmement ardue, partagée entre des jungles étouffantes, et d'interminables savanes remplies de fauves dangereux. Ce sont d'ailleurs ces savanes qui donneront aux colons britanniques l'idée du "safari", que l'on ne pratiquera pas dans les colonies françaises avant le début du XXème siècle.
L'exploration de cette partie de l'Afrique prit à l'Angleterre plusieurs décennies, et engendra quantité de martyrs, de disparus dont on ne retrouva jamais aucune trace – ce qui généra le cliché de l'anthropophage africain faisant bouillir les explorateurs dans une marmite, vision totalement fantaisiste, car il n'y a jamais eu une seule tribu cannibale en Afrique – et d'échecs innombrables et cuisants, qui amenèrent la plupart des colons à renoncer à s'avancer plus avant vers l'intérieur des terres, et à se contenter de développer un impressionnant trafic d'esclaves.
C'est à partir de 1840 qu'un explorateur d'un genre absolument nouveau, va révolutionner sa profession : David Livingstone devint à lui seul une légende encore révérée de l'exploration africaine. En 30 ans, il arpenta toute l'Afrique australe, d'un océan à l'autre, du Kenya à l'Afrique du Sud, apprenant les langues locales avec un indéniable don. Médecin de formation, ordonné pasteur par conviction religieuse, David Livingstone était un esprit droit et rigoureux, et il doit beaucoup à ses qualités morales et intellectuelles l'immense popularité qui est encore la sienne, même en Afrique. Ses connaissances médicales lui permirent d'apporter des médicaments inconnus des autochtones, et qui sauvèrent bien des vies. Ses convictions religieuses le rendirent plus respectable, plus noble, aux yeux des indigènes que les esclavagistes ou les marchands, qui étaient seulement guidés par leurs intérêts. Quand il rencontrait une tribu, David Livingstone n'hésitait pas à s'y installer pour une ou deux semaines, prenant le temps de discuter avec chacun et de perfectionner sa connaissance des langues, choisissant minutieusement les cadeaux à offrir à chaque habitant selon ses goûts et ses besoins, apportant au sein de ces tribus une idée jusque là inconnue d'elles : le souci d'équité.
Il fut également, tant en Afrique que lorsqu'il rentrait en Angleterre pour y faire des conférences, un vigoureux militant contre l'esclavagisme. Toute sa vie, David Livingstone défendit l'idée d'un colonialisme bienveillant, respectueux et humaniste.
Bien qu'il puisse aujourd'hui nous apparaître condescendant, le système des cadeaux était essentiel, non seulement pour fraterniser avec les populations locales, mais aussi pour obtenir, dans des pays qui ne fonctionnaient pas selon un système monétaire, des vivres, des animaux de remplacements, des ustensiles, et des outils. Par principe, David Livingstone refusait qu'il y ait des armes dans sa caravane. Il fut d'ailleurs plusieurs fois attaqué par des bandes de pillards, envers lesquelles il ne tenta pas la moindre résistance. Pacifiste et humaniste, il jugeait que c'était à lui à se faire à l'Afrique et non le contraire. Il se contentait d'évangéliser les Africains seulement lorqu'ils en faisaient la demande.
En 1865, il publia « Exploration du Zambèze et de ses Affluents », qui fut son ultime récit de voyage. Puis il disparut, cessa brusquement toutes ses correspondances, jusqu'à ce que plus personne en Afrique ne sache ce qu'il était devenu.
L'homme était très populaire et très estimé en Angleterre. Il était inimaginable de l'abandonner à son sort. Mais qui serait assez fou pour lancer une expédition de recherche ? Un candidat se présenta : Henry Morton Stanley, jeune journaliste sans expérience, mais bien décidé à devenir célèbre par tous les moyens.
On ne pouvait trouver une personnalité plus éloignée de David Livingstone que celle de ce Henry Morton Stanley, né dans une famille alcoolique et misérable, dont il fut retiré pour être enfermé dans un orphelinat, où il fut battu et violé. Devenu ouvrier à l'âge de 15 ans, il se hissa jusqu'au journalisme par un travail acharné, une totale absence de scrupules, et l'opiniâtreté noire de celui qui ne vit que pour prendre une revanche sur le destin. L'Afrique ne l'intéressait pas, il ne croyait ni en Dieu, ni aux valeurs morales, et il prouva par la suite qu'il était obsédé par la domination brutale des indigènes, le pillage immodéré de l'Afrique et le trafic d'esclaves, auquel il prit part financièrement. Il n'avait en réalité qu'une qualité : la rage d'arriver. Mais ce fut probablement cette rage qui lui permit de réussir là où bien d'autres auraient échoué.
Car après des mois d'avancée difficile dans la jungle, Stanley put retrouver le docteur Livingstone en 1871, dans un petit village de l'ouest de la Zambie où, selon son habitude, il s'était arrêté pour vivre avec les indigènes. Il n'était rien arrivé de grave à David Livingstone, mais simplement, sa santé déclinant avec l'âge, il s'était décidé à partir dans une dernière quête effrénée vers la source du Zambèze, qu'il voulait absolument découvrir, et baptiser du nom de la reine Victoria, comme il l'avait fait quelques années plus tôt pour les chutes Victoria, où les flots du Zambèze s'écoulent à travers une gigantesque faille dans le roc de plusieurs kilomètres de long.
David Livingstone n'avait pas cessé, depuis des années, de remonter le cours du fleuve, à pied et avec sa caravane, espérant chaque jour atteindre la source du Zambèze un jour prochain. Or, cette quête qui l'absorbait, au point de délaisser ses notes et son courrier, se révélait interminable, car le fleuve Zambèze coule sur pas moins de 2750 kilomètres. Aux dires de Stanley, David Livingstone était conscient de s'être lancé dans un voyage dont il ne reviendrait pas vivant, mais il espérait arriver tout de même à la source. Il en était hélas encore loin quand il mourut de dysenterie et de malaria deux ans plus tard.
En 1872, une fois revenu en Angleterre, Henry Morton Stanley publia à son tour le récit de son expédition, « Comment J'ai Retrouvé Livingstone », qui fut un immense best-seller, dont les ventes augmentèrent encore lorsque la mort de Livingstone fut connue. La carrière journalistique et littéraire de Stanley était ainsi définitivement lancée.
Ces deux ouvrages furent traduits en français chez de petits éditeurs aux tirages modestes. Ils furent rapidement épuisés, et sans doute seraient-ils totalement oubliés de ce côté-ci du Channel, si un explorateur français, Alain Gheerbrant, n'avait eu l'incroyable idée, en 1959, de faire réimprimer ensemble le dernier livre de David Livingstone et le premier livre d'Henry Morton Stanley dans une édition critique présentée par lui-même, et publiée par le Club des Libraires de France à seulement 4000 exemplaires, sous une luxueuse reliure en toile, enluminée des gravures et des cartes des deux éditions originales.
Ce volume, encore trouvable à un prix abordable, constitue à mon sens un chef d'oeuvre indispensable de la littérature coloniale, car non seulement il exhume des traductions fidèles de deux ouvrages fondateurs du genre, mais Alain Gheerbrant s'est servi de ces deux récits, qu'il accompagne d'un avant propos, d'un texte de transition entre les deux livres, et d'une postface, pour raconter une autre histoire : la rencontre émouvante, figée par la postérité, de deux hommes, fort différents, dans un coin perdu d'Afrique, où l'un étant à la recherche de l'autre, et l'autre étant touché du chemin parcouru par l'un, il advint qu'une sympathie instinctive naquit entre eux, alors que s'ils s'étaient mieux connus dans un autre contexte, ils se seraient volontiers haïs.
En effet, ces deux livres racontent à peu près la même histoire : une expédition qui remonte le Zambèze, non sans difficultés extrêmes et contretemps malencontreux. Mais ces deux hommes qui parcourent, à quelques années d'écart, le même chemin, ne voient pas la même chose, ne s'expriment pas avec la même sensibilité, ce qui fait qu'à aucun moment, on ne ressent un sentiment de répétition. David Livingstone est avant tout investi dans une démarche documentaire : sa narration est morne, sans prétention littéraire, avec même un peu de la sécheresse du médecin qui établit un diagnostic, et son frère Charles Livingstone, co-auteur, se borne à unir de façon à peu près harmonieuse des notes qui furent prises au jour le jour.
Livingstone ne parle que très peu de lui-même, sinon pour décrire une scène où son rôle lui semble avoir plus d'importance. Il écrit surtout sur l'Afrique et les Africains, déploie à la fois une très grande érudition et une bienveillance poétique sur les us et coutumes des indigènes. Son livre est considérablement instructif, d'autant plus que l'auteur est rigoureux, il veut tout comprendre et se fait tout expliquer. On réalise, en le lisant, quel homme passionné et investi il a pu être. Il ne fait jamais le moindre reproche aux Africains, il ne condamne réellement que leur intempérance sexuelle (puritanisme protestant oblige), et leur complicité active dans le trafic d'esclaves.
Car l'une des révélations les plus frappantes du récit de Livingstone, c'est sa dénonciation fort documentée du trafic d'esclaves, initiée en réalité… par les Africains eux-mêmes ! Ou, plus précisément, par des bandes criminelles nomades et organisées, qui faisaient des descentes ponctuelles dans des villages pour s'emparer de jeunes hommes qu'ils menaçaient de mort, dont ils ligotaient les avant-bras, et qu'ils reliaient entre eux avec ces fameux bâtons fourchus souvent reproduits sur des gravures, et qui sont une invention barbare authentiquement africaine (une gravure du livre montre d'ailleurs les esclaves bel et bien menés par d'autres noirs).
Les futurs esclaves étaient alors ramenés vers les côtes, dans les villes portuaires, ou d'autres marchands, soit africains, soit le plus souvent arabes, se chargaient de les vendre aux colons britanniques, qui n'étaient donc que les acheteurs passifs d'une main d'oeuvre qui, malgré tous ces intermédiaires locaux, restait bon marché.
Pour autant, David Livingstone ne juge pas les britanniques moins coupables que les trafiquants. Comme sujet royal et comme chrétien, le devoir d'un Britannique, selon lui, serait de refuser ce trafic infâme. Il entend bien les problèmes liés au manque de personnel dans l'exploitation coloniale elle-même, mais non seulement il ne juge pas que la contrainte se justifie au point d'enchaîner des hommes, mais il dénonce aussi le trafic international des négriers, qui exportent les Africains comme du vulgaire bétail, en surchargeant les navires, quitte à ce qu'un tiers du cheptel meure en cours de voyage.
Plus encore que la consignation fidèle mais prévisible de l'expédition, ce chapitre amer sur la réalité du trafic d'esclaves, en Afrique de l'est dans les années 1860, est particulièrement intéressante, même si évidemment, elle serait difficile à republier à notre époque de moeurs victimaires et de mortification morale.
Mais pourtant, en tournant, un peu navré, la dernière page du récit de David Livingstone, le lecteur n'a pas idée de ce qui l'attend : rien ne procurera plus de douloureuses émotions que le récit de Henry Morton Stanley qui, soit volontairement, soit avec une belle inconscience, prend exactement le contrepied de l'ouvrage de Livingstone.
Ce n'est pas un rapport circonstancié, c'est un roman d'aventure au pays des sauvages, pire : un roman d'épouvante. Stanley, effectivement, débarque en Afrique sans rien en connaître, et surtout pas les langues locales. Durant toute sa narration, il ne parle des Africains et même des Arabes que comme des animaux ou des vermines, dont il redoute le pire mais auxquels il doit absolument imposer son autorité.
Rassembler une expédition lui est donc difficile, et il est obligé de recruter, dans les bouges et les endroits mal famés, des aventuriers douteux, des escrocs, des crapules et des assassins, lesquels ne se privent pas d'égorger des villageois, ou de vider des bouteilles d'alcools, jusqu'à en être ivre mort. Plus que les difficultés du trajet, c'est la gestion de ces fripouilles qui pose le plus de problèmes à Stanley. Et autant Livingstone ne parlait que rarement de lui, autant Stanley ne s'intéresse qu'à ce qu'il ressent et ce qu'il constate, sans pour autant se donner le beau rôle.
Il n'y a, à ses yeux, qu'une façon de mater des brigands, c'est d'être encore plus brigand qu'eux. Stanley est donc un homme qui menace, qui braque des fusils en permanence sur la tête des gens, qui leur tire dessus quand ils cherchent à s'enfuir, qui ne s'adresse jamais à un Africain sans le menacer du fouet ou de coups de bâton, qui s'arrête dans les villages en regardant autour de lui, en se demandant d'où viendra la menace.
Son récit est parfaitement odieux, mais paradoxalement, il est aussi très drôle, car loin de s'y présenter en civilisé conquérant, Stanley donne de lui l'image d'un homme perpétuellement apeuré, soucieux d'affirmer une autorité virile de peur qu'elle ne lui échappe, mais intérieurement persuadé de traverser l'Enfer de Dante, et d'y mourir s'il ne tire pas plus vite que son ombre.
Cette vision volontiers paranoïaque de l'Afrique, surtout lue après celle si humaine et pacifique de Livingstone, frappe surtout par son incongruité obsessionnelle, et à lire ce déluge presque ininterrompu de menaces, de trahisons, de pièges et d'agressions diverses, on ne peut s'empêcher de penser à un mauvais nanar italien des années 80.
De ce fait, on est très étonné de découvrir à la fin du récit un Stanley apaisé, et même transfiguré, par sa rencontre finale avec Livingstone, auquel il adresse cette phrase devenue mythique, par tout ce qu'elle suggère d'un flegme britannique naissant spontanément entre deux citoyens de la Couronne :
- « Docteur Livingstone, je présume ? »
Une question d'autant plus marquante qu'elle succède à 200 pages de véritable « survival-horror », comme on dit aujourd'hui.
En effet, et cela semble sincère, Stanley éprouve une immense estime pour ce pasteur-docteur qui a su créer autour de lui un havre de paix, en compagnie d'autochtones qui l'estiment comme un père. Il se demande même, avec une candeur stupéfiante, comment Livingstone parvient à se faire obéir et respecter par ces sauvages sans jamais devoir les battre à coups de trique, avant de conclure sombrement qu'il se sentirait incapable de traiter les Noirs avec humanité; et peut-être faut-il voir dans cette déclaration à la fois odieuse et chagrinée le traumatisme d'un enfant malmené par la vie, qui ne veut plus jamais croire à autre chose qu'à la force brutale.
« Du Zambèze au Tanganyika » est donc le mariage heureux, quoique inconfortable, de deux visions coloniales vieilles d'un siècle et demi, où percent toute la complexité et les paradoxes de la nature humaine, et qui incarnent, par leur divergence, la vanité de toutes les utopies dès lors qu'elles se heurtent à la réalité âpre d'un contexte nouveau auxquelles elles ne sont pas préparées.
Entre l'humaniste fervent, mourant à la recherche d'une source, et l'opportuniste raciste et dominateur qui risque sa vie pour la célébrité - mais qui ne la perdra pas -, on peut établir toute une échelle de valeurs, mais on peut aussi juger que la terre d'Afrique se moque bien des ambitions des hommes et dicte à tous sa propre loi, celle de la jungle, que nul n'a jamais su totalement éradiquer. Cependant, les exemples parlants et contrastés de l'aventure commune de Stanley & Livingstone sont à la fois une grande aventure humaine, et une réflexion pertinente, et plus profonde, qu'il n'y parait sur la nature de notre humanité, quand elle s'extrait du cocon douillet et illusoire de la civilisation.
Le premier homme à écrire des ouvrages coloniaux de fiction, quoique inspirés de faits réels, était un marchand du nom de Frederick Marryat, auquel on doit pas moins de 26 romans d'aventures exotiques, publiés entre 1829 et 1848, qui furent traduits en français dès 1833 et connurent un immense succès jusqu'au Second Empire.
Cependant, son cas reste isolé. Bien vite, ce furent les explorateurs, qui publièrent d'autant plus volontiers les récits de leurs voyages que le produit des ventes de leurs livres leur permettait de financer une nouvelle expédition. L'exploration était en effet une tâche ingrate, car au contraire du marchand, non seulement l'explorateur ne faisait pas de commerce, mais il devait aussi se charger de cadeaux, histoire d'amadouer les populations locales et d'obtenir ainsi des informations sur telle ou telle région qui devait être explorée.
Alors que la France s'installait en Afrique de l'Ouest, région touffue par endroits, mais offrant aussi des grandes plaines désertiques ou pré-désertiques qui, en dépit des températures élevées, facilitaient les déplacements des caravanes, les Britanniques héritèrent de l'Afrique de l'Est, région bien plus belle mais terriblement sauvage et extrêmement ardue, partagée entre des jungles étouffantes, et d'interminables savanes remplies de fauves dangereux. Ce sont d'ailleurs ces savanes qui donneront aux colons britanniques l'idée du "safari", que l'on ne pratiquera pas dans les colonies françaises avant le début du XXème siècle.
L'exploration de cette partie de l'Afrique prit à l'Angleterre plusieurs décennies, et engendra quantité de martyrs, de disparus dont on ne retrouva jamais aucune trace – ce qui généra le cliché de l'anthropophage africain faisant bouillir les explorateurs dans une marmite, vision totalement fantaisiste, car il n'y a jamais eu une seule tribu cannibale en Afrique – et d'échecs innombrables et cuisants, qui amenèrent la plupart des colons à renoncer à s'avancer plus avant vers l'intérieur des terres, et à se contenter de développer un impressionnant trafic d'esclaves.
C'est à partir de 1840 qu'un explorateur d'un genre absolument nouveau, va révolutionner sa profession : David Livingstone devint à lui seul une légende encore révérée de l'exploration africaine. En 30 ans, il arpenta toute l'Afrique australe, d'un océan à l'autre, du Kenya à l'Afrique du Sud, apprenant les langues locales avec un indéniable don. Médecin de formation, ordonné pasteur par conviction religieuse, David Livingstone était un esprit droit et rigoureux, et il doit beaucoup à ses qualités morales et intellectuelles l'immense popularité qui est encore la sienne, même en Afrique. Ses connaissances médicales lui permirent d'apporter des médicaments inconnus des autochtones, et qui sauvèrent bien des vies. Ses convictions religieuses le rendirent plus respectable, plus noble, aux yeux des indigènes que les esclavagistes ou les marchands, qui étaient seulement guidés par leurs intérêts. Quand il rencontrait une tribu, David Livingstone n'hésitait pas à s'y installer pour une ou deux semaines, prenant le temps de discuter avec chacun et de perfectionner sa connaissance des langues, choisissant minutieusement les cadeaux à offrir à chaque habitant selon ses goûts et ses besoins, apportant au sein de ces tribus une idée jusque là inconnue d'elles : le souci d'équité.
Il fut également, tant en Afrique que lorsqu'il rentrait en Angleterre pour y faire des conférences, un vigoureux militant contre l'esclavagisme. Toute sa vie, David Livingstone défendit l'idée d'un colonialisme bienveillant, respectueux et humaniste.
Bien qu'il puisse aujourd'hui nous apparaître condescendant, le système des cadeaux était essentiel, non seulement pour fraterniser avec les populations locales, mais aussi pour obtenir, dans des pays qui ne fonctionnaient pas selon un système monétaire, des vivres, des animaux de remplacements, des ustensiles, et des outils. Par principe, David Livingstone refusait qu'il y ait des armes dans sa caravane. Il fut d'ailleurs plusieurs fois attaqué par des bandes de pillards, envers lesquelles il ne tenta pas la moindre résistance. Pacifiste et humaniste, il jugeait que c'était à lui à se faire à l'Afrique et non le contraire. Il se contentait d'évangéliser les Africains seulement lorqu'ils en faisaient la demande.
En 1865, il publia « Exploration du Zambèze et de ses Affluents », qui fut son ultime récit de voyage. Puis il disparut, cessa brusquement toutes ses correspondances, jusqu'à ce que plus personne en Afrique ne sache ce qu'il était devenu.
L'homme était très populaire et très estimé en Angleterre. Il était inimaginable de l'abandonner à son sort. Mais qui serait assez fou pour lancer une expédition de recherche ? Un candidat se présenta : Henry Morton Stanley, jeune journaliste sans expérience, mais bien décidé à devenir célèbre par tous les moyens.
On ne pouvait trouver une personnalité plus éloignée de David Livingstone que celle de ce Henry Morton Stanley, né dans une famille alcoolique et misérable, dont il fut retiré pour être enfermé dans un orphelinat, où il fut battu et violé. Devenu ouvrier à l'âge de 15 ans, il se hissa jusqu'au journalisme par un travail acharné, une totale absence de scrupules, et l'opiniâtreté noire de celui qui ne vit que pour prendre une revanche sur le destin. L'Afrique ne l'intéressait pas, il ne croyait ni en Dieu, ni aux valeurs morales, et il prouva par la suite qu'il était obsédé par la domination brutale des indigènes, le pillage immodéré de l'Afrique et le trafic d'esclaves, auquel il prit part financièrement. Il n'avait en réalité qu'une qualité : la rage d'arriver. Mais ce fut probablement cette rage qui lui permit de réussir là où bien d'autres auraient échoué.
Car après des mois d'avancée difficile dans la jungle, Stanley put retrouver le docteur Livingstone en 1871, dans un petit village de l'ouest de la Zambie où, selon son habitude, il s'était arrêté pour vivre avec les indigènes. Il n'était rien arrivé de grave à David Livingstone, mais simplement, sa santé déclinant avec l'âge, il s'était décidé à partir dans une dernière quête effrénée vers la source du Zambèze, qu'il voulait absolument découvrir, et baptiser du nom de la reine Victoria, comme il l'avait fait quelques années plus tôt pour les chutes Victoria, où les flots du Zambèze s'écoulent à travers une gigantesque faille dans le roc de plusieurs kilomètres de long.
David Livingstone n'avait pas cessé, depuis des années, de remonter le cours du fleuve, à pied et avec sa caravane, espérant chaque jour atteindre la source du Zambèze un jour prochain. Or, cette quête qui l'absorbait, au point de délaisser ses notes et son courrier, se révélait interminable, car le fleuve Zambèze coule sur pas moins de 2750 kilomètres. Aux dires de Stanley, David Livingstone était conscient de s'être lancé dans un voyage dont il ne reviendrait pas vivant, mais il espérait arriver tout de même à la source. Il en était hélas encore loin quand il mourut de dysenterie et de malaria deux ans plus tard.
En 1872, une fois revenu en Angleterre, Henry Morton Stanley publia à son tour le récit de son expédition, « Comment J'ai Retrouvé Livingstone », qui fut un immense best-seller, dont les ventes augmentèrent encore lorsque la mort de Livingstone fut connue. La carrière journalistique et littéraire de Stanley était ainsi définitivement lancée.
Ces deux ouvrages furent traduits en français chez de petits éditeurs aux tirages modestes. Ils furent rapidement épuisés, et sans doute seraient-ils totalement oubliés de ce côté-ci du Channel, si un explorateur français, Alain Gheerbrant, n'avait eu l'incroyable idée, en 1959, de faire réimprimer ensemble le dernier livre de David Livingstone et le premier livre d'Henry Morton Stanley dans une édition critique présentée par lui-même, et publiée par le Club des Libraires de France à seulement 4000 exemplaires, sous une luxueuse reliure en toile, enluminée des gravures et des cartes des deux éditions originales.
Ce volume, encore trouvable à un prix abordable, constitue à mon sens un chef d'oeuvre indispensable de la littérature coloniale, car non seulement il exhume des traductions fidèles de deux ouvrages fondateurs du genre, mais Alain Gheerbrant s'est servi de ces deux récits, qu'il accompagne d'un avant propos, d'un texte de transition entre les deux livres, et d'une postface, pour raconter une autre histoire : la rencontre émouvante, figée par la postérité, de deux hommes, fort différents, dans un coin perdu d'Afrique, où l'un étant à la recherche de l'autre, et l'autre étant touché du chemin parcouru par l'un, il advint qu'une sympathie instinctive naquit entre eux, alors que s'ils s'étaient mieux connus dans un autre contexte, ils se seraient volontiers haïs.
En effet, ces deux livres racontent à peu près la même histoire : une expédition qui remonte le Zambèze, non sans difficultés extrêmes et contretemps malencontreux. Mais ces deux hommes qui parcourent, à quelques années d'écart, le même chemin, ne voient pas la même chose, ne s'expriment pas avec la même sensibilité, ce qui fait qu'à aucun moment, on ne ressent un sentiment de répétition. David Livingstone est avant tout investi dans une démarche documentaire : sa narration est morne, sans prétention littéraire, avec même un peu de la sécheresse du médecin qui établit un diagnostic, et son frère Charles Livingstone, co-auteur, se borne à unir de façon à peu près harmonieuse des notes qui furent prises au jour le jour.
Livingstone ne parle que très peu de lui-même, sinon pour décrire une scène où son rôle lui semble avoir plus d'importance. Il écrit surtout sur l'Afrique et les Africains, déploie à la fois une très grande érudition et une bienveillance poétique sur les us et coutumes des indigènes. Son livre est considérablement instructif, d'autant plus que l'auteur est rigoureux, il veut tout comprendre et se fait tout expliquer. On réalise, en le lisant, quel homme passionné et investi il a pu être. Il ne fait jamais le moindre reproche aux Africains, il ne condamne réellement que leur intempérance sexuelle (puritanisme protestant oblige), et leur complicité active dans le trafic d'esclaves.
Car l'une des révélations les plus frappantes du récit de Livingstone, c'est sa dénonciation fort documentée du trafic d'esclaves, initiée en réalité… par les Africains eux-mêmes ! Ou, plus précisément, par des bandes criminelles nomades et organisées, qui faisaient des descentes ponctuelles dans des villages pour s'emparer de jeunes hommes qu'ils menaçaient de mort, dont ils ligotaient les avant-bras, et qu'ils reliaient entre eux avec ces fameux bâtons fourchus souvent reproduits sur des gravures, et qui sont une invention barbare authentiquement africaine (une gravure du livre montre d'ailleurs les esclaves bel et bien menés par d'autres noirs).
Les futurs esclaves étaient alors ramenés vers les côtes, dans les villes portuaires, ou d'autres marchands, soit africains, soit le plus souvent arabes, se chargaient de les vendre aux colons britanniques, qui n'étaient donc que les acheteurs passifs d'une main d'oeuvre qui, malgré tous ces intermédiaires locaux, restait bon marché.
Pour autant, David Livingstone ne juge pas les britanniques moins coupables que les trafiquants. Comme sujet royal et comme chrétien, le devoir d'un Britannique, selon lui, serait de refuser ce trafic infâme. Il entend bien les problèmes liés au manque de personnel dans l'exploitation coloniale elle-même, mais non seulement il ne juge pas que la contrainte se justifie au point d'enchaîner des hommes, mais il dénonce aussi le trafic international des négriers, qui exportent les Africains comme du vulgaire bétail, en surchargeant les navires, quitte à ce qu'un tiers du cheptel meure en cours de voyage.
Plus encore que la consignation fidèle mais prévisible de l'expédition, ce chapitre amer sur la réalité du trafic d'esclaves, en Afrique de l'est dans les années 1860, est particulièrement intéressante, même si évidemment, elle serait difficile à republier à notre époque de moeurs victimaires et de mortification morale.
Mais pourtant, en tournant, un peu navré, la dernière page du récit de David Livingstone, le lecteur n'a pas idée de ce qui l'attend : rien ne procurera plus de douloureuses émotions que le récit de Henry Morton Stanley qui, soit volontairement, soit avec une belle inconscience, prend exactement le contrepied de l'ouvrage de Livingstone.
Ce n'est pas un rapport circonstancié, c'est un roman d'aventure au pays des sauvages, pire : un roman d'épouvante. Stanley, effectivement, débarque en Afrique sans rien en connaître, et surtout pas les langues locales. Durant toute sa narration, il ne parle des Africains et même des Arabes que comme des animaux ou des vermines, dont il redoute le pire mais auxquels il doit absolument imposer son autorité.
Rassembler une expédition lui est donc difficile, et il est obligé de recruter, dans les bouges et les endroits mal famés, des aventuriers douteux, des escrocs, des crapules et des assassins, lesquels ne se privent pas d'égorger des villageois, ou de vider des bouteilles d'alcools, jusqu'à en être ivre mort. Plus que les difficultés du trajet, c'est la gestion de ces fripouilles qui pose le plus de problèmes à Stanley. Et autant Livingstone ne parlait que rarement de lui, autant Stanley ne s'intéresse qu'à ce qu'il ressent et ce qu'il constate, sans pour autant se donner le beau rôle.
Il n'y a, à ses yeux, qu'une façon de mater des brigands, c'est d'être encore plus brigand qu'eux. Stanley est donc un homme qui menace, qui braque des fusils en permanence sur la tête des gens, qui leur tire dessus quand ils cherchent à s'enfuir, qui ne s'adresse jamais à un Africain sans le menacer du fouet ou de coups de bâton, qui s'arrête dans les villages en regardant autour de lui, en se demandant d'où viendra la menace.
Son récit est parfaitement odieux, mais paradoxalement, il est aussi très drôle, car loin de s'y présenter en civilisé conquérant, Stanley donne de lui l'image d'un homme perpétuellement apeuré, soucieux d'affirmer une autorité virile de peur qu'elle ne lui échappe, mais intérieurement persuadé de traverser l'Enfer de Dante, et d'y mourir s'il ne tire pas plus vite que son ombre.
Cette vision volontiers paranoïaque de l'Afrique, surtout lue après celle si humaine et pacifique de Livingstone, frappe surtout par son incongruité obsessionnelle, et à lire ce déluge presque ininterrompu de menaces, de trahisons, de pièges et d'agressions diverses, on ne peut s'empêcher de penser à un mauvais nanar italien des années 80.
De ce fait, on est très étonné de découvrir à la fin du récit un Stanley apaisé, et même transfiguré, par sa rencontre finale avec Livingstone, auquel il adresse cette phrase devenue mythique, par tout ce qu'elle suggère d'un flegme britannique naissant spontanément entre deux citoyens de la Couronne :
- « Docteur Livingstone, je présume ? »
Une question d'autant plus marquante qu'elle succède à 200 pages de véritable « survival-horror », comme on dit aujourd'hui.
En effet, et cela semble sincère, Stanley éprouve une immense estime pour ce pasteur-docteur qui a su créer autour de lui un havre de paix, en compagnie d'autochtones qui l'estiment comme un père. Il se demande même, avec une candeur stupéfiante, comment Livingstone parvient à se faire obéir et respecter par ces sauvages sans jamais devoir les battre à coups de trique, avant de conclure sombrement qu'il se sentirait incapable de traiter les Noirs avec humanité; et peut-être faut-il voir dans cette déclaration à la fois odieuse et chagrinée le traumatisme d'un enfant malmené par la vie, qui ne veut plus jamais croire à autre chose qu'à la force brutale.
« Du Zambèze au Tanganyika » est donc le mariage heureux, quoique inconfortable, de deux visions coloniales vieilles d'un siècle et demi, où percent toute la complexité et les paradoxes de la nature humaine, et qui incarnent, par leur divergence, la vanité de toutes les utopies dès lors qu'elles se heurtent à la réalité âpre d'un contexte nouveau auxquelles elles ne sont pas préparées.
Entre l'humaniste fervent, mourant à la recherche d'une source, et l'opportuniste raciste et dominateur qui risque sa vie pour la célébrité - mais qui ne la perdra pas -, on peut établir toute une échelle de valeurs, mais on peut aussi juger que la terre d'Afrique se moque bien des ambitions des hommes et dicte à tous sa propre loi, celle de la jungle, que nul n'a jamais su totalement éradiquer. Cependant, les exemples parlants et contrastés de l'aventure commune de Stanley & Livingstone sont à la fois une grande aventure humaine, et une réflexion pertinente, et plus profonde, qu'il n'y parait sur la nature de notre humanité, quand elle s'extrait du cocon douillet et illusoire de la civilisation.
Citations et extraits (13)
Voir plus
Ajouter une citation
Notre expédition est la première, nous le croyons du moins, qui ait vu la traite au lieu même de son origine et l'ait suivie dans toutes ses phases; c'est pour cela que nous avons décrit avec tant de détails les diverses pratiques de cet odieux négoce.
On a dit que la vente de l'homme était soumise, comme toutes les autres, à la loi commerciale de l'offre et de la demande, et devait par conséquent rester libre. Cette assertion a été risquée parce que nul ne pouvait la démentir. Mais, nous l'affirmons à notre tour : cette vente est la cause de tant de meurtres qu'elle ne mérite pas plus d'être classée parmi les branches de commerce que le vol de grand chemin, l'assassinat ou la piraterie.
Tout d'abord, c'est une pénalité : le coupable seul est vendu; et l'on peut y voir un acte de justice. La peine atteint bientôt les accusés de sorcellerie; puis l'enfant d'un pauvre est saisi en paiement d'une dette ou d'une amende : tout cela au nom du chef, et à titre légal.
Viennent ensuite les voleurs qui, soit isolément, soit par groupe, enlèvent les enfants des hameaux voisins quand les pauvres petits vont puiser de l'eau ou chercher du bois.
Nous avons vu des districts où chaque demeure était entourée d'une estacade, et les habitants n'y étaient pas en sûreté.
Ces rapts, d'abord partiels, amènent des représailles; les bandes se forment, la lutte grandit. Ce qui avait lieu de village à village se passe de tribu à tribu. Le parti le plus faible devient errant, se procure des armes en vendant ses captifs, attaque les tribus paisibles et n'a plus d'autre emploi que d'approvisionner les marchés de la côte.
Des Arabes et des métis portugais viennent en outre chercher le bétail humain qu'ils ont fait recueillir et stimulent l'activité des pourvoyeurs. Parmi ces derniers, se remarquent les Ajahouas et les Babisas, qui ont à la fois le goût du trafic et des voyages.
L'effet de cet odieux commerce est visible chez tous ceux qui le pratiquent; ainsi les Babisas et les Ajahouas, d'une intelligence supérieure à la plupart des gens de leur race, sont tellement pervertis par leur affreux négoce, qu'on les a vus troquer leurs nouvelles épouses ou leurs propres filles pour une dent d'éléphant qui leur plaisait. Ceux de leur tribu, qui ont une vie sédentaire et n'ont jamais trafiqué de leurs semblables, s'indigneraient au seul récit de pareilles énormités.
Enfin, nous voyons la traite prendre un nouvel essor par le fait d'Européens qui, sans le vouloir, offrent un débouché à l'exportation de l'indigène. Des bandes armées, conduites par des agents commerciaux, appartenant à des Arabes et à des Portugais de la côte, sont expédiées dans l'intérieur avec de grandes quantités de mousquets, de munitions, de grains de verre et de cotonnade. Ces derniers articles servent, au début du voyage, à payer les frais de route et à faire des achats d'ivoire. Très souvent, ainsi que nous l'avons vu, la bande conserve le caractère commercial pendant une grande partie de la tournée. En pareil cas, elle s'installe dans un lieu favorable aux affaires, s'entend avec le chef et cultive un champ d'une certaine étendue; mais il n'est pas une de ces caravanes qui n'ait accompagné les indigènes dans leurs razzias et n'ait attaqué une peuplade quelconque avec l'intention d'y faire des captifs. Nous n'avons pas un seul exemple du contraire. Le fait est si commun qu'il en résulte une dépopulation effrayante. L'arc et les flèches ne tiennent pas contre le mousquet; la fuite des habitants, la famine et la mort s'ensuivent. Nous répétons ce que nous avons dit plus haut avec une ferme conviction, qu'il n'est pas un cinquième des victimes de ces chasses, souvent même un dixième, qui arrive à Cuba ou partout ailleurs et profite de ces bons maîtres que leur destine la Providence; car c'est ainsi que les possesseurs d'esclaves interprètent les Écritures.
Ce dernier système des bandes guerrières et trafiquantes est celui des Portugais de Têté; et le carnage qu'il a mis sous nos yeux défie toute description. Comme tous les médecins, nous avions assisté à des scènes bien douloureuses; le spectacle de la mort nous était familier; mais les horreurs produites par le commerce de l'homme dépassent tout ce que nous aurions pu croire.
Nous avons montré le double courant de cet odieux négoce, tel qu'il se faisait sous nos yeux !une partie des esclaves remontant le Zambèze, tandis que le reste se dirigeait vers la côte. Les femmes, expédiées dans l'intérieur, s'y vendaient jusqu'à deux arrobas (soixante-quatre livres) d'ivoire. Une grande partie des hommes étaient envoyés à l'île de la Réunion.
Si nous reparlons de ce sujet pénible, c'est qu'il est important de faire observer que tout cela s'est fait sous la direction d'un esprit aussi éclairé que prévoyant. En voulant suppléer par des Africains aux ouvriers qui manquaient à la Réunion, Napoléon III ne songeait qu'à des émigrants volontaires. Sur chaque navire était un préposé chargé de veiller à ce que l'engagement fût équitable et librement consenti; à ce que la nourriture fût saine, en quantité suffisante, et le nombre des passagers en rapport avec l'espace qu'ils devaient occuper.
Malgré tous les soins de l'Empereur, cette mesure n'a jamais été que la traite sous la forme la plus grave; et le trafic maudit a d'autant mieux prospéré qu'il était soutenu par un gouvernement énergique et puissant. Honneur à Napoléon III pour avoir délivré les Français de toute participation à la vente de l'homme; honneur au gouvernement britannique pour lui avoir démontré les maux qu'il faisait naître, sans en avoir conscience, et pour avoir facilité l'émigration des coolies hindous au prix d'un sacrifice considérable.
On pourrait croire que les effets que nous attribuons au système des "engagés" sont le résultat d'une méprise; mais nous n'avons rien dit que nous n'ayons vu, rien avancé dont nous n'ayons la preuve.
("Expédition du Zambèze et de ses Affluents")
On a dit que la vente de l'homme était soumise, comme toutes les autres, à la loi commerciale de l'offre et de la demande, et devait par conséquent rester libre. Cette assertion a été risquée parce que nul ne pouvait la démentir. Mais, nous l'affirmons à notre tour : cette vente est la cause de tant de meurtres qu'elle ne mérite pas plus d'être classée parmi les branches de commerce que le vol de grand chemin, l'assassinat ou la piraterie.
Tout d'abord, c'est une pénalité : le coupable seul est vendu; et l'on peut y voir un acte de justice. La peine atteint bientôt les accusés de sorcellerie; puis l'enfant d'un pauvre est saisi en paiement d'une dette ou d'une amende : tout cela au nom du chef, et à titre légal.
Viennent ensuite les voleurs qui, soit isolément, soit par groupe, enlèvent les enfants des hameaux voisins quand les pauvres petits vont puiser de l'eau ou chercher du bois.
Nous avons vu des districts où chaque demeure était entourée d'une estacade, et les habitants n'y étaient pas en sûreté.
Ces rapts, d'abord partiels, amènent des représailles; les bandes se forment, la lutte grandit. Ce qui avait lieu de village à village se passe de tribu à tribu. Le parti le plus faible devient errant, se procure des armes en vendant ses captifs, attaque les tribus paisibles et n'a plus d'autre emploi que d'approvisionner les marchés de la côte.
Des Arabes et des métis portugais viennent en outre chercher le bétail humain qu'ils ont fait recueillir et stimulent l'activité des pourvoyeurs. Parmi ces derniers, se remarquent les Ajahouas et les Babisas, qui ont à la fois le goût du trafic et des voyages.
L'effet de cet odieux commerce est visible chez tous ceux qui le pratiquent; ainsi les Babisas et les Ajahouas, d'une intelligence supérieure à la plupart des gens de leur race, sont tellement pervertis par leur affreux négoce, qu'on les a vus troquer leurs nouvelles épouses ou leurs propres filles pour une dent d'éléphant qui leur plaisait. Ceux de leur tribu, qui ont une vie sédentaire et n'ont jamais trafiqué de leurs semblables, s'indigneraient au seul récit de pareilles énormités.
Enfin, nous voyons la traite prendre un nouvel essor par le fait d'Européens qui, sans le vouloir, offrent un débouché à l'exportation de l'indigène. Des bandes armées, conduites par des agents commerciaux, appartenant à des Arabes et à des Portugais de la côte, sont expédiées dans l'intérieur avec de grandes quantités de mousquets, de munitions, de grains de verre et de cotonnade. Ces derniers articles servent, au début du voyage, à payer les frais de route et à faire des achats d'ivoire. Très souvent, ainsi que nous l'avons vu, la bande conserve le caractère commercial pendant une grande partie de la tournée. En pareil cas, elle s'installe dans un lieu favorable aux affaires, s'entend avec le chef et cultive un champ d'une certaine étendue; mais il n'est pas une de ces caravanes qui n'ait accompagné les indigènes dans leurs razzias et n'ait attaqué une peuplade quelconque avec l'intention d'y faire des captifs. Nous n'avons pas un seul exemple du contraire. Le fait est si commun qu'il en résulte une dépopulation effrayante. L'arc et les flèches ne tiennent pas contre le mousquet; la fuite des habitants, la famine et la mort s'ensuivent. Nous répétons ce que nous avons dit plus haut avec une ferme conviction, qu'il n'est pas un cinquième des victimes de ces chasses, souvent même un dixième, qui arrive à Cuba ou partout ailleurs et profite de ces bons maîtres que leur destine la Providence; car c'est ainsi que les possesseurs d'esclaves interprètent les Écritures.
Ce dernier système des bandes guerrières et trafiquantes est celui des Portugais de Têté; et le carnage qu'il a mis sous nos yeux défie toute description. Comme tous les médecins, nous avions assisté à des scènes bien douloureuses; le spectacle de la mort nous était familier; mais les horreurs produites par le commerce de l'homme dépassent tout ce que nous aurions pu croire.
Nous avons montré le double courant de cet odieux négoce, tel qu'il se faisait sous nos yeux !une partie des esclaves remontant le Zambèze, tandis que le reste se dirigeait vers la côte. Les femmes, expédiées dans l'intérieur, s'y vendaient jusqu'à deux arrobas (soixante-quatre livres) d'ivoire. Une grande partie des hommes étaient envoyés à l'île de la Réunion.
Si nous reparlons de ce sujet pénible, c'est qu'il est important de faire observer que tout cela s'est fait sous la direction d'un esprit aussi éclairé que prévoyant. En voulant suppléer par des Africains aux ouvriers qui manquaient à la Réunion, Napoléon III ne songeait qu'à des émigrants volontaires. Sur chaque navire était un préposé chargé de veiller à ce que l'engagement fût équitable et librement consenti; à ce que la nourriture fût saine, en quantité suffisante, et le nombre des passagers en rapport avec l'espace qu'ils devaient occuper.
Malgré tous les soins de l'Empereur, cette mesure n'a jamais été que la traite sous la forme la plus grave; et le trafic maudit a d'autant mieux prospéré qu'il était soutenu par un gouvernement énergique et puissant. Honneur à Napoléon III pour avoir délivré les Français de toute participation à la vente de l'homme; honneur au gouvernement britannique pour lui avoir démontré les maux qu'il faisait naître, sans en avoir conscience, et pour avoir facilité l'émigration des coolies hindous au prix d'un sacrifice considérable.
On pourrait croire que les effets que nous attribuons au système des "engagés" sont le résultat d'une méprise; mais nous n'avons rien dit que nous n'ayons vu, rien avancé dont nous n'ayons la preuve.
("Expédition du Zambèze et de ses Affluents")
Trois cents mètres nous séparent encore du village. La foule augmente; on se presse autour de moi. Tout à coup, au milieu des yambos, j'entends dire à ma droite:
- "Good morning, sir !"
Je tourne vivement la tête, cherchant qui a proféré ces paroles; et je vois une figure du plus beau noir, celle d'un homme tout joyeux, portant une longue robe blanche, et coiffé d'un turban de calicot, un morceau de mérikani
autour de sa tête laineuse.
- "Qui diable êtes-vous ?" demandé-je.
- "Je m'appelle Souzi; le domestique du docteur Livingstone", dit-il avec un sourire qui découvrit une double rangée de dents éclatantes.
- "Le docteur est ici ?"
- "Oui, monsieur."
- "Dans le village ?"
- "Oui, monsieur."
- "En êtes-vous sûr ?"
- "Très sûr; je le quitte à l'instant même."
- "Le docteur va bien ?"
- "Non, monsieur."
- "Allez prévenir le docteur."
- "Oui, monsieur."
Et il partit comme une flèche.
Nous étions encore à deux cents pas; la multitude nous empêchait d'avancer. Des Arabes et des Vouangouana écartaient les indigènes pour venir me saluer, car d'après eux j'étais un des leurs.
- "Mais comment avez-vous pu passer ?"
C'était là leur surprise.
Souzi revint bientôt, toujours courant, me prier de lui dire comment on m'appelait. Le docteur, ne voulant pas le croire, lui avait demandé mon nom; et il n'avait su que répondre.
Mais pendant les courses de Souzi, la nouvelle que cette caravane, dont les fusils brûlaient tant de poudre, était bien celle d'un blanc, avait pris de la consistance. Les plus marquants des Arabes du village, Mohammed ben Séli, Séid hen Medjid, Mohammed ben Ghérib, d'autres encore, s'étaient réunis devant la demeure de Livingstone; et ce dernier était venu les rejoindre pour causer de l'événement.
Sur ces entrefaites, la caravane s'arrêta, le Kirangozi en tête, portant sa bannière aussi haut que possible.
- "Je vois le docteur, monsieur", me dit Sélim. "Comme il est vieux !"
Que n'aurais-je pas donné pour avoir un petit coin de désert où, sans être vu, j'aurais pu me livrer à quelque folie : me mordre les mains, faire une culbute, fouetter les arbres; enfin donner cours à la joie qui m'étouffait ! Mon cœur battait à se rompre; mais je ne laissais pas mon visage trahir mon émotion, de peur de nuire à la dignité de ma race.
Prenant alors le parti qui me parut le plus digne, j'écartai la foule, et me dirigeai, entre deux haies de curieux, vers le demi-cercle d'Arabes devant lequel se tenait l'homme à barbe grise.
Tandis que j'avançais lentement, je remarquais sa pâleur et son air de fatigue. Il avait un pantalon gris, un veston rouge et une casquette bleue, à galon d'or fané. J'aurais voulu courir à lui; mais j'étais lâche en présence de cette foule. J'aurais voulu l'embrasser; mais il était anglais, et je ne savais pas comment je serais accueilli.
Je fis donc ce que m'inspiraient la couardise et le faux orgueil : j'approchai d'un pas délibéré, et dis en ôtant mon chapeau :
- "Docteur Livingstone, je présume ?"
- "Oui", répondit-il en soulevant sa casquette, avec un bienveillant sourire.
Nos têtes furent recouvertes, et nos mains se serrèrent.
- "Je remercie Dieu", repris-je, "de ce qu'il m'a permis de vous rencontrer.
- "Je suis heureux", dit-il, "d'être ici pour vous recevoir".
Je me tournai ensuite vers les Arabes, qui m'adressaient leurs yambos, et que le docteur me présenta, chacun par son nom. Puis oubliant la foule, oubliant ceux qui avaient partagé mes périls, je suivis Livingstone.
Il me fit entrer sous sa véranda, simple prolongation de la toiture, et m'invita de la main à prendre le siège dont son expérience du climat d'Afrique lui avait suggéré l'idée : un paillasson posé sur la banquette de terre qui représentait le divan, une peau de chèvre sur le paillasson, et pour dossier, une autre peau de chèvre, clouée à la muraille, afin de se préserver du froid contact du pisé. Je protestai contre l'invitation; mais il ne voulut pas céder; et il fallut obéir.
Nous étions assis tous les deux. Les Arabes se placèrent à notre gauche. En face de nous plus de mille indigènes se pressaient pour nous voir, et commentaient ce fait bizarre de deux hommes blancs se rencontrant à Oujiji, l'un arrivant du Manyéma, ou du couchant, l'autre de l'Ounyanyembé, ce qui était venir de l'est.
L'entretien commença. Quelles furent nos paroles ? Je déclare n'en rien savoir. Des questions réciproques, sans aucun doute.
- "Quel chemin avez-vous pris ?"
- "Où avez-vous été depuis vos dernières lettres ?"
Oui, ce fut notre début, je me le rappelle; mais je ne
saurais dire ni mes réponses, ni les siennes; j'étais trop absorbé. Je me surprenais regardant cet homme merveilleux, le regardant fixement, l'étudiant et l'apprenant par cœur. Chacun des poils de sa barbe grise, chacune de ses rides, la pâleur de ses traits, son air fatigué, empreint d'un léger ennui, m'enseignaient ce que j'avais soif de connaître, depuis le jour où l'on m'avait dit de le retrouver. Que de choses dans ces muets témoignages, que d'intérêt dans cette lecture !
Je l'écoutais en même temps. Ah ! Si vous aviez pu le voir et l'entendre ! Ses lèvres, qui n'ont jamais menti, me donnaient des détails. Je ne peux pas répéter ses paroles, j'étais trop ému pour les sténographier. Il avait tant de choses à dire qu'il commençait par la fin, oubliant qu'il avait à rendre compte de cinq ou six années. Mais le récit débordait, s'élargissant toujours, et devenait une merveilleuse histoire.
Les Arabes se levèrent, comprenant, avec une délicatesse dont je leur sus gré, que nous avions besoin d'être seuls.
Je donnai des ordres pour que mes gens fussent approvisionnés; puis je fis appeler Kéif-Halek, et le présentai au docteur en lui disant que c'était l'un des soldats de sa caravane, restée à Kouihara, soldat que j'avais amené pour qu'il remit en mains propres les dépêches dont il était chargé. C'était le fameux sac, daté du 1er novembre 1870, et qui arrivait trois cent soixante-cinq jours après sa remise au porteur. Combien de temps serait-il resté dans l'Ounyanyembé, si je n'avais pas été envoyé en Afrique ?
Livingstone ouvrit le sac, regarda les lettres qui s'y trouvaient, en prit deux qui étaient de ses enfants, et son visage s'illumina.
Puis il me demanda les nouvelles.
- "D'abord vos lettres, docteur; vous devez être impatient de les lire."
- "Ah !" dit-il, "j'ai attendu des lettres pendant des années j'ai maintenant de la patience; quelques heures de plus ne sont rien. Dites-moi les nouvelles générales; que se passe t-il dans le monde ?"
- "Vous êtes sans doute au courant de certains faits; vous savez, par exemple, que le canal de Suez est ouvert, et que le transit y est régulier entre l'Europe et l'Asie ?"
- "J'ignorais qu'il fût achevé. C'est une grande nouvelle. Après ?"
Et me voilà transformé en annuaire du globe, sans avoir besoin ni d'exagération, ni de remplissage à deux sous la ligne; le monde a vu tant de choses, et tant de choses sur prenantes dans ces dernières années ! Le chemin de fer du Pacifique, Grant président des États-Unis, l'Égypte inondée de savants, la révolte des Crétois, le Danemark démembré, l'armée prussienne à Paris, la dynastie des Napoléon éteinte par Bismarck et par de Moltke, la France vaincue.
Quelle avalanche de faits pour un homme qui sort des forêts vierges du Manyéma ! En écoutant ce récit, l'un des plus émouvants que l'histoire ait jamais permis de faire, le docteur s'était animé; le reflet de la lumière éblouissante que jette la civilisation éclairait son visage.
Combien les petits actes des États barbares pâlissaient devant ceux-là ! Et qui pouvait dire sous quelles nouvelles phases s'agitait l'Europe, tandis que, isolés de tous, deux de ses enfants s'entretenaient de ses dernières gloires, de ses derniers malheurs ? Plus digne de les raconter, peut être, eût été un Démodocus; mais, en l'absence du poète, le reporter s'en acquitta de son mieux et le plus fidèlement possible.
Peu de temps après leur départ, les Arabes nous avaient envoyé leurs présents, sous forme de nourriture : Séid ben Medjid, des gâteaux de viande hachée, espèces de rissoles; Mohammed, un poulet au cari; Moéni, une étuvée de riz et de chèvre. Les dons se succédaient; et, à mesure qu'ils étaient apportés, nous les attaquions énergiquement. J'ai des facultés digestives de premier ordre, que l'exercice avait fortement aiguisées, il n'était pas étonnant que j'en fisse usage. Mais Livingstone, qui se plaignait d'avoir perdu l'appétit, de ne pouvoir digérer au plus qu'une tasse de thé, de loin en loin, Livingstone mangeait aussi, mangeait comme moi, en homme affamé, en estomac vigoureux; et tout en démolissant les gâteaux de viande, il répétait :
- "Vous m'avez rendu la vie, vous m'avez rendu la vie."
- "Oh ! Par George, quel oubli !" m'écriai-je. "Vite Sélim, allez chercher la bouteille; vous savez bien. Vous prendrez les gobelets d'argent."
Sélim revint bientôt avec une bouteille de Sillery que j'avais apportée pour la circonstance; précaution qui m'avait souvent paru superflue. J'emplis jusqu'au bord la timbale de Livingstone, et versai dans la mienne un peu du vin égayant.
- "À votre santé, docteur."
- "À la vôtre, monsieur Stanley."
Et le champagne que j'avais précieusement gardé pour cette heureuse rencontre fut bu, accompagné des vœux les plus cordiaux, les plus sincères.
Nous parlions, nous parlions toujours, les mets ne cessaient pas de venir; tout l'après-midi, il en fut ainsi.
("Comment j'ai retrouvé Livingstone")
- "Good morning, sir !"
Je tourne vivement la tête, cherchant qui a proféré ces paroles; et je vois une figure du plus beau noir, celle d'un homme tout joyeux, portant une longue robe blanche, et coiffé d'un turban de calicot, un morceau de mérikani
autour de sa tête laineuse.
- "Qui diable êtes-vous ?" demandé-je.
- "Je m'appelle Souzi; le domestique du docteur Livingstone", dit-il avec un sourire qui découvrit une double rangée de dents éclatantes.
- "Le docteur est ici ?"
- "Oui, monsieur."
- "Dans le village ?"
- "Oui, monsieur."
- "En êtes-vous sûr ?"
- "Très sûr; je le quitte à l'instant même."
- "Le docteur va bien ?"
- "Non, monsieur."
- "Allez prévenir le docteur."
- "Oui, monsieur."
Et il partit comme une flèche.
Nous étions encore à deux cents pas; la multitude nous empêchait d'avancer. Des Arabes et des Vouangouana écartaient les indigènes pour venir me saluer, car d'après eux j'étais un des leurs.
- "Mais comment avez-vous pu passer ?"
C'était là leur surprise.
Souzi revint bientôt, toujours courant, me prier de lui dire comment on m'appelait. Le docteur, ne voulant pas le croire, lui avait demandé mon nom; et il n'avait su que répondre.
Mais pendant les courses de Souzi, la nouvelle que cette caravane, dont les fusils brûlaient tant de poudre, était bien celle d'un blanc, avait pris de la consistance. Les plus marquants des Arabes du village, Mohammed ben Séli, Séid hen Medjid, Mohammed ben Ghérib, d'autres encore, s'étaient réunis devant la demeure de Livingstone; et ce dernier était venu les rejoindre pour causer de l'événement.
Sur ces entrefaites, la caravane s'arrêta, le Kirangozi en tête, portant sa bannière aussi haut que possible.
- "Je vois le docteur, monsieur", me dit Sélim. "Comme il est vieux !"
Que n'aurais-je pas donné pour avoir un petit coin de désert où, sans être vu, j'aurais pu me livrer à quelque folie : me mordre les mains, faire une culbute, fouetter les arbres; enfin donner cours à la joie qui m'étouffait ! Mon cœur battait à se rompre; mais je ne laissais pas mon visage trahir mon émotion, de peur de nuire à la dignité de ma race.
Prenant alors le parti qui me parut le plus digne, j'écartai la foule, et me dirigeai, entre deux haies de curieux, vers le demi-cercle d'Arabes devant lequel se tenait l'homme à barbe grise.
Tandis que j'avançais lentement, je remarquais sa pâleur et son air de fatigue. Il avait un pantalon gris, un veston rouge et une casquette bleue, à galon d'or fané. J'aurais voulu courir à lui; mais j'étais lâche en présence de cette foule. J'aurais voulu l'embrasser; mais il était anglais, et je ne savais pas comment je serais accueilli.
Je fis donc ce que m'inspiraient la couardise et le faux orgueil : j'approchai d'un pas délibéré, et dis en ôtant mon chapeau :
- "Docteur Livingstone, je présume ?"
- "Oui", répondit-il en soulevant sa casquette, avec un bienveillant sourire.
Nos têtes furent recouvertes, et nos mains se serrèrent.
- "Je remercie Dieu", repris-je, "de ce qu'il m'a permis de vous rencontrer.
- "Je suis heureux", dit-il, "d'être ici pour vous recevoir".
Je me tournai ensuite vers les Arabes, qui m'adressaient leurs yambos, et que le docteur me présenta, chacun par son nom. Puis oubliant la foule, oubliant ceux qui avaient partagé mes périls, je suivis Livingstone.
Il me fit entrer sous sa véranda, simple prolongation de la toiture, et m'invita de la main à prendre le siège dont son expérience du climat d'Afrique lui avait suggéré l'idée : un paillasson posé sur la banquette de terre qui représentait le divan, une peau de chèvre sur le paillasson, et pour dossier, une autre peau de chèvre, clouée à la muraille, afin de se préserver du froid contact du pisé. Je protestai contre l'invitation; mais il ne voulut pas céder; et il fallut obéir.
Nous étions assis tous les deux. Les Arabes se placèrent à notre gauche. En face de nous plus de mille indigènes se pressaient pour nous voir, et commentaient ce fait bizarre de deux hommes blancs se rencontrant à Oujiji, l'un arrivant du Manyéma, ou du couchant, l'autre de l'Ounyanyembé, ce qui était venir de l'est.
L'entretien commença. Quelles furent nos paroles ? Je déclare n'en rien savoir. Des questions réciproques, sans aucun doute.
- "Quel chemin avez-vous pris ?"
- "Où avez-vous été depuis vos dernières lettres ?"
Oui, ce fut notre début, je me le rappelle; mais je ne
saurais dire ni mes réponses, ni les siennes; j'étais trop absorbé. Je me surprenais regardant cet homme merveilleux, le regardant fixement, l'étudiant et l'apprenant par cœur. Chacun des poils de sa barbe grise, chacune de ses rides, la pâleur de ses traits, son air fatigué, empreint d'un léger ennui, m'enseignaient ce que j'avais soif de connaître, depuis le jour où l'on m'avait dit de le retrouver. Que de choses dans ces muets témoignages, que d'intérêt dans cette lecture !
Je l'écoutais en même temps. Ah ! Si vous aviez pu le voir et l'entendre ! Ses lèvres, qui n'ont jamais menti, me donnaient des détails. Je ne peux pas répéter ses paroles, j'étais trop ému pour les sténographier. Il avait tant de choses à dire qu'il commençait par la fin, oubliant qu'il avait à rendre compte de cinq ou six années. Mais le récit débordait, s'élargissant toujours, et devenait une merveilleuse histoire.
Les Arabes se levèrent, comprenant, avec une délicatesse dont je leur sus gré, que nous avions besoin d'être seuls.
Je donnai des ordres pour que mes gens fussent approvisionnés; puis je fis appeler Kéif-Halek, et le présentai au docteur en lui disant que c'était l'un des soldats de sa caravane, restée à Kouihara, soldat que j'avais amené pour qu'il remit en mains propres les dépêches dont il était chargé. C'était le fameux sac, daté du 1er novembre 1870, et qui arrivait trois cent soixante-cinq jours après sa remise au porteur. Combien de temps serait-il resté dans l'Ounyanyembé, si je n'avais pas été envoyé en Afrique ?
Livingstone ouvrit le sac, regarda les lettres qui s'y trouvaient, en prit deux qui étaient de ses enfants, et son visage s'illumina.
Puis il me demanda les nouvelles.
- "D'abord vos lettres, docteur; vous devez être impatient de les lire."
- "Ah !" dit-il, "j'ai attendu des lettres pendant des années j'ai maintenant de la patience; quelques heures de plus ne sont rien. Dites-moi les nouvelles générales; que se passe t-il dans le monde ?"
- "Vous êtes sans doute au courant de certains faits; vous savez, par exemple, que le canal de Suez est ouvert, et que le transit y est régulier entre l'Europe et l'Asie ?"
- "J'ignorais qu'il fût achevé. C'est une grande nouvelle. Après ?"
Et me voilà transformé en annuaire du globe, sans avoir besoin ni d'exagération, ni de remplissage à deux sous la ligne; le monde a vu tant de choses, et tant de choses sur prenantes dans ces dernières années ! Le chemin de fer du Pacifique, Grant président des États-Unis, l'Égypte inondée de savants, la révolte des Crétois, le Danemark démembré, l'armée prussienne à Paris, la dynastie des Napoléon éteinte par Bismarck et par de Moltke, la France vaincue.
Quelle avalanche de faits pour un homme qui sort des forêts vierges du Manyéma ! En écoutant ce récit, l'un des plus émouvants que l'histoire ait jamais permis de faire, le docteur s'était animé; le reflet de la lumière éblouissante que jette la civilisation éclairait son visage.
Combien les petits actes des États barbares pâlissaient devant ceux-là ! Et qui pouvait dire sous quelles nouvelles phases s'agitait l'Europe, tandis que, isolés de tous, deux de ses enfants s'entretenaient de ses dernières gloires, de ses derniers malheurs ? Plus digne de les raconter, peut être, eût été un Démodocus; mais, en l'absence du poète, le reporter s'en acquitta de son mieux et le plus fidèlement possible.
Peu de temps après leur départ, les Arabes nous avaient envoyé leurs présents, sous forme de nourriture : Séid ben Medjid, des gâteaux de viande hachée, espèces de rissoles; Mohammed, un poulet au cari; Moéni, une étuvée de riz et de chèvre. Les dons se succédaient; et, à mesure qu'ils étaient apportés, nous les attaquions énergiquement. J'ai des facultés digestives de premier ordre, que l'exercice avait fortement aiguisées, il n'était pas étonnant que j'en fisse usage. Mais Livingstone, qui se plaignait d'avoir perdu l'appétit, de ne pouvoir digérer au plus qu'une tasse de thé, de loin en loin, Livingstone mangeait aussi, mangeait comme moi, en homme affamé, en estomac vigoureux; et tout en démolissant les gâteaux de viande, il répétait :
- "Vous m'avez rendu la vie, vous m'avez rendu la vie."
- "Oh ! Par George, quel oubli !" m'écriai-je. "Vite Sélim, allez chercher la bouteille; vous savez bien. Vous prendrez les gobelets d'argent."
Sélim revint bientôt avec une bouteille de Sillery que j'avais apportée pour la circonstance; précaution qui m'avait souvent paru superflue. J'emplis jusqu'au bord la timbale de Livingstone, et versai dans la mienne un peu du vin égayant.
- "À votre santé, docteur."
- "À la vôtre, monsieur Stanley."
Et le champagne que j'avais précieusement gardé pour cette heureuse rencontre fut bu, accompagné des vœux les plus cordiaux, les plus sincères.
Nous parlions, nous parlions toujours, les mets ne cessaient pas de venir; tout l'après-midi, il en fut ainsi.
("Comment j'ai retrouvé Livingstone")
Je restai là pendant deux jours. Un de mes hommes, nommé Jako, avait déserté avec l'une de mes carabines; j'avais envoyé à sa recherche; il fallait bien l'attendre; j'en profitai pour explorer les bords du lac.
Jako me fut ramené vers la fin du second jour : il expliqua sa disparition en disant qu'un excès de fatigue l'avait fait s'endormir dans les broussailles, à quelques pas de la route. Mais cette halte en pays de famine, halte forcée dont il était cause, ne m'avait pas disposé à la clémence; et pour prévenir chez lui toute velléité de récidive, je fis ajouter Jako à la chaîne des déserteurs.
Nous perdîmes encore deux ânes, dont l'un fut tué par le poids énorme et par le balancement continu de Farquhar. Celui-ci devenait la risée de la caravane par son complet abandon de lui-même et par ses exigences. Il voulait toujours avoir près de lui cinq ou six personnes qu'il invoquait sans cesse en pleurant, comme un enfant malade. Jako avait été son cuisinier; il l'avait rendu stupide à force de le battre; et mes soldats craignaient tellement sa violence, qu'ils n'osaient pas approcher de lui.
Je supportai cette musique pendant une semaine. Si les ânes ne m'avaient pas manqué, je l'aurais supportée plus longtemps; mais avec le petit nombre de mes baudets, avee leur affaiblissement et un pareil cavalier, c'eût été la ruine de l'expédition que de continuer ainsi. Je pensai done qu'il valait mieux pour nous tous, et pour lui-même, que Farquhar fût laissé à quelque bon chef de village, avec de l'étoffe et des grains de verre pour six mois, pendant lesquels il se remettrait plus facilement qu'en route.
En attendant, il mangeait à ma table ainsi que maître Shaw. Le 15 mai, lorsque mes deux convives furent appelés pour déjeuner, ils arrivèrent avec des figures qui ne présageaient rien de bon. Ni l'un ni l'autre ne répondit au "Good morning" que je leur adressai, et leurs visages se détournèrent pour éviter mon regard. L'idée me vint que la conversation qu'ils venaient d'avoir entre eux, et dont j'avais entendu le bruit, avait roulé sur moi. Néanmoins je les priai de s'asseoir, et je dis à Sélim d'apporter le déjeuner. Le menu se composait d'un quartier de chèvre rôti, d'un foie à l'étuvée, d'une demi-douzaine de patates, d'une assiettée de crêpes et d'une tasse de café.
- "Veuillez découper le rôti et servir Farquhar", dis-je à maître Shaw.
- "Cette viande-là ? Bonne pour les chiens !" s'écria celui-ci, avec la dernière insolence.
- "Que dites-vous ?" Iui demandai-je.
- "Je dis que c'est une honte, monsieur", répondit-il en se tournant vers moi, "une véritable honte que la manière dont vous nous traitez. Je dis que vous m'écrasez de fatigue, que nous pensions avoir des ânes et des serviteurs, et qu'au lieu de cela vous me faites marcher tous les jours, en plein soleil, jusqu'à me faire sentir que j'aimerais mieux être en enfer que dans cette expédition damnée; et je voudrais que tous ceux qui en font partie fussent au diable. Voilà ce que je dis, monsieur."
- "Écoutez-moi, Shaw, et vous aussi, Farquhar. Depuis notre départ jusqu'au moment où nous les avons perdus, vous avez eu des ânes. Les serviteurs ne vous ont pas manqué, on a dressé vos tentes, fait votre cuisine, porté vos bagages. Mes repas ont été les vôtres; à cet égard, pas de différence entre vous et moi. Aujourd'hui, les ânes nous manquent; tous ceux de Farquhar sont morts; j'en ai perdu sept, et les autres faiblissent. Il m'a fallu jeter divers objets qui faisaient partie de leur charge. Bientôt il ne m'en restera plus; il faudra les remplacer, louer de nouveaux pagazis : une dépense énorme. Et c'est en face d'un pareil état de choses que vous osez vous plaindre, vous emporter, me maudire à ma propre table ! Rappelez-vous donc le pays où vous êtes, et votre qualité de serviteurs; je ne suis pas votre compagnon."
- "Au diable le..."
Avant qu'il eût fini sa phrase, maître Shaw était par terre.
- "Faut-il continuer la leçon ?" lui demandai-je.
- "Monsieur", répondit Shaw en se relevant, "permettez moi de vous dire : le mieux est que je m'en aille. J'en ai assez et je n'irai pas plus loin. Veuillez me donner mon congé."
- "Oh ! Certainement."
J'appelai Bombay :
- "Cet homme veut partir", lui dis-je. "Pliez sa tente, apportez-moi ses armes; prenez ses effets, et conduisez-le à deux cents mètres du camp où vous le laisserez avec ses bagages."
Peu de temps après, Bombay avait exécuté mes ordres et revenait avee quatre soldats.
- "Maintenant, monsieur", dis-je à mon contremaître, "vous pouvez partir; vous êtes libre."
Il se leva et sortit avec l'escorte.
Après le déjeuner, je démontrai à Farquhar la nécessité d'une marche rapide et le besoin, pour moi, de n'avoir pas d'entraves. Nous allions franchir un désert où l'on ne fait pas de halte; que deviendrait-il si je n'avais pas de monture à lui donner ? Sa maladie pouvait durer longtemps. Ne serait-il pas plus sage de le laisser dans un endroit paisible, sous la protection d'un bon chef, qui, moyennant un prix quelconque, veillerait sur lui jusqu'au moment où il pourrait regagner la côte, avec les gens d'un Arabe ? Il en convint et approuva cette résolution.
L'entretien n'était pas fini, lorsque Bombay reparut en me disant que maître Shaw désirait me parler.
Je me rendis à l'entrée du camp où je trouvai Shaw qui, air confus et plein de repentir, me demanda pardon et me supplia de le reprendre, en m'assurant que désormais je n'aurais aucun reproche à lui faire.
Je lui tendis la main.
- "Cher camarade", lui dis-je, "ne parlons plus de tout cela. Il n'est pas de famille qui n'ait ses querelles; dès que vous m'offrez vos excuses, tout est
fini; soyez-en convaincu".
Le soir, au moment où je commençais à dormir, j'entendis un coup de feu et le sifflement d'une balle qui traversait ma tente à quelques pouces de moi. Je saisis mes revolvers et me précipitai au-dehors.
- "Qui vient de tirer ?" demandai-je aux sentinelles. Tout le monde était debout, chacun plus ou moins ému.
L'un des hommes répondit :
- « C'est Bwana Mdogo, le Petit Maître."
J'allumai une bougie et me dirigeai vers la tente du Bwana.
- "Est-ce vous qui avez tiré, Shaw ?"
Pas de réponse; il paraissait dormir et affectait de ronfler.
- "Shaw ! Shaw ! Est-ce vous qui avez tiré ce coup de feu ?"
- "Moi ?" dit-il en s'éveillant; "Moi ? Un coup de feu ? Je dormais."
Mes yeux tombèrent sur son fusil qui était à côté de lui. Je pris cette arme : le canon était chaud; j'y introduisis le petit doigt et l'en retirai noirci par la poudre.
- "Qu'est-ce que c'est que cela ?" demandai-je au dormeur. "Le fusil est chaud, et les hommes disent que c'est vous qui avez tiré".
- "Ah !... Oui", répondit-il. "Je me rappelle; j'ai rêvé qu'un voleur passait ma porte; et j'ai tiré; c'est vrai, je l'avais oublié. J'ai tiré, mais après ? De quoi s'agit-il ?"
- "De rien", répliquai-je. "Seulement, je vous conseille à l'avenir, pour éviter les soupçons, de ne pas tirer dans ma tente ou dans mon voisinage; je pourrais être blessé; dans ce cas-là, de mauvais rapports ne manqueraient pas de se faire et vous en devinez les conséquences. Bonsoir."
Il ne fut plus question de l'incident; la première fois que j'en ouvris la bouche, ce fut pour le raconter à Livingstone.
- "Il voulait vous tuer !" s'écria celui-ci, donnant un corps à mes soupçons.
Mais quelle stupidité que ce meurtre ! Assurément, s'il m'avait tué, mes hommes l'en auraient puni à l'instant même ; et s'il voulait se défaire de moi, il en aurait eu, pendant la marche, des occasions cent fois meilleures. Je ne peux m'expliquer le fait que par un accès de folie.
("Comment j'ai retrouvé Livingstone")
Jako me fut ramené vers la fin du second jour : il expliqua sa disparition en disant qu'un excès de fatigue l'avait fait s'endormir dans les broussailles, à quelques pas de la route. Mais cette halte en pays de famine, halte forcée dont il était cause, ne m'avait pas disposé à la clémence; et pour prévenir chez lui toute velléité de récidive, je fis ajouter Jako à la chaîne des déserteurs.
Nous perdîmes encore deux ânes, dont l'un fut tué par le poids énorme et par le balancement continu de Farquhar. Celui-ci devenait la risée de la caravane par son complet abandon de lui-même et par ses exigences. Il voulait toujours avoir près de lui cinq ou six personnes qu'il invoquait sans cesse en pleurant, comme un enfant malade. Jako avait été son cuisinier; il l'avait rendu stupide à force de le battre; et mes soldats craignaient tellement sa violence, qu'ils n'osaient pas approcher de lui.
Je supportai cette musique pendant une semaine. Si les ânes ne m'avaient pas manqué, je l'aurais supportée plus longtemps; mais avec le petit nombre de mes baudets, avee leur affaiblissement et un pareil cavalier, c'eût été la ruine de l'expédition que de continuer ainsi. Je pensai done qu'il valait mieux pour nous tous, et pour lui-même, que Farquhar fût laissé à quelque bon chef de village, avec de l'étoffe et des grains de verre pour six mois, pendant lesquels il se remettrait plus facilement qu'en route.
En attendant, il mangeait à ma table ainsi que maître Shaw. Le 15 mai, lorsque mes deux convives furent appelés pour déjeuner, ils arrivèrent avec des figures qui ne présageaient rien de bon. Ni l'un ni l'autre ne répondit au "Good morning" que je leur adressai, et leurs visages se détournèrent pour éviter mon regard. L'idée me vint que la conversation qu'ils venaient d'avoir entre eux, et dont j'avais entendu le bruit, avait roulé sur moi. Néanmoins je les priai de s'asseoir, et je dis à Sélim d'apporter le déjeuner. Le menu se composait d'un quartier de chèvre rôti, d'un foie à l'étuvée, d'une demi-douzaine de patates, d'une assiettée de crêpes et d'une tasse de café.
- "Veuillez découper le rôti et servir Farquhar", dis-je à maître Shaw.
- "Cette viande-là ? Bonne pour les chiens !" s'écria celui-ci, avec la dernière insolence.
- "Que dites-vous ?" Iui demandai-je.
- "Je dis que c'est une honte, monsieur", répondit-il en se tournant vers moi, "une véritable honte que la manière dont vous nous traitez. Je dis que vous m'écrasez de fatigue, que nous pensions avoir des ânes et des serviteurs, et qu'au lieu de cela vous me faites marcher tous les jours, en plein soleil, jusqu'à me faire sentir que j'aimerais mieux être en enfer que dans cette expédition damnée; et je voudrais que tous ceux qui en font partie fussent au diable. Voilà ce que je dis, monsieur."
- "Écoutez-moi, Shaw, et vous aussi, Farquhar. Depuis notre départ jusqu'au moment où nous les avons perdus, vous avez eu des ânes. Les serviteurs ne vous ont pas manqué, on a dressé vos tentes, fait votre cuisine, porté vos bagages. Mes repas ont été les vôtres; à cet égard, pas de différence entre vous et moi. Aujourd'hui, les ânes nous manquent; tous ceux de Farquhar sont morts; j'en ai perdu sept, et les autres faiblissent. Il m'a fallu jeter divers objets qui faisaient partie de leur charge. Bientôt il ne m'en restera plus; il faudra les remplacer, louer de nouveaux pagazis : une dépense énorme. Et c'est en face d'un pareil état de choses que vous osez vous plaindre, vous emporter, me maudire à ma propre table ! Rappelez-vous donc le pays où vous êtes, et votre qualité de serviteurs; je ne suis pas votre compagnon."
- "Au diable le..."
Avant qu'il eût fini sa phrase, maître Shaw était par terre.
- "Faut-il continuer la leçon ?" lui demandai-je.
- "Monsieur", répondit Shaw en se relevant, "permettez moi de vous dire : le mieux est que je m'en aille. J'en ai assez et je n'irai pas plus loin. Veuillez me donner mon congé."
- "Oh ! Certainement."
J'appelai Bombay :
- "Cet homme veut partir", lui dis-je. "Pliez sa tente, apportez-moi ses armes; prenez ses effets, et conduisez-le à deux cents mètres du camp où vous le laisserez avec ses bagages."
Peu de temps après, Bombay avait exécuté mes ordres et revenait avee quatre soldats.
- "Maintenant, monsieur", dis-je à mon contremaître, "vous pouvez partir; vous êtes libre."
Il se leva et sortit avec l'escorte.
Après le déjeuner, je démontrai à Farquhar la nécessité d'une marche rapide et le besoin, pour moi, de n'avoir pas d'entraves. Nous allions franchir un désert où l'on ne fait pas de halte; que deviendrait-il si je n'avais pas de monture à lui donner ? Sa maladie pouvait durer longtemps. Ne serait-il pas plus sage de le laisser dans un endroit paisible, sous la protection d'un bon chef, qui, moyennant un prix quelconque, veillerait sur lui jusqu'au moment où il pourrait regagner la côte, avec les gens d'un Arabe ? Il en convint et approuva cette résolution.
L'entretien n'était pas fini, lorsque Bombay reparut en me disant que maître Shaw désirait me parler.
Je me rendis à l'entrée du camp où je trouvai Shaw qui, air confus et plein de repentir, me demanda pardon et me supplia de le reprendre, en m'assurant que désormais je n'aurais aucun reproche à lui faire.
Je lui tendis la main.
- "Cher camarade", lui dis-je, "ne parlons plus de tout cela. Il n'est pas de famille qui n'ait ses querelles; dès que vous m'offrez vos excuses, tout est
fini; soyez-en convaincu".
Le soir, au moment où je commençais à dormir, j'entendis un coup de feu et le sifflement d'une balle qui traversait ma tente à quelques pouces de moi. Je saisis mes revolvers et me précipitai au-dehors.
- "Qui vient de tirer ?" demandai-je aux sentinelles. Tout le monde était debout, chacun plus ou moins ému.
L'un des hommes répondit :
- « C'est Bwana Mdogo, le Petit Maître."
J'allumai une bougie et me dirigeai vers la tente du Bwana.
- "Est-ce vous qui avez tiré, Shaw ?"
Pas de réponse; il paraissait dormir et affectait de ronfler.
- "Shaw ! Shaw ! Est-ce vous qui avez tiré ce coup de feu ?"
- "Moi ?" dit-il en s'éveillant; "Moi ? Un coup de feu ? Je dormais."
Mes yeux tombèrent sur son fusil qui était à côté de lui. Je pris cette arme : le canon était chaud; j'y introduisis le petit doigt et l'en retirai noirci par la poudre.
- "Qu'est-ce que c'est que cela ?" demandai-je au dormeur. "Le fusil est chaud, et les hommes disent que c'est vous qui avez tiré".
- "Ah !... Oui", répondit-il. "Je me rappelle; j'ai rêvé qu'un voleur passait ma porte; et j'ai tiré; c'est vrai, je l'avais oublié. J'ai tiré, mais après ? De quoi s'agit-il ?"
- "De rien", répliquai-je. "Seulement, je vous conseille à l'avenir, pour éviter les soupçons, de ne pas tirer dans ma tente ou dans mon voisinage; je pourrais être blessé; dans ce cas-là, de mauvais rapports ne manqueraient pas de se faire et vous en devinez les conséquences. Bonsoir."
Il ne fut plus question de l'incident; la première fois que j'en ouvris la bouche, ce fut pour le raconter à Livingstone.
- "Il voulait vous tuer !" s'écria celui-ci, donnant un corps à mes soupçons.
Mais quelle stupidité que ce meurtre ! Assurément, s'il m'avait tué, mes hommes l'en auraient puni à l'instant même ; et s'il voulait se défaire de moi, il en aurait eu, pendant la marche, des occasions cent fois meilleures. Je ne peux m'expliquer le fait que par un accès de folie.
("Comment j'ai retrouvé Livingstone")
Halimah, la ménagère du docteur, n'en revenait pas. Elle qui avait eu peur que son maître n'appréciât jamais ses talents culinaires, faute de le pouvoir ! Et le voilà qui mangeait, mangeait, mangeait encore ! Son ravissement tenait du délire.
Nous entendions sa langue courir à toute vapeur, rouler et claquer, pour transmettre à la foule le fait incroyable dont elle l'ébahissait.
J'étais arrivé à une entière réplétion; et Livingstone finit par convenir qu'il avait assez mangé. Nous continuâmes à parler de choses et d'autres, principalement de la déception qu'il avait éprouvée lorsque, en arrivant à Oujiji, il s'était vu sans ressources. En outre, une dysenterie fort grave l'avait mis dans un état déplorable; et depuis trois semaines qu'il était là, c'était à peine si l'amélioration était sensible. Toutefois, il avait bien mangé, et se trouvait déjà plus fort.
Comme tous les autres, cet heureux jour finit par s'éteindre. Nous regardions, tout en causant, l'ombre envahir les palmiers, ramper au flanc des montagnes que j'avais franchies le matin, et qui s'effaçaient rapidement. Pleins de gratitude pour Celui qui dispense tout bonheur, nous écoutions le roulement des vagues et tous les bruits du soir.
Des heures passèrent; nous étions toujours là, l'esprit occupé des événements du jour. Tout à coup, je me rappelai ses dépêches, qu'il n'avait pas lues.
- "Docteur", lui dis-je, "et vos lettres ? Je ne vous retiens pas plus longtemps."
- "Oui", répondit-il, "je vais les lire. Il est tard. Bonsoir, et que Dieu vous comble de ses bénédictions."
- "Bonne nuit, docteur; permettez-moi d'espérer que les nouvelles que vous allez apprendre seront au gré de vos désirs."
Et maintenant, lecteur, que vous savez comment j'ai retrouvé Livingstone, à vous aussi, je souhaite le bonsoir.
("Comment j'ai retrouvé Livingstone")
Nous entendions sa langue courir à toute vapeur, rouler et claquer, pour transmettre à la foule le fait incroyable dont elle l'ébahissait.
J'étais arrivé à une entière réplétion; et Livingstone finit par convenir qu'il avait assez mangé. Nous continuâmes à parler de choses et d'autres, principalement de la déception qu'il avait éprouvée lorsque, en arrivant à Oujiji, il s'était vu sans ressources. En outre, une dysenterie fort grave l'avait mis dans un état déplorable; et depuis trois semaines qu'il était là, c'était à peine si l'amélioration était sensible. Toutefois, il avait bien mangé, et se trouvait déjà plus fort.
Comme tous les autres, cet heureux jour finit par s'éteindre. Nous regardions, tout en causant, l'ombre envahir les palmiers, ramper au flanc des montagnes que j'avais franchies le matin, et qui s'effaçaient rapidement. Pleins de gratitude pour Celui qui dispense tout bonheur, nous écoutions le roulement des vagues et tous les bruits du soir.
Des heures passèrent; nous étions toujours là, l'esprit occupé des événements du jour. Tout à coup, je me rappelai ses dépêches, qu'il n'avait pas lues.
- "Docteur", lui dis-je, "et vos lettres ? Je ne vous retiens pas plus longtemps."
- "Oui", répondit-il, "je vais les lire. Il est tard. Bonsoir, et que Dieu vous comble de ses bénédictions."
- "Bonne nuit, docteur; permettez-moi d'espérer que les nouvelles que vous allez apprendre seront au gré de vos désirs."
Et maintenant, lecteur, que vous savez comment j'ai retrouvé Livingstone, à vous aussi, je souhaite le bonsoir.
("Comment j'ai retrouvé Livingstone")
Il nous fut impossible de partir le lendemain; et six des Makololos, voulant essayer leurs mousquets, allèrent à la recherche d'un éléphant. Ils rencontrèrent une bande de femelles avec leurs éléphanteaux. Dès que la première de la troupe eut découvert les chasseurs qui se trouvaient sur les rochers, d'où ils la dominaient, elle plaça, avec un instinct vraiment maternel, son petit entre ses jambes de devant, afin de le protéger. "Il faut tous envoyer nos balles à celle-là", cria Mantlanyané. La pauvre bête reçut une volée d'artillerie, et s'enfuit dans la plaine où elle fut achevée par une nouvelle décharge. Quant à l'éléphanteau, il s'échappa et disparut avec les autres.
Nos chasseurs, ivres de joie, dansèrent autour du corps de la reine des forêts en poussant des acclamations, mêlées à des chants de triomphe. Ils prirent la queue, plus un morceau de la trompe, et revinrent au camp, où ils entrèrent le front haut, d'un pas militaire, et se sentant grandis de plusieurs coudées.
La femme de Sandia fut immédiatement informée de leur succès, attendu que, suivant la loi du pays, la moitié de l'éléphant appartient au chef du district où l'animal est tombé. Les Portugais se soumettent toujours à cette loi; fût-elle d'ailleurs de création indigène qu'on ne pourrait guère la taxer d'injustice. Elle fit prévenir son mari, et nous dit qu'il reviendrait bientôt; elle ajouta qu'elle allait envoyer plusieurs de ses gens pour aider nos hommes à dépecer l'animal, et qu'ils recevraient la part que nous voudrions bien leur donner. Nous accompagnâmes nos chasseurs à l'endroit où ils avaient laissé la bête. C'était une belle vallée, couverte de grandes herbes. On trouva l'animal intact : une masse énorme de viande.
Le partage d'un éléphant, en pareil cas, est un spectacle des plus curieux. Les hommes, rangés autour de la bête, gardent un profond silence, tandis que le chef des voyageurs déclare qu'en vertu d'une ancienne coutume, la tête et la jambe de devant, du côté droit, appartiennent à celui qui a tué l'animal, c'est-à-dire qui l'a blessé le premier; que la jambe gauche est à celui qui a fait la seconde blessure, ou qui, le premier, a touché la bête après que celle-ci soit tombée; que le morceau qui entoure l'œil se donne au chef des étrangers; et que certaines parts reviennent aux chefs des feux, c'est-à-dire des différents groupes qui forment le camp. Il recommande surtout de réserver la graisse et les entrailles pour une seconde distribution.
Dès que ce discours est terminé, les indigènes fondent sur la proie en criant, et, s'animant de plus en plus, jettent des clameurs sauvages, tout en découpant la bête avec leurs grandes lances, dont les longues hampes s'agitent dans l'air au-dessus de leurs têtes. Enfin, leur exaltation, plus forte de moment en moment, arrive au comble lorsque la masse énorme est ouverte, ainsi que l'annonce le rugissement des gaz qui s'en échappent. Quelques-uns s'élancent dans le coffre béant, s'y roulent çà et là, dans leur ardeur à saisir la graisse précieuse; tandis que leurs camarades s'éloignent en courant, chargés de viande saignante, la jettent sur l'herbe, et reviennent en chercher d'autre, tous parlant et hurlant sur le ton le plus aigu qu'il leur soit possible d'atteindre. Trois ou quatre, au mépris de toutes les lois, saisissent le même morceau qu'ils se disputent brièvement. De temps à autre s'élève un cri de douleur : un homme, dont la main a reçu un coup de lance d'un ami frénétique, surgit de la masse grouillante qui remplit la bête et qui la recouvre. Il faut alors un morceau d'étoffe, et de bonnes paroles, pour éviter la querelle. Toutefois, l'œuvre continue, et, dans un espace de temps incroyablement court, plusieurs tonnes de viande sont détaillées, et les morceaux rangés en différents tas.
Peu de temps après la division de la bête, arriva Sandia : un vieillard portant une perruque de filasse d'ifé, teinte en noir et d'un lustre brillant. Il avait au cou son mosaméla, qui lui pendait dans le dos, et ressemblait exactement à celui des Égyptiens d'autrefois. Le mosaméla, espèce de petit tabouret en bois sculpté qui sert d'oreiller, s'emporte ordinairement dans les expéditions de chasse, de même que la natte où l'on s'étend pour dormir.
Le chef visita les feux de nos hommes et accepta la viande que ceux-ci lui donnèrent; mais il se réserva de la manger avec ses anciens; il voulait les consulter, ne sachant pas trop s'il devait recevoir la moitié de notre éléphant. Ses ministres ne voyant pas de motif pour se départir de la règle établie, décidèrent qu'il fallait traiter les payeurs blancs sur le même pied que les noirs, et prendre la part qui revenait au trésor.
Sandia revint dans l'après-midi avec ses conseillers; il était accompagné de son épouse et suivi de plusieurs femmes qui apportaient cinq pots de bière; trois dont il nous faisait présent et deux qui étaient à vendre.
Nous eûmes pour nous le pied de la bête, que l'on nous accommoda à la mode du pays. Un grand trou fut creusé dans le sol, on y fit du feu; quand l'intérieur eut le degré de chaleur voulu, on y plaça l'énorme pied, que l'on recouvrit de cendres chaudes, ensuite de terre, et l'on fit sur le tout un bon feu qui brûla toute la nuit. Le lendemain matin, le pied nous fut servi à déjeuner : il était parfait. C'est une masse blanchâtre, un peu gélatineuse, et qui ressemble à de la moelle. Après un repas de pied d'éléphant, il est sage de faire une longue course pour éviter un mouvement de bile.
La trompe et la langue sont aussi de bons morceaux; mises à l'étuvée et cuites à point, elles se rapprochent beaucoup de la langue de bœuf et de la bosse de bison. Tout le reste est coriace et d'un tel fumet que, pour le manger, il faut avoir grand-faim.
La quantité de viande que nos gens consomment en pareille occasion est vraiment prodigieuse. Ils en font bouillir autant qu'il peut en tenir dans leurs marmites, et en avalent jusqu'à ce qu'il leur soit physiquement impossible d'en loger davantage. Vient ensuite une danse tumultueuse, accompagnée de chants de stentors. Dès qu'ils ont secoué le premier service et lavé la sueur et la poussière dont la danse les a revêtus, ils s'occupent du rôti et le font disparaître. Ils se couchent, se relèvent bientôt pour remplir la marmite; et la nuit tout entière se passe à faire bouillir et à manger, à faire rôtir et à dévorer, sans autre intervalle que de courts instants de sommeil.
("Exploration du Zambèze et de ses Affluents")
Nos chasseurs, ivres de joie, dansèrent autour du corps de la reine des forêts en poussant des acclamations, mêlées à des chants de triomphe. Ils prirent la queue, plus un morceau de la trompe, et revinrent au camp, où ils entrèrent le front haut, d'un pas militaire, et se sentant grandis de plusieurs coudées.
La femme de Sandia fut immédiatement informée de leur succès, attendu que, suivant la loi du pays, la moitié de l'éléphant appartient au chef du district où l'animal est tombé. Les Portugais se soumettent toujours à cette loi; fût-elle d'ailleurs de création indigène qu'on ne pourrait guère la taxer d'injustice. Elle fit prévenir son mari, et nous dit qu'il reviendrait bientôt; elle ajouta qu'elle allait envoyer plusieurs de ses gens pour aider nos hommes à dépecer l'animal, et qu'ils recevraient la part que nous voudrions bien leur donner. Nous accompagnâmes nos chasseurs à l'endroit où ils avaient laissé la bête. C'était une belle vallée, couverte de grandes herbes. On trouva l'animal intact : une masse énorme de viande.
Le partage d'un éléphant, en pareil cas, est un spectacle des plus curieux. Les hommes, rangés autour de la bête, gardent un profond silence, tandis que le chef des voyageurs déclare qu'en vertu d'une ancienne coutume, la tête et la jambe de devant, du côté droit, appartiennent à celui qui a tué l'animal, c'est-à-dire qui l'a blessé le premier; que la jambe gauche est à celui qui a fait la seconde blessure, ou qui, le premier, a touché la bête après que celle-ci soit tombée; que le morceau qui entoure l'œil se donne au chef des étrangers; et que certaines parts reviennent aux chefs des feux, c'est-à-dire des différents groupes qui forment le camp. Il recommande surtout de réserver la graisse et les entrailles pour une seconde distribution.
Dès que ce discours est terminé, les indigènes fondent sur la proie en criant, et, s'animant de plus en plus, jettent des clameurs sauvages, tout en découpant la bête avec leurs grandes lances, dont les longues hampes s'agitent dans l'air au-dessus de leurs têtes. Enfin, leur exaltation, plus forte de moment en moment, arrive au comble lorsque la masse énorme est ouverte, ainsi que l'annonce le rugissement des gaz qui s'en échappent. Quelques-uns s'élancent dans le coffre béant, s'y roulent çà et là, dans leur ardeur à saisir la graisse précieuse; tandis que leurs camarades s'éloignent en courant, chargés de viande saignante, la jettent sur l'herbe, et reviennent en chercher d'autre, tous parlant et hurlant sur le ton le plus aigu qu'il leur soit possible d'atteindre. Trois ou quatre, au mépris de toutes les lois, saisissent le même morceau qu'ils se disputent brièvement. De temps à autre s'élève un cri de douleur : un homme, dont la main a reçu un coup de lance d'un ami frénétique, surgit de la masse grouillante qui remplit la bête et qui la recouvre. Il faut alors un morceau d'étoffe, et de bonnes paroles, pour éviter la querelle. Toutefois, l'œuvre continue, et, dans un espace de temps incroyablement court, plusieurs tonnes de viande sont détaillées, et les morceaux rangés en différents tas.
Peu de temps après la division de la bête, arriva Sandia : un vieillard portant une perruque de filasse d'ifé, teinte en noir et d'un lustre brillant. Il avait au cou son mosaméla, qui lui pendait dans le dos, et ressemblait exactement à celui des Égyptiens d'autrefois. Le mosaméla, espèce de petit tabouret en bois sculpté qui sert d'oreiller, s'emporte ordinairement dans les expéditions de chasse, de même que la natte où l'on s'étend pour dormir.
Le chef visita les feux de nos hommes et accepta la viande que ceux-ci lui donnèrent; mais il se réserva de la manger avec ses anciens; il voulait les consulter, ne sachant pas trop s'il devait recevoir la moitié de notre éléphant. Ses ministres ne voyant pas de motif pour se départir de la règle établie, décidèrent qu'il fallait traiter les payeurs blancs sur le même pied que les noirs, et prendre la part qui revenait au trésor.
Sandia revint dans l'après-midi avec ses conseillers; il était accompagné de son épouse et suivi de plusieurs femmes qui apportaient cinq pots de bière; trois dont il nous faisait présent et deux qui étaient à vendre.
Nous eûmes pour nous le pied de la bête, que l'on nous accommoda à la mode du pays. Un grand trou fut creusé dans le sol, on y fit du feu; quand l'intérieur eut le degré de chaleur voulu, on y plaça l'énorme pied, que l'on recouvrit de cendres chaudes, ensuite de terre, et l'on fit sur le tout un bon feu qui brûla toute la nuit. Le lendemain matin, le pied nous fut servi à déjeuner : il était parfait. C'est une masse blanchâtre, un peu gélatineuse, et qui ressemble à de la moelle. Après un repas de pied d'éléphant, il est sage de faire une longue course pour éviter un mouvement de bile.
La trompe et la langue sont aussi de bons morceaux; mises à l'étuvée et cuites à point, elles se rapprochent beaucoup de la langue de bœuf et de la bosse de bison. Tout le reste est coriace et d'un tel fumet que, pour le manger, il faut avoir grand-faim.
La quantité de viande que nos gens consomment en pareille occasion est vraiment prodigieuse. Ils en font bouillir autant qu'il peut en tenir dans leurs marmites, et en avalent jusqu'à ce qu'il leur soit physiquement impossible d'en loger davantage. Vient ensuite une danse tumultueuse, accompagnée de chants de stentors. Dès qu'ils ont secoué le premier service et lavé la sueur et la poussière dont la danse les a revêtus, ils s'occupent du rôti et le font disparaître. Ils se couchent, se relèvent bientôt pour remplir la marmite; et la nuit tout entière se passe à faire bouillir et à manger, à faire rôtir et à dévorer, sans autre intervalle que de courts instants de sommeil.
("Exploration du Zambèze et de ses Affluents")
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de David Livingstone (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La Passe-miroir 1.Les fiancés de l'hiver
Quel est le tout premier golem d'Ophélie ?
Ses gants
Son écharpe
Ses lunettes
Un miroir de poche
13 questions
930 lecteurs ont répondu
Thème : La passe-miroir, tome 1 : Les fiancés de l'hiver de
Christelle DabosCréer un quiz sur ce livre930 lecteurs ont répondu