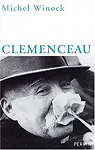En lien avec l'exposition «La France sous leurs yeux. 200 regards de photographes sur les années 2020», une table ronde réunit quatre auteurs qui échangent sur les nouvelles représentations de la France contemporaine.
Quatre auteurs ont été invités à regarder les travaux produits par les 200 photographes de la grande commande nationale pour le photojournalisme et à rédiger quatre essais dédiés chacun à une notion de la devise nationale, convoquant journalisme (Liberté par Pierre Haski, journaliste), philosophie (Fraternité par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste), histoire (Égalité par Judith Rainhorn, historienne, et Potentialités par Pierre Charbonnier, philosophe). Ils échangeront sur les nouvelles représentations de la France contemporaine.
Table ronde animée par Sonia Devillers, France Inter, membre du jury de la grande commande pour le photojournalisme
Plus d'informations sur l'exposition «La France sous leurs yeux. 200 regards de photographes sur les années 2020» : https://www.bnf.fr/fr/agenda/la-france-sous-leurs-yeux

Judith Rainhorn/5
3 notes
Résumé :
Les substances toxiques peuplent notre monde, elles ont conquis l’air ambiant et envahi l’espace domestique. Nourriture, emballages alimentaires, textiles, produits cosmétiques, peintures... Pas un domaine de la vie quotidienne n’échappe à la myriade de poisons, cancérogènes ou perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés. Chacun le sait et, pourtant, y consent.
Pour comprendre les raisons de cet accommodement collectif, l’historienne Judith Rainhor... >Voir plus
Pour comprendre les raisons de cet accommodement collectif, l’historienne Judith Rainhor... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Blanc de plomb : Histoire d'un poison légalVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
J'ai reçu ce livre dans le cadre de la masse critique de juin 2019 et je l'avais sélectionné en raison de mon intérêt général pour les questions de santé publique. Je n'ai pas été déçue et je remercie beaucoup Babelio et les Presses de Sciences Po de me l'avoir envoyé.
Judith Rainhorn présente une histoire chronologique du blanc de plomb du 18ème siècle à nos jours. Le blanc de plomb ou céruse est un produit dont la toxicité est connue depuis bien longtemps et qui est à l'origine, comme tous les dérivés du plomb, du saturnisme, terrible maladie provoquant coliques, immenses douleurs, paralysies et pouvant mener à la mort. Ceci n'a pas empêché l'utilisation massive de la céruse à partir du 19ème siècle, en particulier dans la peinture, et le développement d'une production industrielle du produit. Les ouvriers des ateliers de production, les peintres en bâtiment et également des ouvriers d'autres métiers sont largement touchés par l'intoxication au plomb. Il existe pourtant un produit de substitution mais qui a du mal à s'imposer tellement la céruse a de défenseurs. Il faut attendre 1919 et bien des rebondissements pour voir l'interdiction de l'utilisation de la céruse en France dans la peinture. Cette décision ne signe pourtant pas sa disparition puisque la céruse réapparaît régulièrement et ce jusque dans les années 1980 avec l'intoxication d'enfants habitant des logements insalubres.
L'étude de Judith Rainhorn retrace ainsi l'histoire de ce produit et des combats menés par ces défenseurs et ces opposants. le sujet est à la croisée de nombreux domaines qui sont tous traités : l'histoire bien sûr mais aussi l'économie, la sociologie, la politique, la médecine, la chimie, le droit, la technologie. Son travail est remarquable de rigueur et de précision. Chaque idée, chaque propos, chaque argument trouvé dans les sources, même et surtout les plus communément admis ou répétés au fil des textes et publications, est passé à la loupe des faits, d'autres sources et de la critique scientifique historique. Le tout est remis dans le contexte général des découvertes, des luttes, des lois sur le travail, la santé et les toxiques. C'est donc un travail académique méticuleux et approfondi qu'elle présente mais qui n'a rien de froid. Il laisse transparaître une grande colère plus que justifiée qui ne prend pourtant jamais le pas sur l'honnêteté du travail de recherche.
En effet, à travers cette histoire ancienne (du moins pour la France) de l'intoxication au plomb, comment ne pas reconnaître nos débats actuels autour d'autres produits toxiques qui ont investi notre quotidien ? On retrouve dans ce récit des personnages et des événements qui sont très contemporains. En voici quelques exemples :
Des industriels cyniques qui n'ont que peu de considération pour la vie des ouvriers, qui piétinent l'humain mais qui arrivent dans le discours à se parer des habits de la générosité, de l'altruisme et de l'honnêteté.
Des scientifiques lanceurs d'alerte attaqués par des experts à la solde des industriels qui remettent en cause les études et qui sont capables de tenir des discours surréalistes (« ce n'est pas si dangereux », « tout cela est fortement exagéré », etc.), instillant ainsi le doute.
Des politiques d'une cécité coupable, toujours en retard et qui attendent de voir de quel côté va pencher la balance mais qui ont l'art de présenter leurs prises de position et leurs décisions comme novatrices alors qu'elles sont seulement opportunistes.
La collusion entre industriels, experts et agents publics pour la protection des intérêts privés avant celle de la santé publique.
La menace, si on interdisait le produit, de la faillite économique, de l'effondrement du pays, de l'attaque de puissances étrangères (car le poison est quand même toujours beaucoup plus sympa quand il est bien de chez nous).
Des débats et des processus législatifs à n'en plus finir qui oublient l'essentiel : pendant ce temps, on meurt au travail.
De gros rapports de commissions d'enquête avec plein de chiffres, de tableaux et de témoignages mais qui ne résistent pas aujourd'hui à l'analyse historique et se révèlent n'être que calomnies, mauvaise foi et négation des faits et de la science.
Des arguments de sécurité (« Tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité des ouvriers, de l'environnement… ») et de longues recommandations de bonnes pratiques censées changer la donne mais dont personne ne surveille l'application réelle sur le terrain.
La culpabilisation de l'ouvrier, dont la maladie ne vient pas de son travail (quelle idée saugrenue !) mais de sa vie dissolue, de son incapacité et de sa réticence à se protéger au travail.
La manipulation de l'opinion publique par la mise en avant de faits divers émouvants et par la construction d'une image du produit rarement basée sur la réalité.
La difficulté à mobiliser et à faire se rejoindre les luttes car le problème se retrouve souvent segmenté et permet l'effacement de la vision d'ensemble du problème (à savoir ici, la dangerosité bien connue et intrinsèque du produit). Etc.
Tout cela sonne terriblement familier et c'est bien là le but du propos de Judith Rainhorn. Comme elle l'écrit dans l'épilogue, l'histoire de la céruse est avant tout celle d'un échec assez effrayant. Comment ce produit dont la toxicité est avérée et pour lequel il existe des solutions de substitution a-t-il pu se maintenir si longtemps sur le marché ? C'est bien sûr la responsabilité des acteurs cités précédemment. Mais pas seulement. C'est aussi la responsabilité collective de la société qui accepte de vivre avec le risque toxique et qui consent à son propre empoisonnement. Judith Rainhorn montre en effet comment l'enchevêtrement des événements de l'histoire de la céruse a mené à l'accommodement collectif au produit toxique. Il a également entraîné une amnésie régulière, des dénis et des oublis plus ou moins organisés du problème, avec des bégaiements de l'histoire et des résurgences momentanées. Ce livre nous interroge donc au niveau individuel et sociétal sur le risque avec lequel nous acceptons de vivre malgré notre degré de connaissance qui peut être assez élevé. Il est clairement démontré ici que le savoir ne mène pas toujours à l'action et que la collectivité s'accommode de la dangerosité d'un produit, entraînant ainsi son maintien dans l'environnement, et préfère gérer le risque plutôt que de le prévenir.
Ce livre nous invite, à travers cette histoire, à regarder le passé pour porter un regard neuf sur notre actualité et à peut-être en tirer des leçons. A la lecture et avec le recul, cette histoire est énervante et absurde. Que de perte de temps aux conséquences dramatiques. Et pourtant, c'est notre quotidien pour d'autres produits toxiques avec lesquels nous choisissons de vivre. Serons-nous plus vigilants et plus rapides pour agir ? Ou aurons-nous dans deux siècles une Judith Rainhorn du futur pour démontrer notre absurdité présente ?
Seul petit, minuscule regret suite à cette lecture : ce livre est parfois un peu technique, long à lire et demande pas mal de concentration. Ceci dit, il est difficile de lui reprocher ce qui fait son immense qualité, à savoir sa rigueur scientifique et son exhaustivité à ce jour (me semble-t-il). Je rêverais pourtant d'un second livre tiré de celui-ci, toujours aussi passionnant et instructif mais plus accessible, afin de toucher un plus large public sur les questions tellement contemporaines qu'il éclaire magnifiquement.
Judith Rainhorn présente une histoire chronologique du blanc de plomb du 18ème siècle à nos jours. Le blanc de plomb ou céruse est un produit dont la toxicité est connue depuis bien longtemps et qui est à l'origine, comme tous les dérivés du plomb, du saturnisme, terrible maladie provoquant coliques, immenses douleurs, paralysies et pouvant mener à la mort. Ceci n'a pas empêché l'utilisation massive de la céruse à partir du 19ème siècle, en particulier dans la peinture, et le développement d'une production industrielle du produit. Les ouvriers des ateliers de production, les peintres en bâtiment et également des ouvriers d'autres métiers sont largement touchés par l'intoxication au plomb. Il existe pourtant un produit de substitution mais qui a du mal à s'imposer tellement la céruse a de défenseurs. Il faut attendre 1919 et bien des rebondissements pour voir l'interdiction de l'utilisation de la céruse en France dans la peinture. Cette décision ne signe pourtant pas sa disparition puisque la céruse réapparaît régulièrement et ce jusque dans les années 1980 avec l'intoxication d'enfants habitant des logements insalubres.
L'étude de Judith Rainhorn retrace ainsi l'histoire de ce produit et des combats menés par ces défenseurs et ces opposants. le sujet est à la croisée de nombreux domaines qui sont tous traités : l'histoire bien sûr mais aussi l'économie, la sociologie, la politique, la médecine, la chimie, le droit, la technologie. Son travail est remarquable de rigueur et de précision. Chaque idée, chaque propos, chaque argument trouvé dans les sources, même et surtout les plus communément admis ou répétés au fil des textes et publications, est passé à la loupe des faits, d'autres sources et de la critique scientifique historique. Le tout est remis dans le contexte général des découvertes, des luttes, des lois sur le travail, la santé et les toxiques. C'est donc un travail académique méticuleux et approfondi qu'elle présente mais qui n'a rien de froid. Il laisse transparaître une grande colère plus que justifiée qui ne prend pourtant jamais le pas sur l'honnêteté du travail de recherche.
En effet, à travers cette histoire ancienne (du moins pour la France) de l'intoxication au plomb, comment ne pas reconnaître nos débats actuels autour d'autres produits toxiques qui ont investi notre quotidien ? On retrouve dans ce récit des personnages et des événements qui sont très contemporains. En voici quelques exemples :
Des industriels cyniques qui n'ont que peu de considération pour la vie des ouvriers, qui piétinent l'humain mais qui arrivent dans le discours à se parer des habits de la générosité, de l'altruisme et de l'honnêteté.
Des scientifiques lanceurs d'alerte attaqués par des experts à la solde des industriels qui remettent en cause les études et qui sont capables de tenir des discours surréalistes (« ce n'est pas si dangereux », « tout cela est fortement exagéré », etc.), instillant ainsi le doute.
Des politiques d'une cécité coupable, toujours en retard et qui attendent de voir de quel côté va pencher la balance mais qui ont l'art de présenter leurs prises de position et leurs décisions comme novatrices alors qu'elles sont seulement opportunistes.
La collusion entre industriels, experts et agents publics pour la protection des intérêts privés avant celle de la santé publique.
La menace, si on interdisait le produit, de la faillite économique, de l'effondrement du pays, de l'attaque de puissances étrangères (car le poison est quand même toujours beaucoup plus sympa quand il est bien de chez nous).
Des débats et des processus législatifs à n'en plus finir qui oublient l'essentiel : pendant ce temps, on meurt au travail.
De gros rapports de commissions d'enquête avec plein de chiffres, de tableaux et de témoignages mais qui ne résistent pas aujourd'hui à l'analyse historique et se révèlent n'être que calomnies, mauvaise foi et négation des faits et de la science.
Des arguments de sécurité (« Tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité des ouvriers, de l'environnement… ») et de longues recommandations de bonnes pratiques censées changer la donne mais dont personne ne surveille l'application réelle sur le terrain.
La culpabilisation de l'ouvrier, dont la maladie ne vient pas de son travail (quelle idée saugrenue !) mais de sa vie dissolue, de son incapacité et de sa réticence à se protéger au travail.
La manipulation de l'opinion publique par la mise en avant de faits divers émouvants et par la construction d'une image du produit rarement basée sur la réalité.
La difficulté à mobiliser et à faire se rejoindre les luttes car le problème se retrouve souvent segmenté et permet l'effacement de la vision d'ensemble du problème (à savoir ici, la dangerosité bien connue et intrinsèque du produit). Etc.
Tout cela sonne terriblement familier et c'est bien là le but du propos de Judith Rainhorn. Comme elle l'écrit dans l'épilogue, l'histoire de la céruse est avant tout celle d'un échec assez effrayant. Comment ce produit dont la toxicité est avérée et pour lequel il existe des solutions de substitution a-t-il pu se maintenir si longtemps sur le marché ? C'est bien sûr la responsabilité des acteurs cités précédemment. Mais pas seulement. C'est aussi la responsabilité collective de la société qui accepte de vivre avec le risque toxique et qui consent à son propre empoisonnement. Judith Rainhorn montre en effet comment l'enchevêtrement des événements de l'histoire de la céruse a mené à l'accommodement collectif au produit toxique. Il a également entraîné une amnésie régulière, des dénis et des oublis plus ou moins organisés du problème, avec des bégaiements de l'histoire et des résurgences momentanées. Ce livre nous interroge donc au niveau individuel et sociétal sur le risque avec lequel nous acceptons de vivre malgré notre degré de connaissance qui peut être assez élevé. Il est clairement démontré ici que le savoir ne mène pas toujours à l'action et que la collectivité s'accommode de la dangerosité d'un produit, entraînant ainsi son maintien dans l'environnement, et préfère gérer le risque plutôt que de le prévenir.
Ce livre nous invite, à travers cette histoire, à regarder le passé pour porter un regard neuf sur notre actualité et à peut-être en tirer des leçons. A la lecture et avec le recul, cette histoire est énervante et absurde. Que de perte de temps aux conséquences dramatiques. Et pourtant, c'est notre quotidien pour d'autres produits toxiques avec lesquels nous choisissons de vivre. Serons-nous plus vigilants et plus rapides pour agir ? Ou aurons-nous dans deux siècles une Judith Rainhorn du futur pour démontrer notre absurdité présente ?
Seul petit, minuscule regret suite à cette lecture : ce livre est parfois un peu technique, long à lire et demande pas mal de concentration. Ceci dit, il est difficile de lui reprocher ce qui fait son immense qualité, à savoir sa rigueur scientifique et son exhaustivité à ce jour (me semble-t-il). Je rêverais pourtant d'un second livre tiré de celui-ci, toujours aussi passionnant et instructif mais plus accessible, afin de toucher un plus large public sur les questions tellement contemporaines qu'il éclaire magnifiquement.
C'est grace à la Masse critique de Juin que j'ai reçu cet ouvrage, et j'en remercie babelio et les éditions Les presses de sciences Po.
Ma première réaction en recevant le livre, fut de me dire "houla, il est épais"... la seconde, alors que je faisais défiler les pages "Ouh... c'est écrit petit".
Pour faire ma sélection lors des masse critiques je me limite à l'impression que me fait la 4ème de couv', sans me documenter plus sur l'ouvrage en question. Ici je trouvais le sujet très intéressant, mais je m'attendais à quelque chose de plus accessible.
Mais je m'étais engagée à lire et critiqué ce livre dans le mois, alors je m'y suis jetée.... j'ai plongée dans ce récit, long récapitulatif de l'histoire d'un poison. Oui c'est long et détaillé. Sans connaitre plus que ce que je viens de lire, j'ai l'impression que tout y est, toutes les dates, tous les noms, tous les lieux. Alors évidemment ça ne facilite pas la lecture.
J'ai du m'interdire d'ouvrir tout autre livre, pour avancer sur celui ci et enfin le finir.
Malgré cette difficulté dans la lecture, je garde cette première impression sur l'intérêt du sujet : je ne vais pas dire que ça m'a passionné, mais je suis heureuse de m'endormir moins bête ce soir, et d'en savoir un peu plus sur un problème multi-centenaire et même millénaire, connu depuis son apparition. Et même si les autres poisons en cours au XXIème siècle ne sont que rapidement évoqués dans l'épilogue, plus d'une fois certaines explications sur l'histoire du plomb, m'ont fait penser aux produits phytosanitaires, ou à l'uranium, ou aux divers plastiques avec lesquels nous sommes en contact, ou à ces étiquettes de produits alimentaires ou non qui font peur tellement leur liste de composants est longue et incompréhensible.
Et malheureusement, l'amnésie chronique autour de ces sujets ne me rassurent pas.
Ma première réaction en recevant le livre, fut de me dire "houla, il est épais"... la seconde, alors que je faisais défiler les pages "Ouh... c'est écrit petit".
Pour faire ma sélection lors des masse critiques je me limite à l'impression que me fait la 4ème de couv', sans me documenter plus sur l'ouvrage en question. Ici je trouvais le sujet très intéressant, mais je m'attendais à quelque chose de plus accessible.
Mais je m'étais engagée à lire et critiqué ce livre dans le mois, alors je m'y suis jetée.... j'ai plongée dans ce récit, long récapitulatif de l'histoire d'un poison. Oui c'est long et détaillé. Sans connaitre plus que ce que je viens de lire, j'ai l'impression que tout y est, toutes les dates, tous les noms, tous les lieux. Alors évidemment ça ne facilite pas la lecture.
J'ai du m'interdire d'ouvrir tout autre livre, pour avancer sur celui ci et enfin le finir.
Malgré cette difficulté dans la lecture, je garde cette première impression sur l'intérêt du sujet : je ne vais pas dire que ça m'a passionné, mais je suis heureuse de m'endormir moins bête ce soir, et d'en savoir un peu plus sur un problème multi-centenaire et même millénaire, connu depuis son apparition. Et même si les autres poisons en cours au XXIème siècle ne sont que rapidement évoqués dans l'épilogue, plus d'une fois certaines explications sur l'histoire du plomb, m'ont fait penser aux produits phytosanitaires, ou à l'uranium, ou aux divers plastiques avec lesquels nous sommes en contact, ou à ces étiquettes de produits alimentaires ou non qui font peur tellement leur liste de composants est longue et incompréhensible.
Et malheureusement, l'amnésie chronique autour de ces sujets ne me rassurent pas.
critiques presse (1)
L’historienne signe une superbe essai sur la genèse, au XIXe siècle, des rapports entre nos sociétés industrielles et leurs effets sur l’environnement et la santé humaine, qui éclaire bien des débats actuels.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (2)
Ajouter une citation
Comme le suggérait Didier Fassin, ''une solution intellectuellement confortable, mais scientifiquement peu défendable, consisterait certes à prétendre avec optimisme que l'aventure humaine est une conquête progressive de ce qu'il en est d'être humain'' [L'ordre moral du monde, Essai d'anthropologie de l'intolérable].
Déprenons-nous du postulat optimiste fondée sur la publicisation croissante des questions sanitaires et environnementales qui fabriquent des êtres informés et combatifs dans un monde toxique.
En revanche, mesurer les tentatives effrénées de domestication de l'incertitude et du risque qui caractérisent les sociétés politiques contemporaines conduit à aiguiser notre regard et accroître notre vigilance. Les vastes cimetières électroniques à ciel ouvert en Chine, au Pakistan ou au Nigeria où hommes, femmes et enfants traitent quotidiennement à mains nues les déchets du monde connecté, où l'eau potable doit être acheminée par citernes, où la saturation irréversible des sols et des eaux en plomb, cuivre, chrome, dioxine et autres composants toxiques est telle qu'aucune agriculture n'est possible, sont l'image dystopique de notre indifférence à la contamination du monde industriel.
Page 344
Déprenons-nous du postulat optimiste fondée sur la publicisation croissante des questions sanitaires et environnementales qui fabriquent des êtres informés et combatifs dans un monde toxique.
En revanche, mesurer les tentatives effrénées de domestication de l'incertitude et du risque qui caractérisent les sociétés politiques contemporaines conduit à aiguiser notre regard et accroître notre vigilance. Les vastes cimetières électroniques à ciel ouvert en Chine, au Pakistan ou au Nigeria où hommes, femmes et enfants traitent quotidiennement à mains nues les déchets du monde connecté, où l'eau potable doit être acheminée par citernes, où la saturation irréversible des sols et des eaux en plomb, cuivre, chrome, dioxine et autres composants toxiques est telle qu'aucune agriculture n'est possible, sont l'image dystopique de notre indifférence à la contamination du monde industriel.
Page 344
Ainsi, au lendemain de l'abrogation de l'ordonnance royale de 1825, le Comité consultatif des arts et manufactures dit son dépit de voir abrogée une mesure si utile aux ouvriers et impute l'inefficacité des efforts entrepris par les industriels à "l'obstination et l'insouciance de ces mêmes ouvriers qui se refusent à employer les moyens nécessaires pour conserver leur santé". Déploration incantatoire du danger et culpabilisation des ouvriers : les deux mamelles de l'hygienisme sont en place pour un siècle.
Lire un extrait
Videos de Judith Rainhorn (3)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : histoire contemporaineVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Judith Rainhorn (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3205 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3205 lecteurs ont répondu