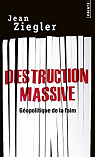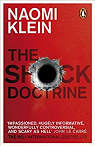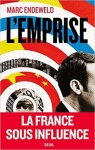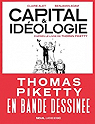Jeremy Scahill
Chloé Baker (Traducteur)Adèle David (Traducteur)/5 8 notes
Chloé Baker (Traducteur)Adèle David (Traducteur)/5 8 notes
Résumé :
Comment une société privée américaine a-t-elle pu décrocher des marchés publics dans le secteur de la défense et de la sécurité intérieure pour se rendre, peu à peu, indispensable ?
Où la firme a-t-elle recruté ses centaines de milliers de "réservistes" ? Quel est son rôle en Irak et dans les transferts "spéciaux" de prisonniers? Comment a-t-elle réussi à s'enrichir lors de l'ouragan Katrina? Pourquoi a-t-elle bénéficié de la menace iranienne? Quels ... >Voir plus
Où la firme a-t-elle recruté ses centaines de milliers de "réservistes" ? Quel est son rôle en Irak et dans les transferts "spéciaux" de prisonniers? Comment a-t-elle réussi à s'enrichir lors de l'ouragan Katrina? Pourquoi a-t-elle bénéficié de la menace iranienne? Quels ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Blackwater : L'ascension de l'armée privée la plus puissante du mondeVoir plus
Citations et extraits (5)
Ajouter une citation
L'histoire de l'Afrique du Sud – et en fait, l'Afrique toute entière – a été longuement marquée par les interventions sanglantes des mercenaires blancs. Après la chute de l’apartheid au début des années 90, beaucoup de soldats et de policiers sud-africains blancs – qui avaient terrorisé les populations noires depuis des années – se retrouvèrent sur le marché du travail. On ne peut estimer précisément le nombre de ceux d'entre eux qui offrirent leurs services aux sociétés privées, aux gouvernements ou à des causes contre-révolutionnaires, faisant de l'Afrique du Sud la cible de toutes les critiques, en s'en servant cette fois-ci comme base d'opérations mercenaires. Executive Outcomes (EO) était l'une de ces compagnies sud-africaines. Fondé en 1989 par un ancien commandent ayant servi sous l'apartheid, elle fut opérationnelle jusqu'à son interdiction en 1998. Elle avait pour client De Beers, l'une des entreprises les plus importantes de l'industrie du diamant, et le gouvernement angolais, qui l'engagea en 1993 pour reprendre en main les zones stratégiques de ses ressources pétrolières à la place des forces armées nationales. Mais EO est certainement plus connue pour les opérations qu'elle a menées en Sierra Leone, pays riche en diamants. Elle y fut engagé pour aider le gouvernement dans sa lutte contre le Front révolutionnaire uni de Foday Sankoh, qui commettaient d’innombrables violations des droits de l'homme. En 1995, le gouvernement de la Sierra Leone versa près de 35 millions de dollars à EO – soit un tiers de son budget annuel de défense – pour écraser l'insurrection, les États-Unis et la Grande-Bretagne ayant refusé d'intervenir. EO n'eut besoin que de neuf jours pour juguler la rébellion et de deux jours pour reprendre le contrôle de la précieuse mine de diamants de Kono. Ceux qui soutenaient l'industrie mercenaire se servirent de cette action de EO comme d'une preuve de ce que les forces privées pouvaient accomplir. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens … Le succès d'Executive Outcomes était en grande partie dû au fait qu'étant issue de l'élite des forces armées sud-africaines, elle avait hérité d'un réseau occulte étendu de sociétés connectées entre elles, et de groupes spécialisés dans la répression des insurrections dont on s'était servi, sur le continent africain, pour opprimer les populations noires ou les dissidents. En dépit du racolage qui entourait le « succès » tactique de EO en Angola ou en Sierra Leone, un problème bien plus vaste était soulevé par cette intervention des mercenaires dans des conflits internationaux : qui détermine l'ordre international ? Les Nations unies ? Les États-nations ? Les riches ? Les entreprises ? Et à qui ces forces armées doivent-elles rendre des comptes ? Le problème devient plus préoccupant avec l'extension de la privatisation des occupations de l'Irak et de l'Afghanistan. Mais alors que les États-Unis esquivèrent le problème de la responsabilité de ces compagnies de mercenaires, tel ne fut pas le cas en Afrique du Sud, où les mercenaires avaient pendant longtemps semé le trouble dans le pays. Après la fin du régime d'apartheid, et le début du processus de Vérité et Réconciliation, les appels furent nombreux pour fermer les sociétés de mercenaires, l'accent étant surtout mis sur les liens très étroits que beaucoup d'entre elles avaient entretenus avec ce régime. Cela conduisit, en 1998, à la promulgation de la loi contre les mercenaires en Afrique du Sud.
Mais seulement quelques années plus tard, au vu de rapports sur les mercenaires sud-africains qui s'étaient engagés en Irak, des législateurs de Johannesburg prétendirent que la loi n'avait pas été réellement appliquée. Ils faisaient valoir que la loi n'avait entraîné « qu'un petit nombre de poursuites judiciaires et de condamnations », malgré la preuve évidente des activités menées par des mercenaires originaires d'Afrique du Sud, et pas seulement en Irak.
Mais seulement quelques années plus tard, au vu de rapports sur les mercenaires sud-africains qui s'étaient engagés en Irak, des législateurs de Johannesburg prétendirent que la loi n'avait pas été réellement appliquée. Ils faisaient valoir que la loi n'avait entraîné « qu'un petit nombre de poursuites judiciaires et de condamnations », malgré la preuve évidente des activités menées par des mercenaires originaires d'Afrique du Sud, et pas seulement en Irak.
La situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan est effrayante : selon Human Rights Watch, « tortures, abus de pouvoir, et emploi abusif de la force policière sont monnaie courante ». Le Département d’État américain, de son côté, qualifiait « d'insuffisante » l'application des droits de l'homme dans le pays et avançait que Aliyev, allié de Kissinger, Baker, Cheney et d'autres s'était maintenu au pouvoir grâce à une élection « qui ne respectait pas les standards internationaux d'une élection démocratique, en raison de nombreuses irrégularités graves ». Le Département d’État accusa l’Azerbaïdjan de s'être rendu coupable de « restreindre les droits des citoyens à un changement de gouvernement pacifique ; de tortures et violences sur des personnes en garde à vue ; d'arrestations et de détentions arbitraires, notamment d'opposants politiques ; de menacer la vie des prisonniers par des conditions de détention éprouvantes ; d'abuser de la force pour dissoudre les manifestations ; […] et d'entretenir l'immunité policière ». Il conclut également que « les membres des forces de la sécurité avaient violé les droits de l'homme à de nombreuses reprises ». Malgré cela, les États-Unis ont dépensé des millions de dollars pour déployer les hommes de Blackwater dans le pays, avec le but affiché de décupler les capacités militaires de l’Azerbaïdjan, notamment en créant des unités d'élite sur le modèle des Forces spéciales SEAL de la Marine. Bien placé pour assurer des bénéfices pétroliers et servir de lieu d’entraînement pour une éventuelle guerre à venir, l’Azerbaïdjan, tout comme d'autres pays « utiles », était un allié précieux pour Washington. La présence de Blackwater dans le pays a renforcé l'implantation militaire américaine dans une région d'importance grandissante pour la politique des États-Unis, et la firme ne s'est pas privé de se servir de cette mission comme d'une publicité pour obtenir d'autres contrats. Comme le conclut le journaliste Tim Shorrock : « Le projet Blackwater en Azerbaïdjan est la preuve formelle que les soldats privés ont franchi la limite qui sépare les mercenaires des partenaires stratégiques du complexe militaro-industriel. »
Blackwater faisait partie d'une poignée de sociétés bénéficiant d'appuis dans les milieux autorisés qui saisirent immédiatement l'opportunité de tirer profit non seulement des dégâts matériels et ravages causés par l'ouragan du golf du Mexique mais aussi des déchaînements médiatiques. Au moment où l’État fédéral et les pouvoirs locaux abandonnaient des centaines de milliers de victimes, la couverture médiatique du passage de l'ouragan était dominée par des images de pillage, d'anarchie et de confusion. Ces reportages étaient outranciers et sans aucun doute racistes et provocateurs. Disons que si vous les regardiez à Kennebunkport dans le Maine, vous pouviez facilement imaginer la Nouvelle-Orléans comme une immense émeute, une sorte de festival de criminels dont le jour de gloire était finalement arrivé. En fait, c'était une ville dont la population avait été déplacée et abandonnée, où les gens avaient désespérément besoin de nourriture, de moyens de transport et de secours. Au lieu de cela, ce sont les armes qui déferlèrent le plus rapidement. Beaucoup d'armes.
[...]
Les répercussions de l'ouragan favorisèrent le retour de la lutte contre le terrorisme, avec une manne de contrats pour les sociétés qui récoltaient des bénéfices aussi faramineux qu'en Irak à moindre risque et sans avoir à quitter le pays. Pour ceux qui avaient critiqué le gouvernement pour sa gestion de la crise causée par l'ouragan, le message était clair. « Voilà ce qui se passe quand les victimes sont des noirs vilipendés avant et après le cyclone : on ne les aide pas, on exerce même une répression », commenta Chris Kromm, directeur de l'Institut des études sudistes et éditeur d'une étude sur la reconstruction des zones dévastées. Kromm estima que si d'innombrables sommes d'argent étaient apparemment distribuées à des contractants véreux, peu ou pas du tout l'étaient pour des projets à la Nouvelle-Orléans tels que : la création d'emplois, la reconstruction des hôpitaux et des écoles, des logements financièrement accessibles et la restauration des zones dévastées par les inondations.
[...]
Les répercussions de l'ouragan favorisèrent le retour de la lutte contre le terrorisme, avec une manne de contrats pour les sociétés qui récoltaient des bénéfices aussi faramineux qu'en Irak à moindre risque et sans avoir à quitter le pays. Pour ceux qui avaient critiqué le gouvernement pour sa gestion de la crise causée par l'ouragan, le message était clair. « Voilà ce qui se passe quand les victimes sont des noirs vilipendés avant et après le cyclone : on ne les aide pas, on exerce même une répression », commenta Chris Kromm, directeur de l'Institut des études sudistes et éditeur d'une étude sur la reconstruction des zones dévastées. Kromm estima que si d'innombrables sommes d'argent étaient apparemment distribuées à des contractants véreux, peu ou pas du tout l'étaient pour des projets à la Nouvelle-Orléans tels que : la création d'emplois, la reconstruction des hôpitaux et des écoles, des logements financièrement accessibles et la restauration des zones dévastées par les inondations.
A bien des égards, Blackwater incarne la « révolution des affaires militaires » de l'Administration Bush qui entraîna l'externalisation massive de l'essentiel des activités de l'armée. La place centrale de la société dans l'occupation américaine en Irak fut représentative du nouveau visage de la machine de guerre américaine. Mais c'est aussi un symbole de l'époque dans laquelle nous vivons, où chaque aspect de la vie est radicalement privatisé – éducation, santé, prisons, sécurité intérieure, renseignements secrets, services municipaux.
Si Blackwater doit son succès éclatant à la politique étrangère belliqueuse, agressive de l'Administration Bush, il est important de se souvenir que l'entreprise a vu le jour sous la présidence de Bill Clinton. C'est l'Administration Clinton qui admit Blackwater en tant que fournisseur du gouvernement fédéral et lui fit l'honneur de ses premiers contrats gouvernementaux.
De fait, la privatisation n'est pas simplement liée au programme républicain ou à l'Administration Bush – elle fut rapidement intensifiée par Bush, mais elle a été adoptée et encouragée par les structures du pouvoir des deux partis politiques pendant des décennies. « Même sous l'Administration Clinton, cette façon de procéder n'avait rien d'exceptionnel », commenta le démocrate de l'Illinois Jan Schakowsky, un des critiques les plus acerbes de la sous-traitance de la guerre. « Nous avons assisté à l'extraordinaire montée en flèche de cette industrie qui représente maintenant des milliards et des milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle un véritable boom. » Le gouvernement américain paye aux contractants l'équivalent de la somme des impôts des Américains ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 dollars, c'est-à-dire que « 90% des contribuables pourraient verser tous leurs impôts aux contractants plutôt qu'au gouvernement » selon une enquête menée par Vanity Fair en 2007.
Si Blackwater doit son succès éclatant à la politique étrangère belliqueuse, agressive de l'Administration Bush, il est important de se souvenir que l'entreprise a vu le jour sous la présidence de Bill Clinton. C'est l'Administration Clinton qui admit Blackwater en tant que fournisseur du gouvernement fédéral et lui fit l'honneur de ses premiers contrats gouvernementaux.
De fait, la privatisation n'est pas simplement liée au programme républicain ou à l'Administration Bush – elle fut rapidement intensifiée par Bush, mais elle a été adoptée et encouragée par les structures du pouvoir des deux partis politiques pendant des décennies. « Même sous l'Administration Clinton, cette façon de procéder n'avait rien d'exceptionnel », commenta le démocrate de l'Illinois Jan Schakowsky, un des critiques les plus acerbes de la sous-traitance de la guerre. « Nous avons assisté à l'extraordinaire montée en flèche de cette industrie qui représente maintenant des milliards et des milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle un véritable boom. » Le gouvernement américain paye aux contractants l'équivalent de la somme des impôts des Américains ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 dollars, c'est-à-dire que « 90% des contribuables pourraient verser tous leurs impôts aux contractants plutôt qu'au gouvernement » selon une enquête menée par Vanity Fair en 2007.
Mais lorsqu'il fut avéré que des commandos chiliens formés sous Pinochet étaient employés en Irak, la nouvelle souleva un tollé dans le pays. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le Chili était opposé à la guerre en Irak. « La présence de paramilitaires chiliens en Irak a suscité un rejet quasi viscéral de la part de la population, qui, il y a tout juste un an, s'était prononcée à 92% hostile à l'intervention américaine en Irak », déclara l'écrivain chilien Roberto Manriquez en juin 2004. La nouvelle provoqua également l'indignation horrifiée des victimes du régime Pinochet. « Il est révoltant de penser que les les officiers militaires chiliens sont considérés comme des bons soldats grâce à l'expérience acquise durant la dictature », s'indigna Tito Tricot, sociologue chilien qui fut emprisonné et torturé sous le régime Pinochet. « Les commandos chiliens travaillant pour le compte de Blackwater sont appréciés pour leur savoir-faire dans les domaines du kidnapping, de la torture et de massacre de civils sans défense. A cause de la privatisation de la guerre en Irak, ce qui devrait être une honte nationale se transforme en argument de vente. Ceci est rendu possible par l'absence totale de respect des États-Unis pour les droits de l'homme, et aussi par le fait que la justice n'a pas été faite ici, au Chili. Des membres des forces armées, qui devraient déjà être en prison pour payer les atrocités qu'ils ont commises sous le régime dictatorial, se promènent librement dans les rues comme si de rien n'était. Pire encore, ils sont maintenant récompensés pour leur passé criminel. »
Video de Jeremy Scahill (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Le nouvel art de la guerre: Dirty Wars. Jeremy Scahill, Lux éditeur, VF
Paris Librairies: http://www.parislibrairies.fr/detaillivre.php?gencod=9782895961796 Amazon: http://www.amazon.fr/nouvel-art-guerre-Dirty-wars/dp/2895961794/...
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jeremy Scahill (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
853 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre853 lecteurs ont répondu