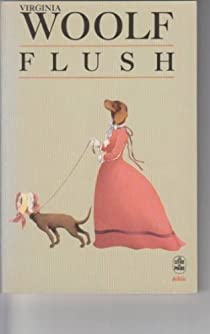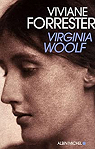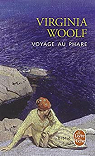Virginia Woolf
EAN : 9782253038429
Le Livre de Poche (31/12/1998)
/5
108 notesLe Livre de Poche (31/12/1998)
Résumé :
C'était le paysage humain qui l'émouvait. II semble que la Beauté, pour toucher les sens de Flush, dût être condensée d'abord, puis insufflée, poudre verte ou violette, par une seringue céleste, dans les profondeurs veloutées de ses narines ; et son extase, alors, ne s'exprimait pas en mots, mais en silencieuse adoration. Où Mrs. Browning voyait, Flush sentait ; il flairait quand elle eût écrit. " Virginia Woolf, Flush, une biographie,1933.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Flush : une biographieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (32)
Voir plus
Ajouter une critique
On a beaucoup parlé, beaucoup dit ou médit des qualités ou des défauts respectifs de tel ou tel exercice de traduction. À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on ne jure plus que par la VO. « Oh ! ma pauvre, tu le lis en français, ce livre ?! Malheureuse, IL FAUT le lire en anglais, sans quoi tu perds tout ! » J'imagine qu'effectivement, ça doit être mieux — quand on maîtrise parfaitement la langue — de lire Tolstoï en russe, Pessoa en portugais, Pamuk en turc, Murakami en japonais, etc., etc. Mais, voilà, mes pauvres amis, mes capacités linguistiques étant ce qu'elles sont et me sentant déjà incapable de lire la Chanson de Roland en ancien français, ce qui est censé être ma propre langue dans sa version 1.0, qu'en sera-t-il du reste ?
C'est l'air du temps, il faut croire, l'ère du mondialisme à tout prix. On oublie, ou l'on feint d'oublier, que beaucoup d'oeuvres exceptionnelles de notre patrimoine littéraire francophone sont en réalité des traductions ou, plus exactement, des transcriptions ; c'est-à-dire que l'on se détache de la rigueur de la lettre pour en mieux conserver l'esprit, pour en révéler toute la force, pour magnifier toute la teneur du texte dans notre propre langue, ce qui est définitivement impossible si l'on colle de trop près à la lettre (ou si l'on est un locuteur somme toute moyen de la langue en question comme le sont bon nombre de ceux qui m'enjoignent de lire en VO).
Je cite, par exemple, le Cid de Corneille, transcription géniale de Guillén de Castro ; Dom Juan de Molière, transcrit de Tirso de Molina ; les Fables de la Fontaine, transcrites d'une brochette d'auteurs antiques. Plus proche de nous, on pourrait encore citer le Moine d'Antonin Artaud, transcrit de Lewis. Bref, chaque fois que d'authentiques auteurs se donnent la peine de transcrire un autre auteur dans leur langue, le résultat a des chances d'être à la hauteur des espérances, même si la lettre est outragée (cf la traduction de Poe par Baudelaire).
Mais les auteurs ne se donnent plus guère cette peine, on laisse la tâche aux traducteurs, qui, dans leur immense majorité sont des champions de la lettre mais pas forcément de l'esprit des oeuvres qu'ils traduisent. Les plus récents exemples d'oeuvres réellement transcrites en français et non pas simplement traduites sont peut-être celui de Finnegans Wake (car sa traduction simple était réputée infaisable) ou celui de Vie et Opinions de Tristram Shandy par Guy Jouvet, qui s'éloigne ainsi de l'ancienne traduction de Charles Mauron.
Alors si je m'éloigne — moi aussi ! — autant de l'oeuvre qui nous occupe aujourd'hui, c'est pour vous signaler un exercice de traduction — de traduction certes — mais quelle traduction, quelle somptueuse traduction ! le traducteur de Flush : une biographie, et qui n'est autre que le Charles Mauron précédemment cité mais qui, cette fois, pour Virginia Woolf, a réalisé un petit trésor d'orfèvrerie de la traduction.
Son texte coule, glisse, avance, pétille, frétille, fourmille, scintille à nos pupilles, émoustille nos papilles et tout ce que vous voudrez encore de rimes en « ille ». Il a su conserver, restituer, révéler l'esprit de son auteure, par delà la lettre et c'est un vrai bonheur à lire. Chapeau, donc, Monsieur Mauron, pour cette fidèle non traduction — sans oxymoron, cela va sans dire.
Qu'en est-il de l'oeuvre elle-même ? En 1932, c'est une Virginia Woolf qui possède déjà une grande expérience en matière d'écriture — certains diront « des heures de vol au compteur », ce dont je me garderai bien car j'approche dangereusement, et chaque jour davantage, de ce même âge fatidique. C'est une auteure, donc, qui a déjà trouvé son identité littéraire : le courant de conscience.
Immerger le lecteur dans la subjectivité (dans la tête) du personnage. Telle pourrait être, très succinctement, la définition du courant de conscience. Et c'est ici que se révèle la grande originalité (pour l'époque) de Virginia Woolf, en ce sens qu'elle prend le parti de nous faire pénétrer dans la tête d'un chien. Mais pas n'importe quel chien, un chien ayant réellement existé et pour lequel des éléments biographiques existent concrètement, puisqu'il s'agit du chien du couple Browning, l'un et l'autre poètes réputés de l'époque victorienne, ayant entretenu une épaisse correspondance au cours de leur vie. le chien, Flush, un cocker spaniel, appartenait, plus précisément à l'épouse, Elizabeth, née Barrett, avant même son mariage avec Robert Browning.
Virginia Woolf se livre à un exercice délicat, car largement hypothétique et lacunaire, mais pourtant balisé de nombreuses références authentiques. D'après moi, elle y excelle quoique… Quoique non, finalement, car, certes, elle a su trouver un ton fantastique, la dose exacte d'humour et de désinvolture qui convenait dans les trois premiers chapitres et le final, le tout allié à une grande pertinence avec son projet littéraire global du courant de conscience. Mais, oui, il y a un mais — et je rejoins totalement en cela le lecteur ileana dans sa critique : il y a ce qu'il appelle « une baisse de régime au milieu du récit » et que moi j'appellerais plutôt un changement de ton.
Virginia Woolf, dans les deux gros chapitres centraux et qui constituent à peu près la moitié de l'ouvrage, devient plus sérieuse, plus factuelle, moins distanciée. Ce n'est pas désagréable à lire, loin s'en faut, mais ce n'est plus du tout le même plaisir à la lecture, la même légèreté jouissive des premiers chapitres. Et donc, malgré sa grande expérience du roman, j'aurais tendance à lui adresser ce tout petit reproche : exercice réussi et maîtrisé dans l'ensemble, à l'exception de ce changement de ton non expliqué et apparemment non justifié au milieu, qui perturbe un peu la lecture et, en ce qui me concerne, m'a fait prendre beaucoup moins de plaisir que le début ou la toute fin du roman.
Vous êtes donc transportés, dans l'essentiel de l'oeuvre, à la place du chien. Vous percevez et interprétez les événements à la façon d'un chien du XIXème siècle, sans toutefois perdre votre double lecture d'humain spectateur du XXIème. On y lit également certains partis pris propres à Virginia Woolf, en sa qualité de femme écrivaine, appartenant à un milieu proche de celui auquel appartenait Elizabeth Barrett-Browning.
Très intéressant, donc, de mon point de vue, avec la petite limitation sus-mentionnée. Mais qui suis-je pour faire des remarques d'ordre stylistique à Virginia Woolf ? Je suis bien d'accord avec vous et par conséquent, gardez toujours à l'esprit que ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
C'est l'air du temps, il faut croire, l'ère du mondialisme à tout prix. On oublie, ou l'on feint d'oublier, que beaucoup d'oeuvres exceptionnelles de notre patrimoine littéraire francophone sont en réalité des traductions ou, plus exactement, des transcriptions ; c'est-à-dire que l'on se détache de la rigueur de la lettre pour en mieux conserver l'esprit, pour en révéler toute la force, pour magnifier toute la teneur du texte dans notre propre langue, ce qui est définitivement impossible si l'on colle de trop près à la lettre (ou si l'on est un locuteur somme toute moyen de la langue en question comme le sont bon nombre de ceux qui m'enjoignent de lire en VO).
Je cite, par exemple, le Cid de Corneille, transcription géniale de Guillén de Castro ; Dom Juan de Molière, transcrit de Tirso de Molina ; les Fables de la Fontaine, transcrites d'une brochette d'auteurs antiques. Plus proche de nous, on pourrait encore citer le Moine d'Antonin Artaud, transcrit de Lewis. Bref, chaque fois que d'authentiques auteurs se donnent la peine de transcrire un autre auteur dans leur langue, le résultat a des chances d'être à la hauteur des espérances, même si la lettre est outragée (cf la traduction de Poe par Baudelaire).
Mais les auteurs ne se donnent plus guère cette peine, on laisse la tâche aux traducteurs, qui, dans leur immense majorité sont des champions de la lettre mais pas forcément de l'esprit des oeuvres qu'ils traduisent. Les plus récents exemples d'oeuvres réellement transcrites en français et non pas simplement traduites sont peut-être celui de Finnegans Wake (car sa traduction simple était réputée infaisable) ou celui de Vie et Opinions de Tristram Shandy par Guy Jouvet, qui s'éloigne ainsi de l'ancienne traduction de Charles Mauron.
Alors si je m'éloigne — moi aussi ! — autant de l'oeuvre qui nous occupe aujourd'hui, c'est pour vous signaler un exercice de traduction — de traduction certes — mais quelle traduction, quelle somptueuse traduction ! le traducteur de Flush : une biographie, et qui n'est autre que le Charles Mauron précédemment cité mais qui, cette fois, pour Virginia Woolf, a réalisé un petit trésor d'orfèvrerie de la traduction.
Son texte coule, glisse, avance, pétille, frétille, fourmille, scintille à nos pupilles, émoustille nos papilles et tout ce que vous voudrez encore de rimes en « ille ». Il a su conserver, restituer, révéler l'esprit de son auteure, par delà la lettre et c'est un vrai bonheur à lire. Chapeau, donc, Monsieur Mauron, pour cette fidèle non traduction — sans oxymoron, cela va sans dire.
Qu'en est-il de l'oeuvre elle-même ? En 1932, c'est une Virginia Woolf qui possède déjà une grande expérience en matière d'écriture — certains diront « des heures de vol au compteur », ce dont je me garderai bien car j'approche dangereusement, et chaque jour davantage, de ce même âge fatidique. C'est une auteure, donc, qui a déjà trouvé son identité littéraire : le courant de conscience.
Immerger le lecteur dans la subjectivité (dans la tête) du personnage. Telle pourrait être, très succinctement, la définition du courant de conscience. Et c'est ici que se révèle la grande originalité (pour l'époque) de Virginia Woolf, en ce sens qu'elle prend le parti de nous faire pénétrer dans la tête d'un chien. Mais pas n'importe quel chien, un chien ayant réellement existé et pour lequel des éléments biographiques existent concrètement, puisqu'il s'agit du chien du couple Browning, l'un et l'autre poètes réputés de l'époque victorienne, ayant entretenu une épaisse correspondance au cours de leur vie. le chien, Flush, un cocker spaniel, appartenait, plus précisément à l'épouse, Elizabeth, née Barrett, avant même son mariage avec Robert Browning.
Virginia Woolf se livre à un exercice délicat, car largement hypothétique et lacunaire, mais pourtant balisé de nombreuses références authentiques. D'après moi, elle y excelle quoique… Quoique non, finalement, car, certes, elle a su trouver un ton fantastique, la dose exacte d'humour et de désinvolture qui convenait dans les trois premiers chapitres et le final, le tout allié à une grande pertinence avec son projet littéraire global du courant de conscience. Mais, oui, il y a un mais — et je rejoins totalement en cela le lecteur ileana dans sa critique : il y a ce qu'il appelle « une baisse de régime au milieu du récit » et que moi j'appellerais plutôt un changement de ton.
Virginia Woolf, dans les deux gros chapitres centraux et qui constituent à peu près la moitié de l'ouvrage, devient plus sérieuse, plus factuelle, moins distanciée. Ce n'est pas désagréable à lire, loin s'en faut, mais ce n'est plus du tout le même plaisir à la lecture, la même légèreté jouissive des premiers chapitres. Et donc, malgré sa grande expérience du roman, j'aurais tendance à lui adresser ce tout petit reproche : exercice réussi et maîtrisé dans l'ensemble, à l'exception de ce changement de ton non expliqué et apparemment non justifié au milieu, qui perturbe un peu la lecture et, en ce qui me concerne, m'a fait prendre beaucoup moins de plaisir que le début ou la toute fin du roman.
Vous êtes donc transportés, dans l'essentiel de l'oeuvre, à la place du chien. Vous percevez et interprétez les événements à la façon d'un chien du XIXème siècle, sans toutefois perdre votre double lecture d'humain spectateur du XXIème. On y lit également certains partis pris propres à Virginia Woolf, en sa qualité de femme écrivaine, appartenant à un milieu proche de celui auquel appartenait Elizabeth Barrett-Browning.
Très intéressant, donc, de mon point de vue, avec la petite limitation sus-mentionnée. Mais qui suis-je pour faire des remarques d'ordre stylistique à Virginia Woolf ? Je suis bien d'accord avec vous et par conséquent, gardez toujours à l'esprit que ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
"En dehors du chien, le livre est le meilleur ami de l'homme. En dedans, il fait trop noir pour y lire."
(Groucho Marx)
Quand j'ai appris que Virginia Woolf avait écrit un petit roman biographique sur Elizabeth Barrett-Browning, raconté du point de vue de son cocker, je l'ai tout de suite classé mentalement dans la catégorie "décidément à lire". Et je suis relativement déçue... quoique, oui, dans certains cas ce livre peut s'avérer idéal. J'ai d'abord planifié que la lecture de "Flush" me permettra de procrastiner pendant mes travaux de rénovation domestique... finalement ce fut le contraire, et par conséquent j'ai achevé toutes mes bricoles beaucoup plus vite que prévu.
On trottera au pas de l'épagneul Flush, qui, encore tout jeune chien, arrive dans la luxueuse maison de la célèbre poétesse. Un cadeau de la modeste famille des Milford à leur chère mademoiselle Barrett, dont l'esprit si merveilleusement vif reste emprisonné dans un corps si regrettablement inerte. La peur et la langueur du jeune chiot vont se transformer peu à peu en amour inconditionnel entre Flush et sa nouvelle maîtresse. Flush va renoncer à sa liberté, aux lapins et aux galipettes à l'air libre, et tout cela rien que pour elle. Les choses se compliqueront quelque peu, quand Miss Barrett tombera amoureuse de Mr Browning...
Mon plus grand problème avec le livre se trouve dans la conception du protagoniste principal, coincée quelque part à mi-chemin entre l'anthropomorphisation et le portrait fidèle d'un animal. Virginia Woolf ne propose décidément pas une image réaliste de la mentalité canine, comme le fait, disons, Eric Knight dans "Lassie" (par exemple, en observant les occupations de sa maîtresse, Flush souhaite savoir écrire comme elle). le monde à travers les yeux noisette de l'épagneul reste cependant très différent du nôtre, ce qui réduit l'angle de vue du narrateur lié au personnage de Flush. le résultat est une pelote emmêlée d'observations qui ne sont ni tout à fait humaines, ni tout à fait canines. C'est pourtant un des points intéressants du récit : l'absence de langage commun entre le chien et sa maîtresse, remplacé par l'affection qui se passe de toute verbalisation... mais malgré tout, je ne savais pas vraiment quoi en penser. A l'exception d'un passage vraiment réussi - la description des odeurs à Florence ! Dans le flux lénifiant de la narration, elle fait l'effet d'un feu d'artifice de l'imagination créative.
Assurément, la lecture devient bien plus captivante au moment où le trio central, les époux Browning avec Flush, arrive en Italie. Jusqu'ici le chien ne fait que rester allongé aux côtés d'Elizabeth malade dans les décors somptueux et moroses de la Wimpole Street londonienne. Les descriptions de l'intérieur font vraiment partie des qualités du roman, mais tout de même - elles remplissent la bonne moitié du livre ! Tandis qu'en Italie, le monde réel avec sa lumière, son mouvement et ses bruits, entre enfin dans la vie d'Elizabeth et de Flush.
J'admets aussi très volontiers que Virginia évoque l'atmosphère historique à la perfection. Londres de l'époque victorienne avec ses slums et ses voleurs de chiens, l'Italie révolutionnaire qui réclame une constitution (1848), spiritisme, romantisme avec sa fine fleur littéraire... bref, la moitié du 19ème siècle comme si on y était.
Dans ses journaux, la romancière décrit son épuisement extrême après avoir fini "Les Vagues", ses tension et ses appréhensions en attendant les réactions à ce livre, et elle dit que la rédaction de "Flush" était pour elle une façon de se reposer.
C'est écrit avec humour et légèreté, et cela se lit de la même manière. Virginia y valorise tout ce qu'elle a l'habitude de démanteler dans ses autres romans : l'inertie et le beau fixe de la société victorienne, avec toutes ses règles et ses impassibles coulisses. C'est sans doute la raison pour laquelle "Flush" se vendait aussi bien, à l'époque, et pourquoi il garde toujours son intérêt.
Mais je ne suis pas persuadée que de nos jours c'est une lecture transcendante pour les amateurs de Virginia Woolf... ni même pour les amateurs de chiens. La noblesse de race y est souvent thématisée, on touche à l'élevage, y compris à l'élimination de chiots dont le toupet ne correspond pas exactement aux standards exigés, et par moments ça m'a agacée.
Puis, en finissant la lecture dans un nuage de poils, la main entre les oreilles du chat, j'ai compris la véritable raison pourquoi "Flush" ne sera jamais en mesure de me convaincre complètement... d'où mes 3,5/5 très personnels.
[...] "Roses, gathered for a vase,
In that chamber died apace,
Beam and breeze resigning —
This dog only, waited on,
Knowing that when light is gone,
Love remains for shining." [...] (Elizabeth Barrett-Browning, "To Flush, My Dog")
(Groucho Marx)
Quand j'ai appris que Virginia Woolf avait écrit un petit roman biographique sur Elizabeth Barrett-Browning, raconté du point de vue de son cocker, je l'ai tout de suite classé mentalement dans la catégorie "décidément à lire". Et je suis relativement déçue... quoique, oui, dans certains cas ce livre peut s'avérer idéal. J'ai d'abord planifié que la lecture de "Flush" me permettra de procrastiner pendant mes travaux de rénovation domestique... finalement ce fut le contraire, et par conséquent j'ai achevé toutes mes bricoles beaucoup plus vite que prévu.
On trottera au pas de l'épagneul Flush, qui, encore tout jeune chien, arrive dans la luxueuse maison de la célèbre poétesse. Un cadeau de la modeste famille des Milford à leur chère mademoiselle Barrett, dont l'esprit si merveilleusement vif reste emprisonné dans un corps si regrettablement inerte. La peur et la langueur du jeune chiot vont se transformer peu à peu en amour inconditionnel entre Flush et sa nouvelle maîtresse. Flush va renoncer à sa liberté, aux lapins et aux galipettes à l'air libre, et tout cela rien que pour elle. Les choses se compliqueront quelque peu, quand Miss Barrett tombera amoureuse de Mr Browning...
Mon plus grand problème avec le livre se trouve dans la conception du protagoniste principal, coincée quelque part à mi-chemin entre l'anthropomorphisation et le portrait fidèle d'un animal. Virginia Woolf ne propose décidément pas une image réaliste de la mentalité canine, comme le fait, disons, Eric Knight dans "Lassie" (par exemple, en observant les occupations de sa maîtresse, Flush souhaite savoir écrire comme elle). le monde à travers les yeux noisette de l'épagneul reste cependant très différent du nôtre, ce qui réduit l'angle de vue du narrateur lié au personnage de Flush. le résultat est une pelote emmêlée d'observations qui ne sont ni tout à fait humaines, ni tout à fait canines. C'est pourtant un des points intéressants du récit : l'absence de langage commun entre le chien et sa maîtresse, remplacé par l'affection qui se passe de toute verbalisation... mais malgré tout, je ne savais pas vraiment quoi en penser. A l'exception d'un passage vraiment réussi - la description des odeurs à Florence ! Dans le flux lénifiant de la narration, elle fait l'effet d'un feu d'artifice de l'imagination créative.
Assurément, la lecture devient bien plus captivante au moment où le trio central, les époux Browning avec Flush, arrive en Italie. Jusqu'ici le chien ne fait que rester allongé aux côtés d'Elizabeth malade dans les décors somptueux et moroses de la Wimpole Street londonienne. Les descriptions de l'intérieur font vraiment partie des qualités du roman, mais tout de même - elles remplissent la bonne moitié du livre ! Tandis qu'en Italie, le monde réel avec sa lumière, son mouvement et ses bruits, entre enfin dans la vie d'Elizabeth et de Flush.
J'admets aussi très volontiers que Virginia évoque l'atmosphère historique à la perfection. Londres de l'époque victorienne avec ses slums et ses voleurs de chiens, l'Italie révolutionnaire qui réclame une constitution (1848), spiritisme, romantisme avec sa fine fleur littéraire... bref, la moitié du 19ème siècle comme si on y était.
Dans ses journaux, la romancière décrit son épuisement extrême après avoir fini "Les Vagues", ses tension et ses appréhensions en attendant les réactions à ce livre, et elle dit que la rédaction de "Flush" était pour elle une façon de se reposer.
C'est écrit avec humour et légèreté, et cela se lit de la même manière. Virginia y valorise tout ce qu'elle a l'habitude de démanteler dans ses autres romans : l'inertie et le beau fixe de la société victorienne, avec toutes ses règles et ses impassibles coulisses. C'est sans doute la raison pour laquelle "Flush" se vendait aussi bien, à l'époque, et pourquoi il garde toujours son intérêt.
Mais je ne suis pas persuadée que de nos jours c'est une lecture transcendante pour les amateurs de Virginia Woolf... ni même pour les amateurs de chiens. La noblesse de race y est souvent thématisée, on touche à l'élevage, y compris à l'élimination de chiots dont le toupet ne correspond pas exactement aux standards exigés, et par moments ça m'a agacée.
Puis, en finissant la lecture dans un nuage de poils, la main entre les oreilles du chat, j'ai compris la véritable raison pourquoi "Flush" ne sera jamais en mesure de me convaincre complètement... d'où mes 3,5/5 très personnels.
[...] "Roses, gathered for a vase,
In that chamber died apace,
Beam and breeze resigning —
This dog only, waited on,
Knowing that when light is gone,
Love remains for shining." [...] (Elizabeth Barrett-Browning, "To Flush, My Dog")
Mon premier Virginia Woolf sur une biographie canine, Wouaf !
Flush est un épagneul vivant en Angleterre au 19ème. De Miss Mitford à Miss Barret, il trouve son bonheur dans le regard que sa maîtresse porte sur lui, amant ou bébé non bienvenus. Et même si ses instincts sont subitement réduits à un espace domestiqué, peu lui importe, il en fait son afflair. Un toutou quoi, vous me direz.
Le roman surfe sur l'ambivalence du regard porté sur le monde, est-ce celui d'un humain ou d'un chien, ou d'un chien humanisé ? «Certes le biographe serait heureux d'en inférer que la vie de Flush, ne fut qu'une suite d'orgie dépassant toute description, et d'écrire que si le bébé, chaque jour saisissant au vol un nouveau mot, repoussait plus loin de lui la réalité ingénue, le destin de Flush, au contraire, était de rester dans un paradis où les essences se conservent dans leur pureté suprême et où la nudité des choses s'imprime immédiatement sur la nudité des nerfs : par malheur ce serait faux. ».
Écrit sur un coup de fatigue, pour se délasser après l'éreintante chevauchée des « vagues », mais aussi pour parodier les biographies à succès de l'époque, ce Flush prend des allures de coup de poker gagnant. Une écriture de haut vol, qui me donne envie d'en connaître plus sur l'auteur.
Flush est un épagneul vivant en Angleterre au 19ème. De Miss Mitford à Miss Barret, il trouve son bonheur dans le regard que sa maîtresse porte sur lui, amant ou bébé non bienvenus. Et même si ses instincts sont subitement réduits à un espace domestiqué, peu lui importe, il en fait son afflair. Un toutou quoi, vous me direz.
Le roman surfe sur l'ambivalence du regard porté sur le monde, est-ce celui d'un humain ou d'un chien, ou d'un chien humanisé ? «Certes le biographe serait heureux d'en inférer que la vie de Flush, ne fut qu'une suite d'orgie dépassant toute description, et d'écrire que si le bébé, chaque jour saisissant au vol un nouveau mot, repoussait plus loin de lui la réalité ingénue, le destin de Flush, au contraire, était de rester dans un paradis où les essences se conservent dans leur pureté suprême et où la nudité des choses s'imprime immédiatement sur la nudité des nerfs : par malheur ce serait faux. ».
Écrit sur un coup de fatigue, pour se délasser après l'éreintante chevauchée des « vagues », mais aussi pour parodier les biographies à succès de l'époque, ce Flush prend des allures de coup de poker gagnant. Une écriture de haut vol, qui me donne envie d'en connaître plus sur l'auteur.
La biographie d'un cocker peut-elle à la fois amuser le lecteur et l'instruire sur les moeurs d'une époque ? Absolument comme le démontre ici Virginia Woolf en nous plongeant dans un récit au ton badin et moqueur, ponctué d'apartés plus sérieux sur les travers de la société. Que ce soit sur les choses qui n'ont pas de prix, sur l'indulgence dont profite les hommes quant à leurs comportements sexuels, ou encore sur le gouffre qui sépare la bourgeoisie des classes laborieuses, l'auteure sait, en quelques remarques acérées, nous indiquer clairement son point de vue.
Écrire sur ce que ressent un chien sans tomber dans l'anthropomorphisme est un défi et, à cet égard, ce roman me semble particulièrement réussi; Flush appréhende le monde avec son odorat, démontre l'exubérance et la fidélité propres à sa race et laisse les considérations philosophiques aux humains. Au fil de sa vie il est question d'attachement, de liberté, des compromis entre les deux, mais surtout de joie de vivre. Au-delà de ses pérégrinations, et en même temps à cause de celles-ci, le lecteur entrevoit ce que peut être une vie de chien; et ce n'est pas nécessairement celle que désigne l'expression populaire.
Écrire sur ce que ressent un chien sans tomber dans l'anthropomorphisme est un défi et, à cet égard, ce roman me semble particulièrement réussi; Flush appréhende le monde avec son odorat, démontre l'exubérance et la fidélité propres à sa race et laisse les considérations philosophiques aux humains. Au fil de sa vie il est question d'attachement, de liberté, des compromis entre les deux, mais surtout de joie de vivre. Au-delà de ses pérégrinations, et en même temps à cause de celles-ci, le lecteur entrevoit ce que peut être une vie de chien; et ce n'est pas nécessairement celle que désigne l'expression populaire.
Dans une lettre datée du 23 février 1933 et adressée à une de ses amies, Virginia Woolf explique qu'elle est sortie épuisée de la rédaction de son ambitieux roman : Les Vagues et profondément touchée par la disparition de son ami l'écrivain biographe Lytton Strachey auteur de Victoriens éminents. Elle souhaite lui adresser un dernier clin d'oeil à travers un nouveau projet qui l'amuse beaucoup : écrire la biographie du chien de la poétesse Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) dont elle lit la correspondance.
Baignée dans la culture antique gréco-latine et nourrie des grands classiques européens, la jeune Elizabeth écrit depuis son plus jeune âge. Après la perte de sa mère en 1928 et le décès accidentel par noyade de son frère en 1840, elle est prise d'une paralysie qui l'oblige à vivre recluse dans sa chambre tapissée de lourds rideaux de damas vert, à Londres, au 50 Wimpole Street, surveillée par un père très aimant qui n'imagine pas voir sa fille quitter un jour sa maison. Coupée du monde par sa maladie, elle ne sort guère et passe son temps à écrire.
Sa seule compagnie, en dehors de sa famille et de deux ou trois amis, est un cocker nommé Flush qu'une amie vient de lui offrir.
Séduit par ses écrits, le poète Robert Browning entreprend une correspondance avec elle et finira par la rencontrer en mai 1845 et par … l'aimer ! Deux années passent et le couple décide de se marier en cachette le 12 septembre 1846 et de fuir ensuite avec la nurse Wilson et Flush le 19 septembre à Florence, Casa Guidi, Via Bassio, près du Palais Pitti où Elizabeth mourra en 1861.
Une vie pour le moins romanesque que nous découvrons dans l'oeuvre de Virginia Woolf à travers les yeux de Flush, le propre chien d'Elizabeth Barrett Browning !
S'il est évident que Virginia Woolf s'amuse de ce point de vue plutôt original, elle dresse néanmoins un portrait très saisissant de la société de son temps. Et son petit roman eut un succès considérable… que l'on comprend car c'est une pure merveille.
Traversant rapidement toutes les époques pour évoquer les origines du petit cocker, l'auteur suppose que l'année de naissance de Flush se situe en 1842. Il vécut les premiers mois de sa vie à Three Mile Cross dans une ferme près de Reading où il découvrit lors des sorties avec Miss Mitford les « odeurs fortes de la terre ; odeurs sucrées des fleurs ; odeurs innommées des feuilles et des ronces ; odeurs aigres des routes traversées ; odeurs âcres à l'orée des champs de fèves ». Bouquet enivrant de fragrances multiples…
On imagine ainsi volontiers le choc de Flush lorsqu'il fut offert à la poétesse qui vivait enfermée dans sa chambre « sombre et verte à cause du lierre », des haricots rouges, des convolvulus et des capucines qui obstruaient une fenêtre à jamais fermée.
« Flush, d'abord, ne distingua rien dans ce crépuscule verdâtre » surchargé de meubles, de miroirs, de bustes et de livres, le tout baignant dans une odeur d'eau de Cologne insoutenable pour le flair ultra sensible d'un quadrupède !
Finie la liberté…
La maîtresse observa l'animal, l'animal observa la maîtresse : « Entre eux béait le gouffre le plus large qui puisse séparer un être d'un autre. Elle parlait; il était muet. Elle était femme ; il était chien. »
L'animal, désespéré, finit par se coucher « sur la courtepointe, aux pieds de Miss Barrett ». Quelques rares sorties dans les magasins pour choisir un tissu et dans Regent's Park mais en laisse : le bonheur des courses folles dans la campagne semble disparu à jamais. « Tous ses instincts étaient refoulés, contredits. »
Cela dit, observant ses congénères, notre Flush prend quand même conscience qu'il fait partie des privilégiés, des toutous aristocrates somme toute…
Journées longues et répétitives où sa maîtresse écrit sans relâche, reçoit quelques visites et parle longuement, le soir, avec son père avant de s'endormir.
Et c'est ainsi que notre Flush changea : « Il est naturel qu'un chien toujours couché avec la tête sur un lexique grec en vienne à détester d'aboyer ou de mordre ; qu'il finisse par préférer le silence du chat à l'exubérance de ses congénères et la sympathie humaine à toute autre. », il vieillit, s'attacha « à la vie à la mort » à sa maîtresse-allongée-sur-son-sofa et aima finalement sa petite vie bien confortable et bien régulière… jusqu'à ce qu'un soir de janvier 1845, arrive une lettre qui bouleversa Miss Barrett, d'autres suivirent de plus en plus nombreuses. Elizabeth se jetait alors sur sa plume, étrangement agitée, les joues rouges et les yeux vifs sous l'oeil inquiet de son cocker…
Un jour, un homme fut annoncé : « Mr.Browning » : alors « Flush s'agita aux pieds de Miss Barrett. Elle n'y prit pas garde. Il gémit. On ne l'entendit même pas. Alors il s'abîma dans un muet désespoir » qui ne durera pas… rassurez-vous ! Mais, je ne vous en dis pas plus…
Ce texte délicieux et plein d'humour nous plonge dans l'intimité d'une femme de la société victorienne qui, contre l'avis de son père et de ses frères, va choisir son destin en se libérant d'une société patriarcale qui sous couvert d'aimer et de protéger les femmes, les enferme, les étouffe et finit par les tuer ! A coup sûr, Virginia Woolf admirait cette femme écrivain capable de refuser les décisions des hommes qui lui étaient chers ( après son mariage et sa fuite, elle ne reverra jamais son père) et de rompre ses liens les plus forts pour se protéger et enfin revivre.
Par ailleurs, ce qui nous est dépeint, c'est le monde bien cloisonné de la société victorienne : Wimpole Street d'un côté et ses belles maisons alignées, Whitechapel de l'autre, où les gens vivent dans des « compartiments de briques entrecoupés de venelles, avec un ruisseau pour égout. » et « où la pauvreté et le vice engendrent sans cesse le vice ou la pauvreté. »
Enfin, Virginia Woolf se lance ici dans l'exercice difficile de traduire en mots la perception qu'un animal peut avoir du monde. Mais le pouvoir des mots est-il illimité ? Au contraire, « les mots ne détruisent-ils pas une réalité » qui les dépasse ?
Finalement, ce petit texte trop peu connu encore pose des questions essentielles sur les pouvoirs de la littérature et en dit long sur la société du dix-neuvième, ses valeurs et la place accordée aux femmes.
Ainsi, derrière ses allures légères, Flush a-t-il un côté bien mordant !
Lien : http://lireaulit.blogspot.fr/
Baignée dans la culture antique gréco-latine et nourrie des grands classiques européens, la jeune Elizabeth écrit depuis son plus jeune âge. Après la perte de sa mère en 1928 et le décès accidentel par noyade de son frère en 1840, elle est prise d'une paralysie qui l'oblige à vivre recluse dans sa chambre tapissée de lourds rideaux de damas vert, à Londres, au 50 Wimpole Street, surveillée par un père très aimant qui n'imagine pas voir sa fille quitter un jour sa maison. Coupée du monde par sa maladie, elle ne sort guère et passe son temps à écrire.
Sa seule compagnie, en dehors de sa famille et de deux ou trois amis, est un cocker nommé Flush qu'une amie vient de lui offrir.
Séduit par ses écrits, le poète Robert Browning entreprend une correspondance avec elle et finira par la rencontrer en mai 1845 et par … l'aimer ! Deux années passent et le couple décide de se marier en cachette le 12 septembre 1846 et de fuir ensuite avec la nurse Wilson et Flush le 19 septembre à Florence, Casa Guidi, Via Bassio, près du Palais Pitti où Elizabeth mourra en 1861.
Une vie pour le moins romanesque que nous découvrons dans l'oeuvre de Virginia Woolf à travers les yeux de Flush, le propre chien d'Elizabeth Barrett Browning !
S'il est évident que Virginia Woolf s'amuse de ce point de vue plutôt original, elle dresse néanmoins un portrait très saisissant de la société de son temps. Et son petit roman eut un succès considérable… que l'on comprend car c'est une pure merveille.
Traversant rapidement toutes les époques pour évoquer les origines du petit cocker, l'auteur suppose que l'année de naissance de Flush se situe en 1842. Il vécut les premiers mois de sa vie à Three Mile Cross dans une ferme près de Reading où il découvrit lors des sorties avec Miss Mitford les « odeurs fortes de la terre ; odeurs sucrées des fleurs ; odeurs innommées des feuilles et des ronces ; odeurs aigres des routes traversées ; odeurs âcres à l'orée des champs de fèves ». Bouquet enivrant de fragrances multiples…
On imagine ainsi volontiers le choc de Flush lorsqu'il fut offert à la poétesse qui vivait enfermée dans sa chambre « sombre et verte à cause du lierre », des haricots rouges, des convolvulus et des capucines qui obstruaient une fenêtre à jamais fermée.
« Flush, d'abord, ne distingua rien dans ce crépuscule verdâtre » surchargé de meubles, de miroirs, de bustes et de livres, le tout baignant dans une odeur d'eau de Cologne insoutenable pour le flair ultra sensible d'un quadrupède !
Finie la liberté…
La maîtresse observa l'animal, l'animal observa la maîtresse : « Entre eux béait le gouffre le plus large qui puisse séparer un être d'un autre. Elle parlait; il était muet. Elle était femme ; il était chien. »
L'animal, désespéré, finit par se coucher « sur la courtepointe, aux pieds de Miss Barrett ». Quelques rares sorties dans les magasins pour choisir un tissu et dans Regent's Park mais en laisse : le bonheur des courses folles dans la campagne semble disparu à jamais. « Tous ses instincts étaient refoulés, contredits. »
Cela dit, observant ses congénères, notre Flush prend quand même conscience qu'il fait partie des privilégiés, des toutous aristocrates somme toute…
Journées longues et répétitives où sa maîtresse écrit sans relâche, reçoit quelques visites et parle longuement, le soir, avec son père avant de s'endormir.
Et c'est ainsi que notre Flush changea : « Il est naturel qu'un chien toujours couché avec la tête sur un lexique grec en vienne à détester d'aboyer ou de mordre ; qu'il finisse par préférer le silence du chat à l'exubérance de ses congénères et la sympathie humaine à toute autre. », il vieillit, s'attacha « à la vie à la mort » à sa maîtresse-allongée-sur-son-sofa et aima finalement sa petite vie bien confortable et bien régulière… jusqu'à ce qu'un soir de janvier 1845, arrive une lettre qui bouleversa Miss Barrett, d'autres suivirent de plus en plus nombreuses. Elizabeth se jetait alors sur sa plume, étrangement agitée, les joues rouges et les yeux vifs sous l'oeil inquiet de son cocker…
Un jour, un homme fut annoncé : « Mr.Browning » : alors « Flush s'agita aux pieds de Miss Barrett. Elle n'y prit pas garde. Il gémit. On ne l'entendit même pas. Alors il s'abîma dans un muet désespoir » qui ne durera pas… rassurez-vous ! Mais, je ne vous en dis pas plus…
Ce texte délicieux et plein d'humour nous plonge dans l'intimité d'une femme de la société victorienne qui, contre l'avis de son père et de ses frères, va choisir son destin en se libérant d'une société patriarcale qui sous couvert d'aimer et de protéger les femmes, les enferme, les étouffe et finit par les tuer ! A coup sûr, Virginia Woolf admirait cette femme écrivain capable de refuser les décisions des hommes qui lui étaient chers ( après son mariage et sa fuite, elle ne reverra jamais son père) et de rompre ses liens les plus forts pour se protéger et enfin revivre.
Par ailleurs, ce qui nous est dépeint, c'est le monde bien cloisonné de la société victorienne : Wimpole Street d'un côté et ses belles maisons alignées, Whitechapel de l'autre, où les gens vivent dans des « compartiments de briques entrecoupés de venelles, avec un ruisseau pour égout. » et « où la pauvreté et le vice engendrent sans cesse le vice ou la pauvreté. »
Enfin, Virginia Woolf se lance ici dans l'exercice difficile de traduire en mots la perception qu'un animal peut avoir du monde. Mais le pouvoir des mots est-il illimité ? Au contraire, « les mots ne détruisent-ils pas une réalité » qui les dépasse ?
Finalement, ce petit texte trop peu connu encore pose des questions essentielles sur les pouvoirs de la littérature et en dit long sur la société du dix-neuvième, ses valeurs et la place accordée aux femmes.
Ainsi, derrière ses allures légères, Flush a-t-il un côté bien mordant !
Lien : http://lireaulit.blogspot.fr/
critiques presse (1)
Tout commence comme une fantaisie brillante, joliment incongrue, légère et drolatique — la généalogie de Flush, sa naissance, ses premiers apprentissages, son adoption... —, mais au fil des pages, et sans rien perdre jamais de sa saveur, l’exercice acquiert une intensité qu’on ne soupçonnait pas d’emblée.
Lire la critique sur le site : Telerama
Citations et extraits (25)
Voir plus
Ajouter une citation
La terre, tantôt dure, tantôt molle, chaude en un lieu, froide en un autre, piquait, picotait, chatouillait les coussins moelleux de ses pattes. Et quelle variété de parfums entrelacés en combinaisons subtiles venait agacer et faire trembler ses narines ! Odeurs fortes de terre ; odeurs sucrées des fleurs ; odeurs innommées des feuilles et des ronces ; odeurs aigres des routes traversées ; odeurs âcres à l'orée des champs de fèves. Soudain arrivait sous le vent une odeur plus aiguë, plus forte, plus déchirante qu'aucune autre — une odeur qui lui labourait le cerveau, soulevant un millier d'instincts, mettant en branle un million de souvenirs — une odeur de lièvre, une odeur de renard. Et voici Flush filant, en un éclair, comme un poisson rapide vers une eau toujours plus profonde. Il oubliait sa maîtresse ; il oubliait toute l'espèce humaine ; il entendait des hommes à la peau sombre crier : « Span ! Span ! » Des fouets claquaient à ses oreilles. Il galopait ; il se ruait. Soudain, il s'arrêtait tout interdit ; il écoutait en lui l'incantation décroître puis se perdre ; alors, très lentement, en agitant la queue d'un air penaud, il revenait au petit trot à travers champs vers Miss Mitford ; debout elle appelait : « Flush, Flush, Flush ! » en brandissant son parapluie. Une fois au moins l'appel fut plus impérieux encore. Une fanfare souleva en Flush des instincts plus profonds, battit le rappel d'émotions plus sauvages et plus fortes qui, transcendant soudain tout souvenir, confondirent pour lui, anéantirent herbe, arbres, lièvre, lapin, renard en un seul hurlement d'extase féroce. La torche de l'amour fulgura dans ses yeux ; le cor de Vénus chasseresse éclata contre son oreille. Encore presque chiot, Flush était déjà père.
Chapitre I : Three Mile Cross.
Chapitre I : Three Mile Cross.
Un ingénieux entrepreneur avait jeté bas un vieil hôtel pour élever à sa place une maison de rapport en torchis. La pluie s'égouttait à travers le toit, et le vent soufflait à travers les murs. Mr. Beames vit un enfant plongeant son broc dans l'eau verdâtre d'un canal. Buvait-on cette eau ? demanda-t-il. On en buvait ; on y lavait aussi, car le propriétaire ne permettait de la renouveler que deux fois par semaine. De telles rencontres étaient d'autant plus surprenantes qu'on pouvait les faire dans les quartiers les plus calmes et les plus brillants de Londres — « les paroisses les plus aristocratiques avaient leur part ». Derrière la chambre de Miss Barrett, par exemple, était un des pires " slums " londoniens. À cette respectabilité venait se mêler cette horreur. Mais, naturellement, il existait certains quartiers depuis longtemps abandonnés aux pauvres et où nul autre qu'eux ne pénétrait jamais. Dans Whitechapel ou dans l'espace triangulaire qui forme le fond de Tottenham Court Road, la pauvreté, le vice et la misère avaient nourri, semé et propagé leur espèce pendant des siècles et sans qu'on eût tenté la moindre intervention. Un bloc de masures croulantes dans St. Giles était « presque un établissement pénitentiaire, une sorte de métropole des pauvres ». Assez justement, lorsque les pauvres s'aggloméraient ainsi, la masse de leurs logements était appelée " nids-à-freux ", car les êtres humains y grouillaient les uns sur les autres comme les freux grouillent en masses sombres à la cime des arbres. Seulement, les maisons, ici, n'étaient pas des arbres — à peine encore des maisons. C'étaient des compartiments de briques entrecoupés de venelles, avec un ruisseau pour égout. Dans la journée, les venelles grouillaient d'êtres humains à demi nus ; et le soir, il s'y déversait encore tout le flot des voleurs, mendiants, prostituées, qui, tout le jour, avaient exercé leurs talents dans West End. La police n'y pouvait rien. Et que pouvait un simple promeneur ? Rien que traverser cet enfer en hâte et peut-être laisser entendre ensuite, comme le fit Mr. Beames, à travers des citations, avec maint euphémisme et mainte échappatoire, que tout n'était pas au mieux dans la ville. Le choléra viendrait un jour, et sans doute l'avertissement du choléra serait-il de nature moins évasives.
Chapitre IV : Whitechapel
Chapitre IV : Whitechapel
Flush courait les rues de Florence pour savourer l'ivresse des odeurs. Le fil des odeurs le menait ; des grands boulevards aux venelles, par les avenues et les places, il suivait son nez, d'odeur en odeur, de la raboteuse à la fluide, de la funèbre à la dorée. Il furetait partout, franchissait tous les seuils : ici l'on battait de l'orge ou l'on cuisait le pain ; là des femmes assises peignaient leurs chevelures ; des cages d'oiseaux étaient empilées sur les dalles ; du vin se répandait en flaques rouge sombre ; ailleurs traînait l'odeur du cuir, des harnais, des aulx suspendus ; derrière une porte, des hommes assis buvaient, crachaient, jetaient les dés — Flush entrait, ressortait, toujours trottant, le nez filant à ras de terre pour humer les essences, ou dressé haut dans l'air où maint arôme palpitait. S'endormait-il dans une chaude tache de soleil ? Quel fumet le soleil peut faire exhaler à la pierre ! Se glissait-il le long d'un tunnel d'ombre ? De quelle acidité l'ombre imprégnait les dalles ! Flush dévorait des grappes entières de raisins mûrs, surtout à cause de leur odeur pourpre ; il mâchonnait puis recrachait les reliefs de chèvre et de macaronis qu'une ménagère italienne avait jetés de son balcon — chèvre et macaronis sont des odeurs rauques, des odeurs cramoisies. Il suivait la douceur défaillante des bouffées d'encens dans l'entrelacs violet des sombres cathédrales ; et, reniflant, tentait de laper au passage l'or répandu par un vitrail. […] La pierre usée des grises draperies, les doigts, les orteils des statues reçurent bien souvent la caresse de sa langue, le frôlement de ses narines trémulantes. Sur les coussinets infiniment sensibles de ses pattes s'imprimèrent d'orgueilleuses inscriptions latines. Bref, il connut Florence comme nul être humain ne l'a jamais connue.
Chapitre V : L'Italie.
Chapitre V : L'Italie.
Mais vendre Flush était inconcevable. Il appartenait à cette catégorie si précieuse de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. N'appartenait-il pas à cette catégorie de choses plus précieuses encore qui, parce qu'elles incarnent ce qui relève de l'esprit, ce qui n'a pas de prix, deviennent un symbole idéal du désintéressement de l'amitié ; qui peuvent être offertes dans ce même esprit à une amie - si on a la chance d'en avoir une - , qui est plus une fille qu'une amie ; à une amie qui gît coupée du monde durant les longs mois d'été, dans une chambre sombre de Wimpole Street, à une amie qui n'est autre que la plus importante poétesse anglaise, la géniale, la malheureuse, la bien-aimée Elizabeth Barrett ? Telles étaient les pensées qui venaient de plus en plus souvent à l'esprit de Miss Mitford, lorsqu'elle regardait Flush faire des acrobaties et gambader au soleil ; lorsqu'elle était assise au côté de Miss Barrett dans sa chambre londonienne aux fenêtres obscurcies par le lierre. Oui, Flush était digne de Miss Barret ; Miss Barrett était digne de Flush. Le sacrifice était grand ; mais le sacrifice devait être accompli.
Où Mrs. Browning voyait, Flush sentait ; il flairait quand elle eût écrit.
Ici le biographe se doit d'arrêter son récit. Deux ou trois mille mots se montrent impuissants à traduire ce que voient nos yeux : ainsi Mrs. Browning dut s'avouer battue par les Apennins. « Je ne puis vous en donner la moindre idée », admit-elle. Or nous n'avons guère que deux mots et demi pour désigner ce que sent notre nez. L'odorat humain est pratiquement inexistant. Les plus grands poètes du monde n'ont connu que le parfum des roses et la puanteur des bouses. Entre ces deux extrêmes, un infini de gradations demeure informulé. C'est pourtant dans ce monde des odeurs que Flush vivait le plus ordinairement. L'amour pour lui était surtout odeur ; odeur la couleur et la forme ; odeur la musique et l'architecture, le droit, la politique, les sciences — et la religion même. Traduire sa plus simple expérience — côtelette ou biscuit quotidiens — dépasse nos possibilités. Mr. Swinburne lui-même n'aurait pu dire ce que signifiait pour Flush l'odeur de Wimpole Street par un chaud après-midi de juin. Quant à décrire l'odeur d'une épagneule, mêlée à celle des torches, des lauriers, de l'encens, des drapeaux, des bougies de cire et d'une guirlande de roses écrasée par un talon de satin qui a longtemps macéré dans le camphre — Shakespeare seul, peut-être, s'interrompant d'écrire Antoine et Cléopâtre… Mais Shakespeare ne s'est pas interrompu. Confessant donc notre impuissance, nous noterons seulement que l'Italie apparut à Flush au cours de ces années qui furent les plus riches, les plus libres et les plus heureuses de sa vie, surtout comme une succession d'odeurs.
Chapitre V : L'Italie.
Ici le biographe se doit d'arrêter son récit. Deux ou trois mille mots se montrent impuissants à traduire ce que voient nos yeux : ainsi Mrs. Browning dut s'avouer battue par les Apennins. « Je ne puis vous en donner la moindre idée », admit-elle. Or nous n'avons guère que deux mots et demi pour désigner ce que sent notre nez. L'odorat humain est pratiquement inexistant. Les plus grands poètes du monde n'ont connu que le parfum des roses et la puanteur des bouses. Entre ces deux extrêmes, un infini de gradations demeure informulé. C'est pourtant dans ce monde des odeurs que Flush vivait le plus ordinairement. L'amour pour lui était surtout odeur ; odeur la couleur et la forme ; odeur la musique et l'architecture, le droit, la politique, les sciences — et la religion même. Traduire sa plus simple expérience — côtelette ou biscuit quotidiens — dépasse nos possibilités. Mr. Swinburne lui-même n'aurait pu dire ce que signifiait pour Flush l'odeur de Wimpole Street par un chaud après-midi de juin. Quant à décrire l'odeur d'une épagneule, mêlée à celle des torches, des lauriers, de l'encens, des drapeaux, des bougies de cire et d'une guirlande de roses écrasée par un talon de satin qui a longtemps macéré dans le camphre — Shakespeare seul, peut-être, s'interrompant d'écrire Antoine et Cléopâtre… Mais Shakespeare ne s'est pas interrompu. Confessant donc notre impuissance, nous noterons seulement que l'Italie apparut à Flush au cours de ces années qui furent les plus riches, les plus libres et les plus heureuses de sa vie, surtout comme une succession d'odeurs.
Chapitre V : L'Italie.
Videos de Virginia Woolf (84)
Voir plusAjouter une vidéo
Soirée rencontre à l'espace Guerin à Chamonix
autour du livre : Vers l'Everest
de George Mallory
traduit par : Charlie Buffet
enregistré le 24 février 2024
Résumé : Inédits du célébrissime George Mallory, premier disparu de l'Everest.
«Une masse triangulaire incongrue a surgi des profondeurs; son côté se perdait dans les nuages. Très progressivement, nous avons vu apparaître les flancs d'une grande montagne, ses glaciers et ses arêtes, tantôt un éclat, tantôt un autre à travers les échancrures mouvantes, jusqu'à ce que, bien plus haut dans le ciel que ce que l'imagination avait osé suggérer, apparaisse le sommet blanc de l'Everest. C'était comme la création la plus folle d'un rêve.» En 1921, un homme marche vers l'Himalaya, fasciné. Il est le premier Occidental à approcher le plus haut sommet du monde, à le décrire, à le photographier, et à s'élever sur ses pentes. Cet homme, c'est George Mallory. Britannique, dandy, courageux dans l'effort et l'inconfort, il est alpiniste par passion, écrivain et artiste par vocation: «Les alpinistes n'admettent aucune différence sur le plan émotionnel entre l'alpinisme et l'Art. Ils prétendent que quelque chose de sublime est l'essence même de l'alpinisme. Ils peuvent comparer l'appel des cimes à une mélodie merveilleuse, et la comparaison n'est pas ridicule.» Mallory écrivait. Ses textes racontent au plus intime ce que fut l'exploration exaltante de l'Everest jusqu'à ce 8 juin 1924 où il disparut sur les dernières pentes du Toit du monde, qu'il fut peut-être le premier à atteindre. Et où son corps momifié a été découvert le 1er mai 1999. Tous les écrits de George Mallory sont rassemblés pour la première fois dans ces pages: textes de réflexion, récits d'ascension, lettres à sa femme Ruth, jusqu'au dernier message confié à un Sherpa…
Bio de l'auteur : George Mallory, né le 18 juin 1886 en Angleterre, fils d'un pasteur anglican, proche du « groupe de Bloomsburry » (Keynes, Virginia Woolf) pendant ses études, alpiniste élégant (une voie porte son nom à l'aiguille du Midi), disparu à l'Everest le 8 juin 1924.
enregistré le 24 février 2024
Résumé : Inédits du célébrissime George Mallory, premier disparu de l'Everest.
«Une masse triangulaire incongrue a surgi des profondeurs; son côté se perdait dans les nuages. Très progressivement, nous avons vu apparaître les flancs d'une grande montagne, ses glaciers et ses arêtes, tantôt un éclat, tantôt un autre à travers les échancrures mouvantes, jusqu'à ce que, bien plus haut dans le ciel que ce que l'imagination avait osé suggérer, apparaisse le sommet blanc de l'Everest. C'était comme la création la plus folle d'un rêve.» En 1921, un homme marche vers l'Himalaya, fasciné. Il est le premier Occidental à approcher le plus haut sommet du monde, à le décrire, à le photographier, et à s'élever sur ses pentes. Cet homme, c'est George Mallory. Britannique, dandy, courageux dans l'effort et l'inconfort, il est alpiniste par passion, écrivain et artiste par vocation: «Les alpinistes n'admettent aucune différence sur le plan émotionnel entre l'alpinisme et l'Art. Ils prétendent que quelque chose de sublime est l'essence même de l'alpinisme. Ils peuvent comparer l'appel des cimes à une mélodie merveilleuse, et la comparaison n'est pas ridicule.» Mallory écrivait. Ses textes racontent au plus intime ce que fut l'exploration exaltante de l'Everest jusqu'à ce 8 juin 1924 où il disparut sur les dernières pentes du Toit du monde, qu'il fut peut-être le premier à atteindre. Et où son corps momifié a été découvert le 1er mai 1999. Tous les écrits de George Mallory sont rassemblés pour la première fois dans ces pages: textes de réflexion, récits d'ascension, lettres à sa femme Ruth, jusqu'au dernier message confié à un Sherpa…
Bio de l'auteur : George Mallory, né le 18 juin 1886 en Angleterre, fils d'un pasteur anglican, proche du « groupe de Bloomsburry » (Keynes, Virginia Woolf) pendant ses études, alpiniste élégant (une voie porte son nom à l'aiguille du Midi), disparu à l'Everest le 8 juin 1924.
+ Lire la suite
autres livres classés : biographie fictiveVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Virginia Woolf (140)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Virginia Woolf
Virginia Woolf a grandi dans une famille que nous qualifierions de :
classique
monoparentale
recomposée
10 questions
196 lecteurs ont répondu
Thème :
Virginia WoolfCréer un quiz sur ce livre196 lecteurs ont répondu