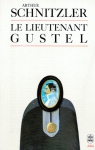Citations de Arthur Schnitzler (316)
Et Béate se disait : N’est-il point effrayant qu’en plein bonheur on puisse parler de la mort en plaisantant et en s’amusant comme si un pareil sort ne menaçait qu’autrui, sans pouvoir vous atteindre vous-même ? Et voici que la mort vient réellement, on ne la comprend pas et on subit pourtant son sort ; le temps poursuit sa course et l’on continue de vivre ; on dort dans le lit que l’on a partagé autrefois avec l’être aimé, on boit dans le verre que ses lèvres ont effleuré, on cueille des fraises à l’ombre des mêmes sapins où on les cueillait avec celui qui jamais plus n’en goûtera : et, somme toute, on n’aura jamais compris entièrement ni la vie ni la mort.
(p. 10)
(p. 10)
Le jardin s’étendait là, sous l’éclat bleuâtre de la nuit étouffante. Nuit chatoyante, nuit bruissante ! Comme les plantes et les arbres dansaient ! Oh, c’était le printemps qui devait lui rendre la santé. Quel air pur ! Quel air pur ! Pouvoir le respirer toujours, et sa guérison était assurée. Mais là-bas, qu’y avait-il là-bas ? Il voyait venir de la grille qui lui paraissait plongée dans un abîme une silhouette féminine auréolée par l’éclat bleuâtre de la lune. Comme elle planait, et ne se rapprochait pas ! « Marie, Marie ! » Et un homme derrière elle, un homme avec Marie, fantastiquement grand. Alors les grilles commencèrent à danser, à les suivre en dansant, et le ciel derrière eux, et tout, tout dansait à leur suite. Du lointain montaient des sons, des accords, des chants, si beaux, si beaux. Et tout devint noir…
(p. 153-154)
(p. 153-154)
Le malade se tourna vers Alfred. « Penses-tu qu’il n’y a pas pour moi d’espoir de guérison ? As-tu voulu me laisser mourir chez moi ? Voilà de la charité mal comprise. Qu’importe le lieu où l’on se meurt ? On est chez soi là où est la vie. Et je ne veux pas, je ne veux pas mourir sans lutter. »
(p. 119)
(p. 119)
Dans la journée, en particulier, quand elle marchait près de lui ou lui faisait la lecture, Félix avait souvent le sentiment qu’il ne lui serait pas pénible de se séparer de cette femme. Elle ne représentait pour lui rien de plus qu’un élément de l’existence. Elle faisait partie de la vie qui l’entourait et qu’il lui fallait bien un jour quitter, elle ne lui appartenait pas en propre. Mais à d’autres moments, particulièrement la nuit, quand elle reposait près de lui, les paupières closes, lourdes d’un profond sommeil, dans la beauté de sa jeunesse, il l’aimait éperdument, et, plus son repos à elle était paisible, plus il l’isolait du monde, plus son âme perdue dans des rêves s’éloignait de lui, de ses souffrances qui le tenaient éveillé, plus il l’aimait follement.
(p. 59)
(p. 59)
Félix dut s’avouer qu’il avait dernièrement joué à Marie une comédie ridicule. S’il avait vraiment eu le désir de lui épargner sa fin proche, le mieux aurait été de disparaître simplement de sa vie. Il se serait déjà trouvé une petite place isolée pour y mourir en paix. (…) Mais quand il commença à réfléchir sérieusement à l’exécution de ce plan, quand, au cours d’une interminable, effroyable nuit blanche, il en envisagea les détails : partir le lendemain au petit jour sans dire adieu, partir pour la solitude et la mort prochaine en laissant Marie à une vie ensoleillée, riante, une vie perdue pour lui, il ressentit alors toute son impuissance, comprit qu’il ne le pouvait pas, qu’il ne le pourrait jamais.
(p. 57)
(p. 57)
« Félix ! » Des deux bras elle l’arrêta dans sa marche. Il se dégagea.
« La période la plus pitoyable commence. Jusqu’à présent j’étais le malade intéressant, un peu pâle, un peu poitrinaire, un peu mélancolique. Dans une certaine mesure cela peut encore plaire à une femme. Mais ce qui doit venir maintenant, mon enfant, je préfère te l’épargner. Cela empoisonnerait le souvenir que tu garderas de moi. »
(p. 53-54)
« La période la plus pitoyable commence. Jusqu’à présent j’étais le malade intéressant, un peu pâle, un peu poitrinaire, un peu mélancolique. Dans une certaine mesure cela peut encore plaire à une femme. Mais ce qui doit venir maintenant, mon enfant, je préfère te l’épargner. Cela empoisonnerait le souvenir que tu garderas de moi. »
(p. 53-54)
Ce jour-là, Félix s’enhardit à fumer un cigare tout en observant, par-delà la nappe ondoyante de l’eau, les rochers aux sommets baignés par la lueur jaune d’un soleil déclinant.
« Dis, Marion, commença-t-il, as-tu le courage de regarder là-haut ?
– Où cela ? »
Il désigna du doigt le ciel. « Là, tout droit dans la profondeur bleue. Moi, je ne peux pas. Cela m’impressionne. »
Elle leva les yeux, demeura quelques secondes à fixer le ciel.
« Pour moi, c’est plutôt agréable.
– Vraiment ? Quand la lumière est comme aujourd’hui si intense, je n’y arrive pas. Cette distance, cette distance effroyable ! Quand il y a des nuages, je suis plus à mon aise, les nuages font partie de notre monde, ils sont de la famille. »
(p. 31-32)
« Dis, Marion, commença-t-il, as-tu le courage de regarder là-haut ?
– Où cela ? »
Il désigna du doigt le ciel. « Là, tout droit dans la profondeur bleue. Moi, je ne peux pas. Cela m’impressionne. »
Elle leva les yeux, demeura quelques secondes à fixer le ciel.
« Pour moi, c’est plutôt agréable.
– Vraiment ? Quand la lumière est comme aujourd’hui si intense, je n’y arrive pas. Cette distance, cette distance effroyable ! Quand il y a des nuages, je suis plus à mon aise, les nuages font partie de notre monde, ils sont de la famille. »
(p. 31-32)
Tout d’un coup, son existence n’avait plus aucun sens. Il descendit dans la rue sans savoir ce qu’il allait faire, ni où se diriger. Il détestait tout le monde, il détestait la ville et l’univers entier, y compris sa profession, puisqu’en définitive, elle ne lui avait servi qu’à donner la mort à cet être charmant qui semblait destiné à lui prodiguer, dans son âge mûr, l’éblouissement d’un dernier bonheur. Quelle perspective s’offrait encore à lui ici-bas ? Il avait les moyens de renoncer à sa profession, s’il en avait envie, et de ne plus échanger un seul mot avec qui que ce soit. Voilà en quoi consistait son unique consolation, le seul profit que lui ait procuré son existence entière.
("Docteur Graesler", p. 244-245)
("Docteur Graesler", p. 244-245)
Ses paroles se précipitaient, s’embrouillaient, et il savait bien qu’il ne trouvait pas, qu’il ne pouvait pas trouver celles qui l’auraient sauvé, car, entre ses lèvres et le cœur de Sabine, une barrière infranchissable s’était dressée.
("Docteur Graesler", p. 234)
("Docteur Graesler", p. 234)
Il plia la feuille. Par moments il avait senti ses yeux se mouiller tout en écrivant. Il s’était attendri sur lui-même et sur Sabine. Maintenant qu’une décision provisoire était prise, il cacheta sa lettre, l’œil sec, sans la moindre émotion, et la tendit au cocher qui devait la déposer au chalet. (…) Il se mit alors à préparer son départ brusqué. (…) Puis, quand il songea que Sabine avait sa lettre entre les mains, il éprouva une douleur physique au cœur et il se mit à attendre le retour de la voiture, peut-être avec une réponse, ou avec Sabine elle-même qui aurait décidé de venir chercher ce fiancé indécis. (…) Elle ne vint pas, elle n’envoya pas de lettre et Graesler ne revit la voiture que beaucoup plus tard, au crépuscule. (…) Graesler dormit mal, d’un sommeil agité, et le matin, grelottant et morose, il partit pour la gare tandis qu’une pluie aiguë fouettait la capote de sa voiture.
("Docteur Graesler", p. 179)
("Docteur Graesler", p. 179)
Elle ne savait rien de lui, c’était la pierre d’achoppement et, sous l’angle de cette incompréhension, il aperçut son existence entière dans un éclairage nouveau. Il se rendait compte que jamais personne ne l’avait compris, ni homme ni femme. Ses parents ne l’avaient pas compris, sa sœur non plus, pas plus que ses confrères ou ses malades. Sa réserve était taxée de froideur, son amour de l’ordre, de manie, sa gravité, de sécheresse. Ainsi, depuis toujours, la solitude était-elle son lot parce qu’il manquait d’entrain et de brio. Tel il était et ne pouvait changer, et, en plus, bien plus âgé que Sabine ! Voilà pourquoi il n’avait pas le droit d’accepter le bonheur qu’elle était prête à lui offrir, ou se croyait prête à lui apporter, alors que ce bonheur était peut-être illusoire.
("Docteur Graesler", p. 177)
("Docteur Graesler", p. 177)
Robert, sans avoir vraiment pris conscience de son acte, en pressentait néanmoins l’irrémédiable atrocité. (…) Il traversa la place du marché, emprunta la longue rue du village et gagna la campagne. Là, ses pas s’enfonçaient dans la neige épaisse. Il jeta son manteau qui entravait sa course démente et alla plus loin, plus loin encore. Il n’avait qu’une volonté ferme : ne jamais reprendre conscience, fuir toujours, plus loin, fuir à travers la nuit bleue, la nuit qui chantait, à travers la nuit qui pour lui ne finirait jamais. Et il savait qu’il avait déjà parcouru mille fois ce chemin, qu’il le parcourrait encore mille fois, cent mille fois, éternellement, à travers une infinité de nuits mélodieuses et bleues.
("L’appel des ténèbres", p. 131-132)
("L’appel des ténèbres", p. 131-132)
Robert (…) monta dans sa chambre, il était minuit passé, il se coucha tout habillé sur son lit pour prendre un peu de repos mais n’éteignit pas la lumière et fixa la fenêtre en face de lui. Elle ne s’ouvrait que sur le ciel obscur où se profilait la cime d’un pic. Au-dessus une étoile scintillait. L’horloge du clocher sonna minuit et demi : les sons se propagèrent dans le silence et se perdirent comme si la nuit se fût refusée à les rendre, puis ils vibrèrent à nouveau, se décuplèrent pour se muer en un jeu d’orgue assourdissant.
("L’appel des ténèbres", p. 129)
("L’appel des ténèbres", p. 129)
Le chef de gare passa et le salua avec courtoisie. D’un point qu’il ne put déterminer, Robert entendit le chant des fils télégraphiques. Les rochers bleus pointaient dans la nuit. « Quelle paix ! pensa-t-il. Si tout allait s’arranger ? Otto ne pourrait-il pas guérir dans ce calme ? Il faut qu’il guérisse, il le faut. Comment pourrais-je jouir de la vie, respirer, s’il ne recouvrait pas la santé ? » Et il comprit qu’il n’aimait personne au monde autant qu’Otto. Une fois de plus, il sentit qu’il n’existait aucune autre relation, aussi intense, aussi stable par nature que celle de frère à frère. Ce qu’il ressentait pour Otto, chevillé aux fibres les plus profondes de son âme, était plus fort que l’amour paternel et filial, plus grand que ne pouvait l’être l’amour pour une femme. Et il résolut de maîtriser le destin qui menaçait de détruire ce lien si mystérieux et si puissant entre deux êtres humains.
("L’appel des ténèbres", p. 126)
("L’appel des ténèbres", p. 126)
Sans quitter sa pelisse, Robert s’assit dans le fauteuil de cuir noir à large dossier poussé contre le lit. (…) Quand on lui eut apporté du papier, il s’installa à la table et écrivit. (…) Sa plume courut pendant deux heures. En guise de conclusion provisoire, il nota : « Impression de responsabilité dans les idées délirantes de mon frère. Lui et moi : deux incarnations de la même idée divine ? L’un de nous devait sombrer dans les ténèbres. C’est lui que le sort a désigné, bien que la balance penchât d’abord de mon côté. » Il enferma ce texte dans son sac de voyage et sortit prendre l’air.
("L’appel des ténèbres", p. 125)
("L’appel des ténèbres", p. 125)
L’heure des explications avait sonné ; il devait parler de cette lettre à Otto – de cette lettre et de tant d’autres choses… de tout ce qui, profond et mystérieux, s’était noué entre eux depuis la prime enfance peut-être, de ce jeu ambigu de compréhension et d’incompréhension, de fraternité et d’étrangeté, d’amour et de haine ; tout cela devait être élucidé enfin. Il n’était pas trop tard. Robert tenait encore entre ses mains son existence. Otto, également, mais pour lui le moment était venu de se décider entre la santé et la maladie, la lucidité et la confusion, la vie et la mort. Robert, lui, avait pris son parti ; son esprit était clair, son âme sauvée. Une fois encore, la dernière, l’occasion de choisir était donnée à Otto.
("L’appel des ténèbres", p. 107-108)
("L’appel des ténèbres", p. 107-108)
La prudence s’imposait, Robert devait être sur ses gardes, mais la lutte n’était pas vaine. Personne encore n’osait affirmer qu’il avait l’esprit dérangé, personne n’y croyait à l’heure présente, à moins qu’Otto, lui, n’en soit déjà là. Si les autres, même des médecins, n’avaient pas dépisté les troubles mentaux d’Otto – qui étaient sérieux bien qu’ils n’en soient pas au stade du délire – Robert, lui, voyait clair et il était le seul, il avait le droit et même le devoir d’avertir l’entourage du danger. Il ne s’agissait pas seulement de légitime défense, mais aussi de l’intérêt d’Otto. Certes, il fallait être vigilant et puisque Otto avait cherché des alliés, Robert était fondé à en faire autant, c’était ce qu’il devait faire.
("L’appel des ténèbres", p. 102)
("L’appel des ténèbres", p. 102)
Que de fois un dément s’acharnant à prouver la folie d’un homme bien portant réussit-il à le faire interner ! Robert se souvenait de maints exemples de cette espèce. (…) Sa vie durant, toutes sortes d’obsessions, de méchants délires l’avaient torturé, surtout depuis la maladie de Höhnburg et non seulement il l’avait avoué à à son frère, mais il l’avait même supplié de le tuer si jamais tout cela s’avérait une atroce réalité. Il le lui avait demandé, il lui avait même délivré un document qui attestait cette obligation d’Otto et mettait sa responsabilité à couvert.
("L’appel des ténèbres", p. 102)
("L’appel des ténèbres", p. 102)
Qu’importait qu’il se fût senti mieux ces temps derniers ? Son entourage ne s’en était pas forcément rendu compte et probablement Otto, en psychiatre sérieux qui savait les nerfs de son frère malades, qui craignait chez celui-ci l’éclosion de la folie, ne cessait-il de l’observer ou de le faire observer. (…) Robert ne devait-il pas chercher en son frère plutôt qu’en lui-même les motifs de cette méfiance croissante ? Constatant chez lui les premiers symptômes de dégradation et repoussant le moment de se l’avouer, le démoniaque Otto n’essayait-il pas de conjurer le sort et de transférer le mal dans l’âme tourmentée de son frère, cette âme qu’il jugeait prédisposée ?
("L’appel des ténèbres", p. 101-102)
("L’appel des ténèbres", p. 101-102)
Une terreur poignante le saisit. À sa paisible conversation avec Alberte avait peut-être succédé une scène violente dont il n’avait pas gardé le souvenir. Peut-être, fou de jalousie, l’avait-il maltraitée… étranglée… puis enfouie sous les feuilles mortes ? Une chose demeurait certaine : il était allé avec elle – dans la forêt – et il était rentré sans elle. (…) Si vraiment, dans un état crépusculaire, il avait commis un crime – et Robert en cette minute osait à peine en douter – de quels stratagèmes, de quelles malices n’eût-il pas été capable pour masquer son forfait ?
("L’appel des ténèbres", p. 63)
("L’appel des ténèbres", p. 63)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Arthur Schnitzler
Lecteurs de Arthur Schnitzler (1919)Voir plus
Quiz
Voir plus
Petit Pays
Comment s'appelle le père de Gabriel ?
Martin
Mathieu
Michel
Mohammed
50 questions
2489 lecteurs ont répondu
Thème : Petit pays de
Gaël FayeCréer un quiz sur cet auteur2489 lecteurs ont répondu