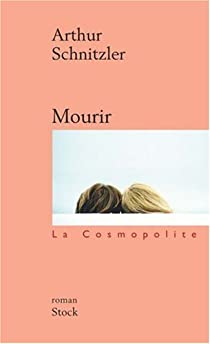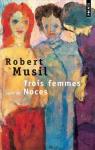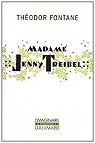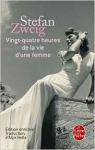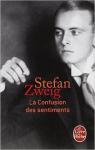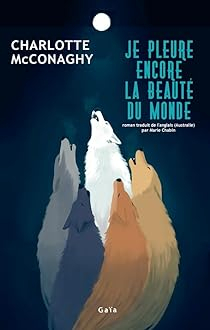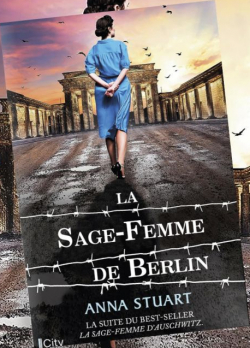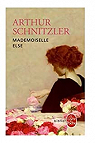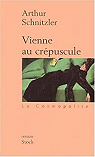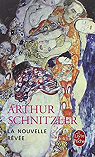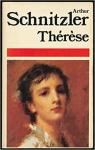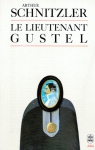Arthur Schnitzler
Robert Dumont (Traducteur)/5 68 notes
Robert Dumont (Traducteur)/5 68 notes
Résumé :
Félix et Marie forment un jeune couple à qui la vie sourit ... jusqu'à ce qu'ils se retrouvent soudain confrontés à la mort. Félix apprend de la bouche d'un éminent spécialiste que ses jours sont comptés. Il va d'abord s'efforcer de faire bonne figure, se prétendre de taille à affronter en philosophe un destin cruel, tout en souhaitant le bonheur de sa compagne. Bientôt, pourtant, le masque stoïque se fissure. A mesure qu'approche l'issue fatale, Félix ne veut plus ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après MourirVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (9)
Voir plus
Ajouter une critique
Ayant lu un tentant commentaire sur « Mourir » d'Arthur Schnitzler, sans hésitation j'ai cherché le livre, et y vais de ma petite parlotte.
Vienne 1892. Freud le considère son double littéraire. Il connaît aussi Zweig. « Mourir » est sa première oeuvre considérée comme une nouvelle ; il s'agit des sentiments valsés racontés dans le détail d'un couple :
Lui ne parle pas, elle s'inquiète, il avoue : il lui reste un an à vivre. Elle proclame qu'elle ne lui survivra pas, elle ne vivra pas un jour sans lui, d'ailleurs il ne mourra pas, tellement elle l'aime. Sanglots, déni de part et d'autre, car le monde est beau et la mort n'y a pas sa place.
Ils semblent unis, heureux. Pas pour longtemps. Marie plonge tête la première dans la pitié et la surprotection, ce qui agace prodigieusement son amant. Elle essaie de l'aimer moins, ou tout au moins d'avoir l'air plus détaché, plus gai, elle lui cache son désespoir, puisque ce désespoir tape sur les nerfs de Felix. Après tout, c'est lui le malade, pas elle, alors, qu'elle la boucle.
Alors, ils se mentent, malgré leurs efforts réciproques ils se mentent ; elle se sent coupable, on se demande bien de quoi puisqu'elle le soigne amoureusement, elle essaie de ne plus vivre, elle l'entoure de toute son affection, elle se méprise d'admirer le ciel ou d'avoir du plaisir à ouvrir la fenêtre.
Schopenhauer, ainsi que Socrate, sont des menteurs, dit il , tout le monde a peur de la mort. Rageur, égoïste et haineux, il fait payer à cette douce femme prête à se sacrifier pour lui le fait d ‘être condamné.
Et puis il a bien vu comment les autres hommes la regardaient, et elle n'est pas si claire, peut être qu'elle le trompe (sûr qu'elle ferait mieux). Il la soupçonne -son sacrifice est il authentique ?- et puis d'ailleurs il ne l'aime plus. Elle se prépare à l'abandonner. Il la hait….Ben, bien fait, elle commence doucement elle aussi à en avoir marre de ce grand enfant.
Schnizler dans un face à face entre deux êtres séparés sans mots par la maladie, insinue que peut être il n'y a pas d'amour, si l'amour est volonté de rendre l'autre heureux, en restant soi même. L'une protège et se sacrifie, l'autre, indifférent aux attentions qu'il reçoit, en veut toujours plus, et exige qu'elle meure avec lui, et surtout de son plein gré, pareille aux saties hindoues livrées sur le bucher de leur défunt mari.
Les pensées de Marie, hésitante à sortir juste une heure prendre l'air, ses craintes devant le regard inquisiteur de Felix, et la balance qu'elle fait entre son amour pour lui et les dérisoires et périssables distractions du dehors, débouchent sur une impression d'euphorie : être elle même.
Merci à celui ou celle qui a parlé de ce petit bijou de psychologie pure, ces allers retours entre les sentiments de l'un et la réaction de l'autre, dans un vase clos-Vienne- avec échappées dans la montagne et vers la campagne italienne. Un petit bijou.
Vienne 1892. Freud le considère son double littéraire. Il connaît aussi Zweig. « Mourir » est sa première oeuvre considérée comme une nouvelle ; il s'agit des sentiments valsés racontés dans le détail d'un couple :
Lui ne parle pas, elle s'inquiète, il avoue : il lui reste un an à vivre. Elle proclame qu'elle ne lui survivra pas, elle ne vivra pas un jour sans lui, d'ailleurs il ne mourra pas, tellement elle l'aime. Sanglots, déni de part et d'autre, car le monde est beau et la mort n'y a pas sa place.
Ils semblent unis, heureux. Pas pour longtemps. Marie plonge tête la première dans la pitié et la surprotection, ce qui agace prodigieusement son amant. Elle essaie de l'aimer moins, ou tout au moins d'avoir l'air plus détaché, plus gai, elle lui cache son désespoir, puisque ce désespoir tape sur les nerfs de Felix. Après tout, c'est lui le malade, pas elle, alors, qu'elle la boucle.
Alors, ils se mentent, malgré leurs efforts réciproques ils se mentent ; elle se sent coupable, on se demande bien de quoi puisqu'elle le soigne amoureusement, elle essaie de ne plus vivre, elle l'entoure de toute son affection, elle se méprise d'admirer le ciel ou d'avoir du plaisir à ouvrir la fenêtre.
Schopenhauer, ainsi que Socrate, sont des menteurs, dit il , tout le monde a peur de la mort. Rageur, égoïste et haineux, il fait payer à cette douce femme prête à se sacrifier pour lui le fait d ‘être condamné.
Et puis il a bien vu comment les autres hommes la regardaient, et elle n'est pas si claire, peut être qu'elle le trompe (sûr qu'elle ferait mieux). Il la soupçonne -son sacrifice est il authentique ?- et puis d'ailleurs il ne l'aime plus. Elle se prépare à l'abandonner. Il la hait….Ben, bien fait, elle commence doucement elle aussi à en avoir marre de ce grand enfant.
Schnizler dans un face à face entre deux êtres séparés sans mots par la maladie, insinue que peut être il n'y a pas d'amour, si l'amour est volonté de rendre l'autre heureux, en restant soi même. L'une protège et se sacrifie, l'autre, indifférent aux attentions qu'il reçoit, en veut toujours plus, et exige qu'elle meure avec lui, et surtout de son plein gré, pareille aux saties hindoues livrées sur le bucher de leur défunt mari.
Les pensées de Marie, hésitante à sortir juste une heure prendre l'air, ses craintes devant le regard inquisiteur de Felix, et la balance qu'elle fait entre son amour pour lui et les dérisoires et périssables distractions du dehors, débouchent sur une impression d'euphorie : être elle même.
Merci à celui ou celle qui a parlé de ce petit bijou de psychologie pure, ces allers retours entre les sentiments de l'un et la réaction de l'autre, dans un vase clos-Vienne- avec échappées dans la montagne et vers la campagne italienne. Un petit bijou.
Félix et Marie forment donc un jeune couple à qui la vie sourit... Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent soudain confrontés à la mort ! Félix apprend de la bouche d'un éminent spécialiste, que ses jours sont comptés. Marie, qui l'aime "à en mourir" - c'est là que nous réalisons l'impact des mots que nous employons -, accepte de partir avec lui, presque sans hésitation ! Mais au fur et à mesure, la jeune femme regrette sa décision, elle qui aime trop la vie pour se sacrifier, mais qui aime aussi trop Félix pour l'abandonner ! Déchirée par un cruel et impossible dilemme, entre l'amour d'un homme sans lequel elle ne peut vivre et sa propre mort qui lui fera tout perdre, alors qu'elle a toute la vie devant elle, la jeune femme devra choisir...
Avec son roman sobrement intitulé "Mourir", Arthur Schnitzler choisit d'aborder un sujet apparemment simple, mais en réalité complexe et intelligent. La notion d'amour absolu est mis sur le devant de la scène, avec tout ce qu'elle possède de merveilleux, de beau, de magique, mais aussi d'admirable... Jusqu'à quel point ? Un amour qui peut virer au drame, lorsqu'il se termine en sacrifice, au renoncement même de l'existence, au prix de l'amour de notre vie !
En cela, ce roman psychologique fouille les sentiments, émotions et contradictions de l'esprit humain ; à l'instar de Stefan Zweig, camarade autrichien également doué dans cet exercice. Mais c'est aussi un roman philosophique, qui pousse le lecteur à se poser de réelles et brutales questions sur sa propre notion d'amour, de concessions et de sacrifice ; aussi bien que sur le poids et les conséquences de ces promesses qu'on ne peut pas toujours tenir... Un roman redoutablement intelligent, qui a le mérite d'être lu et de marquer les esprits !
Avec son roman sobrement intitulé "Mourir", Arthur Schnitzler choisit d'aborder un sujet apparemment simple, mais en réalité complexe et intelligent. La notion d'amour absolu est mis sur le devant de la scène, avec tout ce qu'elle possède de merveilleux, de beau, de magique, mais aussi d'admirable... Jusqu'à quel point ? Un amour qui peut virer au drame, lorsqu'il se termine en sacrifice, au renoncement même de l'existence, au prix de l'amour de notre vie !
En cela, ce roman psychologique fouille les sentiments, émotions et contradictions de l'esprit humain ; à l'instar de Stefan Zweig, camarade autrichien également doué dans cet exercice. Mais c'est aussi un roman philosophique, qui pousse le lecteur à se poser de réelles et brutales questions sur sa propre notion d'amour, de concessions et de sacrifice ; aussi bien que sur le poids et les conséquences de ces promesses qu'on ne peut pas toujours tenir... Un roman redoutablement intelligent, qui a le mérite d'être lu et de marquer les esprits !
Un roman très court mais très intense.
Il traite du problème d'un homme Félix qui sait qu'il va mourir et de l'évolution des relations au sein du couple qu'il forme avec Marie.
Il nous trace la dégradation physique et mentale de Félix qui ne conçoit accepter la mort que si Marie l'accompagne et montre le dévouement de celle-ci, face à la souffrance de son compagnon.
Une oeuvre superbe par l'étude des caractères mais difficile quant au sujet traité.
Il traite du problème d'un homme Félix qui sait qu'il va mourir et de l'évolution des relations au sein du couple qu'il forme avec Marie.
Il nous trace la dégradation physique et mentale de Félix qui ne conçoit accepter la mort que si Marie l'accompagne et montre le dévouement de celle-ci, face à la souffrance de son compagnon.
Une oeuvre superbe par l'étude des caractères mais difficile quant au sujet traité.
Pas très gai certes mais magnifique. Dans ce très court roman, Arthur Schnitzler se fait explorateur de l'âme humaine. Contemporain et ami de Freud (Viennois tous les deux), il est marqué par ses théories. Comme son jeune "confrère" de vingt ans son cadet, S Zweig, il dissèque l'intimité des êtres.La mort s'immisce dans le quotidien de Félix et Marie un jeune couple à qui tout souriait. Un médecin annonce à Félix (!) qu'il n'a plus qu'un an à vivre. Au départ, il veut affronter l'épreuve avec stoïcisme et sa compagne désespérée lui dit qu'elle ne saurait vivre sans lui et mourra avec lui. Mais peu à peu les masques tombent, la relation évolue. Félix ne peut supporter l'idée de la mort et encore moins l'idée qu'elle ne sera pas collective, que Marie et le monde continueront à vivre sans lui. Il est jaloux de la jeunesse et de la santé de sa compagne et lui rappelle sa promesse. Marie, quant à elle, soigne Félix jour et nuit mais peu à peu la pitié remplace l'amour, elle culpabilise de préférer la vie à Félix et bien sûr elle n'est plus prête à tenir sa promesse.
À chaque récit Schnitzler trouve le moyen d'élargir notre sensibilité. En quelques pages, il sait créer une intensité émotive tout à fait remarquable.
Avec Mourir, on voit une tragédie interne. L'égoïsme du moribond est féroce. C'est un roman réaliste mais foncièrement pessimiste. Cet homme mourant n'est pas celui qu'il était. Comme quoi la mort fait tomber les voiles superficiels de la vie quotidienne. La bonne santé tient secret bien des défauts. Son agonie permet de découvrir sa véritable personnalité et elle est tout sauf attirante.
Avec Mourir, on voit une tragédie interne. L'égoïsme du moribond est féroce. C'est un roman réaliste mais foncièrement pessimiste. Cet homme mourant n'est pas celui qu'il était. Comme quoi la mort fait tomber les voiles superficiels de la vie quotidienne. La bonne santé tient secret bien des défauts. Son agonie permet de découvrir sa véritable personnalité et elle est tout sauf attirante.
Citations et extraits (13)
Voir plus
Ajouter une citation
Félix dut s’avouer qu’il avait dernièrement joué à Marie une comédie ridicule. S’il avait vraiment eu le désir de lui épargner sa fin proche, le mieux aurait été de disparaître simplement de sa vie. Il se serait déjà trouvé une petite place isolée pour y mourir en paix. (…) Mais quand il commença à réfléchir sérieusement à l’exécution de ce plan, quand, au cours d’une interminable, effroyable nuit blanche, il en envisagea les détails : partir le lendemain au petit jour sans dire adieu, partir pour la solitude et la mort prochaine en laissant Marie à une vie ensoleillée, riante, une vie perdue pour lui, il ressentit alors toute son impuissance, comprit qu’il ne le pouvait pas, qu’il ne le pourrait jamais.
(p. 57)
(p. 57)
Le jardin s’étendait là, sous l’éclat bleuâtre de la nuit étouffante. Nuit chatoyante, nuit bruissante ! Comme les plantes et les arbres dansaient ! Oh, c’était le printemps qui devait lui rendre la santé. Quel air pur ! Quel air pur ! Pouvoir le respirer toujours, et sa guérison était assurée. Mais là-bas, qu’y avait-il là-bas ? Il voyait venir de la grille qui lui paraissait plongée dans un abîme une silhouette féminine auréolée par l’éclat bleuâtre de la lune. Comme elle planait, et ne se rapprochait pas ! « Marie, Marie ! » Et un homme derrière elle, un homme avec Marie, fantastiquement grand. Alors les grilles commencèrent à danser, à les suivre en dansant, et le ciel derrière eux, et tout, tout dansait à leur suite. Du lointain montaient des sons, des accords, des chants, si beaux, si beaux. Et tout devint noir…
(p. 153-154)
(p. 153-154)
Dans la journée, en particulier, quand elle marchait près de lui ou lui faisait la lecture, Félix avait souvent le sentiment qu’il ne lui serait pas pénible de se séparer de cette femme. Elle ne représentait pour lui rien de plus qu’un élément de l’existence. Elle faisait partie de la vie qui l’entourait et qu’il lui fallait bien un jour quitter, elle ne lui appartenait pas en propre. Mais à d’autres moments, particulièrement la nuit, quand elle reposait près de lui, les paupières closes, lourdes d’un profond sommeil, dans la beauté de sa jeunesse, il l’aimait éperdument, et, plus son repos à elle était paisible, plus il l’isolait du monde, plus son âme perdue dans des rêves s’éloignait de lui, de ses souffrances qui le tenaient éveillé, plus il l’aimait follement.
(p. 59)
(p. 59)
Ce jour-là, Félix s’enhardit à fumer un cigare tout en observant, par-delà la nappe ondoyante de l’eau, les rochers aux sommets baignés par la lueur jaune d’un soleil déclinant.
« Dis, Marion, commença-t-il, as-tu le courage de regarder là-haut ?
– Où cela ? »
Il désigna du doigt le ciel. « Là, tout droit dans la profondeur bleue. Moi, je ne peux pas. Cela m’impressionne. »
Elle leva les yeux, demeura quelques secondes à fixer le ciel.
« Pour moi, c’est plutôt agréable.
– Vraiment ? Quand la lumière est comme aujourd’hui si intense, je n’y arrive pas. Cette distance, cette distance effroyable ! Quand il y a des nuages, je suis plus à mon aise, les nuages font partie de notre monde, ils sont de la famille. »
(p. 31-32)
« Dis, Marion, commença-t-il, as-tu le courage de regarder là-haut ?
– Où cela ? »
Il désigna du doigt le ciel. « Là, tout droit dans la profondeur bleue. Moi, je ne peux pas. Cela m’impressionne. »
Elle leva les yeux, demeura quelques secondes à fixer le ciel.
« Pour moi, c’est plutôt agréable.
– Vraiment ? Quand la lumière est comme aujourd’hui si intense, je n’y arrive pas. Cette distance, cette distance effroyable ! Quand il y a des nuages, je suis plus à mon aise, les nuages font partie de notre monde, ils sont de la famille. »
(p. 31-32)
Le malade se tourna vers Alfred. « Penses-tu qu’il n’y a pas pour moi d’espoir de guérison ? As-tu voulu me laisser mourir chez moi ? Voilà de la charité mal comprise. Qu’importe le lieu où l’on se meurt ? On est chez soi là où est la vie. Et je ne veux pas, je ne veux pas mourir sans lutter. »
(p. 119)
(p. 119)
Videos de Arthur Schnitzler (8)
Voir plusAjouter une vidéo
Le grand roman d'Arthur Schnitzler mis en images par Manuele Fior, ce sera en janvier 2023. Quand, pour sauver son père de la ruine, une jeune femme convoitée sollicite l'aide d'un ami de la famille, celui-ci exige une faveur : voir Else nue pendant un quart d'heure. Cédera-t-elle ?
Dans une ambiance crépusculaire, Manuele Fior livre une interprétation magistrale de l'oeuvre du Viennois Schnitzler. Il convoque les grands artistes de l'époque et c'est somptueux.
Dans la catégorie :
Romans, contes, nouvellesVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature des langues germaniques. Allemand>Romans, contes, nouvelles (879)
autres livres classés : littérature autrichienneVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Liste Otto.
moravia
54 livres
Autres livres de Arthur Schnitzler (52)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz: l'Allemagne et la Littérature
Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?
Hoffmann
Gordon
Grimm
Marx
10 questions
415 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature allemande
, guerre mondiale
, allemagneCréer un quiz sur ce livre415 lecteurs ont répondu