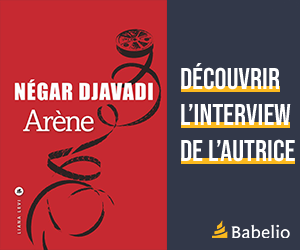Né(e) à : Iran , 1969
Négar Djavadi est une scénariste, réalisatrice et écrivaine.
Elle suit sa scolarité au lycée français de Téhéran. Sa famille fait partie des opposants au régime du Shah puis de l'ayatollah Khomeini. À l'âge de 11 ans, elle fuit l'Iran et la révolution islamique avec sa mère et ses deux sœurs en traversant les montagnes du Kurdistan à cheval. Elles s'installent à Paris.
Négar Djavadi suit des études de cinéma à l'INSAS de Bruxelles dont elle est diplômée en 1994. Elle se consacre au cinéma, qu'elle enseigne de 1996 à 2000 à l'Université Paris 8. Elle est scénariste, monteuse et réalisatrice. Elle a réalisé quatre courts-métrages, sélectionnés dans de nombreux festivals.
En 2016, elle publie son premier roman "Désorientale" qui rencontre rapidement le succès. Négar Djavadi reçoit pour ce roman de nombreux prix dont le Prix du Style 2016 et le Prix du Roman-News 2017.
Elle vit et travaille à Paris.
Ajouter des informations
Entretien avec Négar Djavadi à propos de son ouvrage Désorientale
30/09/2016Désorientale est le récit à la première personne de la vie de Kimîa, Iranienne exilée à Paris à l’âge de 11 ans et celle de sa famille. Ce roman est-il une autobiographie ? Comment est-il né ? À partir de quoi l’avez-vous écrit ?
Ce roman n’est pas autobiographique dans la mesure où il ne s’agit pas d’un témoignage. De plus, le récit commence par ce que la narratrice, Kimiâ, appelle « l’événement » autrement dit l’assassinat de son père, Darius, ce qui ne m’est pas arrivé. Le roman est placé sous le signe de cet événement tragique qui a façonné la vie de Kimiâ, la conduisant là où elle en est aujourd’hui. Cependant, comme elle, je suis née en Iran, fille d’opposants politiques à la fois au régime du Shah et à celui de Khomeiny. J’ai ainsi vécu la révolution iranienne aux premières loges et j’ai quitté l’Iran clandestinement par les montagnes du Kurdistan. Cette partie du roman empreinte beaucoup à mon vécu.
L’idée du roman est née de mon envie d’écrire une saga familiale avec des personnages dont le destin allait être dévié par l’Histoire. En l’occurrence l’Histoire contemporaine de l’Iran, un pays incroyable et très paradoxal et qui étrangement – bien que très souvent dans l’actualité – reste méconnu.
Le roman n’est pas écrit de façon chronologique ; le lecteur suit l’héroïne au gré de ses souvenirs et digressions. Pourquoi cette narration ?
Avant tout, il s’agit d’un roman à la fois de la mémoire, à la fois sur la mémoire. C’est une plongée dans l’Iran de mon enfance, celui de mes souvenirs. Et le chemin de la mémoire, me semble-t-il, n’est pas chronologique. Les anecdotes conduisent à d’autres anecdotes, les détails renvoient à des récits qu’on avait effacés, des personnages apparaissent au premier plan sortis du brouillard de l’oubli. L’écriture non linéaire était un moyen de mettre en lumière ce chemin et de mettre le thème de la mémoire en avant.
La famille de la narratrice joue un rôle fondamental dans le roman ; vous dédiez même la première partie du livre à l’histoire de ses ancêtres. Pourquoi cette place de choix ? Votre héritage culturel familial joue-t-il un rôle important dans votre personnalité aujourd’hui ?
Revenir en arrière et parler des ancêtres me permettaient de montrer une image de l’Iran que peu d’Occidentaux connaissent. Montrer comment ce pays est passé de la féodalité à la modernité, de la modernité à un régime islamique. Montrer aussi les étapes qui ont conduit à la révolution de 1979, une révolution dont les racines remontent à très loin.
Je ne sais pas si cet héritage culturel joue un rôle important dans ma personnalité aujourd’hui, sans doute d’ailleurs, mais je sais qu’il est à l’origine de mon regard sur le monde et sur les événements qui le secouent.
Le regard que porte votre narratrice sur la France est assez noir et elle oppose souvent l’indifférence des Français à la convivialité de son pays d’origine. Est-ce votre vision des choses ? Qu’en est-il de l’Iran d’aujourd’hui comparé à celui de votre enfance ?
Kimiâ ne porte pas à proprement parler un regard noir sur la société française et si elle oppose l’indifférence des Français à la convivialité des Iraniens, elle oppose aussi la franchise des uns à l’hypocrisie des autres. Elle parle de la France comme d’un pays dont les avancées sociales permettent de s’affranchir de l’autre, ne pas être obligé de compter uniquement sur ses voisins ou sa famille pour résoudre des problèmes du quotidien, mais pouvoir aussi compter sur un système social qui soulage l’individu et prend en compte ses difficultés. Il y a une face claire et une face sombre dans les deux cultures, comme dans toute culture.
Je ne peux pas parler de l’Iran d’aujourd’hui que je ne connais pas. La façon dont ma famille et moi avons quitté ce pays, et l’opposition de mes parents au régime, ne me permets pas d’y retourner. Mais, une chose est sûre c’est que dans l’Iran de mon enfance, les femmes n’avaient pas l’obligation de porter le voile et la religion ne pénétrait pas dans l’intimité des gens à travers des lois répressives. En Iran, le voile n’est pas culturel contrairement à ce que l’on pense ; il a été imposé aux femmes après 1979.
Vous évoquez également la question de l’homosexualité et de la procréation assistée. La maternité apparaît par ailleurs comme l’un des seuls remèdes à la condition de vos personnages. Est-ce l’un de vos combats ?
Le thème de la maternité traverse le livre. À travers la maternité, je voulais montrer l’évolution des femmes au sein d’une même famille. De l’arrière-grand-mère qui meurt en mettant au monde des jumelles sans que personne ne sache qui elle était, ni comment elle s’appelait, à Kimiâ qui, plus d’un siècle plus tard, patiente à Paris dans cette salle d’attente.
J’ai commencé à écrire ce livre avant les débats sur la PMA. Il ne s’agit pas d’un combat, mais d’une réflexion sur un problème qui agite la société dans laquelle je vis.
À travers l’histoire de votre narratrice, vous peignez celle de la révolution iranienne, en prenant soin de démentir les clichés véhiculés par les politiques de l’époque. Dire la vérité était-ce une motivation à l’écriture de ce livre ?
La motivation était plutôt de donner des éléments pour comprendre cette révolution au-delà des raccourcis historiques ou journalistiques. Une révolution est un séisme inimaginable et extrêmement complexe. Elle ne peut être réduite à quelques mois, ni à quelques formules spectaculaires ou quelques figures emblématiques. De plus, cette révolution ne concerne pas seulement les Iraniens, mais aussi les Occidentaux, très présents dans ce pays pendant tout le 20e siècle. Ils ont leur part dans cet événement et dans ceux qui l’ont précédé, comme le coup d’État de 1953, dans la façon dont le destin de ce pays a basculé.
En évoquant les questions d’héritage familial, de culture et de maternité, votre roman questionne la notion d’identité. En quoi cette notion vous a-t-elle particulièrement intéressée ?
Personnellement, je pense que la notion d’identité est souvent abordée de façon dramatique, quand elle n’est pas utilisée pour opposer les uns aux autres. L’identité m’intéresse non en tant que telle, mais dans la mesure où elle modifie le regard que l’on porte sur quelqu’un, elle déclenche des sentiments et des émotions parfois contradictoires. Le regard change quand on dit qu’on est Iranien, ou Syrien, ou Argentin, comme il change quand on dit qu’on est homosexuel ou transsexuel. Je voulais créer un personnage qui peu à peu échappe à ce regard, qui montre à quel point l’histoire qu’elle porte en elle ou ses interrogations quant à la maternité ou au couple sont universelles. Le roman permet de lui donner la parole, de l’écouter raconter et se raconter, sans l’interrompre, sans la questionner, et une fois arrivé à la dernière page j’espère constater que malgré ses différences, elle est terriblement familière.
Désorientale est votre premier roman. Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l’écriture ? Avez-vous d’autres projets ?
Je suis scénariste, l’écriture est mon quotidien. Mais cette histoire-là ne pouvait pas se raconter autrement que sous forme de roman, à cause de la liberté que le roman permet. J’ai des projets audiovisuels, certains en développement dans les chaînes, d’autres au stade de l’écriture. Et bien sûr, je pense à un autre roman.
Négar Djavadi et ses lectures
Quel est le livre ou la bande dessinée qui vous a donné envie d`écrire/de dessiner ?
Tous les livres que je lis ou les films que je regarde me donnent envie d’écrire.
Quelle est votre première grande découverte littéraire ?
Fiodor Dostoïevski, et surtout Crime et Châtiment
Quel est le livre ou la bande dessinée que vous avez relu le plus souvent ?
Le livre de l`intranquillité de Fernando Pessoa
Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?
1984 de George Orwell (j’ai vu le film et du coup je ne suis pas allée vers le livre)
Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?
Mon oncle Napoléon de Iradj Pezechkzad (ed. Actes Sud)
Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?
Aucun
Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?
« La vie est un rêve c’est le réveil qui nous tue » dans Orlando de Virginia Woolf
Et en ce moment que lisez-vous ?
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie
Entretien réalisé par Marie-Delphine
Découvrez Désorientale de Négar Djavadi aux éditions Liana Lévi :

L'Historique et le Domestique se fondirent l'un dans l'autre et Darius baissa d'un coup son journal. Il pointa son regard assombri sur Sara.
" Pourquoi tu veux un autre enfant ? Indira Gandhi était fille unique, tu sais ! "
L'attente est un phénomène progressif et sournois, une activité en soi. Et pendant que nous attendons, par nécessité, besoin, désir ou mimétisme, nous ne nous révoltons pas. La ruse consiste à détruire chez les individus leur énergie, leur capacité à réfléchir, à s'opposer. Les réduire à des objectifs instantanés, aussi fugaces qu'une jouissance.
Le malheur pour toute la vie.
(lors d'une interview)
L’étranger, d'Albert Camus
Où Meursault rencontre-t-il Marie Cardona le lendemain de l’enterrement de sa mère ?
1323 lecteurs ont répondu